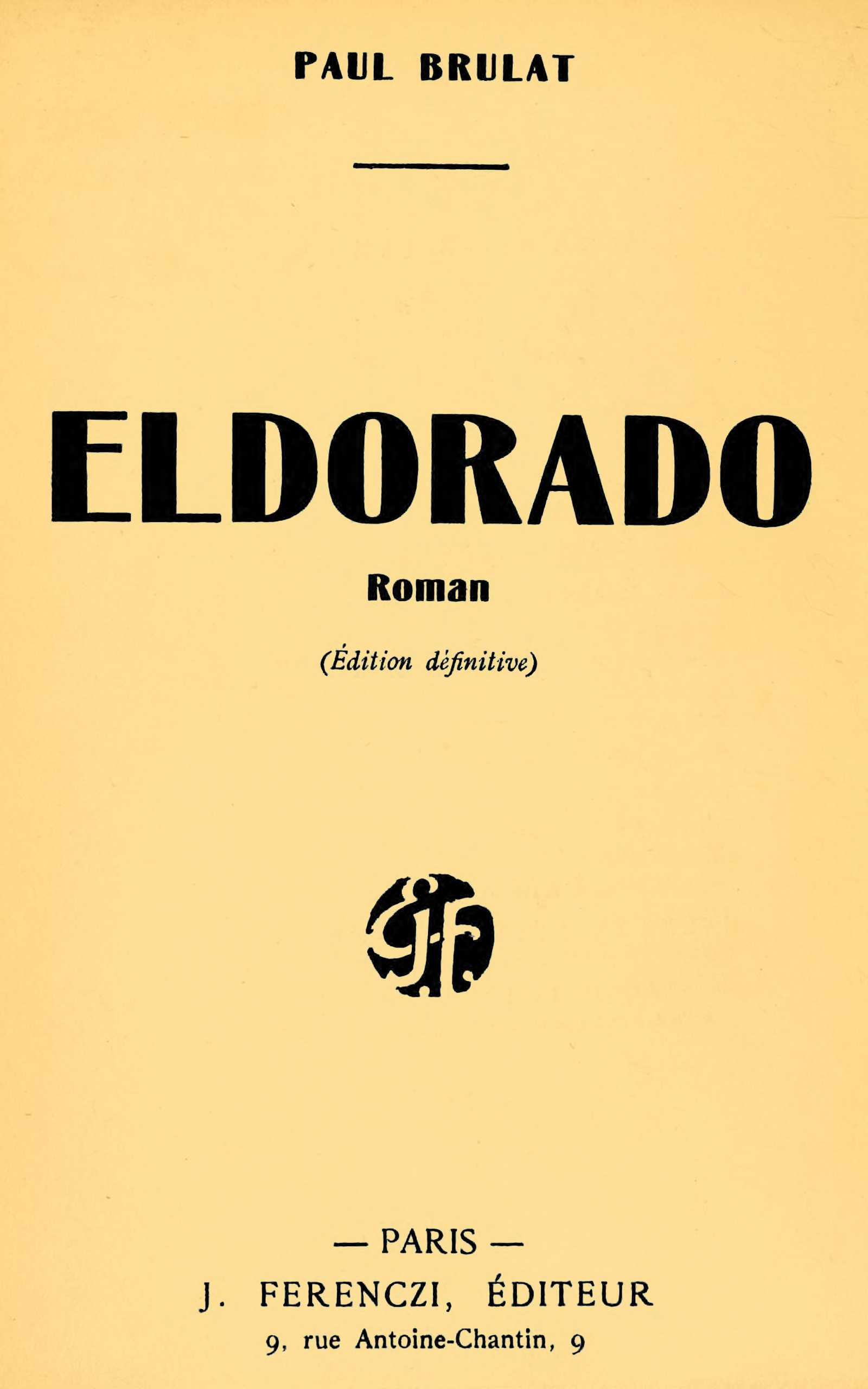
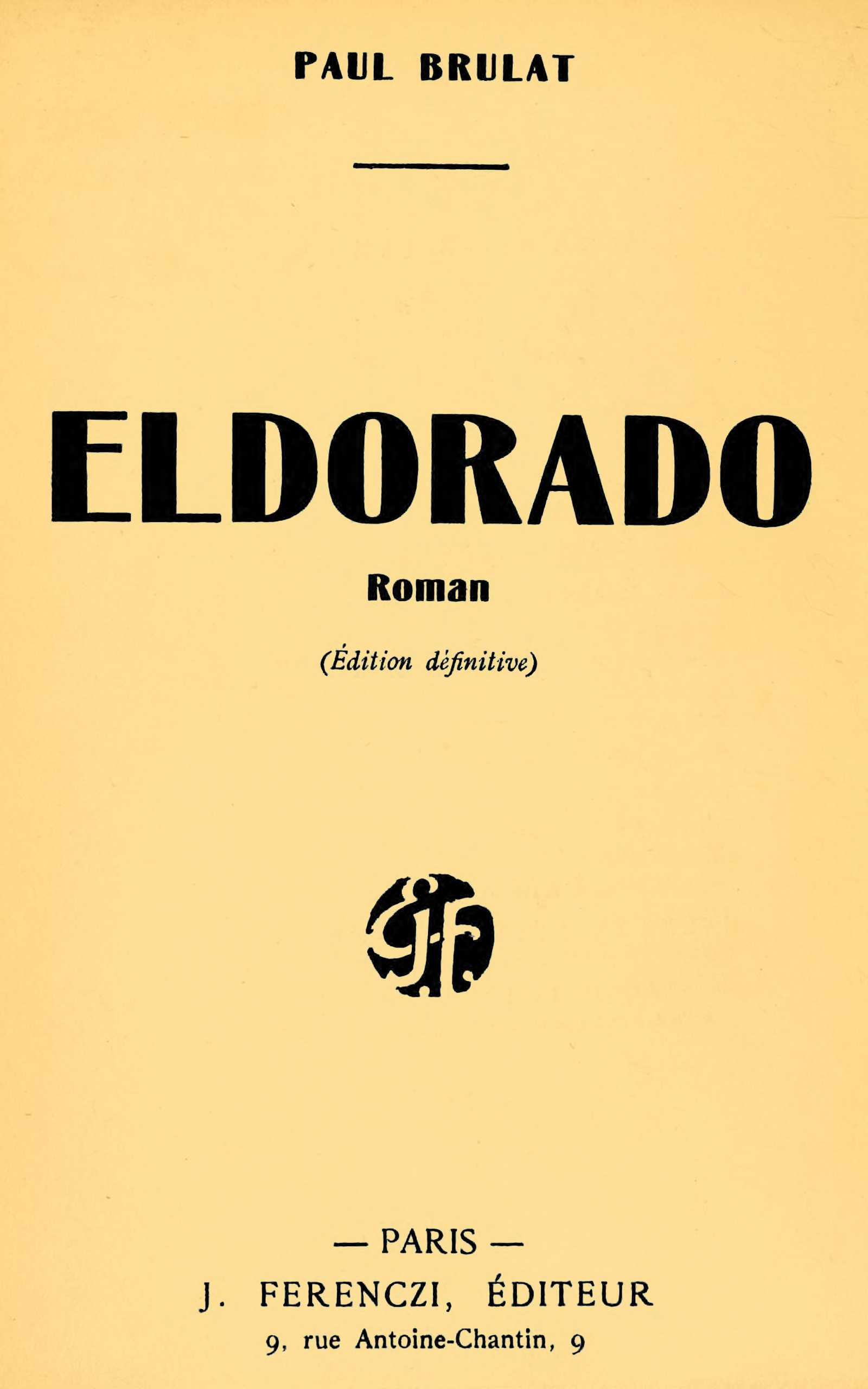
PAUL BRULAT
Roman
— PARIS —
J. FERENCZI, ÉDITEUR
9, rue Antoine-Chantin, 9
Œuvres de Paul Brulat
ROMANS | |
| I. L’Ame Errante | 1 volume |
| II. La Rédemption | — |
| III. L’Ennemie | — |
| I. Le Reporter | — |
| II. La Faiseuse de Gloire | — |
| La Gangue | — |
| L’Eldorado | — |
| L’Aventure de Cabassou | — |
| Rina | — |
| Le Nouveau Candide | — |
| Mirgem | — |
| Sous la Fenêtre | — |
| La Femme et l’Ombre | — |
| La Vie de Rirette | — |
| Les Destinées | — |
POLÉMIQUE | |
| Violence et Raison | 1 volume |
HISTOIRE | |
| Histoire de Jules Ferry | — |
| Histoire de Gambetta | — |
| Histoire d’Émile Zola | — |
| Histoire du Général Hoche | — |
| Histoire de Galliéni | — |
| Pensées | 1 volume |
THÉATRE | |
| La plus belle Victoire | 1 volume |
| A PARAITRE : | |
| L’Étoile de Joseph | 1 volume |
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE :
10 exemplaires sur papier Lafuma,
tous numérotés à la presse
Copyright, J. Ferenczi, 9, Rue Antoine-Chantin, Paris (XIVe) 1921.
Sont réservés tous droits de traduction, d’adaptation, de mise au théâtre et au cinématographe.
Parti de Bordeaux pour Montevideo et Buenos-Ayres, dernière escale de son voyage, l’Eldorado avait gagné la haute mer dans toute la gloire de sa toilette neuve et d’un resplendissant soleil d’août.
C’était un bâtiment superbe, long de cent trente mètres, sur douze de large, jaugeant sept mille tonneaux, réalisant tout le confort et tout le luxe des nouveaux grands transports maritimes qui relient l’Europe et l’Amérique. Élancé et gracieux, malgré sa masse énorme, il glissait sans secousse sur l’Océan uni et placide comme un beau ciel renversé. On était en route depuis quelques heures. Au loin, les côtes de France s’effaçaient dans la pourpre du couchant, qui magnifiait les flots de teintes ardentes.
L’Eldorado emportait cinq cents passagers, un ramassis de dix nations, représentant toutes les classes, toutes les professions, tous les milieux sociaux : une vraie ville flottante, avec son quartier riche et son quartier pauvre, ses boulevards, ses recoins, ses impasses, son faubourg misérable où s’entassait une cargaison grouillante d’émigrants, et ses étables, son abattoir, ses boucheries, toute une organisation compliquée, localisant la splendeur en première classe, l’aisance en seconde, et parquant la détresse en troisième, en une sorte de ghetto, à l’avant du navire.
A l’arrière, sur le pont supérieur, réservé aux passagers de première, la cité commençait à s’animer de ces sentiments confus qui naissent des longs voyages, où l’ivresse du départ, l’imprévu d’une vie nouvelle, se mêlant à la mélancolie du passé qui s’éloigne, rapprochent les âmes, provoquent des effusions, rendent l’homme plus sociable. Des groupes, çà et là, se formaient ; des propos quelconques préludaient aux causeries intimes.
Seuls, deux jeunes hommes, étrangers l’un à l’autre, semblaient se tenir volontairement à l’écart.
L’un se nommait André Laurel. C’était un grand garçon, blond, mince, d’apparence distinguée, avec des yeux à la fois ardents et candides, comme illuminés par le rêve. Il avait vingt ans et les paraissait à peine. La pensée qui le hantait le rajeunissait, car il était à cet âge où la pensée n’est encore que de l’illusion et ne cherche pas à sonder le mystère charitable que la nature a posé comme un voile sur des vérités désolantes. On eût dit qu’il regardait la mer, mais il ne contemplait que le monde idéal et magnifique éclos dans son imagination.
L’autre, Armand Reboul, avait un visage intense qui révélait une agitation profonde : il venait de commettre une grande folie romanesque. La veille, à pareille heure, étant de passage à Bordeaux, il s’apprêtait à reprendre le rapide pour Paris, lorsque, au détour d’une rue, le hasard l’avait soudain mis en présence de Mme Rolande. Il l’avait connue jeune fille, à l’aube du cœur qui s’éveille, et elle avait été sa première passion, la plus vraie, la plus sincère, celle qui ne s’analyse pas… La ravissante jeune fille qu’elle était alors ! Il y avait quinze ans de cela ! Mais combien plus adorable encore la femme qu’il retrouvait dans tout l’éclat de la maturité, belle de cette beauté sereine et définitive, dégagée des fluctuations de la jeunesse ! Leur entrevue n’avait duré qu’un instant ; il avait balbutié des paroles troublantes ; elle l’avait sagement interrompu, tandis que ses paupières, par pudeur, s’abaissaient sur son regard voilé d’un regret inavouable : « Mon ami, il est trop tard, on ne recommence pas sa vie, je suis mariée… Vous ne me reverrez plus jamais, je pars demain pour Buenos-Ayres. » Et elle s’était éloignée sans dire adieu, car, en amour, le seul adieu définitif est celui qu’on ne dit pas. Il l’avait suivie des yeux jusqu’au moment où s’était évanoui, parmi la foule, ce fantôme de bonheur. Et, tout à coup, Armand Reboul était redevenu l’homme qu’il avait été à vingt ans. Sa passion s’était réveillée toute, si exclusive, si impérieuse que, sur-le-champ, il avait pris la résolution de s’embarquer le lendemain pour Buenos-Ayres, de la suivre jusqu’à l’autre bout du monde. Qu’adviendrait-il ? Le sort en déciderait… Ah ! plutôt la souffrance, la souffrance seule, que cette inaction du cœur où il avait langui tant d’années ! Le calme plat de l’existence l’accablait. Dans la quiétude, il sentait se tarir en lui les sources mêmes de la vie. Impulsif, il ne retrouvait sa joie d’être que dans les situations anormales, les crises violentes de la sensibilité. Ainsi, riche, exonéré de tout, il s’était morfondu dans une oisiveté fiévreuse, comme privé de boussole sociale. Et maintenant, lancé à toute volée dans l’inconnu, l’aventure, le romanesque, il était étonné et ravi de ne plus s’ennuyer, en proie à une exaltation qui redoublait en lui toutes les puissances de la vie.
De temps à autre, il tendait vers Mme Rolande un regard furtif, guettant le moment où il pourrait l’aborder et lui parler. Paresseusement étendue dans un rocking-chair, en une attitude de souveraine, elle affectait le calme. Peut-être ignorait-elle encore qu’il fût là. Autour d’elle, on causait.
— Quel temps merveilleux !
— Pourvu que ça dure !
— Ça durera.
— Dieu vous entende !
— Vous verrez qu’on ne s’ennuiera pas à bord.
— Nous organiserons un bal de charité au bénéfice de la Société centrale pour le sauvetage des naufragés… Qu’en dites-vous ?
— Il faut en parler au commandant.
— Il acceptera, c’est un charmant homme, notre commandant.
— Un vieux loup de mer : quarante ans de navigation, et pas un accident dans toute sa carrière. Avec un tel homme, nous sommes en sûreté.
— Savez-vous que nous avons à bord une troupe de comédiens ?
— Et un orchestre de Tziganes.
— Et trois cents émigrants de tous les pays… Il faut aller voir ça à l’avant du bateau. Le spectacle en vaut la peine.
— Enfin, mesdames, ajouta galamment M. Danglar, un diplomate qui venait d’être nommé consul à Montevideo, toutes les distractions vous seront offertes pendant la traversée, y compris même, si vous le désirez, les luttes à mains plates… Parfaitement, nous avons l’honneur de posséder le célèbre Marzouk, le champion français, qui a terrassé tous ses adversaires, l’hiver dernier, au Casino de Paris. J’ai pu le contempler tout à loisir, il n’y a qu’un instant. C’est une brute énorme, effrayante. Il va disputer le championnat du monde à un nègre américain, qui l’a provoqué.
— Je souhaite, pour l’honneur de la France, qu’il soit victorieux, dit un Anglais.
L’impertinence ne fut pas relevée. Un bourgeois grave, d’une dignité parfaite, et qui frisait la cinquantaine, s’approcha de Mme Rolande. On devinait que c’était son mari, à cette ressemblance indéfinissable qu’impriment aux époux de longues années d’une vie commune.
— Qu’avez-vous, ma chère amie ? lui dit-il. Vous êtes pâle, seriez-vous indisposée ?… Pourtant, nous ne bougeons pas plus que sur un lac.
— Je ne suis pas malade, répondit-elle, mais je suis un peu triste… Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on s’expatrie… c’est tout un passé qui s’efface, un pays que nous ne reverrons peut-être jamais… Tout départ sans retour a un goût amer… N’est-ce pas, madame Larderet ? ajouta-t-elle en se tournant à demi vers une voisine.
— Hélas ! soupira celle-ci… Ah ! j’ai mis bien longtemps à me décider à ce long voyage ! Mais il le fallait. Depuis la mort de mon pauvre mari, j’étais trop seule ; je n’avais plus au monde qu’une vieille parente qui habite Buenos-Ayres et que je vais rejoindre.
— Nous, c’est autre chose, déclara Mme Rolande. Mon mari va tenter une exploitation forestière en Amérique… Nous avons éprouvé de tels revers, ces deux dernières années…
— Je sais, dit à voix basse Mme Larderet.
C’était une respectable veuve de quarante ans, onctueuse et décente, offrant l’embonpoint de la bourgeoise parvenue à son plein épanouissement. Son mari avait occupé à Bordeaux une haute situation dans la magistrature. De la considération en rejaillissait encore sur Mme Larderet qui, de plus, était dévote et participait à des œuvres de bienfaisance. A peine quelques personnes, douées d’une fâcheuse mémoire, se souvenaient qu’autrefois, à Paris, elle avait accompli avec éclat des années de service dans le bataillon de Cythère. L’ancien magistrat l’y avait distinguée, et il en avait fait sa maîtresse, puis, par instinct de propriété, sa femme légitime. Dès lors, Mme Larderet, ainsi que les anciennes grues déchues de leur apostolat et définitivement reléguées dans la prostitution exclusive des justes noces, avait donné l’exemple de toutes les vertus bourgeoises : l’ordre, l’économie, la piété, la haine des institutions démocratiques, une intransigeante sévérité pour toutes les faiblesses humaines.
La voix d’un monsieur décoré, aux allures martiales, s’éleva, seule et grave, dans un groupe voisin.
— Eh bien, moi, déclara-t-il, je l’avoue, je pars sans regret, je ne crains pas la nostalgie, et c’est un patriote qui vous parle… Oui, j’en ai assez, on nous a trop changé notre beau pays de France. En quelques années, la démagogie, le prétendu progrès y ont tout détruit, tout saccagé : la morale, la religion, la famille, l’idée de patrie, toutes les saines traditions qui faisaient notre force et notre grandeur… Il n’y a plus rien, plus de respect, plus d’autorité, plus de pudeur. Partout la corruption, la décadence des mœurs, le déchaînement des appétits, la curée. On ne se sentait plus chez soi en France !
Celui qui se dégonflait ainsi le cœur se nommait M. Gallerand, colonel retraité.
— Comme vous dites vrai, monsieur ! approuva Mme Larderet avec un balancement de tête lourd de mélancolie… Une honnête femme, de nos jours, n’osait plus se risquer seule dans la rue. On entendait chuchoter à ses oreilles des propositions obscènes. Si j’avais été mère, j’aurais tremblé pour mes filles.
— Triste époque ! gémit Mme Gallerand… A qui se fier aujourd’hui ? Les honnêtes gens n’ont plus qu’à s’enfermer chez eux.
— On nous a livrés à la voyoucratie et à l’élément étranger, affirma l’ancien colonel.
— On ne sait même plus que lire, reprit Mme Gallerand en fermant un volume qu’elle venait d’achever… Encore un livre affreux ! Quelle littérature, mon Dieu !
Une sainte femme que Mme Gallerand, mère de quatre enfants, une vertu que le plus léger soupçon n’avait jamais effleurée. On la plaignait un peu, car son mari affichait des liaisons coupables. O ironie des choses ! Ceux-là seuls n’étaient point trompés qui auraient mérité de l’être ! Un mot un peu osé faisait rougir Mme Gallerand. On attendait qu’elle ne fût plus là pour placer quelques propos grivois.
Mme Rolande était retombée dans son silence, un silence qui cachait autre chose que la tristesse d’un départ sans retour. Son mari s’approcha.
— Vous ne dites rien ? Quelle pensée vous obsède ? Vous paraissez inquiète.
— En mer, je ne suis jamais bien rassurée, répondit-elle.
— Ayons confiance en Dieu, soupira Mme Larderet. Nous sommes sur une coquille de noix que lui seul va diriger !
— J’ai surtout confiance en notre commandant Lagorce, répliqua M. Rolande… Le voici… Commandant, veuillez rassurer ces dames.
Le commandant se contenta de sourire. La contemplation des lointains horizons avait mis dans son regard comme un songe éternel. Il naviguait depuis l’âge de quinze ans ; il en avait près de soixante. C’était son dernier voyage ; il allait prendre sa retraite, dès son retour en France, et il vivrait heureux, tranquille, à la campagne, avec tous les siens. On lui avait promis la croix ; il l’avait bien méritée, pensait-il, car on n’aurait pu relever contre lui une faute, en plus de quarante ans de navigation, et il avait parcouru toutes les mers, tous les océans. Sa figure de bonhomie souriait à ce rêve serein, si près de la réalité.
— Vous ne regretterez pas un si beau navire, commandant ? insinua le diplomate Danglar.
— Ma foi, je ne dis pas non, peut-être. C’est le plus beau que j’aie commandé, un des meilleurs marcheurs de la compagnie.
— Combien filons-nous ?
— Seize nœuds.
— Pour votre dernier voyage, commandant, la Providence vous gâte ; vous ne pouviez souhaiter un temps plus merveilleux.
— Il est vrai qu’on n’en voit pas souvent de pareil.
Cependant, Mme Larderet s’était penchée vers Mme Rolande, devenue tout à coup très pâle et, à voix basse :
— Connaissez-vous ce jeune homme ? demanda-t-elle.
— Non.
— Comme il vous regarde !
— Vous croyez ?
— J’en suis sûre. Voilà une heure qu’il ne vous quitte pas des yeux. Que vous veut-il donc ?
— Je l’ignore, dit-elle en simulant l’indifférence, tandis qu’Armand Reboul, sentant qu’il était question de lui, disparaissait brusquement.
— Et cette jeune fille ? interrogea de nouveau Mme Larderet.
— C’est la première fois que je la vois.
— Moi aussi… Elle n’était pas de la société.
— Elle est charmante.
— Plutôt curieuse… Mais elle ne me paraît pas avoir beaucoup de santé. Voyez, ses mains sont transparentes.
Elle était pourtant très gaie, la frêle jeune fille, mais d’une gaieté étrange et surprenante. Car son corps mince, comme évaporé sous l’abondance des dentelles, et qu’on soupçonnait à peine, tant elle était chétive, ses grands yeux cernés d’une auréole bleuâtre et rayonnant d’un surnaturel éclat, sa pâleur, tout en elle contrastait singulièrement avec l’ivresse de vivre et le ravissement qu’elle répandait à l’entour. Elle semblait heureuse de ce bonheur inconscient qui flotte comme un rêve intangible par-dessus les réalités. On eût dit que toute la joie de la nature se reflétait dans ses regards, aussi limpides que le ciel de cette radieuse journée d’août. Elle ne pouvait demeurer une seconde en place, papillonnait d’un bout à l’autre du pont. Il émanait de toute sa personne un charme fiévreux et délicat, la grâce d’une tige pliante et cette beauté éphémère des choses que l’on sent destinées à bientôt périr… D’où venait-elle ? On s’interrogeait en vain à son sujet. Sans doute était-elle étrangère. Quelqu’un l’avait vue s’embarquer avec une dame âgée. Le commissaire du bord ne savait d’elle que son nom : Myrrha.
— Et ce songeur ? demanda M. Danglar… C’est un visage qui ne m’est pas inconnu… Où l’ai-je donc rencontré ? Savez-vous qui c’est ?
Il désignait André Laurel qui restait immobile et solitaire, les yeux fixés sur l’horizon, perdus dans les lointains d’un idéal.
— Voilà une bien triste histoire, murmura Mme Larderet, encore un signe des temps !… Ce jeune homme n’est autre que le fils de M. Laurel, notre ancien préfet… Oh ! un gamin qui ne vaut pas cher et qui a fait le désespoir de tous les siens, une famille très honorable. Le père, commandeur de la Légion d’honneur, un digne vieillard vénéré dans tout le département. Et voilà son fils unique qui s’en va, pour échapper au service militaire.
— Un lâche, proféra M. Gallerand.
— Pis encore, un anarchiste, révéla Mme Larderet.
Un frisson parcourut l’assistance.
— Le malheureux ! fit M. Rolande.
— Moi, je plains les parents.
— Ils ne méritaient pas cela.
— Peut-être y a-t-il un peu de leur faute, dit M. Danglar. On récolte généralement ce qu’on a semé.
— Non, non, protesta vivement Mme Larderet… Je connais la famille et je vous affirme qu’elle n’est pas responsable. Le père est aujourd’hui dans les bonnes idées ; Mme Laurel, de son vivant, remplissait ses devoirs religieux. Ils n’ont pu donner de faux principes à leur enfant… Mais, que voulez-vous ! il est de mauvaises natures qu’on ne saurait réduire.
— C’est un grand malheur, dit Mme Gallerand.
— Voilà la conséquence de ces funestes doctrines que répandent, de nos jours, les démagogues, déclara solennellement le diplomate, à qui la République venait de donner de l’avancement.
— Ces gens-là ont fait un grand mal à la France, affirma Mme Larderet.
— Enfin, conclut M. Danglar, ce pauvre garçon veut sans doute convertir à ses théories les nègres d’Amérique, qui ne demandent qu’à croire que tous les hommes sont frères. Laissons cet apôtre à ses illusions.
Il y eut des rires approbateurs. Maintenant, les connaissances étaient faites ; chacun avait déjà repris de l’aisance. Deux Anglais arpentaient le pont à grandes enjambées ; les Méridionaux, étendus sur les bancs, contemplaient l’océan gravement, tandis que les dames continuaient à jacasser, entourées de galants. Çà et là, dans les groupes, on se livrait à des paris sur le temps ou le nombre de milles parcourus par le paquebot. Français, Italiens, Espagnols fraternisaient. Tout faisait prévoir une traversée charmante.
Le jour baissait un peu. Le soleil lassé, noyant comme à regret dans les flots sa pâleur éblouissante, allumait à l’horizon un immense incendie. Un son de cloche annonça le dîner. Au même instant, Marzouk, le célèbre lutteur, le colosse énorme apparut sur le pont des premières. Il était si puissant, si formidable que sa présence souleva une émotion. Des dames s’écartèrent vivement, comme terrorisées. Lui regardait, ébahi, ne comprenant pas. Le commissaire du bord intervint et lui intima l’ordre de se retirer. Marzouk obéit sans répliquer, mais une lueur étrange passa dans ses yeux gris, et ses joues s’empourprèrent, comme s’il eût ressenti profondément l’humiliation.
André Laurel quitta la table avant la fin du dîner, pris d’un malaise au milieu de ces bourgeois graves et vertueux. Personne ne lui avait adressé la parole. Seule, Myrrha l’avait un moment regardé avec compassion. Il devinait qu’on connaissait maintenant son histoire. L’hostilité à son égard était manifeste. Il n’en souffrait pas ; au contraire, il éprouvait une exaltation de sa personnalité à se sentir ainsi frappé d’ostracisme, relégué dans le fier isolement de sa pensée.
Il monta sur le pont. Une rumeur confuse s’élevait par instants. Les bœufs meuglaient. Dans les intervalles de silence, la mélodie gémissante d’un accordéon adoucissait le crépuscule, puis s’éteignait lentement comme une plainte résignée.
Le jeune homme promena un moment ses regards à l’entour, aspirant avec ivresse les senteurs vivifiantes que soufflait le grand large. Un besoin de confier son rêve, de s’épancher dans une sympathie humaine le saisit tout à coup. Il se dirigea vers l’avant du navire où étaient situées les troisièmes classes. A mesure qu’il avançait, les bruits devenaient plus distincts, l’atmosphère bourdonnait comme à l’approche d’une grande cité. Et il s’arrêta soudain devant un spectacle digne d’une éternelle pitié.
Il y avait là des centaines d’émigrants, de tous pays, parlant toutes les langues, mêlant leurs costumes disparates et bariolés. Parias de la civilisation que l’inexorable concurrence, le flot de la misère rejetaient de la vieille Europe et qui trouvaient le courage d’affronter une existence nouvelle, au delà des mers. Des familles entières, groupées autour des paniers de provisions, se serraient pour affermir leur solidarité devant l’inconnu redoutable du lendemain. Des seins flétris, allaitant les derniers nés, attestaient la fécondité lamentable des meurt-de-faim. Les hommes, debout, interrogeaient l’horizon comme pour pénétrer le destin caché là-bas, dans les brumes opaques qu’amassait la nuit tombante. L’inquiétude assombrissait quelques fronts. Mais la plupart étaient gais, enivrés d’une espérance, résolus au suprême effort, la volonté tendue vers le mystérieux lointain. Si noir était le passé que l’incertitude même de l’avenir apparaissait radieuse. Il y avait dans presque tous les regards le rayonnement de l’illusion. Parmi les cris des marmots, éclataient des voix ardentes, des rires joyeux, des chants d’allégresse. Un Italien jouait de l’accordéon ; une jeune Espagnole dansait, resplendissante de beauté, de grâce et de passion… C’était une cacophonie merveilleuse où les sons, les voix, les âmes se confondaient, se soutenaient dans un besoin de fraternité humaine, un formidable salut à l’espérance.
Où allaient tous ces pauvres êtres ? Trouveraient-ils en d’autres mondes une existence moins cruelle ? La plupart ne faisaient que changer leur malheur d’épaule, et c’était là peut-être l’unique cause de tant d’allégresse.
Mais un chant bizarre, qu’il n’avait jamais entendu, un chant dolent, monotone comme l’infini, vague comme la plainte du vent dans le désert, lointain comme la fatalité et qui, plus que tout, exprimait le néant des volontés humaines, la soumission au destin, arrêta l’attention d’André Laurel.
Il se retourna et vit un musulman. Il aurait cru que ce chant venait de très loin, des espaces incommensurables, et le chanteur était là, tout près. C’était ce musulman. Assis, les jambes croisées, dans une immobilité de pierre, il jetait sa complainte lente à l’immensité. Son regard immuable ne voyait rien, ne disait rien, qu’une insouciance dédaigneuse, un détachement universel, l’acceptation passive d’une force secrète et souveraine qui dirigeait le monde vers des fins ignorées et contre laquelle luttait inutilement toute l’énergie des hommes.
Il s’appelait Si-Mohamed ; c’était tout ce qu’on savait de lui. Son silence même révélait son mépris pour tous ces gens qui travaillaient, s’agitaient, s’inquiétaient, ces Européens ambitieux, avides d’argent ou de gloire, et qui faisaient de leur vie une éternelle bataille… Est-ce qu’on ne mourait pas aussi dans leurs pays ? Le grand mouvement d’action qui entraînait le monde civilisé lui semblait aussi vain que les lames de l’océan se brisant contre les rochers et s’envolant en poussière d’eau. Pourquoi tant de hâte et vers quel but ?… Il n’avait, lui, pour répondre à tout, que deux mots : Rabi Gibou, Mektoub. Le premier le dispensait d’agir et de prévoir, le second de rien regretter ; l’un signifiait : Dieu y pourvoira ; l’autre : c’était écrit.
André Laurel, en présence de ce personnage, sentit un moment sa foi chanceler. Celui-là n’était-il pas le seul sage qui ne tentait pas de résister, qui opposait aux événements la sérénité du fataliste ? Que pesaient nos calculs, nos prévisions, auprès de l’immense inconnu ? Le terrible « à quoi bon ? » le traversa comme un frisson, et il s’éloigna en s’efforçant d’arracher de son cœur les premières racines qu’y poussait le scepticisme.
Au milieu d’un groupe, se dressait la stature colossale de Marzouk, le champion des luttes à mains plates. Il racontait d’une voix rageuse comment on l’avait chassé tout à l’heure du salon des premières, où il s’était aventuré sans savoir : et il en décrivait le luxe, la splendeur dorée. Rien n’était trop beau pour les bourgeois. Eux, les émigrants, on les parquait là, comme un troupeau de bétail… Ah ! quand donc les misérables se révolteraient-ils ? Ils étaient les plus nombreux, les plus forts. Ils n’avaient qu’à vouloir, ils s’empareraient du navire, ils seraient les maîtres… Comme on ne l’écoutait pas, il se tut, l’air sombre et farouche d’une brute domptée, prise par les liens de fer d’une formidable organisation sociale.
André Laurel s’en revint lentement. Il était anarchiste aussi, mais d’une autre façon que Marzouk. Les paroles de haine et de vengeance troublaient sa généreuse conception d’un monde selon son cœur, affranchi des vieilles servitudes, des codes, des lois, de toute autorité. Les soupirs du grand large et le remous des flots se brisant contre les flancs du paquebot, adoucissaient sa rêverie naïve, où irradiait, dans les lointains de l’idéal, l’ère de liberté et de fraternité universelle.
L’accordéon, au loin, avait cessé sa mélodie dolente. La nuit maintenant était tout à fait tombée, une de ces nuits ardentes et calmes du mois d’août où la lune apparaît tard. L’Eldorado n’était plus qu’une grande masse d’ombre fuyant dans l’obscurité phosphorescente. Seul, le salon des premières resplendissait.
C’était l’heure du thé. Plusieurs passagers s’étaient déjà retirés dans leurs cabines ; les autres s’attardaient à causer, confortablement assis autour de la longue table. Par un coin de rideau levé, André Laurel se prit à observer ces bourgeois que sa présence scandalisait ; il ne lui parut pas que les émotions du voyage eussent haussé d’un degré le ton de leurs pensées familières. Leurs faces veules exprimaient la satiété, la paresse de vivre, l’ennui d’une existence rance, que traversaient seulement des éclairs de luxure.
Il détourna les yeux et se remit à errer, en proie à cette vague exaltation que soulèvent dans l’âme les soirs de rêve. Il y avait çà et là des coins de silence et de mystère. On n’entendait que le bruit sourd et cadencé de la machine, imprimant au navire une trépidation continue.
Une silhouette fine glissa dans les ténèbres. C’était Myrrha dans une toilette toute blanche. Elle alla s’accouder sur le bastingage, à l’arrière du pont, et demeura là, immobile, fascinée par le sillage d’argent que créait le tournoiement de l’hélice et que des reflets lumineux criblaient de perles d’or. Une autre ombre parut, s’approcha, une voix murmura : « Myrrha, c’est toi ? Je te cherchais partout… Quelle imprudence ! Tu sais bien que le docteur t’a défendu… Ne crains-tu pas de prendre mal ?… Viens, je t’en supplie. — Non, laisse-moi, répondit-elle, je vais très bien, je suis heureuse, il fait si bon, ce soir ! » Il y eut encore des phrases échangées ; puis la vieille parente, lasse d’insister, se retira ; la jeune fille resta seule. André Laurel fut tenté de l’aborder. Quelque chose de mystérieux et de doux l’attirait vers elle, l’intuition d’une pensée proche de la sienne. Mais la crainte d’être indiscret et cette timidité qui naît d’un sentiment plus profond que le désir le retinrent sur place, l’âme soulevée d’une émotion inattendue.
Près de là, un chuchotement doux se percevait à peine. C’étaient Armand Reboul et Mme Rolande qui causaient.
— Malheureux, disait-elle, qu’avez-vous fait ? Oh ! quelle folie ! Que vous me rendez malheureuse !… Ne craignez-vous pas de me perdre ?
— Pardonnez-moi, balbutia-t-il, je vous aime. La vie sans vous m’était si amère !… Ma folie est d’avoir voulu réparer l’injustice du destin qui nous a séparés, quand nous étions faits l’un pour l’autre.
— Il est trop tard, soupira-t-elle. Je ne suis plus libre… Qu’attendez-vous de moi ? Que je trompe mon mari, que je trahisse mes devoirs, que je me jette dans une aventure dont nous ne pouvons prévoir l’issue ?… Non, mon ami, on ne recommence pas la vie, à mon âge, on ne se libère pas ainsi du passé, il nous enchaîne par trop de liens, trop de souvenirs, trop d’obligations.
— Qu’importe, dit Reboul d’une voix ardente, si nous nous aimons ! Qu’importent ces liens, ces devoirs que nous impose un ordre social hypocrite, si nous nous suffisons à nous-mêmes !
— Mon ami, répondit Mme Rolande, êtes-vous sûr que nous serions heureux ? N’avez-vous pas assez vécu déjà pour savoir que l’idéal réalisé est souvent tout près du malheur ? Je ne puis douter de votre sincérité, la preuve que vous m’en donnez est trop grande, mais quand on aime, on n’imagine pas qu’on pourra ne plus aimer, et c’est le caractère de la passion de se croire éternelle… Vous dites que nous étions faits l’un pour l’autre. Supposez que vous m’ayez épousée ; nous aurions aujourd’hui dix ans de ménage, et vous ne me tiendriez pas le même langage. Nous serions peut-être maintenant de bons amis, et ce serait bien beau ; peu de mariages d’inclination finissent aussi bien.
— Comme vous me parlez, murmura-t-il, que vous êtes cruelle, que vous me faites souffrir à votre tour !
— Je vous parle en femme sensée, répondit-elle, et qui voudrait vous épargner dans l’avenir le remords d’une irréparable folie, dont je serais justement châtiée, car j’en aurais été cause. Les erreurs que les hommes nous pardonnent le moins sont celles que nous n’avons pu les empêcher de commettre. Puisque vous êtes les plus forts, il faut bien que nous soyons les plus sages… Ouvrez les yeux, remarquez tous ces couples qui semblent traîner avec lassitude la chaîne qui les unit ; la plupart se sont aimés autrefois, avaient cru qu’ils étaient nés l’un pour l’autre, et ils étaient aussi sincères que vous l’êtes en ce moment ; mais les années ont passé, l’illusion s’est dissoute, l’intimité a séparé ces deux êtres que l’éloignement avait rapprochés, qui croyaient se comprendre parce qu’ils s’ignoraient… Permettez-moi donc, mon ami, de ne pas briser votre avenir. Si vous m’en croyez, vous reviendrez en France par le prochain courrier. Cette traversée ne vous en paraîtra que plus charmante, car il n’est pour l’amour-propre de plus grande satisfaction que d’avoir échappé à une faute. Vous aurez fait un très beau voyage, vous aurez vu des pays nouveaux, et vous m’en garderez un bon souvenir. Puis, vous raconterez plus tard à vos amis une aventure romanesque qui avait pu si mal finir et qui se sera dénouée à la façon d’un aimable vaudeville.
— Si tout le monde raisonnait ainsi, dit Reboul, on fuirait toujours le bonheur, sous prétexte qu’il ne saurait être éternel… Non, ce n’est pas cela qui vous retient, mais tous les vains préjugés sociaux, la peur de l’opinion et le respect d’une morale qui vous rend prisonnière d’un homme que vous n’aimez pas, car, je le sais, vous avez été mariée contre votre gré.
— Et vous voudriez m’affranchir ? dit-elle avec une nuance d’ironie.
— Oui, d’une erreur qu’une loi inhumaine prétend rendre définitive… N’a-t-on pas le droit de se tromper, et ce droit ne comporte-t-il celui de réparer l’erreur, quand elle est reconnue ?
— Mon ami, répliqua Mme Rolande, permettez-moi de ne pas penser comme vous. Je redoute cette liberté que vous envisagez comme le plus précieux des biens. Qui sait quel usage nous en ferions et que de maux en naîtraient ? Ah ! nous regretterions bientôt cette morale surannée et cette servitude qui vous pèsent, car la liberté absolue que vous rêvez engendrerait une servitude pire… Félicitons-nous de ces chaînes que nous sommes impatients de rompre et qui nous libèrent peut-être.
— Moi, dit Reboul, je maudis tous ces liens qui nous empêchent de vivre notre vraie vie. Pourquoi vous rendre esclave du passé ? Il est une morale supérieure aux lois, aux préjugés, c’est celle qui nous commande de saisir le bonheur qui s’offre à nous. Ce serait une affreuse injustice qu’après vous être donnée à un homme que vous n’aimiez pas, vous ne puissiez plus accepter un amour vrai, sincère et profond.
— N’attendez pas de moi, mon ami, répliqua-t-elle, le bonheur que vous vous promettez, il serait de trop courte durée. Je ne suis plus à l’âge où la passion a l’excuse de la jeunesse et de l’ignorance.
— Je vous aime, reprit-il d’une voix frémissante, je n’ai vécu que pour vous. Sans vous, il n’est plus pour moi d’existence acceptable… Je vous adorerai, vous serez mon culte éternel.
— Enfant ! soupira-t-elle, vous me maudiriez bientôt, si j’avais la faiblesse de vous céder. J’ai quelques années de plus que vous, j’ai trop vécu pour partager vos illusions, vos rêves romanesques… Vous cesseriez bien vite de m’aimer !
— Jamais, je vous le jure !
— Les serments d’amour reposent sur du sable… Oubliez-moi, je vous en conjure ! Il est tant d’autres femmes plus jeunes, plus belles et qui sont libres !
— Il n’est pas en mon pouvoir de renoncer à vous.
D’une voix douce, tranquille et comme irrévocable, elle prononça :
— Soyons amis, rien qu’amis. Cela pourra durer toujours, et nous n’aurons jamais ni regret, ni déception, ni remords.
Elle retira sa main qu’il avait prise et qu’il pressait sur ses lèvres. La lune s’était levée, répandant à l’entour une clarté indiscrète. Ils parlaient plus bas, on ne distinguait plus qu’un confus murmure.
André Laurel s’éloigna ; ses pas le ramenèrent à l’avant du navire, dans le quartier des émigrants.
Beaucoup, enveloppés de couvertures, dormaient là, sur le pont, à la belle étoile et à la dure, comme sur un champ de bataille. Des ronflements, des souffles lents et pénibles, semblables à des râles, aggravaient le silence jusqu’au tragique.
Le long du bastingage, une ombre errait, d’une allure suspendue de fantôme, dans cette solitude vivante, comme une âme inquiète et mélancolique veillant sur le sommeil de cette humanité misérable. Parfois, elle s’arrêtait, prenait en grandissant une raideur spectrale. Et, brusquement, la lune rougeoyante éclaira un maigre profil de femme, un de ces visages où le destin a mis son baiser inexorable. La bouche avait gardé dans ses plis la trace d’un sourire machinal et professionnel, tandis que le regard très las révélait une expérience résignée des choses. Sa chevelure dénouée, coulant sur les épaules, accentuait l’air d’abandon et de renoncement qui suintait de sa personne ; tout en elle annonçait l’exilée, la flétrie, douloureuse de tous les vices dont l’alluvion avait passé sur elle, de toutes les peines et de tous les remords qui avaient, un instant, bu sur ses lèvres la volupté de l’oubli.
On la nommait Lola. C’était une de ces pauvres filles, usées déjà dans les travaux forcés à perpétuité de l’amour, et qu’un trafic infâme envoie, de par le monde, peupler les bagnes de la prostitution.
André Laurel s’approcha.
— Bonsoir, dit-il simplement.
Elle répondit de même, méfiante d’abord :
— Bonsoir.
— Où allez-vous ? questionna-t-il.
— A Buenos-Ayres… Et vous ?
— Moi, je ne sais… A Buenos-Ayres ou ailleurs, peu m’importe, pourvu que ce soit loin, très loin. Je m’arrêterai là où l’atmosphère me semblera respirable… J’ai quitté la France et ma famille pour toujours.
Elle le regarda, surprise, intéressée tout à coup, moins par ce qu’il disait que par son accent de sincérité, sa figure fine et distinguée, d’une touchante jeunesse qui contrastait avec le ton désabusé de ses paroles.
— Pour quelle cause ? demanda-t-elle.
— Parce que j’en avais assez !
— De quoi ?
— De leurs mensonges, de leurs masques, de toute l’hypocrisie sociale.
— Vous êtes un révolté ?
— Oui. Il n’y a de dignité vraie et de grandeur que dans la révolte. Je ne veux pas me soumettre, être lâche : je veux être libre et vivre selon ma conscience.
— C’est donc que vous êtes riche ?
— Non.
— Pourtant, vous êtes, comme on dit, un fils de famille. Ça se sent… Alors, ce sont vos parents qui ont du bien ?
— Qu’ils le gardent. Je gagnerai ma vie.
Elle l’interrogea de nouveau et il en vint à tout dire, son histoire entière et ses rêves d’apôtre. Elle l’écoutait, silencieuse et grave, en le fixant de ce regard qui dénonçait une science inquiétante des choses.
— Gosse ! gosse ! fit-elle enfin, envahie d’une pitié subite. Va, retourne chez toi… Quoi que tu veux faire ? Changer le monde ? Faudrait voir d’abord à changer le cœur des hommes !… L’anarchie, la société sans loi, sans gendarmes, que tu rêves, ah, oui ! ça ferait du propre !… Pauvre petiot, t’as trop de sentiment, tu serais trop malheureux, tu ne connais pas les hommes. Va, gosse, rentre dans ta famille, qui sera bien contente de te dorloter encore. C’est un bon conseil que je te donne.
Et elle disparut, le laissant là, obstiné et songeur.
André Laurel était affligé d’une grave infirmité : il croyait tout ce qu’il disait et tout ce qu’on disait. C’était une nature simple, droite et candide, avec des élans passionnés et des aspirations généreuses. L’éducation qu’il avait reçue n’avait fait qu’accroître ces inquiétantes dispositions. Comme la plupart des petits bourgeois, il avait grandi, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, dans la plus complète ignorance des réalités sociales. Tout le monde autour de lui, ses parents et ses professeurs, s’étaient plu à l’entretenir dans ces illusions touchantes qui sont la grâce de l’enfance, à préserver sa jeune âme des amertumes de l’expérience. « On y voit clair bien assez tôt, et la vie se charge elle-même de vous déniaiser. » Mais les Laurel, en élevant leur fils, ne s’étaient même pas tenu ce raisonnement, ils n’avaient fait que suivre les communs usages.
Sous l’Empire, M. Laurel avait été un ardent républicain, comme on l’était alors, révolutionnaire jusqu’à admirer Marat, jusqu’à approuver l’attentat d’Orsini. Tous les jours, le petit André entendait son père déclamer contre les rois, les usurpateurs, les tyrans qui poussent les peuples sur les champs de bataille, sacrifient des générations entières à leur détestable gloire. Les lieux communs contre la guerre enflammaient sa verve. A la tête de l’opposition républicaine dans sa petite ville de province, il avait illuminé son balcon, quand l’Empire avait croulé.
Par sa mère, femme pieuse, André avait été imprégné de la morale évangélique. Son père n’y voyait nul inconvénient, se plaisant à répéter, après Camille Desmoulins, que le sans-culotte Jésus était le premier des républicains. D’ailleurs, bien qu’esprit supérieur, incrédule lui-même, M. Laurel déclarait respecter la foi religieuse chez autrui, attendu que, selon une parole fameuse, si Dieu n’existait pas, il eût fallu l’inventer — pour la masse. Car la masse avait besoin de croyance, d’espérance, de consolation… M. Laurel commençait à s’enrichir.
Plus tard, au collège, André avait appris l’histoire, qui vénère les héros morts pour la liberté. Les auteurs classiques, Plutarque, Tacite, Montaigne, Rabelais, Voltaire, Jean-Jacques, attisaient son âme contre les tyrannies, flattaient les tendances révolutionnaires qu’il tenait de son père. La Boétie s’était écrié : « Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, levons-nous. » Pascal avait ridiculisé la guerre. Montesquieu sacrifiait l’idée de patrie à l’amour de l’humanité. « Tous les hommes sont frères, lui avait dit autrefois l’Évangile. — Tu ne tueras point, ordonnait la morale de tous les temps. » Parmi les auteurs contemporains qu’on ne lui interdisait pas, se trouvait Tolstoï. Il le lisait et l’admirait. Et Tolstoï ne voulait pas qu’on prît les armes contre ses semblables. Enfin, toujours et par tout le monde, ses parents et ses maîtres, André avait entendu dire qu’il faut obéir à sa conscience, mettre d’accord sa conduite et ses principes. Il atteignit ainsi ses dix-huit ans.
Cependant, M. Laurel, favorisé par le gouvernement de la République, avait rapidement escaladé les degrés de la carrière administrative. L’ancien communard venait d’être nommé préfet. Ses fureurs révolutionnaires, frénésie de la médiocrité, s’étaient apaisées. Il en souriait, à cette heure. « La jeunesse a tant d’excuses ! On devient raisonnable en vieillissant. » Riche, décoré, la vanité satisfaite, il condamnait les utopies dangereuses, se dressait en bourgeois respectable, gras et modéré, toujours républicain, contre les revendications sociales.
— Il changera, disait-il en parlant de son fils ; à son âge, j’étais comme lui, et j’aime mieux le voir ainsi. Ne pas être communiste à vingt ans prouve un manque de cœur, mais l’être encore à quarante prouve un manque d’esprit.
Aussi se montrait-il indulgent, ne prenant pas la peine de le contredire, lorsque, en sa présence, André, avec une conviction tranquille, soutenait les doctrines que lui-même hurlait jadis avec l’aigreur et la violence de l’ambition impatiente.
Mais, un jour, sa colère éclata. Très calme, André avait déclaré qu’il se refusait au service militaire. D’abord, M. Laurel entreprit de le ramener par la douceur.
— Voyons, mon garçon, tu ne parles pas sérieusement ?
— Si, mon père, répondit le jeune homme. J’ai longtemps réfléchi avant de prendre une telle résolution ; maintenant, elle est irrévocable.
— Que dis-tu ?… Mais c’est impossible… c’est insensé, tu ne feras pas cela !… Songe au désespoir de ta mère, à ma situation, à toi-même, malheureux enfant !
— J’ai songé à tout, répliqua André ; j’ai prévu vos objections, vos raisonnements, votre indignation, mon père, et j’ai décidé que j’obéirais à ma conscience.
— Tu veux donc déshonorer ta famille ?
— L’honneur, à mes yeux, consiste à ne pas désavouer ses convictions par ses actes.
— On te méprisera !
— Je le sais.
— Tu passeras pour fou !
— Que m’importe !
— On te traitera de lâche !
— Cela me prouve qu’il ne faut pas souvent moins de courage pour agir selon sa conviction que pour risquer sa vie sur un champ de bataille.
La fureur et la douleur agitaient M. Laurel comme un orage. Pour la première fois, il se sentit coupable ; ce malheur, c’était son œuvre ; il eut conscience que la responsabilité en retombait tout entière sur lui.
Des larmes lui montèrent aux yeux, il pleura.
— Pauvre enfant, pauvre enfant ! bégaya-t-il.
Puis, s’étant ressaisi, il parla d’abondance, se cramponna à des arguments comme un noyé à une bouée de sauvetage.
— André, écoute-moi, je fais appel à ton bon sens. En théorie, il se peut que tu aies raison ; en réalité, tu commets la plus grave des erreurs. Il est des exigences sociales auxquelles on ne saurait se soustraire sans causer des désastres autour de soi. Mon enfant, il faut voir la vie telle qu’elle est. Sans doute, ton idéal humanitaire est généreux ; la guerre est une chose abominable, tout le monde en convient, et je souhaite autant que personne l’abolition des armées permanentes, dont l’entretien constitue le plus écrasant des impôts. Mais n’est-ce pas là un mal nécessaire dans l’état social actuel ? Pouvons-nous demeurer sans défense en face de l’Europe armée et qui nous guette ? La guerre est partout dans la nature, elle existe aussi comme une fatalité inéluctable entre les peuples et les nations… A vingt ans, je pensais comme toi, je professais les mêmes utopies ; mais l’expérience et la réflexion m’ont désabusé, et j’ai fait comme tous les bons citoyens, j’ai servi ma patrie avec tout mon dévouement, toute mon intelligence… Conservons notre idéal, tout en nous soumettant aux circonstances qui dépassent notre volonté ; ne faisons jamais rien d’irréparable. Ton héroïsme, mon cher enfant, — car c’est ainsi que tu considères ta folle résolution — serait inutile et te perdrait !
— Mon père, répondit André, je souffre du chagrin que je vous cause, mais vous ne m’avez pas convaincu. Je pense, au contraire, que notre désarmement, loin de nous livrer aux convoitises de l’Europe, serait notre sauvegarde. Nous demeurerions, en paix, comme tant d’autres États, sous la protection des grandes puissances… Et à quoi nous sert cette armée, puisque nous avons cessé d’être les plus forts ? La gloire militaire nous a coûté trop cher. Patriote, je le suis à ma manière, en rêvant une France qui rayonnerait sur le monde civilisé par son génie et par sa sagesse… Mon acte ne sera pas inutile, il donnera l’exemple… Non, je ne ferai pas mon service militaire.
— Tu raisonnes comme un insensé, s’écria le père.
Leur premier entretien en resta là. Mais M. Laurel ne se tenait pas pour battu. Pendant un mois, André eut à subir les objurgations de la famille et des amis. Un prêtre même s’en mêla. « Vous aussi, lui répondit André, vous, le missionnaire de paix, le soldat du Christ, qui a dit : Celui qui se servira de l’épée périra par l’épée ! »
Le malheureux jeune homme n’y comprenait plus rien ; on lui avait toujours enseigné qu’il fallait obéir à sa conscience, mettre d’accord sa conduite et ses pensées ; on lui avait appris à admirer les héros et les martyrs de la foi, et tout le monde maintenant le désapprouvait, le traitait d’imbécile ou de fou ; d’autres l’accusaient de lâcheté ! C’était le plus grand nombre.
Alors, lui apparut la constante contradiction des actes et du langage ; et, comme quiconque est frappé soudain d’une grande déception, il s’exagéra le mal : « Tous ces visages sont des masques, pensa-t-il ; les convenances, les attitudes, les gestes, autant de grimaces. La noblesse des mots farde la bassesse des intérêts. La morale n’existe que dans les livres. La société entière repose sur l’imposture… Oui, tout ment : l’histoire, qui glorifie des héros qu’on persécuterait encore de nos jours ; l’enseignement qui fausse le sens de la vie, et les morts même, les morts couchés dans la terre, les mains jointes et suppliantes, tendues vers un paradis chimérique. »
Ce fut du désespoir, quand ce pessimisme délirant souffla sur son âme désorientée. Personne ne se trouva pour lui dire : « L’hypocrisie, cet hommage que le vice rend à la vertu, selon l’admirable définition de la Rochefoucauld, est un progrès social ; ne blâmons pas trop ce désir de paraître meilleur, cette pudeur qui s’efforce à dissimuler les difformités morales, car c’est déjà se rapprocher un peu de la vertu que de lui rendre hommage. »
Cependant, l’aventure du jeune Laurel s’était répandue dans la société bourgeoise et y causait du scandale. Les honnêtes gens, ceux qui jugent un homme sur ses opinions et non sur ses sentiments, lui consacraient une réputation de mauvais sujet. D’autres, indulgents, le qualifiaient de dégénéré, de fin de famille. Ses anciens condisciples, dès qu’ils l’apercevaient, s’écartaient prudemment, pour ne pas avoir à lui refuser la main, geste qui exige un certain courage. Lui-même fuyait le monde, car les rêveurs et les incompris ne sentent la solitude que lorsqu’ils cessent d’être seuls.
André ne rentrait plus chez lui que le soir, très tard, quand tout dormait à la maison. Partout et à toute heure, il vivait avec ses pensées, les illusions qui lui restaient fidèles, et ses grands yeux songeurs disaient la tristesse infinie des êtres qui se savent méconnus, calomniés non seulement par la société, mais encore, amertume pire, par leurs propres actes. Semblable, en effet, à ces poètes qui, avec de très beaux sentiments, composent de très mauvais vers, André, avec de très nobles mobiles, prenait de déplorables résolutions et commençait par faire le malheur des siens, en voulant le bonheur de l’humanité.
Il vécut, quelques mois, désabusé, égaré. Mais il était de ces âmes qui ne peuvent se passer longtemps d’un idéal et pour lesquelles le scepticisme n’est pas le mol oreiller dont parle Montaigne. Brusquement, il changea, devint un autre homme ; son regard prit un éclat singulier comme éclairé d’une aurore intérieure, un grand soleil qui se levait au fond de lui-même et qui l’éblouissait. Un livre lui avait découvert une religion nouvelle. C’était une œuvre de propagande anarchiste. Il s’enthousiasma pour cette utopie qui s’illusionne sur le cœur humain et en méconnaît les passions jusqu’à prétendre réaliser la fraternité universelle dans l’absolue liberté.
Un matin, André reparut devant son père, avec un visage dont l’énergie révélait une décision sans appel. Il dit d’une voix brève :
— Mon père, je vous fais mes adieux, je suis résolu à quitter la France ; je pars demain.
M. Laurel eut une secousse, comme s’il venait de recevoir un coup droit en pleine poitrine. Mais l’opinion qu’il avait de lui-même, la conscience de sa haute personnalité officielle, lui donnaient, aux moments graves, de l’assurance et de la dignité. Calme et sévère, il demanda simplement :
— Pourquoi ?
— Parce que, répondit André, ce milieu-ci m’est hostile ; je m’y sens à la fois détesté et paralysé, et je veux être libre, agir selon ma foi, vivre sans hypocrisie.
— Où iras-tu ?
— En Amérique.
M. Laurel garda un instant le silence. Son émotion se devinait au tremblement de ses lèvres. Il dit enfin :
— Je ne méritais pourtant pas cela !
Et sa pitié paternelle l’emporta tout à coup, lui inspira des paroles émouvantes et raisonnables, mais qui venaient trop tard et n’avaient plus d’autorité. On ne change pas un état d’esprit par quelques phrases, on ne renverse pas d’un souffle l’échafaudage de dogmes et d’erreurs qu’ont dressé dans une jeune intelligence dix ans de fausse éducation. M. Laurel sentait lui-même qu’il parlait en vain.
— Malheureux enfant, dit-il, tu n’as vécu que dans un rêve ; la réalité prendra sur toi sa revanche, et puisse-t-elle n’être pas trop cruelle ! Va à la découverte de ton paradis terrestre, qui n’existe nulle part, car les hommes sont les mêmes partout… C’est l’hypocrisie qui te révolte ? Elle t’apparaîtra peut-être un jour comme une nécessité sociale… C’est l’indépendance que tu désires ? Hé ! mon pauvre enfant, qui donc est indépendant ? Qu’est-ce qu’un individu dans le formidable engrenage de notre civilisation ?… Tu ne sais rien encore que par tes livres, et tout ce qu’ils t’ont enseigné, tout ce que t’ont dit tes maîtres, atteste seulement l’effort louable d’une éducation qui se propose de léguer aux générations nouvelles le patrimoine moral de l’humanité. Mais il te reste à acquérir la science de la vie, et ta naïveté m’épouvante… Veux-tu un exemple ? ajouta-t-il en prenant tout à coup un ton moins solennel : Regarde ta petite sœur qui nous est arrivée hier de sa pension avec la croix. « Pourquoi as-tu la croix ? lui avons-nous demandé. — Parce que je me suis bien tenue dans le rang », a-t-elle répondu. Eh bien, tout est là, il suffit de bien se tenir dans le rang, et toi, tu veux en sortir, tu prétends vivre en marge de la société… Prends garde ! tu seras broyé !
— Je préfère être broyé, déclara André.
— Allons, tu es un héros, fit ironiquement M. Laurel, mais tu n’en es pas moins mon fils ; tu as du sang de bourgeois dans les veines, tu changeras… Pars, puisqu’en attendant, tout conseil est inutile, puisqu’il n’est pas en mon pouvoir de te convaincre et de te retenir ; parcours le monde, apprends la vie à tes dépens, et reviens quand tu en auras assez… La maison paternelle te sera toujours ouverte.
Le lendemain, André Laurel s’embarquait sur l’Eldorado.
Ce jour-là, le quatrième de la traversée, il faisait encore un temps splendide. Une grande animation régnait sur le pont des premières. L’Eldorado y prenait des airs de fête. On hâtait les préparatifs d’un bal de charité qui devait avoir lieu, le soir même, au bénéfice de la Société centrale pour le sauvetage des naufragés. Mme Larderet, Mme Gallerand et le consul Danglar, qui formaient un groupe à part, interrompirent un moment leur conversation pour observer les matelots occupés à décorer l’arrière du navire avec des pavillons, d’énormes lanternes chinoises et tous les fanaux du bord, tandis que d’autres disposaient déjà un peu partout des rangées de sièges. Il ne manquait que des plantes vertes et des fleurs. Mais le commandant Lagorce, très gai, s’excusait plaisamment en montrant les côtes arides du Maroc, que le paquebot longeait depuis l’aube. Le commissaire annonçait qu’on servirait des glaces et qu’on souperait. Enfin, l’orchestre des tziganes avait promis son concours pour toute la soirée.
— Je m’inscris sur votre carnet pour la première valse, dit M. Danglar à Mme Larderet.
— Je ne danserai pas, déclara celle-ci.
— Pourquoi ?
— Je ne suis plus jeune et je suis veuve… Je vous regarderai, cela m’amusera tout autant.
— Moi non plus, je ne danse pas, dit Mme Gallerand.
— Vous, vous n’avez pas d’excuse, fit Danglar. Vous m’accorderez une valse.
— C’est impossible.
— Voyons, une seule, rien qu’une ?
— Non, pas même.
— Ce n’est pas gentil, là !
— Je vous assure que cela contrarierait beaucoup mon mari.
— Le colonel, un si charmant homme ? Il est donc…
— Vous tenez à le savoir ? Eh bien, oui, il est très jaloux… La danse, ça l’exaspère ; à l’entendre, c’est indécent, ça encourage le flirt, ça autorise des frôlements, des étreintes que la morale réprouve… Enfin, à son avis, une femme qui se respecte ne doit pas danser.
— Et M. Gallerand a raison, approuva Mme Larderet. Mon pauvre mari pensait tout à fait comme lui. Même, il m’interdisait les bains de mer, que les médecins m’avaient tant recommandés… Pauvre cher homme ! ajouta-t-elle avec un profond soupir, après vingt ans de mariage, il était comme au premier jour !
Le diplomate ne put réprimer un sourire. La veille, une mauvaise langue lui avait révélé le passé galant de la respectable veuve. Vers 1880, à Paris, toute une génération d’étudiants en avait fait ses délices. Elle était alors la reine du Quartier Latin, parant de ses cheveux dorés, de son éclat de courtisane fauve, les restaurants de nuit et les bals publics, allumant tous les regards, quand elle dansait, par sa sensualité brûlante, l’ardeur lascive de ses déhanchements. Et Danglar lui-même, qui, justement à cette époque, commençait son droit, se demandait s’il n’avait pas goûté jadis à ces lèvres ardentes. Il lui semblait bien, en effet, maintenant, que quelque chose, dans ce visage de veuve vénérable, ne lui était pas absolument étranger — quelque chose qui n’était plus la beauté, n’en avait plus l’éclat, mais qui en gardait le reflet. Oui, une nuit, peut-être, il n’en était pas bien sûr, c’était si loin, ce bon temps-là, et il en avait tant vu depuis, ayant mené lui-même une jolie vie et passé, pendant vingt ans, à travers toutes les amours avec l’admirable sécheresse d’un conquérant.
— Soyez sans inquiétude, monsieur Danglar, dit Mme Gallerand, vous ne manquerez pas de danseuses, ce soir. Voici, par exemple, une jeune évaporée qui ne se fera pas prier, ajouta-t-elle en désignant Myrrha, qui papillonnait de groupe en groupe, ayant un mot gentil pour chacun, dans un besoin incessant d’agitation vaine. Et rien n’était beau comme sa chevelure abondante, d’une légèreté de fine poussière d’or, flambant au soleil.
Elle était la jeunesse et la grâce, égayant l’assistance de sa candeur ravie et de son frais babil ininterrompu, dissipant l’ennui que provoquent à la longue le spectacle monotone de la pleine mer, le ciel constamment limpide, les mêmes visages sans cesse aperçus. C’était elle qui organisait les jeux, jouait du piano, elle qui chantait — d’une voix très douce, qu’emportait parfois la brise infinie du large. Elle encore qui devinait les charades, mettait l’entrain partout, elle, toujours elle, capricieuse, fantasque, jamais lasse, étourdissante presque avec ses réparties imprévues, ses gestes vifs, ses sautillements d’oiseau.
Elle était si fluette, cependant, d’une telle gracilité maladive, qu’on finissait par s’étonner et s’émouvoir de cette gaieté extraordinaire qui ne se démentait pas un instant, de ce regard clair et joyeux que jamais n’embrumait l’ombre la plus fugitive de mélancolie.
La vieille parente, qui veillait sur elle, restait silencieuse et grave, souriant à peine, parfois, d’un sourire contraint, tandis que ses prunelles se noyaient de larmes. Myrrha, tout bas, l’exhortait à prendre un autre visage.
— Tu vois bien que je ne souffre pas… Je suis heureuse, très heureuse. Je ne veux pas qu’on me plaigne.
Avec une adorable mutinerie, elle plaisantait les gens soucieux, dont le front se barrait de rides sévères, ou dans les yeux desquels elle surprenait une pitié maladroite.
— Vous êtes triste ?… Auriez-vous le mal de mer ? Regardez comme il fait beau ! On n’est pas malade par ce temps-là… Je vais vous jouer une valse.
Elle se remettait au piano, faisait courir sur les touches blanches ses mains plus blanches encore, d’une transparence de cire. Et, sous ses doigts fragiles, les notes les plus graves avaient un son joyeux, éclatant d’allégresse.
Elle était, ce jour-là, déjà prête pour le bal, parée de tous ses bijoux, de dentelles qui flottaient au vent et de deux beaux œillets écarlates qui coloraient ses pommettes, tandis que ses lèvres avouaient la soif inassouvie d’aimer, de se donner et de vivre, de vivre vite… Bientôt, peut-être, ce serait trop tard.
Il était environ quatre heures. L’océan frémissait sous un ciel de feu, rouge et brumeux à l’Occident.
— Il y aura encore bal demain, dit en riant le commissaire.
Et comme on n’avait pas saisi la plaisanterie, il précisa :
— C’est un bel orage qui se prépare, nous danserons.
— Tant mieux, fit Danglar, ça rafraîchira le temps.
Il faisait, en effet, une chaleur accablante. Des passagers prolongeaient leur sieste en plein air, sur le pont. D’autres lisaient, flânaient ou se glissaient sans bruit dans le dédale des fauteuils, contemplant les poses variées des dormeurs et des dormeuses, avec ce regard vague et somnolent qui donne aux voyageurs sur mer la lassitude des espaces sans bornes.
Armand Reboul et M. Rolande, assis l’un près de l’autre, causaient bas, pour ne pas réveiller Mme Rolande, qui reposait à côté d’eux, dans une chaise longue. Les deux hommes, dès les premiers jours, s’étaient intimement liés. Ils en étaient déjà aux confidences.
— Qu’avez-vous donc, mon cher ami ? interrogea M. Rolande… Je vous sens agité et fiévreux… Il se passe en vous quelque chose d’extraordinaire, de mystérieux.
— Quand on est seul dans la vie, soupira Armand, il est des heures où l’on éprouve comme un grand vide !
— Mariez-vous, mon ami, je suis convaincu que vous rendriez une femme heureuse.
Armand allait répondre, lorsqu’il s’aperçut que les paupières de Mme Rolande frémissaient un peu et, devinant qu’elle ne dormait pas, il éleva la voix pour dire :
— J’avais fait ce souhait, mais le destin est cruel parfois : la seule femme que j’aie jamais aimée est aujourd’hui mariée.
— Et vous l’aimez encore ?
— Oui, dit Armand.
— Alors, vous êtes parti… par désespoir ?
— Non, pour la retrouver… et j’irai, s’il le faut, jusqu’au bout du monde.
M. Rolande s’égaya soudain :
— Votre aventure est romanesque ; mais voulez-vous que je vous en prédise le dénouement ?… Cette femme vous aimera, mon ami, car vous lui aurez donné une rare preuve d’amour. Vous serez son amant, et c’est beaucoup de bonheur que j’entrevois pour vous dans l’avenir.
Un irrésistible sourire monta aux lèvres d’Armand, et il craignit un instant que Mme Rolande elle-même ne partît à rire ; mais il lui parut, au contraire, qu’une légère rougeur se répandait sur son visage. Alors, sérieux, il déclara :
— Oui, cela pourrait être, si les honnêtes femmes n’étaient retenues par cette fausse conception de la vertu, qui leur commande le renoncement au bonheur, la fidélité éternelle dans un mariage sans amour. Et la plupart redoutent aussi l’indiscrétion, le scandale, l’abandon… Tant d’hommes sont légers, vaniteux, inconstants ! Parce qu’ils n’aiment pas vraiment. Je sens bien que je ne suis pas de ces gens-là. La véritable passion est discrète, silencieuse, exclusive… Une voix intérieure m’avertit que je n’aurai dans ma vie d’autre amour que celui-là.
Il avait haussé le ton, pour que Mme Rolande ne perdît rien de ses paroles. Évidemment, elle ne dormait pas, car ses paupières baissées semblaient s’éclairer d’une flamme intérieure, refléter l’éclat de ses prunelles.
M. Rolande demeura un moment songeur. Un pli mélancolique parut au coin de sa bouche, et il dit enfin d’une voix lente, où il y avait à la fois du regret, de la tristesse et du dépit :
— Je ne vous plains pas ; non, je ne vous plains pas… Heureux les hommes de notre époque qui peuvent aimer, qui en ont le loisir ! Ce privilège appartient à bien peu dans la terrible lutte pour l’existence, le souci dévorant du lendemain qui enfièvre nos sociétés modernes. Les Werther, les René, les Obermann se font rares… On n’a plus le temps ! La nécessité de gagner son pain, chaque jour, accapare toute l’énergie vitale, toutes les forces du cœur et de l’intelligence. La vie nous trique, il faut marcher, combattre sans trêve, sans répit… Ainsi, moi, où aurais-je trouvé le temps d’être amoureux, même de ma femme ? Toujours l’inquiétude, le travail, la bataille !… Je n’avais pas de rentes, moi ; je n’avais que des diplômes, je sortais de l’École Centrale… Ah ! le prolétariat intellectuel, les carrières libérales !… Mes parents, des sans-le-sou, auraient mieux fait de m’apprendre un bon métier manuel ; je n’aurais jamais été tout près de la misère et je ne serais pas obligé maintenant d’aller là-bas, si loin, et pour quelle situation, mon Dieu ! Juste de quoi vivre… Vous savez, mon ami, entre nous, ce que je vous raconte là. Les autres n’ont pas besoin de savoir, il vaut mieux sauver sa devanture, bluffer un peu, comme on dit aujourd’hui. C’est de l’héroïsme moderne.
Mme Rolande avait entendu, et, feignant de se réveiller, elle se dressa, mais aussitôt détourna la tête pour cacher ses yeux pleins de larmes et qui brillaient comme une flamme sous l’onde. En un instant, tout le passé s’était rouvert, ainsi qu’une blessure. Elle n’avait jamais été heureuse ! Du mariage, elle ne connaissait que les servitudes. Jamais une joie pure, une bonne journée sereine et voluptueuse, en quinze ans de ménage ! Ah ! que d’efforts, de courage, de petits mensonges, pour sauvegarder les apparences, tenir son rang dans la société ! Car ils faisaient partie de la société… Toujours le sourire aux lèvres et l’angoisse au cœur ! Elle accomplissait des miracles pour figurer dans le monde. « C’est par les relations qu’on arrive », affirmait M. Rolande. Mais le bluff ne leur réussissait guère, la situation s’aggravait, si bien qu’un jour, il fallut inventer une histoire, une ruine soudaine, consentir enfin à s’expatrier pour un gagne-pain dérisoire, qu’une Compagnie américaine offrait au malheureux ingénieur. Voilà à quoi avaient abouti tant de patience, de dévouement, de volonté ! Elle n’en voulait pas à son mari, qui l’avait épousée sans dot et qui avait bien fait son possible, très honnête, très laborieux, mais poursuivi par la malechance. Elle lui était restée fidèle, et combien, pourtant, l’avaient courtisée, séduits par sa grâce élancée, son ravissant visage ovale, d’une candeur délicieuse de blonde qui, chez elle, ne mentait pas, car elle avait gardé, à travers le mariage, cette virginité morale de tant d’honnêtes femmes qui donnent à leur mari ce qu’il est en droit d’exiger, mais rien de plus, rien de leur être intime et profond.
Pour la première fois, Mme Rolande éprouvait, en présence d’Armand Reboul, cet amollissement du cœur qui annonce de prochaines défaillances. En vain se défendait-elle contre un sentiment si doux, sa reconnaissance s’élançait vers celui qui répandait du romanesque, ainsi qu’une rosée, sur la sécheresse de sa vertu conjugale. Ce grand amour, venu tard, à l’heure du renoncement, lui embaumait l’âme, comme les fleurs tardives la terre désolée par les premiers souffles de l’automne. Lui, charmé de la trouver si belle encore, la contemplait, en songeant au bonheur qu’il aurait, ce soir-là, à danser avec elle, à sentir, si près de lui, dans l’ivresse d’une valse, les pulsations tièdes de sa chair.
Elle leva les yeux sur l’horizon, où s’amassaient de gros nuages noirs, sillonnés par de longues raies de feu, tandis que le soleil, à l’occident, prenait un éclat singulier d’or en fusion.
— Nous allons avoir de l’orage, annonça-t-elle.
— Oui, demain ou très tard, cette nuit, dit M. Rolande. Et, d’ailleurs, ça ne changera pas l’état de la mer, s’il n’y a pas de vent. Nous n’avons à craindre que le roulis et le tangage. J’ai déjà vu l’océan très calme, malgré la pluie, les éclairs et le tonnerre… Puis, il faut bien s’attendre à quelques petites bourrasques, en vingt-trois jours de traversée.
— Les marins ne redoutent que la brume, car elle les empêche de rien apercevoir, ni les phares, ni les fanaux des autres navires, expliqua Reboul, et c’est par elle que se produisent les abordages, les échouages, la plupart des sinistres en mer. Mais il est rare qu’il y ait de la brume, en cette saison.
— Je ne suis pas aussi rassurée que vous, dit Mme Rolande. Regardez donc ce ciel, là-bas, ces nuées menaçantes… Oh ! nous allons être ballottés, vous verrez.
— Un petit grain, peut-être, répliqua l’ingénieur, mais nous n’en danserons pas moins, ce soir, au bénéfice des naufragés… N’est-ce pas, commandant ? ajouta-t-il en interpellant celui-ci qui passait près de là.
Mais le commandant Lagorce, si aimable d’habitude, ne répondit pas, paraissant ne pas entendre, l’air anxieux et résolu du marin tout prêt pour la lutte, grandi soudain dans le sentiment de son devoir et de sa responsabilité. De ce brave homme, charmant et modeste, qui rêvait de vivre à la campagne, de pêcher à la ligne, quand il aurait sa retraite, il s’exhalait de l’héroïsme.
— Vous voyez bien que le commandant lui-même n’est pas tranquille, observa d’une voix plus basse Mme Rolande.
Eh effet, le baromètre venait de baisser tout à coup d’une façon inquiétante. L’atmosphère lourde se saturait d’électricité. Aucun souffle, cependant, n’agitait encore la surface de l’océan. L’Eldorado, brave et superbe, continuait à glisser dans l’immensité, sans autre secousse que la trépidation régulière, continue, de sa puissante machine. Le pont des premières classes se faisait désert. Armand Reboul tira sa montre.
— Il est temps de nous apprêter pour le bal, dit-il.
Les deux amis, précédés de Mme Rolande, se levèrent pour regagner leurs cabines, et ils croisèrent André Laurel, qui, voyant le pont abandonné, y venait respirer un peu d’air… Il souffrait ! La tristesse et l’ennui tissaient silencieusement leurs toiles autour de son cœur, et ces journées, avec le spectacle uniforme d’un océan calme, lui semblaient interminables, alourdies par la solitude et les rêves incessamment ressassés. Il ouvrit un livre. Il y avait une heure qu’il lisait, lorsqu’un frôlement léger le fit se retourner, et il demeura surpris, très troublé. Myrrha était devant lui, claire et riante, et lui parlait :
— Bonjour, monsieur André Laurel… Enfin, nous allons pouvoir causer un peu ensemble, car cela me peine de vous voir toujours seul, abandonné. Il est vrai qu’on vous tient à l’écart, on paraît vous en vouloir, oui, je l’ai bien remarqué.
— En effet, ils m’en veulent, répondit André.
— Pourquoi ? Que leur avez-vous donc fait, à tous ces gens-là ?
— Je ne sais, mademoiselle, je ne les connais pas.
— Alors, c’est incompréhensible, car vous n’avez pas l’air méchant ni terrible. Je suis sûre qu’on est très injuste à votre égard. Pourtant — vous allez me trouver bien curieuse et bien indiscrète…
— Non, dites…
— Eh bien ! il doit y avoir quelque raison, un malentendu, sans doute ?
— Oui, quelqu’un a dû leur raconter mon histoire… Je suis un insoumis.
— Insoumis à quoi ?
— A tout.
— C’est-à-dire ?
— A la société, à ses institutions, à ses lois, à sa morale, à ses préjugés.
— C’est là votre crime ?
— Pour l’instant.
— Ainsi, vous êtes un anarchiste ?
— Est-ce le mot qui vous effraie ?
— Oh ! oui, vous me faites très peur… Mais permettez que je vous confesse complètement.
— Je vous le permets, dit André, qui commençait à se divertir de ce badinage, ravi de la trouver si simple, si enjouée, si charmante et originale à la fois.
— Avouez que vous ne voulez pas faire votre service militaire, comme tout le monde, et que c’est pour cela que vous vous êtes embarqué ?
— Comment le savez-vous ? demanda-t-il.
— On le racontait devant moi, ces jours-ci, et votre équipée est connue de tous, à bord.
— Alors, j’avoue.
— Et que vous rêvez une société où tous les hommes seront libres et frères… C’est très grave, et vous êtes un jeune homme très dangereux.
— Prenez garde, mademoiselle, répliqua-t-il avec la même ironie, si on nous voyait ensemble, cela pourrait vous nuire beaucoup dans l’esprit de tous ces honnêtes gens.
— Et je passerais, n’est-ce pas ? pour une excentrique, une évaporée. Cela se dit déjà ; Mme Gallerand le répétait encore tout à l’heure… Elle est bête, Mme Gallerand.
— Vous ne respectez donc pas l’opinion, mademoiselle ?
— Non. Et puisque c’est ainsi, nous continuerons à causer, et nous deviendrons deux bons amis, à leur barbe… Voulez-vous ?
Il prit la main qu’elle lui tendait, une main si fine, si délicate, qu’il la sentait fondre dans la sienne, et, dans la pâleur de son visage, ses yeux rougirent, retenant des larmes.
— Je ne veux pas que vous soyez triste, dit-elle. Moi, je suis très gaie, tout m’amuse, et l’on prétend que je suis malade… Je ne sais pas ce qu’ils ont tous à me regarder ainsi avec pitié… Je vais très bien, à part quelques petits malaises passagers… N’est-ce pas que je n’ai pas l’air malade ?
— Non, répondit-il d’un ton convaincu, pour donner plus de vraisemblance à son mensonge charitable. Et, à son tour, il interrogea :
— Vous allez aussi à Buenos-Ayres ?
— Non, nous nous arrêtons, ma tante et moi, à Montevideo, où nous avons des intérêts, un héritage à recueillir.
— Vous n’avez que votre tante ?
— Oui, et je n’ai pas connu mes parents, j’étais orpheline à un an… Mais j’ai toujours été très heureuse, on m’a tellement gâtée !… Seulement, l’an passé, j’ai commis une imprudence, j’ai pris froid en m’attardant, une nuit, sur une terrasse, au clair de lune… et, depuis, je tousse un peu… un rhume qui ne veut pas guérir… Ah ! voilà M. Danglar, fit-elle, ressaisie d’une gaieté soudaine, en apercevant le diplomate campé, en habit, à l’autre bout du pont… Voyez comme il est beau ! C’est lui, ce soir, qui conduira le cotillon, n’en doutez pas… Savez-vous que nous aurons une tombola ?… Oh ! il y a des lots magnifiques : trois cravates, un paquet de cure-dents, une paire de jarretières, offertes par Mme Larderet. Ma tante a donné un éventail ; moi, un album… Oh ! on va s’amuser !… Et vous, je vous défends d’être triste, vous entendez.
Elle se grisait de son babil, radieuse, malgré sa fragilité de petite fleur maladive, enivrée de ce rien de vie qui lui restait, et d’où jaillissait comme par miracle une intarissable source de joie.
— Je danserai toute la soirée, reprit-elle, et je veux que vous dansiez aussi.
— Je ne sais pas, dit-il.
— Comment, vous ne savez pas ?
— Non, car je n’ai jamais fréquenté le monde ; j’ai toujours vécu comme un sauvage.
— Eh bien ! vous apprendrez. Je vous donnerai, ce soir, votre première leçon.
— Mais je ne suis pas habillé, et je n’ai même pas d’habit, avoua-t-il.
— Tant pis, vous danserez comme vous êtes… Écoutez, voilà que ça commence, offrez-moi votre bras.
Les tziganes attaquaient une première valse, une musique lointaine qui semblait se perdre dans l’infini de l’océan.
Le bal venait de s’ouvrir. On ne dansait pas encore. Il y avait de la tenue et de la raideur. Assises au premier rang, les dames, en des poses de photographie, étalaient d’audacieux décolletages. La plupart, matrones tétonneuses et empesées, bombaient d’opulentes poitrines, dissimulaient, sous l’abondance de leurs jupes, des ventres obèses. Seules, Mme Gallerand et Mme Larderet, qui n’avaient pas fait toilette, demeuraient effacées, manifestant des minauderies décentes et s’obstinant à refuser toute invitation. Les hommes se penchaient, disaient un mot, puis se redressaient avec un secret chatouillement de vanité, et, parmi eux, le consul Danglar, superbe et droit, moustache au vent, allait et venait lentement, comme étincelant de toutes les aventures amoureuses qui avaient marqué sa carrière diplomatique. Quand il passait derrière les épaules nues, trempées de clarté, il allongeait un peu le cou, les paupières pincées, plongeant un regard oblique et dédaigneux. Quelles nudités se cachaient sous ces satins purs, ces velours souples et caressants, ces bleus défaillants comme des évanouissements de turquoises, ces taffetas brodés en mille capricieux dessins, ces dentelles si légères, si fines, qu’on eût dit des vapeurs flottantes sur les transparences des mousselines ? Son œil exercé ne s’y trompait point ; mais il restait aimable, désirant faire réussir cette fête, dont il était l’organisateur, avec le commissaire du bord et M. Conseil, un écrivain notoire qui allait entreprendre, en Amérique, une série de conférences.
M. Gallerand, portant beau également, très froid, très digne, l’allure martiale, s’entretenait avec M. Rolande, s’accordant très bien avec lui pour dauber sur la République, cause de tous leurs mécomptes, — tandis qu’Armand Reboul, debout près de Mme Rolande, s’intéressait à ses moindres gestes, aux mouvements de ses lèvres, comme s’il eût voulu boire ses paroles. Modeste en sa simple toilette de soie blanche, à peine violetée, elle ne répondait que par monosyllabes à un voisin bavard, tout attentive à la musique des tziganes. Et elle penchait la tête, paraissant vouloir s’isoler, pour mieux s’imprégner de cette harmonie qui mettait sur son doux visage une expression de rêve, comme si l’accent des violons eût élevé jusqu’au romantisme le ton de ses pensées habituelles. Un charme infini émanait de toute sa personne, et on eût dit que le malheur se parait en elle de toutes les grâces de la joie.
Maintenant, on dansait, le commandant Lagorce et les officiers du bord ayant les premiers donné l’exemple, aussitôt suivi par Danglar et Conseil, qui entraînaient deux lourdes matrones en une valse onctueuse et pudique.
— A nous deux, dit Myrrha à André.
Il s’excusa en balbutiant :
— Non, non, c’est impossible… Je ne puis pas, je ne sais pas… Vous me rendriez ridicule. Je vous en prie, n’insistez pas… pour moi et pour vous-même…
— Pour moi-même ?
— Mais oui, vous savez bien que je suis mal vu dans ce monde-ci, et il faut craindre les mauvaises langues, les médisances, les calomnies. Je vous assure qu’on bavarderait sur votre compte… Les gens sont si sots, quelquefois si méchants, surtout quand ils n’ont rien à faire.
— Je vous ai déclaré que je me moquais de leur opinion, justement parce qu’ils sont ce que vous dites.
Il supplia encore :
— Faites-moi la grâce de me laisser bien inoffensif et bien sage dans mon petit coin.
— Pas du tout… Je veux que vous dansiez… Vous allez voir, c’est très facile… Vous vous laisserez conduire.
Il était assis tout au fond, à demi-caché, très timide parce qu’il était très fier. Elle l’obligea à se lever, lui fit prendre la position du cavalier. Le cœur lui battait à rompre sa poitrine, il rougissait, s’imaginant que tous avaient les yeux fixés sur lui et qu’on allait se gaudir de sa gaucherie. Mais bientôt, il domina son émotion, et, au premier signal qu’elle lui donna, ils s’élancèrent parmi le tourbillon des autres valseurs. Dix fois, ils firent le tour du bal, passant à travers les groupes, en zigzags. Admirable danseuse, Myrrha le dirigeait avec une aisance étonnante. Il se laissait entraîner, se rendant aussi léger que possible, sans oser la serrer de trop près, comme s’il eût craint de briser cette frêle tige pliante qui s’attachait à lui, l’enveloppait comme d’une caresse. Autour d’eux, tout tournait aussi, le parquet du pont, les lanternes chinoises, les fanaux du navire, la mer immense. André en perdait la notion des réalités environnantes, transporté en une étourdissante extase, un paradis inconnu, plus beau mille fois que la terre promise de ses chimères idéales. Des sourires ravis lui montaient aux lèvres, tout son être s’imprégnait du parfum étrange et délicieux qui émanait d’elle, de son corsage, de ses épaules nues, de sa chevelure de fine poussière d’or pâle. Ils tournaient toujours, accélérant et ralentissant leur envolée, selon le rythme des tziganes. D’instant à autre, leurs corps se rapprochaient et s’étreignaient ; il se sentait pénétrer lentement par la tiédeur douce de cette chair vierge et délicate. Maintenant, leurs regards, leurs sourires se rencontraient, leurs haleines se confondaient, et, sans qu’il le voulût, sa bouche effleurait presque ses cheveux, sa main pressait plus fort la sienne, son bras enlaçait plus étroitement sa taille… Ils tournaient, tournaient, tournaient toujours. Un long frisson le parcourut, une telle ivresse, enfin, le souleva qu’il crut un moment l’emporter, dans un grand vol éperdu, à travers l’espace, là-bas, loin de ce monde, loin de tout, et ses lèvres tremblantes bégayèrent des paroles d’amour.
La musique cessa ; ils s’arrêtèrent, et ce fut Myrrha qui le rassit. Il regardait partout, étonné de se retrouver là, revenant d’une hallucination merveilleuse.
— Que me disiez-vous, tout à l’heure ? demanda-t-elle… Oui, pendant que nous dansions… Répétez un peu, pour voir !
— Moi ?… Je n’ai rien dit, protesta-t-il, très rouge.
— Si, si, j’ai bien entendu ; je n’avais pas perdu la tête, moi… C’était une déclaration, monsieur. Vous allez vite, bien vite… Enfin, je vous pardonne.
Elle riait, d’un rire innocent et joyeux, très amusée de le voir confus, interloqué.
— C’est une folle, dit à voix basse Mme Gallerand, en se penchant vers Mme Larderet.
— Une inconsciente, murmura celle-ci.
— Danser avec ce mauvais sujet !
— Si sa tante le savait !
— Mais elle est là, sa tante, et elle ne lui dit rien, elle lui permet tout.
— Quelle faiblesse !
— Dites plutôt, chère madame, une absence complète de sens moral. C’est une jeune fille qui tournera mal ; vous verrez si je me trompe.
— Dans ces longs voyages, on est toujours exposé à des promiscuités fâcheuses, déclara Mme Larderet. Il faut en prendre son parti.
Les tziganes rejouaient une valse, et leur chef d’orchestre, le brillant Rienzo, se pâmait d’aise, la face réjouie d’un sourire vainqueur. Il regardait les femmes comme s’il eût promené son archet sur leurs nerfs, avec autant de virtuosité que sur les cordes de son violon.
Cependant, le ciel se couvrait. Un léger roulis, dont on ne s’apercevait pas dans le vertige de la fête, berçait doucement l’Eldorado, qui, avec toutes ses lumières, resplendissait, ainsi qu’une féerie errante au milieu d’un océan de ténèbres. Soudain, un long éclair sillonna l’horizon, le tonnerre gronda.
— Gare, gare ! ça va tomber ! cria Danglar.
— Pas encore, affirma un officier du bord.
M. Rolande jeta les yeux autour de lui, de cet air passif et résigné qui indique chez un homme que sa destinée est faite. Il s’étonnait de ne plus voir sa femme.
Elle venait de se retirer pour rejoindre Armand Reboul, qui l’attendait en un coin d’ombre, vers la poupe du navire.
Tout à l’heure, en dansant avec elle, il lui avait donné rendez-vous là. Maintenant qu’il la savait malheureuse, il était plus sûr de la vaincre, car il n’ignorait pas que le malheur est frère de la faiblesse et qu’il n’engendre l’héroïsme que quand il est de courte durée, quand le bonheur précédent a mis dans l’âme une provision d’énergie et de confiance. Ce n’était pas le cas de Mme Rolande. L’amour d’Armand ne s’en trouvait pas amoindri, il était autre, se mêlant à une pitié qui en atténuait la fièvre et en augmentait la douceur… Elle l’écoutait, grave, indécise et tremblante, tandis que le vent de la nuit apportait l’harmonie lointaine des violons.
— Que vous avez dû souffrir, disait-il, car vous n’étiez point faite pour cette vie médiocre et tourmentée à la fois, qui fut la vôtre, pendant quinze ans de mariage !
— Hélas ! répondit-elle, c’est la vie à laquelle sont condamnées la plupart des femmes, qu’on croit heureuses, parce qu’elles ont la fierté de ne jamais se plaindre.
— Mais la plupart n’ont pas votre âme, ni votre beauté ni votre grâce.
— Oh ! mon ami, dit-elle avec une grande mélancolie, choisissez d’autres flatteries pour une femme qui n’est plus jeune.
— La plupart n’ont jamais été aimées comme je vous aime, Xanie !
C’était la première fois qu’il l’appelait par son prénom, et il attendit un instant pour voir si elle acceptait cette liberté, qui établissait entre eux une intimité plus grande et l’autorisait à oser davantage. Elle garda le silence, il reprit :
— Bien peu ont trouvé le salut que je viens vous offrir en me jetant à vos pieds, en vous jurant un amour et une fidélité éternels. En les repoussant, Xanie, à moins que vous ne me haïssiez, vous seriez coupable envers vous-même, car le premier devoir de tout être, c’est de se conserver, c’est de vivre… Que devez-vous désormais à l’homme auquel vous vous êtes immolée jusqu’à ce jour et qui n’a pas su vous rendre heureuse, qui vous entraîne aujourd’hui dans sa ruine et sa faillite ? Quelle sera, là-bas, votre existence ?… O Xanie, puisse-t-elle ne pas être pire que l’ancienne !
Un grand éclair sabra le chaos croissant des ténèbres, projeta, l’espace d’une seconde, une clarté de plein jour. Armand y vit le visage de Mme Rolande baigné de larmes. Alors, il crut que le moment était venu de tout dire :
— Oh ! partons ! s’écria-t-il, partons ensemble, dès notre arrivée à Buenos-Ayres… Gagnons un autre port pour nous soustraire aux recherches… Nous retournerons en France… Qui vous retient ? Quelle chaîne morale que vous ne puissiez rompre sans remords ? Vous n’avez pas d’enfant… Votre mari ? Reconnaissez-vous à cet homme le droit de vous lier jusqu’à votre dernier jour à son mauvais destin ? Encore, s’il vous aimait, mais il n’a plus pour vous que cet attachement banal, ce sentiment neutre qui naît d’une longue vie commune ; il se consolera, et votre départ, dans sa situation présente, lui sera même une délivrance… Xanie, ayez ce courage, consentez à être heureuse !
Un autre éclat de tonnerre retentit dans la nuit. De larges gouttes commençaient à tomber. Mme Rolande ne répondait pas ; il prit ce silence pour une acceptation dont la pudeur retenait l’aveu et, tendant les lèvres, il lui donna un baiser. Elle eut un geste doux qui voulait s’en défendre… Elle était devant la tentation des voluptés défendues comme un naufragé qui a soif devant toute l’eau de la mer. On ne se désaltérait pas davantage, pensait-elle, avec toutes les sources du désir, empoisonnées par le remords.
— Non, mon ami, murmura-t-elle, je ne crois pas à la félicité que vous me promettez et que vous attendez de moi… Elle ne vous laisserait au cœur que la souffrance d’un idéal inassouvi. Abandonnez votre projet, car je ne puis me résoudre à ce que vous me demandez, je serais trop coupable.
Elle avait prononcé ces paroles d’un ton découragé. Armand sentit que ce découragement était tout près de l’abandon, et il l’embrassa de nouveau.
— Mon ami, dit-elle, nous faisons mal.
Elle ne luttait plus que faiblement… Un nouvel éclair les éblouit.
— Séparons-nous, ajouta-t-elle… On pourrait nous surprendre.
Il l’accompagna, descendit avec elle jusqu’à un corridor au fond duquel se trouvait sa cabine, puis remonta seul sur le pont.
Le vent se levait, la mer commençait à s’agiter. A la hâte, on avait tiré la tombola pour les naufragés, et la société, réduite à une vingtaine de personnes, s’était réfugiée dans le salon des premières. Armand y fut assailli par une tempête d’hilarité.
— Qu’est-ce qu’il y a donc ? demanda-t-il.
— Ah ! mon cher, vous avez eu tort de vous absenter, lui répondit M. Rolande… mais ce n’est pas fini ; écoutez, vous allez rire.
Pour distraire la compagnie, navrée par la brusque interruption de la fête, un passager, expert en chiromancie, en même temps qu’homme d’esprit, avait entrepris de lire, dans les mains de ces dames, et ce qu’il leur prédisait devait être d’un comique extraordinaire, car M. Gallerand lui-même s’en tenait les côtes, en perdait sa dignité.
— A madame Larderet, maintenant, fit Danglar.
La vénérable veuve se défendit en rougissant.
— Oh ! moi, déclara-t-elle, mon passé n’a rien qui puisse vous réjouir beaucoup.
— On ne vous dira que votre avenir, madame, répliqua Danglar, en donnant encore un peu plus d’impertinence ironique à son monocle.
Curieuse et rassurée, Mme Larderet présenta la paume de la main gauche. Le chiromancien en étudia consciencieusement les lignes.
— Madame, dit-il gravement, j’ai le plaisir de vous annoncer que vous mettrez au monde deux beaux jumeaux, dans une dizaine de mois.
— La gaffe, la lourde gaffe ! chuchota Danglar.
Le chiromancien avait oublié que Mme Larderet était veuve. Des rires fusèrent. Seul, M. Gallerand, cette fois, demeura impassible, sévère, jugeant la plaisanterie plus que déplacée, indécente.
— Nous oublions que nous sommes Français, dit-il.
La leçon de galanterie jeta un froid. Personne un moment, n’osa élever la voix.
— En voilà des naissances ! fit enfin Mme Chabert, pour rompre un silence pesant. On nous a prédit, à moi, une fille, à Mme Bineau un garçon. Nous allons donc peupler l’Amérique.
— A votre tour, cher ami, dit M. Rolande à Armand.
Sceptique, le jeune homme tendit la main.
— Ah ! monsieur, fit le chiromancien, que vois-je à l’intersection de ces deux lignes ?… Un signe bizarre, vraiment… Vous allez assister à des événements tragiques… mais qui favoriseront vos desseins, sans doute, car votre ligne de vie se prolonge… Celle du cœur s’arrête tout à coup.
— Que j’affronte aussi l’avenir ! s’écria M. Rolande… Voici ma main.
— Vous, reprit le chiromancien, vous avez éprouvé bien des revers, des déboires… Rassurez-vous, cependant… L’imprévu seul arrive… Il va changer bientôt votre situation… Oui, la chance ! Vous allez avoir de la chance !
— Qui donc croit à la chiromancie ? demanda M. Conseil, le littérateur conférencier.
— Pas moi, répondit Mme Chabert.
— Ni moi… heureusement ! déclara Mme Larderet.
— Et vous, commandant, y croyez-vous ?
Le commandant Lagorce haussa les épaules, puis raconta :
— Il y a longtemps, un oiseau de mauvais augure m’a prédit que je périrais de mort violente, dans je ne sais plus quel sinistre, vers ma soixantième année. J’ai dépassé cet âge… Je fais mon dernier voyage… et vous constatez tous que je me porte admirablement.
Un grand coup de roulis ébranla le navire. Le vent, maintenant, soufflait en tempête. L’un après l’autre, se suivant de près, les passagers, pris de malaise, abandonnaient la place, en s’accrochant de meuble en meuble.
— Oh ! dit le Second, nous allons avoir du gros temps.
Le lendemain, la mer devint haute et très dure. Un vent furieux, sifflant dans les cordages, emplissait l’espace d’un long cri de détresse éperdue. L’Eldorado tanguait et roulait, tantôt s’affaissant comme s’il allait s’engloutir au fond de l’abîme insondable, tantôt se soulevant lentement avec une trépidation plus précipitée de sa machine. Sur le pont, que balayaient les vagues, aucun passager n’avait paru. Tous devaient rendre des flots de bile, car, des cabines entr’ouvertes s’échappaient des gémissements et des râles, interrompus de temps à autre par un fracas de vaisselle, quelque violent coup de casserole démolissant une pile d’assiettes, dans la souillarde. A table, on avait placé les violons, des cordes tendues au-dessus des nappes, par de petites planchettes verticales, et destinées à maintenir les verres, les carafes et les bouteilles… Une gigantesque contrebasse, autour de laquelle les maîtres d’hôtel dansaient une sorte de danse de Saint-Guy, secoués par le roulis, se cramponnant partout, réalisant des prodiges d’équilibre pour ne point renverser les sauces. Seul, le commandant Lagorce et deux Anglais faisaient honneur au repas, tous les autres passagers s’occupant à restituer celui de la veille. Et les deux Anglais, eux-mêmes, durent bientôt, l’un après l’autre, se lever de table, exécuter un mouvement de polka autour des violons, puis s’appuyer quelques secondes sur le parapet du pont, avant de regagner leurs couchettes.
Cependant, le second jour, André Laurel se risqua hors de sa cabine. Il craignait peu le mal de mer ; le grand air sans doute dissiperait son léger malaise, causé surtout par l’odeur du bateau, une odeur d’huile et de goudron, mêlée à des émanations de cuisine. Il espérait aussi rencontrer Myrrha quelque part. Son cœur et ses regards erraient à sa recherche. Il ne se défendait pas moins contre un sentiment très doux, qui parfois atteignait à l’exaltation. Pas d’amour, pas de faiblesse, pas d’entrave ! Ni femme, ni famille, ni ami ! La liberté d’agir selon sa foi, la force d’être seul, de ne tenir à rien, de n’avoir rien à perdre, de pouvoir disposer entièrement de soi, de sa propre vie ! Mais cette grandeur farouche de la révolte et du désespoir s’alliait mal à sa nature ardente et romanesque. La grâce de Myrrha faisait lever ses rêves.
Il s’avança en trébuchant jusque sous la passerelle dont la voûte offrait un abri. Près de là, Marzouk, très incommodé par le tangage, jurait et sacrait, tandis que Si-Mohamed, assis, les jambes croisées, indifférent à tout, chantait sa même chanson dolente et monotone, qui se perdait dans le rugissement de la tempête, dont les grandes haleines passaient comme des coups de faux.
Visiblement, elle redoublait de violence. Les vagues, comme une meute hurlante, assaillaient le navire ; les moins hautes crachaient à bord les embruns de leurs crêtes, retombaient en cascade, s’émiettaient en poussière d’eau ; les plus puissantes, qu’on voyait au loin s’avancer, ainsi qu’une longue muraille menaçante et grossissant sans cesse, atteignaient l’arrière, dépassaient la hauteur du plat-bord et bondissaient sur le pont, avec un grand fracas. L’Eldorado fuyait devant le temps, sous les actions combinées de sa voilure et de sa machine, plongeant et se relevant tour à tour, descendant jusqu’au fond des vallées creusées par deux lames successives, ou traçant un large sillon dans les flancs de ces collines mouvantes. Parfois, son hélice sortait de l’eau, tournait dans le vide, comme affolée, ébranlait toute la coque, tandis que la toile des goélettes fouettait furieusement dans la rafale. Tout le gréement, telle une harpe géante, vibrait par moments avec des sonorités métalliques. Des goélands éperdus tournaient autour du paquebot en jetant des cris aigus.
Les officiers réunis sur la passerelle ordonnaient la manœuvre, tous les hommes de l’équipage étant à leur poste. Une vague inonda le salon des premières. Un coup de vent plus fort emporta une voile, qui tourbillonna un instant dans l’espace, ainsi qu’un gigantesque oiseau blessé, puis s’abattit et disparut.
De son abri, André contemplait ce spectacle effrayant et superbe, lorsqu’une forme humaine se traîna jusqu’à lui, et il reconnut un maigre profil tragique, mais plus pâle et plus ravagé, semblait-il, par la souffrance et par l’empreinte du passé. C’était Lola, cette fille avec qui il avait un moment causé, par désœuvrement, le premier soir du voyage. Elle venait là sans doute chercher un refuge, et après l’avoir salué d’un signe de tête, elle se tint à distance, discrète comme le sont toutes les filles, respectueuses de cette pudeur bourgeoise qui les relègue dans le mépris et affecte de les ignorer, en dehors de la possession brutale.
Quelque chose de mélancolique et d’attendri adoucissait, à cette heure, l’expression de son regard, effaçait ce sourire professionnel et machinal qui, d’habitude, avilissait sa bouche. Depuis trois jours, l’oisiveté et la solitude, où fermentent les rêves, réveillaient en elle, confusément, des souvenirs anciens, des choses auxquelles elle n’avait jamais plus pensé, qu’elle croyait mortes dans sa mémoire et dans son cœur, tant c’était vieux, tant elle en avait vu ! Des choses tristes et douces comme une harmonie que la brise apporte de très loin et qui l’auraient fait pleurer, si elle avait eu encore des larmes. Elles lui revenaient de sa maison natale, de son enfance, de sa jeunesse… Oui, elle se souvenait de tout, maintenant, et parmi tant de choses, il en était une qu’elle ne pouvait s’expliquer : comment, de la charmante fillette d’autrefois, si gracieuse et si pure, la société avait-elle fait la misérable créature qu’elle était à présent ?
De son vrai nom, elle s’appelait Louise… Un jour — elle avait alors cinq ans, et c’était son premier souvenir — son père lui avait dit d’aller jouer dans la pièce à côté. — Ce qui s’était passé, ce jour-là, elle ne l’avait compris que bien plus tard. — Tandis qu’elle habillait sa poupée, elle entendit son père et sa mère qui discutaient ensemble dans le salon. Son père avait une voix grave, profonde, sans colère, une voix qu’elle ne lui connaissait pas, car il avait toujours été très gai, très rieur… Quand il reparut, il était très pâle, et jamais il ne l’avait embrassée avec tant de tendresse. Depuis, il avait toujours gardé cette pâleur, une pâleur, immuable, définitive, qui semblait exprimer un chagrin inavoué et irrémédiable. La mère, elle était en voyage, elle allait bientôt revenir, disait-il. Mais les semaines se passaient, Louise ne revoyait plus sa mère.
Alors, on l’avait mise en pension. Elle était la première de sa classe, ses maîtresses la citaient comme exemple, mais elle avait trop bon cœur, elle donnait tout aux autres petites filles. Le jeudi et le dimanche, son père venait la voir. Il la prenait sur ses genoux et la serrait dans ses bras, sans rien dire. Il arrivait toujours bien avant l’ouverture du parloir et se promenait seul, pensif, en attendant, devant la porte de la pension.
Un dimanche, il ne revint pas. Louise pleura beaucoup. Avant qu’on le lui eût annoncé, elle avait bien senti que son père était mort.
Sa mère était remariée. Louise, à dix-sept ans, en sortant de pension, entra dans un nouveau foyer, où il y avait d’autres enfants, que son parâtre avait eus d’un premier mariage… Quelle vie, à dater de ce jour ! Elle était là comme une étrangère, celle qu’on accepte parce qu’on ne saurait faire autrement et qui reste une gêne, un obstacle, quelque chose dont on voudrait bien pouvoir se débarrasser. Elle rappelait aussi un passé fâcheux. Personne ne prononçait le nom de son père.
Un peu de fatalité et beaucoup de misère avaient fait le reste. Sa mère morte aussi, Louise avait quitté cette maison. A vrai dire, on l’en avait chassée, en la lui rendant inhabitable. Une sainte n’aurait pu y tenir davantage. Alors, elle avait cherché une place, et Paris l’avait prise comme une feuille dans un tourbillon de vent, la feuille qui s’envole, éperdue, s’élève et tombe, traîne, s’arrête enfin dans une flaque de boue… Oh ! l’existence de la fille pauvre, abandonnée dans ce Paris si doré et si flambant !… Elle était gentille, en ce temps-là, elle sentait bon la jeunesse, l’innocence et la santé. Les hommes la suivaient dans la rue et voulaient causer. Son cœur battait très fort quelquefois — il y avait si longtemps qu’elle était privée d’affection ! Mais elle ne répondait pas. Elle entendait rester honnête, en travaillant. Une ouvrière, une midinette, ça vivait de rien : deux sous de frites, le matin ; un bouillon le soir ; une petite chambre au sixième — et c’était gai, ça pépiait comme les moineaux du Luxembourg. Ça se laissait attirer aussi avec un peu de mie de pain, quand on savait s’y prendre, mais ça s’enfuyait après à tire d’aile.
Louise gagnait quatre-vingts francs par mois dans une maison de modes. Par malheur, ce modique salaire ne lui permettait pas de supporter la morte saison, les deux mois d’été pendant lesquels l’atelier fermait ses portes, congédiait ses ouvrières. Alors, il lui fallait chercher une autre place, et, chaque année, aux grandes vacances, elle changeait de maison, perdant ainsi le bénéfice de l’ancienneté dans la précédente. De sorte qu’elle n’avançait guère et restait toujours, ou à peu près, aux mêmes appointements. Une année même, quand la morte saison arriva, elle ne trouva pas de travail, et c’était l’époque du terme. Louise n’avait plus que vingt francs. Son propriétaire patientait bien une huitaine, mais jamais plus, et, cette huitaine écoulée, la pauvrette n’osait plus passer devant la loge de sa concierge, dans la crainte que celle-ci ne l’arrêtât pour lui présenter sa quittance. Afin d’échapper à sa vigilance, elle sortait de chez elle dès l’aube et ne rentrait que très tard, vers dix heures… Oh ! les interminables journées de détresse, à travers Paris ! Parfois, écrasée de fatigue, elle s’affaissait sur un banc, avec la peur qu’un agent ne l’appréhendât, car la société est ainsi faite qu’on se sent presque coupable, quand on n’a pas d’argent et quand on a faim.
Que c’était long, la belle saison ! Louise, très prévoyante, ne faisait plus qu’un repas par jour. Il fallait qu’elle fût bien jolie, pour que tant de misère ne l’eût pas déjà rendue laide. Depuis quelques jours, un jeune homme la suivait, un timide, un sincère sans doute, car il ne se décidait pas à l’accoster. Un soir pourtant, il osa… Elle était si lasse, si découragée, si seule, ce soir-là, qu’elle consentit à causer. Il avait des yeux de bonté, une figure fine et une voix caressante qui tremblait d’émotion en balbutiant des phrases qui la bouleversaient toute, lui faisaient passer un frisson sur la chair. Il l’invita à dîner, mais elle ne voulut accepter qu’une consommation, par discrétion et par une sorte de fierté naïve et touchante : pour ne pas montrer qu’elle avait faim.
Ils se revirent, les jours suivants. Il était très respectueux auprès d’elle, ne lui disait jamais rien de malhonnête. Elle l’écoutait, la face noyée de douceur, confiante, sentant qu’elle n’était plus seule au monde, maintenant. Elle lui racontait les tristesses de sa vie, et ses yeux s’embrumaient de larmes qui ne voulaient pas couler, quand elle parlait de son père.
Un dimanche, il l’entraîna hors de Paris, sur la route de Saint-Ouen. Il faisait un temps splendide. Le ciel, lavé par la pluie de la veille, avait l’azur profond et précieux du saphir, et c’était dans l’air pur un éblouissement de lumière. — « Où allons-nous ? demanda-t-elle. — Mais nous nous promenons, tout simplement, répondit-il. — Il me semble, reprit-elle, que je suis déjà passée par ici, autrefois, oh ! il y a bien longtemps, quand j’étais petite. » Ils arrivèrent à la porte d’un cimetière. — « Je me souviens, à présent, fit-elle, c’est ici qu’ils ont enterré mon père. » Elle leva sur son ami un regard suppliant qui signifiait : entrons ! — « Si vous voulez », dit-il. Une longue allée, l’artère principale, s’ouvrait devant eux, silencieuse et morne. De chaque côté, les tombes s’alignaient, régulièrement espacées au premier plan, quelques-unes chargées de guirlandes et de couronnes de perles, la plupart nues, délaissées, ne parlant ni d’orgueil ni d’éternité, attestant l’humilité d’un cimetière démocratique où les morts s’entassaient dans l’oubli, comme les vivants dans les faubourgs populeux et misérables des grandes cités modernes. Tout au fond, un terrain vague s’étendait, percé de grands trous qui se suivaient. Ils errèrent un moment dans une allée transversale. — « C’est ici », déclara-t-elle enfin, en s’arrêtant. Mais elle demeura interdite, ne comprenant pas : la tombe de son père était couverte de fleurs, de belles roses rouges fraîchement épanouies. Qui donc avait apporté toutes ces fleurs ?… Lui se tenait en arrière, mais la rougeur qui lui montait au visage, le dénonçait. Elle se retourna, et devinant tout, elle eut vers lui un long regard chargé de larmes, de reconnaissance et d’amour.
Le soir même, elle se donna, et ce fut une année de bonheur. Une année de bonheur dans toute une vie !… C’était toujours bon de se rappeler ça. Elle en avait gardé au cœur quelques souvenirs délicats, et elle ne lui en voulait pas de l’avoir abandonnée. Les hommes étaient les hommes ! Elle avait subi la commune destinée de la fille pauvre, sans soutien, sans défense, celle qu’on n’épouse pas. Lui était un sentimental et un faible, au fond duquel résidaient obscurément toutes les forces héréditaires d’égoïsme de la bourgeoisie contemporaine. Gentil garçon dépourvu de supériorité individuelle, il avait prouvé son utilité sociale en se mariant richement et raisonnablement.
Dès lors, la chute de Louise avait été rapide. Elle avait toujours été trop honnête, trop confiante avec les hommes. Les fils de famille qu’elle avait connus rêvaient tous de se faire entretenir, par amour-propre.
Un jour, on la renvoya d’un hôpital avant qu’elle fût complètement rétablie. Elle partit sans un sou, si faible qu’elle se tenait à peine debout. La nuit vint, une nuit glacée et pluvieuse de décembre. Louise se mourait de faim et de froid ; l’eau ruisselait de ses manches, sa robe se collait à sa peau. Et c’était cette nuit-là qu’un trafiquant de chair humaine l’avait prise, la trouvant jolie encore, malgré la souffrance et l’usure… Le lendemain, il l’avait embarquée pour la province, et, deux ans après, pour l’Amérique !
Lola, maintenant, regardait la tempête. André songeait à Myrrha, et la voyant paraître, chancelante et souriante, il se précipita au-devant d’elle, la saisit par la taille, pour la retenir, car la bourrasque soufflait avec une telle violence qu’elle était soulevée et semblait vouloir prendre son vol, à chaque pas qu’elle tentait. Il cria très fort :
— C’est de la folie, de la folie ! Vous allez vous envoler comme une plume… Il n’y aura plus de Myrrha… et que deviendrai-je !…
Mais la rafale mugissante emportait sa voix. De la tête, elle lui faisait signe qu’elle n’entendait rien. Un moment, ils se parlèrent par gestes, si près l’un de l’autre que leurs figures se touchaient presque et qu’ils buvaient sur leurs lèvres les paroles qu’ils ne distinguaient point. Il en profitait pour lui dire qu’il l’aimait, tandis qu’elle riait aux éclats et que le vent rageur dispersait autour de son ravissant visage la fine poussière d’or pâle de sa chevelure.
Lola les observait de ses yeux profonds… De l’amour, elle ne connaissait, elle, que les trahisons, les profanations et les souillures. Quelle pensée, en cet instant, l’habitait ? Elle demeurait immobile, effacée, comme dans la crainte de scandaliser le bonheur de ces deux jeunes êtres charmants. Peut-être ce spectacle réveillait-il au fond de son cœur des choses innocentes, des sentiments méconnus, des chimères inavouées, un idéal lointain. Mais une plus grande mélancolie l’envahit, un rayon divin de pitié traversa son désespoir : elle avait aperçu en Myrrha la grâce fragile des choses éphémères… Ah ! pourquoi cette cruauté aveugle du destin qui fauchait si tôt des existences radieuses et qui la condamnait à vivre, elle, l’humiliée, la flétrie, sur qui pesait toute l’iniquité sociale ?
Tout à coup, ce fut une brusque alerte. Les hommes de l’équipage se précipitèrent vers l’avant en poussant des cris qu’étouffait l’ouragan. On ne voyait que des faces épouvantées et les trous noirs des bouches qui vociféraient. Le Second parut, très pâle, faisant de grands gestes rapides, énergiques qui transmettaient des ordres… Que se passait-il ? Il ne semblait pas que le temps fût devenu subitement plus mauvais. Même, depuis quelques minutes, aucune lame n’avait franchi la hauteur du plat-bord. Un lieutenant s’élança vers André et Myrrha qui se tenaient enlacés, saisis d’une frayeur soudaine, et leur commanda brutalement de descendre. Aucun passager sur le pont ! Au même instant, la sirène jeta une plainte sinistre et farouche, comme un appel désespéré, dans la nuit tombante.
Armand Reboul cherchait vainement à s’endormir. Une lecture commencée n’avait pu le distraire de ses obsédants désirs ; il avait repoussé le livre et, emprisonné dans son étroite couchette, s’essayait à mesurer le temps aux pulsations de son cœur. Une fureur le prenait de ne pouvoir rien contre l’insomnie persistante. Le meuglement énorme et grave de la sirène, qui troublait les ténèbres à chaque minute, l’arrachait à ses somnolences et le rejetait, fiévreux, dans des convoitises ardentes, des rêves désordonnés, perpétuant en lui une agitation stérile.
Il ne pouvait penser qu’à Mme Rolande. Son image le hantait sans répit. Depuis deux jours qu’il faisait si mauvais temps, elle devait être couchée comme lui, et si cet horrible tangage durait, il risquait de ne plus la voir jusqu’à la fin de la traversée.
Soudain, la sirène eut un cri d’alarme si lugubre, si déchirant, si prolongé, qu’il se leva pour voir à travers le hublot de sa cabine. Il devait y avoir une brume épaisse… Mais non, la nuit était claire, la lune brillait dans un ciel sans nuage, et la mer, bien que toujours très grosse, semblait se calmer un peu. Les vagues paraissaient moins hautes. Seulement, le vent chassait vers tribord une fumée noire et dense où scintillaient des étincelles… la fumée de la machine, sans doute. Et il ne s’inquiéta pas davantage.
Mais, brusquement, une rumeur vague, inexplicable à cette heure avancée, où tout dormait à bord, lui fit prêter l’oreille et retenir son souffle. Sûrement, il se passait quelque chose d’extraordinaire. Il fut un moment inerte, le cœur battant, les yeux grands ouverts et fixes. Le tumulte se rapprochait. Au-dessus de sa tête, sur le pont, c’était un bruit étrange, un piétinement de foule qui se rue. La sirène maintenant hurlait sans discontinuer. Enfin, tout près, à la porte même de sa cabine, Armand entendit ce cri d’épouvante :
— Le feu !… Il y a le feu à bord !
— Le feu ! Le feu ! répétèrent d’autres voix.
En un clin d’œil, Reboul s’habilla, et il négligea de prendre sa ceinture de sauvetage… A quoi bon ! on était en plein océan, à mille lieues des côtes ! Et il s’élança au dehors, gardant sa présence d’esprit, voulant d’abord se rendre compte du danger.
Toutes les cabines s’ouvraient. Des hommes, des femmes, à demi-vêtus, en sortaient blêmes, hagards, surpris au milieu de leur sommeil par la nouvelle du sinistre, comme par quelque affreux cauchemar, et tellement étranglés par la peur que les mots leur restaient dans la gorge ; ils ouvraient la bouche et demeuraient muets. Le tangage les jetait les uns sur les autres, et ils avançaient en titubant, pêle-mêle, vers l’escalier qui montait au salon des premières. Quelques-uns étaient en manches de chemise, les chevelures dénouées coulaient sur les épaules des femmes. Il fallait que la situation fût bien grave, aucun officier du bord ne se trouvant là pour empêcher ce désordre et rassurer les passagers.
Elle l’était, en effet. Le feu s’était déclaré, à huit heures du soir, spontanément, dans des colis contenant des produits chimiques arrimés sur la partie avant du pont couvert-milieu. Le commandant Lagorce avait aussitôt fait mettre en action toutes les pompes à incendie du bord. Un moment il s’était cru maître du feu. Mais l’eau et le travail d’extinction avaient amené le désarrimage partiel des colis, et depuis, malgré tous les efforts, l’incendie excité par la tempête se propageait. Le charbon contenu dans les soutes s’était enflammé. La lutte continuait, tout l’équipage déployant une énergie héroïque, les mécaniciens allumant les chaudières pour actionner les pompes, les matelots s’efforçant à noyer la cargaison, tandis que d’autres s’apprêtaient déjà à mettre les embarcations à la mer. Mais deux d’entre elles, et justement les deux grands canots, venaient de se briser et partaient à la dérive. Vers minuit, le commandant Lagorce, debout sur sa passerelle, très grand, très brave, jugeait la situation presque désespérée. Cependant, on pouvait combattre encore pendant plusieurs heures, peut-être jusqu’au lendemain. Et deux chances de salut s’offraient : la rencontre d’un navire ou l’échouement sur un rocher perdu, nommé Abrolhos, qui se trouvait à quatre-vingts milles de là, environ, au sud-ouest. Le commandant s’étant arrêté à cette dernière résolution, l’Eldorado, après avoir viré de bord, faisait route à toute vapeur, tous ses fanaux éclairés, vers ce roc désert, tandis que sa sirène, dans l’espoir d’être entendue par quelque autre paquebot, continuait à beugler formidablement dans l’ouragan et l’immensité des ténèbres.
Armand Reboul, cherchant une issue, s’était enfoncé dans un couloir obscur qui communiquait avec les secondes classes. Là encore, une foule s’écrasait, des poings se heurtaient à d’invisibles murailles, comme si tout le salut eût dû venir de leur écroulement, et des cris atroces sortaient de ces profondeurs d’ombre. Une folie contagieuse de terreur hurlait par trois cents bouches l’effroi de l’obscurité et de la mort. Pendant quelques minutes, Armand tenta vainement de se frayer un passage. La tourbe délirante le cernait, l’entraînait, il ne savait où. La clameur s’entrecoupait de phrases hachées où se mêlaient tous les idiomes. De toutes parts, on accourait, des femmes, des enfants, des familles entières se tenant par les mains pour ne point se séparer. La confusion devint inouïe. Des formes croulèrent, meurtries, au bas d’un étroit escalier très raide, et pour en gravir les marches, d’autres formes piétinèrent des poitrines.
Enfin, d’un bond, Reboul se trouva sur le pont. C’était l’air, un peu moins de nuit, et il allait savoir ! Pour l’homme de courage, le danger affronté devenait moindre. Mais le chaos et la panique étaient tels qu’il lui fut impossible de rien distinguer. Les émigrants, chassés par l’incendie qui gagnait l’avant du navire, avaient envahi l’arrière et se mêlaient aux passagers de première et de seconde. Ils étaient là plusieurs centaines, des grappes humaines s’accrochant les unes aux autres, le long des chaloupes que des mains brutales et maladroites voulaient déjà saisir. Des bras se tendaient vers le ciel. Ceux-ci pleuraient, ceux-là juraient ; deux Siciliennes insultaient la madone, et, contre la coupée de babord, deux hommes s’assommaient furieusement, tandis que, près d’eux, un Italien se lamentait, répétant d’une voix gémissante : Non voglio morire, non voglio morire ! Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !
Les femmes tenaient des marmots dans leurs bras. Les familles cherchaient à se grouper ; des noms, des appels éperdus étaient jetés dans le vacarme :
— Giovanni !
— Corelia !
— Robert !
— James !
— Gaëtano !
Des noms de tous les pays ! Les émigrants se montraient actifs. Les passagers de première, habitués à se faire servir, semblaient se demander s’ils n’étaient pas la proie d’un abominable cauchemar et demeuraient inertes au milieu de la cohue, comme par peur de s’assurer qu’ils ne dormaient plus, qu’ils vivaient en pleine réalité.
Soudain, Reboul se prit à trembler. « Xanie ! » cria-t-il. Dans le premier moment, il avait cédé à cet instinct de conservation qui pousse à la fuite, et maintenant il se sentait honteux devant lui-même. Avant tout, il lui fallait la retrouver, l’emporter, et si la mort était au bout de l’étrange aventure, ce serait la mort pour tous les deux, la mort dans un baiser, dans le spasme de la possession ; car elle l’aimait, elle ne se refuserait pas, à l’instant suprême, au bord du néant. La pensée du mari ne lui vint même pas, tant il lui parut que la gravité des circonstances devait supprimer cette barrière sociale, toutes les servitudes, tous les préjugés encombrants et maudits. Désormais indifférent à tout ce qui n’était pas elle, il redescendit, retraça ses premiers pas le long du couloir obscur, compta trois portes, dut se colleter dans la nuit avec des gens qui obstruaient la quatrième, celle de la cabine de Mme Rolande. Peut-être s’y trouvait-elle encore. Il ouvrit et appela fébrilement :
— Xanie ! Xanie !
De ses mains hésitantes, il tâta la couchette vide… Personne !… C’est que déjà elle était sur le pont. Debout, l’une des premières, elle avait sans doute réussi à gagner l’escalier. Sans doute aussi le cherchait-elle. Il avait été stupide de perdre ainsi son temps… De nouveau, il se précipita au dehors.
— Xanie ! Xanie !
Une femme s’accrocha au pan de sa veste ; la gorge nue, les cheveux en désordre.
— Sauvez-moi ! sauvez-moi !… Toute ma fortune est à vous !
C’était Mme Larderet. Il la repoussa d’un geste violent, et lui-même fut brutalement jeté de côté par un corps énorme qui brandissait des poings menaçants. Armand ne reconnut pas Marzouk. La terrible brute écrasait tout sur son passage, et il devait avoir son idée de derrière la tête, quelque projet sinistre, car il fouillait les cabines, s’emparait des objets précieux, surtout des armes. Et il pouvait bien tout se permettre, nul, dans le désarroi général, ne prenant garde à son manège.
Reboul se retrouva sur le pont. Pour la dixième fois, il lança dans la foule son appel désespéré :
— Xanie ! Xanie !
Une autre voix, presque à ses oreilles, cria, frémissante d’angoisse :
— Myrrha ! Myrrha !
André Laurel, de son côté, cherchait en vain Myrrha, au milieu de la mêlée hurlante. Si, par malheur, la jeune fille se trouvait là, ces brutes allaient la renverser, la piétiner, car l’égoïsme déchaîné ne respectait, n’épargnait plus rien ; la bête humaine traquée par l’épouvante apparaissait dans toute son horreur… Non, Myrrha était seule, en quelque coin d’ombre. La mer avait dû lui sembler moins redoutable que les hommes. André se mit à explorer le navire.
Mais une panique plus grande se produisit. De nouveaux cris de terreur se répercutèrent de distance en distance :
— Les bœufs ! voilà les bœufs !… Gare, gare !… Écartez-vous !
Ce fut une violente bousculade en arrière… Quelques bœufs parqués à l’avant du paquebot, foyer de l’incendie, avaient réussi à rompre leur barrage et parcouraient le pont dans un galop furieux, tête baissée, les cornes menaçantes, fonçant contre un ennemi invisible et mystérieux dont ils sentaient l’invasion et qui déjà leur avait grillé un peu le poil. Trois hommes n’ayant pu se garer à temps, furent culbutés. Les énormes bêtes, lâchées dans les ténèbres, affolées par les flammes, la tempête et le sifflement sinistre de la sirène, ravageaient tout sur leur passage. Plusieurs s’abattirent contre les obstacles les jambes cassées. Un jeune taureau fit un bond prodigieux, franchit le parapet, se précipita dans le vide, et la mer l’emporta. On ne mit pas moins d’une heure à s’emparer des autres. L’un d’eux avait pénétré jusqu’au salon des premières et s’était arrêté là, étonné, n’en voulant plus à personne, heureux de se sentir à l’abri. Et il poussa un beuglement grave comme pour témoigner sa surprise et sa satisfaction. Un matelot s’approcha, lui fracassa le crâne d’un coup de massue et le laissa là, étendu, monstrueux, le mufle saignant sur un tapis, les yeux grands ouverts, pleins de sérénité.
L’incendie gagnait toujours, bien qu’on eût jeté à la mer tous les alcools et toutes les matières explosibles enfermés dans la cale. L’Eldorado s’inclinait sur tribord, gouvernant avec peine. L’eau arrivait dans la chaufferie, emplissait à demi le château. C’était au moins une barrière que le feu ne franchirait pas. L’espoir commença à renaître un peu. Mais à l’avant, le pont brûlait. Le navire penchait de plus en plus. Il fallut percer un trou dans la paroi du château pour évacuer l’eau, et la chaufferie étant redevenue habitable, les mécaniciens rallumèrent les chaudières pour actionner les pompes. La lutte reprit ardente et farouche. Le paquebot se redressait lentement.
Tout à coup, ce fut une explosion formidable. Une immense gerbe de feu jaillit du milieu même du pont. Toutes les superstructures de la partie centrale s’effondrèrent.
Du haut de sa passerelle, le commandant Lagorce comprit qu’il était perdu, qu’il allait mourir d’une mort horrible. Les flammes, en effet, entouraient le bas de la passerelle, en dévoraient les échelles et montaient peu à peu jusqu’à lui. Un quart d’heure auparavant, il s’était retourné vers l’homme de barre et lui avait dit : « Va-t’en ! Sauve-toi ! » Lui restait à son poste. Maintenant, il lui était impossible de descendre. Dans quelques minutes, il allait sauter. Alors, très calme, d’une voix brève et forte qui dominait par instants le bruit de la rafale, il continua à donner des ordres.
A l’arrière, la terreur s’était accrue. C’était une course affolée de bâbord à tribord, de l’un à l’autre entrepont. Quelques-uns réclamaient à grands cris des ceintures de sauvetage au commissaire qui exhortait au calme et à l’espérance ; des femmes s’étreignaient en pleurant, d’autres tombaient en prière et les deux Siciliennes, qui naguère outrageaient la madone, l’imploraient à présent, lui demandaient pardon, se croyant au bord de l’éternité. La vie n’en défendait pas moins tous ses droits : parmi ces scènes déchirantes, des mères donnaient le sein à leurs marmots.
Reboul aperçut M. Rolande. Il était là, livide, transi par l’épouvante. Ce niais avait oublié sa femme et ne songeait qu’à lui. Armand lui-même se sentit fléchir. Aucun écho ne lui apportait la voix tant désirée. Peut-être y avait-il déjà des victimes et Xanie était-elle du nombre. Par amour, il eût été capable d’héroïsme, mais cette vaine recherche épuisait son courage. L’ironie du destin jetait sur sa route ceux dont le sort l’intéressait le moins. C’était le beau Danglar, si superbe dans les salons, maintenant défait et tremblant ; ou Conseil, le littérateur-conférencier, non moins lamentable ; ou Rienzo, le chef des Tziganes, entouré de sa petite troupe qu’il dirigeait encore dans cette lutte suprême pour la vie. Lola, toute seule à l’écart, restait silencieuse. Ses yeux, fixés sur l’océan immense et ténébreux où l’on meurt ignoré, loin de la vue des hommes, avaient gardé leur tristesse résignée, et ses lèvres souillées de tous les embrassements s’entr’ouvraient cette fois comme pour recevoir le grand baiser libérateur de la mort. La folie d’alentour ne la gagnait point. Elle n’avait aucun nom chéri à jeter dans ce tumulte, et parmi le déchaînement des égoïsmes, nul ne se souciait de la sauver.
M. Gallerand, l’ancien colonel, passa, très crâne. Il avait devant la tempête et le feu, le même air que devant l’ennemi. C’était un homme d’esprit moyen et arriéré, mais d’une grande bravoure. La peur, il ne connaissait pas ça. Trois fois, en 1870, les balles allemandes l’avaient couché sur le champ de bataille, et il avait été si vaillant colonel qu’on n’avait jamais voulu le faire passer général.
Il venait de s’aventurer jusqu’au milieu du navire, pour mesurer le danger, et avait assisté à la mort du commandant Lagorce, impassible sur sa passerelle, s’obstinant à commander la manœuvre, tandis que ses vêtements commençaient à brûler. Le vieux soldat avait alors ôté son chapeau, et il était resté, la tête découverte, saluant l’héroïsme jusqu’au moment où la passerelle s’était écroulée dans le brasier.
Quand on avait vu ces choses, il n’était plus permis d’avoir la moindre défaillance, sans en rougir. Très droit, très brave, croyant que tout était perdu, le colonel redescendit dans sa cabine où il avait laissé sa femme.
Vis-à-vis d’elle, il avait à se reprocher quelques infidélités. Il avait été un homme comme les autres, mais il vénérait la compagne de sa vie, la mère de ses quatre enfants, la pieuse et vertueuse Mme Gallerand. Il voulait la rassurer, lui cacher la vérité.
Quand il parut, avant qu’il eût ouvert la bouche, elle tomba à ses pieds.
— C’est toi, c’est toi… Il faut que je te parle !… Il faut que je te parle !
Elle avait la figure convulsée, les yeux gonflés de larmes et d’effroi. M. Gallerand crut que sa femme était devenue folle.
— Voyons, du sang-froid ! fit-il en tremblant d’une émotion soudaine.
Et il voulut la relever. Mais elle se traînait à ses genoux, suppliante et accablée, les mains jointes.
— Il faut que je te parle ! répéta-t-elle… Il le faut !… Puisqu’il n’y a pas de prêtre ici, c’est à toi que je veux tout dire, avant de comparaître devant Dieu !
— Ma pauvre amie, ta raison s’égare dans cette nuit atroce, répondit M. Gallerand… De grâce, reviens à toi !… Si nous n’avons plus que quelques heures à vivre, ayons confiance en Dieu, car nous avons toujours été d’honnêtes gens. J’ai rempli tout mon devoir, tu as fait plus que le tien, notre conscience peut être tranquille… Subissons en chrétiens la grande épreuve.
— Non, non, je ne suis pas folle… Je suis une misérable, une misérable ! s’écria Mme Gallerand… la plus méprisable des créatures !… Écoute, écoute ! tu me tueras après, si tu ne veux pas attendre que la mer nous ait engloutis !… Je ne mérite ni ta pitié, ni ton pardon… Je suis une misérable !
Elle s’interrompit, suffoquée de sanglots, les mains crispées, et n’osant plus lever la face. Stupéfait, abasourdi, M. Gallerand se taisait maintenant, le front sabré d’une longue ride sombre.
— Eh bien, que veux-tu dire, parle ? fit-il enfin d’un ton bref.
Il y eut un nouveau silence. On n’entendait que le sifflement de la tempête et la plainte funèbre de la sirène. Mme Gallerand se prosternait plus bas encore, comme pour recevoir le châtiment imploré, le coup de grâce, la délivrance de son torturant remords, tandis que, de ses mains nerveuses, elle s’accrochait à la couchette pour ne point rouler sous les coups de tangage… Enfin, elle râla sa confession tragique.
— Tu m’as crue une honnête femme, une bonne épouse, une mère vertueuse… Ce n’est pas vrai !… Je suis une grande coupable… Je t’ai toujours, toujours trompé !… Depuis la première année de notre mariage, j’ai eu quatorze amants. Je t’ai trahi même avec ton meilleur ami ! Et ma vie n’a été qu’une hypocrisie, un continuel mensonge, une abominable imposture !… toi, tu étais bon, tu étais aveugle, tu ne te méfiais de personne, et j’ai abusé de tout cela, de ta bonté, de ta confiance, de ton aveuglement… J’avais cru qu’il valait mieux te laisser ton ignorance, mais je vais mourir, je vais être jugée, je ne peux plus me taire… Venge-toi, finis mon supplice, tue-moi !… La mort venant de toi, je l’accepterai avec joie, avec reconnaissance… comme une expiation !
M. Gallerand devint très pâle, puis il eut comme un sursaut de révolte contre l’affreuse réalité.
— C’est impossible, c’est impossible ! s’écria-t-il… Tu es folle… ou je rêve !
— J’ai dit la vérité, déclara-t-elle.
Le vieux soldat s’affaissa sur un siège et deux grosses larmes roulèrent dans le lacis de rides qui labouraient ses joues.
— O mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu ! bégaya-t-il, qu’est-ce donc que la vie, qu’est-ce donc que l’humanité ?
Une confusion de ténèbres s’abattait en sa pensée, et ses paupières se baissèrent comme pour faire plus de nuit encore en toutes choses. Puis, lentement, malgré lui, il reprit conscience et questionna, d’une voix haletante :
— Et mes enfants, mes quatre enfants ?
Mme Gallerand garda le silence.
Il se redressa brusquement, terrible.
— Je veux que tu me répondes.
— Tu n’es le père d’aucun d’eux, dit-elle.
— Malheureuse ! proféra-t-il.
Sa main se leva comme pour frapper. Elle s’offrait à ses coups, la gorge nue.
— Frappe, tue-moi, implora-t-elle… Vois, je ne me défends pas… Tout me semblera juste.
Mais la main de M. Gallerand retomba, frémissante… A quoi bon, puisqu’ils allaient disparaître tous deux au fond de l’abîme !… Oh ! mourir, ne plus être, tout oublier !… Que le navire tardait à sombrer ! Combien de minutes encore à subir ce supplice, à contempler ce passé de honte, plus horrible cent fois que le gouffre de l’Océan ?
M. Gallerand avait rejeté sa ceinture de sauvetage, et tous deux, elle prosternée, lui debout, restaient muets, attendant la mort, la délivrance.
Les premières heures de l’aurore blanchissaient le hublot de la couchette. Il semblait que la tempête commençait à s’apaiser. Soudain, une longue clameur d’allégresse s’élança d’un bond, la sirène poussa un meuglement plus formidable, comme enflée d’espérance, et, dans le couloir qui longeait les cabines, des voix joyeuses éclatèrent.
— Sauvés !… Nous sommes sauvés !… Tout le monde sur le pont !
En même temps que l’aube, un vapeur venait d’apparaître à l’horizon. Il avait entendu l’appel de la sirène, il approchait.
Ce fut du délire. Mille bras se tendirent par-dessus le bastingage, vers le sauveur. On avait hissé tous les signaux de détresse, le pavillon de l’Eldorado était en berne et, monté sur les espars de la tente de dunette, un marin balançait un drapeau fixé à l’extrémité d’un manche de gaffe.
Le vapeur était un steamer anglais. Il grandissait à vue d’œil. Dans un quart d’heure il serait là… Hourra ! Hourra ! Hourra ! Le même cri jaillissait de toutes les bouches, on pleurait et l’on s’embrassait. Ceux-ci agitaient leur mouchoir, ceux-là leur chapeau, et les Siciliennes étaient retombées à genoux pour rendre grâce à la madone, jurant que, tout à l’heure elles l’avaient insultée pour la mettre à l’épreuve, mais qu’elle était la meilleure, l’Immaculée, la sainte des saintes, celle qui pardonne et qui sauve toujours !
Tout à coup, il sembla que le steamer anglais changeait de route et s’éloignait… Insensiblement, il s’effaça, puis disparut, emportant son crime de lèse-humanité.
Il y eut, à bord du navire français, un long silence de prostration qui annonçait la soumission au destin. L’humanité a le privilège de s’accoutumer au pire des états, au désespoir même, et il n’est pas jusqu’à la mort qui ne perde à la fin tout pouvoir d’effrayer.
La situation se faisait plus tragique. Après le commandant Lagorce, les deux lieutenants et cinq hommes de l’équipage avaient péri. Cependant, le jour naissant s’obscurcissait. Des nuages noirs, bordés de gris pâle, à contours fortement arrêtés, s’avançaient de l’horizon, rétrécissant de plus en plus la partie encore claire du ciel vers le zénith.
André Laurel avait enfin découvert Myrrha dans le tourbillon humain, et tous deux, s’étant mis à l’écart, causaient bas, serrés l’un contre l’autre. Jamais elle ne lui avait paru si adorable, toute décoiffée, un simple châle jeté sur ses épaules, par dessus la chemise, car elle n’avait pas eu le temps de se vêtir. Mais il était surpris de la voir calme.
— Vous n’avez pas peur ? demanda-t-il.
— Pas du tout, déclara-t-elle.
— Vous n’avez donc peur de rien, Myrrha ?
— Je savais, dit-elle, que je ne vivrais pas longtemps… Les médecins m’avaient condamnée.
— A vous voir si gaie, si radieuse, je pensais que vous ignoriez votre état.
— Je ne voulais pas être aux autres un spectacle de tristesse.
— Vous nous donniez donc, discrètement, une leçon d’héroïsme, Myrrha ?
— On se grise un peu, on se fait illusion… Ce m’était facile, car je ne souffrais pas… Même, j’étais heureuse, et, je ne sais pourquoi, je le suis encore, en ce moment.
— C’est étrange, moi aussi, dit-il, depuis que nous sommes là tous deux… Nous pouvons bien tout nous dire, maintenant, puisque dans une heure peut-être, nous ne serons plus.
— Eh bien, confions-nous vite tous nos secrets… Parlez le premier.
— Voilà trois jours, Myrrha, que je ne pense qu’à vous et que je n’en dors pas.
— Moi, je dormais, mais c’est toujours de vous que je rêvais.
— Depuis quand ?
— Depuis toujours il me semble… Oh ! bien avant, bien avant de vous connaître… depuis que je commence à penser.
— Moi, c’est autre chose, répondit André. Avant de vous avoir vue, je n’avais jamais songé à l’amour, j’avais la tête bourrée de théories qui me rendaient sombre… mais depuis que vous m’êtes apparue, et surtout depuis le soir où j’ai dansé avec vous, je me sens tout autre, je respire avec ivresse… Il me semble que l’air, la mer et la tempête ont le parfum de vos cheveux et que c’est un peu de Myrrha que je respire en ouvrant la bouche.
— Eh bien, moi, la première fois que nos regards se sont rencontrés, j’ai pensé tout de suite : c’est lui, c’est bien lui… et j’étais révoltée contre ces gens qui avaient l’air de vous en vouloir, qui ne vous comprenaient pas… Moi, j’étais sûre qu’on vous calomniait.
— Myrrha, Myrrha, je vous aime !
— Dire que c’est déjà fini ! murmura-t-elle.
— Nous avons peut-être encore quelques heures à vivre.
— Quand nous sombrerons, vous me tiendrez dans vos bras, nous descendrons ensemble au fond de cette mer.
Ils se serraient plus étroitement. Elle avait renversé la tête contre l’épaule du tout jeune homme, et il l’embrassait sur le front, sur les yeux, sur les lèvres.
— Nous pourrions être plus heureux encore, dit-il.
— Est-ce possible ?
— Oui.
— Comment ?
— Si tu voulais être mon épouse, Myrrha… avant de mourir.
— Mais n’est-ce pas comme si je l’étais, puisque je m’abandonne et que tu m’embrasses ?… Que fait-on de plus, quand on est marié ?
— Tu ne sais donc rien, Myrrha ?
— Non, dit-elle, en ouvrant de grands yeux de candeur et qui l’interrogeaient.
— Tu n’as jamais soupçonné une félicité plus haute ?
— Il me semble qu’il ne peut en exister de plus grande que celle d’être embrassée comme tu m’embrasses !
— Tu te trompes, Myrrha… Je t’assure qu’il y a plus de bonheur encore !
— Comment le sais-tu, toi ?
— On me l’a dit.
— Qui te l’a dit ?
— Des jeunes gens de mon âge… Même, ils ne parlaient entre eux que de cela, et à les en croire tous, rien au monde n’est si délicieux, quand on s’aime.
— On s’est peut-être moqué de toi.
— Non, Myrrha ! Car, lorsqu’ils s’entretenaient de cela, leurs figures rayonnaient de joie et de désir, et je sens bien qu’ils avaient raison, parce que je t’aime… Je t’aime tellement, Myrrha, que la pensée de ta possession ne m’avait même pas effleuré jusqu’ici. Il me suffisait de te voir, de t’entendre, d’être assis près de toi. Je t’aurais attendue aussi longtemps que tu l’aurais voulu… Mais, maintenant, les minutes comptent pour des années : il s’en est écoulé plusieurs depuis que nous sommes là à causer, et mon impatience naît enfin de connaître, avant de mourir, le bonheur suprême ?
— Quel est donc ce bonheur ? demanda-t-elle, très pâle, agitée d’un frisson tout nouveau, comprenant qu’il y avait des mystères dont son innocence ne s’était jamais douté.
Alors, à voix basse, en tremblant, il lui révéla le grand secret :
— Myrrha, Myrrha, ouvre ton cœur et bouche un peu tes oreilles, car si la chose est grande et belle, les mots qui l’expriment sont grossiers et te scandaliseraient… Tu ne seras ma femme, Myrrha, et tu ne connaîtras la plus haute félicité que si tu consens à te donner tout entière.
Elle le regardait avec les mêmes yeux candides, ne comprenant pas encore… Il prononça d’autres paroles, plus claires.
— Tais-toi ! tais-toi ! balbutia-t-elle dans un grand trouble, en se cachant la figure… Oh ! c’est affreux !… Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas !… Je mourrais de honte… Restons comme nous sommes, c’est si bon !… tes baisers sont si doux !…
Elle défaillait presque… Il la soutenait par la taille, cherchait à l’entraîner, sans violence.
— Myrrha, le temps passe… Bientôt, ce sera trop tard !… Nous mourrons sans avoir éprouvé les plus grandes joies de l’amour !… Regarde là-bas… oh ! regarde !
Une nouvelle gerbe de flammes jaillissait de la proue du navire. Tout l’avant flambait, et la sirène, comme découragée, avait interrompu son long meuglement de détresse. Le désespoir avait fait le silence partout. Le vent même ne gémissait plus, et d’énormes nuages se condensaient vers le zénith où montait, en gros tourbillons, une épaisse fumée noire, parcourue par instants de lueurs sinistres.
— Viens, viens, Myrrha !… Ne résiste plus… Les minutes deviennent précieuses… chaque seconde qui s’envole, c’est du bonheur qui fuit !
Sa voix frémissait de passion et d’impatience. Il sentait sur le revers de sa main gauche, placée sous le bras de Myrrha, au-dessous des seins, les battements tièdes et précipités de son cœur, tandis que son souffle haletant lui passait sur la joue ; et il bégayait encore des paroles troublantes :
— Je t’aime… Je te veux toute… Mourir avant de t’avoir possédée, ce serait horrible !… Ne sens-tu pas comme je souffre ?… Oh ! ne tardons plus… Viens, viens !
Elle s’abandonnait peu à peu, lui rendait son étreinte. Alors, il la saisit, l’emporta dans sa cabine, la dévêtit de ses mains tremblantes, sans qu’elle opposât de résistance. Et sa nudité jaillit, éclatante comme un grand lis pur, exhalant le parfum d’une chair toute vierge. Puis, il la souleva, l’étendit… Ce furent d’abord des caresses éperdues. Ses lèvres, en baisers rapides, s’égarèrent, coururent, brûlantes, sur la bouche, sur la nuque adorable, d’une blancheur de lait sous la chevelure d’or, sur les seins, sur tout le corps, tandis qu’elle se couvrait le haut du visage de ses bras croisés, pour ne point voir cette lente prise de possession de sa virginité, qui se livrait toute, dans l’attendrissement de cette passion infinie, exaspérée par l’approche de la mort.
Sous l’averse des baisers, ses paupières battaient comme des feuilles sous l’orage ; son être se pâmait à la fois de volupté, de souffrance et d’amour. Enfin, il la posséda toute, et ils s’élancèrent hors du monde, très haut, par delà la création, dans un ravissement inouï, une chevauchée splendide à travers les étoiles.
Quand ils en revinrent, ils se regardèrent et sourirent, pénétrés d’une lassitude délicieuse et très étonnés d’être encore en vie.
— Nous n’avons donc pas sombré ? fit-elle.
— Nous ne sommes donc pas au fond de la mer ? dit-il.
— Il me semble que nous ne bougeons presque plus.
— C’est vrai.
— Que se passe-t-il ?
— Je ne sais pas… La tempête a cessé, mais nous marchons toujours.
— Écoute, on dirait qu’il pleut.
— Oui, à torrents.
— Regarde par le hublot.
— Oh ! la terre, la terre ! s’écria-t-il… Un rocher ! là-bas… pas très loin !… Nous allons droit dessus.
— Reviens près de moi, dit-elle… Aimons-nous… Qu’importe tout le reste !
De nouveau, ils s’enlacèrent et repartirent à travers l’azur, par delà les astres !
Depuis près d’une heure, Armand Reboul se trouvait bloqué dans l’inconnu affreux des ténèbres. Sa course affolée à la découverte de Mme Rolande l’avait égaré, de couloir en couloir, en une sorte de labyrinthe si obscur qu’il désespérait d’en sortir… Où était-il ? il ne savait plus, ne se souvenait que d’une chose : qu’à un moment, attiré par un bruit de voix qui s’élevaient d’un creux et voulant se renseigner, il avait descendu quelques marches raides comme une échelle : mais il avait rencontré une mare profonde. Des hommes perçaient un trou dans la coque du navire pour écouler toute cette eau. Alors, il était remonté précipitamment, et c’était à cet instant-là qu’il avait dû se perdre… A droite, un amas de colis, auquel il venait de se meurtrir les genoux ; à gauche, une porte fermée qu’il avait en vain essayé d’enfoncer à coups d’épaule ; derrière lui, une impasse ; devant, un étroit escalier en colimaçon, d’où tombait une lueur de caverne. Il l’avait gravi et s’était arrêté en face d’un spectacle terrifiant : la passerelle s’effondrant tout à coup au milieu des flammes. Impossible de franchir cette fournaise, pour regagner l’arrière. A l’avant, un autre foyer d’incendie barrait également la route. Plus d’issue sur le pont ! Un des bœufs échappés avait failli lui enfoncer ses cornes dans le ventre… Rebroussant chemin, Reboul s’était de nouveau engouffré dans les abîmes d’ombre où il ne se reconnaissait plus ; et, après avoir tâtonné, ramoné la nuit de ses mains fébriles, le long des murs invisibles, il était demeuré là, immobile, dans une angoisse atroce, redoutant d’être cerné par le feu, s’estimant perdu.
Longtemps, il s’était égosillé à appeler au secours ; aucun écho n’avait répondu à sa voix. Enfin, après une attente mortelle, le jour grandissant fit pénétrer jusqu’à lui un peu de clarté. Il remonta l’escalier, se précipita au dehors, avide de lumière. Il pleuvait à torrents, un déluge providentiel inondant le pont, combattant à la fois l’incendie et la tempête. Les débris de la passerelle ne flambaient déjà plus. Reboul passa, atteignit l’arrière, gagna le couloir des premières classes.
— Xanie ! cria-t-il.
Peut-être, maintenant, se trouvait-elle dans sa cabine. La porte en était entr’ouverte, il entra.
Mme Roland, à genoux, priait au pied de sa couchette.
— Xanie ! répéta-t-il.
Elle se releva, le regarda avec douceur et dit d’une voix qui ne trahissait ni trouble ni épouvante :
— Armand, adieu !… Je vous permets de m’embrasser pour la dernière fois.
Il allait s’élancer vers elle et l’étreindre, mais le ton même dont elle avait prononcé ces paroles le retint. Elle avait encore, malgré son négligé, sa chevelure défaite, ce parfum de vertu hautaine qui inspire à la passion plus de ferveur que de désir, plus de sentiment que de sensualité. Il ne semblait pas que l’apparition de la mort eût sur elle d’autre pouvoir que d’aggraver sa mélancolie, cette fierté douce qui s’exhalait de toute sa personne et cette expression indéfinissable d’au-delà par laquelle se dénoncent les âmes qui n’ont jamais vécu leur vraie vie : natures d’élite asservies à l’inexorable médiocrité, rêveurs descendus des purs sommets dans les bas-fonds des réalités sociales.
Reboul s’approcha et la baisa au front. Un moment, ils demeurèrent sans voix, face à face, et leurs regards seuls se parlèrent, exprimant tout le rêve et toute la souffrance d’une vie, tout ce qu’il y avait en eux d’inassouvi, de profond et d’intraduisible, mille choses délicieuses et tristes qui confusément s’évoquaient, se noyaient dans leurs larmes, tremblantes au bout des cils et qui les aveuglaient. Celles de Mme Roland coulèrent les premières, le long des joues pâles, jusqu’au pli douloureux des lèvres. Plus éloquentes que les paroles, plus troublantes que les aveux, elles confessaient tout : sa longue patience, les révoltes de sa chair, ses exaltations réprimées, ses nuits de fièvre, ses réveils désolés et les désillusions, les dégoûts subis dans sa soumission d’épouse, son bonheur perdu, sa vie manquée, le continuel adultère de son cœur.
— Je n’avais qu’une crainte, dit Armand, c’était de mourir sans vous avoir revue… Oh ! j’ai passé une nuit horrible en vous cherchant et en vous appelant partout, dans les ténèbres et dans le tumulte. Je ne pensais pas à la mort, je ne pensais qu’à vous, et par moments, à cette pensée, au milieu de mon angoisse et de ma torture, c’était un flot de bonheur qui m’inondait… La vie sans vous me semble plus désolante mille fois que la mort dans vos bras, avec vos caresses !… Xanie, ce serait affreux et vous seriez la plus cruelle des femmes, si vous me repoussiez encore… La vertu est coupable, quand elle fait tant souffrir. Existe-t-il, à cette heure, une loi, un devoir, une morale qui puisse nous interdire d’être l’un à l’autre ?
Comme pour prévoir une objection et vaincre un dernier scrupule, il ajouta d’une voix plus basse, mais frémissante de passion, de douleur et d’indignation :
— Votre mari, je l’ai vu, cette nuit, grelottant de peur, affolé. Vous n’existiez plus pour lui, il ne pensait qu’à se sauver lui-même… Moi, je vous aime, et vous m’aimez aussi. Qu’importe à présent tout le reste ? Enivrons-nous de nos baisers jusqu’à notre dernier souffle, jusqu’au fond de cet océan qui va nous engloutir !
Très pâle, Mme Rolande s’abandonnait peu à peu, et des paroles de pitié s’échappaient de ses lèvres tremblantes… Toute une existence dévastée pour aboutir à cet instant de volupté tragique ! Et ils allaient sombrer sans avoir étanché leur soif dévorante. Toutes les barrières, les obstacles autrefois dressés contre leur idéal croulaient en même temps que leurs espérances… C’était vrai, la mort la libérait des chaînes sociales. Elle pouvait l’aimer, maintenant, lui en faire l’aveu et se donner toute. Elle baissa un peu les paupières pour dire :
— Je vous aime, acceptons ce triste bonheur qui vient trop tard et durera si peu !
Alors, simple, sans pudeur affectée, frissonnante et baignée de larmes, elle commença à se dévêtir. Mais un grand cri d’effroi jaillit de sa gorge béante.
La porte de sa cabine venait de s’ouvrir, brusquement.
Une stature colossale, monstrueuse, se dressait devant eux.
C’était Marzouk… Les yeux injectés, les bras ouverts, terrible, il s’avançait vers Mme Rolande.
— Moi d’abord, dit-il.
D’un bond, Reboul se jeta sur le monstre.
Une lutte horrible, inégale, allait s’engager. Marzouk leva son poing formidable pour terrasser d’un coup son dérisoire adversaire.
Au même instant, il y eut un choc d’une violence telle que les deux hommes roulèrent sur le plancher. Les ais grincèrent affreusement, les hélices parurent se bloquer ; puis, au lieu de la trépidation des machines, ce furent des échappées stridentes de vapeur. On eût dit que le paquebot se vidait de toutes ses énergies, hoquetait ses derniers râles dans une agonie effrayante de bête énorme, touchée aux sources mêmes de la vie.
Reboul avait cru sentir éclater son crâne contre la cloison. Il se redressa, constata qu’il n’était que légèrement blessé à la tête. Marzouk avait disparu. Mme Rolande n’avait aucun mal.
Elle crut que le navire sombrait.
— Fuyons, dit-elle… Oh ! vite ! le temps passe !
Et ce fut elle qui l’entraîna, tandis qu’étourdi encore par sa chute, il la suivait sans savoir.
Ils s’enfermèrent dans une autre cabine, qui était celle de Reboul. En toute hâte, craignant qu’il fût déjà trop tard, elle acheva de se dévêtir, découvrit sa nudité intrépide, et ils s’étreignirent comme s’ils disparaissaient au fond d’un océan de félicité.
L’Eldorado venait d’échouer sur l’Abrolhos, un rocher abrupt, émergeant au sud-ouest de l’Atlantique, et dont le nom signifie en langue espagnole : ouvre l’œil.
Sur le pont, les mêmes scènes atroces et sauvages recommençaient. La foule des émigrants, sous l’averse torrentielle, se ruait vers l’unique embarcation qu’avaient épargnée la tempête et l’incendie, maintenant presque éteint. Un mulâtre brandissait son couteau pour se frayer un passage à travers la mêlée hurlante et furieuse. Des clameurs s’entrecroisaient :
— Nous sommes échoués !
— Nous coulons !
— Prenez vos ceintures !
— Les canots ! les canots !
Parmi les officiers de l’équipage, un troisième lieutenant avait seul survécu, et, méconnaissable de rage, il criait au chef mécanicien qui sortait de la chaufferie :
— Mes ordres, mes ordres !… J’ai commandé « machine en arrière ! ». Nous sommes sur un haut fond, je veux dégager le navire.
— Impossible ! déclara le mécanicien.
— Vous refusez d’obéir.
— Oui !
— Prenez garde !
— Mes cylindres sont engorgés de sable, pensez-vous que je vais risquer une explosion ?
— Vous n’avez pas à discuter… Machine en arrière, nom de Dieu ! machine en arrière !
— Jamais ! Laissez-moi tranquille.
Le petit lieutenant sortit un revolver, le braqua sur le chef mécanicien.
— Si vous n’obéissez pas, je vous tue comme un chien !
Marzouk, qui assistait à ce colloque, étendit le bras, arracha sans effort l’arme de la main du lieutenant :
— Allons, pas tant de rouspétance, fit-il. Donnez-moi ça. Vous n’êtes pas le maître ici.
Et, tranquillement, il s’en retourna, traversa la foule en roulant des yeux de despote.
— Jette ça à la mer, ordonna-t-il au mulâtre qui brandissait son couteau.
Le mulâtre obéit.
— C’est bien, dit Marzouk.
Maintenant, le vrai maître, c’était lui. Tous devaient se soumettre, car il était le plus fort… Chacun son tour à commander et à faire des siennes, en ce monde. Les bourgeois des premières n’avaient plus qu’à se bien tenir. Ses muscles puissants saillirent dans un défi collectif à tous les hommes, à tous les destins, à toutes les morts.
D’abord, il s’empara de l’unique chaloupe.
— Si quelqu’un y touche, je lui casse la gueule ! dit-il.
Mais il ne se hâta pas d’y descendre. Si le navire coulait, il serait temps alors. Et si quelque chose d’autre arrivait, on pourrait voir.
Le troupeau des naufragés reculait, effaré, dompté déjà, devant ce colosse effrayant, haut de deux mètres, dépassant de toute la tête les plus grandes tailles. Les bras nus, le revolver au poing, il se dressait, menaçant et formidable, sur le fond du ciel sombre, fondant en pluie diluvienne.
Il s’était assuré qu’il n’y avait plus de péril immédiat. La large fente produite par le choc, sur la muraille de tribord, à la hauteur des ancres, s’étendait presque toute au-dessus de la surface d’eau ; on avait aisément réussi à l’aveugler en la bourrant de matelas et de ciment. Des hommes, affalés avec des cordes le long des flancs du paquebot, ne constataient pas d’autre avarie sérieuse. Le reste de l’équipage s’employait à épontiller solidement la cloison étanche, explorait la cale, transportait à l’arrière toutes les marchandises lourdes. Et l’Eldorado qui, au début, avait plongé sous le poids de l’eau envahissant son avant, se redressait peu à peu, tombait enfin sur l’arrière, faisant ainsi émerger la partie de la fente située sous la ligne de flottaison.
Seul, le pont, avec ses deux cheminées blanches de sel, avait terriblement souffert, dévasté par le feu et la tempête. Partout, des ravages et des ruines, les canots brisés, les roufles aplatis, les banquettes réduites en cendres, tout le gaillard d’avant incendié, fumant encore. Un spectacle funèbre, un vrai champ de bataille couvert de débris, de blessés, de bêtes agonisantes, noyées, brûlées, éclopées, parmi les amarres se tordant comme des serpents coupés. Les cadavres du commandant Lagorce, des deux premiers lieutenants et de cinq matelots gisaient sous les décombres de la passerelle. Çà et là, des bœufs abattus, les jambes cassées, respiraient encore, ouvrant de grands yeux, poussant de longs beuglements douloureux. Personne ne pensait à les achever. Et des canards heureux, échappés de leur cage, nageaient gravement, au milieu du désordre, dans un demi-pied d’eau, où flottaient des dindes et des chapons noyés.
Marzouk semblait seul victorieux sur ce champ de bataille, victorieux de la tourmente, du feu et des hommes, de cette foule qui grouillait là, livide, terrorisée, défaite.
Soudain, une troupe de comédiens, douze sujets, six hommes et six femmes, débouchèrent à la débandade, en titubant, de l’escalier des secondes. Ils étaient très soûls, n’ayant cessé depuis la veille, de noyer dans du champagne, du cognac et de la bière, leur épouvante de la mort. Tous avaient leur masque tragique des galas shakespeariens. Julia, l’ingénue, sanglotait aux bras de la duègne. M. Séraphin, le jeune premier, se tordait les mains dans un grand geste amer et désolé. Mme Beaujois, second prix du Conservatoire, rendait. Mais M. Alvar, le grand premier rôle, chef de la troupe, s’était avancé, très digne, héroïque, devant la foule, prétendant organiser la mise en scène du désastre. Il avait longtemps joué Napoléon et lui ressemblait un peu, bien qu’à la longue son masque imberbe d’histrion eût dévoré les contours césariens de sa figure. Le bras levé, sublime, il réclamait le silence, prenait d’autorité le plus beau rôle dans le drame, et sa voix empâtée par l’ivresse parvint à se faire entendre :
— Mes amis, du sang-froid, du courage !… C’est le moment d’en avoir !… Il est dans la vie des heures tragiques…
Marzouk, à la fin indigné de cette usurpation de pouvoir, dressa le poing :
— Ferme ! sale cabot, ou je te dégringole !
Lui-même était impuissant à rétablir le calme. Les lamentations, les appels désespérés, les invocations et les bordées d’imprécations à la Vierge, les pleurs des enfants, le beuglement énorme des bœufs blessés et jusqu’au coin-coin des canards, faisaient un charivari infernal. Et c’était, de l’un à l’autre bord, une galopade affolée vers on ne savait quelle porte de salut, dans un besoin fougueux de vivre, fût-ce parmi la mort de toutes choses.
Bien que tout danger de submersion fût momentanément conjuré, la situation restait redoutable. La machinerie, désormais hors de service, rendait impossible toute tentative pour dégager le paquebot. On était à six jours de toute côte, loin de la ligne suivie par les transports. Il y avait donc peu de chances pour qu’un autre navire les aperçût jamais. Les vivres pouvaient durer quelques semaines, mais après ?
Danglar, qui avait reparu, exposait la situation au milieu d’un cercle. Son ruban rouge exerçait encore du prestige. On l’écoutait les yeux brûlants de fièvre et d’anxiété, et quand il eut fini de parler, ce furent de nouvelles clameurs désespérées :
— Nous sommes perdus ! perdus à jamais !
— Nous n’avons plus que quelques jours à vivre !
— Nous allons tous périr dans les tortures de la faim !
Des passagers rejetaient ces ceintures de sauvetage pour la possession desquelles ils avaient failli s’entretuer tout à l’heure. La foule s’éparpillait, courait dans toutes les directions, soudain affamée et en quête de vivres, comme si toutes les provisions eussent dû manquer le même soir. A la terreur de la mer succédait la folie de la faim. Des bandes d’émigrants envahissaient le roof d’avant, par où l’on accédait à la cambuse de distribution. M. Conseil suivait, effaré, livide, tâtant machinalement le ceinturon de cuir qui renfermait son or. Et des femmes passèrent aussi, des bourgeoises logées aux premières classes, Mme Bineau, aux rondeurs plantureuses, Mme Chabert, si chaste et si prude, court vêtue, le corsage négligemment ouvert, montrant des seins fanés par toute une vie d’austérité conjugale. Les Siciliennes à leur tour dévalèrent en un troupeau hurleur, où des marmots roulaient, piétinés, parmi les vociférations assourdissantes.
Une femme égarée, les cheveux épars, tomba aux pieds de Marzouk.
— Sauvez-moi ! Sauvez-moi !… Vingt mille francs pour vous, si vous me sauvez !
C’était Mme Larderet. Elle allait de l’un à l’autre, blême, éperdue, répétant la même supplication, s’accrochant aux vêtements des hommes.
D’abord, Marzouk fit un geste pour la repousser, mais l’ayant regardée, il s’arrêta, surpris, et ses yeux s’allumèrent tout à coup d’une concupiscence. Il la trouvait à son goût, grasse, tétonneuse, opulente.
— Reste-là, ma petite chatte, dit-il, et n’aie pas peur, on ne te fera pas de mal.
La pluie avait cessé, un rayon de soleil traversa les nuages, et une voix triomphale s’éleva dans le tumulte. Si-Mohamed, le fataliste musulman, chantait. Assis dans un coin, les jambes croisées, selon sa coutume, il était demeuré impassible durant tout le sinistre, le regard perdu dans une fixité vague, exprimant sa conviction inébranlable de l’inutilité de tous les efforts humains, de toutes les tentatives pour échapper au destin, à ce qui était écrit, à la loi mystérieuse et inéluctable qui dirigeait le monde et tous les êtres vers des fins ignorées. Allah seul était grand, la soumission seule raisonnable, tout le reste agitation vaine et folie pure. Sa voix aiguë et nasillarde recommençait sa mélopée bizarre, monotone comme l’infini, lente comme l’éternité, vague comme l’inconnu qui enveloppe les destinées humaines. Pourquoi tant de cris, de gémissements et de terreur ? Quand notre heure avait sonné, il n’y avait plus qu’à s’incliner. Inutile autant qu’absurde lui paraissait cet entêtement des hommes civilisés, ceux qui prétendent tout connaître, tout discuter, à lutter contre les événements… Ce qui arrive devait arriver, et tout, depuis le commencement des siècles, depuis la course des astres dans le firmament jusqu’à l’écrasement d’une fourmi, se trouvait ordonné par une puissance supérieure, en vue de l’harmonie universelle. Ainsi, le plus insouciant était le plus sage et le seul philosophe.
Marzouk se retourna vers cet étrange personnage, le considéra un instant, avec étonnement, sans comprendre.
— Qu’est-ce que c’est donc que cet oiseau-là ? murmura-t-il.
Si-Mohamed continuait à chanter.
— Veux-tu te taire ! s’écria Marzouk.
Si-Mohamed chantait toujours.
— Tais-toi, ou je t’écrase !
Mais la voix du fataliste s’éleva plus haut encore, bénissant cette fois Allah du don magnifique de son soleil qui venait de resplendir tout entier, en plein zénith, avec tant d’éclat et de soudaineté que l’Arabe lui-même dut clore un peu sa paupière dolente.
Alors, Marzouk, sentant qu’il n’y avait rien à faire contre une telle puissance d’inertie, se borna à hausser les épaules en s’éloignant.
Dès le lendemain, le temps se remit tout à fait au beau, la mer redevint aussi tranquille qu’au départ. Tout compte fait, en rationnant les vivres, on pouvait tenir deux mois, davantage même, grâce à la pêche. D’ici là le salut était possible. On se trouvait loin de la ligne des grands courriers de Bordeaux à Buenos-Ayres, mais l’Atlantique était aujourd’hui sillonné en tous sens par les navires. L’Eldorado lui-même avait laissé des épaves sur son parcours, qui aideraient à sa découverte. Tout espoir enfin n’était pas perdu.
Cependant, la nécessité d’une discipline s’imposant à tous, chacun, d’instinct, avait repris sa place. Seul, Marzouk avait déserté le quartier des émigrants et s’était installé aux premières, dans la meilleure cabine. Et d’abord, il se montra assez bon prince, prit les humbles sous sa protection, manifesta des sentiments de sociabilité, se créa même des partisans. Toute une petite cour s’organisa autour de lui : les garçons, les trois cuisiniers, les deux cambusiers, le boulanger, le boucher, le pâtissier-glacier, enfin à peu près tout le personnel qui, en temps normal, se trouvait placé sous les ordres directs du commissaire.
Ce dernier, qui n’était point né pour le commandement, n’avait pas tenté de maintenir son autorité, jugeant d’ailleurs toute résistance inutile autant que dangereuse. Admirable fonctionnaire, il continuait à tenir son livre de bord, jour par jour, avec une régularité et un abrutissement exemplaires.
Marzouk eut bientôt ses favoris : des intrigants et des flatteurs, ceux qui savaient le prendre. Le mulâtre devint son bras droit, en brute docile et dévouée, respectueuse de la force. Sur un signe du maître, il eût évidemment tout massacré, doué lui-même d’une musculature herculéenne.
Les deux maîtres d’hôtel gagnèrent également les bonnes grâces du despote ; ils avaient découvert son faible : l’amour-propre. Avant d’être champion des luttes à mains plates, Marzouk avait dompté des fauves dans les foires, et il montrait complaisamment deux blessures, la morsure d’un lion, le coup de griffe d’un tigre : deux animaux terribles que nul autre, à l’en croire, n’avait osé affronter. Un dur métier, affirmait-il, mais qui donnait des satisfactions, car il avait été l’amant de cœur de bien des dames, même d’une comtesse authentique, sans compter les petites grues de Montmartre qui lui offraient gentîment leurs modestes économies, toujours acceptées, sans reconnaissance. Et il en avait défloré des tas, de ces gigolettes faubouriennes, qui, depuis, avaient mal tourné. Les femmes aimaient les muscles puissants. Et il montrait ses biceps, qui avaient soulevé jusqu’à trois cents kilos. Quant au nègre, champion des luttes à mains plates dans le Nouveau Monde, qui l’avait provoqué, Marzouk en souriait de pitié, en faisant un simple geste du pouce pour montrer qu’il l’eût écrasé comme une punaise.
Telle était, en face du danger, sa confiance de brute habituée à vaincre, qu’il ne semblait pas avoir conscience de la situation présente. Ou plutôt quelque chose l’avertissait que son heure n’était pas venue, qu’il se tirerait encore d’affaire. Comment ? Il ne savait pas, ne cherchait pas ; il sentait ça, voilà tout.
Aussi, il engouffrait, d’un appétit effrayant, excité, disait-il, par l’air de la mer, et s’adjugeait les meilleurs morceaux, la part du lion. Dix bouches comme la sienne, les vivres eussent été épuisés en moins de huit jours. D’ailleurs, il n’acceptait à cet égard aucune observation malveillante. A chacun selon ses besoins.
A table, Marzouk occupait carrément la place d’honneur, celle du commandant. Un vrai coup d’État. Il ne causait guère, mais se livrait de temps à autre à quelque incongruité, pour embêter les bourgeois. Il eût aisément rivalisé de lyrisme avec un certain personnage d’un roman célèbre que, par hasard, il avait lu : La Terre. Les exercices éoliens de Jésus-Christ n’eussent paru, en comparaison, qu’un souffle léger, un zéphyr dérisoire.
Devant Mme Larderet seule, Marzouk contenait respectueusement le tumulte de ses entrailles. Il avait pour la vénérable veuve un petit grain de sentiment, roulait vers elle des regards de tendresse, lui pinçait parfois la taille. Mais elle se sauvait en jetant des cris éperdus.
— Il veut me violer ! Défendez-moi, défendez-moi !
Dans une minute d’égarement, elle avait imploré la protection du colosse ; maintenant, elle en avait peur, se cachait partout, passait des heures à fond de cale, pour qu’il ne la découvrît pas.
Personne, parmi ces Français chevaleresques, ne venait à son secours, ni Danglar, ni Conseil, ni M. Gallerand lui-même, encore étourdi par la tragique confession de sa femme et plongé dans une sorte de sommeil magnétique. Par moments, ses yeux troubles vacillaient dans son visage blême. C’était la fin de sa longue illusion, la banqueroute de toutes ses idées anciennes. Le monde, la vie lui étaient apparus brusquement sous un autre jour, et il sentait que quelque chose s’effondrait en lui, car il avait cru à tout, à la fidélité, à la reconnaissance, au désintéressement, doué d’un robuste optimisme, d’une candeur extraordinaire, sous sa rude écorce de vieux soldat. Ah ! de quelle fange était pétri le cœur humain ? Sa grande terreur à lui était d’exister encore, de n’être point déjà, avec ce navire, au fond de l’abîme et de l’oubli.
Un soir qu’il se trouvait à l’avant du pont, en proie à ces pensées sombres, il s’arrêta devant Si-Mohamed, cet être singulier qu’il avait considéré jusqu’alors comme inférieur, un barbare, une sorte d’inconscient ; et, surpris de sa sérénité, pressentant tout à coup qu’il y avait dans ce crâne une conception particulière des choses, peut-être juste, il rompit le silence farouche qu’il gardait depuis trois jours et entreprit d’interroger l’Arabe :
— Comment fais-tu pour être heureux ? lui demanda-t-il. Quel est donc le secret de ton insouciance et de ta tranquillité ? Pénètre-moi de ta philosophie consolante, qui ne regrette rien, qui pardonne tout, qui chasse la douleur et le remords, puisque, selon toi, tout est fatalité, puisqu’il n’y a ni libre arbitre, ni responsabilité humaine, ni coupable, ni crime, puisque tout ce qui advient est nécessaire… Apprends-moi à me soumettre, à tout excuser, à me résigner, à ne plus souffrir !
Mais Si-Mohamed n’entendait pas le français, il comprit pourtant que cet homme l’implorait et répéta ces deux mots : « Mektoub ! Rabbi Gibou ! » Puis, il fit un geste qui signifiait : va-t’en, laisse-moi. M. Gallerand s’éloigna lentement, avec un branle sénile de la tête.
Les autres passagers ne se souciaient pas davantage de protéger Mme Larderet contre les assiduités de Marzouk. Même, les dames n’en étaient point fâchées, car, pendant ce temps, l’ignoble brute ne les poursuivait pas. Danglar prétendait que Mme Larderet exagérait ses frayeurs et les brutalités dont elle se disait victime :
— Voyons, madame, il vous a à peine touchée.
— Je voudrais vous y voir ! riposta la veuve. Quand il vous touche, il vous broie les os… Il a des doigts de fer, des mains larges comme des épaules de mouton.
Conseil, cependant, crut devoir intervenir, un jour, par galanterie, et faire entendre à Marzouk, en emmiellant sa voix et avec des raisonnements subtils, qu’il se comportait d’une façon inconvenante. Le littérateur-conférencier ne manquait pas de séduction, ni de prestige. Dans la bonne société, il donnait le ton, exerçait une façon de royauté spirituelle. C’était un écrivain jeune encore, dans tout l’éclat du snobisme, homme du monde, bien pensant, très beurré. Ses livres pouvaient être mis dans toutes les mains. Entouré des dames, il parlait bien, le geste arrondi, la bouche en cœur. « Charmant, charmant », répétait-on. Et les salons l’avaient lancé. A bord, il avait un moment éclipsé le beau Danglar lui-même, toujours victorieux dans leurs assauts d’intellectualité, l’obligeant à s’en tirer par un fin sourire. Enfin, suivant l’exemple d’illustres devanciers, il s’était embarqué pour répandre sa belle réputation d’abord, le goût des belles-lettres ensuite, en Amérique. Irrésistible, l’illustre écrivain se flattait d’adoucir Marzouk. Mais, dès les premiers mots, celui-ci l’interrompit.
— Toi, va-t’en voir si j’y suis, là-bas, et un peu plus vite que ça.
Et vlan ! il lui lança à toute volée son pied dans le derrière.
Puis, il le rappela :
— Écoute ici… ramène-toi, j’ai à te parler.
Conseil s’avança comme un chien qu’on va fouetter.
— Comment t’appelles-tu ?… Ah ! réponds, si tu ne veux pas que je te corrige !
Le conférencier déclina son nom.
— Qu’est-ce que tu fais de ton métier ?
— Homme de lettres… rédacteur à la Revue des Deux Mondes.
Marzouk ricana.
— C’est pas un métier, ça, fit-il. Je crois que tu te fous de moi, sans que ça paraisse… Eh bien, ici, il n’y a plus de bourgeois, plus de fainéant. Faut que tout le monde travaille. A partir de maintenant, tu iras tous les jours à la cuisine, tu nettoieras les casseroles et tu éplucheras les pommes de terre… C’est compris ?… Réponds, nom de Dieu ! Ah ! je vois que ça va mal finir.
— Bien, bien, balbutia Conseil en se sauvant.
— J’irai voir tout à l’heure à la cuisine si tu y es, lui cria Marzouk.
Le pouvoir absolu commençait à le griser, il devenait un tyran intolérable. Certaines têtes lui déplaisaient, celle de M. Rolande, entre autres ; et, un matin, sans raison, il le chassa des premières, avec défense expresse d’y remettre les pieds. Puis, il leur distribua à tous des besognes, les plus sales corvées, ordonnant aux uns de nettoyer le pont à grande eau, aux autres de balayer le salon ou de laver la vaisselle. D’un Anglais très digne, qui portait de beaux favoris, il prétendit faire un maître d’hôtel spécialement attaché à son service.
D’ailleurs, méfiant et soupçonneux comme tous les despotes, il avait organisé l’espionnage pour déjouer les complots. La nuit, le mulâtre couchait à la porte de sa cabine, et lui-même dormait avec un revolver chargé, à ses côtés.
Les matelots ne se liguaient pas contre lui ; il ne les gênait point, n’exerçant son empire que sur les bourgeois. Même, il était au mieux avec tous les hommes de l’équipage, les favorisait dans la distribution des vivres. Et c’était aussi pour eux le repos. Puisque les passagers de première faisaient tout le travail, les autres n’avaient plus qu’à se croiser les bras. La paix, l’ordre, la discipline régnaient à bord. Marzouk s’était presque rendu populaire. Tous ces bourgeois si fiers, si dédaigneux, quand ils étaient les maîtres, il les avait tout de même rudement matés. Aucun n’osait broncher, et rien n’était comique comme de les voir turbiner. Les pauvres bougres, qui avaient toujours pâti, se régalaient de ce spectacle. Le peuple était vengé. Et la confiance même renaissait, Marzouk communiquant à tous son optimisme, assurant qu’on serait sauvé. Par son ordre, un bourgeois se trouvait posté là-haut, de l’aube au crépuscule, pour surveiller l’horizon et signaler le premier navire qui apparaîtrait.
Plusieurs jours s’écoulèrent. Les masques tombaient des visages. Plus d’attitude, de politesse, de minauderie décente, de convenance sociale. On ne se gênait plus vis-à-vis les uns des autres. Chacun se révélait dans la vérité de sa nature, et l’arrière-boutique des âmes commençait à exhaler une odeur forte.
Une énorme ménagerie où se mêlaient toutes les variétés de la bête humaine : il y avait des tigres, des hyènes, de pauvres moutons résignés, quelques bons chiens fidèles et suiveurs, des chats qui se tapissaient dans leur petit coin, des taupes qui se cachaient dans les flancs du navire, des oiseaux nocturnes, invisibles tout le jour, et des porcs en grand nombre. Enfin, toutes sortes d’animaux sauvages, féroces et domestiques, de tous pays et de toutes races, vivant ensemble sous la trique implacable de Marzouk.
Malgré les pessimistes et les pleureurs, la plupart espéraient toujours, ou se familiarisaient avec l’idée de la mort, à force de l’envisager. On se faisait une philosophie. Peu à peu, après l’abattement, la consternation des premières heures, toutes les puissances vitales reprenaient possession des âmes et s’exaspéraient au seuil du néant. C’était une rage charnelle, un rut formidable. La vie prenait sa revanche sur la mort.
Marzouk, à cet égard, se montrait plein de tolérance, à une seule condition : lui d’abord, les autres après. Quelques couples pourtant lui échappaient, ou il les épargnait, soit par indifférence, soit qu’il craignît une résistance désespérée, soit par bonté pure. André et Myrrha passaient sous ses regards attendris et protecteurs. Les deux amants inséparables avaient l’air de ne plus connaître de l’univers que le goût de leurs lèvres ; ils répandaient autour d’eux des bouffées de jeunesse, d’insouciance et de fraîcheur. Marzouk lui-même aimait à respirer ce parfum. Partout ailleurs, dans son empire, c’était une étrange odeur d’auge et d’étable mal tenue, car les bourgeois mêmes se négligeaient. Des dames du meilleur monde renonçaient aux premiers soins de la toilette. Des adultères étaient déjà consommés. Mme Denain ouvrait ses bras à M. Darel ; Mme Avelard glissait, soutenue par M. Dantec, sur la voie des curiosités sensuelles ; Mme Carigues, une hystérique, éprouvait le frisson nouveau sous les puissantes caresses de Marzouk. Dans trois mois, si on vivait encore, on commencerait à voir des ventres s’arrondir. Des maris, sévères en d’autres temps, en venaient insensiblement à une conception indulgente et résignée des choses. Qu’importaient maintenant l’opinion, les préjugés, la morale, puisqu’il n’y avait plus de sanction ? Plus rien n’existait, que l’épouvante de la mort, pour ceux qui ne croyaient pas à l’au-delà ou qu’une conscience très haute, rare parmi les hommes, ne préservait point du vertige, au bord du gouffre. Si l’on était perdu, pourquoi garder encore la camisole de force des conventions sociales ? Si, par miracle, on se sauvait, on mettrait tout au compte de la folie. Vaguement, ce dilemme se posait au fond des âmes. Et, tandis que les épaules pliaient sous l’écrasant destin, les yeux luisaient de luxure, pareils à des charbons, sous des fronts livides de condamnés à mort, trahissant la fièvre de vivre, de savourer les dernières voluptés, d’étancher toutes les soifs, la soif brûlante des passions inassouvies.
Parfois, la nuit, deux ombres mélancoliques glissaient le long du navire. C’étaient Armand Reboul et Mme Rolande. On ne les entendait pas, ils ne parlaient pas, soit qu’ils n’eussent rien à se dire, soit que leur silence fût chargé de plus de sentiments que n’en peuvent exprimer les paroles, soit que celles-ci eussent troublé la confidence muette de leurs âmes, soit qu’il y eût entre eux déjà des choses qu’ils ne voulaient point s’avouer. Ils allaient et venaient ainsi, avec des souplesses de fantômes, d’un bout à l’autre du pont, dans la torpeur accablante de ces nuits équatoriales, où pas un souffle ne faisait frissonner l’atmosphère. Tout le jour, ils restaient enfermés dans leur cabine, par crainte et par dégoût, ne se risquaient dehors qu’à l’heure où les ténèbres envahissaient cette humanité misérable, apaisant la furie, cachant la honte et l’abjection. Il y avait alors dans la nature, sous le ciel impassible et criblé d’étoiles, quelque chose de mystérieux et de très doux, venu de l’infini, qui les pénétrait d’une langueur ineffable. Parfois, vers le milieu de la nuit, la lune, versant çà et là son crépuscule errant et ses pâleurs, éclairait leurs visages. Ils n’avaient pas changé, intenses tous deux et comme chargés de tout ce que l’existence laisse derrière elle de rêves irréalisés. Les yeux de l’amant disaient un idéal inaccessible ; ceux de Mme Rolande songeaient, profonds comme ces sentiments qu’on ne se déclare pas à soi-même. Leurs lèvres se rencontraient encore, mais leurs baisers étaient aussi loin du secret de leur être que la volupté du bonheur.
Une nuit, un bruit vague, à peine distinct, comme le vol velouté d’une chauve-souris qui vous frôle, les fit se retourner.
M. Rolande était devant eux.
— Je vous dérange ? dit-il.
Les deux amants demeurèrent muets. Deux fois déjà, M. Rolande les avait surpris dans leurs étreintes, et il n’avait rien dit, il s’en était allé, feignant de n’avoir rien vu, avec le détachement d’un homme qui, devant la mort, oppose à la fatalité une conscience profonde de l’inanité de toutes choses. Son ombre se traînait dans les ténèbres, indécise et lente, tel un spectre revenu d’un monde où l’on ignore les passions humaines, les tourments de la jalousie et la trahison. Pourquoi donc intervenait-il, à présent ?
Mme Rolande s’étonna de n’éprouver qu’une faible émotion. Elle avait vécu quinze ans avec cet homme et se sentait plus éloignée de lui que s’ils avaient habité l’un et l’autre aux deux extrémités de la terre.
— Que nous voulez-vous ? dit enfin Armand, comme parlant à un étranger qui s’insinue indiscrètement dans des affaires privées.
Mais M. Rolande ne lui fit aucune réponse. Il avait l’air de ne pas le connaître, de ne pas l’entendre, de ne pas le voir. Il s’adressa à sa femme, et sa voix était lointaine, d’un accent tout autre, sans colère, sans amertume, sans regret, sans ironie ; on eût dit qu’elle avait peine à franchir les espaces qui séparaient son âme ancienne de son âme présente.
— Je ne vous reproche rien, lui dit-il, puisque je n’avais pas su vous rendre heureuse. J’ai expié toute une vie de malechance. Ne craignez rien de moi désormais, je ne viendrai plus vous troubler, car j’appartiens à un monde d’où l’on ne ressuscite pas : celui du renoncement. Mon esprit a déserté le corps que j’habitais, en y laissant les convoitises et les passions qui font de l’existence une lutte et un tourment sans trêve. Le mauvais rêve de la vie s’est dissipé pour moi. Je ne souhaite plus rien, tout le mal dont j’ai souffert, venant d’avoir trop souhaité. N’ayez donc aucun remords à mon sujet, car j’ai atteint au repos et à la sérénité définitive.
Mme Rolande avait baissé les paupières. Quand elle les rouvrit, n’entendant plus la voix, l’ombre avait disparu. Elle éprouva alors, en levant les yeux au ciel, un sentiment nouveau ; il lui sembla que tous les désirs de la terre étaient comme le reflet des astres qui brillaient à travers ses larmes.
— Peut-être, murmura-t-elle, avons-nous eu tort de mépriser cet homme.
Danglar s’assombrissait. Pour la première fois, les nuages de méditation passaient sur ce front de diplomate. Il réfléchissait aux moyens d’abattre la détestable puissance de Marzouk.
Il ne fallait pas songer à quelque coup de force. Rien à espérer d’une surprise, d’un guet-apens. Le tyran se tenait sur ses gardes, dormait en gendarme, avec un œil constamment ouvert sur la malignité des bourgeois. Seul, quelque subtil stratagème pouvait réussir. Quand on n’est pas le plus fort, il faut être le plus fin.
Bien pénétré de ce principe, Danglar repassa en sa mémoire les hauts faits de la diplomatie célèbres dans l’histoire. Par elle, on avait amolli des despotes réputés intraitables.
Soudain, le front de Danglar s’éclaira, touché par la grâce du génie. Il avait son plan. Il s’agissait de trouver à Marzouk sa Pompadour ou sa du Barry. Mme Larderet était toute désignée. L’ancien dompteur la pourchassait dans tous les coins ; c’était elle qu’il voulait, et sa passion s’irritait d’une résistance inexplicable… Une ancienne grue, qui avait autrefois couché avec des nègres, et qui maintenant jouait à la vénérable veuve, ayant eu l’adresse de se faire épouser par un paillard, et la chance de l’enterrer et d’en hériter… Assez de comédie ! Marzouk n’était pas plus répugnant qu’un nègre ; on le ferait entendre à Mme Larderet, si, de bonne grâce, elle ne consentait à se dévouer. Mais d’abord il était habile de chercher à la convaincre par de nobles raisons.
La nuit suivante, Danglar se leva. Le ciel était noir, la mer tranquille, le silence régnait partout, troublé seulement par les ronflements du mulâtre, couché en bon chien de garde devant la cabine de son maître.
Le diplomate réveilla, puis réunit en conciliabule quelques compagnons, ceux sur qui pesait le plus lourdement l’abominable autocratie de Marzouk. C’étaient Conseil, M. Avelard, Mme Larderet, Mme Chabert, Mme Bineau et le beau Rienzo, le chef des Tziganes, le plus à plaindre, peut-être, car Marzouk l’obligeait à gratter du violon, tout le jour, sans discontinuer. Par une étrange contradiction de la nature, le monstre adorait en effet la musique, qui adoucit les mœurs.
— Mes amis, dit Danglar, la situation qui nous est faite est atroce.
— Atroce, atroce ! répétèrent-ils tous, d’une même voix colère et désolée.
— Elle se trouve encore aggravée, reprit le diplomate, par un despotisme barbare, odieux, intolérable… C’est la société qui recommence, c’est le règne de la force brutale, le pire état social qui se puisse concevoir, et nous pourrions nous croire revenus à des temps préhistoriques… Mais l’heure n’est point de nous livrer à des considérations philosophiques ; il faut prendre une résolution, il faut agir.
— Oui, oui, clama l’assistance.
— Toute révolte cependant serait vaine, poursuivit gravement Danglar, nous ne pouvons recourir à la violence contre la violence. Nous n’avons pas d’armes, et il n’est point parmi nous de David pour terrasser ce nouveau Goliath. J’avais bien pensé un instant à corrompre le mulâtre, mais il m’a paru trop dévoué à son maître ; nous serions trahis… Enfin, mes chers amis, j’ai tout examiné, j’ai mûrement réfléchi…
Le diplomate s’interrompit et regarda fixement Mme Larderet.
— Seule, une femme, conclut-il, par la toute puissance de sa séduction, en exerçant son empire sur notre tyran, serait capable de nous délivrer du joug horrible que nous subissons.
— Comment ? Que dites-vous ? Veuillez vous expliquer davantage, demanda Mme Larderet qui se sentait clairement désignée.
— Madame, déclara solennellement Danglar, notre salut dépend de vous seule, car vous seule, ici, si vous consentiez…
— N’achevez pas, monsieur, j’ai compris, s’écria Mme Larderet congestionnée de colère… Vous voudriez, n’est-ce pas ? que je joue, pour vous assurer la tranquillité, le rôle de Dalila ou de Boule-de-Suif… Vous voudriez que je me jette dans les bras de ce monstre !
— Il est des circonstances, affirma M. Avelard, qui exigent un courage, une abnégation exceptionnels.
Mme Larderet lui lança un coup droit.
— Vous, monsieur, allez donc voir comment se comporte votre femme, en ce moment-ci !
M. Avelard écarquilla de grands yeux stupides.
— Oh ! ne faites donc pas l’imbécile, ajouta-t-elle, vous savez fort bien ce que tout le monde sait et voit, à bord.
M. Avelard se redressa pour riposter :
— On en voit bien d’autres, à bord. Il s’y passe des horreurs !… Ah ! ne me forcez pas à parler !
Il y eut des chut ! chut ! dans l’assistance, et Conseil crut devoir intervenir pour apaiser la querelle.
— Il est fatal, dit-il, dans la situation effrayante où nous sommes, qu’il se crée une mentalité spéciale, comme un déplacement des idées et de la morale, si je puis m’exprimer ainsi. On ne voit plus les choses de la même façon, certains vieux préjugés s’effacent, chacun cède un peu à ses instincts… Aussi devons-nous être très indulgents les uns envers les autres… Hé ! mon Dieu ! pour le peu de temps qu’il nous reste à vivre !…
— C’est vrai, c’est parfaitement vrai, hélas ! soupira Mme Chabert. Ainsi, moi-même, je me dis quelquefois : pourquoi ne profiterait-on pas de ses derniers jours ? Cela ne ferait de tort à personne et l’on s’en irait avec moins de regrets !
— C’est exactement ce que je pense, avoua Mme Bineau, et j’ai toujours été une honnête femme, je vous le jure.
Mme Chabert sentit une main légère, celle de Conseil, lui frôler la taille, tandis qu’à la faveur de l’obscurité, Rienzo, interprétant les paroles qu’il venait d’entendre comme une invitation discrète, tapotait tendrement la fesse de Mme Bineau, sans qu’elle parût s’en émouvoir.
— Aussi, ajouta-t-elle, notre honorable compagne, Mme Larderet, a-t-elle vraiment tort de s’offenser.
— D’autant plus qu’elle m’a mal compris, déclara Danglar. Qu’ai-je dit ? qu’elle seule pouvait obtenir de notre tyran un peu d’humanité.
— Il me persécute, gémit Mme Larderet.
— Parce que vous lui résistez, répliqua Mme Chabert ; si vous saviez le prendre, vous auriez la paix, et nous aussi.
— Marzouk est un très bel homme, insinua Rienzo.
— Il manque d’élégance et de distinction, mais il a la beauté de l’hercule, appuya Danglar.
— Nous n’ignorons pas, madame, reprit Conseil, la valeur du sacrifice que nous vous demandons. Votre dévouement, en pareil cas, serait interprété comme un de ces actes d’héroïsme dont l’histoire nous offre quelques exemples, et vous n’en deviendriez que plus respectable à nos yeux.
Mme Larderet fit explosion :
— Mais pour qui me prenez-vous donc, tous ? Je suis une honnête femme, sachez-le.
— Heu ! heu ! fit Danglar.
— Il est vrai que madame est depuis longtemps rangée des voitures, ricana M. Avelard.
— Je crois, dit Conseil, qu’il serait malséant de rappeler le passé de madame. Cela ne regarde personne.
— A tout péché miséricorde, prononça Mme Bineau.
— Tout de même, Marzouk n’est pas plus répugnant que bien d’autres, déclara Mme Chabert d’une voix aigre, et quand on a fait la noce pendant dix ans, on a tort de faire tant la dégoûtée.
— J’ai été moins garce que vous ! s’écria Mme Larderet.
Tous s’interposèrent. Conseil reprit aussitôt la parole.
— Mes chers compagnons, ceci est tout à fait déplorable ! Nous n’avons rien à nous reprocher les uns aux autres, nous sommes tous égaux, aussi humbles dans le malheur et devant la mort. L’esprit de fraternité doit seul régner parmi nous, en ces jours sinistres… Il convient de laisser à Mme Larderet le temps de réfléchir, et j’ai la conviction qu’elle obéira au sentiment du devoir qui commande à chacun de nous, pour le salut de tous, le dévouement, l’abnégation, le sacrifice.
— Très bien ! très bien ! approuvèrent plusieurs voix.
En ce moment, un bruit se produisit, semblable à une sorte d’éboulement. Les conjurés prirent peur et se dispersèrent. Danglar retint Mme Larderet pour la catéchiser. Mme Chabert accepta le bras de Conseil, Rienzo suivit de près Mme Bineau. L’heure était nuptiale, on allait s’unir. Rienzo n’en doutait pas, Conseil en était sûr.
Brusquement, Marzouk surgit des profondeurs d’ombre.
Il s’était levé, dévoré par l’insomnie et le rut. Depuis un quart d’heure, il se tenait là, guettant une proie, immobile et frémissant, la bouche redoutable, les membres raidis, irrité d’un désir sans cesse plus aigu qui accentuait la bestialité de sa figure. Des ténèbres s’exhalaient des senteurs fortes qui exaspéraient jusqu’à la torture sa puissance de mâle inassouvi. Une fureur sensuelle secouait le colosse.
Mme Chabert l’aperçut, jeta un cri. Marzouk se précipita :
— C’est assez de chichi comme ça ! fit-il. Faut que l’une y passe !
Il cria à Mme Bineau qui s’enfuyait :
— Toi, sacrée toupie, je te rattraperai, tu y passeras aussi.
Et, sur-le-champ, il viola Mme Chabert.
Conseil et Rienzo s’étaient éclipsés.
Quand l’acte brutal fut consommé, Marzouk se redressa, apaisé soudain. Ses muscles se détendirent dans une sorte de retrait bienfaisant, sa poitrine se souleva, rendit un grand soupir de satisfaction et de béatitude que lui renvoya, du fond de l’horizon, à travers l’Océan, la nuit tiède et sereine. Il sentit en lui une bienveillance extraordinaire, il aida galamment Mme Chabert à se relever.
— A une autre fois, la petite bourgeoise, dit-il. T’es plus gironde que je n’aurais cru… Quand tu voudras, tu sais, je suis toujours prêt.
Mme Chabert s’éloigna sans répondre, pâle encore du frisson involontaire qu’elle avait éprouvé dans les bras du colosse. Ses puissantes caresses lui avaient coulé dans les veines une ivresse nouvelle et inattendue, qu’elle n’osait s’avouer, dont elle avait honte. Instinctivement, dans un spasme d’irrésistible volupté, elle l’avait étreint elle-même. Elle sentait qu’il l’aurait encore, quand il voudrait.
Marzouk, très fier, aspirait la grande paix qui tombait des étoiles. Il n’avait pas envie d’aller se recoucher. Un désir de s’émoustiller un peu le chatouilla. Que se passait-il à bord, à cette heure avancée ! De l’escalier des premières, s’ouvrant sur le pont, s’exhalaient, comme d’un soupirail, d’âpres émanations, une fauve odeur de luxure. Les narines de Marzouk se dilatèrent. Il devait y avoir quelque chose de pourri dans son royaume. Faut aller voir ça, se dit-il. Et il descendit, longea le couloir des cabines, sans bruit, l’oreille attentive… Ah ! les bourgeois ne s’embêtaient pas, pendant la nuit ! Partout des soupirs, des baisers, des cris de passion. Derrière une porte close, c’était un étrange bruit de ripaille : quelques malins sans doute qui, ayant réussi à subtiliser des vivres et de la boisson, au détriment de la communauté, faisaient une noce effrénée et probablement dégoûtante. Il y en avait qui se raillaient de tout, narguaient le destin et la mort. Puisqu’on vivait encore, autant jouir !
— Elle est farce, elle est rien farce, pensa Marzouk.
Il remonta sur le pont. Il n’avait pas tout vu, il voulait savoir. Une ronde nocturne s’imposait, qui lui dévoilerait peut-être des mystères, des complots, des choses qu’il ne soupçonnait pas.
Mais un profond silence s’abattait autour de lui, bourdonnant à ses oreilles. Les ténèbres enveloppaient tout, et Marzouk lui-même, dans leur inconnu troublant, ressentit une sorte d’angoisse, l’angoisse de ces mille existences perdues dans une immensité, séparées du reste de l’univers. L’impassible nature lui asséna son inexorable insouciance de toutes les détresses humaines.
— Fichtre ! murmura-t-il, ce n’est pas rigolo, tout de même.
Du haut de la dunette, l’Eldorado, très penché sur tribord, immobile, ressemblait à quelque gigantesque bête morte sur laquelle grouillait toute cette humanité, comme de la vermine vivant de sa chair, dévorant le cadavre jusqu’au squelette. Et Marzouk eut une horrible vision : la famine, au bout de quelques semaines, les vers se mangeant entre eux, et lui-même, dernier survivant, sur un monceau de charognes infectant l’atmosphère. Un frisson le parcourut des reins à la nuque. Il promena son regard à l’entour. Jamais la nuit ne l’avait impressionné à ce point. Le calme en était effrayant. Çà et là, des fanaux allumés projetaient sur l’Océan des queues de comètes, que brisait une grande masse d’ombre haute et tragique. C’était l’Abrolhos, dressé dans les ténèbres, ainsi qu’un fantôme géant.
Mais un bruit lent et rythmé attira son attention, il se glissa le long du bastingage, en cherchant à percer l’obscurité de son œil aigu. D’abord, il ne vit rien ; peu à peu cependant une forme, qui se détachait des flancs du navire, se dessina, puis apparut nettement sous la lueur d’un fanal. L’unique chaloupe de l’Eldorado gagnait le large, chargée de vivres, ayant à son bord le dernier lieutenant, le chef mécanicien et deux hommes de l’équipage.
— Hé ! dites-donc, là-bas, cria Marzouk, vous pourriez bien me faire une place, je suis solide, vous savez, et bon rameur. Je ramerai tout le temps !
Mais un plus lourd silence tomba. L’embarcation continuait à s’éloigner à force d’avirons. Alors, il hurla d’une voix rauque et navrée.
— Ah ! bandits ! faux frères ! ça ne vous portera pas chance, vous crèverez avant nous… Allez ! En route pour l’éternité !
Un moment, il les suivit des yeux, comme si cette barque emportait sa dernière espérance, avec sa malédiction. Ces lascars-là, qui l’avaient roulé, étaient bien capables de gagner la côte ! Alors, il n’y avait plus de justice ! Marzouk se sentit tout près du désespoir. Mais bientôt sa belle confiance le reprit. Non, il ne se voyait pas mort encore.
Sa colossale stature se raidit, il bomba la poitrine comme pour braver le mauvais sort. Toutefois, il importait désormais de surveiller les bourgeois de plus près.
L’idée lui vint d’explorer les secondes classes. Autour d’une table, les cabots, très ivres, dodelinaient lourdement de la tête. C’était la troisième fois qu’il les surprenait en cet état.
— Eh bien ! quoi, fit-il, on ne dessoule donc plus ?… Avec vous, le liquide, ça ne s’évente guère.
Mais il ne leur adressa aucun autre reproche, pris de bonne humeur devant cette orgie. Il avait de la sympathie et du respect pour les pochards, s’honorant en eux, car lui-même avait, plus souvent qu’à son tour, son coup de sirop.
— Oui, nous sommes saoûls comme des cochons, finit par répondre M. Séraphin, le jeune premier.
— Vous êtes dans le vrai, déclara Marzouk.
Et il prit un verre, trinqua avec ceux, puis embrassa les femmes à pleine bouche.
Rempli d’une allégresse, il regagna le plein air pour dissiper les vapeurs de l’ivresse. Deux ombres s’avançaient à l’arrière du navire. Il se dissimula pour leur faire une farce.
C’étaient Danglar et Mme Larderet. Enfin, le diplomate avait convaincu la vénérable veuve. Elle était décidée au sacrifice.
— Puisqu’il le faut, puisque c’est l’intérêt de tout le monde ! soupira-t-elle.
— Vous rachèterez votre passé, vous grandirez dans notre estime, affirma Danglar, car, vous vous élevez à l’apostolat.
Marzouk, sortant de sa cachette, leur barra brusquement le passage.
— Halte-là ! Ne bougeons plus !
Mais quand il eut reconnu Mme Larderet, il s’attendrit :
— Ah ! c’était toi, ma petite chatte. Fallait prévenir !… Viens. Lâche-donc ce mufle.
Et se tournant vers Danglar :
— Va-t’en, on n’a plus besoin de toi… Veux-tu te trotter plus vite que ça, vaurien, pourri !
Le diplomate disparut. Marzouk entraîna Mme Larderet. Tous deux avançaient sans se voir, tant la nuit était noire. Il cherchait en vain quelque chose de gentil à lui dire ; les mots s’étranglaient dans sa gorge ; il ne savait pas parler aux femmes du monde. Tout son être, cependant, s’enflait de tendresse et de sentiments délicats.
— On va faire dodo, dit-il.
— Pas encore, murmura-t-elle, tremblante… Il fait si bon !
Leurs pieds heurtèrent un obstacle. Marzouk, en se baissant, aperçut Rienzo blotti dans un coin.
— Ça se trouve bien, déclara-t-il au tzigane… Va chercher ton jambon.
Rienzo, ahuri, affectait de ne pas comprendre.
— Ton violon, parbleu ! précisa Marzouk. Tu vas nous jouer tous tes petits airs… Nous t’attendons ici.
Il fit asseoir Mme Larderet et prit place à côté d’elle. Rienzo, revenu avec son instrument, attaqua une valse langoureuse. Son dernier coup d’archet s’éteignit en une plainte lente et désolée, et qui semblait demander grâce. Mais aussitôt il dut recommencer.
— Une autre, une autre, réclamait Marzouk, impérieux.
Le tzigane râclait éperdument. Il était environ trois heures du matin. L’horizon pâlissait déjà. La belle nuit sereine s’adoucissait encore à l’approche du jour. Dans le ciel limpide, les étoiles vacillaient, et la mer assoupie frissonnait à peine sous la clarté d’aurore qui envahissait l’orient.
Marzouk, les yeux en l’air, semblait rêver, tandis que sa main droite, glissée sous les jupes de Mme Larderet, cherchait la chair.
Danglar ne s’était point mépris. A dater de ce jour, Marzouk, amolli par la volupté, devint le modèle du parfait souverain. Toutefois, incommodé lui-même, à la longue, par l’odeur rance qui s’exhalait des âmes à nu, il expulsa les bourgeois des premières classes.
— Décanillez ! leur dit-il. Allez faire vos saletés ailleurs… où vous voudrez. Je vous ai assez vus.
Et il avait cédé leurs cabines à d’honnêtes familles d’émigrants.
Il s’était, cependant, réservé un sérail, qui se composait de Mme Larderet, sa favorite, et de quelques menues bourgeoises de rechange.
Armand Reboul et Mme Rolande réussirent à se loger aux secondes classes. Par une faveur spéciale du despote, André Laurel et Myrrha gardèrent leur couchette.
Les autres s’étaient casés un peu partout, au petit bonheur. Impotents, les mains maladroites, incapables d’initiative, engourdis par leurs habitudes de bien-être somnolent, ils tombaient au plus bas degré de l’état anarchique, en devenaient les parias et les martyrs. Leurs beaux titres de rentes, maintenant, valaient moins que leur poids de papier. Le veau d’or, relégué par delà un océan infranchissable, semblait une divinité démodée et dérisoire. Depuis six semaines qu’on était là, entre deux immensités formidables, le ciel et l’eau, les vivres s’épuisaient, l’espoir s’éteignait, et, à mesure que diminuaient les chances de salut, le désarroi moral, la folie de luxure, la soif des désirs inapaisés s’exaspéraient jusqu’au paroxysme ; toutes les puissances de la nature, en lutte contre la mort, faisaient irruption.
Chacun, à qui mieux mieux, se dépouillait de cette camisole de force morale qu’infligent les convenances sociales. Les formules de politesse étaient abolies. La peur du gendarme ou de l’opinion n’entravait plus la libre expansion des énergies humaines, on obéissait à la nature, on disait tout ce qu’on pensait, et c’était horrible.
André Laurel s’affligeait de ce spectacle.
— Eh bien ! gamin, lui dit Myrrha, le voilà ton Eldorado, la société de tes rêves, tu assistes à la réalisation de ton idéal.
— Oui, c’est du propre ! soupira le jeune homme.
— Regarde, reprit Myrrha, il n’y a plus d’autorité, il n’y a plus que Marzouk, c’est la libre anarchie que tu souhaitais. Tous les gens y sont égaux, mais non pas frères, hélas !
Elle avait une figure claire et riante d’amoureuse ravie, de jeune épousée en pleine lune de miel. Il semblait que le bonheur eût opéré le miracle d’une guérison. Visiblement, elle revenait à la santé, s’épanouissait comme une plante au soleil. Aucune ombre d’inquiétude ne passait dans ses prunelles. « Je sens, lui disait-elle, que nous vivrons longtemps. » A la voir parée toute de tulle blanc, on eût dit une statue de neige vivante prête à se fondre sous la chaleur tropicale. Le visage gardait sa pâleur admirable, avec de grands yeux à la fois ardents et candides. Grande, mince, souple comme un roseau tremblant, sa grâce s’efforçait à ne pas être hautaine. Elle avait cette aristocratie qui ne tient ni à la naissance, ni à la race, mais à l’âme elle-même, à la qualité et à l’intensité des sentiments.
Mais André Laurel, ce soir-là, était tout autre ; une grande mélancolie lui venait de ses pensées anciennes et d’un retour sur lui-même. L’utopie dont il avait vécu, dont s’était exaltée son imagination, se dissolvait comme une bulle de savon. L’expérience lui criait la dérisoire disproportion de la réalité avec les rêveries grandioses et naïves… Et c’était pour cela qu’il était parti, qu’il avait fait le désespoir des siens ! pour cela qu’il avait voulu souffrir, se sacrifier et tout abandonner, croyant que le bonheur des hommes était dans la liberté et que d’elle seule pouvait naître l’harmonie fraternelle !
Maintenant, il voyait son erreur ; la réalisation de sa chimère étalait sous ses yeux un spectacle abominable, ce déchaînement de passions, de fureurs et de vices, la bête humaine se révélant dans toute la vérité de la nature, dévêtue de ses oripeaux, délivrée de ses entraves.
Non, décidément, les hommes ne méritaient pas la liberté, cette liberté absolue que réclamaient si imprudemment les apôtres de l’anarchie. Elle n’avait d’autre effet que d’enfanter la pire des tyrannies, le règne de la violence, de la force brutale, écrasant la faiblesse. André songeait à tous les sentiments bas, toutes les haines qui fermentent en silence au cœur même des plus purs. Le sage lui-même, au dire d’un juste proverbe, péchait sept fois par jour. Or, entre la pensée et l’action, il n’y avait que la crainte du gendarme ou du code, et cette crainte seule, souvent, différenciait l’honnête homme du coquin. Le gendarme et le code supprimés, toutes les pensées mauvaises entraient aussitôt en action.
— Oui, c’est du propre ! répéta-t-il… Ah ! la vilaine chose, la vilaine chose !
— Alors, tu regrettes d’être parti ? demanda la jeune femme.
— Non, Myrrha, puisque je t’ai trouvée. Et il ne pouvait y avoir pour moi de plus grand bonheur. L’amour seul ne m’a point déçu. Nous ne nous quitterons jamais, car je n’ai plus d’autre culte et d’autre espérance que toi. Je renonce à mes autres rêves, je reconnais que je m’étais trompé. Sans cette funeste expérience, j’aurais été longtemps dans l’illusion et dans l’erreur, et peut-être aurais-je fait le mal avec les meilleures intentions et les plus généreux enthousiasmes. Si nous nous sauvons, nous reviendrons en France, nous nous marierons et nous vivrons comme d’honnêtes bourgeois, car je crois bien que la société organisée, malgré tout ce qu’on en peut dire, vaut mieux que l’anarchie… Vois-tu, Myrrha, les hommes ne sont pas encore assez sages pour se passer du sergent de ville. Les institutions valent mieux que les gens.
— Laisse ces pensées, fit Myrrha.
Elle lui passa la main au front comme pour en chasser la fumée des songes creux. Mais elle-même fut prise d’une inquiétude soudaine.
— Il faut bien tout de même que nous finissions par le lui dire, murmura-t-elle.
— A qui ? demanda-t-il.
— A ma tante… Tu comprends, je n’ai pas osé encore, j’avais peur de lui faire de la peine… Elle est si bonne, cette pauvre tante, et elle m’aime tant !
— Crois-tu qu’elle n’ait pas deviné déjà, à nous voir si souvent ensemble ?
— Sans doute, car j’ai aperçu plusieurs fois de la tristesse et des reproches dans ses yeux… Même, un jour, elle nous a surpris juste au moment où tu m’embrassais. Mais peut-être ne s’imagine-t-elle pas que nous ayons été plus loin.
— Elle ne t’a jamais questionnée ?
— Si.
— Et qu’as-tu répondu ?
— J’ai menti… C’est très vilain, n’est-ce pas ?
— Oui.
— Alors, que faire ?
— Il faut tout lui dire.
— J’aurais honte.
— Il y a des circonstances atténuantes.
— Alors, tu parleras, tu expliqueras, tu seras éloquent…
— Si je peux… Je n’ai pas la parole très facile, tu le sais bien.
Leurs cœurs battaient très fort.
— Viens, dit-elle… Elle verra bien dans tes yeux que tu es honnête, et tu n’auras pas besoin peut-être de faire de longs discours.
Ils errèrent longtemps à la recherche de la tante et la découvrirent enfin seule, blottie dans un coin, près du cabestan, avec cet air de douce abnégation qu’ont les vieilles filles, quand elles s’autorisent à rêver un peu. Ses mains délicates tremblaient légèrement, tandis que ses prunelles s’éclairaient de la petite flamme discrète et mélancolique des félicités imaginaires et inaccessibles. Mais quand elle vit s’avancer vers elle les deux amants, elle se redressa, redevint grave, surprise, ne comprenant pas, car, jusqu’à ce jour, ils s’étaient cachés d’elle. Ils étaient très rouges, très émus.
— Tante, dit Myrrha, je te présente mon mari.
La vieille fille fut un moment interloquée, puis balbutia :
— Quoi !… Que dis-tu ?… Tu perds la tête, ma pauvre Myrrha.
— Non, tante, c’est la vérité. Nous nous aimions, et nous ne pouvions pas attendre… tu comprends… Alors, ça s’est fait ainsi, sans le consentement de personne… Regarde, nous sommes heureux, ne nous gronde pas.
— Comment ? Est-ce possible ?… Tu as fait cela, toi, Myrrha ! bégaya de nouveau la vieille.
— Nous nous étions crus perdus, expliqua Myrrha, nous pensions n’avoir plus qu’une heure à vivre… Alors, nous nous sommes mariés… comme ça, sans cérémonie, tout de suite. Est-ce que tu aurais attendu, toi, ma tante, à ma place ?
— Ce n’est pas notre faute, c’est la faute des choses, ajouta André.
— Il faut que tu nous pardonnes, dit Myrrha… Quand nous serons de retour en France, tu vivras avec nous, nous ne te quitterons jamais, nous t’aimerons, et tu seras heureuse… N’est-ce pas, André ?
— Oui, oui, confirma le jeune homme, nous vous aimerons bien, nous vous rendrons heureuse.
Les yeux de la vieille s’emplirent de grosses larmes qui, peu à peu, se détachèrent, puis coulèrent lentement le long de ses rides.
— Mes pauvres enfants ! mes pauvres enfants ! fit-elle enfin.
Elle les regardait l’un après l’autre, sans pouvoir exprimer rien de plus.
— Embrassons-la, dit Myrrha à André.
Ils se penchèrent en même temps et l’embrassèrent, chacun sur une joue. Elle pleurait plus fort, en répétant : « Mes pauvres enfants !… mes pauvres petits ! »
— N’aie pas de chagrin, ma tante, reprit Myrrha. Nous serons sauvés, j’en suis sûre, je sens bien que notre heure n’est pas venue, que nous avons encore de longues années à vivre, tous les trois… Tu verras, tu verras !… Regarde-moi, je ne suis plus malade, je ne tousse plus, plus du tout. C’est la joie qui m’a guérie.
La tante souleva les bras, les enlaça tous deux et leur rendit leurs baisers.
— Je n’ai pas le cœur de vous gronder, dit-elle… Oui, c’est la faute des choses, et ça ne servirait à rien de les déplorer. Plus tard, si Dieu nous prête vie, on régularisera cette situation devant M. le maire, à cause de la société. Maintenant, restez près de moi, ne m’abandonnez plus, et aimez-vous bien, mes enfants, parce qu’il n’y a que l’amour pour sauver ce pauvre monde et aussi la bonté qui comprend et qui excuse.
Mais ils durent s’éloigner, car, près de là, une scène de violence furieuse venait d’éclater.
Mme Avelard invectivait son mari. Les amertumes, les dégoûts de sa vie conjugale, toutes les vieilles colères réprimées s’exhalaient de sa bouche en un flot d’injures véhéments :
— Oui, je te hais, s’écriait-elle, je t’ai toujours haï, tu m’as trop fait souffrir, parce que tu étais le plus fort et que la loi te donnait tous les droits. Mais je me vengeais en te trompant. Et ce m’est une joie de te tromper encore… On m’avait forcée à t’épouser, on m’avait livrée, vendue, prostituée à ta fortune, oui, une prostitution légale, la pire de toutes… J’en aimais un autre, et il a été mon amant, pendant cinq ans, entends-tu ? Oh ! je suis heureuse de pouvoir te dire tout cela. Maintenant, il n’y a plus rien, je ne te crains plus, je suis libre, et je te méprise !
Ses paroles, entre ses lèvres minces et sèches, avaient un sifflement de vipère, et dans son visage fiévreux, ses yeux fulguraient d’une joie mauvaise. Quelques matelots accourus au bruit, assistaient, impassibles, à cette scène.
— Coquine ! coquine ! répéta M. Avelard, d’une voix étouffée par la rage.
Ses mains se crispaient, il avait envie de l’étrangler, mais il semblait en avoir peur, tant elle se dressait, agressive, prête à la bataille. Et elle le provoquait encore.
— Lâche ! lâche ! Tu as peur ? Si nous avions été là-bas, tu m’aurais tuée, n’est-ce pas ? parce que les jurés acquittent toujours… Maintenant, ose donc me toucher !
A la fin, des ricanements coururent parmi l’assistance. On espérait qu’ils allaient se battre. Mais M. Avelard n’eut qu’un mot, qui termina l’algarade :
— Tu me dégoûtes, fit-il.
Et il tourna le dos, simplement, heureux d’en finir ainsi. Au fond, ça ne l’atteignait guère, il n’aimait plus sa femme, n’en était pas jaloux, et l’opinion du monde n’entrant plus dans ses préoccupations, il ne se souciait nullement de venger son honneur conjugal.
D’autres maris montraient à cet égard le même détachement. Quelques masques fortement collés tenaient encore à des visages, mais la plupart concevaient maintenant les rapports sociaux avec une conscience libérée des contraintes morales et des souffrances artificielles. Le grand souffle de la mort avait dissipé cette poudre d’or dont la civilisation farde la devanture des âmes et des choses.
Cependant, au milieu de ces événements, M. Gallerand restait l’homme du passé, très pâle, tel un marbre de la désespérance.
Un soir, il aborda M. Rolande. Les deux solitaires se prirent à causer. Le même malheur les rapprochait, ils ne craignaient pas le ridicule en face l’un de l’autre, et peu à peu ils en vinrent aux confidences. M. Gallerand parla le premier, à voix très basse :
— Oui, elle m’a tout avoué, dit-il… Oh ! des choses horribles !… Et moi qui n’avais rien vu, rien soupçonné !… J’avais vécu dans un mirage, je vénérais ma femme, j’adorais ces enfants, qui ne sont pas les miens. Tout, autour de moi, n’était que mensonge… Imaginez-vous rien de plus affreux ?… Mais vous-même, que vous devez souffrir !
— Non, répondit M. Rolande, car j’ai passé l’âge des désillusions ; je ne lutte plus contre ma destinée… Le vrai sens de la vie m’est enfin apparu. La nature fait de chaque être l’instrument de ses grands desseins obscurs. Elle l’épargne ou le favorise, tant qu’il collabore, inconsciemment d’ailleurs, soit par ses bonnes actions, soit par ses méfaits, aux fins mystérieuses qu’elle se propose. Elle l’accable au contraire et le supprime, dès qu’il cesse d’être son complice. Il n’y a pas d’autre justice, et c’est l’unique explication de la chance ou de l’infortune. Il se peut ainsi qu’on soit plus puni pour ses vertus que pour ses vices. Pourquoi combattre et chercher à prévoir, quand l’imprévu seul arrive ? Hélas ! ce qu’il nous est donné de connaître et d’éviter, qu’est-ce en comparaison de l’immense inconnu qui nous enveloppe ?… Non, il n’y a rien à faire, qu’à s’incliner. Cessez donc de vous tourmenter et consentez aussi au repos, en vous résignant.
M. Gallerand ne répliqua point ; les deux hommes demeurèrent longuement pensifs.
Non loin d’eux, tandis que le soleil lassé noyait sa pâleur éblouissante dans la brume pourprée de l’Occident, Armand Reboul et Mme Rolande causaient bas. C’était l’heure où tout ce qu’il y avait en eux de vague et de profond leur venait aux lèvres. Le reste du jour, leurs âmes désorientées erraient loin d’eux-mêmes. Ils n’auraient su dire alors s’ils s’aimaient vraiment. La question, d’ailleurs, leur semblait oiseuse ; ils ne se la posaient pas, convaincus qu’ils n’avaient plus que quelques jours à vivre. Qu’importait dès lors que leur passion fût ou non assez haute pour résister aux épreuves de toute une existence ; ils avaient encore de la joie à s’étreindre, et elle suffisait à entretenir en eux cette illusion du véritable amour à laquelle s’accrochent ceux qui n’ont d’autre but et d’autre raison d’être. Un caprice du cœur, une émotion des sens, irrités par les obstacles, ne pouvaient les absoudre, elle de sa faute, lui de cette équipée romanesque qui devait lui coûter la vie. Elle, du moins, avait pour excuse, la pitié qui succombe ; mais lui ne se justifiait, à ses propres yeux, que par l’irrésistible entraînement d’une grande passion. Il s’efforçait d’y croire, et il sentait en elle la même inquiétude inavouée et la même volonté d’illusion.
— Xanie, m’aimez-vous ? demanda-t-il.
— Pouvez-vous en douter ? répondit-elle.
— Auriez-vous cependant, reprit-il, consenti jamais à notre union, si cette catastrophe ne s’était produite ?
Elle hésita, un moment, puis dit, d’une voix de rêve :
— Je ne sais, mon ami… Nous ne connaissons jamais assez notre propre cœur, pour savoir ce que nous ferions ni de quoi nous serions capables en telle circonstance. Il est événements qui nous révèlent à nous-mêmes, meilleurs ou pires, font surgir des profondeurs de notre conscience tout ce qui y sommeille, en temps ordinaire : des grandeurs ou des bassesses, des lâchetés, de l’héroïsme, de l’enthousiasme, du dévouement, toutes sortes de sentiments et de passions nobles ou vils, de beautés ou de laideurs que nous ne soupçonnons même pas en nous dans la monotonie quotidienne de l’existence. N’en voyons-nous pas ici une preuve ?… Telle a vécu comme une honnête femme, qui avait une âme de catin, et telle est tombée dans l’abjection, qui nourrissait des rêves romanesques… Ce n’est même pas sur leurs actes qu’on peut juger des gens ; il en est qui sont calomniés par leur vie, comme d’autres par leur visage.
— C’est vrai, répondit Armand… Je croyais connaître les hommes, je me trompais, car tout ce que je vois, tout ce que j’entends ici me déconcerte.
— Vous aviez toujours été heureux, dit-elle, et il n’est donné qu’au malheur d’être clairvoyant.
— Hélas ! soupira-t-il, on se méprend aussi sur soi-même. Nous ne savons pas toujours quand nous sommes sincères et quand nous ne le sommes pas… vous me disiez un jour que l’idéal réalisé est souvent tout près du malheur.
Ils se turent, sentant qu’ils glissaient à des aveux irréparables. Il y avait entre eux ces symptômes inquiétants qui dénoncent la fragilité des affections humaines, les dissemblances profondes et inexplicables qui font saigner le cœur de solitude, tandis que les lèvres se joignent. En vain évitaient-ils toute parole discordante ; des riens insaisissables, des nuances fugitives, ces silences qui dissimulent le vide et arrêtent l’expansion, les avertissaient qu’ils n’étaient point nés l’un pour l’autre. Ils avaient des sourires et des phrases à côté de leurs pensées, des impressions qu’ils n’éprouvaient pas le besoin de se communiquer, des sentiments qui ne trouvaient pas leur expression.
Ils s’étaient aperçus de tout cela insensiblement. L’intimité même les éloignait. Plus ils se pénétraient, plus l’inconnu, qui dressait entre eux une barrière morale, s’épaississait, comme certains problèmes deviennent plus obscurs, quand on les approfondit.
Ils continuaient à s’étreindre pour chasser l’angoisse de la mort, mais cette continuelle possession amenait la satiété, leurs baisers déjà n’avaient plus la même saveur. Les journées leur semblaient infinies, alourdies par l’oisiveté, la chaleur accablante et l’inexorable monotonie de l’Océan impassible.
Chaque heure augmentait l’ennui d’Armand ; il demeurait silencieux auprès d’elle, étonné de n’avoir plus rien à lui dire et d’éprouver de la sécheresse. La perspective d’être lié jusqu’à son dernier jour à Mme Rolande l’eût empli de malaise, et peut-être eût dissipé jusqu’aux cendres d’une passion que soutenait seule encore l’épouvante du néant. Elle avait quelques années de plus que lui, il s’en apercevait maintenant ; il lui avait découvert quelques cheveux blancs, et déjà s’éveillait en lui cette fâcheuse clairvoyance qui annonce le crépuscule de l’amour. Ils en avaient parcouru la carrière trop rapidement, en brûlant les étapes, dans la crainte de mourir avec la souffrance des voluptés inassouvies. Et la lassitude leur était venue de cette course éperdue à travers l’extase.
— Oui, murmura-t-elle après un long silence et d’une voix lente, notre misère est souvent faite de la réalisation des rêves que nous avions le plus délicieusement caressés. Mais il ne saurait en être ainsi pour moi, car l’idéal qu’on se fait à mon âge n’a rien que de très simple. Je me satisferais, à défaut du grand amour, qui ne peut durer toujours, d’une douce et fidèle affection, soutenue par le souvenir et la reconnaissance des félicités anciennes. Ainsi, on n’a pas à redouter le malheur d’être seul à aimer ou la persécution d’un amour qu’on ne partage plus.
Dans le ton même de ces paroles, il y avait comme l’humilité d’un rêve déchu et qui consent à des concessions pour ne point tout perdre. Elle eut un sourire de mélancolie navrante, qui sollicitait une approbation.
Il parut ne pas comprendre. D’autres réflexions se levaient dans son esprit. Il songeait à la fatalité qui, un jour, à Bordeaux, au coin d’une rue où il passait par hasard, l’avait mis en présence de Mme Rolande… A quoi tenait la destinée des hommes ! Une minute plus tôt ou plus tard, il ne l’eût point rencontrée et il n’eût pas fait cette folie. Maintenant, il serait en quelque villégiature d’été, bien tranquille sous de frais ombrages. Il ne s’expliquait plus ce grand coup de passion, ce voyage insensé. Ses yeux se fixèrent sur Mme Rolande, tandis qu’elle baissait les siens. C’étaient les mêmes traits charmants qu’il avait adorés, ce visage d’une grâce mélancolique et fière. Pourquoi ne soulevait-elle plus en lui aucune émotion ? Par quel mystère le cœur de l’homme changeait-il ainsi, en si peu de temps ?
Les jours se succédaient sous le soleil brûlant. Rien n’apparaissait à l’horizon, aucune voile, aucune fumée. Un peu de brume dorée magnifiait la tristesse des crépuscules. De temps en temps, la sirène poussait encore une plainte enrouée et lugubre, le dernier râle d’une agonie solitaire, dans le silence effrayant des espaces infinis, aggravant jusqu’à la cruauté l’indifférence de la nature aux angoisses humaines. L’Abrolhos, fauve et soucieux, rendait l’immensité plus farouche. De malheureux goélands abordaient parfois le roc abrupt, puis s’enfuyaient à tire d’aile, avec des cris éperdus.
L’abus des voluptés sensuelles, excité par l’effroi de la mort et le vertige de l’ennui, allumait les regards d’une fièvre intense. Certaines figures prenaient ces profondeurs d’expression que donne le vice, comme l’habitude de la méditation ou la longue souffrance.
Le bruit se répandait que les vivres touchaient à leur fin, mais nul ne demandait à diminuer les rations. Aucune autorité n’intervenait. Marzouk, fatigué du pouvoir et perdu de débauche, se désintéressait, passait ses jours à scruter d’un œil sombre les horizons toujours déserts.
Conseil et Danglar proposaient le repas des Girondins, une grande orgie finale. Après quoi, on ferait le saut par-dessus bord, avec un poids lourd au cou. La mort soudaine plutôt que la lente agonie dans les affres de la famine et parmi des scènes de cannibalisme ! Le projet prenait consistance, ralliait des partisans. L’eau était chaude, en cette saison ; la noyade semblait être le mode de suicide le plus acceptable. On ne souffrait pas, affirmait Conseil ; il suffisait d’une seconde de courage, et pour y atteindre, on se monterait un peu la tête, on boirait un peu plus que de coutume… Puis, on imiterait les moutons de Panurge. La sagesse, cette fois, ordonnait de suivre cet illustre exemple.
Au milieu de ces événements, Lola témoignait une douce modération. Elle assistait à ces choses avec la tristesse soumise et le mépris indulgent de celles qui ont exploré les égouts du cœur humain.
Depuis la catastrophe, elle se tenait à l’écart, tranquille, sans crainte, sans désir. Les hommes la sollicitaient en vain. Non, elle ne voulait pas. Avant de mourir, elle avait bien le droit de prendre quelques vacances. Chacun sa manière de voir, maintenant qu’on était libre.
Pendant les premiers jours de la traversée, Lola avait encouru la réprobation des honnêtes gens à l’égard de la fille publique ; de celle qui n’a pas réussi, la prolétaire de la prostitution. Les passagers des premières et des secondes se garaient d’elle. Pour éviter le scandale, le commissaire du bord avait cru devoir la reléguer en troisième parmi les émigrants, bien qu’elle eût un billet de seconde classe.
A présent, c’était son tour à les considérer avec un dégoût silencieux. La vraie bourgeoise respectable, c’était elle, incontestablement, à cette heure où s’étalait la nudité des âmes. Elle en incarnait toutes les vertus : la sagesse, la dignité, la chasteté, la résignation.
C’est qu’elle n’avait plus de passion, elle, plus de vice, plus de ces ardeurs comprimées qui consument tant d’honnêtes femmes dans le cloître de la fidélité conjugale. Elle en avait trop vu, elle avait trop plongé dans le gouffre des aberrations humaines. Ses sens étaient repus, elle n’avait plus que des besoins de cœur. Il existait en elle encore, malgré tout, des coins innocents, des aspirations sentimentales, des tendresses que les hommes avaient toujours dédaignées. Sur le fumier de sa vie, avait poussé une petite fleur très pâle et très pure, où les colimaçons n’avaient point laissé leur bave.
Ne sachant que faire dans ces longues journées, elle relisait pour la troisième fois, Paul et Virginie, le seul livre qu’elle eût emporté. Parfois, elle se retrouvait la fillette qu’elle avait été à dix-sept ans. La souillure n’était qu’à la surface, son âme n’avait pas été déflorée, et il en renaissait, de loin en loin un parfum de jeunesse qui chassait les visions d’horreur, les souvenirs de honte, comme le vent du matin les impuretés de la nuit.
Un soir, après le coucher du soleil, le bruit sourd d’une masse qui s’affaissait derrière elle la fit se retourner. Lola reconnut Marzouk, assis dans un coin d’ombre. D’abord, ils n’échangèrent aucune parole. L’énorme brute restait inerte, les yeux vagues, les entrailles silencieuses, ce qui chez lui indiquait un profond découragement. Ce fut elle enfin qui parla la première, curieuse de savoir :
— Quoi donc, ça ne va plus ? demanda-t-elle.
— Non, fit-il d’une voix rauque.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
Il hésita un moment à répondre, comme convaincu de l’inutilité des paroles, puis déclara :
— Il y a qu’on va crever, pardi !
— C’est donc qu’on est au bout ?
— Probable… Dans trois jours, plus de biscuit, plus rien à barboter… Ceux qui n’auront pas le cœur de se jeter à l’eau se boufferont. Voilà.
Il y eut un silence.
— Eh bien ! qu’est-ce que tu en dis ? reprit Marzouk… Ça te va, à toi, de faire le plongeon ?
— Pour sûr que ça vaudrait mieux, si on en arrivait là, dit-elle. Mais faut pas désespérer. On ne sait jamais.
Il la regarda, étonné de son calme.
— On croirait, à t’entendre, que ça ne te tourmente guère.
— Non, guère, fit-elle.
— Pourtant, t’es pas trop décatie.
— J’ai que vingt-quatre ans… Mais, vrai, pour l’agrément que j’ai eu jusqu’au jour d’aujourd’hui !… Ah ! non, je ne regretterais rien. Quand on n’a pas de chance, plutôt on s’en va, mieux ça vaut.
— Qu’est-ce que tu faisais, avant ? questionna-t-il.
— J’étais en maison, avoua-t-elle.
Il la dévisagea, indécis, comme si une comparaison s’imposait à son esprit, et, tout à coup, une lueur fauve éclaira ses prunelles.
— On va coucher ensemble, cette nuit, dit-il brutalement.
Elle eut un lent signe de tête qui signifiait : non.
— Pourquoi ? demanda-t-il.
— Ça ne me va pas.
— Voyons, qu’est-ce que ça peut te faire ?… Une fois de plus ou de moins…
— Ça me fait que je ne veux pas… Ni avec toi ni avec personne… C’est pas les femmes qui te manquent ici… Retourne avec tes bourgeoises.
— J’en ai soupé, déclara Marzouk… Oui, elles me dégoûtent.
— A cause ?
— A cause qu’elles ont trop de vice, ça sent trop le vert-de-gris… Toi, t’as l’air d’une bonne fille… Viens donc… Rien qu’un moment. Après, on se quittera bons camarades.
— Non.
— Puisqu’on va crever, dit-il d’une voix d’angoisse, on peut bien prendre un peu de plaisir avant, tout de même, ça nous fera oublier, un moment.
— J’ai dit non, là !
Il la saisit par le bras, tenta de l’entraîner, mais elle le repoussa violemment.
— Fiche-moi la paix, hein !… C’est compris ?… Tu sais, tu ne me fais pas peur, je me fous de toi comme de la mort.
Elle se redressait contre le colosse, gaillarde, intrépide, le poing tendu, prête au combat. Marzouk en demeura stupéfait. C’était la première fois qu’une femme lui résistait ainsi.
— Allons, ne te fâche pas, dit-il, je veux pas te nuire… Après tout, tu as raison : chacun son idée.
— Oui, murmura-t-elle, radoucie soudain, chacun son idée : l’amour, ça va quand on a faim, ou alors faut avoir de l’amitié pour quelqu’un. Et l’amitié, ça ne vient pas comme ça, tout de suite.
— C’est vrai, répondit Marzouk.
Il fut un instant interloqué, puis ajouta :
— On peut tout de même se serrer la main, ça ne tire pas à conséquence.
— Je veux bien, dit-elle. Tu n’es peut-être pas plus mauvais qu’un autre, dans le fond. Seulement, t’as dû être gâté par les femmes.
— Faut bien vivre, répliqua Marzouk. J’avais pas de rentes et pas d’instruction… Chacun se débrouille comme il peut.
Ils se donnèrent la main.
— Adieu, fit-il.
— Adieu.
— Suffit qu’on ait de l’estime l’un pour l’autre, conclut-il.
Et il s’éloigna gravement.
La nuit était tout à fait tombée, une nuit douce et noire, accablée d’un silence sinistre qui s’abattait, semblait-il, plus lourdement, après chaque appel désespéré de la sirène à l’immensité implacable et déserte. De suprêmes efforts tentés, la veille, pour dégager le navire, étaient restés sans résultat. L’avant s’enfonçait chaque jour un peu plus dans le sable. Enfin, les optimistes les plus entêtés perdaient la verve de la foi. Des visages livides, des regards hébétés annonçaient l’état comateux du désespoir. L’épouvante chassait le sommeil. Jusqu’à l’aube, des raideurs spectrales erraient dans les ténèbres. Lola les suivait des yeux. Elle-même, parfois, malgré son acceptation stoïque de toutes les fatalités, se sentait traversée d’un frisson. Des masses d’ombres, que les fanaux du bord constellaient de larges étoiles rougeâtres, prenaient l’apparence de fantômes tragiques, s’avançant lentement, comme pour l’envelopper. Jamais la nuit ne lui avait paru si pleine d’inconnu troublant. Une profonde pitié lui venait de ces centaines de vivants endormis là et qui bientôt ne se réveilleraient plus. De temps en temps, des plaintes s’élevaient, de vagues murmures inutiles et découragés, des pleurs d’enfants vite apaisés.
Les familles se groupaient plus étroitement. Quelques-unes, prévoyantes, thésaurisaient des vivres en des cachettes. Le jour, c’était une sorte de pillage dans un effroyable désordre, une lutte horrible, où les bourgeois avaient toujours le dessous, autour des provisions, et qui devenait plus enragée, à mesure que celles-ci s’épuisaient. L’égoïsme humain étalait un spectacle farouche. Le partage du dernier bœuf avait failli faire couler du sang. Marzouk avait terminé le conflit en s’adjugeant le bœuf entier dont il avait ensuite distribué des portions, selon ses sympathies. Dans ces sortes de distributions, Danglar et Conseil et bon nombre de bourgeois se brossaient le ventre.
Chacun faisant sa cuisine, ces derniers, ignorant l’art culinaire, faisaient maigre et mangeaient froid, réduits à se gaver de biscuit et de fromage. Ils volaient d’ailleurs comme les autres, mais d’une manière plus cynique et plus maladroite, qui leur valait de dures représailles, maintenant qu’ils n’étaient plus protégés par le code. Chaque jour, de solides matelots se chargeaient de modérer par des arguments frappants leur instinct de conservation.
Lola se sentit frôler dans la demi-obscurité. C’était Mme Gallerand, un pauvre corps de femme amaigri par la souffrance et les privations. Depuis sa confession tragique, elle avait cessé toute relation avec son mari. Dès qu’il l’apercevait, il s’éloignait, inexorablement. Entre eux, tout semblait fini. Elle-même, maintenant, l’évitait, ne sortant plus de sa cabine que la nuit, endurant des journées affreuses de détresse et de remords.
Lola ne l’avait jamais vue. Les deux femmes se saluèrent machinalement d’un hochement de tête.
— Savez-vous où nous en sommes ? demanda Mme Gallerand.
— Paraît que c’est la fin, répondit Lola ; il n’y a plus de vivres… Moi, j’ai encore un pain. Le voilà… Voulez-vous qu’on partage ?
— Je ne veux pas vous en priver, gardez-le… Ce n’est pas cela qui nous sauvera.
— Tout de même, vous pourriez avoir faim. Prenez, ça me fera plaisir.
— Non, merci… Qui êtes-vous ?
— Je ne peux pas vous le dire.
— Pourquoi ?
— Peut-être bien que vous me mépriseriez.
— Vous vous trompez.
— Vous n’êtes pas mariée ?
— Si… Mais cela ne me donne pas le droit de mépriser les autres.
— Je suis une fille publique, déclara Lola.
— Du moins, vous n’avez trompé personne, vous.
— Pour ça, non. De ce côté-là, je n’ai pas de regret. Mon idéal, à moi, était de vivre bien tranquille, toujours avec le même. Si mon premier amant ne m’avait pas quittée, bien sûr que je ne lui aurais jamais fait d’infidélité. Ce n’est pas ma faute, si j’ai mal tourné. Je n’avais pas de vice, je ne demandais qu’à travailler. Il m’aurait fallu peu pour être heureuse… Mais les belles choses qu’on espère n’arrivent jamais.
— Que pensez-vous des femmes adultères ?
— Pourquoi que vous me demandez ça ?
— Pour savoir, simplement.
— Je ne peux pas juger, je n’ai pas ce droit. Si je jugeais, vous auriez bien raison de vous moquer de moi.
— Non, je ne me moquerais pas de vous.
— Il me semble que, quand on n’aime plus quelqu’un, ce serait mieux de le lui dire et de s’en aller.
— Vous avez raison, répondit Mme Gallerand, il serait plus honnête d’agir ainsi, mais les choses ne sont malheureusement pas aussi simples. Il y a des obligations et des préjugés dont on ne s’affranchit pas.
— Peut-être bien que vous avez de la peine à ce sujet, dit Lola.
Mme Gallerand se tut, et ses paupières meurtries rougirent, brûlées par des larmes qui se refusaient à couler.
— Ce sont des choses qui ne me regardent pas, reprit Lola, mais quand on connaît la vie, quand on est ce que je suis, on comprend tout, on ne peut pas être sévère, on a pitié de ceux qui ont fauté… C’est pas toujours les plus mauvaises qui font le mal. Pour être juste, faudrait n’en vouloir qu’à des choses qu’on ne peut expliquer ni changer. On est tous des victimes, voilà, et si le bon Dieu était ce qu’on dit, il enverrait tout le monde en paradis.
Mme Gallerand pleurait silencieusement. Ses lèvres remuèrent comme si elle eût voulu parler, mais elle se borna à abandonner un instant sa main dans celle de Lola. Puis, elle se retira, en songeant à l’ironie de la nature qui avait donné un cœur d’honnête femme à cette prostituée et un tempérament de grue à des bourgeoises cossues, environnées de respect.
Il devait être près de quatre heures. Bientôt l’aube allait poindre. Une lueur indécise bleuissait le levant. Lola, fatiguée, se disposait à s’étendre, lorsqu’une rumeur confuse, qui montait des entrailles du navire, attira son attention ; elle traîna ses pas jusqu’aux compartiments des secondes. Que se passait-il ? Des voix pâteuses détonnaient dans le silence frissonnant des ténèbres. Un peu de lumière filtrait à travers les rideaux.
Pour s’étourdir, avant de faire le grand plongeon, les bourgeois, ayant réussi, à la faveur de l’obscurité, à subtiliser les dernières bouteilles, se livraient à une orgie macabre. Le petit verre du condamné à mort s’était multiplié. Le repas des Girondins dégénérait en une sale noce. Vingt litres d’alcool, déjà vides, gisaient sur la table. Tous, très saouls, titubaient, les yeux troubles, l’air hébété. Danglar, qui venait de choir, faisait de vains efforts pour se redresser. Conseil rendait. Les époux Avelard, encore aux prises, s’invectivaient furieusement. D’autres avaient un rire stupide et lugubre. Mme Bineau, vautrée dans ses cheveux épars, sanglotait bruyamment, des sanglots à fendre l’âme. A son côté, un Italien, toujours le même, pleurait aussi, reprenant sa lamentation invariable : Non voglio morire, non voglio morire ! Mme Garigues, une folle tourmentée d’hystérie, avait attiré deux hommes à l’écart et, entr’ouvrant le peignoir dont elle était revêtue, étalait devant eux sa nudité obscène. Seuls, deux Anglais demeuraient graves, taciturnes, d’une dignité exceptionnelle, paraissant se raidir contre l’ivresse. Et nul ne parlait plus d’imiter les moutons de Panurge. L’excès même de cette débauche en avait fait oublier le but héroïque, la volonté d’échapper par le suicide aux affres de la famine.
Lola regardait. Quelqu’un l’invita à prendre un verre. Mais elle resta immobile et muette. Elle préférait ne pas en être, de ces bourgeois poltrons et déments, contente de pouvoir les mépriser, à son tour, se sentant vengée un peu, par le spectacle de leur ignominie, des humiliations et des souillures subies. S’il fallait faire le grand saut par-dessus bord, elle le ferait toute seule, sans l’aide de personne, en gardant sa raison. Si elle avait misérablement vécu, exploitée et flétrie par les hommes, elle ne mourrait pas comme une bête. Un peu de fierté la remettait d’aplomb, consciente de valoir mieux que ces gens-là, mieux surtout que sa vie, l’inique destin dont elle était la victime et la calomniée.
Une pâleur d’aurore pénétrait par les hublots, refoulant les ombres vers les coins, donnant aux objets et aux visages une teinte livide.
La sirène, en ce moment, eut un cri si puissant que les vitres en tremblèrent ; tout le navire frémit, comme agité d’un dernier soubresaut d’agonie. Un silence plein d’angoisse succéda. Puis, un meuglement sourd s’éleva, qui semblait venir du fond de l’espace. De nouveau, la sirène hurla. Le même meuglement lointain, plus prolongé, répondit. Tous, cette fois, tressaillirent. Lola s’élança sur le pont.
Soudain, ce fut une clameur formidable. Des bras se tendirent vers l’horizon. Un paquebot venait d’apparaître, un paquebot français. Déjà, avec la longue-vue, on pouvait distinguer le pavillon tricolore. Marzouk, joyeux, tonnait : une vraie salve d’artillerie, des coups de canon à n’en plus finir, une explosion de lyrisme trop longtemps contenu.
Les bourgeois rassemblés, les yeux hagards, le cerveau embrumé par l’ivresse, se tâtaient pour constater qu’ils ne rêvaient pas. Quelques-uns, dégrisés un peu par la fraîcheur matinale et la brusque surprise, cherchaient à se ressaisir et déjà à reprendre leur masque. Conseil se redressait, voulant faire bonne contenance. Danglar, trop saoul, ne comprenait rien, marmottait des paroles inintelligibles.
Le paquebot sauveur avançait rapidement. C’était la Guyenne, un bâtiment de la même compagnie, qui, depuis cinq semaines, sillonnait l’océan, à la recherche de l’Eldorado. Le troupeau des émigrants beuglait plus fort d’allégresse… Ah ! la bête humaine pouvait tout endurer. On avait beau l’exploiter, la duper et la dévorer, elle ne demandait qu’à ne pas mourir. C’était l’éternel salut à l’espérance, l’illusion tenace, la vie qu’on ne se lasse pas de croire bonne et qu’on veut vivre jusqu’au bout, malgré les déboires, les trahisons, les fléaux, la lutte inexorable ; la vie que réclament encore les infirmes et les déshérités !
La Guyenne, le paquebot sauveur, ayant à son bord tous les naufragés de l’Eldorado, faisait route à toute vapeur vers les côtes de France.
Chacun avait naturellement repris son rang. La hiérarchie sociale se trouvait rétablie comme au départ de Bordeaux.
Sur le pont des premières, Danglar et Conseil, M. Gallerand et sa femme, les époux Avelard, Mmes Larderet, Bineau et Chabert, causaient posément, en gens du monde, dignes et graves. Un peu de malaise toutefois transpirait.
Il était temps qu’on s’expliquât franchement, la franchise étant toujours préférable. Tout le monde s’accordait sur ce point.
— Il faut bien le reconnaître, avança Danglar, nous avons été pris d’une sorte de vertige.
— On l’aurait été à moins, dit Mme Bineau… Je vous le demande, qui donc aurait gardé son sang-froid en ces jours d’épouvante ?
— Personne assurément, confirma Mme Chabert, n’importe qui aurait perdu la tête.
— Nous avons vécu un affreux cauchemar, déclara Conseil. Aucun de nous ne savait ce qu’il faisait, et il faut s’étonner seulement que nous ne soyons pas devenus fous. Nous n’étions plus responsables de nos actes.
— C’est vrai, je n’avais plus conscience de moi-même, avoua Mme Bineau.
— Quant à moi, pour vous dire toute la vérité, affirma Mme Larderet, je ne me souviens de rien. Il me semble que j’ai fait un de ces mauvais rêves qu’on cherche en vain à reconstituer à son réveil et dont il ne reste plus qu’un grand malaise, une sorte d’oppression… Vous avez dû éprouver cela aussi, n’est-ce pas ?
Cette fois, un gros silence régna. Deux personnes de l’honorable société présentèrent le dos à Mme Larderet, et Mme Gallerand attendit qu’elle eût pris quelque distance pour déclarer à son tour :
— Il paraît que j’ai eu le délire, et que je me suis accusée auprès de mon mari de choses abominables, autant qu’invraisemblables. C’est lui qui m’a appris cela… Jugez de ma stupéfaction.
— Et moi qui avais cru !… dit M. Gallerand.
— Tu n’avais pas non plus ta raison, mon ami.
— C’est bien certain.
— On a vu des gens dans le délire, prétendit Conseil, s’accuser de crimes qu’ils n’avaient pas commis. Il en est des exemples historiques. Ainsi Voltaire, dans son Histoire de Charles XII, raconte qu’un quidam, dans un accès de fièvre chaude, ouvrit sa fenêtre pour crier au public qu’il était l’auteur de l’assassinat du roi de Suède.
— Et il était innocent ? demanda Mme Gallerand.
— Voltaire l’affirme.
— Tu vois, dit-elle en se retournant vers son mari.
— Oui, oui, fit l’ancien colonel.
Mais son front restait sombre ; il ne semblait pas absolument convaincu, un doute le tenaillait encore.
— Ah oui ! nous avons vécu des jours horribles, dit M. Avelard. Il vaut mieux n’y plus penser… Passons l’éponge.
— Ah ! pardon, intervint Danglar, il en est un qui s’est comporté d’une façon abominable et qu’il nous est impossible de ne pas dénoncer, à notre retour. C’est ce misérable Marzouk, cette brute immonde…
— Vous avez raison, interrompit Conseil et, pour ma part, je déposerai une plainte au parquet.
— Nous nous joindrons à vous, dit M. Avelard. Ce scélérat passera aux assises.
— Oui, oui, clamèrent-ils tous d’une même voix.
L’indignation et la colère avaient empourpré les visages. Tous maintenant se souvenaient, citaient des faits précis. Mme Chabert affirma que le monstre avait tenté de la violer.
— Il n’y a pas que vous, dit Mme Bineau.
— Comment, vous aussi ?
— Parfaitement !
L’indignation redoubla. Tous parlaient à la fois :
— Il faut qu’on le condamne… Il ira au bagne… Vingt ans de travaux forcés… Oui, ça vaut ça… La guillotine…
Marzouk parut. Il avait surpris les derniers propos.
— Hé ! dites donc, vous autres, fit-il ; comment donc que vous arrangez ça ?
Conseil se redressa.
— Vous ne nous faites plus peur, sachez-le.
— Vous ne relevez plus que des tribunaux, vous êtes un criminel, ajouta M. Avelard.
— Nous vous accuserons tous, vous ne resterez pas impuni, la justice suivra son cours.
Marzouk eut un ricanement épais. Il croisa les bras, promena sur l’assistance un regard insolent et tranquille.
— Alors, vous voulez bavarder, dit-il. C’est bien, moi aussi. J’ai des témoins : les hommes de l’équipage, les émigrants… On racontera toutes vos saletés, on lavera son linge sale devant les tribunaux, et on verra qui rigolera le plus… Eh bien, quoi ! vous ne dites plus rien, à présent ?
Tous, en effet, s’étaient tus, pâles, inquiets, hagards. Enfin, Danglar reprit la parole :
— Il est vain de récriminer, dit-il. Il faut raisonner, voir les choses comme elles sont. La vérité est que nous étions tous égarés, affolés, et cet homme ne saurait être plus responsable que nous. Le vertige l’avait gagné aussi… Soyons justes, n’accusons personne, car personne n’est coupable, et remercions la Providence de nous avoir sauvés.
Ce fut un revirement soudain. Tous approuvèrent. Oui, il fallait être juste. On n’avait rien à se reprocher les uns aux autres.
— La nature humaine a ses faiblesses et ses défaillances, dit Conseil, et il convient de lui faire un peu grâce.
M. Avelard tendit la main à Marzouk.
— Alors, c’est bien, fit celui-ci. Si vous gardez votre langue, je garderai la mienne. Ça vaudra mieux pour tout le monde.
Après quelques considérations d’ordre moral, on en vint à conclure que chacun avait fait son devoir.
— Vous raconterez tout cela à vos nombreux lecteurs, dit Mme Chabert à Conseil.
— J’y songe, en effet, répondit l’écrivain.
Déjà, il ruminait un bel article de revue sur le naufrage de l’Eldorado, et qui, vraisemblablement, retentirait dans le monde entier. C’était la gloire.
Cependant, Marzouk devenait soucieux en envisageant l’avenir. Qu’allait-il faire, à son retour ? Les luttes à mains plates étaient passées de mode. Il avait exercé une foule d’industries, toutes en désuétude, sauf celle de souteneur. Mais l’âge venait, et il était au bout de ses ressources. La compagnie lui rembourserait sans doute son passage ; peut-être aussi ouvrirait-on une souscription au bénéfice des naufragés. Mais après ?… Marzouk caressait un projet, celui de faire concurrence au pétomane, alors en pleine vogue. Ses entrailles grondaient continuellement. C’était le don. Il ouvrirait boutique en face et ferait de l’or, comme l’autre. Cela pouvait mener à tout, on ne savait pas. L’Homme-canon venait d’être élu député. La pétomanie, étant une carrière nouvelle, autorisait toutes les espérances, sous la troisième République. D’abord, gagner de l’argent. Le reste, les honneurs viendraient après, par surcroît. Marzouk avait foi en sa chance. Une chiromancienne lui avait prédit qu’il serait décoré.
Le commissaire de la Guyenne le rappela à la réalité, en lui intimant l’ordre de regagner le quartier des émigrants.
Mme Gallerand prit à part son mari. Tous deux s’éloignèrent pour causer. L’ancien colonel paraissait en proie à une idée fixe.
— Je sens que cela te tourmente encore, lui dit-elle.
Il nia.
— Mais non, je t’assure, c’est fini, je n’y pense plus, oublions ces choses.
Déjà, ils s’étaient expliqués longuement. D’abord, il l’avait repoussée rudement, refusant de l’entendre. Pour qui le prenait-elle ? Alors, elle avait feint l’ahurissement, jouant son rôle en grande comédienne, confiante en la candeur incomparable du pauvre homme. Et elle était parvenue à le convaincre, car il ne demandait qu’à croire, contre l’évidence même.
L’heure de sa comparution devant Dieu se trouvant retardée, Mme Gallerand s’était sentie soulagée du remords. Un prêtre l’absoudrait, quand il serait temps. Dès lors, pourquoi briser sa vie, la respectable devanture de son honnêteté bourgeoise ? C’était, en elle, un mélange d’hypocrisie et de superstition peureuse. Aussi bien, pensait-elle, l’humanité lui faisait presque un devoir de renouveler l’illusion bienfaisante qui avait créé le bonheur de son ménage, la quiétude de son mari.
M. Gallerand avait découvert en son amour-propre ces subtiles raisons qui déterminent la foi aveugle. Tout le passé, trente ans de vie commune pendant lesquels le soupçon ne l’avait même pas effleuré, ses enfants, mille souvenirs plaidaient l’innocence de sa femme. Il fallait croire envers et contre tout, sous peine de désespérer. Oui, Mme Gallerand avait eu un moment de folie. Plus il y réfléchissait maintenant, plus il en était sûr. D’ailleurs, ses quatre enfants lui ressemblaient d’une façon frappante ; ce n’était qu’un cri.
— Non, je n’en reviens pas, reprit-elle… Comment ai-je pu te dire une pareille chose ?
— Tu me l’as dite.
— Et tu l’as crue ?
— J’étais fou aussi.
— C’est drôle, quand on y pense.
— Oui, c’est drôle.
— Tiens ! nous ferions mieux d’en rire.
— Tu as raison.
Ils se regardèrent et partirent à rire.
— Bête ! fit-elle en lui tapant sur la joue.
M. Gallerand branla la tête comme un vieux cheval qu’une mouche aurait piqué. Un sang plus chaud circula tout à coup dans ses veines, et sa chair frissonna d’un regain de désir. Ils n’étaient plus jeunes, tous les deux ; lui avait dépassé la soixantaine. Les petites pirouettes ne lui réussissaient plus ; il en gardait mal aux reins pendant trois jours. Sa dernière tentative surtout avait été pitoyable ; il avait simplement, après s’être essoufflé, brûlé la politesse à Mme Gallerand… Tout de même, on pouvait essayer encore. L’atmosphère torride lui mettait un brasier dans le corps. Cette fois, il lui semblait qu’il allait faire feu partout, aussi vaillant que jadis, sur le champ de bataille… Il se pencha vers sa femme et murmura :
— Viens, rentrons dans notre cabine… J’ai un mot à te dire.
— Polisson ! roucoula-t-elle.
— Chérie ! soupira-t-il.
Et ils descendirent.
Sur le pont, la conversation continuait entre Danglar, Conseil, Mmes Chabert, Bineau et les époux Avelard, qui s’étaient réconciliés. Le souvenir du brave commandant Lagorce, mort sur la passerelle, au milieu des flammes, attendrissait les cœurs… Ah ! celui-là aussi avait fait noblement son devoir !
— Nous avons encore, dit Danglar, à déplorer la mort de deux lieutenants et de cinq matelots.
— Il est admirable de constater, remarqua Conseil, combien le sentiment de la responsabilité et du devoir élève la nature humaine, à certains moments.
— Oui, reconnut Mme Bineau, il est des heures, comme celles que nous venons de traverser, où l’on se sent capable de tous les courages, de tous les dévouements et de tous les sacrifices. N’avez-vous pas éprouvé cela ?
— Si, affirma Mme Chabert.
— Et vous ?
— Nous aussi, déclarèrent Danglar et Conseil. Mais j’avoue volontiers, ajouta galamment ce dernier, que les femmes sont encore plus vaillantes que nous, en maintes circonstances.
— Il existe en nous, observa M. Avelard, des facultés d’énergie, je dirai même d’héroïsme, dont nous ne nous doutons pas, en temps ordinaire.
Mme Bineau s’était penchée vers Mme Chabert, et toutes deux parlaient bas, en phrases courtes, indignées :
— C’est scandaleux !
— C’est intolérable !
— Il faut avertir le commissaire.
— Où est-il ?
— Je n’en sais rien.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda Danglar.
Mme Chabert désigna Lola, qui s’était aventurée, sans savoir, sur le pont des premières.
— En effet, c’est par trop de sans-gêne, dit le diplomate… Je vais la chasser.
— Ne soyez tout de même pas trop brutal, prévint M. Avelard. Ces filles ont un rude coup de gosier… Évitez une scène.
— N’ayez crainte.
— Elle se croit encore sur l’Eldorado, fit Mme Bineau.
— Ah non ! c’est fini ! soupira Mme Avelard. Chacun à sa place, maintenant.
Danglar s’approcha de Lola.
— Que faites-vous ici ?
— Moi… rien, répondit-elle. Je regarde la mer… Ça vous offense ?
— Ce n’est pas votre place, retirez-vous.
— Pourquoi ?
— Votre présence scandalise ces dames.
Lola parut hésiter un instant ; un triste sourire d’ironie lui monta aux lèvres, puis elle s’éloigna sans rien dire. Elle comprenait bien que ces gens-là avaient besoin de retaper leur façade. Ils avaient encore du bon temps à vivre, étant riches. Pour elle, ça ne lui allait guère de retourner en France et d’être encore de ce monde. Elle eût préféré en finir. Lorsqu’elle avait vu arriver ce bateau, d’abord elle avait été contente, comme les autres, car on a beau être misérable, n’attendre aucune satisfaction, la mort trouble quand même. Après, elle avait regretté. Quoi faire, une fois débarquée ? Recommencer sa vie ? Oui, ou crever de faim ; il n’y avait pas d’autre choix… Ça lui semblerait peut-être plus dur, à présent que des pensées, des rêveries, des souvenirs et le grand souffle de l’océan l’avaient désinfectée des baisers anonymes, des haleines impures, des vices ou des crimes qui avaient cherché sur ses lèvres la volupté et l’oubli.
Dieu ! quelle croix, quel calvaire !… Elle erra longtemps, près d’une heure, espérant trouver quelqu’un, entendre une voix charitable. Son cœur se souleva tout à coup d’un plus grand besoin d’effusion, lorsqu’elle crut reconnaître la dame avec qui elle avait causé un instant l’autre nuit. C’était Mme Gallerand. Mais son mari était là. Tous deux venaient de remonter sur le pont. Le colonel devait avoir accompli quelque exploit, car jamais il n’avait paru plus fier, ni plus éreinté.
Lola attendit qu’il se fût éloigné, puis, ne voyant personne à l’entour, elle aborda Mme Gallerand. Celle-ci détourna la tête.
— Vous ne me remettez pas, dit Lola… C’est moi, vous savez bien, celle à qui vous avez parlé, l’avant-dernière nuit, sur l’Eldorado… Même que vous pleuriez en me demandant des choses que j’étais bien embarrassée de vous dire, si vous vous rappelez…
Mme Gallerand la toisa d’un de ces regards qui méprisent et qui repoussent.
— Vous vous trompez, déclara-t-elle.
— C’est donc que vous êtes consolée, maintenant, répliqua Lola… Bien, je suis contente de voir que tout s’arrange à la fin, pour les autres.
Mais elle ne put en dire davantage ; la dame avait déjà repris ses distances.
Le commandant de la Guyenne passa, très affairé, et il s’arrêta devant le groupe des passagers de première classe, pour les interroger.
— Mesdames et messieurs, prononça-t-il, je suis obligé de me livrer à une enquête pour établir mon rapport sur la catastrophe de l’Eldorado. Veuillez répondre aux questions que je vais vous poser.
— Très volontiers, dit Danglar.
— A vos ordres, commandant, ajouta Conseil.
— Eh bien, qu’avez-vous à déclarer ?
Danglar entreprit un long récit du sinistre.
— C’est bien, je vous remercie, interrompit le commandant, je suis déjà suffisamment informé sur tout cela, mais savez-vous d’autres faits qui mériteraient d’être signalés ?… Par exemple, quelqu’un de vous a-t-il été témoin d’actes de violence, de brutalité qu’on ne saurait passer sous silence et qui appelleraient une répression.
Tous se regardèrent, un moment indécis et inquiets.
— Non, dit enfin M. Avelard.
— Non, répétèrent Conseil et Danglar.
— Personne n’a donc à se plaindre ?
— Personne, répondit le diplomate au nom de tous.
— Alors, tout le monde s’est bien comporté ?
— Parfaitement, affirma Conseil.
— J’en suis heureux, dit le commandant… Messieurs, je vous remercie, c’est tout ce que je désirais savoir de vous.
Les brumes du crépuscule commençaient à resplendir à l’occident. La Guyenne glissait sans la moindre oscillation sur la surface unie de l’océan, avec une vitesse de dix-sept nœuds à l’heure. On devait être à Bordeaux, le surlendemain, à midi, si le beau temps durait. La joie renaissait à bord. Des sons d’accordéon, venus de l’avant du navire, avaient une douceur mourante dans la grande paix mélancolique du crépuscule. Comme d’habitude à pareille heure, Si-Mohamed, tourné vers le levant, faisait sa prière, en plein air, tantôt prosterné, tantôt debout, les bras dressés vers le ciel, bénissant Allah qui réglait toutes choses, dans sa parfaite sagesse, et dispensait le sage de prévoir ou de regretter.
Il était dix heures du matin. Au loin, sous le ciel clair, les côtes de France commençaient à se dessiner dans un flamboiement de soleil. Marzouk, plein d’entrain, les entrailles tumultueuses, s’apprêtait à quelques expériences éoliennes, mais il se contint, impressionné soudain, en voyant s’avancer vers lui le commandant de la Guyenne. C’était à lui qu’il en voulait. Un bourgeois devait avoir bavardé, quelqu’un l’avait trahi.
— C’est bien vous Marzouk ? questionna le commandant.
Le colosse se découvrit respectueusement.
— Oui, mon commandant, c’est moi.
— Je vous félicite, mon garçon. Il paraît que vous vous êtes admirablement conduit sur l’Eldorado.
Marzouk, croyant à de l’ironie, se disposait à plaider les circonstances atténuantes.
— On était comme fou, on ne se rendait plus compte, balbutia-t-il.
— Vous n’en avez que plus de mérite, repartit le commandant. Au dire des matelots et des émigrants, vous auriez arrêté la panique, rétabli l’ordre, réglé la distribution des vivres et sauvé plusieurs personnes pendant l’incendie. J’ai consigné tout cela dans mon rapport.
Marzouk se redressa.
— Je n’ai fait que mon devoir, déclara-t-il.
— C’est bien, dit le commandant.
Et il lui serra la main.
C’était, à bord, le brouhaha qui précède l’arrivée. Des appels et des ordres retentissaient d’un bout à l’autre du pont. On approchait. Armand Reboul, pensif, regardait l’horizon où les côtes apparaissaient plus nettement, avec des teintes infiniment variées et délicates. Il se retourna en entendant la voix de Mme Rolande.
— Venez, j’ai à vous parler.
Il fut surpris de son air grave, fier et résolu.
— Parlez, dit-il, je vous écoute.
— Non, pas ici. Il faut que nous soyons seuls… Suivez-moi.
Ils descendirent, longèrent le couloir des premières. Devant sa cabine, Armand s’arrêta.
— Voulez-vous que nous entrions là ? demanda-t-il.
— Non, dit-elle simplement.
Elle l’entraîna au fond d’une sorte d’impasse où le jour pénétrait à peine.
— Armand, écoutez-moi, je n’abuserai pas de votre patience… Mais l’heure est venue de nous expliquer honnêtement et loyalement… Armand, vous ne m’aimez plus !
Il eut un geste qui protestait.
— Oh ! je ne vous reproche rien, reprit-elle. En me jurant un amour éternel, vous aviez promis plus que vous ne pouviez tenir. Il faut avoir beaucoup souffert et connaître bien la vie pour manier avec délicatesse ces félicités fragiles, si vite brisées par la plupart des hommes… Pourtant je vous avais prévenu, pourquoi ne m’avez-vous pas crue ? Hélas ! je ne croyais pas moi-même avoir si tôt raison.
— Comme vous me parlez ! murmura-t-il, confondu par cette franchise hautaine, humilié d’apparaître et de se sentir un raté du cœur.
— Je ne vous en veux pas, dit-elle. Vous étiez sincère et vous vous êtes trompé. Le cœur aussi a droit à l’erreur… Mon ami, je vous rends votre liberté, en faisant des vœux pour que le souci de ma destinée ne vous trouble pas désormais.
Sa voix trembla un peu en ajoutant :
— Quand vous aurez trouvé votre joie de vivre, ne vous inquiétez pas de ce que je serai devenue.
Il répliqua d’une voix ardente :
— Je ne vous abandonnerai pas, je suis un honnête homme, je vous ai donné ma parole.
— Je vous en délie, dit-elle avec douceur. Je ne veux pas être la chaîne de votre existence, mon ami, ni renouveler avec vous le triste roman d’Adolphe et d’Élénore. Vous avez éprouvé déjà de la déception. Vous vous consolerez loin de moi, vous aimerez encore… Le cœur de l’homme est comme l’habit du pauvre, c’est à l’endroit où il est raccommodé qu’il est le plus fort.
Elle le regarda longuement, comme si elle eût voulu fixer dans ses prunelles l’image de son dernier amour, puis ajouta :
— Voici l’instant de nous séparer… Armand, adieu !… Je vous permets de m’embrasser, une dernière fois.
Il ne répondit pas, se sentant coupable et petit, près de tant de noblesse. S’il ne l’aimait plus, il ne pouvait se défendre de tenir à son estime ; y renoncer l’eût amoindri à ses propres yeux. Cette estime même avait porté atteinte à sa passion, où la sensualité avait pris plus de place que le sentiment, et maintenu entre elle et lui cet éloignement moral, ce respect qui glace la communion des corps, comme si, pour éprouver la volupté entière de la possession, il était nécessaire de mépriser un peu. Il eût désiré qu’elle gardât de lui un bon souvenir et s’attristait de ne pas trouver une phrase qui révélât quelque grandeur d’âme.
Alors, indulgente, elle lui prit la main et, l’attirant vers elle, le baisa au front, comme un grand enfant qu’on console. Pour elle, elle était arrivée à ce point où le malheur se passe de consolation. C’était un déchirement de tout son être. Sa poitrine se gonflait de toutes les larmes dont ses yeux étaient taris, car il n’est que les petites douleurs qui pleurent ; les grandes ne montent jamais à la surface.
Elle continuait à l’embrasser, sans plus pouvoir rien dire. Lui, cependant, reprenait conscience et lui rendait ses baisers. Un peu de remords lui venait de cette existence dont il achevait la destinée, et il balbutia :
— Xanie, j’étais indigne de vous, mon cœur était trop faible pour un si grand amour, pardonnez-moi… Mais que puis-je maintenant pour réparer le mal que j’ai causé ?
— Rien, dit-elle, puisque je n’ai pas réussi à vous rendre heureux… Mais que cette triste expérience vous soit utile. Désormais, bornez-vous aux désirs, sans souhaiter qu’ils se réalisent, car les montagnes, mon ami, ne sont bleues que de loin.
Ils se quittèrent sans prononcer le mot d’adieu, sentant que cette fois c’était l’adieu définitif, celui qu’on ne dit pas.
Mme Rolande s’éloigna lentement. Son intelligence errait dans un pessimisme vague ; elle pensait à sa vie gâtée, à l’éternel avortement humain, et en arrivait au désintéressement d’elle-même. Elle eût voulu n’avoir jamais été, ou être la chose insensible, la feuille que le vent emporte et qui ne saigne pas.
En s’engageant dans un couloir, elle eut brusquement la sensation d’être suivie. Sans se retourner, elle continua son chemin. Derrière elle, cependant, les pas résonnaient plus fort, semblaient se rapprocher et l’atteindre. Un souffle lui effleura la nuque. Elle fit volte-face, vit un homme immobile et triste devant elle.
C’était M. Rolande. Il était méconnaissable, blanchi, vieilli de plusieurs années en quelques semaines.
Ils se regardèrent un moment, sans une parole, sans un geste, elle, comme étonnée de se retrouver en présence de cet homme, lui, debout, très grand, avec son air morne et silencieux de fantôme.
— Que me voulez-vous ? dit enfin Mme Rolande.
— Êtes-vous disposée à m’entendre ? demanda-t-il… J’aurais beaucoup de choses à vous dire, mais qui peuvent se résumer d’un mot, si vous êtes impatiente, si je vous suis devenu odieux au point que le son de ma voix vous soit intolérable… Xanie, je vous pardonne.
Mme Rolande tressaillit. Il eut un mouvement comme pour se retirer.
— Restez, dit-elle… Quelle parole ai-je entendue ?… Qui me parle ainsi ?… O mon Dieu ! qu’ai-je fait ? qu’ai-je fait ?
— Je vous pardonne, répéta-t-il. N’en soyez pas surprise, car si un peu de malheur donne de l’amertume, beaucoup porte à la bonté qui n’est qu’une plus grande justice… Pendant vingt ans que nous avons vécu ensemble, vous avez été une honnête femme ; vous l’êtes encore, à mes yeux, car une faute ne saurait effacer un long passé de vertu. La fatalité seule est coupable ; et le cœur a des exigences qu’il est impossible de ne satisfaire jamais. Quand on est altéré d’idéal, c’est jusque dans la boue qu’on irait puiser la goutte d’eau rafraîchissante… Ma pauvre amie, nous revenons tous deux de très loin, vous, des chimères décevantes, moi, des vanités et des préjugés qui rendent la plupart des hommes si ridicules et si misérables. Nous pouvons nous réconcilier, à cette heure, car nous voici plus près l’un de l’autre que nous n’avons jamais été… Aussi bien, il est trop tard pour recommencer, chacun de notre côté, l’existence ; on n’a plus de chance, à notre âge… Il ne nous reste plus qu’à accepter avec patience et humilité la dure condition humaine qui veut qu’on se résigne, après avoir éprouvé la défaite des illusions et l’inutilité de la révolte.
Une accalmie s’était faite. La machine avait ralenti. Le navire s’engageait dans l’embouchure de la Gironde.
Mme Rolande était tombée aux pieds de son mari.
— Relevez-vous, dit-il, et prenez mon bras. Il faut nous préparer à débarquer… Venez m’aider à boucler nos valises.
Ils croisèrent, sans y prendre garde, Mme Larderet qui sanglotait auprès de Marzouk. La veuve, jadis vénérée, maintenant tenue à l’écart et considérée comme une prostituée, avait acquis la conviction qu’elle était enceinte des œuvres du lutteur. Lui, très paternel, la consolait, à sa façon :
— Ben, si ça y est, ça y est. Il y a pas de quoi chialer. C’est gentil, un gosse… Ça te fera une compagnie pour plus tard.
Mais il l’avait rejoint dans une autre intention et attendait le moment de placer sa phrase. Comme elle ne cessait de geindre, il se décida :
— Dis donc, c’est pas tout ça… Moi, je suis sans le sou, raide comme un piquet… Toi, tu es riche. Faut que tu m’avances cinq cents francs. C’est raisonnable, c’est pas exigeant… Je te revaudrai ça, quand je serai installé.
Mme Larderet sanglotait plus fort.
— C’est pas cinq cents francs de moins qui pourraient te gêner, insista Marzouk. Et puis, je ne suis pas ingrat… Si tu me rendais ce service, bien sûr que je n’irais pas raconter ce qui s’est passé entre nous. Je garderais le secret… Moi, j’ai l’habitude d’être délicat avec les gens qui me veulent du bien.
Cette fois, la veuve releva la tête. Elle avait compris.
— C’est bien, vous les aurez, dit-elle.
— Quand ça ?
— Les voici.
Marzouk compta les billets de banque. Il avait son compte.
— Faut s’entr’aider, affirma-t-il… Merci et au revoir.
Mais il se retourna pour dire :
— Quand il naîtra, tu l’appelleras François. C’est mon petit nom.
Puis, il réfléchit. Il y avait encore d’autres personnes susceptibles de s’intéresser à son avenir et à sa discrétion : toutes les bourgeoises cossues dont il avait obtenu les faveurs. A cette heure, son silence valait de l’or ; il s’en ferait des rentes. Plus d’une avait le masque, et déjà des ventres commençaient à poindre. Le principal auteur de ce bel ouvrage, c’était lui. On ne pouvait pas laisser un père de famille dans la misère. En comptant bien, quatorze femmes, y compris Mmes Larderet, Chabert et Bineau portaient le fruit de ses œuvres. Un moment, ce calcul l’obséda. A la fin, ses entrailles de père s’émurent, il tonna avec tant de puissance que les cloisons en tremblèrent et qu’un Anglais, très digne, qui passait derrière, fit un bond de côté, en s’écriant : « Shocking ! shocking ! shocking ! »
Cependant, une vague rumeur montait vers le ciel pur. Dans quelques minutes, on serait à Bordeaux. Tandis qu’André Laurel, radieux, embrassait les mains de Myrrha, ce témoignage d’amour où il entre à la fois de la tendresse, de l’humilité et de la reconnaissance, Armand Reboul, en contemplant les rives du fleuve, méditait sur la triste fin de son aventure. Ainsi, cette grande passion avait abouti à ce dénouement banal et pacifique, la rupture sans fracas, sans regret, sans larme, qui ne laisse au cœur qu’une mélancolie terne, une paresse de la sensibilité, quelque chose comme la lassitude d’un ouvrier, sa journée faite. Il lui semblait qu’il n’aurait plus jamais la force de recommencer à aimer, tant le feu de son imagination avait tari en lui les sources du désir, tant il avait été glouton au banquet de l’amour. Est-ce que tout l’art de vivre ne consistait pas en ce précepte du sage qui ordonnait de se lever de table avec un peu d’appétit ? Son cœur avait fait faillite, parce qu’il avait craint de mourir avant d’être rassasié. L’intimité de tous les instants avait éteint sa passion. Sans doute eût-il aimé Mme Rolande pendant des années encore, s’il n’avait pu la voir qu’une fois par semaine. Hélas ! pensa-t-il, rien ne résiste qu’à la distance qui permet l’illusion ; la nature fut prévoyante en créant ces obstacles que nous nous efforçons à vaincre, et peut-être tous les secrets qu’elle nous cache sont-ils autant de déceptions et de maux dont elle a voulu nous préserver.
André dit à Myrrha :
— Nous allons nous marier, le plus tôt possible. Il ne faut pas que ça traîne… Et tu mettras de la fleur d’oranger dans tes cheveux, Myrrha. Ça ne coûte pas cher et ça fait bonne impression.
Elle le regarda, surprise et fâchée.
— Ce n’est pas gentil ce que tu dis là, André, et ce n’est pas très spirituel. Tu m’as fait de la peine. Dispense-moi de ces plaisanteries d’un goût douteux.
— Mais je ne plaisante pas, répliqua-t-il. C’est très sérieux, Myrrha, je t’assure ! Il faut que tu te maries avec de la fleur d’oranger. C’est nécessaire.
— Pourquoi ce mensonge ?
— Parce que le mensonge aussi est nécessaire. La société tout entière repose sur lui, et sans lui, il n’est même pas de société possible. Mon père me le répétait souvent, et cela m’indignait. Je vois maintenant qu’il avait raison.
Comme elle semblait ne pas comprendre, il s’étendit :
— Voyons, Myrrha, est-ce que le vêtement lui-même, qui cache les difformités du corps, n’est pas un mensonge ? Est-ce qu’on se fréquenterait si chacun disait tout ce qu’il pense ? Si l’attitude et le langage étaient toujours l’image des dispositions du cœur ? La nature ne ment-elle pas aussi, qui se pare et se farde sans cesse ?… Vois-tu, Myrrha, Dieu fit le monde et, le voyant si laid, il donna à l’homme l’illusion, c’est-à-dire la faculté de se tromper et d’adorer, sous le nom d’idéal ce que nous blasphémons sous le nom de mensonge. Les roses de l’esprit naissent du fumier de la vie. Les conditions sociales mêmes nous obligent tous, tant que nous sommes, à l’hypocrisie, et peut-être ne faut-il pas s’en plaindre, Myrrha, après ce que nous venons de voir, car le vice qui rend hommage à la vertu, en se parant de ses dehors, est moins blâmable que celui qui étale cyniquement sa laideur et le mauvais exemple… Voilà, ma chère Myrrha, les réflexions que je me suis faites, en ces jours d’opprobre et d’épouvante où chacun de ces gens-là, si dignes maintenant, avait déposé son masque.
Après un silence, il ajouta :
— Il y a trois personnages en nous : celui que nous sommes, celui que nous croyons être et celui que nous voudrions être. A n’en pas douter, c’est ce dernier qui vaut le mieux, puisqu’il tend à s’améliorer et à se rapprocher d’un idéal.
— C’est bien, dit en riant Myrrha, je me marierai avec de la fleur d’oranger.
— Soyons seulement sincères vis-à-vis de nous-mêmes, conclut André.
La machine venait de stopper. La Guyenne glissait lentement, avec précaution, le long des quais. Puis ce furent de nouvelles trépidations ; l’hélice s’était remise à tourner, répandant un tourbillon d’écume, d’une blancheur de lait. On faisait machine en arrière pour arrêter l’élan du paquebot.
— Oh ! regarde ! regarde ! s’écria Myrrha.
Sur le quai de débarquement, une foule énorme stationnait, plus de dix mille personnes. Depuis une heure, la Guyenne était annoncée, et le bruit s’était aussitôt répandu en ville que le navire ramenait les naufragés de l’Eldorado. Une clameur formidable d’enthousiasme retentit. Cinq cents existences sauvées ! Les bras, les mouchoirs et les chapeaux s’agitaient au-dessus des têtes, et déjà les reporters et correspondants des journaux, envahissaient le pont, sollicitant des interviews.
Marzouk, posément, l’air humble, racontait à trois d’entre eux ses exploits, ses actes de dévouement, de sang-froid et d’héroïsme, un héroïsme dont il ne semblait pas lui-même avoir conscience, tant son récit avait de naturel et de simplicité. Les reporters prenaient des notes. L’un d’eux le félicita. Marzouk se souvint de la réponse qu’il avait faite au commandant et répéta avec la modestie touchante des héros :
— Je n’ai fait que mon devoir.
Depuis deux mois, la disparition de l’Eldorado occupait toute la presse française, angoissait l’opinion. On avait fini par croire le navire perdu, sombré dans quelque terrible cyclone, en plein océan, ou échoué sur quelque côte déserte de l’Afrique occidentale, et pillé par des nègres. Le premier paquebot envoyé à sa recherche était rentré à Bordeaux, après avoir en vain sillonné l’Atlantique. Et l’on commençait à s’inquiéter du second, la Guyenne, de la même compagnie, parti avec la même mission et dont on ne savait rien, depuis près de cinq semaines.
Tout à coup, la grande nouvelle souleva d’émotion la France entière : la Guyenne venait d’arriver, ayant à son bord les cinq cents naufragés de l’Eldorado. Il n’y manquait que le commandant Lagorce, deux lieutenants et cinq matelots, héroïques victimes du devoir. Le reste était sain et sauf.
A défaut d’une actualité passionnante, l’événement prit une importance extraordinaire. Les journaux de Paris et de province abondèrent en détails, en interviews émouvantes, dramatiques, racontant le sinistre, l’incendie, l’échouage, les effroyables jours de détresse où tous avaient fait preuve d’un courage et d’un stoïcisme étonnants.
Aucun des naufragés n’avait soufflé mot de la panique et de la folie, des aberrations et des promiscuités, des nombreux adultères, des débauches et des hontes. La solidarité du silence s’était faite naturellement, sans entente, chacun ayant quelque méfait sur la conscience.
Les reporters citaient des traits admirables de sang-froid, de bravoure, de dévouement. Les chroniqueurs moralistes et psychologues s’étonnaient de ce que peut la nature humaine, en certaines circonstances. Une légende héroïque se créait sur le naufrage de l’Eldorado.
Ce fut, d’abord, de l’attendrissement, puis un grand élan de générosité. Partout, des souscriptions s’ouvrirent au bénéfice des émigrants dont la plupart se trouvaient dans un dénûment extrême. Danglar et Conseil triomphaient à Paris. Une conférence de l’illustre écrivain attira un public frémissant. A Bordeaux, les salons s’arrachaient les époux Avelard, qui ne s’étaient jamais vus à pareille fête, car ils appartenaient à la petite bourgeoisie, reléguée de la haute société provinciale. On se disputait également, dans le grand monde, les Gallerand, Mmes Chabert, Bineau, Garigues et Larderet. Celle-ci y recevait des compliments sur sa santé. Oui, il semblait qu’elle avait engraissé. L’air de la mer sans doute lui avait été favorable.
Chacun, objet de curiosité et d’admiration, offert en spectacle aux invités, reprenait chaque soir, devant une galerie stupéfaite, le tragique récit du naufrage. Plus de grand dîner sans l’un d’eux. Enfin tous des héros. Eux-mêmes maintenant, ayant fini par se prendre à leurs propres mensonges, en étaient convaincus.
Mais l’enthousiasme redoubla, quand un grand quotidien de Paris eut publié le rapport du commandant de la Guyenne. Marzouk y était cité. Le lendemain, en tête du Petit Journal, paraissait l’article suivant :
UN HÉROS
« A côté de tant de spectacles, dont s’attriste justement la conscience publique, il est doux et reposant parfois d’arrêter un instant ses regards sur quelque bel exemple de courage, de désintéressement et de sacrifice. C’est à nous de le révéler, de le propager ; il ne faut pas qu’il soit dit que le mal seul a droit à la réclame. Le bien, il est vrai, ne fait pas de bruit, le véritable héros n’est pas tapageur, et c’est pourquoi on a peine souvent à le découvrir.
« Le hasard, cette fois, a voulu soulever le voile dont s’enveloppe ordinairement sa modestie. On a lu, hier, dans nos colonnes, le rapport si émouvant du commandant de la Guyenne sur la catastrophe de l’Eldorado.
« Certes, tous ceux qui vécurent ces jours horribles, éprouvèrent de telles angoisses, séparés du reste de l’humanité, perdus au milieu de l’océan, méritent les plus grands éloges, car tous firent preuve de sang-froid, de solidarité et de la plus rare énergie. Mais, parmi eux, une figure se dresse, celle d’un héros véritable, digne de toute notre admiration. Il se nomme Marzouk.
« A lui seul, il sauva plus de vingt personnes, hommes, femmes et enfants, parvint à arrêter la panique, maintint l’ordre, organisa la distribution des vivres, soutint l’espoir et la vaillance de tous, en l’absence du commandant et des officiers du navire, qui avaient péri dans l’incendie.
« Marzouk est un géant, un bon géant, grand par le cœur comme par la taille. Il mesure près de deux mètres de haut, il est doué d’une force herculéenne qui, seule, l’avait distingué jusqu’à ce jour. Nous avons pu le voir et le féliciter nous-même, mais nos félicitations ont paru le gêner : « Je n’ai fait que mon devoir », nous a-t-il répondu. Il se dérobe aux ovations.
« Marzouk, ce nom n’est pas ignoré de tous. Plusieurs peut-être s’en souviennent. Il figura, en effet, un moment, sur les affiches du Casino de Paris et des Folies-Bergère, au temps, déjà un peu lointain, où ces établissements nous offrirent le spectacle des luttes à main plate. Marzouk y terrassa ses adversaires et fut déclaré champion de France… Où diable la vertu va-t-elle se loger ? pourrait-on s’écrier après Molière.
« Mais, direz-vous, il n’est pas de sot métier. Chacun gagne sa vie comme il peut, et il serait injuste, j’allais écrire démoralisant, que l’héroïsme ne fût pas récompensé partout où il se rencontre. Et qui devrait-on encourager, si de tels actes, qui consolent un peu des mille turpitudes de la vie courante, ne l’étaient point ?
« Un de nos confrères réclamait pour ce héros la médaille de sauvetage… Eh bien, non, ce n’est pas assez, c’est une dérision, et tout le monde, je pense, sera de mon avis. Le gouvernement de la République, qui proclame l’égalité des citoyens, s’honorerait en faisant davantage, et nul, cette fois, n’y trouverait à redire : tous applaudiraient.
« Combien portent la croix des braves qui ne sauvèrent pas une seule vie ? Combien de rubans rouges ne sont dûs qu’à l’intrigue et à la faveur ? Et pourquoi ne décorerait-on pas Marzouk ? Quoi donc s’y oppose ? Sa condition ? Tous les hommes n’auraient donc pas les mêmes droits dans notre démocratie ?
« Toutefois, il existe des précédents. N’a-t-on pas, en effet, il y a quelques années, promu au grade de chevalier de la Légion d’honneur un simple sergent de ville qui avait arrêté un anarchiste ; et ne fut-il pas sérieusement question, une autre fois, d’accorder la même récompense à un cocher de fiacre qui s’était distingué par sa bravoure dans l’incendie du bazar de la Charité ?
« En vérité, notre héros n’a-t-il pas fait bien davantage ? Qu’on le décore… Si, cependant, on y voyait un obstacle dans la profession qu’il exerça, il serait aisé de lui trouver un emploi compatible avec sa nouvelle dignité. Honorons la vaillance, le dévouement et la vertu. »
Le dithyrambe fut cité, reproduit, approuvé. Oui, il fallait décorer ce brave, réhabiliter le ruban rouge, vendu, prostitué, accordé à des épiciers enrichis, à des anarchistes, à des littérateurs ignorant la syntaxe. Question de principes et de morale, simplement. La Légion d’honneur, Napoléon l’avait créée pour récompenser l’héroïsme.
La politique s’en mêla. Pour la première fois, tous les partis furent d’accord. Marzouk devint populaire. Grâce à sa haute taille, on le reconnaissait dans la foule, qu’il dépassait de toute la tête. Les passants s’arrêtaient, les voyous l’acclamaient. Lui, très droit, très digne, avançait lentement dans cette apothéose.
— Je n’ai fait que mon devoir, répétait-il invariablement.
Sa photographie figurait aux vitrines des grands magasins, parmi les célébrités contemporaines : artistes, savants, hommes d’État. Les journaux l’exposèrent dans leur salle des dépêches. Elle orna les cartes postales. Des industriels exploitaient la gloire du héros. Un roman en livraisons à dix centimes fut lancé sur la voix publique : Les Mémoires de Marzouk.
La morale, cette fois, prenait sa revanche. A la bonne heure ! On avait assez fait de publicité à des forçats libérés, à des Gabrielle Bompard. Tout était pourri, la noblesse et la bourgeoisie. Il n’y avait encore de la vertu, de la générosité, du désintéressement que dans le peuple, dont sortait Marzouk.
A la fin, le gouvernement céda. Marzouk eut la croix et obtint du même coup une bonne sinécure : la garde d’un jardin public.
D’abord, un peu déconcerté, il avait vite repris son assurance. Sa célébrité ne l’étonnait pas. Elle lui semblait légitime. C’était vrai, après tout, ce que les journaux avaient raconté de lui : il avait rétabli l’ordre, partagé les vivres et rendu la confiance aux naufragés. Peut-être même avait-il sauvé du monde ; il ne se souvenait plus bien, mais ce devait être aussi la vérité, puisque tout le monde le disait.
Son ruban rouge le faisait loucher. Il le portait large comme la main, et tel était son respect pour ce glorieux insigne qu’il le retirait un moment de sa poitrine, chaque fois que, par une habitude malheureuse dont il ne parvenait pas à se défaire complètement, il éprouvait le besoin de soulager ses entrailles enflées d’un ouragan. La Légion d’honneur, ça lui bouchait positivement le derrière ; il fallait à toute force qu’il l’enlevât, quand ça le prenait, et vite il gagnait un bosquet solitaire pour que personne n’entendît. Car, s’il respectait sa décoration, il se respectait aussi lui-même maintenant, comme le public, la société tout entière.
Enfin, un homme absolument métamorphosé, grave, silencieux, ne parlant plus que de devoir, de morale, d’honneur et de patrie, faisant la leçon aux pochards, prêchant partout le bon exemple. Le symbole même de la vertu récompensée.
Cependant, une ardente polémique venait de s’engager entre les Libertaires et ceux qui les traitaient d’utopistes, au sujet du naufrage de l’Eldorado. Les Libertaires chantaient victoire, triomphaient bruyamment. La société libre, affranchie des lois, avait fait ses preuves. L’expérience était décisive. Pendant deux mois, à bord d’un navire échoué au milieu de l’océan, sur un rocher désert, alors qu’il n’y avait plus ni commandant, ni officier, ni autorité d’aucune sorte, l’accord le plus parfait, la solidarité la plus touchante avaient régné, entre ouvriers, bourgeois, matelots, prolétaires, tous devenus égaux et frères, réalisant l’idéal de l’état anarchique. Et qui donc maintenant oserait dresser l’épouvantail des égoïsmes, des passions et des vices déchaînés par la liberté absolue ? L’argument imbécile et de mauvaise foi tombait de lui-même. A bas les codes ! A bas les frontières ! A bas les gendarmes, les juges, les prisons et les patries ! Les hommes de tous les pays et de toutes les races ne demandaient qu’à vivre en frères. Vive l’anarchie ! Mort à la société bourgeoise, unique cause de toutes les corruptions, de toutes les iniquités, de tous les maux !
Un journal catholique, La Croix de Bordeaux, éleva soudain la discussion à des hauteurs inaccessibles. C’était Dieu, Dieu seul qu’il fallait remercier de son infinie bonté, Dieu qui avait encore fait ce miracle, pour éblouir le monde, de sauver cinq cents naufragés considérés comme perdus. Mais il était juste aussi de féliciter ces derniers de n’avoir pas désespéré de la clémence céleste. Ils avaient été de bons chrétiens, convaincus que rien n’est impossible à Dieu, et c’est pourquoi le ciel les avait exaucés. Malheur aux incrédules, quand l’Auteur des choses donnait de tels signes de sa puissance et de sa souveraine miséricorde !
L’article était intitulé : Un miracle, et conviait en terminant les naufragés au saint office qui serait célébré, le lendemain, à la cathédrale, pour rendre grâces au divin Sauveur.
Ce fut une cérémonie magnifique, à laquelle assista toute la société chrétienne de Bordeaux, le préfet lui-même entouré des hauts fonctionnaires. On avait réservé une place, dans le chœur même de la basilique, à ceux que Dieu avait choisis pour attester son omnipotence et offrir aux fidèles assemblés le témoignage vivant d’un miracle. Ils n’étaient qu’une vingtaine, la plupart ayant déjà quitté la ville. Mais les présents compensaient par leur qualité la quantité d’absents. Au premier rang, agenouillées, très recueillies, la tête basse, les mains jointes, Mmes Larderet, Gallerand, Chabert, Bineau, Garigues et Avelard, murmuraient des prières. Les messieurs, debout, suivaient pieusement la messe, une grande messe chantée, qui fut interrompue par un sermon, si long, si long que ces dames ne voyaient plus venir le moment tant désiré où elles pourraient enfin s’approcher de la sainte table et recevoir la communion.
Mais le prédicateur dut s’interrompre un instant. Un murmure s’était élevé au fond de la nef, près du portail, et toutes les têtes se retournèrent. Qui troublait la majesté du saint lieu ? Plusieurs chut ! chut ! indignés se firent entendre, et aussitôt le silence se rétablit. Le bedeau avait chassé Lola qui s’était réfugiée dans l’église, cherchant un abri contre le froid qui pinçait dur, ce matin de décembre. Et elle sortit, sans protester, confuse d’être tombée au milieu de cette grande cérémonie à laquelle elle ne s’attendait pas. La maison du bon Dieu n’était point faite pour recueillir les créatures comme elle, sans pain et sans toit, celles dont le groupe éploré consolait, du haut du calvaire, les regards de Jésus crucifié.
Tout s’arrangeait, car la nature comme la société a horreur du désordre qui dure et, selon le mot de Gœthe, lui préfère l’injustice.
Les émigrants dispersés à travers le monde, après s’être partagé le produit, bien diminué, ainsi qu’il arrive toujours, des souscriptions publiques, avaient repris la chaîne de leur existence, en courbant le dos sous l’écrasement du destin.
Les bourgeois s’enlizaient de nouveau dans le bien-être. Mmes Larderet, Chabert et Bineau, la première veuve, la seconde divorcée, la troisième simplement séparée de corps et de biens, à cause de ses convictions religieuses, avaient accouché dans le plus grand mystère : l’une, de deux superbes jumeaux, les deux autres, chacune d’un garçon, dont la filiation demeurait d’ailleurs incertaine. Marzouk avait bien passé par là, mais le beau Rienzo, le chef des Tziganes, Danglar et Conseil aussi, et bien d’autres. Alors, on ne savait plus. C’était à s’y perdre.
Enfin, avec de l’argent, on se tire des situations les plus délicates, les plus scabreuses. De retour à Bordeaux, Mmes Larderet, Chabert et Bineau passèrent pour avoir adopté des orphelins, et l’on admira leur grand cœur.
Dans une petite ville de province, Mme Rolande et son mari vivaient heureux, très retirés, plus unis qu’ils n’avaient jamais été. Enfin, la chance souriait au pauvre ingénieur. Au service d’une société fondée pour la construction d’un canal, il touchait des appointements fixes, cinq cents francs par mois : la grande aisance des provinciaux rangés, économes, sans ambition.
Un enfant était né dans le ménage, environ sept mois après leur retour en France, sur la Guyenne. M. Rolande ne s’était point fait illusion. Il n’était pas le père. Mais quand on a pardonné, on pardonne encore.
— Puisqu’il est là, nous le garderons, avait-il dit, et nous tâcherons de bien l’élever, en lui cachant toujours la vérité sur sa naissance.
Ce jour-là, Mme Rolande avait beaucoup pleuré, et c’étaient les meilleures larmes qu’elle eût jamais versées, des larmes tièdes et douces où il y avait de tout : du repentir, de l’humilité, de la reconnaissance, de la pitié et presque de l’amour.
L’enfant grandissait, devenait charmant, avec cette sorte de douceur implorante des innocents qui sentent qu’ils ont quelque chose à se faire pardonner. M. Rolande, jadis si amer, était joyeux, d’une joie qu’il puisait dans la complète abnégation de lui-même. Peut-être son acte n’eût-il pas été compris de tout le monde, la magnanimité n’étant pas encore très humaine. Cependant, quand il disait : mon fils, il était convaincu qu’il ne mentait pas, puisqu’il donnait à cet enfant une intelligence et une âme, ce qui créait, à son sens, une paternité plus entière et plus légitime que le simple accident de la génération, où il n’était pour rien.
Armand Reboul, qui n’avait plus eu de nouvelles de Mme Rolande, ignorait ce fils qu’il n’avait eu que la peine de faire. Il vivait à Paris et continuait à se morfondre dans une oisiveté désordonnée et fébrile. Enfin, un charmant garçon que la vie avait trop gâté et auquel il n’avait manqué peut-être que du malheur, car, à part cela, il avait tout ce qu’il fallait pour être heureux : la fortune, l’indépendance et une assez bonne santé.
André Laurel avait épousé Myrrha, et il n’y avait pas de couple plus joli, plus rayonnant de jeunesse, d’espérance et de grâce. Ils avaient gardé la vieille tante, qui avait le bon esprit de se laisser vivre sans intervenir, sous prétexte d’expérience, dans les affaires du ménage.
M. Laurel père triomphait de voir son fils revenu à de saines idées. André ne rêvait plus de changer le monde, désabusé des présomptueuses chimères et convaincu qu’il n’y avait de meilleure œuvre que de faire un peu de bonheur autour de soi.
Exempté du service militaire, grâce à un peu de myopie et à de puissantes protections, il était devenu un ardent chauvin, prêt à reconquérir l’Alsace et la Lorraine, au coin de son feu, tandis que Myrrha souriait, rassurée, pensant qu’avec de tels patriotes, les épouses et les mères pouvaient dormir tranquilles.
Très appuyé, André se sentait promis au plus bel avenir. Sa carrière était toute tracée. Attaché déjà à la préfecture, il serait un jour préfet, comme l’avait été son père, dont il partageait maintenant toutes les opinions sociales, approuvant d’un balancement de tête continu et respectueux quand M. Laurel lui tenait ce langage :
— Mon cher enfant, je ne nie pas qu’il y ait des réformes nécessaires, mais les institutions, si imparfaites qu’elles nous paraissent, valent encore mieux que les hommes, car ce sont eux qui les pervertissent, en dénaturent l’esprit et les bonnes intentions. Et c’est le cœur humain qu’il faudrait réformer, bien plus que nos codes et nos lois. Mais la tâche semble bien difficile, sinon impossible. Laissons-la aux songe-creux et faisons un peu crédit à la nature humaine, en acceptant avec sagesse, tolérance et philosophie un tel état social qu’il n’est pas en notre pouvoir de changer et qui, d’ailleurs, marque bien un petit progrès sur les siècles précédents.
André approuvait toujours.
— Nul doute, poursuivait M. Laurel, que la société ne soit mauvaise et fondée sur le droit du plus fort. Mais peut-il en être autrement ? Peut-on supprimer l’égoïsme, la jalousie, l’ambition, toutes les passions humaines ? Peut-on, même en changeant la face du monde, faire autre chose que de déplacer la souffrance, qui sans doute est nécessaire à l’évolution universelle ? L’humanité, quoi qu’on fasse, restera ce qu’elle est. D’accord pour critiquer et démolir, nos idéologues cessent de l’être, quand il s’agit de reconstituer. Tous les systèmes, poursuivant au fond le même but d’amélioration, s’entredétruisent… Où est la vérité ? Qu’est-ce même que la vérité ? comme disait Pilate… Un jugement humain sujet à d’éternelles variations, suivant les lieux et les époques ? Et qu’est-ce aussi que la justice ? Encore une conception qui se modifie avec chaque individu. Ce qui est juste pour celui-ci paraît injuste à celui-là. L’intérêt personnel guide tout, demeure le souverain juge. Réparer une injustice n’est-ce pas souvent en commettre une autre ? Et comment l’homme faible, impuissant, soumis à l’inéluctable fatalité des choses, dirigé par des forces inconnues, peut-il espérer refaire l’œuvre de la nature, qui elle-même, dans ses desseins mystérieux, a établi l’iniquité sur la terre ? La grande sagesse est peut-être de se résigner à son sort. Cesser de souhaiter ce dont il faut désespérer, telle est sans doute la seule forme sous laquelle les hommes peuvent prétendre au bonheur.
Et laissant ainsi tomber toute sa philosophie bourgeoise, l’ancien préfet fumait un bon cigare, tandis qu’au dehors, la plainte du vent apportait l’écho lointain des détresses invisibles.
Le long des quais, Lola regardait Paris reposant dans la splendeur d’une féerie mystérieuse et profonde. Il était dix heures du soir. Une âpre bise soufflait sous le ciel morne, chargé d’une neige qui s’obstinait à ne pas tomber. Au loin, les réverbères des ponts, aux lanternes jaunes et rouges, traçaient sur le courant de la Seine des traînées resplendissantes, comme des chevelures de comète.
Depuis trois jours, elle errait, affamée, les pieds meurtris dans des chaussures qui crachaient la boue. Un trafiquant l’avait ramenée à Paris. Mais les hommes ne voulaient plus d’elle, elle était trop décatie, trop usée par la misère et la souffrance. Quant à chercher du travail, il ne fallait pas y penser.
Elle n’avait pas su exploiter les hommes au temps où elle était gentille, où ils couraient tous après elle. Son métier de garce ne lui était jamais entré dans la peau ; elle n’avait pas le caractère à ça. Et ça ne s’apprend pas : on naît garce, on ne le devient pas.
Maintenant, c’était fini. Elle était laide, fauchée, crottée à faire peur. Elle ne s’était pas traînée jusqu’en ce lieu désert, par cette nuit glacée de décembre, avec l’espoir vague de trouver quelqu’un, mais pour se soustraire au Paris doré et flamboyant, enfoncer sa détresse en un coin de ténèbres.
Cependant, à l’entour, des ombres quêteuses rampaient sur le pavé boueux. C’est là, entre le pont des Invalides et celui de la Concorde, sur la rive gauche de la Seine, que viennent échouer, de dix heures à minuit, les sentinelles perdues de la basse prostitution, tout ce qu’il y a de plus déchu, de plus flétri, de plus abîmé, des femmes qu’on dirait sorties de cavernes et qui s’offrent aux marauds pour cinq sous, pour deux sous ; des figures tragiques, ravagées par le vice, la longue misère et la famine, la plupart vieilles, grisonnantes, la bouche édentée, fendue d’un rire machinal et horrible. Le jour, ça rôde dans les bois suburbains, chassées de la capitale par le dégoût public, épaves pourries des bagnes de l’amour, tellement sinistres qu’on ne saurait croire que des êtres humains en arrivent à ce degré de laideur et d’ignominie.
Lola, accoudée sur le parapet, la tête basse, regardait couler l’eau sous le pont, fascinée par le courant, tentée de s’y précipiter. Un chien crevé qui passa sous le reflet d’un réverbère la rendit jalouse.
Des coups de sifflet stridents déchirèrent le silence de la nuit. Elle savait ce que ça signifiait. Des souteneurs aux aguets avertissaient ainsi que la police des mœurs s’apprêtait à donner, dans ces parages, un coup de filet à la prostitution.
Lola pressa le pas, puis, les sifflets redoublant, se mit à courir, malgré la faiblesse de ses jambes usées, à force d’arpenter les kilomètres. Tout, plutôt que de tomber entre les pattes de la Rousse !
Elle courait, éperdue, le long des quais, espérant dépister les agents. Mais les pas résonnaient plus fort derrière elle, sur le pavé. Ils étaient à sa poursuite, ils se rapprochaient. Déjà, il lui semblait sentir leur haleine rude sur sa nuque. Et, tout à coup, son pied buta, elle tomba raide, en jetant un grand cri.
— Enfin, nous l’avons, celle-là, fit une voix.
Trois agents se ruaient sur elle avec une brutalité de sauvages. D’un café voisin, qui flambait au coin du quai, une bande bruyante au même instant déboucha, envahit la chaussée. Un colosse se dressait au milieu, acclamé par la foule. C’était Marzouk. Bien qu’il fût devenu un peu fier, presque inabordable pour le menu fretin de la population, rendant à peine les saluts, et passant raide comme un piquet parmi les ovations, sa popularité n’avait fait que croître dans cette rue qu’il habitait, et dont il était le plus bel ornement, reluqué par les femmes, cité pour le bon exemple, choyé, flatté, admiré, recevant des cadeaux. Enfin, l’orgueil du quartier et des pauvres gens, comme si tous s’étaient sentis décorés en sa personne.
Les agents furieux de s’être essoufflés à la poursuite de Lola, la rouaient de coups. Attiré par ses cris, Marzouk s’avança. Et il considéra un moment, sans broncher, cette scène de meurtre, tandis que des réflexions naissaient en lui. Puis, relevant la tête, grandi soudain, il laissa tomber de très haut sur la foule, d’un ton sentencieux et avec un noble geste, l’enseignement moral que comportait ce banal fait divers, et désignant Lola :
— Voilà, dit-il, où mène l’inconduite.
FIN
PARIS
IMPRIMERIE GAMBART
52, avenue du Maine
LIBRAIRIE J. FERENCZI
9, Rue Antoine-Chantin — PARIS (14e)
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
| René BIZET | La Bouteille de whisky, roman | 3 50 |
| Paul BRULAT | Les Destinées | 3 50 |
| — — | Rina, roman | 6 » |
| Maurice DEKOBRA | Prince ou Pitre, roman | 3 50 |
| L. DELARUE-MARDRUS | L’Apparition, roman | 3 50 |
| Charles FOLEY | La Folie de l’Or, roman | 6 75 |
| Marion GILBERT | Celle qui s’en va, roman | 6 75 |
| Gustave GUICHES | La Tueuse, roman | 6 75 |
| Jehan d’IVRAY | La Rose du Fayoum, roman | 3 50 |
| André LICHTENBERGER | Les Centaures, roman | 3 50 |
| — — | Père, roman | 6 » |
| — — | Raramémé, roman | 6 75 |
| Maurice LEVEL | Les Morts étranges | 3 50 |
| Jeanne LANDRE | Le Débardeur lettré, roman | 3 50 |
| Pierre MILLE | L’Ange du bizarre | 6 75 |
| André PICARD et Francis CARCO | Mon Homme | 6 75 |
| L.-F. ROUQUETTE | Chère petite chose, roman | 5 » |
| — — | Le Grand Silence Blanc, roman | 6 75 |
| SHERIDAN | Renée, confession d’une amoureuse, roman | 6 75 |
| G. SPITZMULLER | Poil-de-Brisque, roman | 5 » |
| Edmond SÉE | La Lettre anonyme, roman | 6 75 |
| Gabriel TIMMORY | On danse | 3 50 |
| Pierre VEBER | Une Aventure de la Pompadour, roman | 6 75 |
| — — | Archytas-Roi | 6 75 |
Tirages spéciaux sur papier vergé pur fil des Papeteries Lafuma et sur papier alfa.
IMP. GAMBART, 52, AVENUE DU MAINE — PARIS.