L'ILLUSTRATION
Prix du Numéro: 75 cent.
SAMEDI 14 MARS 1891
49e Année--Nº 2507
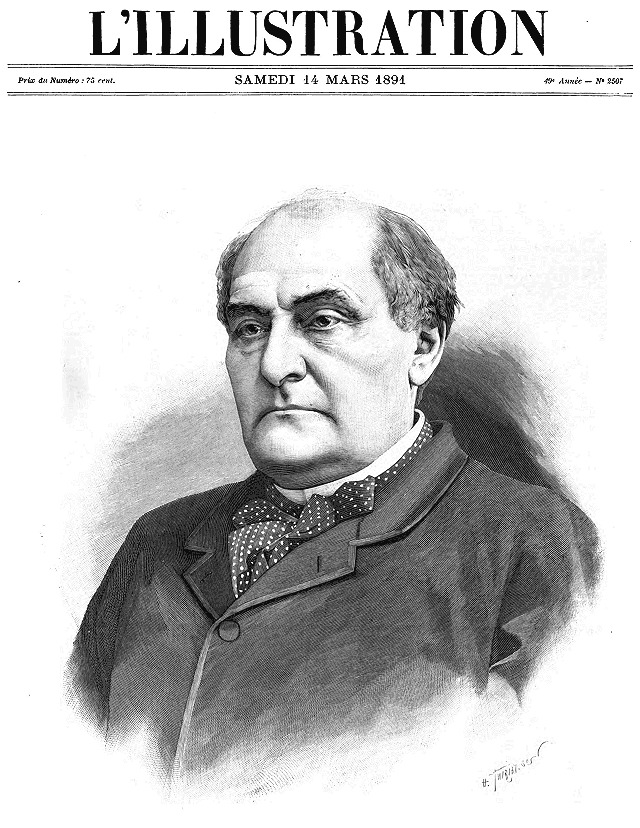
LE PRINCE NAPOLÉON
Photographie Pirou.

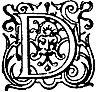 imanche dernier, en m'éveillant je me suis mis à la fenêtre. Un ciel
gris en haut, une boue jaune en bas. En face, devant une boutique de
fleuriste, des palmiers mouillés tremblotant au vent de pluie. Des
passants crottés, des fiacres vernis par l'averse.
imanche dernier, en m'éveillant je me suis mis à la fenêtre. Un ciel
gris en haut, une boue jaune en bas. En face, devant une boutique de
fleuriste, des palmiers mouillés tremblotant au vent de pluie. Des
passants crottés, des fiacres vernis par l'averse.
--Bon, me suis-je dit, en me rappelant le mot de ce maire de Paris redoutant l'averse: il pleut ce matin, il n'y aura rien aujourd'hui!
Cependant, les escadrons prenaient leur place de bataille dans les avenues du Bois, et les fantassins se déployaient en rideau pour mieux recevoir la Ligue des bookmakers, L. D. B., qu'on disait toute prête à entrer en guerre. Les pari-mutuellistes s'étaient, disait-on, mobilisés aux cris de: Des tuyaux ou la mort! On s'attendait à une journée. Mais moi, voyant tomber la pluie--ô giboulées de mars, vous voici arrivées!--je prophétisais sans beaucoup de peine:
--Rien. Il n'y aura rien!
Et il n'y a rien eu, en effet. Un calme plat, très plat. Des agents baignés de pluie, des municipaux recevant l'ondée avec la placidité de gens qui braveraient de même les balles.
Un pari-mutuelliste faisait courir ce quatrain mouillé au retour des courses sans paris, mais non sans averses:
8 Mars, de l'eau, pas de bataille,
Soyons-en fiers, mais sans orgueil!
Quelle aquarelle pour Detaille
Que cette bataille d'Auteuil!
La question des paris, des piquets, des bookmakers, a absorbé l'attention pendant bien des jours, et l'on a pu voir par là quelle importance ont les courses au point de vue des habitudes modernes. Je n'en suis ni amateur ni partisan. Mais je ne me reconnais pas le droit d'injurier ceux qui les aiment.
On me dit: Les courses développent la passion du jeu et ruinent les pauvres diables mêmes, qui sont la proie des bookmakers véreux et des joueurs de bonneteau. Sans doute. Mais la Bourse, mais la Banque, mais les émissions douteuses, mais tout ce qui fait appel aux appétits et aux espérances des foules, n'est-ce pas du jeu, n'est-ce pas la ruine mise à la portée de tous, sous le pseudonyme de la Fortune? Sans doute, l'humanité serait bien autrement morale si elle savait extirper ses passions comme un pédicure vous enlève un cor. Mais elle n'en est pas arrivée à ce degré de vertu, et elle ne paraît point devoir y parvenir encore cette année.
Il faut la prendre comme elle est, et l'amour de l'aléa fait partie de ses misères. De là, la fureur des courses. Je ne vous donne pas cet amour des courses pour ce qu'il y a de plus noble au monde, loin de là. C'est une ivresse comme une autre, un alcoolisme d'un certain genre. Mais enfin, je le répète, cela existe.
--Il faut, disait M. de Talleyrand, faire dans la vie la part du diable, comme dans un incendie on fait la part du feu.
Lorsque l'ex-évêque d'Autun rendit le dernier soupir, avec son dernier bon mot, il y eut autour de son lit de mort une sorte de curiosité un peu bien déplacée. On voulait savoir comment finirait le prince de Bénévent. Nous venons d'avoir à peu près le même spectacle autour de la dernière maladie du prince Napoléon.
--Finira-t-il en libre penseur ou en chrétien?
Si les paris n'avaient pas été interdits, on eût parié, tant le goût du jeu et de l'imprévu est, encore un coup, dans la nature humaine.
Ce n'est pas d'un simple comparse de la vie contemporaine, cette fois, c'est d'un personnage historique qu'il s'agit et, en quelque sorte, quoique rien de mystérieux n'existe dans sa vie, d'un personnage énigmatique: je veux dire que sa figure reste inachevée, comme sa destinée garde quelque chose d'incomplet.
C'était une rare et profonde intelligence que ce prince toujours mécontent et qui, même aux jours de triomphe, n'a jamais eu l'humeur d'un satisfait. Trop dédaigneux du vulgaire, malgré ses aspirations socialistes, il n'a jamais été populaire, parce que le peuple aime le panache et que le prince Napoléon préférait l'être au paraître.
Un jour, dans je ne sais quel voyage de gala, il était, avec un ami, étendu dans un wagon et, aux stations, comme on le savait là, on poussait des vivats, avec ce besoin qu'ont les foules d'acclamer qui que ce soit.
Le prince Napoléon, indifférent à ces manifestations, demeurait sur ses coussins, dans cette pose horizontale que son ami Théophile Gautier affectionnait.
--Monseigneur, lui dit son compagnon de voyage, montrez-vous au moins, ne fût-ce qu'une minute, à la portière. Ils vous attendent, ces braves gens. Entendez-les! Ils vous demandent: ils voudraient vous voir.
--Eux? fit-il. Allons donc! D'abord ils m'assomment, et puis ils ne me connaissent même pas; ils n'ont soif que de voir un prince!
Et il demeura étendu dans son wagon.
Comment d'ailleurs n'eût-il pas eu le mépris de la popularité? N'avait-il pas rencontré un jour, en plein Paris, une pauvre fille à qui il faisait l'aumône, lui disant:
--A qui ressemblé-je?
--Je ne sais pas.
--Regarde!
Et il lui montrait la pièce de monnaie à l'effigie de Napoléon Ier qu'il lui avait donnée. Le regard de la malheureuse allait, presque hagard, de la pièce au prince.
--C'est vrai, vous ressemblez à ça!
--Eh bien! qu'est-ce que c'est que ça? Oui, le portrait qui est sur cette pièce?
--Le portrait? Je ne sais pas.
--C'est Napoléon.
--Napoléon? répétait la pauvre fille, comme hébétée.
--Oui, Napoléon. Tu ne connais pas Napoléon?
--Non.
Elle ne le connaissait pas. Et ce n'était point une idiote. C'était une errante, une des anonymes de l'immense foule.
Le prince Napoléon, qui contait un soir cette histoire, ajoutait:
--Parlez donc de la gloire! Il y a des bas-fonds où nul rayon ne pénètre! Elle avait vingt-cinq ans, cette fille, et elle ne connaissait pas l'empereur!
Il m'est arrivé, à moi, passant par Versailles, de dire machinalement, rue Duplessis, à une bonne bretonne qui avait pourtant été à l'école primaire:
--C'est là, tenez, Yvonne, que demeurait Robespierre!
--Robespierre!
Elle ouvrait de grands yeux. Et ce nom ne lui disait rien, exactement rien. C'était la première fois en sa vie qu'elle l'entendait prononcer.
Le prince Napoléon, discutant, un jour, avec Napoléon III, se souvenait de la ressemblance absolue que son masque césarien lui donnait avec le «fondateur de la dynastie», comme on disait en ces heures-là.
--Regarde-toi donc, s'écriait-il en montrant une glace à l'empereur, lequel de nous deux a l'air d'un Napoléon?
Oui, il avait le profil de César et il restait tel qu'Edmond About l'avait représenté en une sorte de camée! «Le voilà bien ce César déclassé, que la nature a jeté dans le moule des empereurs romains et que la fortune a condamné à se croiser les bras sur les marches d'un trône...»
Je me rappelle l'avoir vu, vieilli et le visage toujours beau, bien que d'une chair affaissée et creusée de rides--quelque temps avant son exil. C'était dans un dîner somptueux. Au dessert, tout en fumant son cigare, le prince se mit à dire:
--Tant que quelques-uns feront des dîners comme celui-ci et que tant d'autres manqueront de pain, la machine ira mal! On peut vivre sans un menu pareil à celui de ce soir et les malheureux ne sauraient vivre sans le nécessaire!
C'était au moment où la Chambre allait voter la loi sur la proscription des prétendants.
--Si on la vote, demanda quelqu'un, que dira l'Europe?
Le prince Napoléon haussa les épaules.
--Ah! l'Europe! Elle se moque pas mal de quelques princes comme nous, l'Europe! Je les connais, les souverains, je suis peu ou prou le parent d'un certain nombre. Mais on nous collerait au mur qu'ils ne bougeraient pas! L'Europe! Il n'y a plus d'Europe, il y a M. de Bismarck!
Depuis, les choses ont changé: il n'y a plus de M. de Bismarck. J'ignore s'il y a une Europe. Mais il y a un tzar et il y a Guillaume II. Je n'oublierai jamais avec quelle hauteur de philosophie dédaigneuse ce neveu d'un empereur, ce fils d'un roi, ce cousin de César--enfant avant tout de la révolution française--parlait des souverains. C'était un cerveau puissant, moins né pour l'action que pour la discussion avec des savants, comme Renan ou Berthelot. Avec un tel tempérament, on peut entrer à l'Institut, mais on n'arrive pas au trône.
Napoléon III, plus nébuleux, mais plus croyant en son étoile, n'est pas entré à l'Académie, malgré la Vie de Jules César, mais il a régné.
Et voilà que cette silhouette d'un homme qui a fait tant de bruit dans le monde et qui eût souhaité y faire tant de besogne a absorbé presque tous les feuillets de notre causerie hebdomadaire. N'y a-t-il donc, à Paris, que cet écho d'un hôtel de Rome?
Il y a le Mage, qu'on donnera lundi, et tous nos reporters vont parler de Zoroastre comme ils parleraient de Daubray ou de Mily-Meyer. Zoroastre, comment donc! Mais ils ne connaissent que cela! demandez au Dictionnaire Larousse! Zoroastre par un z, comme Zola! Et nous allons assister au grand déballage de science banale puisée dans les dictionnaires!
Il y a Musotte et les cas de conscience qu'elle fait traiter dans les ménages. «Que devrais-je faire, dit la femme, si, tout à coup, j'apprenais que tu as un enfant caché quelque part?» L'histoire de Musotte va certainement rendre très prudentes les jeunes filles dès qu'elles seront fiancées. Elles exigeront de leur futur époux un serment préalable:
«Jurez-moi que vous n'abandonnez pas de Musotte!... Donnez-moi votre parole que vous n'avez pas d'enfant!» D'autres, des jeunes filles tout à fait fin de siècle, ayant lu le compte-rendu de la pièce de MM. Guy de Maupassant et Jacques Normand, ont eu un raisonnement plus original:
--Au fait, ce serait beaucoup plus commode si nos maris nous apportaient en dot un petit Musotte; nous n'aurions plus la peine de le mettre au monde!
Ce qui est certain, c'est que, depuis l'avènement de Musotte, les modèles font prime. Voilà, se dit-on, des femmes qui ont du cœur! Bonnes filles, ne demandant rien, ne demandant qu'un petit souvenir à l'heure de la mort. Tout à fait commodes. Il n'est pas une mère de famille qui ne rêve présentement une Musotte pour son fils, à la condition que Musotte mourra le jour même où le garnement épousera une jolie fille et une grosse dot. Ah! sans cela, pas de Musotte! Ou brusquement Musotte devient Sapho, et c'est grave. Sapho, c'est Musotte crampon. Musotte, c'est Sapho rosière.
Le malheur, c'est que Musotte est l'exception et Sapho la généralité. Il y a autant de Sapho qu'il y a d'officiers d'académie, et ce n'est pas peu dire! Un libraire a eu l'idée de publier un Annuaire des officiers d'académie et des officiers de l'instruction publique. Ce n'est pas bête, et, si tout bon citoyen enrubanné de violet achète ce volume, le libraire fera fortune. Un Annuaire spécial pour les officiers d'académie, n'est-ce pas admirable? C'est l'almanach des cent mille décorés!
--C'est par un ruban qu'on tient les hommes en laisse, disait encore feu M. de Talleyrand le ressuscité.
Rastignac.
LES MÉMOIRES DE TALLEYRAND
Au temps où le dialogue des morts, cette forme littéraire renouvelée des Grecs, était à la mode, il me semble qu'il y en aurait eu un bien joli à faire, à propos de la publication des Mémoires du prince de Talleyrand. On aurait pour la circonstance expédié aux enfers M. Renan ou quelqu'un de ses disciples, M. Maurice Barrès, par exemple; il n'eût pas manqué d'y rencontrer le prince qui lui eût tout aussitôt demandé des nouvelles de son livre.
Et M. Renan, après lui avoir conté le tapage qu'avait fait cette publication, eût loué le goût d'ironie supérieure et transcendante qui s'en dégage.
--On a prétendu fort irrévérencieusement, lui aurait dit M. Renan, que j'avais été de mon vivant le plus délicieux des fumistes, mais un fumiste. J'avoue que je l'ai bien été un peu, surtout vers la fin de ma vie. Il est doux, quand on est arrivé au comble de la gloire, de jeter sur l'humanité un regard de moquerie bienveillante et d'indulgent dédain. Mais vous m'avez été, je le reconnais, bien supérieur en ce genre, et la mystification que vous avez préparée avant de mourir passe de beaucoup toutes celles qu'on a jamais imaginées.
Avez-vous dû rire, en écrivant vos Mémoires, de la bonne, de l'excellente farce que vous ménagiez à la postérité! Ils étaient les plus innocents du monde: vous ne le saviez que trop, puisque c'est vous qui les composiez. Vous faisiez même exprès d'y chanter sur un mode aimable la vertu et vos vertus; et, pendant que vous vous livriez à cette occupation éminemment bucolique, vous alliez chuchotant partout d'un air mystérieux: «Oh! ces mémoires! le secret du siècle y est! J'y dis tout... tout... et le reste!... S'ils paraissaient aujourd'hui, ce serait en Europe un remue-ménage épouvantable. Toutes les vérités lâchées à la fois prendraient leur vol et le monde en serait effaré. Mais ils ne paraîtront point aujourd'hui; ils ne paraîtront pas même dans dix ans, ni dans vingt, ni dans trente; ce serait encore trop tôt. Trop de réputations encore debout seraient atteintes et bousculées. Cinquante ans après ma mort! Les mémoires dormiront tout ce temps, sous les cachets dont je les ai scellés. J'ai nommé des exécuteurs testamentaires, qui, à l'époque marquée, en pourront prendre connaissance, et, s'ils ne jugent pas qu'un bouleversement trop énorme en doive résulter, ils verront s'ils peuvent procéder à la publication.»
Et depuis lors, ô le plus astucieux des princes! le monde a vécu dans l'attente de vos Mémoires, et à chaque fois qu'un historien parlait de l'époque où vous avez vécu, et tous les jours il y en avait un nouveau, on se murmurait tout bas à l'oreille dans le public: «Oui! mais il n'a pas lu les Mémoires de Talleyrand! ah! s'il avait lu les Mémoires de Talleyrand!»
Et lorsque approcha l'heure fatale que vous aviez marquée pour l'ouverture de ce testament, il y eut dans la foule un grand frémissement de curiosité. Sera-ce pour demain? pour après-demain? enfin, nous allons tout savoir!
Ah! prince, si vous avez reçu aux enfers des nouvelles de ce qui se passait alors sur terre, vous avez dû goûter une joie fine et distinguée d'ironie supérieure, ce que mes disciples appellent une sensation exquise. Mais vous étiez plus malin encore qu'on n'avait pensé; vous aviez si bien choisi vos chargés de pouvoir, qu'eux aussi, après avoir pris connaissance de ces fameux mémoires, ils feignirent de trembler à l'idée des scandales épouvantables qui en allaient jaillir; ils refermèrent le couvercle, et déclarèrent qu'il fallait attendre dix ans encore.
Et ce fut dans toute l'Europe un cri de curiosité déçue: quoi! dix ans encore sans savoir le grand secret! L'imagination populaire surexcitée par ces mystérieuses cachotteries travailla sur ce thème; elle supposa que ces mémoires étaient, comme le cheval de Troie, tout pleins de révélations qui en allaient sortir la nuit armés, et mettre tout à feu et à sang.
Que je vous envie, prince! comme vous avez dû rire dans votre barbe! passez-moi cette expression familière, qui n'est pas de mon style habituel, mais sur les bords de l'Achéron on se met à son aise.
Il n'y a plus enfin moyen de reculer. Il a bien fallu publier vos mémoires; quel malheur que vous n'ayez pas été là! Si vous aviez vu la mine attrapée de tous vos lecteurs, qui s'étaient précipités sur les deux volumes! Ils y cherchaient le grand secret, les malheureux! Vous savez ce qu'ils y ont trouvé!
--Eh mais! pourrait répondre Talleyrand, ils y ont trouvé quelque chose dont ils ne se doutaient assurément pas: c'est que j'ai toujours été le plus chaste des jeunes gens, le plus vertueux des diplomates, le plus honnête des ministres. Est-ce qu'on savait cela? Eh bien, je l'ai dit, on le saura maintenant......
On le saura, mon Dieu! oui, mais ce n'est peut-être pas ce qu'on s'attendait à trouver dans les mémoires de Talleyrand. Oh! il y a eu un moment de déception.
Eh quoi! ce n'était que cela! Ce Talleyrand qui avait vu tant de choses, prêté dix-sept serments, qu'il avait tous trahis, qui avait été mêlé à tant d'intrigues ténébreuses, qui avait pratiqué tant de diplomates de souverains et qui les avait trompés tous, ce n'était plus qu'un bon jeune homme, qui était devenu un brave homme de ministre, pour mourir un aimable octogénaire!...
M. Mignet avait sans doute, lui, par avance lu ces mémoires étonnants, lorsqu'il prononçait cette oraison funèbre, qui est restée comme un des modèles du genre académique:
«Quand on n'a eu qu'une opinion, s'écriait M. Mignet, quand on n'a été l'homme que d'une seule cause, le jour où cette cause succombe, on se tient à l'écart et on s'enveloppe dans son deuil; mais lorsque, ayant traversé de nombreuses révolutions, on considère les gouvernants comme des formes éphémères d'autorité, lorsqu'on a pris l'habitude de ne les redouter qu'autant qu'ils savent se conserver, on se jette au milieu des événements pour en tirer parti...»
Et M. Mignet, après avoir montré son héros appliqué à la pratique de ses maximes, ajoutait:
«Talleyrand s'associa aux divers pouvoirs, mais il ne s'attacha point à eux; il les servit, mais sans se dévouer; il se retira avec la bonne fortune, qui n'est pas autre chose pour les gouvernements que la bonne conduite...
*
* *
Toute l'histoire de ces palinodies, arrangée par lui et à son avantage, ne peut offrir grand intérêt aux lecteurs. Des deux volumes que nous avons déjà, c'est le premier qui est le plus curieux, parce qu'il nous conte les premières années de Talleyrand. Il va de 1754, année de sa naissance, à l'entrevue d'Erfurth (1808). Le prince y conte en grands détails les premières années de son existence. Je ne sais si vous avez fait cette remarque: c'est, chez tous ceux qui ont écrit leurs mémoires, le printemps de leur vie qu'ils ont étalé avec le plus de vérité et de fraîcheur. Qu'y a-t-il, dans les Confessions de Jean-Jacques, de plus délicieux que le premier volume, où il nous dit ses joies et ses misères d'enfant, ses amours de jeune homme, ses rêves et ses déceptions? Retranchez de ce premier volume deux pages qui sont très vilaines, et qui le sont volontairement, c'est ce que l'on a écrit de plus divin, et songez que Jean-Jacques, à l'époque où il a rédigé cette autobiographie, était un vieux maniaque atrabilaire. Mais, quand il retournait ses regards vers les belles années de sa jeunesse, il avait plaisir à baigner ses yeux dans cette lumière pure.
Il va sans dire que je ne compare point Talleyrand à Rousseau. L'un est un grand écrivain; l'autre n'est qu'un homme de très bonne compagnie qui écrit avec beaucoup d'agrément. Mais c'est précisément ce qui m'a charmé dans la lecture de ces souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est de voir comme en ce temps-là les grands seigneurs, quand ils avaient de l'esprit naturel et un peu d'instruction (tous n'en avaient pas), écrivaient naturellement, d'un style aisé plein de grâce et d'enjouement.
Tenez! voulez-vous un exemple de cette langue à la fois libre, familière, nette et spirituelle? Prenez le joli passage où Talleyrand, qui était alors élève à Saint-Sulpice et qui s'y ennuyait si prodigieusement qu'il songeait au suicide, raconte ses premières amours.
«Plusieurs fois, j'avais remarqué dans une chapelle de l'église une jeune et belle personne, dont l'air simple et modeste me plaisait extrêmement. A dix-huit ans, quand on n'est pas dépravé, c'est là ce qui attire. Je devins plus exact aux grands offices. Un jour qu'elle sortait de l'église, une forte pluie me donna la hardiesse de la ramener jusque chez elle, et elle accepta la moitié de mon parapluie. Je la conduisis rue Féron où elle logeait. Elle me permit de monter chez elle, et, sans embarras, comme une jeune personne très pure, elle me proposa d'y revenir. J'y fus d'abord tous les trois ou quatre jours, ensuite plus souvent. Ses parents l'avaient fait entrer malgré elle à la Comédie; j'étais malgré moi au séminaire. Cet empire, exercé par l'intérêt sur elle, et par l'ambition sur moi, établit entre nous une confiance sans réserve. Tous les chagrins de ma vie, toute mon humeur, ses embarras à elle, remplissaient nos conversations. On m'a dit depuis qu'elle avait peu d'esprit; quoique j'aie passé deux ans à la voir presque tous les jours, je ne m'en suis jamais aperçu.»
Savez-vous bien que Lesage ni Voltaire ne content pas mieux, d'un tour plus leste et plus agréable? C'est que Talleyrand est le dernier-né du dix-huitième siècle, et c'est le dix-huitième siècle qui a porté à son plus haut point de perfection cet art de conter, qui est une de nos supériorités littéraires. Oui, je sais bien, vous allez m'objecter les récits de Mme de Sévigné. Nous les savons tous par cœur; mais Mme de Sévigné, c'était une imagination toujours en mouvement. Je parle de cette narration simple, aisée, fluide, relevée par-ci par-là d'un mot spirituel, dont Voltaire et Lesage ont donné, tous les deux, les plus inimitables modèles.
Y a-t-il rien de plus joli que cette phrase jetée négligemment dans le récit: «je devins plus exact aux grands offices!» Et comme il se termine, ce récit, d'une façon à la fois juste et piquante: «On m'a dit, depuis, qu'elle avait peu d'esprit; quoique j'aie passé deux ans à la voir presque tous les jours, je ne m'en suis jamais aperçu.» Quelle façon charmante de montrer ce que peut sur l'homme la prévention de l'amour. Il est plus que probable que cette jeune fille qu'il avait aimée était fort ordinaire; il s'en est aperçu plus tard et ne l'a pas voulu dire. Voltaire, ni Lesage, ni personne au dix-huitième siècle, ne se fût tiré plus galamment de la difficulté.
On avait bien de l'esprit en ce temps-là. N'est-ce pas Talleyrand lui-même qui a dit quelque part que quiconque n'avait pas vécu de 1780 à 1789 n'avait pas connu la douceur de vivre? Il a tracé dans ses mémoires un joli portrait de cette société, qui ne songeait alors qu'à l'amour, et ne se doutait guère de la proximité du gouffre où elle allait s'engloutir tout entière.
«C'était un spectacle curieux, pendant les six années dont je parle, que celui de la grande société. Les prétentions avaient déplacé tout le monde. Delille dînait chez Mme de Polignac avec la reine; l'abbé de Balivière jouait avec le comte d'Artois; M. de Vianes serrait la main de M. de Liancourt; Chamfort prenait le bras de M. de Vaudreuil; la Vaupellière, Travanet et Chalabre allaient au voyage de Marly et soupèrent à Versailles, chez Mme de Lamballe. Le jeu et le bel esprit avaient tout nivelé. Les barrières, ce grand soutien de la hiérarchie et du bon ordre, se détruisaient. Tous les jeunes gens se croyaient propres à gouverner... Cet état de choses aurait changé en un moment, si le gouvernement eût été plus fort et plus habile; si le sérieux ne fût pas totalement sorti des mœurs; si la reine, moins belle et surtout moins jolie, ne se fût pas laissé entraîner par tous les caprices de la mode...»
C'était regrettable assurément; mais il a fait bon vivre à cette époque pour les gens qui n'avaient que de l'esprit. A coup sûr je préfère le nôtre pour toutes sortes de raisons, dont la première est que, si j'avais vécu alors, je n'écrirais pas cet article aujourd'hui. Mais tous ces gens dont parle Talleyrand ont dû joliment s'amuser, et s'amuser d'une façon aimable.
Talleyrand excelle à tracer un portrait. Ce n'est pas le trait enfoncé à la Saint-Simon, le trait grossi, flamboyant, qui s'impose à l'imagination. C'est une suite de petites touches vives, lumineuses et spirituelles. Voyez ce qu'il dit de ce brave Lafayette, qui était bien le plus honnête homme du monde et le plus médiocre en même temps.
«Il était entré dans le monde avec une grande fortune et avait épousé une fille de la maison de Noailles. Si quelque chose d'extraordinaire ne l'eût pas tiré des rangs, il serait resté terne toute sa vie. M. de Lafayette n'avait en lui que de quoi arriver à son tour; il est en deçà de la ligne où l'on est réputé un homme d'esprit. Dans son désir, dans ses moyens de se distinguer, il y a quelque chose d'appris. Ce qu'il fait n'a point l'air d'appartenir à sa propre nature. On croit qu'il suit un conseil. Malheureusement, personne ne se vantera de lui en avoir donné à la grande époque de sa vie.»
Ce portrait de demi-teinte est délicieux. Cet homme qui n'a en lui que de quoi arriver à son tour, qui reste en deçà de la ligne où l'on est réputé homme d'esprit, qui ne fait bien que sur le conseil des autres, et à qui personne n'a donné de conseils à la grande époque de sa vie, c'est d'une malice rentrée et sournoise, dont l'effet est d'autant plus grand que l'allure du style est plus cavalière, que l'air en sent mieux son gentilhomme.
Une fois que Talleyrand est entré dans la politique, je préfère ne plus le suivre. Je ne suis pas trop compétent en histoire, et ne saurais pas démêler les endroits où il donne un croc-en-jambe sournois à la vérité.
Et puis, entre nous, aussitôt que Talleyrand ne conte pas des anecdotes ou ne trace pas un portrait, son style, j'ai regret à le dire, son style devient quelconque. C'est un bon français de diplomate: à force de rédiger des protocoles, ce grand seigneur, ce fils de Voltaire, dit un de nos confrères, perdit toute personnalité. Il affecta toujours de n'être point un lettré. Ses mémoires sont une indéniable preuve qu'il ne l'était point.
Lui ramèneront-ils la postérité? lui tiendra-t-elle rigueur de cette dernière mystification?
--Tout cela, dirait M. Renan, dévient bien indifférent, si, on le regarde du haut de l'étoile de Sirius.
Francisque Sarcey.
L'INTERDICTION DES PARIS AUX COURSES
L'HIPPODROME D'AUTEUIL, LE 8 MARS

Sportsmen improvisés.
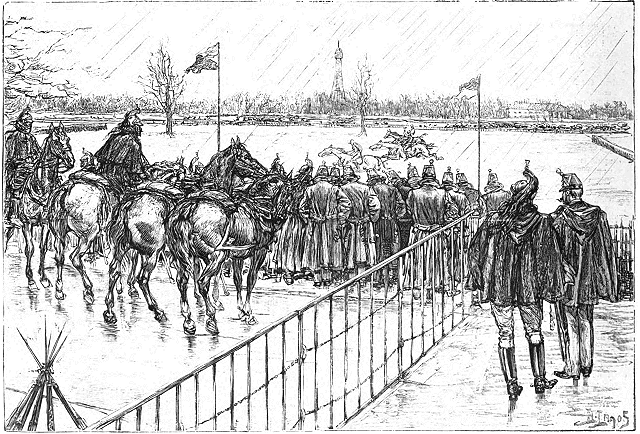
Le champ de courses occupé par la garde municipale.
DES PARIS AUX COURSES
L'HIPPODROME D'AUTEUIL, LE 8 MARS

Le mauvais exemple.
Les voitures cellulaires.
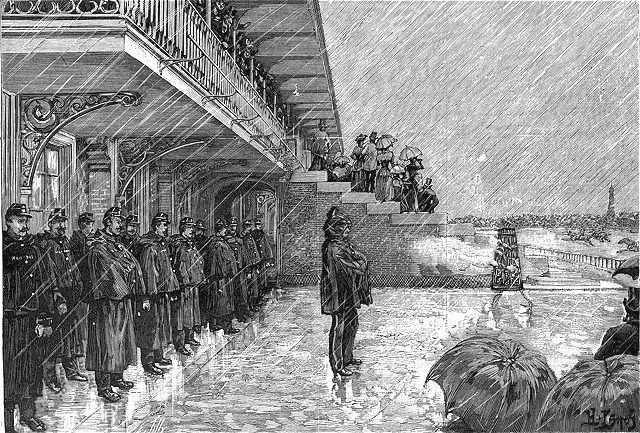
Sous les tribunes.
CŒURS DÉLICATS
--Bien vrai, tu ne m'en veux pas, mon fils?
--Père!
Le regard brillant d'affection du jeune marin, l'étreinte prolongée de sa main nerveuse, devraient pleinement rassurer un homme qui n'a plus le droit de s'inquiéter de la façon dont son fils unique a pris la nouvelle de son second mariage, puisqu'il y a répondu en prenant le train pour assister à la cérémonie. Cependant M. de Neyres reprend encore:
--Tu ne devais guère t'attendre cela? A mon âge!
Un bel éclat de rire du fils. Il met au clair des dents d'autant plus blanches que sa face est plus dorée, hâlée par le soleil et les embruns.
--Vous voulez des compliments, je pense?
--Henri!
--Je ne vous les marchanderai pas. Sous prétexte que l'état-civil vous donne quelque quarante ans...
--Si tu en mettais cinq de plus.
--Quatre! Vous n'aviez pas vingt-deux ans quand je vous suis né... Je n'en ai pas encore vingt-trois... donc... Et puis, qu'importe un lustre de plus ou de moins quand on a votre physionomie! Pas un cheveu gris, point de rides, et mince!... Vous ne consultez donc jamais votre miroir?
--Hélas!
--Vous le consultez mal. Maintenant pas plus qu'autrefois, on ne saurait vous prendre pour mon père... Un grand frère tout au plus... et pas vénérable... en la forme, s'entend! Combien de fois nous a-t-on tenus pour tels, lorsque nous courions les champs et les bois, si camarades... étant tout l'un pour l'autre puisque ma mère...
--Tu ne penses pas que sa mémoire ait cessé de m'être chère!
--Père! voyons! Après vingt ans de veuvage, lorsque le fils ingrat que vous aviez rêvé garder près de vous, vous a quitté, emporté par la passion de la mer et des armes, demeuré seul, tout seul, n'avez-vous pas bien le droit de songer à vous, de vous faire la famille que je n'ai pas envie de vous donner de sitôt? Qui oserait vous blâmer? Qui le peut?
--Toi seul... Tu aurais un seul sentiment de regret, d'ennui de ma résolution Toi d'abord, tu le sais.
--Vous d'abord, vous le savez aussi. Et puis ce serait joli, maintenant que vous êtes à la veille de vous marier, de planter là celle qui vous aime!...
--Qui m'aime!
--Oh! oui, l'éternelle crainte des cœurs raffinés de ne pas faire le bonheur d'autrui. Mais vous avez fait celui de ma mère, le mien... et vous ferez, parbleu! celui de la jeune fille, que je ne connais pas, mais que j'aime déjà tout plein, puisque son cœur a été assez haut pour comprendre le vôtre.
--Tu dis cela pour me faire plaisir!
--Le diable m'emporte, non! Votre mariage! mais depuis que je navigue je le demandais au ciel et à la terre, pour m'absoudre d'avoir fait faux bond à votre affection. Je le demandais pour moi plus que pour vous; pour être heureux de vous voir heureux comme vous le méritez et pour avoir des frères et des sœurs... Car je compte bien que vous m'en donnerez... et sans compter. Si vous saviez ce que je me sens déjà oncle pour eux, car, moi, je serais trop vieux pour être leur frère; oui, oui, vous verrez, je me rattraperai. Allons! ne persistez pas à attrister un moment qui devait être joyeux... rien que joyeux.
Un serrement de main et le silence, le bon silence de gens attendris, délivrés surtout des paroles obligées, toujours insuffisantes à traduire les délicatesses infinies du sentiment et ses mille nuances; tandis que le coupé les emporte vers l'appartement de l'avenue de Messine, où le comte Georges de Neyres va présenter son fils à sa fiancée, la jolie Colette de Hesnaut, qui a vingt ans tout juste.
*
* *
Certes, lorsque les deux hommes parurent dans le salon fleuri et lumineux où les attendaient quelques amis et parents de Mme de Hesnaut, une créole vieillie plutôt que vieille et de languissant aspect, si la face dorée d'Henri de Neyres, ses yeux bruns, sa franchise d'allures, firent bonne impression, chacun se dit que son père ne perdait rien de ses avantages à se trouver à côté de lui. Il ne paraissait même que plus jeune dans sa joie de mêler son fils à son bonheur.
Mme de Hesnaut se souleva à peine pour tendre la main au jeune homme qu'elle présenta d'une voix exténuée à ceux qui l'entouraient. Ce n'est qu'après ces cérémonies qu'elle appela «Colette».
Un tourbillon de mousseline de soie fit brusquement irruption, venant du salon voisin. De ce tourbillon sortit un buste charmant, une tête très éveillée aux yeux couleur de noisette mûre, un teint ayant le duvet d'un fruit rose; et coiffée d'un tas de cheveux châtain-doré qui avait l'air de mousser. A la vue du comte qui s'était avancé vers elle pour lui amener Henri, elle poussa un joli cri de plaisir, lui tendant non pas une, mais les deux mains:
--J'admirais encore vos perles... vous me gâtez trop et...
Elle n'acheva pas, apercevant seulement Henri, et, de gaieté, d'embarras peut-être:
--Votre fils... le bébé...
--Oui, m'man, reprit sur le même ton le jeune homme.
Tous deux riant encore se serrèrent la main à «la camarade», pour se trouver tout à coup embarrassés dans le silence qui s'établit, ce silence qui règne toujours lorsque une même pensée s'impose à tout un cercle.
Car tous ceux qui regardaient les jeunes gens, y compris l'indifférente créole, ne pouvaient échapper à cette pensée que, si les jeunes gens s'étaient rencontrés plus tôt, ils auraient pu se choisir et se plaire.
Ni Henri ni Colette ne l'eurent. Lui, la trouva jolie, amusante, et fut heureux pour son père. Quant à elle, elle s'en voulait de s'être figuré le jeune homme plus jeune, bien plus jeune, presque enfant... C'est qu'il avait l'air aussi homme, plus homme presque que son jeune père! Cela ne l'ennuyait pas; cela ne la gênait en rien: ce n'était que de l'étonnement.
Mais ces diverses impressions ne durèrent pas. On se mit à table et la gaieté franche du jeune enseigne de vaisseau gagna bientôt les plus graves: si bien que, lorsqu'on se sépara, personne n'avait plus le souvenir de cet éclair de compréhension qui leur avait fait voir à tous les choses telles qu'elles auraient pu, sinon telles qu'elles auraient dû être.
*
* *
Les premiers jours passés, Henri voulut laisser son père et sa fiancée à ce qu'on appelle «la cour», moments réputés charmants et qui ne le sont peut-être pas autant qu'on le dit. N'est-ce pas un temps d'agitation, d'achats, souvent laborieux, de robes à essayer, d'ameublements à combiner? puis, lorsque les fiancés se trouvent seuls, n'éprouvent-ils pas ce sentiment de gêne qui résulte du rôle en quelque sorte appris qu'ils ont conscience de jouer l'un vis-à-vis de l'autre? Mais le comte ne voulait pas que son fils les abandonnât. Son bonheur se doublait de le voir là en tiers avec eux. Henri ne résista pas extrêmement puisqu'il s'était mis à son aise avec sa future belle-mère. Il s'amusait fort de jouer avec elle l'enfant terrible pour se faire gronder et pour la voir rire soudain. Comme son père avait bien choisi! Une seule chose l'étonnait, le jeune homme, c'était de se trouver parfois un peu embarrassé pour dire à celui-ci tout le bien qu'il pensait de la jeune fille. Mais ce n'était rien, sans doute.
Colette, de son côté, était heureuse, bien plus heureuse qu'avant la venue du «gamin». Quelle bonne vie elle allait mener avec ces deux hommes! Plus libre avec celui qui ne devait pas être son mari, plus réservée avec le comte, gaîment tendre avec tous deux, les jours, les semaines coulaient avec rapidité. Parfois, cependant, lorsqu'ils la laissaient seule, elle se surprenait à rêvasser sans raison. Mais cela arrive à tout le monde, n'est-ce pas? en ces moments-là.
Le mariage allait être célébré dans une dizaine de jours lorsque Henri, après un déjeuner avec un ami d'enfance qui l'avait en vain supplié de venir chasser avec lui en Bretagne, flânant sur le boulevard pour ne pas arriver trop tôt chez Colette où l'on dînait, fut attiré par un étalage de joaillerie. C'était le cas, puisqu'il en avait le loisir, de choisir avec soin le cadeau de noces qu'il devait à la fiancée de son père. Entré chez le marchand, il goûta le plaisir de se décider pour quelque chose de très cher, et, l'emplette terminée, il se hâta de l'apporter, pour jouir de la surprise de la jolie fille, de l'éclat de ses yeux couleur de noisette mûre et de son joli visage duveté comme un fruit rose sous la mousse de ses cheveux châtain doré.
Colette était seule dans le salon à peine éclairé, lorsque son beau-fils entra l'écrin à la main. Elle lisait ou rêvait accoudée à une table légère. Au bruit qu'il fit elle tressaillit, étouffa un cri de surprise, de peur peut-être, et dit tout justement le mot qu'elle ne voulait pas dire:
--Votre père?
--Je le croyais ici, reprit Henri, étonné de mentir sans raison.
--Je croyais que vous ne vous quittiez pas?
--Aujourd'hui j'avais à faire quelque chose que je devais faire seul.
Les mots ne sont ni graves ni dangereux par eux-mêmes. Ce qui est grave et dangereux, c'est la signification que leur prête l'état d'esprit conscient ou inconscient où l'on se trouve. Colette eut peur, sans comprendre pourquoi; cette peur gagna Henri, qui, pour sortir de cet inexplicable embarras, posa l'écrin devant elle, en balbutiant:
--J'ai pensé, n'est-ce pas? que j'avais bien le droit... de vous offrir...
A l'aspect des pierres qui brillaient du plus vif éclat, Colette ne put retenir un cri de joie... puis elle se prit à pleurer. Et lui:
--Qu'avez-vous? Je ne vous ai pas blessée...
Non, il ne l'avait pas blessée. Elle le lui dit, et pourtant quelque chose devait être blessé en elle, puisqu'elle ne pouvait s'empêcher de pleurer encore. Affolé par ce chagrin, Henri s'approcha et lui prit la main... Elle le repoussa presque violemment. Le regard de surprise qu'ils échangèrent après ce double mouvement fit entrer dans leur esprit ce que leur cœur savait déjà, la certitude inattendue que leur amitié était déjà plus que de l'amitié.
Le comte entra sur ces entrefaites et ne parut voir qu'une chose, c'est qu'elle avait pleuré de joie de l'attention de son fils.
Mais lorsque, le lendemain, Henri déclara à son père qu'il allait chasser en Bretagne, lorsqu'il se lâcha presque des prières que son père lui fit pour le retenir, celui-ci tressaillit et, soudain, n'insista plus. Tous deux se séparèrent avec une froideur qu'ils ne s'étaient jamais marquée.
Au retour de la chasse où il passa huit jours, fatiguant son corps sans arriver à vaincre le trouble de son esprit, Henri trouva son père souriant, heureux. M. de Neyres lui fit le plus grand plaisir qu'il pût lui faire en lui disant qu'ils passeraient cette soirée, une des dernières avant le mariage, entre eux seuls. De Colette, pas un mot.
Le dîner, où Henri parla extrêmement et inventa même quelques exploits qu'il n'avait pas accomplis, fut assez gai. Mais lorsqu'il prit fin et que le père et le fils se trouvèrent seuls au coin du feu dans le cabinet de travail du comte, le silence s'établit entre eux. Le jeune homme se dit que son père souffrait de ne pas être près de sa fiancée; et il fût cruellement jaloux.
A dix heures il n'y tint plus et, prétextant la fatigue des jours précédents, il se leva, serra la main à son père, qui très doucement lui dit:
--Bonsoir, mon cher enfant, et...
--Que voulez-vous dire, père?
--Rien... J'allais te répéter ce que je te disais en t'embrassant quand tu étais enfant. Ne fais que de bons rêves!
Le jeune homme se troubla et, rentré dans son appartement, se sentit tout à coup au comble de l'inquiétude. Si son père l'avait deviné! Il le devinait autrefois.
Pourquoi aussi était-il venu se jeter à travers ce mariage? Ne devait-il pas penser que la fiancée de son père, un père à qui il se sentait moralement si semblable, pouvait lui plaire! Voilà! il n'avait pas encore aimé et, comme tous ceux qui n'ont jamais attrapé cette fièvre chaude, il ne la craignait pas; il niait même son existence. Il n'aurait dû la voir que mariée; il n'eût pu être jaloux...
Qu'en savait-il?
Malgré sa fatigue réelle, Henri ne dormit guère et ses rêves ne furent pas bons. Plein de remords d'avoir presque haï aussi bien dans la veille que le sommeil un père qui avait été si exquis pour lui, il voulut, dès le lever, aller l'embrasser.
Il frappa à la porte de l'appartement, traversa le cabinet, la chambre à coucher, et vit que le lit n'avait pas été défait. Une angoisse terrible lui serra le cœur. Ses yeux errants tombèrent sur une table où se trouvait bien en évidence une lettre qu'il saisit. Elle était à son adresse. Il l'ouvrit. Une autre s'en échappa à l'adresse de Mme de Hesnaut. Il lisait déjà la sienne.
«Pardonne-moi, mon cher enfant, de te demander, d'exiger de toi une démarche, qui va me faire déchoir dans ton estime, puisqu'elle consiste à remettre toi-même entre les mains de Mme de Hesnaut les quelques mots par lesquels je la supplie de me rendre la parole que j'ai donnée à sa fille.
«Pourquoi cela? diras-tu. Pour rien. Déjà bien avant ta venue, alors que j'étais le plus heureux, alors que je me croyais le plus déterminé à ce mariage, des inquiétudes subites, des repentirs, venaient empoisonner ma joie. Souviens-toi de ce qui s'est passé lorsque j'ai été te chercher à la gare, combien j'ai insisté devant toi sur l'âge de Colette et le mien. J'aurais cru que tu comprendrais mes hésitations. J'aurais cru aussi que tu comprendrais encore pourquoi j'avais besoin que tu fusses en tiers avec nous. La dissonance de ce jeune cœur si gai et de mon vieux cœur plein de tristesse, que j'entendais dès que nous nous taisions, je ne l'entendais plus autant. Il est vrai que je n'ai bien compris tout cela moi-même qu'en me retrouvant seul avec elle pendant ton absence si courte et si longue. Si je fuis, si je m'évade, ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle; c'est de moi que j'ai peur, du changement de ma vie, du lien, du souvenir de ta mère, revivifié par ta présence, tes yeux qui étaient les siens! Va l'âge est l'âge, mon ami. Il n'y a que les gens de vingt ans comme toi qui peuvent résolument offrir tout leur cœur... Les cœurs vieillis n'ont plus que des moitiés, des quarts de tendresse à donner, et corrompue par la rancœur des vieilles souffrances. Ah! si j'étais toi, ou si tu étais moi!
«Mais tu n'es pas moi. Vous êtes trop pareils tous deux pour que je puisse espérer voir votre camaraderie se changer en une tendresse qui... Je ne veux, je ne puis te demander de pousser le dévouement jusqu'à offrir, en échange du vieux mari qui fait défaut, un jeune mari à cette charmante enfant. Mais en tout cas je puis te demander de me servir d'avocat. Non que je sois digne d'être défendu. Accuse-moi plutôt, accuse l'hypocondrie trop puissante chez qui a souffert longtemps! Arrange les choses suivant l'inspiration de ton cœur. Mais ne cherche pas à découvrir le lieu où se cache ma honte et mon hypocondrie. Car je ne veux reparaître que lorsque je la saurai heureuse et que tous pourrez tous deux me pardonner.»
Henri n'a pas voulu voir Colette; il s'est borné à remplir la mission qui lui a été confiée auprès de Mme de Hesnaut, qui ne lui a pas paru prendre au tragique la rupture. Quant à lui, il ne peut ni ne veut profiter du sacrifice que lui fait son père. Ah! s'il pouvait le voir, ce père, lui persuader qu'il n'aime pas, qu'il n'aime plus Colette!... Mais le comte a tenu parole, et son fils ne peut découvrir sa retraite. Il souffre si cruellement de cette absence, de son crime envers celui qui a été si bon pour lui et toujours et si entièrement, qu'il imagine un moment qu'il va oublier la jeune fille.
Mais il ne l'oublie pas puisqu'il ne peut se résoudre à quitter Paris, puisqu'il se surprend à rôder aux alentours de l'avenue de Messine, et bientôt près de la maison. Il s'en arrache plus difficilement chaque jour, honteux de l'espérance qui l'agite encore.
Enfin, son congé va expirer, et la mer le guérira. Elle bercera, alanguira au moins son cœur repentant et déchiré...
La veille de son départ, au moment où il désespère tout à fait de revoir Colette et son père, il reçoit un mot de ce dernier. Il l'attend chez un ami commun.
L'appartement où il est entré est obscur pour un homme qui vient du dehors et du grand jour, et, quand il s'éclaire, le jeune homme voudrait fuir, car Colette est devant lui, tremblante mais résolue: elle lui tend une main sur laquelle il se jette, pour s'éloigner en disant:
--Mon père, je ne veux pas, je ne veux pas le faire souffrir.
--Et s'il ne souffre plus? fait une voix grave et sans défaillance.
Le fils est dans les bras du père qui le regarde avec un air de tendresse si profond que le pauvre amoureux ne peut lire aucune arrière-pensée.
--C'est vous qui le voulez... père, c'est vous...
--C'est moi qui le veux, mes enfants.
Colette et Henri se sont écartés, oublieux déjà de celui qui vient de les donner l'un à l'autre. Alors, seulement, le comte porte la main à sa poitrine où vibre encore quelque douleur. Mais il n'a pas cessé de sourire, du sourire mélancolique du sacrifice, le sacrifice, la seule joie humaine qui, au rebours des autres, mette l'amertume au bord de la coupe et le miel au fond.
Ch. Legrand.
QUESTIONNAIRE
N° 16.--Lettres d'Amour.
Quels sont les Grandes Amoureuses et les Amants célèbres
qui ont écrit
les plus belles Lettres d'amour?
(14 juin 1890.)
RÉPONSES
Mlle Aïssé, Haydée.--Quelle jolie figure que celle d'Haydée, dont on a fait Aïssé, je ne sais trop pourquoi, en ôtant à son nom sa couleur et son harmonie. Son âme est aussi gracieuse que son visage, son cœur aussi doux que ses yeux, son esprit aussi fin que le sourire de sa bouche. Son histoire est un véritable conte des Mille-et-une Nuits. La Belle Circassienne est une fleur du soleil oriental, transplantée dans la serre-chaude de Paris, qui s'ouvre, se décolore et se fane sous le ciel brumeux d'Occident, une sultane indolente au milieu de l'active fourmilière du royaume de la poudre, du rouge et des mouches. Sa légende mystérieuse exhale encore le parfum d'une Rose de cent ans.--Soliman B.
Assurément, ce n'est pas l'amour qui domine dans les trente-six lettres de sa Correspondance avec Mme Calandrini, figure revêche de Genevoise mômière et puritaine.
Le monde est triste et laid, les hommes méchants, les femmes ne valent pas mieux. Elle rencontre le chevalier d'Aydie, et, sentant qu'elle est vaincue d'avance par l'amour, elle désarme et s'abandonne, sans combat et sans comédie, sans calcul et sans arrière-pensée. Elle offre la clef d'or de son cœur à celui qui en a surpris le secret sans essayer de le forcer; elle a refusé des fortunes princières; de lui elle accepte tout, et elle le convertit si bien au culte de la fidélité, qu'il sert de modèle au Couci d'Adélaïde Du Guesclin, tragédie de Voltaire, qui annota les Lettres d'Aïssé:» Cette Circassienne est plus naïve qu'une Champenoise, dit-il. Elles ont pourtant une qualité plus rare et plus précieuse que celles du Patriarche de Ferney, le sentiment, le naturel et la simplicité, le charme doux d'une âme tendre, l'émotion sincère et délicieuse d'un cœur bien épris. Et un mot du cœur d'Aïssé vaut mieux que tous les traits d'esprit de Voltaire, même en littérature.--Véra.
Le chevalier d'Aydie, un Gaulois élevé à Athènes, avait fait des vœux à Malte; dans la suite, il a voulu plusieurs fois en être relevé pour pouvoir épouser Mlle Aïssé, ce qu'elle n'a jamais voulu permettre: «Je suis trop son amie pour le souffrir». Son amour noble et illégitime, chaste et passionné, est un mélange d'innocence et de volupté, d'abandon et de repentir; c'est l'amour d'une vierge enivrée, d'une victime martyrisée. Elle est faible, on l'est à moins; la femme la plus sage est souvent celle qui n'a point trouvé son vainqueur.--Carmen.
J.-J. Rousseau et Mme d'Houdetot.--Aucune femme n'a donné son amour à J.-J. Rousseau, pas une n'eut le sien; il a vécu sans être aimé et sans avoir aimé. Il n'aima jamais que ses Chimères idéales, incarnées dans des réalités souvent séduisantes, parfois douloureuses, toujours désenchantées. Sans cesse altéré de femmes, assoiffé d'amours nouvelles, il se consolait facilement de leurs illusions décevantes, pour recommencer cette chasse aux papillons dont les ailes brillantes ne lui laissaient aux doigts que la fine poussière de leurs ailes décolorées. Il a écrit des Lettres d'amour à Mme d'Houdetot, brûlées par Saint-Lambert; mais on peut en retrouver le reflet dans les Lettres de La Nouvelle Héloïse. Mme d'Houdetot considérait sans doute l'Amour comme un ouvrage en deux volumes, la Poésie avec Jean-Jacques et la Prose avec Saint-Lambert.--Harold.
«Mme d'Houdetot me redemanda ses lettres; je les lui rendis toutes, avec une fidélité dont elle me fit l'injure de douter un moment. Elle ne pouvait les retirer sans me rendre les miennes. Elle me dit qu'elle les avait brûlées; j'en osai douter à mon tour, et j'avoue que j'en doute encore. Non, l'on ne met point au feu de pareilles lettres. On a trouvé brûlantes celles de la Julie; eh, Dieu! qu'aurait-on donc dit de celles-là? Non, non, jamais celle qui peut inspirer une pareille passion n'aura le courage d'en brûler les preuves. Si ces lettres sont encore en être, on connaîtra comment j'ai aimé.»--(Confessions).
Le récit de M. de Musset, d'après le témoignage de Mme la Vicomtesse d'Allard, a été confirmé par quelqu'un digne de foi qui, lié avec Mme d'Houdetot et Saint-Lambert, les a questionnés sur le sort des Lettres de J.-J. Rousseau, et en a reçu les mêmes réponses, avec cette seule différence qu'au lieu d'une lettre, Mme d'Houdetot en aurait conservé quatre, toutes remises à Saint-Lambert, et toutes quatre brûlées par lui, du moins au dire de ce dernier.
Comme on flamberait avec plaisir le Poème des Saisons du fade Saint-Lambert, ce plat imitateur des bergeries du dix-huitième siècle, et même les jolis vers de sa trop fidèle amie, si cet auto-da-fé devait rendre une page, une phrase des Lettres d'amour de J.-J. Rousseau!--Un Lecteur de l'Illustration.
On admire un peu trop à la légère, ce me semble, l'indulgence de Mme d'Houdetot pour la passion sans espoir quelle inspira au Philosophe de Genève. La Révolution respecta son idole, la Postérité a inscrit son nom sur le Livre d'or: elle lui doit la vie et l'immortalité. Que lui doit-il?--Un Ours.
Diderot et Mlle Volland.--La Correspondance de Diderot avec Mlle Volland est le plus original, le plus substantiel, le plus curieux et le plus amusant de ses ouvrages; c'est un livre unique dans toutes les littératures anciennes et modernes. Il y a dans ces Lettres l'étoffe de cent volumes, la moelle de l'Encyclopédie. C'est aussi le roman mouvant et vivant des hommes et des choses de son époque; tout le dix-huitième siècle tient dans ce microcosme au milieu duquel il a vécu.--Curiosus.
Il n'existe pas de Lettres de Diderot à Mlle de Puisieux.--L. L.
Il serait intéressant de connaître les Lettres de Mlle Volland; mais, d'après ce qu'on en peut savoir par celles de Diderot, elles devaient être bien raisonnables et bien insignifiantes. C'était une amie sage, froide et sans passion. Comme elle devait assommer le bon Diderot avec ses commérages de caillettes, et les impressions de ses lectures sur les ouvrages sérieux qui avaient ses préférences, l'Émile, de Rousseau, l'Esprit, d'Helvétius, les opuscules de Voltaire, etc. A peine si elle répond par des billets, et fort inexactement, aux volumineux grimoires de son professeur, qui a du génie et qui le dépense à lui plaire. Si Mlle de Lespinasse avait donné la réplique à Diderot, ils auraient mis le feu au papier. --Véra.
Que de Grandes Amoureuses dont les Lettres ne seront même pas mentionnées! Que d'Amants célèbres dont le nom seul éveille tant d'échos: Mirabeau, Chateaubriand, Benjamin Constant, Balzac, Stendhal, Alfred de Musset, etc. Mais si le cadre du Questionnaire n'a pas permis d'y exposer leurs portraits, ils figureront dans une Galerie plus complète sous la forme du livre.
Charles Joliet.
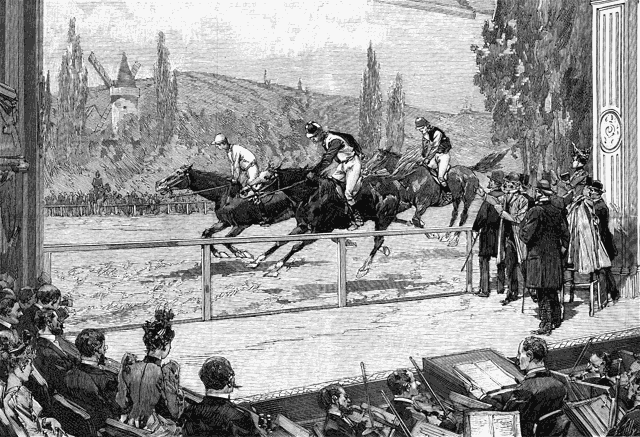
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS.--La course de chevaux
dans la revue
«Paris port de mer».
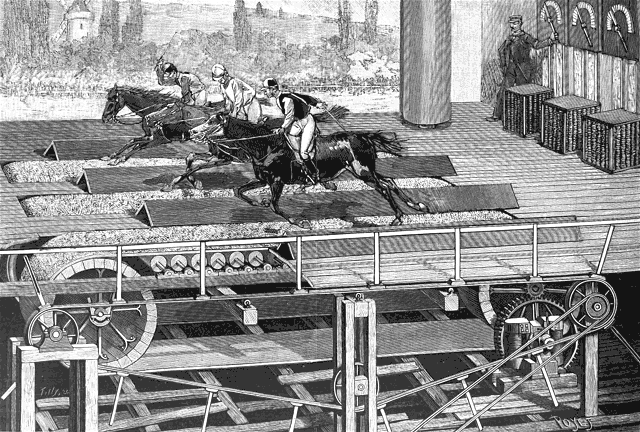
La course de chevaux dans la revue des Variétés.--Coupe
de la scène représentant le mécanisme intérieur qui met les pistes en
mouvement.

Pièce d'orfévrerie Pour l'ornementation
d'un album offert
à M. Carnot.
LA DERNIÈRE ŒUVRE DE MEISSONIER
Dans une des gravures que nous avons publiées sur Meissonier, au moment de sa mort, nous avons montré le grand artiste modelant lui-même la maquette d'une figure qui lui servira plus tard pour un de ses tableaux. Beaucoup des admirateurs du maître ignoraient cette particularité de son talent. L'œuvre que nous reproduisons ci-dessus est la dernière signée Meissonier; elle a été modelée par lui, elle vient d'être délicatement ciselée par MM. Bapst et Falize, et cette plaque d'or fin, qui représente un faisceau de palmes et de branches d'olivier, est aujourd'hui la propriété de M. le président de la République. Elle forme, en effet, la partie principale de la couverture d'un album qui lui a été offert ces jours-ci par les présidents de section de l'Exposition universelle de 1889. Cet album contient une adresse accompagnée d'un grand nombre de signatures, et sera pour M. Carnot un souvenir précieux de la grande manifestation artistique et industrielle à laquelle il a présidé.
LA PORTE DE FRANCE A BELFORT

La porte de France à Belfort.--Phot. Pernelle.
On se rappelle l'émotion produite il y a quelques mois, par la nouvelle de la démolition de la Porte de France à Belfort. Cette œuvre de destruction, que l'on croyait abandonnée, n'était qu'ajournée, paraît-il, et il est plus que probable que la porte de France est condamnée définitivement à disparaître.
L'émoi de la population de Belfort se comprend. Cette porte, construite par Vauban, et sur laquelle se voient le soleil de Louis XIV et les armes de France, rappelle en effet aux habitants, en dehors de sa valeur historique, des souvenirs patriotiques de la dernière guerre. Le peuple tient souvent plus à ses douleurs qu'à ses joies, ce sont là des sentiments que l'on ne discute pas.
Partout, d'ailleurs, où d'anciennes fortifications ont dû subir des modifications pour répondre aux exigences de la défense, on a tenu à laisser subsister un fragment de l'ancien ensemble. Il serait facile d'agir de même dans le cas actuel, et, bien qu'il soit nécessaire d'ouvrir à la circulation une voie plus large que celle qui existe pour entrer en ville, on peut le faire en respectant la porte, et en faisant de chaque côté une brèche plus que suffisante pour assurer pleinement la liberté du charroi et de la circulation.
CONGÉLATION DU LAC D'ANNECY
Le dernier souvenir du terrible hiver que nous venons de traverser nous aura été' légué sans doute par le beau lac d'Annecy qui, il y a peu de jours encore, était complètement gelé et présentait un spectacle des plus curieux.
Que l'on imagine, en effet, une étendue de 16 kilomètres de longueur sur 1 de largeur complètement recouverte d une épaisseur de glace de 20 centimètres, persistante malgré une température de 8 à 10° centigrades au-dessus de 0 dans la journée, et là où naguère des voiles flottaient au vent, des rames battaient l'eau, des promeneurs tout étonnés de traverser un lac à pied sec, ou des patineurs se livrant à leurs évolutions. Depuis longtemps le fait ne s'était produit. En 1880 le lac avait été gelé aussi, mais sur une partie seulement de sa superficie, et la durée de la congélation avait été moindre.
H.

Le lac d'Annecy, pendant l'hiver de 1891.--Photographie
Pittier.
TRAVAUX EN PAPIER DÉCOUPÉ
Les cartes de visite nous ont servi, il y a quelque temps, à confectionner des pantins articulés et mobiles (1); aujourd'hui que nous sommes en carême, je vais indiquer comment nous pourrons découper, dans des cartes de visite ou du papier fort, les sœurs de charité dont nous donnons les dessins ci-dessous, sans oublier leurs petites élèves.
Note 1: Voir l'article: les Pantins animés dans
le n° 2,190 de l'Illustration du 15 novembre 1890.
Il suffira, pour cela, de suivre exactement les instructions suivantes, qui sont des plus simples, comme vous allez vous en assurer.
Matériel nécessaire: quelques cartes de visite, du papier blanc un peu fort, un crayon noir, un crayon à bouts rouge et bleu, une paire de ciseaux. Etes-vous prêts? Nous commençons:
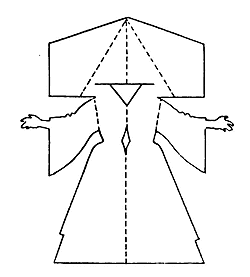
Fig. 1.
Pliez en deux une carte de visite, dans le sens de sa longueur; calquez, sur du papier transparent, la moitié du gabarit représenté fig. 1, et reportez-la sur une des moitiés de la carte pliée; le pli de la carte devra se confondre avec la ligne pointillée formant l'axe de la fig. 1. Une fois que le contour de cette demi-figure aura été tracé, découpez votre carte suivant ce contour; en la dépliant ensuite, vous aurez une figure semblable à la fig. 1. Il ne reste plus grand'chose à faire pour transformer la carte, ainsi découpée, en sœur de charité.

Fig. 2.
Repliez de nouveau la carte suivant sa ligne médiane; ramenez en avant les deux bras, en les pliant suivant les lignes pointillées du modèle, puis faites la cornette au moyen de deux grands plis obliques, vous pourrez en varier légèrement la forme, mais elle doit venir en avant, de façon à cacher le visage, qui est absent. Coloriez en bleu foncé, à l'aide du crayon de couleur, la jupe et les manches, en réservant en blanc le grand tablier; dessinez un rosaire, un trousseau de clefs, etc.; vous pourrez aussi placer dans une main une allumette-bougie, figurant un cierge, ou encore un petit morceau de carton plié, représentant un livre de messe; pour ces accessoires, chacun pourra les varier suivant son goût.
La sœur, ainsi confectionnée, aura l'aspect représenté fig. 2. C'est bien, n'est-ce pas, la sœur de Saint-Vincent de Paul, dont le costume est populaire dans toutes les parties du monde.
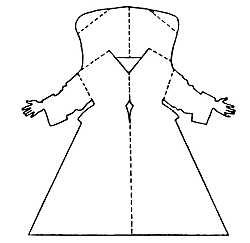
Fig. 3.

Fig. 4.
Avec le gabarit de la fig. 3, vous pourrez fabriquer une sœur un peu différente; la forme de la cornette n'est plus la même, mais elle ne présente aucune difficulté. Cette variante est représentée fig. 4.
Le léger écartement des deux moitiés de la carte permet à nos deux sœurs de se tenir debout quand nous les posons sur la table.
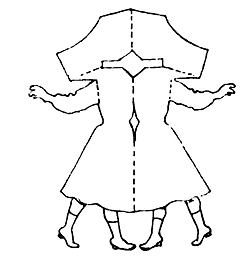
Fig. 5.

Fig. 6.
Si nous passons à une de leurs élèves, nous constatons avec étonnement que son gabarit (fig. 5) indique l'existence de quatre jambes! Rassurez-vous; lorsque nous aurons découpé, puis replié la carte sur laquelle le demi-contour du gabarit de la fig. 5 aura été tracé, nous aurons soin de couper deux de ces jambes, en en laissant une de chaque côté; si nous laissons la jambe droite en avant, nous laisserons la jambe gauche en arrière, ou vice-versa, de façon que, en regardant la fillette de profil, nous verrons ses deux pieds l'un derrière l'autre (fig. 6).
Comme elle ne peut se tenir debout, nous pourrons la fixer dans la fente d'un bouchon de moutarde.
Le crayon de couleur nous permettra de lui faire des bas et une capeline rouges, une robe à raies ou à pois roses ou bleus, etc.
L'ensemble figuré au bas de cet article se compose de quatre sœurs, dansant en rond avec quatre fillettes qu'elles tiennent par la main. Les huit personnes sont découpées d'un seul morceau dans une feuille de papier.
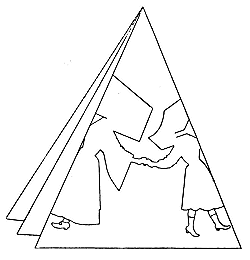
Fig. 7.
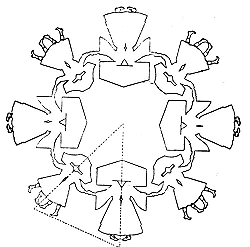
Fig. 8.
Pour cela, repliez votre feuille de papier en deux, puis, par un pli perpendiculaire au précédent, pliez-la en quatre; enfin, un pli intermédiaire aboutissant à la rencontre des deux précédents vous donnera la feuille pliée en huit. Sur la, face supérieure du papier ainsi replié, tracez le gabarit de la demi-sœur et de la demi-fillette, indiqué fig. 7, découpez en une seule fois les huit épaisseurs du papier suivant ce contour, et, en dépliant la feuille ainsi découpée, vous obtenez la fig. 8, dans laquelle vous reconnaîtrez quatre sœurs et quatre enfants semblables à celles dont nous avons étudié plus haut la fabrication. Coloriez chacun des personnages, en évitant de rien déchirer, surtout à la jonction des mains, qui est fragile; repliez chaque sœur et chaque enfant comme si elles étaient isolées, faites l'amputation des jambes supplémentaires, et voilà votre ronde organisée et vos petites personnes qui se tiennent debout sans difficulté. Posez-les sur un morceau de carton garni d'un papier vert et figurant une pelouse; vous piquerez, dans ce carton, des brins de bois ou des allumettes couvertes de mousse à leur partie supérieure; ce seront les arbres du décor champêtre.
Tom Tit.
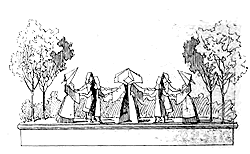

La semaine parlementaire.--Une des discussions les plus intéressantes qui aient eu lieu à la Chambre est celle qui s'est élevée sur la proposition de M. Méline tendant à exempter du principal de l'impôt foncier les terres ensemencées en blé de printemps. On sait que la plupart des récoltes sont perdues ou fortement compromises par suite du froid inusité qui a régné cet hiver et qui a gelé la terre à une grande profondeur. Malgré l'intérêt que méritent nos agriculteurs, un certain nombre de députés ne voyaient pas sans appréhension le dépôt d'une proposition qui tend à faire de l'État le tuteur de ceux qui subissent un dommage et à favoriser une catégorie de citoyens au moyen du fonds commun, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables. «Ce système, a dit M. Raiberti, est un trompe-l'œil économique; il constitue un virement de contribution et un privilège injuste.» De son côté, M. Pelletan a pris la parole pour développer cette thèse que, s'il fallait venir en aide à l'agriculture, ce n'était pas au moyen d'un dégrèvement qui pouvait ressembler à une faveur, mais par l'institution du crédit à bon marché.
Malgré cette opposition, la majorité a été d'avis qu'il fallait tenir compte des désastres causés par l'hiver exceptionnel que nous venons de traverser, et elle s'est rangée au système proposé par la commission, d'accord avec M. Méline.
--Le projet de loi sur les caisses de retraite, de secours et de prévoyance, fondées au profit des employés et ouvriers, a été voté en seconde lecture. Il va être soumis maintenant à la sanction du Sénat.
La question des courses.--On croyait dans le public, et la plupart des journaux avaient accrédité cette opinion, que l'interpellation de M. Paulmier devait avoir pour résultat d'amener le gouvernement à maintenir le statu quo en matière de paris aux courses, c'est-à-dire à pratiquer le système de la tolérance. Il n'en a rien été. En effet, M. Constans, dans un discours très net, a répondu à l'interpellation et aux orateurs qui l'ont appuyé qu'il lui était impossible, en premier lieu, d'autoriser le pari mutuel, déclaré illicite par les tribunaux, et en second lieu de percevoir un prélèvement qui constituait une dérogation aux règles de la comptabilité publique. Le ministre demandait donc un vote précis et décisif. La Chambre était placée dans une situation embarrassante, quand M. Develle est monté à la tribune pour annoncer le dépôt d'un projet de loi qui aura pour effet de réduire le nombre des hippodromes et aussi des journées de courses.
Plusieurs ordres du jour étaient déposés. Celui de M. Pichon, se bornant «à prendre acte des déclarations du gouvernement», a été accepté par le ministère et a été voté à une forte majorité. M. Develle en a précisé par avance la portée en disant «qu'il l'interprétait comme une invitation à déposer à bref délai le projet de loi en question et à interdire les paris jusque-là».
Le grand débat sur le fond même de la question est donc ajourné.
La manifestation du 1er mai.--Nous sommes encore loin du 1er mai, et peut-être serait-il un peu prématuré d'en parler, si la hâte que mettent les organisateurs à préparer cette seconde représentation n'était précisément un fait à signaler. Il y a là en effet la preuve que les meneurs de cette entreprise procèdent avec suite, avec méthode, qu'ils veulent tout mettre en œuvre pour réussir, et qu'ils n'entendent rien laisser au hasard. Par leurs soins, une propagande active est faite dans tous les ateliers, des réunions sont organisées dans tous les centres ouvriers, des souscriptions sont ouvertes pour couvrir les frais de publicité: en un mot, tout est prévu pour qu'à l'heure dite le monde des travailleurs réponde à l'appel qui leur est adressé dans toutes les parties du monde.
Comme l'année dernière, la fixation à huit heures de la journée de travail constitue le premier article du programme adopté par les manifestants; «mais, ont soin d'ajouter les membres du conseil national, si la journée légale de huit heures est l'objectif immédiat de la manifestation du 1er mai, ce n'est qu'un premier pas vers l'affranchissement complet, c'est-à-dire la restitution au peuple des travailleurs de tous les moyens de production par lui créés.»
Évidemment, de pareilles aspirations ne sont pas nouvelles, et on les retrouve, formulées en termes à peu près identiques, dans tous les écrits socialistes des temps passés. Mais il n'en est pas moins vrai qu'elles se produisent aujourd'hui sous un aspect qui est fait pour donner à réfléchir à tous les gouvernements. Les socialistes renoncent à l'action irréfléchie et brutale qui les livrait autrefois, en quelque sorte désarmés, aux mains de ceux qui avaient pour mandat de protéger la société. Aujourd'hui, ils s'organisent, réussissent à s'entendre, échelonnent leurs revendications. Ils commencent par la journée de huit heures, comptant, pour l'obtenir, sur l'effet moral d'une manifestation pacifique organisée à la même heure sur tous les points du globe. Ils verront ensuite s'ils peuvent s'entendre pour faire déclarer une grève générale, et, qui sait? plus tard peut-être, pour montrer que là où est le nombre, là est la force. Il y a là une marche méthodique, presque savante, qui contraste avec les emportements des révolutionnaires de la vieille école et qui prouve que, de plus en plus, les questions sociales tendront à prendre le pas sur les questions purement politiques.
Le Soudan français.--Un télégramme du commandant Archinard a annoncé que, le 25 février, le village de Dienna, dans le Barrinko, a été pris d'assaut. C'est là que s'étaient fortifiés un millier de Sofas, envoyés par Samory pour soulever le pays pendant que nous étions aux prises avec Ahmadou. La lutte a été vive, mais le succès a été complet, et permet d'espérer que Samory renoncera à nous susciter des difficultés, comme il l'a fait jusqu'à présent.
Le commandant Archinard comptait reprendre prochainement la route de Kayes.
Les colonies anglaises: Canada; Australie.--On attendait avec curiosité le résultat des élections qui viennent d'avoir lieu au Canada, en raison des progrès réalisés par le parti qui bat en brèche les principes de la domination anglaise. Ce résultat est favorable au gouvernement, mais la victoire a été chèrement acquise et le ministère que représente sir Macdonald a éprouvé des pertes sensibles.
La majorité conservatrice est, en effet, très faible. Dans une chambre qui compte 215 membres, on le fixe à 25 voix au maximum. C'est peu, d'autant plus que, dans les provinces et les villes les plus importantes, l'opposition a gagné du terrain. La représentation, il est vrai, est égale pour toutes les provinces, mais on ne peut nier que les députés des grands centres civilisés ont une influence morale qui les met au-dessus de ceux de leurs collègues nommés dans des régions habitées par des mineurs ou des trappeurs. Or, la province d'Ontario, qui compte 92 députés, donnait jusqu'ici 22 voix de majorité au gouvernement; cette fois, sa députation est partagée en deux parties égales, on croit même qu'elle penche du côté de l'opposition. A Québec, le changement est encore plus radical: cette province comptait 37 conservateurs contre 28 libéraux; elle vient d'envoyer à la Chambre 38 libéraux contre 27 conservateurs.
En outre, trois ministres ont subi des échecs personnels. Ce sont: M. Foster, ministre des finances; M. Carling, ministre de l'agriculture, et M. Colby, président du conseil privé.
Le gouvernement canadien, bien qu'il soit assuré du pouvoir pendant cinq années encore, va donc rencontrer de sérieuses difficultés.
Si le Canada, tend de plus en plus à échapper à la domination de l'Angleterre, la situation est tout aussi caractéristique en Australie, en sorte qu'on peut se demander si, dans un avenir plus ou moins prochain, ces grandes colonies, qui ont fait jusqu'ici, et très justement, l'orgueil de nos voisins, ne reprendront pas leur indépendance complète.
Dans une des dernières séances de la Convention fédérale de Sydney, M. Mac-Millan, trésorier et ministre des chemins de fer, a déposé au nom de sir Henry Parkes, premier ministre de la nouvelle Galle du sud, une sorte de projet de constitution de l'Australasie, ainsi qu'on s'exprime maintenant pour englober avec l'Australie la Nouvelle-Zélande.
Le projet débute par affirmer que les droits et privilèges des diverses colonies australiennes et néo-zélandaises resteront intacts devant l'union fédérale. L'Australasie prend pour modèle les États-Unis.
Au point de vue économique, le projet proclame la pleine liberté du commerce entre les colonies fédérées. Les autorités fédérales seules pourront établir les droits de douane et en répartir les produits. Au gouvernement fédérai également, le soin de la défense de l'Australasie, la disposition pleine et entière des forces de terre et de mer. Enfin toute une série de lois constitutionnelles régissent le fonctionnement d'un véritable gouvernement, entièrement distinct de celui de la métropole.
Espagne: ouverture des Cortès.--A l'ouverture des Cortès, à laquelle assistait la reine régente accompagnée du petit roi Alphonse XIII, lecture a été donnée du discours du trône.
Dans ce message, la reine se félicite du résultat des élections, qui ont permis de constater «combien les provinces sont attachées aux lois constitutionnelles qui régissent le royaume». Elle passe ensuite en revue les principales questions d'ordre intérieur qui intéressent le pays et arrive ensuite à un sujet qui regarde la France: les relations commerciales avec l'étranger. «Par suite de la dénonciation du traité passé avec la France, a dit la reine, il est nécessaire d'établir de nouvelles relations économiques entre l'Espagne et les autres États, car ce traité international était la base de notre régime commercial.»
Le message ajoute que les négociations engagées avec la France au sujet de la délimitation des possessions de la Guinée continuent d'une façon cordiale. Nous n'en sommes pas surpris, car, lorsque nous avons signalé les difficultés qui s'étaient élevées sur ce point entre notre pays et nos voisins, nous avons exprimé la certitude qu'il n'y aurait pas conflit et que les deux gouvernements apporteraient dans le règlement de cette affaire le même esprit d'entente et la même loyauté.
Chine: les réceptions diplomatiques.--Nous avons indiqué dernièrement les décisions prises par l'empereur de Chine au sujet des réceptions des ambassadeurs accrédités auprès de lui.
La première réception a eu lieu lieu le 5 mars, conformément aux dispositions nouvelles. Six ministres et quatre chargés d'affaires, accompagnés de leurs secrétaires, attachés et interprètes, ont été reçus par le souverain. Le prince Ching était chargé de les introduire un par un auprès de l'empereur et ensuite il les présenta tous en corps.
Cette réforme qui constitue une dérogation sensible aux traditions était combattue par le groupe conservateur de la Cour; celui-ci n'admet pas que l'on «porte la moindre atteinte au principe de la suprématie absolue du trône du céleste empire. En vertu de ce principe, les représentants des puissances ne pouvaient être reçus par l'empereur qu'à titre de simples particuliers venant présenter une requête ou demander une faveur.
Afin de donner un semblant de satisfaction aux conservateurs, l'audience du 5 mars a eu lieu en dehors des limites sacrées du palais, dans une salle servant habituellement à la réception des feudataires et tributaires. Mais cette précaution même ne fait que confirmer l'importance de la réforme opérée, en montrant que l'empereur ne sacrifie qu'en apparence au préjugé traditionnel.
Nécrologie.--M. Vésignié, ancien ingénieur des constructions navales, administrateur des Messageries maritimes.
La comtesse de Fiers, veuve de l'ancien sénateur de l'Orne.
Mme la baronne d'Ivry, fille du maréchal comte de Lobau.
M. J.-L. Havard, président honoraire de la chambre syndicale des fabricants de papier.
Le marquis de La Guiche, ancien député à l'Assemblée nationale.
NOTES ET IMPRESSIONS
Les hommes médiocres jouent un rôle dans les grands événements, uniquement parce qu'ils se sont trouvés là. (Mémoires.)
Talleyrand.
*
* *
En France, quand les convenances manquent, la moquerie est bien près.
(Ibid.)
Talleyrand.
*
* *
Écrire ses mémoires, c'est souvent s'embusquer derrière sa tombe pour tirer sans péril sur ses ennemis.
La duchesse de L...
*
* *
Je ne voudrais pas qu'un mot hostile à quelqu'un restât après moi... La postérité n'est pas l'égout de nos passions; elle est l'urne de nos souvenirs, elle ne doit, conserver que des parfums.
Lamartine.
*
* *
C'est voler que de vivre dans le monde sans rien essayer pour le rendre meilleur.
Th. Bentzon.
*
* *
C'est méconnaître la place que le cœur tient dans la vie à côté de la raison, que de prendre l'égoïsme pour l'art d'être heureux.
*
* *
Le citoyen d'un État libre est un peu comme la femme de Sganarelle: il aime mieux être battu que protégé malgré lui.
G.-M. Valtour.
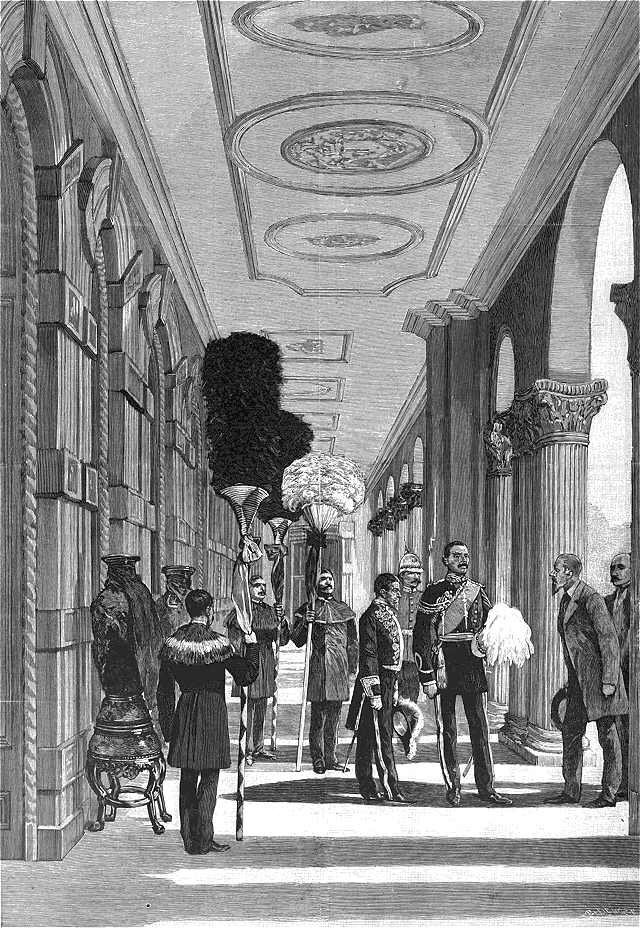
LES FUNÉRAILLES DU ROI KALAKAUA, A HONOLULU.--Les
résidents européens reçus par le chambellan sous le péristyle du
palais.
LES FUNÉRAILLES D'UN ROI
A HONOLULU
La mort du roi David Kalakaua a surpris tout le monde à Honolulu, peuple et résidents étrangers. On attendait en effet son retour d'Amérique où il était allé se faire soigner. Le contre-amiral Brown, de la marine des États-Unis, avait informé le commandant du Mohican alors dans les eaux d'Honolulu, que le croiseur Charlestown, parti de San-Francisco le 24 janvier, arriverait le 31 avec le roi des Hawaï à bord. De grands préparatifs avaient été faits pour le recevoir et sa sœur, la princesse-régente Lilinokalani, héritière du trône, avait depuis une semaine déjà envoyé les invitations à un grand bal qui devait avoir lieu au palais Solani pour fêter ce retour.
Tout à coup, le 29 janvier, de très bonne heure, les deux offices téléphoniques centraux envoyaient la nouvelle suivante:
«Le Charlestown à 15 milles avec le pavillon étoilé et le drapeau hawaïen à mi-mât.» La nouvelle se répandit instantanément et tandis que le Charlestown, du large, la confirmait par signaux télégraphiques au Mohican, le peuple déjà envahissait les quais, commentant le fait qui venait de rendre douloureusement vrai le pronostic d'un médecin français, le docteur Georges Trousseau, lequel, consulté à Paris par le roi, l'avait averti qu'un voyage entrepris en hiver au cours d'une maladie grave des reins devait être considéré comme un suicide.
Le jour même. Lilinokalani fut proclamée reine après avoir prêté serment à la Constitution. Le soir on débarqua le corps du roi, que des soldats d'infanterie de marine américains et anglais escortèrent jusqu'au palais où il devait être exposé.
Les cérémonies auxquelles a donné lieu cette exposition sont curieuses, ainsi qu'on peut le voir par les dessins que nous donnons.
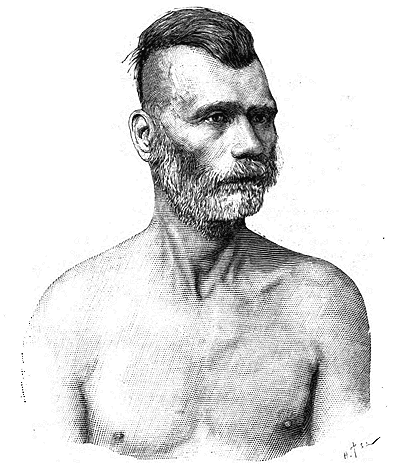
Coiffure de deuil d'un Hawaïen.
Dans la salle du trône transformée en véritable serre par un amoncellement de fleurs merveilleuses, le catafalque est dressé, surmonté des insignes de la royauté, sceptre et couronne, et recouvert de grands manteaux de plumes d'une richesse énorme et d'un prix fabuleux. Ils sont composés par la réunion de plumes d'un jaune très brillant dont un unique spécimen se trouve sous chaque aile d'un oiseau appelé «OO». Un musée américain possède un de ces manteaux qui est réputé valoir un million de dollars, soit environ cinq millions de francs. Celui qui recouvre le cercueil du roi appartenait autrefois à Nahienaena, une cheffesse, sœur de Kamehamea Ier, le fondateur du royaume-uni des îles Hawaï.
De chaque côté de la salle sont disposés d'anciens emblèmes hawaïens désignés sous le nom de «Kahilis». Ces Kahilis sont des sortes de grands cylindres de plumes emmanchés sur un bâton ou une hampe, les uns fixés dans des trépieds, les autres tenus à la main et agités de haut en bas ou de droite à gauche près du cercueil par des gens de la maison du roi. De plus, pendant tout le temps que le corps est exposé, des pleureuses de profession font retentir l'air de leurs lamentations et des chanteurs de ballades les accompagnent de leurs chants alternativement tendres, joyeux, puis lugubres.
Habituellement aussi ces chants sont accompagnés d'une danse particulière, le hula-hula, mais qui a été cette fois-ci supprimée, car en général les exécutants de cette danse dépassent la mesure et se livrent alors à des contorsions et des écarts qui rappellent trop le cancan européen. Mais, si le hula-hula a été supprimé, en revanche une vieille coutume de famille a été rétablie à l'occasion des obsèques de Kalakaua. C'est celle qui consiste à laisser brûler des torches pendant le jour, en souvenir d'un vieux chef, ancêtre du roi décédé, qui mit un jour le feu à ses emblèmes, à son Kahilis, et le laissa brûler pour défier le soleil.
Les résidents européens ont été admis à défiler devant le corps, et ont été reçus, ainsi que le montre notre dessin, sous le péristyle du palais, par le vice-chambellan du roi défunt.
Au dehors, le peuple manifeste sa douleur par une coutume bizarre: les hommes se rasent d'une façon singulière, se coupant par exemple la moitié de la chevelure ou un favori, les femmes se raccourcissent les cheveux, puis hommes et femmes se font sauter une dent.
David Kalakaua, dont nous avons donné le portrait dans notre numéro du 31 janvier dernier, était le septième roi des îles Hawaï.
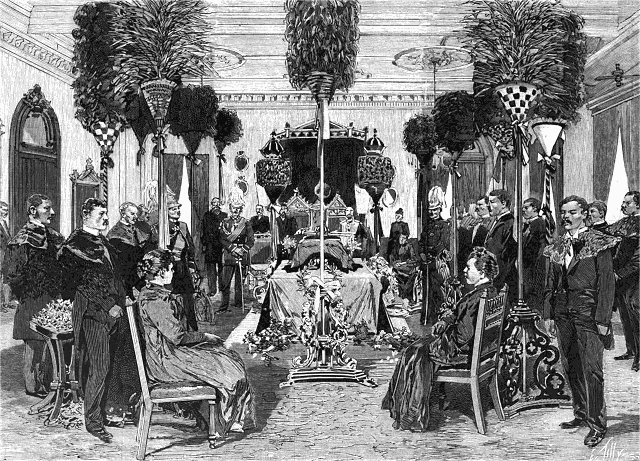
LES FUNÉRAILLES DU ROI KALAKAUA, A
HONOLULU.--L'exposition du corps dans la salle du Trône.
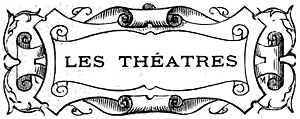
Châtelet: Camille Desmoulins, drame historique en six actes, par Blanchard et Mallian.-Variétés: Paris port de mer, revue par MM. Monréal et Blondeau.--Renaissance: La Petite Poucette, de MM. Ordonneau et Hennequin, musique de M. Pugno.
Le théâtre du Châtelet a du bien être étonné du calme dans lequel s'est passée la première soirée de Camille Desmoulins. Pas un murmure, pas une protestation. Où donc étaient alors les spectateurs de Thermidor, ceux qui n'avaient pu laisser aller, tant leur conscience républicaine en avait été blessée, la pièce de M. Sardou? On ne les avait donc pas avertis que le théâtre menaçait à nouveau la mémoire de Robespierre et s'attaquait aux actes du tribunal révolutionnaire? Le public ne protestait plus; il m'a semblé même qu'il prenait plaisir à retrouver en scène, dans les invectives de Camille contre ses bourreaux, une réplique du vieux cordelier.
Ainsi les choses étaient en 1831, quand Blanchard et Mallian donnèrent ce drame historique qui eut le plus grand succès: Les Partis en 1794. Ainsi parlait le sous-titre de la pièce. Le drame était écrit à quarante ans de distance des faits; les esprits étaient tout agités, tout enfiévrés encore de l'agitation, des fièvres de la Révolution; les passions politiques tenaient pour 89, pour les Girondins et pour Camille. La Terreur éveillait des souvenirs affreux: vous devez penser si ce drame de Camille Desmoulins fut bien reçu, s'il fit courir la foule. Fort bien fait du reste, un peu long dans sa première partie, mais habilement conduit dans ses développements, et émouvant au dernier point, dans le tableau qui conduit devant les juges Camille, Danton, Philippeaux, Lacroix, Basire, Chabot, Hérault de Séchelles et le général Wessermann.
Tout le tribunal est là, avec ses accusateurs, ses jurés, avec le peuple qui l'envahit, les tricoteuses et les gendarmes. On s'accuse, on se défend, on s'invective; Camille et Danton insultent les juges et leur crachent au visage; la bataille est livrée entre les accusés et les accusateurs, et la foule, qui hurle, prend parti pour les victimes. Cette scène a retrouvé l'autre soir encore l'intérêt des premiers jours de sa représentation. Quant au récit que la pièce nous fait de l'amour et du dévouement de Lucile pour Camille Desmoulins, il a laissé le public assez indifférent, et nous ne croyons pas à la longue durée de ce drame soi-disant historique sur l'affiche du Châtelet. La pièce est bien interprétée pourtant.
M. Brémond est excellent dans le rôle de Camille; M. Deshayes fait le personnage de l'abbé Bérardier, qui fut à la fois le maître de Camille Desmoulins et de Robespierre, et dont la bonté d'âme ne parvint pas à rapprocher ses deux anciens élèves. Danton, c'est M. Bonyu; M. Raymond, poudré à blanc, avec des ailes de pigeon, fait Robespierre, et lui donne une tête sinistre; mais le public ne m'a pas paru prendre grand souci de cette évocation du passé.
Après cent cinquante représentations, Ma Cousine a cédé aux Variétés la place à la Revue. Elle est un peu en retard, la Revue, si elle vient nous entretenir de l'année qui a pris fin il y a deux mois; mais depuis ce temps il s'est passé tant de choses que l'an 90 est déjà oublié et que l'an 91 peut déjà fournir son contingent à la comédie. Celle-ci a pour titre: Paris port de mer, et elle est des plus gaies et des plus heureusement venues.
M. Paris, qui songe à une union conjugale avec Mme la Manche, fait visiter à cette fiancée ses nouveaux domaines. Les voilà l'un et l'autre en promenade. Comme invention cela n'est pas très original, mais trouvez-moi le moyen d'introduire autrement un compère et une commère dans ces sortes de pièces! Voilà le couple qui commence sa pérégrination au faubourg Montmartre, à l'endroit même le plus défoncé de la ville. Des guides y sont nécessaires: on en a appelé du Tyrol pour la plus grande sécurité du voyageur; il y a là un Tyrolien qui chante sa tyrolienne d'une voix charmante. Les piétons, femmes et hommes, ne se laisseront pas intimider par les fondrières qu'ils franchissent dans un saut périlleux: comme les passants, les sergents de ville font aussi le saut de carpe. Voici venir un cortège pomponné, enrubanné, et que conduit, déguisé en Amour, M. Lassouche. Ce Cupidon a pour mission de Mme sa mère d'apporter un remède au mal de dépopulation qui nous menace. Au bruit grandissant des clarinettes et des grosses-caisses, Stanley arrive en palanquin du fond de l'Afrique; il exhibe l'homme-chat et la femme-chatte.
Un vélocipédiste conduit à l'Odéon un ours, que M. Porel refuse de recevoir, mais que le Jardin des Plantes hébergera. M. Cooper chante spirituellement un rondeau sur l'air du baiser. Le petit chalet que nous avons vu pendant vingt-quatre heures sur l'esplanade de l'Opéra est sous la direction de M. Brasseur, déguisé en vieille dame: là-dessus, les plaisanteries et les calembours vont leur train; elles sont un peu salées, les plaisanteries. Sed erat hic locus. Sous les traits du maire Chamouillard, M. Baron marie ses administrés en musique. L'histoire toute parisienne est d'hier; vous devez penser si on en a ri.
Nous arrivons maintenant au point culminant de la revue, à ce truc qui fera courir tout Paris. Sur une vraie piste, trois chevaux montés par de vrais jockeys galopent, pendant que le paysage de Longchamps se développe sous vos yeux. La salle étonnée abattu des mains, et le sort de Paris Port de Mer était assuré pour cent représentations.
Le théâtre de la Renaissance a joué sous ce titre: la Petite Poucette, un vaudeville-opérette en trois actes, un peu trop rapidement improvisé, mais joué à merveille par Mme Mily-Meyer, chargée du rôle bien amusant de la Petite Poucette. La musique pleine de gaieté et d'entrain, et qui confine souvent au meilleur genre bouffe, est de M. Raoul Pugno: elle a été très applaudie. Le public, qui a bissé plusieurs morceaux de la partition, a plus chaleureusement encore accueilli au troisième acte les couplets spirituels de la Zanardella que Mme Mily-Meyer chante et joue avec une finesse et une fantaisie incomparables.
M. Savigny.
LES LIVRES NOUVEAUX
Mémoires du prince de Talleyrand, publiés avec une préface et des notes par le duc de Broglie, de l'Académie française, 2 forts vol. in-8° à 7 fr. 50 le vol. (Calmann-Lévy). Si longtemps attendus, ils sont enfin publiés. Aux trente ans exigés par l'auteur pour qu'aucun des personnages mentionnés ne fût encore vivant lors de la publication, les légataires successifs en ont ajouté vingt. C'était de quoi faire espérer bien des choses: tant de précautions ne pouvaient se justifier que par beaucoup d'indiscrétions, pas mal de confidences et un peu de scandale. C'était le moins qu'on pût attendre d'un homme qui avait tout vu, et qui, de son vivant, avait, par réserve diplomatique, de toujours se taire, d'un homme de tant d'esprit qui avait dû retenir tant de mots excellents où la bénignité n'aurait eu que faire. Et voilà que c'est tout autre chose. Pas l'ombre de satire, peu ou point d'anecdotes, à peu près nulle malignité. Cet homme tant attaqué allait-il au moins plaider sa cause et, par suite, prendre à son tour l'offensive? Ce n'est pas cela davantage: pas de plaidoyer, ni même de confession, le parti pris au contraire de ne pas occuper de lui ses lecteurs, du moins de ce qui ne touche que lui seul, parti pris qui ne va pas sans une forte nuance de dédain.
Les grands intérêts politiques et nationaux dont il a tenu plusieurs fois le sort entre ses mains et dont la France et la postérité ont le droit de lui demander compte, voilà ce qu'il nous invite à considérer. La France, à diverses reprises, lui a confié sa fortune: sa préoccupation est de prouver que cette fortune n'a pas souffert de cette confiance; il s'anime à le démontrer; il a le souci de convaincre, plus presque qu'on ne devait l'attendre, et ce témoignage qui lui tient au cœur, il se le rend à lui-même avec fierté. Suffira-t-il, d'autre part, à convaincre cette postérité pour laquelle il écrivait ces pages? Les partis n'acceptent guère que l'on n'appartienne à aucun d'eux (cela donne quelquefois si bien l'air de leur appartenir à tous!); mais si «comme ministre, comme ambassadeur, en face de l'étranger (ennemi, rival ou allié), le prince de Talleyrand, comme on peut l'estimer avec M. le duc de Broglie, a vraiment défendu la cause de la grandeur et de l'indépendance nationale», les lecteurs des Mémoires reconnaîtront volontiers les services de ce serviteur, peut-être un peu trop avisé, qui déclare avec tant d'esprit «n'avoir jamais abandonné aucun gouvernement avant qu'il se fût abandonné lui-même!»
L. P.
Reine des Bois, par André Theuriet. 1 vol. in-12, 3 fr. 50 (Bibliothèque Charpentier).--Le vieux châtelain célibataire Claude de Buxiène, qui vient de mourir, a semé bien des enfants dans la contrée. L'un d'eux, Claudet, a presque rang d'enfant légitime et serait reconnu si la mort n'avait arrêté la plume du testateur avant la fin du testament. Le château passe donc aux mains d'un arrière-petit-cousin, Julien de Buxiène, qui s'ennuierait fort dans ses nouveaux domaines s'il n'y avait rencontré Reine des Bois. Devenu l'ami de Claudet, il croit découvrir que Reine et lui s'aiment, ce qui n'est qu'à demi la vérité, et il veut les marier, pour n'être plus jaloux, car il se sent pris au cœur par la jolie fermière. Mais voilà bien un obstacle imprévu. Le curé refuse de consacrer ce mariage, et l'explication qu'il donne de son refus à Julien, c'est que Reine est la sœur naturelle de Claudet... Oh! ce vieux Buxiène! Claudet s'engage et meurt à Montebello. Et Reine? Elle épouse Julien qu'elle aimait. L'idylle se mêle au drame pour former un charmant poème, qui s'harmonise à merveille avec un cadre rustique, cher à M. André Theuriet, les forêts de la montagne langroise, dont le poète connaît bien tous les sentiers.
L. P.
La Bataille littéraire, par Philippe Gille. Quatrième série (1887-1888) avec une préface de l'auteur. 1 vol. in-12, 3 fr. 50 (Victor-Havard, éditeur).--Aux lecteurs des trois premières séries, la quatrième n'est plus à recommander. La bataille continue: Réalistes et naturalistes, spiritualistes et romantiques, se disputent pied à pied le terrain; mais voilà qu'entre en ligne un élément nouveau: de jeunes troupes qui portent inscrits sur leur drapeau des noms étranges: décadents, symbolistes, évolutifs, instrumentistes... Quel sera leur rôle dans la bataille? nous ne pouvons pas nous résoudre à le croire sérieux et nous pouvons bien voir que M. Philippe Gille y a aussi quelque peine. Mais il s'est fait un devoir de leur donner place, de nous initier autant que faire se peut à leurs mystères. Il cherche à les comprendre, nous aussi, et il faut bien espérer que ce n'est pas uniquement de notre faute si nous n'y parvenons pas. La crise littéraire actuelle est d'ailleurs résumée en tête du volume dans une préface de beaucoup de sens et d'esprit.
L. P.
Études d'histoire parlementaire: Les Beaux jours du second empire, par M. Corentin Guyho, ancien député, avocat général à la cour d'Amiens. 1 vol, in-12. 3 fr. 50. (Calmann-Lévy).--On sait ce que furent, sous le second empire, les discussions législatives, combien l'indépendance y était rare et difficile, à quel point elles étaient étouffées et sont par suite demeurées inconnues. Leur analyse impartiale a tenté M. Corentin Guyho qui s'est proposé d'établir par ce moyen aux yeux de la postérité combien, dès l'origine, le second empire a manqué de contrôle, «vice inaperçu ou timidement signalé dans les beaux jours; plus tard, cause de ruines irréparables et de désastres inouïs, quand l'empire, atteint de la maladie de l'incertitude, fut devenu un régime personnel où il n'y avait plus personne». Volume très intéressant et très attachant, dont la matière se borne aux années 1853 et 1854.
L. P.
Tribunes et Tréteaux par M. Étienne Salliard. M. Étienne Salliard vient de publier à la librairie Marpon et Flammarion, sous ce titre: Tribunes et Tréteaux, esquisses parlementaires, un volume contenant une série d'études fort humoristiques sur nos hommes politiques les plus en vue.
C'est par classifications, ou, si l'on aime mieux, par groupes--deux termes qui leur sont également chers du reste--que nos honorables défilent dans cette galerie satirique, avec leurs tics si drôles, leurs manies souvent bizarres, leurs attitudes tantôt frondeuses, tantôt empreintes de la plus réjouissante flagornerie.
Dans une préface étincelante d'esprit, M André de Latour de Lorde présente au lecteur ce livre écrit de verve et qui va faire sensation dans les sphères politiques.
Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts: les Armes, par Maurice Maindron. 1 vol. in-12, illustré de 300 gravures. 3 fr. 50 (May et Motteroz, 7, rue Saint-Benoit.)--C'est l'histoire des armes offensives et défensives à travers les temps; elle s'adresse aux artistes, aux amateurs, aux escrimeurs, aux officiers. Le projet est traité avec une grande rigueur scientifique qui, fort heureusement, n'exclut pas le sentiment de l'art. L'ouvrage se termine par un répertoire des marques d'armuriers les plus fameux du quinzième au dix-septième siècle.
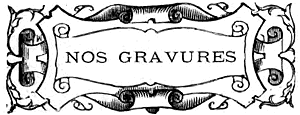
LE PRINCE NAPOLÉON
Le prince Jérôme Napoléon souffre, en ce moment, à Rome d'une affection des bronches et du péritoine que le grand âge du malade rend très dangereuse. Bien qu'on ait signalé, à plusieurs reprises, une amélioration notable, son état, à l'heure où nous mettons sous presse, semble désespéré, et c'est l'heure de rappeler la longue carrière du cousin de Napoléon III.
Il est né à Trieste (Illyrie) en septembre 1822, second fils de l'ex-roi Jérôme, frère de Napoléon 1er, et de la princesse Frédérique de Wurtemberg. Il fit son éducation en Suisse, puis parcourut l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. La France lui était fermée: il visita Paris, cependant, en 1815, sous le nom de comte de Montfort, et grâce à une autorisation spéciale de Guizot. Deux ans après, du reste, le gouvernement de Louis-Philippe autorisait l'ex-roi Jérôme et sa famille à rentrer en France. Au lendemain de la révolution de février 1819, le prince Napoléon se rallia ouvertement au nouveau régime, et il accentua encore son adhésion à la République dans sa profession de foi aux électeurs de la Corse qui l'élurent, en tête de liste, représentant à l'Assemblée constituante.
En 1819, le prince Napoléon fut pendant quelque temps ministre plénipotentiaire à Madrid, mais fut révoqué pour avoir quitté son poste sans autorisation. Il revint siéger à l'Assemblée législative, toujours comme député de la Corse; il se tint à l'écart au moment du coup d'État. Ce n'est qu'à la fin de 1852 qu'il fut investi de toutes les dignités que comportait sa proche parenté avec l'empereur: il eut le titre de prince français, une place au Sénat et au conseil d'État, il fut grand-croix de la Légion d'honneur et général de division.
Pendant la guerre de Crimée, le prince Jérôme-Napoléon commanda une division d'infanterie de réserve aux batailles de l'Alma et d'Inkermann. Trois ans après, en 1857, il entreprit une longue excursion dans les mers du Nord. En 1859, le prince Napoléon épousa la princesse Clotilde-Marie-Thérèse de Savoie, fille du roi Victor-Emmanuel et, par conséquent, sœur du roi actuel d'Italie. Humbert Ier.
On sait quel fut le rôle du prince Napoléon pendant toute la durée du second empire. Il avait sa cour au Palais-Royal, une cour dont les hommes les plus illustres et les plus distingués de l'époque étaient les familiers et les assidus. Ernest Renan, Sainte-Beuve, Émile Augier, Edmond About, étaient parmi ceux-là. Le prince, qui avait de hautes qualités d'intelligence, qui aimait les lettres et les arts, se plaisait dans la compagnie de ces esprits éminents, et il n'y était pas déplacé. On pensait et on parlait librement dans ce cénacle, qui avait des tendances anticléricales et démocratiques non dissimulées. Parfois même les Tuileries prirent ombrage de ce qui se disait au Palais-Royal, et ne virent pas sans crainte le mouvement d'idées auquel le patronage du prince Jérôme-Napoléon donnait une sanction impériale.
Quand éclata la malheureuse guerre de 1870, le prince Jérôme-Napoléon, qui avait toujours beaucoup aimé les lointains voyages, se trouvait en Norvège. Il rentra en toute hâte, plein d'anxiété pour l'issue des événements dont il prévoyait la tournure désastreuse.
Après la chute de Napoléon III, le prince Jérôme s'occupa très activement de politique: il fut nommé conseiller général en Corse aux élections de 1871: expulsé en 1872, il obtint la permission de rentrer en France après le 21 mai 1874. La tendance démocratique qu'il donnait à sa propagande lui eut, bientôt aliéné les amis directs du prince impérial. Le prince Jérôme-Napoléon ne faisait rien, d'ailleurs, pour prévenir une rupture fatale. Il se présenta aux élections législatives de 1876 à Ajaccio contre M. Rouher. Il fut combattu, au nom du prince impérial, par les chefs officiels du parti impérialiste. Il échoua, mais, l'élection de M. Rouher ayant été annulée, il entra à la Chambre. Il prit part aux débats de la loi sur la collation des grades. Son discours était semé de mots comme celui-ci: «Semez du jésuite, vous récolterez un révolté.»
Le prince Jérôme-Napoléon vota, avec la majorité républicaine, contre le ministère du 16 mai: il fut un des 363, mais il fut battu, aux élections d'octobre 1877, par le baron Haussmann.
Depuis, le prince Napoléon se consacra à la direction de son parti. La mort inopinée du prince impérial fit, du prince Jérôme-Napoléon, à l'égard de la stricte hérédité, le chef dynastique de la famille impériale. Mais la grande majorité des bonapartistes ne pardonnaient pas au prince son opposition à Napoléon III et ses allures de César populaire et voltairien. On lui imposa son propre fils aîné, le prince Victor-Napoléon, que désignait, d'ailleurs, le testament du prince impérial. Ce fut, dès lors, entre le père et le fils la rupture et la guerre. L'exil commun, survenu depuis, ne les a pas réconciliés; et la princesse Clotilde, au chevet de son époux mourant, n'a pas encore réussi à faire admettre le prince Victor qui est accouru à Rome.
Le prince Jérôme-Napoléon a deux autres enfants: le prince Louis qui sert dans l'armée russe, et la princesse Lætitia, veuve du duc d'Aoste.
LA BATAILLE D'AUTEUIL
Un corps d'armée, ou tout au moins une division, avait été mobilisée pour assurer dimanche l'exécution du vote récent de la Chambre, qui supprimait le jeu aux courses. Dès le matin, par une pluie battante, les troupes occupaient l'hippodrome et ses abords, et prenaient leurs positions. En même temps, des escouades d'agents envahissaient les diverses enceintes et s'échelonnaient devant les tribunes. Auteuil était en état de siège.
En arrivant sur l'hippodrome, on constatait, sans s'émouvoir d'ailleurs, que la piste ne présentait pas son animation habituelle, qu'une partie des baraques du mutuel avait disparu, et que les piquets des bookmakers étaient remplacés, sans avantage, par des agents, dont on s'accordait généralement à plaindre la corvée. Pauvre gens, qui barbotaient dans la boue depuis le matin, et semblaient grelotter sous leurs imperméables complètement détrempés! La silhouette de plusieurs voitures cellulaires, à peine dissimulées, croquemitaines qui n'effrayaient personne, faisait doucement sourire, et de tous côtés on entendait tenir, sans aucune aigreur, les mêmes propos narquois, qu'on peut résumer ainsi: «Faut-il vraiment qu'on nous croie bêtes!» Et on se promettait de ne pas justifier cette opinion peu flatteuse. On était, du reste, aguerri par la campagne de 1887, et on s'avançait avec le calme de veilles troupes, habituées au feu.
Les courses se passèrent donc sans encombre, sans que personne songeât a récriminer, d'autant moins que, dès la seconde épreuve, les paris au livre, sans échange apparent d'argent, furent sinon autorisés, au moins tolérés sans intervention de la police dont il convient de reconnaître le calme et l'urbanité. On eut dit qu'elle aussi n'était pas convaincue.
Mais alors, que faisaient, pendant ce temps, les pauvres troupiers, réduits fort heureusement à un rôle passif?
Mon Dieu, ils s'intéressaient aux courses, tout simplement. A leur impassibilité ordinaire, avait peu à peu succédé un mouvement de curiosité; ils suivaient, avec une attention un peu inquiète d'abord, le passage des chevaux aux divers obstacles: puis bientôt s'enhardissaient et on voyait émerger au-dessus de la barrière en planches qui masquait les baraques du mutuel des casques, des moustaches et des bras s'agitant avec une animation qui rappelait les marionnettes des théâtres forains: d'autres, grimpés sur les balustrades des baraques, suivaient ardemment les détails de la course. Il en était de même plus loin, dans la partie que le public appelle le Tonkin, sans doute parce qu'elle est la plus humide de l'hippodrome, ainsi que dans l'allée des lacs; on voyait des groupes se former et discuter, avec animation, en connaisseurs, les divers incidents de course que l'état glissant du terrain rendait assez nombreux. Enfin, le long des barrières blanches, les agents, empoignés eux aussi, se passionnaient pour telles ou telles casaques et ils auraient, s'ils l'avaient osé, applaudi avec enthousiasme lorsqu'elles avaient franchi, sans encombre, la fameuse rivière des tribunes dont ils avaient si souvent entendu parler.
Il n'y avait à ce montent ni gardes, ni agents, ni public, tout le monde était confondu dans un même sentiment, obéissait à une même passion: l'accord était complet. Les courses seules pouvaient faire ce miracle!
Puis, s'enhardissant encore, mis en goût tout à fait, gardes et agents s'approchaient doucement des donneurs, que leurs carnets et leurs crayons permettaient de facilement reconnaître, et... ils se risquaient à demander la cote des chevaux; de là à essayer un petit pari il n'y a qu'un bien petit pas à faire, et l'attrait est tel qu'il n'était pas possible d'y résister. Et bientôt, plus ou moins vigoureusement, mais à peu près sur tous les points, l'armée française était engagée, elle pariait avec ensemble, les officiers eux-mêmes se laissaient entraîner: de nombreuses poules étaient organisées, et le turf comptait de nouveaux adeptes! Résultat peu prévu, sans doute, mais vraiment original et significatif.
Le spectacle était touchant, bien fait pour attendrir les apôtres fanatiques de la fameuse devise qui prêche la fraternité, bien propre en même temps à émouvoir ce bon M. Prudhomme, dont, en cette mémorable journée, le sabre qui devait combattre les paris ne les a pas protégés sans doute, mais en a subi le charme.
La preuve nous paraît faite, concluante et péremptoire, la cause est entendue, et il serait dommage d'insister. Aussi, avec quels cris de joie les listmen ont-ils accueilli le départ des fameuses voitures cellulaires, regagnant à vide leurs dépôts respectifs, au milieu des lazzis et de plaisanteries d'un goût plus ou moins douteux! et comme on était tenté de partager l'opinion des Pandores, qui murmuraient au retour, d'une voix un peu triste, le refrain connu:
Ah! qu'il est beau d'être homme d'armes.
Mais c'est un sort bien exigeant!
Alors, on n'a arrêté personne?
Pardon, un ivrogne, qu'on a relâché pour lui épargner les tristesses de la solitude.
Aujourd'hui, on est rassuré; la crise durera peut-être plus longtemps qu'on ne l'avait cru: mais la solution en est certaine et tout le monde, au moins la partie saine du public qui fréquente les champs de course y applaudira. On se consolera aisément, au besoin, de la suppression de quelques journées de courses au seul détriment de la tourbe qui déshonorait les hippodromes, si l'on peut, à ce prix, être pour l'avenir assuré de la tranquillité que l'on réclame depuis si longtemps.
Cette crise passagère profitera donc à l'institution des courses, et cette saignée salutaire, en la débarrassant du cortège d'escarpes qui la compromettaient, lui donnera une vitalité nouvelle.
S.-F. Touchstone.
LA COURSE DE CHEVAUX DE LA REVUE «PARIS PORT DE MER»
Un des clous de la revue Paris port de mer, de MM. Montréal et Blondeau, jouée au théâtre des Variétés, est une course de chevaux. Trois chevaux vrais, montés par de vrais jockeys, sont lancés à fond de train et font le tour de l'hippodrome de Longchamps. Il y a là un effet réel doublé d'un effet d'illusion. Les chevaux sont libres de toute entrave et galopent réellement; mais le sol se dérobe sous leurs pieds en glissant en sens inverse de la direction de la course, et le paysage ainsi que les barrières s'enfuient en sens également contraire à la marche des chevaux.
Nos lecteurs ont sous les yeux le mécanisme assez simple au moyen duquel fonctionne ce remarquable truc de théâtre. Les trois chevaux courent sur trois pistes indépendante l'une de l'autre, mais disposées côte à côte. Notre dessin représente, en coupe, l'une de ces pistes constituée par un tapis sans fin en fibres de noix de coco, analogue aux paillassons qui servent d'essuie-pieds, mais de tissu plus épais et plus serré. Cette sorte de courroie, 93 centimètres de large, s'enroule sur deux tambours placés de chaque côté de la scène, dans le premier dessous; elle est tendue sur un troisième cylindre, monté dans le second dessous, et, au niveau du plancher de scène, elle est soutenue par une suite de rouleaux de bois très rapprochés les uns des autres et tournant sur pivots. Le tambour (monté à gauche du théâtre et de la gravure) peut être mis en mouvement de rotation rapide par une machine électromotrice qui reçoit le fluide d'une batterie d'accumulateurs placée rue Feydeau, à proximité du théâtre. Des appareils commutateurs permettent, par le jeu de simples manettes, de rester maître de la mise en marche comme de la vitesse des machines.
Au moment de la course, chaque cheval vient se placer sur la piste qui lui est affectée. Le courant électrique est lancé dans les dynamos, et la courroie-tapis entre en mouvement. Les chevaux, sentant le sol glisser et les entraîner en arrière, piétinent d'abord pour se maintenir, puis, d'une part, le mouvement fuyant de la piste s'accentuant, de l'autre, leurs jockeys les excitant de la voix et de l'éperon, ils prennent le galop d'autant plus marqué que plus rapide est le mouvement du tapis sous leurs pieds. Cependant, malgré la vitesse, les coureurs occupent toujours le centre du tableau circonscrit par le cadre de la scène et dont le fond est formé par le panorama de Longchamps. L'immobilité des chevaux dans l'espace résulte donc du double effet de leur projection en avant sous l'impulsion des jockeys et de leur ramenage en arrière par la fuite du sol. Si la courroie venait à s'arrêter subitement, le cheval et son jockey iraient se briser contre le mur: dans le cas contraire, ils culbuteraient en arrière. L'équilibre se maintient entre les deux impulsions par le jeu très attentif des commutateurs qui règlent la marche des moteurs, par suite celle des tambours et du tapis.
L'illusion est complétée par le déroulement d'une toile de fond, de 93 mètres de longueur, qui représente le panorama de la campagne, vue des tribunes de Longchamps. Cette toile, d'abord enroulée sur un cylindre vertical monté à droite du théâtre, se déroule pour venir s'enrouler sur un cylindre absolument semblable monté à gauche de la scène et représenté à droite de notre gravure. Les deux cylindres sont mis en mouvement par un treuil disposé dans les frises et manœuvré à bras d'hommes. Enfin, la barrière dont on voit les piquets fuir au premier plan, dans le même sens que le panorama, est montée sur une courroie sans fin circulant sur deux tambours actionnés par un moteur à air du système Popp. Le panorama se déroule en une minute un quart et, pendant ce temps, le tapis circule à la vitesse de neuf cents à mille mètres par minute, autrement dit de douze à quinze lieues à l'heure. Ce truc vraiment curieux a pour auteurs: M. L. Bruder, pour la construction des pistes, M. Solignac, pour l'installation des moteurs électriques, et M. Justin, pour l'entraînement des chevaux.
Paul Laurencin.
L'ASSOCIATION DES DAMES FRANÇAISES
La vente annuelle de l'association des Dames Françaises, dont le siège social est 21, boulevard des Capucines, a été splendide: la foule était considérable, et les comptoirs étaient tenus par les femmes les plus distinguées de Paris. Nous avons particulièrement remarqué un beau groupe qui se trouvait au comptoir de Mlle de Tailhardat: cette œuvre de grande valeur, due à M. Vital-Dubray, personnifie l'association et représente deux ambulancières donnant leurs soins à un soldat blessé. Ces figures sont des plus expressives, et l'ensemble du groupe est des plus réussis.
Malgré qu'on ait eu à regretter l'absence de la présidente de l'œuvre, Mme la comtesse Foucher de Careil, empêchée par son grand deuil, le produit de la vente est très considérable, et l'Association est de plus en plus florissante.
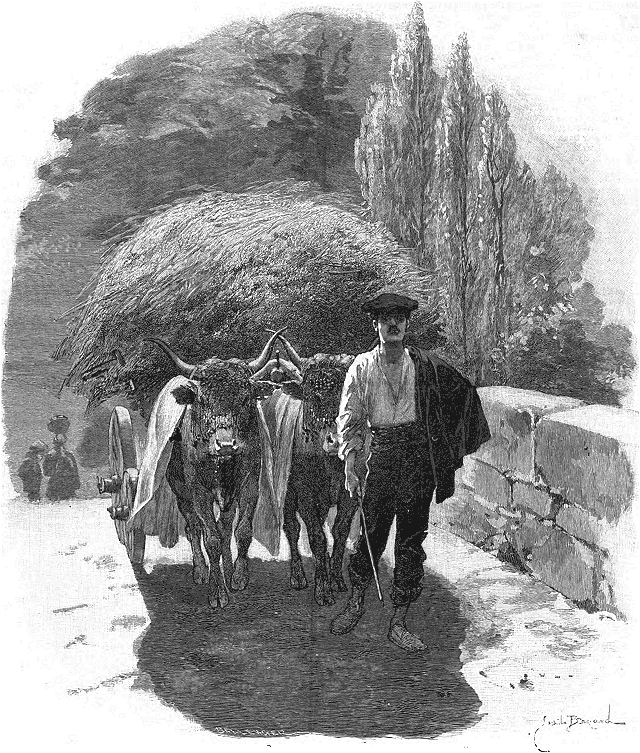
ANIE
Roman nouveau, par HECTOR MALOT
Illustrations d'ÉMILE BAYARD
Suite.--Voir nos numéros depuis le 21 février 1891.
C'était beaucoup pour échapper aux procès, dont il avait l'horreur, que Barincq avait accepté les propositions de Sauval, qui semblaient devoir lui offrir une sécurité absolue; cependant devant ce double refus il avait fallu se résoudre à plaider de nouveau: une fille lui était née, il ne pouvait pas la laisser ruiner, pas plus qu'il ne devait laisser dévorer la fortune de sa femme, déjà gravement compromise. Il avait donc demandé aux tribunaux la nomination d'experts qui auraient à examiner si les procédés de Sauval étaient susceptibles d'une application industrielle; à constater que si dans le laboratoire ils donnaient des résultats superbes, dans la pratique ils n'en donnaient d'aucune sorte; enfin à reconnaître qu'ils ne reposaient pas sur une base sérieuse, et que ce qu'il avait vendu était le néant même.
Quelle stupéfaction, quelle indignation pour Sauval!
Il croyait bien pourtant s'être entouré de toutes les précautions en ne traitant pas avec un de ces commerçants de profession qui n'achètent une découverte que pour dépouiller son inventeur; mais voilà le terrible, c'est que l'esprit commercial est contagieux, et qu'aussitôt qu'on touche aux affaires on devient un homme d'affaires.
Sans doute il ferait facilement le sacrifice des bénéfices qui étaient le fruit de son travail, et, sur ce point, il était prêt à toutes les concessions; mais il y en avait un que sa position ne lui permettait pas de mettre en discussion: c'était de subir le contrôle d'experts qui dans la science ne pouvaient pas être ses pairs.
Il fallait donc qu'il se défendit et n'acceptât pas qu'en sa personne le savant fût une fois de plus exploité par le commerçant.
L'affaire s'était traînée de juridiction en juridiction, et, pendant que les clercs grossoyaient des monceaux de papier timbré en expliquant longuement la technique des matières colorantes à deux francs le rôle; pendant que les avocats plaidaient et refaisaient chacun à son point de vue l'histoire de la chimie; pendant que les juges écoutaient, somnolaient ou jugeaient, la situation commerciale de Barincq sombrait, s'enfonçant chaque jour un peu plus. Il lui aurait fallu des capitaux, pour faire marcher sa maison en même temps que pour soutenir ses procès, et il ne se soutenait plus que par des miracles d'énergie appuyés par des sacrifices désespérés.
Alors qu'il pensait faire lui-même sa vie, sans secours d'aucune sorte, au moyen des seules idées qu'il avait en tête, il avait pu abandonner avec indifférence la plus grosse part de son héritage paternel; aux abois, traqué de tous les côtés, affolé, il revint à Ourteau pour expliquer sa situation à son frère, et lui demander de le sauver en consentant une garantie hypothécaire pour une somme de cent cinquante mille francs. Bien que le mot hypothèque fût un épouvantail pour Gaston, la garantie fut accordée, sinon sans inquiétude, au moins sans marchandages:
--Puisque tu as besoin de moi, cadet, c'est mon devoir de te venir en aide.
Ces cent cinquante mille francs avaient été une goutte d'eau. Six mois après leur versement, c'était du garant que le créancier exigeait par acte d'huissier le paiement de ses intérêts, le garanti étant dans l'impossibilité de se libérer.
Les rapports des deux frères, jusque-là affectueux, s'étaient aigris: un huissier au château, c'était la première fois que pareil scandale se produisait; la lettre qui l'annonçait avait été dure malgré le parti-pris de modération.
«Tu n'as donc pas pensé que le «parlant à» pourrait être rempli au nom d'un de mes domestiques, ce qui a eu lieu?»
Pour arranger la situation, Mme Barincq avait voulu venir à Ourteau avec sa fille: Gaston n'était-il pas un oncle à héritage? Il importait de le ménager.
Au lieu d'aplanir les difficultés, elle les avait exaspérées, en insistant plus qu'il ne convenait sur la générosité que son mari avait montrée lors du partage de la succession paternelle. Comment l'aîné pouvait-il admettre la générosité, quand il était convaincu que son cadet avait simplement accompli son devoir?
Lorsqu'au bout de huit jours elle avait quitté le château pour rentrer à Paris, la rupture entre les deux frères était irréparable.
Les procès se prolongèrent pendant dix-huit mois encore, au bout desquels un arrêt définitif prononçait la nullité des brevets; mais il était trop tard, Barincq, épuisé, n'avait plus qu'à abandonner à ses créanciers le peu qu'il lui restait, et s'il échappait à la mise en faillite, c'était grâce à la généreuse intervention de Sauval.
Un ami le recueillait par pitié dans la petite maison de la rue de l'Abreuvoir, et le directeur de l'Office cosmopolitain des inventeurs, qui avait gagné tant d'argent avec lui, le prenait comme dessinateur aux appointements de deux cents francs par mois.
IX
A six heures du matin le train déposa Barincq à la gare de Puyoo; de là à Ourteau, il avait deux lieues à faire à travers champs. Autrefois, une voiture se trouvait toujours à son arrivée, et, par la grande route plus longue de trois ou quatre kilomètres, le conduisait au château; mais il n'avait pas voulu demander cette voiture par une dépêche, et l'état de sa bourse ne lui permettait pas d'en prendre une à la gare. D'ailleurs, cette course de deux lieues ne l'effrayait pas plus que le chemin de traverse qu'il connaissait bien; le temps était doux, le soleil venait de se lever dans un ciel serein; après une nuit passée dans l'immobilité d'un wagon, ce serait une bonne promenade; sa valise à la main, il se mit en route d'un pas allègre.
Mais il ne continua pas longtemps cette allure, et sur le pont il s'arrêta pour regarder le Gave, grossi par la première fonte des neiges, rouler entre ses rives verdoyantes ses eaux froides qui fumaient par places sous les rayons obliques du soleil levant et pour écouter leur fracas torrentueux. Il venait de quitter les lilas de son jardin à peine bourgeonnants et il trouvait les osiers, les saules, les peupliers en pleine éclosion de feuilles, faisant au Gave une bordure vaporeuse au-dessus de laquelle s'élevaient les tours croulantes du vieux château de Bellocq. Que cela était frais, joli, gracieux, et, pour lui, troublant par l'évocation des souvenirs! Mais ce qui, tout autant que le bruit des eaux bouillonnantes, le bleu du ciel, la verdure des arbres, réveilla instantanément en lui les impressions de ses années de jeunesse, ce fut la vue d'un char qui arrivait à l'autre bout du pont: formé d'un tronc de sapin dont l'écorce n'avait même pas été enlevée, il était posé sur quatre roues avec des claies de coudrier pour ridelles; deux bœufs au pelage bringé, habillés de toile, encapuchonnés d'une résille bleue, le traînaient d'un pas lent, et devant eux marchait leur conducteur, la veste jetée sur l'épaule, une ceinture rouge serrée à la taille, les espadrilles aux pieds, un long aiguillon à la main; pour s'abriter du soleil il avait tiré en avant son béret qui formait ainsi visière au-dessus de ses yeux brillants dans son visage rasé de frais.
Que de fois avait-il ainsi marché devant ces attelages de bœufs, l'aiguillon à la main, à la grande indignation de son frère qui, n'aimant que la chasse, la pêche et les chevaux, l'accusait d'être un paysan!
Après un bonjour échangé, il se remit en marche, et, au lieu de continuer la grande route, prit le vieux chemin qui montait droit la colline.
Pour être géographiquement dans le midi et même dans l'extrême midi de la France, il n'en résulte pas que le Béarn soit roussi ou pelé, c'est au contraire le pays du vert, et d'un vert si frais, si intense, qu'en certains endroits on pourrait se croire en Normandie, n'était la chaleur du soleil, le bleu du ciel, la sérénité, la limpidité, la douceur de l'atmosphère; l'océan est près, les Pyrénées sont hautes, et, tandis que la montagne le défend des vents desséchants du sud, la mer lui envoie ses nuages qui, tombant sur une terre forte, y font pousser une vigoureuse végétation; dans les prairies l'herbe monte jusqu'au ventre du bétail; sur les collines, dans les touyas que les paysans routiniers s'obstinent à conserver en landes, les ajoncs, les bruyères et les fougères dépassent la tête des hommes; le long des chemins les haies sont épaisses et hautes.
De profondes ornières pleines d'eau coupaient celui qu'il avait pris, mais trop large de moitié, il offrait de chaque côté des tapis herbus qu'on pouvait suivre. De ce gazon, le printemps avait fait un jardin fleuri jusqu'au pied des haies où pâquerettes, primevères et renoncules se mêlaient aux scolopendres et aux tiges rousses de la fougère royale qui, au bord des petites mares et dans les fonds tourbeux, commençait déjà à pousser des jets vigoureux.
Quelle fête pour ses yeux que cette éclosion du printemps, si superbe dans cette humilité de petites plantes mouillées de rosée, et combien le léger parfum que dégageait leur floraison évoquait en lui de souvenirs restés vivants!
Ce fut en égrenant le chapelet de ces souvenirs qu'il continua son chemin jusqu'au haut de la montée. Déjà une fois il l'avait vu aussi fleuri dans une matinée pareille à celle-ci et il lui était resté dans les yeux tel qu'il le retrouvait.
A la suite d'une épidémie on avait licencié le collège, et le train venant de Pau les avait descendus à Puyoo à cette même heure, son frère et lui. Comme on n'était pas prévenu de leur retour, personne ne les attendait à la gare, et, au lieu de louer une voiture, ils s'étaient fait une joie de s'en aller bride abattue à travers champs pour surprendre leur père. Que de changements cependant, tandis que tout restait immuable dans ce coin de campagne, que de tristesses: son père, son frère morts, lui debout encore, mais secoué si violemment que c'était miracle qu'il n'eut pas le premier disparu. Combien à sa place se fussent abandonnés, et certainement il eût cédé aussi à la désespérance s'il n'avait pas lutté pour les siens. Le secours qui lui venait d'eux l'avait jusqu'au bout soutenu: un sourire, une caresse, un mot de sa fille, son regard, la musique de sa voix.
Au haut de la colline il s'arrêta, et, posant sa valise au pied d'un arbre, il s'assit sur le tronc d'un châtaignier qui attendait, couché dans l'herbe, que les chemins fussent assez durcis pour qu'on pût le descendre à la scierie.
De ce point culminant qu'un abattage fait dans les bois avait dénudé, la vue s'étendait libre sur les deux vallées, celle du Gave de Pau qu'il venait de quitter aussi bien que sur celle du Gave d'Oloron ou il allait descendre, et au-delà, par-dessus leurs villages, leurs prairies et leurs champs, sur un pays immense, de la chaîne des Pyrénées couronnée de neige aux plaines sombres des Landes qui se perdaient dans l'horizon.
Comme il n'avait pas mis plus d'une heure à la montée et qu'il ne lui faudrait que quarante ou cinquante minutes pour la descente, il pouvait, sans crainte de retard, se donner la satisfaction de rester là un moment à se reposer, en regardant le panorama étalé devant lui.
Tandis que la base des montagnes était encore noyée dans des vapeurs confuses, les sommets neigeux, frappés par le soleil, se découpaient assez nettement pour qu'il pût les reconnaître tous, depuis le pic d'Anie, qui avait donné son nom à sa fille, comme à toutes les aînées de la famille, jusqu'à la Rhune, dont le pied trempe dans la mer à Saint-Jean-de-Luz. En temps ordinaire il se serait amusé à distinguer chaque pic, chaque col, chaque passage, en se rappelant ses excursions et ses chasses; mais, en ce moment, ce qui le touchait plus que la chaîne des Pyrénées, si pleines de souvenirs et d'émotions qu'elle fût pour lui, c'était le village natal; aussi, quittant les croupes vertes qui de la montagne s'abaissent vers la plaine, chercha-t-il tout de suite le cours du Gave qui, en un long ruban blanc courant entre la verdure de ses rives, l'amenait à la maison paternelle: isolée au milieu du parc, il la retrouva telle qu'elle s'était si souvent dressée devant lui en ses mauvais jours, quand il pensait à elle instinctivement comme à un refuge, avec ses combles aux ardoises jaunies, ses hautes cheminées et sa longue façade blanche, coupée de chaînes rouges, mais aussi avec un changement qui lui serra le cœur; au lieu d'apercevoir toutes les persiennes ouvertes, il les vit toutes fermées, faisant à chaque étage des taches grises qui se répétaient d'une façon sinistre. Personne non plus au travail, ni dans les jardins, ni dans le parc, ni devant les écuries, les remises, les étables; pas de bêtes au pâturage dans les prairies, le long du Gave, ou dans les champs; certainement la roue de la pêcherie de saumon qui détachait sa grande carcasse noire sur la pâle verdure des saules ne tournait plus; partout le vide, le silence, et dans la vaste chambre du premier étage, celle où il était né, celle où son père était mort, son frère dormant son dernier sommeil.
Cette évocation qui le lui montrait comme si, par les persiennes ouvertes, il l'eût vu rigide sur son lit, l'étouffa, et tout se brouilla devant ses yeux pleins de larmes.
X
En entendant huit heures sonner à l'horloge de l'église lorsqu'il arrivait aux premières maisons du village, l'idée lui vint de passer d'abord chez le notaire Rébénacq; c'était un camarade de collège avec qui il causerait librement. Si Gaston avait fait un testament en faveur de son fils naturel, Rébénacq devait le savoir, et pouvait maintenant sans doute en faire connaître les dispositions.
Le caractère de son frère, porté à la rancune, d'autre part l'affection et les soins qu'il avait toujours eus pour ce jeune homme, tout donnait à croire que ce testament existait, mais enfin ce n'était pas une illusion d'héritier de s'imaginer que, tout en instituant son fils son légataire universel, il avait pu, il avait dû laisser quelque chose à Anie. En réalité, ce n'était point d'une fortune gagnée par son industrie personnelle et que son travail avait faite sienne, que Gaston jouissait et dont il pouvait disposer librement, sans devoir compte de ses intentions à personne, c'était une fortune patrimoniale, acquise par héritage, sur laquelle, par conséquent, ses héritiers naturels avaient certains droits, sinon légaux, au moins moraux. Or, Gaston avait un héritier légitime, qui était son frère, et s'il pouvait déshériter ce frère, ainsi que la loi le lui permettait, les raisons ne manquaient pas pour appuyer sa volonté et même la justifier: rancune, hostilité, persuasion que son legs, s'il en faisait un, serait gaspillé; mais aucune de ces raisons n'existait pour Anie, qui ne lui avait rien fait, contre laquelle il n'avait pas de griefs, et qui était sa nièce. Dans ces conditions, il semblait donc difficile d'imaginer qu'elle ne figurât pas sur ce testament pour une somme quelconque; si minime que fut cette somme, ce serait la fortune, et, mieux que la fortune, le moyen d'échapper aux mariages misérables auxquels elle s'était résignée.
Deux minutes après il s'arrêtait devant les panonceaux rouillés qui, sur le place, servaient d'enseigne au notariat, et dans l'étude où il entrait il trouvait un petit clerc en train de la balayer.
--C'est à M. Rébénacq que vous voulez parler? dit le gamin.
--Oui, mon garçon.
--Je vas le chercher.
Presqu'aussitôt le notaire arriva, mais au premier abord il ne reconnut pas son ancien camarade.
--Monsieur...
--Il faut que je me nomme?
--Toi!
--Changé, paraît-il?
--Comme tu n'as pas répondu à mes dépêches, je ne t'attendais plus; car je t'en ai envoyé deux et je t'ai écrit.
--C'est parce que je venais que je ne t'ai pas répondu; pouvais-tu penser que je laisserais disparaître mon pauvre Gaston sans un dernier adieu?
--Tu es venu à pied de Puyoo? dit le notaire sans répondre directement et en regardant la valise posée sur une chaise.
--Une promenade; les jambes sont toujours bonnes.
--Entrons dans mon cabinet.
Après l'avoir installé dans un vieux fauteuil en merisier, le notaire continua:
--Comment vas-tu? Et Mme Barincq? Et ta fille?
--Merci pour elles, nous allons bien. Mais parle-moi de Gaston; ta dépêche a été un coup de foudre.
--Sa mort en a été un pour nous. C'est il y a deux ans environ que sa santé, jusque-là excellente, commença à se déranger, mais sans qu'il résultât de ces dérangements un état qui présentât rien de grave, au moins pour lui, et pour nous. Il eut plusieurs anthrax qui guérirent naturellement, et pour lesquels il n'appela même pas le médecin, car c'était son système, de traiter, comme il le disait, les maladies par le mépris. Va-t-on s'inquiéter pour un clou? Cependant, il était moins solide, moins vigoureux, moins actif; un effort le fatiguait; il renonça à monter à cheval, et bientôt après il renonça même à sortir en voiture, se contentant de courtes promenades à pied dans les jardins et dans le parc. En même temps son caractère changea, tourna à la mélancolie et s'aigrit; il devint difficile, inquiet et méfiant. J'appelle ton attention sur ce point parce que nous aurons à y revenir. Un jour, il se plaignit d'une douleur violente dans la jambe et dut garder le lit. Il fallut bien appeler le médecin qui diagnostiqua un abcès interne qu'on traita par des cataplasmes, tout simplement. L'abcès guérit, et Gaston se releva, mais il se rétablit mal, l'appétit était perdu, le sommeil envolé. Pourtant, peu à peu, le mieux se produisit, et la santé parut revenir. Mais ce qui ne revint pas, ce fut l'égalité d'humeur.
--Avait-il des causes particulières de chagrin?
--Je le pense, et même j'en suis certain, bien qu'il ne m'ait jamais fait de confidences entières, pas plus à moi qu'à personne, d'ailleurs. Il m'honorait de sa confiance pour tout ce qui était affaires, mais pour ses sentiments personnels il a toujours été secret, et en ces derniers temps plus que jamais; il est vrai qu'un notaire n'est pas un confesseur. Mais nous reviendrons là-dessus; j'achève ce qui se rapporte à la santé et à la mort. Je t'ai dit que l'état général paraissait s'améliorer, avec le printemps il avait repris goût à la promenade, et chaque jour il sortait, ce qui donnait à espérer que bientôt il reprendrait sa vie d'autrefois; à son âge cela n'avait rien d'invraisemblable. Les choses en étaient là lorsqu'avant-hier Stanislas, le cocher, se précipite dans ce cabinet et m'annonce que son maître vient de se trouver mal; il est décoloré, sans mouvement, sans parole; on ne peut pas le faire revenir. Je cours au château. Tout est inutile. Cependant, j'envoie chercher le médecin, qui ne peut que constater la mort causée par une embolie; un caillot formé au moment de la poussée des anthrax ou de la formation de l'abcès de la jambe a été entraîné dans la circulation et a obstrué une artère.
--La mort a été foudroyante?
--Absolument.
Il s'établit un moment de silence, et le notaire, ému lui-même par son récit, ne fit rien pour distraire la douleur de son ancien camarade, qu'il voyait profonde; enfin il reprit:
--Je t'ai dit que Gaston s'était montré en ces dernières années triste et sombre; je dois revenir là-dessus, car ce point est pour toi d'un intérêt capital; mais, quel que soit mon désir de l'éclaircir, je ne le pourrai pas, attendu que pour beaucoup de choses j'en suis réduit à des hypothèses, et que tous les raisonnements du monde ne valent pas des faits; or, les faits précis me manquent. Bien que, comme je te l'ai dit, Gaston ne m'ait jamais fait de franches confidences, les causes de son chagrin et de son inquiétude ne sont pas douteuses pour moi: elles provenaient pour une part de votre rupture, pour une autre d'un doute qui a empoisonné sa vie.
--Un doute?
--Celui qui portait sur la question de savoir s'il était ou n'était pas le père du capitaine Sixte.
--Comment...
--Nous allons arriver au capitaine tout à l'heure; vidons d'abord ce qui te regarde. Si tu as été affecté de la rupture avec ton frère, lui n'en a pas moins souffert, et peut-être même plus encore que toi, attendu que, tandis que tu étais passif, il était actif; tu ne pouvais que supporter cette rupture, lui pouvait la faire cesser, n'ayant qu'un mot à dire pour cela, et luttant par conséquent pour savoir s'il le dirait ou ne le dirait pas; j'ai été le témoin de ces luttes; je puis t'affirmer qu'il en était très malheureux; positivement, elles ont été le tourment de ses dernières années.
--Nous nous étions si tendrement aimés.
--Et il t'aimait toujours.
--Comment ne s'est-il pas laissé toucher par mes lettres?
--C'est qu'à ce moment il payait les intérêts de la somme dont il avait répondu pour toi, et que l'ennui de cette dépense le maintenait dans son état d'exaspération et son ressentiment.
--Dans sa position, cette dépense était cependant peu de chose.
--Il faut que tu saches, et je peux le dire maintenant, que précisément, lorsque les échéances des intérêts de la garantie arrivèrent, Gaston venait de perdre une grosse somme dans un cercle à Pau, qu'il ne put payer qu'en l'empruntant. Cela embrouilla ses affaires; il se trouva gêné. Il le fut bien plus encore quand, par suite du phylloxéra d'abord et du mildew ensuite, le produit de ses vignes fut réduit à néant. Un autre à sa place eût sans doute essayé de combattre ces maladies; lui, ne le voulut pas; c'était des dépenses qu'il prétendait ne pas pouvoir entreprendre, et cela par ta faute, disait-il. La vérité est qu'il ne croyait pas à l'efficacité des remèdes employés ailleurs, et que, par apathie, obstination, il laissait aller les choses; et, en attendant que le hasard amenât un changement, il rejetait la responsabilité de son inertie sur ceux qui le condamnaient à se croiser les bras. C'est ainsi que toutes ses vignes sont perdues, et que celles qui n'ont point été arrachées, n'ayant reçu aucune façon depuis longtemps, sont devenues des touyas ou ne poussent que des mauvaises herbes et des broussailles. Vois-tu maintenant la situation et comprends-tu la force de ses griefs?
--Hélas!
--Comme, malgré tout, il ne pouvait pas, avec ses revenus, rester toujours dans la gêne, il arriva un moment où les économies qu'il faisait quand même lui permirent de rembourser et la somme qu'il avait garantie pour toi et celle qu'il avait empruntée pour payer sa dette de jeu. J'attendais ce moment avec une certaine confiance, espérant que, quand ton souvenir ne serait plus rappelé à ton frère par des échéances, un rapprochement se produirait; comme il n'aurait plus de griefs contre toi, votre vieille amitié renaîtrait; et je crois encore qu'il en eût été ainsi, si Gaston, isolé, n'avait pu trouver d'affection que de ton côté et du côté de ta fille; mais alors, précisément, quelqu'un se plaça entre vous qui empêcha ce retour: ce quelqu'un, c'est le capitaine Valentin Sixte. Je t'avais dit que j'arriverais à lui, nous y sommes.
--Je t'écoute.
--Le capitaine est-il ou n'est-il pas le fils de ton frère? c'est la question que je me pose encore, bien que pour tout le monde, à peu près, elle soit résolue dans le sens de l'affirmative; mais, comme elle ne l'était pas pour Gaston, qui devait avoir cependant sur ce point des clartés qui nous manquent, et des raisons pour croire à sa paternité, tu me permettras de rester dans le doute. D'ailleurs tu en sais peut-être autant que moi là-dessus, puisqu'à la naissance de l'enfant, tu étais dans les meilleurs termes avec ton frère.
--Il ne m'a rien dit alors de Mlle Dufourcq; et plus tard je n'en ai appris que ce que tout le monde disait; deux ou trois fois j'ai essayé d'en parler à Gaston, qui détourna la conversation comme si elle lui était pénible.
--Elle l'était, en effet, pour lui, par cela même qu'elle le ramenait à un doute qui jusqu'à sa mort l'a tourmenté, et même plus que tourmenté, angoissé, désespéré. C'est il y a trente-et-un-ans que Gaston fit la connaissance des demoiselles Dufourcq qui demeuraient à deux kilomètres environ de Peyrehorade au haut de la côte, à l'endroit où la route de Dax arrive sur le plateau. Là se trouvait autrefois une auberge tenue par le père et la mère Dufourcq; à la mort de leurs parents, les deux filles, qui étaient intelligentes et qui avaient reçu une certaine instruction, eurent le flair de comprendre le parti qu'elles pouvaient tirer de leur héritage en transformant l'auberge en une maison de location pour les malades qui voudraient jouir du climat de Pau, en pleine campagne et non dans une ville. Tu connais l'endroit.
--Je me rappelle même la vieille auberge.
--Tu vois donc que la situation est excellente, avec une étendue de vue superbe; ce fut ce qui attira les étrangers, et aussi la transformation que ces deux filles avisées firent subir à la vieille auberge, devenue par elles une maison confortable avec bon mobilier, jardins agréables, cuisine excellente, et le reste. De l'une de ces filles, l'aînée, Clotilde, il n'y a rien à dire, c'était une personne qui ne se faisait pas remarquer et ne s'occupait que de sa maison; de la jeune Léontine il y a beaucoup à dire, au contraire; jolie, coquette, mais jolie d'une beauté à faire sensation, et coquette à ne repousser aucun hommage. Ton frère la connut en allant voir un de ses amis établi chez les sœurs Dufourcq pour soigner sa femme poitrinaire, et il devint amoureux d'elle. Tu penses bien qu'une fille de ce caractère n'allait pas tenir à distance un homme tel que M. de Saint-Christeau. Quelle gloire pour elle de le compter parmi ses soupirants! Ils s'aimèrent; tous les deux jours Gaston faisait trente kilomètres pour aller prendre des nouvelles de la femme de son ami. Où cet amour pouvait-il aboutir? Léontine Dufourcq s'imagina-t-elle qu'elle pouvait devenir un jour la femme de M. de Saint-Christeau? C'était bien gros pour une fille de sa condition. De son côté Gaston dominé par sa passion promit-il le mariage pour l'emporter sur un jeune Anglais, fort riche et malade, qui, habitant la maison, proposait, dit-on, à Léontine de l'épouser. C'est ce que j'ignore, car je n'ai appris toute cette histoire que par bribes, un peu par celui-ci, un peu par celui-là, c'est-à-dire d'une façon contradictoire. Ce qu'il y a de certain, c'est que Léontine devint enceinte. Pourquoi à ce moment Gaston ne l'épousa-t-il pas? Probablement parce qu'il désespéra d'obtenir un consentement, qu'il n'aurait même pas osé demander. Vois-tu la fureur de votre père, en apprenant que son aîné voulait épouser la fille d'un aubergiste?
--Notre père n'aurait jamais donné ce consentement; il aurait plutôt rompu avec Gaston, malgré toute sa tendresse, toute sa faiblesse pour son aîné.
--On n'en vint pas à cette extrémité, et si votre père connut la liaison de son fils avec Léontine, il ne crut certainement qu'à une amourette sans conséquence. D'ailleurs, avant que la grossesse fût apparente, Léontine quitta Peyrehorade pour aller habiter Bordeaux, où elle se cacha; on dit dans le pays qu'elle était auprès d'une sœur aînée, mariée en Champagne. Chaque semaine Gaston fit le voyage de Bordeaux: à Royan on les rencontra ensemble. En même temps qu'elle quittait Peyrehorade, le jeune Anglais, qui s'appelait Arthur Burn, partait aussi; on a raconté qu'on les avait vus lui et elle à Bordeaux; est-ce vrai, est-ce faux? je l'ignore: mais tout me paraît croyable avec une femme coquette comme celle-là; si elle n'épousait pas Gaston qu'elle devait, semblait-il, préférer, elle retrouverait son Anglais; condamné à une mort prochaine, celui-là était à ménager. Chose extraordinaire, ce ne fut pas le malade qui mourut, ce fut la belle fille, saine et forte: un mois après l'accouchement, elle fut emportée tout d'un coup. L'enfant n'avait pas été reconnu par Gaston qui, sans doute, voulait le légitimer par mariage subséquent quand il le pourrait faire. La tante Clotilde le prit avec elle à Peyrehorade et l'éleva comme son neveu en le disant fils de sa sœur aînée, la Champenoise. Des années s'écoulèrent sur lesquelles je ne sais rien, si ce n'est que Gaston allait voir l'enfant quelquefois chez sa tante, et que, quand le moment arriva de le mettre au collège à Pau, il paya sa pension. Il se montra élève appliqué, studieux, intelligent, et il entra à Saint-Cyr dans les bons numéros. Ce fut en costume de Saint-Cyrien que, pour la première fois, il vint au château où il passa une partie de ses vacances à pêcher, à chasser, à galoper. Pour ceux qui n'avaient pas oublié les amours avec Léontine, ce séjour fut le commencement de la reconnaissance du fils par le père, car pour tout le monde Valentin était bien le fils de Gaston; personne ne doutait de cette paternité, et moi-même qui jusque-là m'étais tenu sur la réserve...
--Avais-tu des raisons pour la justifier?
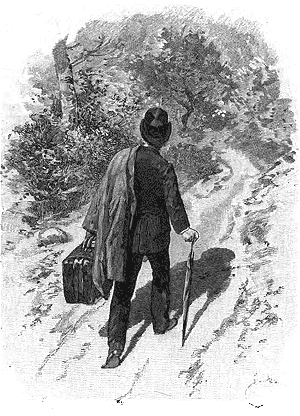
--Pas d'autres que celles qui résultaient de la non-reconnaissance par Gaston; mais pour moi celles-là étaient d'un grand poids, car, avec un homme du caractère de ton frère, il me paraissait impossible d'admettre que, croyant ce garçon son fils, il ne lui donnât pas son nom; s'il ne le faisait pas, c'est qu'il en était empêché; et, comme il ne dépendait plus de personne, ce ne pouvait être que par un doute basé sur les relations qui avaient existé entre Léontine et Arthur Burn. Quelles avaient été au juste ces relations? Innocentes ou coupables? Bien malin qui pouvait le dire après vingt ans, alors que l'un et l'autre avaient emporté leur secret. En tous cas Gaston n'osait pas se prononcer puisqu'il ne reconnaissait pas ce fils, à ses yeux, douteux. S'intéresser, s'attacher à lui, cela il le pouvait, et le jeune homme, je dois le dire, justifiait cet intérêt; mais le reconnaître, lui donner son nom, en faire l'héritier, le continuateur des Saint-Christeau, cela il ne l'osait pas. J'ai vu ses scrupules, ou plutôt je les ai devinés; j'ai assisté à ses luttes de conscience alors qu'il était partagé entre deux devoirs également puissants sur lui: d'une part, celui qu'il croyait avoir envers ce jeune homme; d'autre part, celui qui le liait à son nom, et je t'assure qu'elles ont été vives.
--N'a-t-il pas fait des recherchés, une enquête?
--Après vingt ans! Sur un pareil sujet! Il est certain cependant qu'il a dû recueillir tous les renseignements qui pouvaient l'éclairer. Mais il est certain aussi qu'ils n'ont pas été assez probants puisque la reconnaissance n'a pas eu lieu. Les choses continuèrent ainsi sans que ma femme et moi nous osions décider qu'elle se ferait ou ne se ferait pas; penchant tantôt pour la négative, tantôt pour l'affirmative. Valentin, en quittant Saint-Cyr, devint officier de dragons et entra plus tard à l'École de guerre d'où il sortit le troisième. Gaston, fier de lui, avait son nom sans cesse sur les lèvres, et, toutes les fois que Valentin obtenait un congé, il venait le passer au château; un père n'eût pas été plus tendre pour son fils; un fils plus affectueux pour son père. Cependant ce fut à ce moment même que j'acquis la certitude que jamais Gaston ne le reconnaîtrait, et voici comment elle se forma dans mon esprit. Tu me trouves sans doute bien décousu, bien incohérent?
--Je te trouve d'une lucidité parfaite.
--Alors je continue. Un jour Gaston me chargea de lui dresser un modèle de testament qu'il copierait. Si réservé que je dusse être avec un client défiant qui avait toujours peur qu'on l'amenât à dire ce qu'il voulait tenir secret, je fus cependant obligé de lui adresser quelques questions. Il me répondit évasivement en se tenant dans des généralités, si bien qu'au lieu d'un seul modèle je lui en fis quatre ou cinq, répondant aux divers cas qui, me semblait-il, pouvaient se présenter pour lui. Quatre jours après, il m'apporta son testament dans une enveloppe scellée de cinq cachets et me demanda de le garder.
--Alors, il a fait un testament?
--Il en a fait un à ce moment; mais, il y a un mois, il me l'a repris pour le modifier, peut-être même pour le détruire, et je ne sais pas s'il en a fait un autre; ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis dépositaire d'aucun, de sorte qu'aujourd'hui tu es le seul héritier légitime de ton frère; ce qui ne veut pas dire, tu dois le comprendre, que tu recueilleras cet héritage.
--Je comprends qu'on peut trouver un testament dans les papiers de Gaston.
--Parfaitement. Cela dit, je remonte à la conviction qui s'est établie en moi que Gaston ne reconnaîtrait pas le capitaine, le jour même où il m'a demandé un modèle de testament. Et cette conviction est, il me semble, basée sur la logique. Tu sais, n'est-ce pas, que l'enfant naturel reconnu n'a pas sur les biens de son père les mêmes droits que l'enfant légitime? dans l'espèce, le capitaine, fils légitime de Gaston, hérite de la totalité de la fortune de son père, fils naturel reconnu il n'hérite que de la moitié de cette fortune, puisque ce père laisse un frère qui est toi. Pour qu'il recueille cette fortune entière, il faut qu'elle lui soit léguée par testament, et ce testament n'est possible en sa faveur que s'il est un étranger et non un enfant naturel reconnu.
--Je ne savais pas cela du tout.
--N'en sois pas surpris; quand la loi s'occupe des enfants naturels, adultérins ou incestueux, elle est pleine d'obscurité, de lacunes, de trous ou de traquenards, au milieu desquels ceux dont c'est le métier d'interpréter le Code ont souvent bien du mal à se débrouiller. Donc, selon moi, ton frère, faisant son testament, renonçait à reconnaître le capitaine pour son fils.
--Et la conclusion de ton raisonnement était que le désir de laisser toute sa fortune au capitaine le guidait.
--En effet, la logique conduisait à cette conclusion.
--Soupçonnes-tu les raisons pour lesquelles il t'a repris son testament?
--Elles sont de plusieurs sortes, mais les unes comme les autres ne reposent que sur des hypothèses.
--Puisque tu les as examinées, trouves-tu quelque inconvénient à me les dire?
--Nullement.
--Tu admets, n'est-ce pas? qu'elles nous intéressent assez pour que je te les demande?
--Je crois bien.
--Depuis longtemps j'étais habitué à l'idée que Gaston laisserait sa fortune au capitaine, mais ce que tu viens de m'apprendre me montre que les choses ne sont pas telles que je les imaginais, notamment pour la paternité, que je croyais certaine; les conditions sont donc changées.
--Après avoir été trop loin dans un sens, ne va pas trop vite maintenant dans un sens opposé.
--Je n'irai que jusqu'où tu me diras d'aller. La fortune m'a été trop dure pour que je me laisse emballer; et je puis t'affirmer, avec une entière sincérité, qu'en ce moment même je suis plus profondément ému par le chagrin que me cause la mort de Gaston, que je ne suis troublé par la pensée de son héritage. Certainement je ne suis pas indifférent à cet héritage, sur lequel j'ai bien quelques droits, quand ce ne serait que ceux auxquels j'ai renoncé, mais enfin je suis frère beaucoup plus qu'héritier; fais-moi l'honneur de le croire.
--C'est justement sur ces droits dont tu parles que repose une des hypothèses auxquelles je suis arrivé, quand je me suis demandé pourquoi Gaston me reprenait son testament. Je puis te dire que depuis votre rupture je ne suis pas resté sans parler de toi avec ton frère. Dans les premières années cela était difficile, je t'ai expliqué pourquoi: colère encore vivante, rancune exaspérée par les embarras d'argent, échéances des sommes à payer. Mais quand tout a été payé, quand le souvenir des embarras d'argent s'est effacé, ton nom n'a plus produit le même effet d'exaspération, j'ai pu le prononcer, ainsi que celui de ta fille, et représenter incidemment, sans appuyer, bien entendu, qu'il serait fâcheux qu'elle ne pût pas se marier uniquement parce qu'elle n'avait pas de dot.
--Tu as agi en ami, et je t'en remercie de tout cœur.
--En honnête homme, en honnête notaire qui doit éclairer ses clients, même lorsqu'ils ne lui demandent pas, et les guider dans la bonne voie, vers le vrai et le juste. Or pour moi la justice voulait que vous ne fussiez pas entièrement frustrés d'un héritage sur lequel vous aviez des droits incontestables. Est-ce pour modifier son testament dans ce sens que Gaston me l'a repris? Cela est possible.
--Évidemment.
--Sans doute; et j'aime d'autant plus à m'arrêter à cette hypothèse qu'elle est consolante, et que sa réalisation serait honorable pour la mémoire de ton frère en même temps qu'elle vous serait favorable. Mais il faut bien se dire qu'elle n'est pas la seule. Si ton frère a voulu modifier son testament, qui sous sa première forme n'était pas en ta faveur, je le crains, et y ajouter de nouvelles dispositions pour te donner à toi ou à ta fille ce qu'il vous devait, il peut aussi l'avoir modifié dans un sens tout opposé, comme il peut aussi l'avoir tout simplement supprimé.
--Y a-t-il dans ses relations avec le capitaine quelque chose qui puisse te faire croire à cette suppression?
--Rien du tout, et même je dois dire que ces relations sont devenues plus suivies qu'elles n'étaient, quand Sixte a été nommé officier d'ordonnance du général Harraca qui commande à Bayonne, ce qui lui a permis de venir à Ourteau très souvent; j'ajoute encore que ce choix a été inspiré par Gaston qui avait été l'ami du général.
(A suivre)
Hector Malot.
