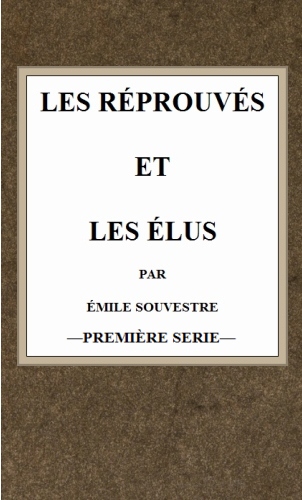
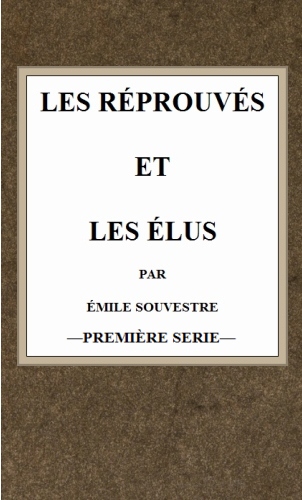
COLLECTION MICHEL LÉVY
ŒUVRES COMPLÈTES
D’ÉMILE SOUVESTRE
| Format grand in-18 | |
| ——— | |
| AU BORD DU LAC | 1 vol. |
| AU COIN DU FEU | 1 — |
| CHRONIQUES DE LA MER | 1 — |
| CONFESSIONS D’UN OUVRIER | 1 — |
| DANS LA PRAIRIE | 1 — |
| EN QUARANTAINE | 1 — |
| HISTOIRES D’AUTREFOIS | 1 — |
| LE FOYER BRETON | 2 — |
| LES CLAIRIÈRES | 1 — |
| LES DERNIERS BRETONS | 2 — |
| LES DERNIERS PAYSANS | 1 — |
| DEUX MISÈRES | 1 — |
| CONTES ET NOUVELLES | 1 — |
| PENDANT LA MOISSON | 1 — |
| SCÈNES DE LA CHOUANNERIE | 1 — |
| SCÈNES DE LA VIE INTIME | 1 — |
| SOUS LES FILETS | 1 — |
| SOUS LA TONNELLE | 1 — |
| UN PHILOSOPHE SOUS LES TOITS | 1 — |
| EN FAMILLE | 1 — |
| RÉCITS ET SOUVENIRS | 1 — |
| SUR LA PELOUSE | 1 — |
| LES SOIRÉES DE MEUDON | 1 — |
| SOUVENIRS D’UN VIEILLARD | 1 — |
| SCÈNES ET RÉCITS DES ALPES | 1 — |
| LA GOUTTE D’EAU | 1 — |
| LES RÉPROUVÉS-ET LES ÉLUS | 2 — |
| LES PÉCHÉS DE JEUNESSE | 1 — |
| LES ANGES DU FOYER | 1 — |
| RICHE ET PAUVRE | 1 — |
| L’ÉCHELLE DE FEMMES | 1 — |
| PIERRE ET JEAN | 1 — |
| LES DRAMES PARISIENS | 1 — |
| DEUX MISÈRES | 1 — |
| POISSY.—Typographie ARBIEU. |
PAR
ÉMILE SOUVESTRE
—PREMIÈRE SERIE—
PARIS
MICHEL LEVY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE VIVIENNE, 2 BIS
——
1859
Reproduction et traduction réservées.
Il y a un pays, en France, où la raison humaine n’a pas encore revêtu la robe des docteurs, où les hommes sont restés des enfants que l’on adoucit avec des chansons et que l’on instruit avec des histoires. Là, l’enseignement du bien n’a point été réduit à une algèbre sociale que l’on apprend par article; il flotte dans l’air avec les guerz des laboureurs armoricains; il court de collines en collines, avec les sônes dialogués des jeunes pâtres; il s’asseoit aux foyers des cabanes avec les récits des discrévellerrs. Aux symboles de la vieille sagesse viennent, chaque jour, s’ajouter les symboles de la sagesse moderne; et, ces leçons vivantes, nées sur le même sol, de la même inspiration populaire, se maintiennent, l’une près de l’autre, sans contradictions, sans luttes, comme on voit le jeune enfant, l’homme fait et le vieillard former, au foyer commun, une seule famille.
Or, j’avais déjà recueilli un grand nombre de ces traditions, lorsqu’un soir, j’en entendis raconter une qui m’était complètement inconnue.
Le discrévellerr était un kloarek[A] à l’air pensif, qui avait habité les villes assez longtemps pour avoir entendu, de près, le nouvel orage qui gronde à tous les horizons. Il savait, sans doute, de quels maux se plaint notre époque, et attendait, comme tant d’autres, la bonne nouvelle. Mais cette préoccupation se cachait chez lui sous les formes transmises par les pères.
Après avoir fait le signe de la croix, selon la coutume des chrétiens, il raconta donc ce qui suit:
Un jour que le Christ était assis sur son trône de lumière, tout triste à la pensée des hommes, voilà que l’ange noir et blanc parut à la porte de son paradis, conduisant de nouveaux morts qui venaient pour se faire juger.
—Que m’amènes-tu là, esprit ailé? demanda le Christ.
—Maître, ce sont les épis que la mort a aujourd’hui moissonnés pour toi, répondit l’ange noir et blanc. J’en ai fait deux gerbes, d’après leur apparence et le jugement de la terre. De ce côté, sont ceux qui ont été déclarés les élus par la justice humaine; de l’autre, ceux qu’elle a appelés réprouvés. Vois maintenant toi-même, ô Christ, et décide selon la vérité.
Jésus descendit alors de son trône, et l’ange lui montra, l’un après l’autre, les morts de chaque bande.
Il y avait parmi les élus de sages pères de famille qui s’étaient fait estimer par les prêtres et par les juges; des seigneurs qui étaient morts grandement honorés; des dames nobles, belles et connues pour leurs aumônes; des marchands enrichis par l’économie et le travail.
De l’autre côté, au rang des réprouvés, se trouvaient des filles portant sur leurs bras des enfants dont elles n’osaient nommer les pères; des hommes condamnés, à bon droit, par la justice humaine; des gens qui avaient mangé leur patrimoine en projets insensés; des femmes coupables que l’on avait lapidées, non avec les pierres du chemin, comme les Juifs, mais avec les injures et les mépris.
Jésus regarda longtemps la bande des réprouvés et celle des élus; puis se tournant vers l’ange, il lui dit:
—Le monde n’aime pas le bien du fond du cœur; mais il s’aime lui-même sans mesure. Tout ce qui le dérange est le mal, et il ne veut point se demander s’il est lui-même, de son côté, ce qu’il devrait être. Pour lui, les coupables ne sont pas ceux qui sont méchants, mais ceux qui sont autrement qu’il ne l’a permis. Il ne cherche ni la cause des fautes ni les remèdes qui pourraient guérir les hommes; il ressemble enfin au mauvais père qui transmettrait à ses fils des infirmités et qui les punirait ensuite parce qu’ils sont faibles et malsains.
Après avoir ainsi parlé, le Christ fit sortir de leurs rangs un certain nombre de réprouvés et un certain nombre d’élus; il les toucha du doigt, et l’ange vit avec étonnement que dans le cœur de beaucoup d’élus se tordait un serpent, tandis que dans celui de beaucoup de réprouvés brillait une étoile.
Alors Jésus lui dit:
—Chacun de ces serpents est un vice secret qui a empoisonné toutes les actions de ceux-ci, et chacune de ces étoiles est un amour caché qui a racheté les fautes de ceux-là. Ne crois donc plus aux jugements du monde, car il ne s’arrête qu’aux apparences; mais, quand tu redescendras sur la terre, efforce-toi de faire connaître, par tous les moyens et à tous, que là sont les véritables élus et là les véritables réprouvés.
Telle fut la légende du kloarek, et elle me laissa un profond souvenir. Bien des fois, depuis, je pensai à ces deux bandes de morts jugées par le Christ, et bien des fois l’idée me vint de les faire revivre. Cette tâche longtemps différée, je la tente enfin aujourd’hui; seulement, je me suis rappelé les recommandations de Jésus, demandant que l’on réformât les jugements de la terre, et j’ai tâché de laisser voir le serpent au cœur de ses élus et l’étoile au cœur de ses réprouvés.
On a déjà remarqué bien des fois que chaque ville a, comme chaque homme, sa physionomie individuelle et facile à reconnaître. Ainsi, sans parler des apparences tranchées du port de mer, où tout sent le goudron, de la ville frontière cerclée de murailles et bardée de canons, de la cité manufacturière hérissée de cheminées gigantesques et toujours enveloppée d’un nuage de fumée, il y a des villes d’étude, comme Rennes et Montpellier, où l’herbe perce les pavés, et dont les vastes places ne sont traversées que par des magistrats en toge ou par des professeurs en simarre; il y a les villes historiques, comme Arles, Orléans, Fontainebleau, où l’on vous montre les arènes antiques, la maison de Jeanne d’Arc et la table sur laquelle Napoléon signa son abdication; il y a les villes à légendes, comme Strasbourg, dont la vie se confond avec celle de sa cathédrale; les villes poétiques, comme Toulouse, Dijon, Avignon; les villes royales, comme Versailles. Puis viennent celles dont le caractère extérieur ne doit rien au passé, mais à je ne sais quel hasard pittoresque du ciel ou du site; celle-ci agreste, celle-là mondaine, l’une coquette, l’autre négligée.
Or, parmi la variété infinie de ces dernières physionomies, nous en connaissons une qui mérite d’être spécialement mentionnée, c’est celle de Château-Lavallière.
Château-Lavallière, qui ne peut passer précisément pour un bourg, n’est point non plus tout à fait une ville. C’est ce que les provinciaux, qui ne se piquent point de beau langage, appellent un endroit. Placé sur les limites d’Indre-et-Loire, entre les départements de Loir-et-Cher, de la Sarthe et de Maine-et-Loire, éloigné de toutes les grandes voies de communication et caché, comme un nid, au milieu de sa forêt, Château-Lavallière a, dans son aspect, quelque chose de mystérieux et, pour ainsi dire, de romanesque. A voir ses rues désertes, sur lesquelles s’ouvrent des portes basses et dérobées, ses jardins enveloppés de murs qu’aucune claire-voie n’interrompt, ses maisons précédées d’une cour fermée, qui les voile, ses fenêtres aux rideaux élégants mais toujours rabattus, on dirait un de ces asiles où vont se cacher les douleurs sans remèdes, les joies solitaires et les amours menacées. Sur quelque toit que l’œil se repose, on reconnaît la retraite où l’on eût voulu se renfermer à vingt ans, avec quelque femme adorée, dont on a oublié le nom. Derrière chaque jardin s’étend la forêt, promenade ouverte aux longs tête-à-tête et aux longues rêveries; plus bas un étang bordé de glaïeuls baigne les pieds de la colline. Les bruits de la ville sont couverts par le murmure du vent dans les arbres et par les chants des oiseaux. De loin en loin seulement, un froissement de roues effleure le pavé; une calèche qui passe à demi-fermée laisse apercevoir un voile flottant, une main gantée, puis tout disparaît rapidement sous les immenses avenues!
Tel on voit aujourd’hui Château-Lavallière, tel on le voyait en 1819, époque à laquelle commence notre récit.
On se trouvait à la fin du mois de septembre; le jour touchait à son déclin, et le soleil couchant jetait des lueurs d’incendie à travers les feuillages de la futaie.
Sur la lisière même de celle-ci existait alors une habitation isolée, à laquelle ses portes et ses persiennes, peintes de la couleur qu’affectionnait tant Rousseau, avaient fait donner le nom de maison verte. Bâtie entre cour et jardin, comme la plupart des demeures bourgeoises de Château-Lavallière, elle avait, dans son extérieur, quelque chose de plus mystérieux encore et de plus fermé que les maisons voisines. Mais si du dehors ses murailles garnies de verre brisé, sa porte à guichet grillé et sa cloche à chaîne de fer lui donnaient l’apparence d’un couvent ou d’une prison, à l’intérieur cette physionomie disparaissait complétement, grâce à l’élégance du logis et à la gaieté de ses abords.
La cour sur laquelle donnait la façade, avait été transformée en parterre, garni de plantes rares, et les murs eux-mêmes, cachés sous les chèvrefeuilles, les jasmins et les vignes vierges, ressemblaient à des massifs de verdure. Vis-à-vis du perron, une coupe de marbre s’élevait au milieu d’une touffe de roseaux et laissait déborder ses eaux dans un bassin où nageaient quelques poissons dorés, tandis qu’un peu plus loin, un petit hamac d’aloès suspendu à deux lilas, se balançait doucement aux mouvements de la brise. Des jouets d’enfants étaient éparpillés, de tous côtés, sur le sable des allées, parmi l’herbe fine des pelouses et le long des degrés qui conduisaient à la maison.
Cet ensemble d’une prodigalité luxueuse et fleurie servait, pour ainsi dire, de cadre à un groupe placé au milieu même d’un parterre, et dont les personnages méritent un examen détaillé.
La première figure qui frappait était celle d’une femme encore jeune, assise sur un fauteuil de bambous, dans l’attitude affaissée d’une personne malade. Bien qu’on ne pût la dire belle, ses traits avaient une expression de douceur qu’illuminait par instants une certaine flamme du regard. Celui-ci s’animait surtout lorsqu’il s’abaissait vers une enfant assise plus bas sur les genoux d’une jeune paysanne.
C’était une petite fille d’environ trois ans, mais dont les traits chétifs et pâles annonçaient une de ces enfances étiolées qui ne peuvent éclore à la vie. A demi-renversée sur le sein de sa nourrice, elle agitait languissamment les grelots d’un hochet qu’elle laissait retomber à chaque instant avec un cri de souffrance ennuyée. Quoique l’air fût tiède et qu’aucun souffle n’agitât les feuilles les plus frêles, elle était enveloppée d’une pelisse de satin, doublée de peau de cygne, et portait un bonnet de velours grenat qui laissait paraître à peine quelques touffes de cheveux, d’un blond inanimé. Ses pieds, chaussés de brodequins fourrés, pendaient sur l’herbe, sans force et sans mouvement.
Quant au quatrième personnage, il avait quarante ans. Vêtu d’une redingote noire boutonnée jusqu’à la cravate, et les yeux cachés par une paire de lunettes à doubles verres, il tenait à la main une cravache de cuir, dont il effleurait des bottes poudreuses et garnies d’éperons. Malgré le sourire constant qui flottait sur son visage, un disciple de Lavater eût étudié avec quelque défiance ces lèvres serrées que le maître signale comme l’indication d’une avarice tenace, et les partisans de Gall se fussent presque effrayés de ce crâne triangulaire dont la forme rappelait celle des animaux les moins nobles et les plus amoureux du sang.
Mais, quelle que pût être l’impression scientifique produite par l’examen des traits et du crâne de M. Vorel, le plus rigide observateur l’eût difficilement conservée en l’entendant parler. Sa voix avait une simplicité calme, également éloignée de la brusquerie et de l’affectation doucereuse. Semblable à certains chanteurs, dont le timbre garde une expression émouvante sans qu’ils soient émus, le docteur avait, dans l’accent, une justesse et une franchise pour ainsi dire involontaires, et, même en trompant, il conservait cette voix loyale qui déroutait toutes les préventions; c’était chez lui plus que du calcul, plus que de l’adresse; il avait reçu, en naissant, le don du mensonge.
Du reste, la première partie de sa vie avait été cruellement traversée. Sans nom, sans fortune, sans protecteurs, il n’était parvenu à acquérir une profession qu’à force de travail et d’humilité. Nature dominatrice, il s’était plié à toutes les volontés de ceux qui pouvaient le servir; esprit hardi, il avait coupé les ailes de son audace pour l’obliger à ramper! Cette transformation forcée, en tuant tout ce qu’il pouvait garder d’instinct heureux, avait, pour ainsi dire, envenimé ses vices! Ce qu’il y avait en lui de dur était devenu méchant; son désir de posséder s’était tourné en avarice insatiable, son insensibilité en malveillance. Entravé et meurtri par les hommes dès ses premiers pas, il s’était mis à les haïr, non de cette haine ouverte qui suppose encore la liberté, mais d’une haine sourde, cauteleuse, enchaînée, qui se contient par calcul et consent à l’attente, dans l’intérêt de sa sûreté.
Établi d’abord à Trévières, en Normandie, il y avait fait la connaissance d’une riche propriétaire campagnarde connue dans le pays sous le nom de la mère Louis. La mère Louis, dont le mari, d’abord meunier, avait acquis une énorme fortune par l’achat des biens nationaux, était depuis longtemps veuve, et faisait valoir elle-même le grand domaine des Motteux: c’était une femme violente, égoïste, aux façons grossières, mais dont on citait quelques bonnes actions, qui servaient d’excuse aux mauvaises. Elle y avait bien reçu le jeune docteur, parce qu’il lui donnait des recettes pour ses rhumatismes, et qu’il soignait gratuitement ses bestiaux malades. Celui-ci en profita pour s’insinuer dans les bonnes grâces de la fille de la maison, et pour la demander en mariage. La propriétaire des Motteux, comme on devait s’y attendre, rejeta de bien loin une pareille prétention; mais Vorel détermina la fille à passer outre, au moyen d’un de ces actes que le législateur a si plaisamment appelés des soumissions respectueuses. Le mariage eut lieu malgré la mère Louis, qui fut, en outre, obligée de payer environ cent mille écus qui revenaient à la jeune mariée du chef de son père. Cette dernière circonstance souleva contre M. Vorel tous les parents qui avaient des comptes à rendre à leurs filles, et il s’ensuivit une espèce de réprobation qui décida le médecin à quitter Trévières pour se rendre en Touraine et s’établir à Bourgueil, où demeurait une partie de sa famille.
Devenu veuf au bout de quelques années, il avait continué à y vivre avec un fils unique, alors infirme et presque idiot.
Mais, outre la fille mariée au docteur Vorel, la mère Louis avait un fils enlevé par la conscription, et que le hasard de la guerre avait favorisé. Promu de grade en grade sur le champ de bataille, il avait eu, avec le mérite alors commun de se bien battre, celui plus rare de survivre; et Napoléon, qui commençait à sentir le besoin de renouveler son état-major de maréchaux gorgés et vieillis, l’avait successivement nommé général, puis baron. Enfin, en 1810, il épousa mademoiselle de Mazerais, dont la vieille noblesse devait servir à étayer son titre de nouvelle date.
La chute de l’empire vint malheureusement arrêter court toutes ses espérances. Le général Louis en reçut la nouvelle en Vendée, où il avait été envoyé pour étouffer l’insurrection, et, soit douleur, soit hasard, il n’y survécut que peu de jours. Sa veuve, après avoir habité Paris quelque temps, vint enfin visiter des propriétés qu’elle possédait en Touraine, et ce fut là qu’elle rencontra son beau-frère, sur les instances duquel elle s’établit à Château-Lavallière.
Tels étaient les rapports existants entre le docteur Vorel et la baronne Louis, que nous avons tout à l’heure montrés au lecteur, assis ensemble sous un berceau de la Maison verte.
Le médecin venait de se pencher vers l’enfant, dont les plaintes, d’abord faibles et entrecoupées, étaient insensiblement devenues plus bruyantes, lorsque la baronne s’écria:
—Mon Dieu! docteur, Honorine paraît encore plus souffrante ce soir.
M. Vorel hocha la tête avec un sourire immuable.
—Qui vous fait croire cela? demanda-t-il, de sa voix douce et vibrante.
—N’entendez-vous pas ses cris?
—L’enfant n’a point d’autre manière d’exprimer ses impressions et ses caprices; il crie, comme l’être raisonnable gronde, parle ou chante.
—Mais, Honorine pleure, docteur!
—La sécrétion des glandes lacrymales est toujours abondante à cet âge. On voit bien, ma sœur, que vous en êtes à votre premier enfant, tout vous inquiète.
—Mais songez qu’elle aura bientôt trois ans, reprit la mère, en montrant la petite fille malingre et abattue.
—Je le sais, répondit le médecin; elle est née huit mois après la mort du général.
La malade fit un signe affirmatif.
—Pauvre Louis! continua M. Vorel avec une bonhomie affectée, s’il eût vécu, quel bonheur pour lui de se trouver père!... et surtout quel bonheur inespéré! car il m’a répété bien des fois qu’il n’y comptait plus. Il croyait avoir des raisons de croire.... Enfin, il s’est trompé! Mais il faut avouer, ma sœur, que ce voyage en Vendée pour rejoindre le général, a été un heureux hasard!
La baronne ne répondit pas et se pencha vers l’enfant, dont elle agrafa la pelisse.
—Ne serait-il pas prudent de faire rentrer Honorine? demanda-t-elle après un court silence.
—Pourquoi cela? dit le médecin, il n’y a ni vent, ni humidité; vous exagérez les précautions.
—Hélas! je ne sais, répliqua la veuve d’un accent ému; ne pouvant découvrir la cause des souffrances de ma fille ni des miennes, je m’en prends à tout ce qui m’entoure. Lorsque je suis venue m’établir ici, j’espérais, d’après votre assurance, que le calme de cette habitation, l’exercice, l’air des bois nous rendraient la santé; et depuis trois mois que nous y sommes, nos forces s’affaiblissent de jour en jour. L’air libre, le soleil, le parfum des fleurs, tout ce qui fait vivre les autres, semble, pour nous, un poison. Vous affectez en vain de ne pas vous en apercevoir, les progrès du mal sont visibles. Quand je sors, maintenant, les paysannes que nous rencontrons n’arrêtent plus Honorine pour demander son âge et l’embrasser; elles s’éloignent avec leurs enfants, comme si elles craignaient quelque maligne influence, et nous suivent de ce regard demi-effrayé que le peuple jette aux mourants.
M. Vorel voulut l’interrompre.
—Oh! ne cherchez pas à nier, continua-t-elle plus vivement, des explications médicales ne pourraient rien changer à ce qui est; je sens que la vie nous échappe, et cependant il ne faut pas que ma fille meure, docteur! Moi-même, je veux vivre pour elle, et puisque notre séjour ici a si mal réussi, je désire tenter un nouvel essai.
Le médecin la regarda.
—Vous songez à partir? demanda-t-il brusquement.
—Oui, mon frère, répondit la baronne.
—Auriez-vous, par hasard, la pensée d’accepter l’invitation de la mère Louis et de vous rendre aux Motteux?
—Non, je craindrais de n’y trouver ni soins, ni repos; mais je veux tenter un voyage en Italie; c’est une dernière ressource pour les désespérés!
—Et vous vous exposerez avec votre fille aux fatigues de cette longue route? vous oserez transporter votre maladie dans un pays étranger, où, si elle s’aggrave, vous ne trouverez ni soins ni famille?
—Pardonnez-moi, docteur; je ne serai point seule, ma sœur m’accompagnera.
—Madame la comtesse de Luxeuil?
—J’ai su qu’elle allait visiter Naples; je lui ai écrit pour qu’elle me permît de la suivre avec Honorine, et elle a consenti. Tout cela a été décidé depuis votre dernière visite, et je vous en aurais instruit par une lettre si je ne vous avais attendu chaque jour; j’ignorais qu’une affaire vous eût appelé à Orléans.
M. Vorel ne put retenir un geste de dépit.
—J’admire votre miséricorde vraiment chrétienne, ma sœur, dit-il avec un accent d’amertume ironique; jeune fille, vous avez dû défendre votre fortune contre madame de Luxeuil; mariée, elle a essayé de calomnier votre intimité avec le duc de Saint-Alofe; veuve, elle a voulu jeter des doutes odieux sur la naissance de votre fille, et vous avez déjà tout pardonné!
—Ah! pourquoi toucher à ces souvenirs, interrompit la malade, dont les yeux se remplirent de larmes; je voudrais les oublier! A quoi bon me rappeler que ma sœur ne m’aime pas, que personne ne m’a jamais aimée! il est de certains êtres, hélas! comme des arbres que vous voyez là: nés dans une mauvaise terre et exposés aux vents du nord, ils ne servent à rien et ne plaisent à personne!... Mais je ne veux point m’arrêter sur ces pensées, je ne veux songer qu’à ma fille; il faut qu’elle recouvre la santé, qu’elle essaie d’un autre air, d’une autre vie!
—Et en partant avec madame de Luxeuil, fit observer le docteur, vous n’avez point réfléchi que vous vous mettiez à sa merci? Vous ne craignez point son égoïsme, sa tyrannie, ses duretés?
—Je ne crains que le mal d’Honorine, reprit vivement la baronne; ne me parlez point d’autre chose. Que pouvais-je faire d’ailleurs? Ne venez-vous point de me dire vous-même que c’eût été folie de partir seule? à qui donc m’adresser? Des étrangers voudraient-ils accepter pour compagnes de voyage une enfant malade et une femme mourante? Ma sœur, du moins, aura pitié de nous.
M. Vorel secoua la tête.
—J’en suis sûre, continua vivement la baronne; quand elle a connu l’état alarmant d’Honorine, elle s’est montrée inquiète, elle m’a écrit sur-le-champ qu’elle voulait la voir.
—Sans doute, dit le médecin du même ton amer, la maladie de votre fille l’occupe et l’intéresse! A défaut des enfants, les sœurs sont légitimes héritières....
—Ah! que dites-vous? interrompit la baronne avec un cri; vous pourriez supposer....
—Je ne suppose rien, mais je comprends.
—Non, non, c’est impossible! Vos préventions contre madame de Luxeuil vous rendent injuste; cela ne peut être, docteur, cela n’est pas!..... Ce serait trop horrible. Elle, grand Dieu! ma sœur, aurait pu penser que si ma fille.... Ah! pauvre enfant, pauvre enfant!
Elle s’était penchée vers Honorine, qu’elle prit vivement dans ses bras en la couvrant de baisers et de larmes. Il y eut une assez longue pause. M. Vorel gardait un silence contraint, qui semblait confirmer et aggraver ce qu’il venait de dire; enfin pourtant il reprit la parole et demanda à la malade quand elle comptait rejoindre madame de Luxeuil.
—Je ne la rejoins pas, répondit la baronne, elle vient me chercher.
—Ici! Quand cela?
—Au premier jour; demain peut-être. Son départ dépend du docteur Darcy.
—Comment?
—Vous savez qu’il devait faire ce voyage d’Italie en compagnie de ma sœur, dont il est l’ami dévoué.
—Je le sais.
—Eh bien! en apprenant ma demande, il a pensé que sa présence pourrait être utile à deux malades...
—Et il vient à Château-Lavallière?
—Avec madame de Luxeuil.
M. Vorel changea de visage et se leva brusquement.
—C’est-à-dire que mes soins ne vous suffisent plus, dit-il avec éclat; vous avez pris en défiance le savoir du médecin de campagne, et vous voulez en appeler au médecin de Paris.
—Moi! s’écria la baronne saisie, ah! ne le croyez pas, mon frère! Sur l’honneur! je n’ai ni désiré, ni appelé M. Darcy.
—Qui peut alors l’avoir décidé?
—Le départ de ma sœur d’abord, puis le désir de voir madame de Norsauf, qui se trouve à sa terre de Rillé. Ma volonté n’est pour rien dans ce voyage, et le hasard seul a tout fait.
—Hasard dont vous profiterez?
—Vous-même en déciderez, docteur. Défendez-moi de consulter M. Darcy, et je ne lui parlerai de rien. Que votre avis soit contraire au sien, et votre avis seul sera suivi.
—Est-ce bien vrai, ma sœur?
—Doutez-vous de ma parole, mon frère?
M. Vorel regarda la baronne et parut un instant indécis.
—Non, dit-il enfin d’une voix adoucie, je veux croire que tout ceci est fortuit, comme vous me l’assurez. Si je me suis montré blessé au premier abord, ne croyez pas que ce soit par vanité de médecin; mais le cœur a aussi ses susceptibilités.
—Oh! je connais votre dévouement, dit madame Louis en lui tendant la main.
Il la prit et la serra dans les siennes d’un air ému.
—Oui, reprit-il, j’ose dire que ce dévouement est sincère et désintéressé. Aussi n’abuserai-je point de la confiance que vous me témoignez. Vous consulterez le docteur Darcy, ma sœur! L’opinion d’un homme aussi justement célèbre ne peut être qu’utile pour vous, et instructive pour moi.
—A la bonne heure, mon frère.
Le médecin se tut un instant.
—Seulement, reprit-il avec une sorte d’hésitation, je vous donnerai un conseil. Il est important que M. Darcy connaisse exactement ce que vous éprouvez, et quel a été le traitement suivi.
—Sans doute, et je lui dirai...
—Non! interrompit vivement M. Vorel; les malades s’interrogent mal; ils donnent de fausses indications, ils rapportent inexactement les médications employées, et il peut en résulter, pour le médecin qui arrive, de fausses impressions.
—Vous pensez?
—J’en suis sûr; je parle dans votre intérêt, ma sœur, et si vous m’en croyez, vous ne donnerez pas de préjugés à M. Darcy; vous me laisserez lui répondre...
—En vérité, c’est me tirer d’un grand embarras, répondit la baronne en souriant, car le plus souvent je ne sais comment définir ce que j’éprouve, et vos formules sont toujours pour moi des énigmes.
—Alors, vous promettez de me renvoyer le docteur pour toutes les explications?
—C’est convenu.
Le visage de M. Vorel reprit son expression souriante, et il continua quelque temps l’entretien sur un ton amical; enfin, il se leva, prit congé de la malade, embrassa l’enfant, et, après avoir fait à la nourrice quelques recommandations pleines de sollicitude, il se dirigea vers l’auberge où il avait laissé son cheval.
Tant qu’il se trouva en vue de la baronne qui l’avait reconduit jusque sur le seuil de la petite porte du parterre, il marcha du pas égal et paisible qui lui était ordinaire; mais, lorsqu’il eut tourné la rue et qu’il se trouva loin de tous les regards, sur la route déserte, sa marche devint insensiblement plus rapide. Le sourire qui donnait à son visage une sorte d’épanouissement mécanique s’effaça, et ses traits détendus reprirent cette forme aiguë et cette apparence fauve dont nous avons déjà parlé. Levant la cravache qu’il tenait à la main, il se mit à abattre, en passant, les jeunes pousses de troënes qui bordaient le chemin, comme s’il eût senti le besoin de décharger sur quelque chose une secrète colère. Mais cette espèce d’emportement muet fut de courte durée; il ne tarda pas à laisser retomber sa cravache, à baisser la tête et à ralentir le pas. La réflexion était évidemment venue, et, après s’être indigné de quelque désappointement inattendu, il cherchait le moyen d’en tirer parti.
On eût pu seulement défier l’observateur le plus habile de deviner la nature ou l’objet de sa préoccupation. Tous ses mouvements avaient repris cette apparence terne et calme qui laissait, pour ainsi dire, glisser le regard; son visage n’offrait à l’étude qu’une espèce de masque en terre cuite, sec, anguleux, inerte, sur lequel ses yeux, masqués par des lunettes bleues, semblaient deux taches miroitantes et sombres qui ne reflétaient rien.
Il atteignit ainsi l’auberge de la Femme-sans-Tête, où il avait l’habitude de mettre son cheval lorsqu’il venait voir la baronne. Arrivé là, il sortit de sa rêverie, et ses traits, comme s’ils eussent été touchés par un ressort intérieur, retrouvèrent instantanément leur crispation souriante.
L’auberge de la Femme-sans-Tête était une de ces hôtelleries équivoques recommandées seulement par leur position à l’entrée de la ville, et presque exclusivement fréquentées par les porte-balles, les rouliers et les bateleurs, race voyageuse qui vit sur la grande route, s’arrête où elle peut, et s’embarrasse médiocrement de l’apparence du gîte ou du choix de la compagnie.
La présence de M. Vorel dans un pareil bouge pouvait étonner au premier abord; mais l’hôtellier, le père Blanchet, était un de ses anciens clients, parti de Bourgueil sans avoir soldé un long mémoire de maladie, et le docteur, qui aimait l’ordre par-dessus tout, avait pensé qu’en choisissant son auberge il pourrait obtenir, en son et en avoine, l’équivalent des consultations qu’il n’avait pu se faire payer autrement.
Cet avantage compensait largement pour lui les désagréments d’un gîte où il s’arrêtait d’ailleurs peu de temps.
Lorsqu’il arriva à la Femme-sans-Tête, il ordonna de préparer son cheval, et, voulant continuer à réfléchir en l’attendant, il évita la salle commune, où retentissaient les cris des buveurs, et gagna le jardin placé derrière l’auberge.
La nuit était venue, et, bien qu’il n’y eût point de brouillard visible, aucune étoile ne se montrait au ciel. M. Vorel suivit la grande allée du jardin, presque effacée par l’herbe, et arriva à une treille dont la charpente brisée laissait pendre des vignes maigres et échevelées. Immédiatement au-dessus, se trouvait une croisée appartenant à la pièce la plus écartée de l’auberge. Alors ouverte et éclairée, elle laissait voir trois hommes assis autour d’une table, et qui achevaient de souper.
Bien que le bruit de leurs voix animées arrivât, par instant, jusqu’à la tonnelle, le médecin, tout entier à sa méditation, ne parut point y prendre garde et s’assit sur un banc placé sous la fenêtre.
Nous le laisserons là, livré à ses réflexions, pour introduire le lecteur dans la chambre même où soupaient alors les trois voyageurs.
A en juger par l’unique plat posé au milieu d’une table sans nappe, le repas que venaient de faire les trois convives avait été des plus modestes: une bouteille d’eau-de-vie presque achevée en formait le seul luxe. Un des côtés de la fenêtre était occupé par un homme encore jeune, petit, barbu, pâle et vêtu d’un bourgeron presque neuf. Il avait la bouteille à sa droite et versait seul à boire, privilége qui le signalait évidemment pour l’amphitryon. Son coude gauche était appuyé sur la table, et il tenait, de la main droite, un couteau à lame forte et longue, avec lequel il s’amusait à agrandir les fissures du bois vermoulu. Toute sa personne avait une expression chétive, vicieuse et farouche qui se retrouvait également dans le voyageur assis devant lui, mais sous des formes différentes et avec d’autres nuances.
Celui-ci, d’une taille démesurée, était d’une telle maigreur, que les saillies de ses os avaient laissé leurs traces sur la redingote râpée qui le serrait. Sa chevelure, d’un blond fade, encadrait un de ces visages sans largeur, et, pour ainsi dire, coupants, qui, de quelque côté qu’on les regarde, ne semblent présenter qu’un profil. Il avait, près de lui, un énorme havresac où se trouvaient confondus des peaux de lapin, des débris de porcelaine dorée, des faux bijoux brisés, des vêtements d’homme et de femme en lambeaux, témoignages parlants d’une monomanie trafiquante que pouvait seule justifier l’origine hébraïque. Le grand homme maigre était effectivement Juif, et, de plus, Alsacien, comme le prouvait clairement son accentuation tudesque.
Quant au troisième convive, placé au bout de la table, sa physionomie était moins tranchée. Un peu plus jeune que ses compagnons, il avait un air plutôt hardi que féroce. Son costume et son teint bruni par le soleil, pouvaient même le faire prendre, au premier aspect, pour un paysan; mais, en regardant de plus près, sa taille souple, ses mouvements prompts, ses mains étroites et sans callosités ne permettaient point de le croire habituellement livré aux travaux rustiques. Tout en lui annonçait plutôt l’aventurier. Ses traits avaient une expression ouverte et insouciante, qui, sans être de la pureté, n’étaient point non plus de la bassesse; ils respiraient une sorte de brutalité naïve qui pouvait mettre en garde contre les actes de l’homme, sans qu’il inspirât pour cela de la haine ni du dégoût. Évidemment le hasard et l’ignorance avaient une forte part dans cette corruption, qui ne semblait point irrévocable.
Au moment où commence notre récit, il venait de vider son verre qu’il tendit de nouveau à son voisin en frappant sur la table et en criant:
—A boire, Parisien!
Le petit homme barbu se retourna lentement.
—Ah! ah! Rageur, dit-il avec un ricanement cynique, dont il semblait avoir l’habitude, on voit qu’il y a longtemps que tu n’as goûté à l’eau-d’aff; tu la siffles comme de la tisane de marchand de coco.
—Quand on a eu faim, l’estomac a besoin de se refaire, répondit laconiquement le Rageur.
—Toi affoir donc été dans une crande teppine? demanda le Juif.
—Dans une débine à manger des glands, Alsacien.
—Et tu n’as bas trouffé à faire un beu de gommerce?
—Du commerce, avec quoi?
—Avec ce gon a, tonc! Il y a touchours moyen de gommercer.
—Oui, interrompit le Parisien, pour toi qui troquerais les pierres du chemin contre des cosses de pois; mais le Rageur n’est pas un marchand de bric-à-brac, lui; il a travaillé dans le grand genre avec moi, quand nous faisions la guerre aux patauds[B], en Maine-et-Loire. La diligence nous a passé deux fois par les mains.
—Y affait-il peaucoup de pacages, Jacques? demanda naïvement le Juif.
—Il y avait deux cent mille balles (200 mille francs), répondit le Parisien, avec un laconisme triomphant.
—Deux cent mille palles à vous teux! s’écria le Juif émerveillé.
—Non, au commandant de canton tout seul, dit le Rageur; il a tout pris pour le service du roi et tout gardé pour son propre service, ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir des croix, des places, des pensions, tandis que nous autres, on nous a dit de rentrer dans nos villages et de chercher du travail.
—Ce que tu as fait? dit le Parisien d’un ton ironique, car tu as voulu te ranger.
—Eh bien! après? répliqua le Rageur brusquement; si c’est mon idée?...
—Pourquoi y avoir renoncé, alors?
—Pourquoi?... tu le sais aussi bien que moi! J’y ai renoncé parce que, dans le pays, on me refusait de l’ouvrage en me disant que j’étais trop connu, et qu’ailleurs on ne voulait pas m’en donner, sous prétexte qu’on ne me connaissait pas.
—De sorte que tu t’es dégoûté d’en chercher?
—Je me suis dégoûté de mourir de faim.
—Preuve que tu n’étais pas né pour être honnête homme, mon petit. L’ouvrier né honnête doit manger quand il a du pain, et quand il n’en a pas, serrer d’un cran la boucle de son pantalon; c’est un article de morale que ton curé aura oublié de te faire connaître. Quant à moi, vois-tu, j’avais pas plus de douze ans quand j’ai compris la chose.
—Comment ça?
—J’avais pour parents légitimes la crême des couples vertueux, un père cousu de certificats de probité, et une mère dont on eût pu faire une rosière. Mon père, qui était employé à l’administration générale des déménagements, avait rendu je ne sais combien de fois, à leurs propriétaires, de l’argenterie, des bijoux et des billets de banque perdus, ce qui lui avait rapporté l’estime générale et un certain nombre de pièces de vingt sous. Par malheur, un jour qu’il était chargé d’une malle, le pied lui manqua dans un escalier, il se donna un effort, et il fallut le porter à l’hôpital, où il mourut un mois après. Par considération pour les bons services du défunt, l’administration accorda une gratification de 25 fr. à ma mère. Ce n’était pas cher pour la vie d’un homme, mais elle aurait pu ne rien donner; aussi, ma mère alla remercier le directeur.
—Et quel âge avais-tu alors, toi? demanda le Rageur, en paraissant prendre une sorte d’intérêt au récit de Jacques.
—Onze ans, répondit celui-ci, juste ce qu’il fallait pour bien sentir la misère!... et tu peux croire qu’on en eut à discrétion. Au bout de quelques mois, ma mère tomba en langueur; elle ne pouvait presque plus travailler... alors le pain manqua. Il fallut demander l’aumône; mais ils m’avaient rendu fier dans la famille: je demandais mal, et le plus souvent je revenais sans rien avoir: alors on se couchait à jeun. Aussi la mère alla de mal en pis. On voulut la faire entrer à l’hôpital, mais quand les médecins l’eurent vue, ils dirent qu’elle n’avait pas de maladie, qu’elle ne souffrait que de la faim, et que c’était une incommodité dont ils ne guérissaient pas. On la renvoya dans notre grenier, où elle traîna encore quelques mois, jusqu’à ce que la portière me dit un soir, comme je rentrais, qu’elle venait de mourir.
—Ta mère! répéta le Rageur, visiblement ému, elle est morte en ton absence?
—Oui, dit Jacques avec insouciance, et comme je n’étais encore qu’un enfant, ça me fit quelque chose; surtout quand je trouvai les voisines qui étaient autour du corps qui répétaient que Dieu avait fait une grande grâce à la défunte de la prendre. Aussi ne s’occupait-on que de l’ensevelir. On avait déjà demandé un drap au locataire du premier étage, qui avait cabriolet, mais la dame avait répondu qu’elle n’avait pas de vieux linge; enfin, ceux des mansardes se cotisèrent: on acheta ce qu’il fallait. Quant à moi, je regardais tout ça sans rien dire. Je tenais à la main le portefeuille que ma mère avait ordonné de me remettre, et qui renfermait nos papiers, extraits de mariage, de naissance, certificats de bonne conduite, et je pensais en moi-même:—Voilà donc comme ça se joue pour les pauvres? Tout ce qu’ils gagnent à être des saints, c’est de mourir à l’hôpital ou dans un grenier, et d’être ensevelis par la charité de voisins qui les trouvent bien heureux d’être morts! Et c’est là ce qui m’attend, dans le cas où je ferais comme mon père? Merci de la chance! S’il n’y a pas d’autre récompense pour les travailleurs honnêtes que de laisser à leurs enfants des quittances de leur probité, j’aime mieux vivre comme un voyou et ne rien faire.
—Et tu as gommencé tout de suite le métier, Barisien?
—J’ai commencé par descendre chez le portier pour jeter au feu tous les papiers laissés par le père et la mère; il me semblait que c’était une manière de renoncer à l’héritage.
—Eh bien! je n’aurais pas fait comme ça, moi, dit le Rageur avec une sensibilité grossière; non, si j’avais eu des parents... une mère... il me semble que je n’aurais pas voulu faire honte à leur nom. Mais un enfant trouvé n’a pas de nom: c’est comme un chien perdu; tout le monde a le droit de lui lancer une pierre... Ah! si j’avais eu une famille...
—Dans ce cas tu aurais rempli ton rôle d’honnête homme, pas vrai, ajouta Jacques en ricanant. Quand on croit au paradis, encore, à la bonne heure, on peut espérer que l’on touchera son arriéré chez le Père éternel; mais pour ceux qui veulent vivre de leur vivant, le métier me paraît peu récréatif? Qu’en penses-tu, Alsacien?
—Moi, reprit l’homme maigre, je bense que j’aurais jamais rien bris à bersonne, si j’avais eu seulement un betit gabital pour entrebrendre du gommerce.
Le Rageur éclata de rire.
—Ce diable de monsieur Jérusalem ne rêve qu’à son gommerce, dit-il; s’il était condamné à être pendu, il vendrait une corde au butteur (bourreau).
—Les gordes, c’est une maufaise marchandise, fit observer sérieusement l’Alsacien.
—Pas toujours, reprit Jacques plus bas; je me rappelle une certaine corde, à Bourbon-Vendée, qui nous a rapporté près de deux cents louis. Il faudrait trouver ici quelque chose dans le même goût.
—Avez-vous cherché? demanda le Rageur d’un air indifférent.
—Oui, répliqua le Parisien. Je me suis promené dans les environs pour prendre une leçon de géographie; il y a des maisons qui ont bonne apparence; mais il faudrait avoir quelques renseignements sur les bourgeois, vu qu’il s’en trouve, des fois, qui sont méchants et qui vous dérangent.
—J’aime bas qu’on me terrange, dit le Juif, avec un sérieux féroce; quand on terrange y a moyen de rien emborter. Aussi y faut mieux faire aux gens se taire.
—C’est mon opinion, reprit Jacques, surtout quand on travaille à l’aveuglette et qu’il faut chercher la place du magot, comme ce serait ici le cas. Une fois sûr que personne ne peut faire du bruit, on prend son temps.
—Possible, dit le Rageur, mais moi, ça ne me flatte pas!
—Fais donc la bégueule! reprit le Parisien avec son sourire pâle; quand nous étions en Maine-et-Loire tu t’es peut-être privé de descendre les bourgeois qui s’attardaient sur les routes.
—C’étaient des bleus! reprit vivement le Rageur, ils savaient que nous nous promenions dans le pays; ils n’avaient qu’à prendre garde. Dans ce cas-là, envoyer un coup de fusil au bourgeois, c’est de la guerre; mais entrer chez lui pour le trouver au lit, endormi, je n’ai pas le cœur à ces choses-là, vois-tu!.... d’autant qu’il peut y avoir des femmes, et qu’alors ce serait encore pis.
—C’est-à-dire, Rageur, que tu bois l’eau d’aff, mais que tu ne veux pas la gagner.
—Si fait, Jacques, je veux la gagner, mais il faut que l’affaire soit montée autrement. Adressons-nous, si tu veux, à une diligence, comme autrefois; il y a toujours là-dedans des gens qui peuvent se défendre.
—Comment, double niais! tu tiens donc à courir des risques?
—Eh bien! oui, ça m’encourage.
—Bas moi, bas moi! interrompit vivement le Juif.
Jacques haussa les épaules.
—Le Rageur a toujours eu un coup de marteau, dit-il, en touchant son front du doigt; mais, quand nous aurons trouvé une occasion, si la chose le taquine trop, il pourra faire galerie en nous laissant jouer la partie à deux.
—Et nos barts n’en seront que meilleures! ajouta philosophiquement l’Alsacien.
L’arrivée de l’aubergiste, qui venait réclamer le prix du souper, empêcha le Rageur de répondre. Jacques acquitta la note, offrit à maître Blanchet ce qui restait dans la bouteille, et, après avoir trinqué, tous quatre descendirent dans la salle commune où le Parisien et le Rageur se mirent à fumer. Le Juif tira également de la poche de son gilet une grosse pipe allemande dont il secoua ostensiblement les cendres sur son genou pendant un quart d’heure; mais aucun de ses compagnons n’ayant offert de la remplir, il la remit dans sa poche avec un soupir.
Quelques instants après, M. Vorel parut.
Si l’on se fût trouvé à Paris, l’entrée d’un habit fin dans un lieu exclusivement fréquenté par des porteurs de vestes et de bourgerons, n’eût point manqué d’exciter une surprise suivie de murmures et de provocations; là, en effet, l’intelligence populaire plus éveillée, a compris que le bourgeois ne venait jamais se mêler aux habitudes ou aux plaisirs de l’ouvrier que dans l’intérêt de ses vices, et elle maintient, comme une défense, cette séparation des classes qu’on lui a imposée comme un joug. Mais en province, la tradition antique n’est point encore tellement éteinte, que le serf affranchi ne tienne à honneur le contact de son ancien maître; là, le peuple n’en est encore qu’à la vanité; celui de Paris est déjà remonté jusqu’à l’orgueil.
La réception faite au médecin par les gens réunis à la Femme-sans-Tête, fit clairement apprécier cette différence; la plupart s’interrompirent dans leurs conversations, et portèrent la main à leurs bonnets ou à leurs chapeaux, tandis que l’homme au bourgeron se détournait avec un grognement.
—Tiens, il vient donc ici des Elbeuf, dit-il assez haut pour être entendu du docteur. Qu’est-ce qu’il demande, ce monsieur? ce doit être le commissaire de l’endroit ou un brigadier de gendarmerie déguisé en bourgeois.
—Eh non! interrompit maître Blanchet, qui cherchait une chaise pour M. Vorel; c’est le médecin de Bourgueil. Asseyez-vous donc, monsieur le docteur; comment va la baronne?
—Médiocrement, Blanchet, médiocrement, répondit M. Vorel, de sa voix honnête et posée; je ne suis point content de son état.
—Aussi elle est trop sédentaire, répondit l’aubergiste, on ne la voit jamais hors de son couvent.
—Elle donne tout son temps à sa fille.
—Oui, on dit qu’elle a fait de sa maison et de son jardin un vrai paradis; ça a même été cause qu’on a crié dans le pays.
—A quel propos?
—Parce qu’elle a tout acheté à Paris, les meubles, les tapisseries, les fleurs! Vous comprenez, monsieur Vorel, que lorsqu’on a de quoi, il est juste d’en faire profiter ceux de l’endroit: quand elle aurait dû payer un peu plus cher, on la dit riche à ne pas connaître elle-même sa fortune.
—Vous savez qu’on exagère toujours, maître Blanchet, la baronne a une trentaine de mille livres de rentes.
—Eh bien! et ce qui lui reviendra de votre belle-mère, la bonne femme Louis, car vous n’êtes que deux héritiers, la fille de la baronne et vous?
—C’est vrai.
—De sorte, ajouta l’aubergiste, en clignant les yeux, que si la petite ne grandissait pas, vous prendriez seul toute la succession! Eh bien! ça ne serait pas encore si sot. En définitive, nous sommes tous mortels, comme dit cet autre; ce ne serait pas votre faute, si l’enfant vous manquait dans la main, et vous toucheriez, comme consolation, une vingtaine de mille livres de rentes.
—Vingt mille livres de rentes, s’écria le Parisien, qui avait tout entendu, tonnerre! c’est tentant pour un médecin!
M. Vorel tressaillit comme un homme frappé d’un coup inattendu; il pâlit jusqu’aux lèvres et se retourna vers Jacques avec une exclamation indignée: mais l’impassibilité cynique de celui-ci parut le déconcerter; il balbutia quelques mots inintelligibles, détourna la tête et s’approcha du feu comme s’il se fût senti du froid.
L’aubergiste ne parut point avoir pris garde à cet incident rapide et continua:
—C’est égal, pour une femme qui a dix mille écus à dépenser tous les ans, la baronne ne fait guère de bruit; à quoi peut-elle employer son argent?
—A accroître la dot de sa fille par ses économies, répliqua Vorel.
—Eh bien! elle doit en avoir alors de ces pièces rondes; car le diable me brûle, si elle dépense le quart de son revenu! Elle vit là-bas sans autre train de maison qu’un jardinier à la journée, une chèvre et une servante.
—A mon grand regret, fit observer le docteur; je voudrais la savoir moins seule.
—Et à cause donc?
—Parce que la maison est isolée et que des voleurs y trouveraient de quoi faire fortune.
—Tiens! ma foi, je n’y avais pas pensé, dit Blanchet, c’est encore vrai ce que vous dites là, monsieur Vorel. De mauvais gars n’auraient qu’à être avertis!... Il serait facile d’entrer par le bout du jardin, qui donne sur le bois.
—Les fenêtres ne sont défendues que par des persiennes.
—Et une fois dans la maison on pourrait tout égorger à son aise; il n’y a pas de voisins.
—C’est effrayant, répéta M. Vorel en promenant un regard autour de lui, comme s’il eût voulu s’assurer qu’aucun des auditeurs de ce dialogue n’était homme à en abuser.
Mais le Parisien et le juif venaient de se retirer à l’écart et échangeaient, à voix basse, quelques paroles rapides. Quant au Rageur, demeuré à la même place, il semblait n’avoir rien écouté.
Le garçon d’écurie de la Femme-sans-Tête entra dans ce moment, et annonça au docteur que son cheval était prêt.
—Vous repartez donc pour Bourgueil? demanda Blanchet.
—Non, dit M. Vorel, je continue jusqu’au Vivier, où lord Murfey me prie d’aller depuis longtemps.
—Est-ce que l’Anglais est malade? demanda l’aubergiste.
—Pas précisément, dit M. Vorel en souriant: mais comme il n’a rien à faire, il se gorge de bœuf et de Madère pendant six jours, et il prend médecine le septième. Au revoir, père Blanchet.
Le docteur, après avoir boutonné jusqu’au haut sa redingote à la propriétaire, plongea les deux mains dans ses larges poches pour y chercher ses gants; mais il en retira une petite boîte cachetée, à la vue de laquelle il fit un geste de désappointement.
—Au diable, l’étourdi! s’écria-t-il, j’ai oublié de remettre les pastilles pour Honorine.
La vérité était que sa préoccupation, au moment de quitter la baronne, lui avait fait perdre le souvenir de la boîte.
—C’est-y quéque chose de pressé? demanda l’aubergiste.
—Sans doute, reprit le docteur; mais je suis déjà en retard, et je ne voudrais point retourner chez ma belle-sœur; ne pourriez-vous pas, père Blanchet, lui faire remettre ceci sur-le-champ?
—Je ferai mon possible, monsieur Vorel, répliqua l’hôtelier avec un peu d’hésitation; mais, pour le moment, je n’ai là que Joseph qui ne peut quitter l’écurie.
—Tâchez de trouver une autre personne, dit le médecin, en promenant autour de lui un regard par lequel il semblait solliciter la complaisance des auditeurs.
L’Alsacien, qui s’était rapproché, porta la main à son chapeau gris.
—Si le pourgeois a pesoin, je borderai la poète, dit-il avec un sourire aimable qui rappelait le rictus des têtes de mort.
—Eh bien! ça se trouve comme de cire, dit le père Blanchet.
—Mais, Monsieur... connaît-il la maison de madame la baronne? demanda le docteur en examinant le juif à travers ses lunettes.
—Je gonnaîtrai, je gonnaîtrai, reprit celui-ci, qui s’efforça de donner encore plus d’affabilité à son sourire, l’aupergiste y m’indiguera.
—Je crains que ce ne soit abuser de votre obligeance?
—Dy tout, dy tout, mein Herr, je broboserai en même temps mes zervices à la parone. J’achète les beaux de labin, mein Herr, et la borcelaine cazée, et les choses de verre en gristal; donnez la poète, a m’aitera à faire mon gommerce.
—Allons, voilà qui lève mes scrupules, dit le médecin, et puisque monsieur l’Allemand veut bien...
—Ah! mein Herr a teffiné que j’étais Hallemand? interrompit l’homme maigre d’un air émerveillé; gomment donc qu’il a teffiné? A cause que je suis plond dans mes geveux...
—Oui, et un peu aussi à l’accent.
—Tiens!... j’ai un accent, reprit le juif, qui regarda tout le monde avec une surprise souriante, et pien je mé aberçois bas, barole t’honneur! mais, n’imborte, je borderai la poète.
—Je vous engage alors à vous hâter, fit observer le docteur, car plus tard le jardinier serait parti, et on ne vous ouvrirait peut-être point.
—Je bars, je bars, s’écria l’Alsacien.
Et en trois enjambées il fut hors de l’auberge, tandis que de son côté M. Vorel montait à cheval et prenait le chemin du Vivier.
Quant au Parisien, il s’était approché du Rageur, qui, sur un signe, l’avait suivi, et tous deux disparurent du côté de l’étang.
Environ une heure après, deux hommes étaient accroupis derrière une des haies qui bordent le chemin conduisant des premières maisons du faubourg à la partie supérieure de la ville. L’un d’eux avait le cou tendu et l’œil fixé sur le milieu de la route, que la lune commençait à éclairer, tandis que l’autre, renversé en arrière dans une pose nonchalante, semblait à moitié endormi.
Tout à coup le premier se redressa, prêta l’oreille, pencha la tête à droite et à gauche pour mieux voir, et fit entendre cette espèce de bredouillement cadencé qui, chez les faubouriens de Paris, remplace le sifflement d’appel.
La réponse ne se fit point attendre, et, presque au même instant, une ombre se dessina sur l’espace lumineux du chemin et s’avança vers l’endroit où les deux compagnons se tenaient cachés.
—Est-ce bien toi, Moser? demanda le Parisien qui s’était levé.
—C’est pien moi! repondit l’Alsacien; tu es seul?
—Voici le Rageur.
—A la ponne heure, on ne beut bas nous entendre?
—Non; mais parle vite, y a-t-il gras?
—Il y a cras, il y a cras, reprit Moser, dont les yeux bleus et ronds brillaient d’une vivacité singulière.
—Tu es entré dans la case?
—Foui, c’est la serfante qui m’a ouffert.
—Et tu lui as donné la boîte?
—Bas si pête, j’ai dit que je foulais barler à la paronne. On m’a fait monter et on m’a laissé dans une betite salon où il y a une fenêtre qui tonne sur le parterre; alors, bour m’occuper, j’ai foulu dévisser le grochet de la bersienne.
—Tu n’as pas pu?
—Le foilà! dit l’Alsacien, en montrant triomphalement un morceau de fer qu’il tenait caché dans sa manche; un grochet ça peut se fendre...
—Mais as-tu eu le temps d’examiner un peu l’intérieur?
—Beaucoup, beaucoup. T’abord, quand on m’a gonduit à la paronne, j’ai traversé trois bièces, oh! mais des bièces si pien meuplées!... Quel dommage, Barisien, qu’on ne buisse pas emborter les meubles!
—Finis donc.
—Enfin, j’ai remis la poète à la paronne; elle a l’air pien malade, la pauvre tame!
—Et après?
—Après, je lui ai temanté si elle n’affait pas de beaux de labins à fendre.
—Ah! satané Juif, dit le Parisien, en riant malgré lui, le jour du jugement il proposera au père Éternel de lui acheter ses vieilles culottes!
—Y fallait pien, Jacques, reprit Moser sérieusement, ça me tonnait l’air de faire mon gommerce.
—Que t’a répondu la baronne?
—Elle m’a répontu: Non.
—Et tu es ressorti?
—Foui, mais j’ai fait attention à me dromber de borte pour foire encore d’autres champres.
—Alors tu pourras te reconnaître en dedans?
—Très-pien.
—Mais pour entrer dans le parterre?
—Pour entrer dans le barterre, c’est facile, je fas fous expliquer ça.
Moser commença une sorte de description topographique qui prouvait une intelligence singulièrement exercée dans ce genre d’observation. Il pensait que tous trois devaient d’abord franchir le mur de clôture, et qu’arrivés au parterre, le Rageur, qui était le plus leste, gagnerait la fenêtre du petit salon dont la persienne ne pouvait plus se fermer, pénètrerait dans la maison et leur en ouvrirait la porte.
Le Parisien se tourna vers son compagnon qui était jusqu’alors demeuré étendu sur l’herbe et avait tout écouté sans rien dire.
—Il me semble que Monsieur Jérusalem a bien compris l’affaire, fit-il observer, qu’en dis-tu, mon vieux, est-ce que ça te va?
—Non, répondit le Rageur sans se déranger.
—Pourquoi ça?
—Parce qu’une fois entrés dans la cassine, vous voudrez faire taire les femmes.
—Allons, vas-tu recommencer? dit Jacques, en haussant les épaules; ça fait pitié, ma parole d’honneur: un voyou qui ne possède que sa vermine et qui se mêle d’avoir des nerfs!
—Eh bien! si c’est mon idée, reprit le Rageur, en se mettant sur son séant, est-ce que je ne suis pas libre, par hasard?
—Non, tu n’es pas libre! s’écria le Parisien, car maintenant tu connais le coup que nous avons monté.
—Eh bien?
—Eh bien!... tu peux jaser.
Le Rageur se redressa si brusquement que Jacques recula.
—Répète-moi ça, dit-il en regardant le Parisien fixement; je n’ai pas bien entendu.
—C’est pourtant clair, reprit Jacques, qui balançait évidemment à exprimer une seconde fois sa défiance, une affaire ne doit être connue que de ceux qui en sont, et, si tu caponnes, le mieux sera de tout laisser.
—Non bas, non bas, interrompit vivement Moser, je ne feux bas laisser, moi! L’affaire il est trop ponne; j’irai plitôt tout seul. Rabellez-fous tonc les baroles du docteur: il a tit qu’y avait de quoi enrichir blusieurs... braves gens; je serais gontent d’être riche, moi.
—Tiens, il croit être le seul, murmura le Rageur, avec un mouvement d’épaules.
—Et pien, si toi aussi tu feux avoir de l’archent, y faut fenir, reprit Moser; c’est un fattout; abrès ça, tu bourras te retirer des affaires.
—A la bonne heure, dit brusquement le Rageur, j’en serai, mais à une condition.
—Laquelle?
—C’est que vous ne jouerez pas du couteau. La maison est assez isolée pour qu’on ne craigne pas d’être surpris.
—Mais si les femmes s’éveillent et veulent crier?
—Alors, je me charge de les bâillonner.
—Ça beut se faire, dit le juif; mais y faut blus de brégautions.
—Est-ce convenu alors? demanda le Rageur.
—C’est convenu.
Ainsi tombés d’accord, les trois compagnons se dirigèrent du côté de la Maison verte; mais il était encore trop tôt pour qu’ils pussent commencer à travailler; aussi gagnèrent-ils une butte qui s’élevait de l’autre côté de la route et d’où l’on apercevait distinctement, par-dessus le mur de clôture, la façade de la maison.
Tous les trois s’y assirent, cachés par les broussailles, et attendirent avec impatience, l’œil fixé sur leur proie.
Les rideaux des fenêtres étaient restés ouverts, de sorte que l’appartement éclairé leur apparaissait, à travers la route, comme un théâtre amoindri par l’éloignement, et sur lequel se jouait une sorte de pantomime de la vie privée. Ils suivaient les lestes mouvements de la jeune servante, et ceux plus languissants de la baronne. Ils les voyaient s’empresser toutes deux autour de l’enfant, la promener dans leurs bras, et s’efforcer de l’endormir. Mais l’arrivée de la nuit avait redoublé le malaise d’Honorine, dont les cris plaintifs arrivaient jusqu’aux trois compagnons. Le mal ne semblait céder de temps en temps que pour reprendre bientôt plus vif. Minuit sonna à l’horloge éloignée, et les deux femmes continuaient vainement à bercer la petite fille.
—Il ne finira donc pas, cet avorton du diable! murmura le Parisien, à bout de patience.
—Je foudrais avoir son cou tans ma main! ajouta le Juif en fermant ses longs doigts de squelette, avec une expression féroce.
—Il peut les tenir comme ça, debout jusqu’à demain!
—Et imbossible d’entrer bendant qu’elles sont effeillées; elles nous entendraient.
—Faites donc pas tant de mauvais sang, dit le Rageur; voilà que ça va finir.
Les cris avaient, en effet, cessé, et la nourrice ne tarda pas à quitter la chambre avec l’enfant endormi.
La baronne, restée seule, s’approcha de la fenêtre, et demeura quelque temps le front appuyé sur les vitres. A la distance où elle se trouvait, il était impossible de distinguer ses traits; mais son attitude révélait un tel affaiblissement, que le Rageur hocha la tête avec une vague expression de pitié.
—Elle a l’air d’une morte, dit-il à demi-voix.
—Ça ne suffit pas, l’air, murmura Jacques entre ses dents; est-ce qu’elle va rester là toute la nuit, maintenant?
—Non, fit observer Moser; elle gommence à brier le pon Tieu... c’est pon signe! Quand les femmes brient le pon Tieu, c’est qu’elles ont envie de tormir.
La baronne venait de se mettre à genoux. Après une prière assez longue, elle se releva avec effort, appela la nourrice pour fermer les persiennes, et toutes les deux disparurent en emportant les lampes.
La façade demeura dans une complète obscurité.
Le Parisien et ses deux amis attendirent encore, en silence, pendant assez longtemps, enfin, lorsqu’une heure et demie sonna, tous trois se levèrent lentement, et, après s’être assurés que la route était déserte, ils escaladèrent le portail, et arrivèrent au pied du perron.
Moser désigna alors au Rageur la fenêtre du petit salon, qu’il atteignit sans trop de peine, et dont la persienne, mal fermée, céda presque aussitôt; un carreau, brisé avec précaution, lui permit d’ouvrir la fenêtre.
—Y es-tu? demanda Jacques à voix basse.
—Oui, répliqua le Rageur.
—A brésent, la bremière borte à gauche pour drouver l’escalier, murmura Moser.
Le Rageur ne répondit rien, mais il disparut dans l’appartement.
Jacques se pencha à l’oreille du Juif.
—Prépare ton couteau, murmura-t-il.
—Bourquoi? demanda Moser.
—Pour servir les femmes si elles se réveillent.
—Mais le Rageur?
—Il faudra bien qu’il se taise quand ce sera fait.
—C’est vrai, dit l’Alsacien, en tirant de la poche de son pantalon un couteau-poignard qu’il ouvrit; comme ça tu moins, on n’aura bas à se bresser.
Tous deux se placèrent près de la porte et attendirent; mais un temps assez long s’écoula sans que leur compagnon reparût.
—Bourquoi tonc que l’autre n’arrive bas? demanda le juif étonné et inquiet.
—Il a peut-être de la peine à se reconnaître là-dedans, dit le Parisien, si tu avais pu monter à sa place, ça serait allé plus vite.
—Attends, je fois là quelque chose.
Moser s’avança vers l’objet qu’il avait aperçu dans l’ombre; c’était une échelle couchée le long du mur par le jardinier. Jacques l’aida à la transporter sous la fenêtre précédemment ouverte par leur compagnon, et, après l’y avoir appuyée, tous deux montèrent lentement.
Ils n’avaient pas franchi la moitié de l’échelle, lorsqu’un cri se fit entendre à l’intérieur.
—Nous sommes découverts, dit l’Alsacien qui s’arrêta court.
Un second cri, puis un troisième retentirent.
—Les couteaux! les couteaux! répéta le Parisien en forçant Moser à avancer.
Celui-ci comprit et sauta dans l’appartement. Une porte qu’il reconnut pour celle de la chambre où la baronne l’avait reçu, était ouverte et éclairée: c’était de là que venaient les cris; Jacques et lui y coururent; mais la pièce était vide, le lit défait et le berceau de l’enfant renversé. Ils s’étaient arrêtés stupéfaits et le couteau à la main sur le seuil, lorsque le Rageur, les traits bouleversés, parut à une seconde entrée; à leur vue, il recula brusquement et disparut avec un cri.
—Eh bien! qu’a-t-il donc? s’écria le Parisien.
—Nous lui affons fait beur, répliqua Moser.
—Il ne nous a pas reconnus, alors?
—C’est bossible.
Tous deux coururent à la porte par laquelle leur compagnon venait de s’échapper et essayèrent de l’ouvrir; mais elle était fermée.
—Il a tiré le ferrou, dit le juif.
—Écoute, interrompit Jacques.
On entendait un murmure de voix parmi lesquelles se distinguait celle du Rageur, suppliante et éperdue.
—Que tiable se passe-t-il là-tetans? demanda Moser.
—Il faut enfoncer la porte! dit le Parisien, à qui l’impatience et la peur ôtaient toute prudence.
Et il se mit à secouer la serrure avec une sorte de fureur.
Un cri d’effroi s’éleva dans la chambre voisine.
—Ne craignez rien, madame la baronne, répéta distinctement le Rageur: quiconque voudra arriver jusqu’à vous est mort!
Jacques et Moser firent un mouvement en arrière.
—Il est donc defenu fou? balbutia ce dernier stupéfait.
—C’est pourtant bien sa voix, reprit le Parisien qui cherchait vainement à comprendre.
Et secouant de nouveau la porte, il se mit à appeler le Rageur. On ne lui fit aucune réponse; mais le murmure de voix recommença de l’autre côté.
Les deux brigands déconcertés se regardèrent.
—Le gredin nous a vendus! s’écria Jacques avec un geste de désappointement plein de rage.
—Il gonnaissait donc la paronne? ajouta le juif, dont l’étonnement paralysait pour ainsi dire la colère. Mais pourquoi alors nous affoir laissé fenir?
—Est-ce que je sais, moi?... Pour nous livrer, peut-être...
Il n’avait point achevé que des coups répétés retentirent à la grande porte extérieure. Tous deux s’élancèrent dans le petit salon et coururent à la fenêtre; une chaise de poste venait de s’arrêter devant l’entrée.
Ils escaladèrent rapidement le balcon pour regagner le jardin; comme ils posaient le pied sur les premiers barreaux de l’échelle, le cri: Au voleur! se fit entendre dans la rue; ils avaient été aperçus par le domestique occupé à défaire la bâche de la voiture de voyage.
Effrayés, ils balancèrent un instant, puis finirent par se décider à descendre; mais leur retard avait permis au domestique de franchir le mur de clôture avec un des voyageurs de la chaise de poste. Le juif et le Parisien les trouvèrent tous deux au bas de la fenêtre, le pistolet à la main.
Comprenant que la lutte était inutile, ils se débarrassèrent des couteaux, dont ils étaient armés, et se laissèrent saisir sans résistance.
La chaise de poste, arrivée si à propos à la Maison-Verte, y amenait madame de Luxeuil et le docteur Darcy.
Tous deux trouvèrent la baronne privée de sentiment. La nourrice, accourue près d’elle, à demie vêtue, essayait de lui faire reprendre ses sens.
Elle raconta à la comtesse que sa maîtresse désirant veiller elle-même sa fille, l’avait renvoyée pour prendre quelque repos. Réveillée peu de temps après par des cris, elle s’était précipitée, malgré son épouvante, vers la chambre de la baronne, qu’elle avait trouvée évanouie aux pieds d’un homme en blouse. Mais le bruit des pas de la comtesse et du docteur avait fait fuir ce dernier sans qu’elle pût dire ce qu’il était devenu.
Pendant que madame de Luxeuil écoutait ces explications, en les entrecoupant d’exclamations plaintives sur l’effroi qu’elle venait d’éprouver et sur le danger qu’elle avait failli courir, M. Darcy s’occupait de rappeler la malade à la vie.
Elle finit par rouvrir les yeux, et balbutia le nom de sa fille. Le docteur la lui fit présenter.
A la vue de l’enfant endormi sur le sein de sa nourrice, la baronne parut se ranimer; elle fit un effort, souleva la tête; et, dans ce mouvement, ses yeux rencontrèrent la comtesse. Elle tendit les mains avec un faible cri et en prononçant le nom de sa sœur.
—Elle me reconnaît, dit madame de Luxeuil, qui se pencha pour l’embrasser; pauvre chérie! dans quel état nous vous trouvons; sans nous vous étiez assassinée.
La baronne serra madame de Luxeuil dans ses bras sans répondre autrement que par des sanglots convulsifs.
—Allons, calmez-vous, dit la comtesse, en lui faisant quelques caresses qui semblaient moins dictées par la tendresse que par le désir de mettre fin à cette crise d’expansion; ne me serrez pas ainsi, vous allez vous faire mal. Il n’y a plus de danger; soyez tranquille, le docteur se charge de vous soigner et de vous guérir.
Elle accompagna ces mots d’un baiser dont elle effleura le front de la malade, puis se redressa, en défripant sa robe et passant les doigts dans les boucles de ses cheveux.
Malgré ses souffrances, la baronne fut, sans doute, frappée de cette légèreté indifférente, car elle regarda sa sœur, croisa les mains et tourna la tête avec une expression de désappointement douloureux.
Madame de Luxeuil n’y prit point garde: mobile et décousue, comme tous les esprits inoccupés, elle se mit à promener les yeux autour d’elle, et se leva pour se mirer dans une psyché placée en face de l’alcôve.
La comtesse était une de ces femmes du monde incapables d’affections, qui acceptent les sentiments de famille comme le reste de l’héritage, sous bénéfice d’inventaire. Tant qu’elle y trouvait son plaisir ou son profit, elle se montrait bienveillante, sinon affectueuse; mais dès que le lien lui devenait à charge, elle le brisait sans hésitation et sans remords. L’amitié qui l’unissait à la baronne ressemblait donc à ces sociétés léoniennes, où l’un des associés apporte tout et où l’autre seul en profite. Telle était, du reste, la naïveté de son égoïsme qu’on le lui pardonnait; car privées du sens moral la plupart des personnes du monde ne reconnaissent le vice, qu’aux efforts qu’il fait pour se cacher; celui qui se montre leur paraît, par cela seul, excusable. Aussi, madame de Luxeuil passait-elle surtout pour franche et naturelle. Cependant ceux qui la connaissaient mieux prétendaient que ce naturel et cette franchise n’étaient qu’une profondeur d’insensibilité, et que, pour servir ses intérêts, tout lui serait, non-seulement possible, mais facile.
Bien qu’on la trouvât, en général, spirituelle, sa personnalité sans honte lui donnait parfois l’apparence d’une sottise brutale. Pour voir loin et complétement, outre l’intelligence, il faut le cœur; mais le cœur de madame de Luxeuil n’avait point d’yeux, et comme les aveugles il ne connaissait rien en dehors de lui-même.
Des ressemblances apparentes avaient servi de lien entre la comtesse et M. Darcy. Ce dernier appartenait, comme elle, à l’école de ceux qui déclarent, «que l’on n’a pas trop de soi pour s’occuper de soi,» et qui proclament l’intérêt personnel la grande loi des sociétés humaines. Seulement l’égoïsme de M. Darcy rappelait ces contrées lointaines dont les anciens rois d’Espagne se prétendaient souverains, et qui n’existaient pas; il s’en glorifiait sans en profiter. Toujours prêt à s’oublier pour les autres, exploité par ses amis, dépouillé par les fripons, il masquait ses actes sous ses paroles, appelait sa générosité de l’insouciance, sa compassion du calcul, son dévoûment de l’activité, et rassurait ainsi sa conscience en se calomniant.
Ce prétendu égoïsme n’était pas, du reste, sa seule manie: il affectait, en outre, une haine implacable pour la religion catholique et pour ses prêtres. Au seul aspect de ceux-ci, on voyait son œil s’arrondir, ses lèvres se serrer, son menton s’enfoncer dans sa cravate et toute sa personne prendre une attitude farouche. Il avait fait de cette répugnance une sorte de sixième sens: il reconnaissait l’approche du prêtre comme on a dit que certains animaux reconnaissaient la présence du serpent. A l’en croire, le catholicisme avait seul produit tous les maux de l’humanité. C’était lui le véritable tentateur qui avait enlevé aux hommes le paradis terrestre; sans lui, les crimes eussent été ignorés, les instincts les plus féroces adoucis, et l’on eût vu, comme au temps de l’âge d’or, les tigres broutant le gazon à côté des génisses.
Il ne manquait jamais, comme on le pense, pour soutenir sa thèse, de rappeler la série de cruautés et de vices qui sont, dans la grande histoire de l’Église, comme ces décombres et ces immondices qui souillent les abords de nos plus sublimes monuments. Il savait au juste combien les papes avaient eu de bâtards, et combien l’inquisition avait brûlé d’innocents.
Cette monomanie anti-catholique ouvertement manifestée alors que le gouvernement de la Restauration tendait de toutes ses forces à la reconstitution du trône et de l’autel, avait bien moins nui qu’on eût pu le penser à la carrière scientifique du docteur Darcy. Elle avait même contribué à lui donner une physionomie, ce qui est, en toute chose, la première condition du succès. On l’appelait le docteur athée, et ce nom, loin d’être un épouvantail, était presque une recommandation. Les dévots les plus fervents voulaient le voir afin de le convertir; les plus curieux, seulement pour savoir quel air avait un athée. C’était un motif pour parler de lui dans les sociétés les mieux pensantes, pour déplorer qu’un si grand talent se fût laissé entraîner dans l’abîme ouvert par la philosophie, et pour chercher les moyens de l’en arracher. L’impiété du docteur devint ainsi une sorte de porte-voix pour sa réputation, et servit à l’agrandir.
Nous avons dit comment ses soins avaient réussi à ranimer la baronne. Dès qu’il la jugea en état de parler, il lui adressa quelques questions qui cachaient, sous leurs formes bienveillantes, la préoccupation du médecin; mais au moment même où la malade allait répondre, M. Vorel entra conduit par la nourrice.
Il arrivait du Vivier et venait d’apprendre les événements de la nuit dont il semblait tout ému. Sa belle-sœur fit un effort pour lui tendre la main et le présenter à M. Darcy, qui l’accueillit avec bienveillance; quant à la comtesse, elle répondit brièvement à son salut et à ses compliments, comme une personne qui souffre d’être forcée à la politesse, et demanda la permission de se retirer pendant que les deux médecins examineraient ensemble la malade.
Leur consultation dura longtemps. Lorsqu’ils rejoignirent madame de Luxeuil au salon, tous deux avaient l’air troublé.
—Ah! mon Dieu, qu’y a-t-il? s’écria la comtesse, en regardant M. Darcy.
—Une mauvaise nouvelle, répondit celui-ci, avec l’affectation de dureté des gens qui souffrent de vous affliger et qui ne veulent point en avoir l’air.
—Vous trouvez ma sœur bien mal?
—Mourante!
Madame de Luxeuil, qui prévoyait la réponse, poussa un cri préparé, se laissa tomber sur un fauteuil qu’elle avait remarqué d’avance, et renversa la tête en arrière, comme si elle eût été près de se trouver mal; mais le regard expérimenté de M. Darcy reconnut sur-le-champ qu’il n’y avait rien à craindre.
—Allons, belle dame, dit-il en prenant une de ses mains et la frappant avec distraction, comme s’il se fût agi de dissiper un évanouissement de théâtre, soyez raisonnable; vous-même aviez prévu ce malheur.
—Madame ne le supposait point sans doute si prochain, fit observer M. Vorel de sa voix la plus séduisante, et vous le lui avez annoncé si brusquement.
—Mourante! reprit madame de Luxeuil, enjoignant les mains, et avec l’incertitude d’une actrice qui répète la réplique pour se donner le temps de préparer son effet.
—Si vous faisiez respirer des sels à madame la comtesse, dit Vorel, en présentant à son confrère un flacon.
Celui-ci le prit d’un air insouciant et l’offrit à madame de Luxeuil qui l’accepta pour se donner une contenance.
—Et il n’y a plus d’espoir? demanda-t-elle; plus aucun espoir?
Le docteur parisien secoua la tête.
—Une phthisie, compliquée d’une affection au cœur, dit-il.
Madame de Luxeuil couvrit son visage de son mouchoir pour cacher les larmes qu’elle ne versait pas.
—Hier encore, lorsque je l’ai quittée, son état était loin d’être aussi alarmant, dit tristement M. Vorel; mais la terrible émotion de cette nuit a hâté les progrès du mal.
—Et maintenant il n’y a rien à faire, ajouta M. Darcy avec une brusquerie dont la rudesse cachait une sorte de sensibilité.
—Pauvre sœur, murmura le médecin de Bourgueil, succomber si jeune! quand sa fille avait tant besoin de ses soins!
M. Darcy qui s’était mis à parcourir le salon s’arrêta.
—Au fait, il y a une enfant, dit-il; la baronne peut avoir des mesures à prendre dans ses intérêts.
Personne ne répondit.
—Il faut que la malade soit avertie de sa position, reprit le docteur avec fermeté.
—Y songez-vous! s’écria madame de Luxeuil; ce serait la tuer.
—D’abord on ne tue pas une personne morte, reprit M. Darcy, avec sa logique implacable, et autant dire que la baronne ne vit plus, ses heures sont comptées; puis, c’est un devoir pour nous, Madame, un devoir rigoureux. Nous sommes là pour avertir le patient lorsque nous ne pouvons le guérir; ne point le faire est une trahison, une lâcheté, car ce n’est jamais lui que nous voulons ménager, mais nous-mêmes.
—Mais songez, docteur, à l’effet terrible d’une telle annonce!
—Pourquoi donc? qu’y a-t-il, après tout, de si redoutable dans cette transformation que l’on appelle la mort? Ce sont les prêtres qui l’ont entourée de fantômes hideux, de visions menaçantes. A force de mensonges, ils ont réussi à faire de ce passage entre deux états une espèce de pont à péage dont ils perçoivent tous les bénéfices. Mais, quoi qu’il en soit, la baronne doit être avertie; elle peut avoir des dispositions à prendre, et il ne faut pas que la mort l’enlève par surprise.
—Mais qui osera la prévenir?
—Moi, s’il le faut.
—Vous, docteur?
—Pourquoi pas? votre sœur a de l’esprit, je lui prouverai la sottise de toutes les superstitions dont on l’a épouvantée, et, quand elle saura qu’il n’y a rien après l’enterrement, et que nous sommes simplement une agrégation de molécules qui changent de forme, elle mourra aussi tranquillement que si elle s’endormait.
—Pardon, interrompit doucement M. Vorel, mais je doute que la baronne soit en état de suivre les raisonnements de mon savant confrère; ce serait, d’ailleurs, troubler inutilement ses derniers instants. S’il est nécessaire qu’elle soit avertie, je me résignerai à cette douloureuse mission.
—Soit, dit M. Darcy; il est plus convenable que l’avertissement vienne de votre part. Pendant que vous vous occuperez de cette affaire, je vais prendre quelques informations sur la route qui conduit à Norsauf. Vous permettez, comtesse?
Madame de Luxeuil fit un signe de consentement et le docteur sortit.
Son départ fut suivi d’un assez long silence. M. Vorel et la comtesse désiraient évidemment une explication; mais tous deux éprouvaient un égal embarras à l’entamer; la comtesse se décida enfin à parler.
—Je ne puis croire encore à la nécessité de l’affreuse révélation conseillés par le docteur, dit-elle, et, quel que soit le danger, je persiste à attacher plus d’importance au repos de la malade qu’à ses dernières dispositions.
—D’autant qu’elles sont déjà prises, ajouta M. Vorel; je n’ai point cru devoir m’expliquer à cet égard devant M. Darcy; mais avec madame la comtesse, c’est autre chose.
—Quoi! ma sœur a fait un testament? demanda madame de Luxeuil, visiblement inquiétée; et... vous savez sans doute.... ce qu’il contient?
—J’ai lieu de croire qu’il pourvoit à la tutelle de l’enfant de madame la comtesse.
—Mais... le choix des personnes chargées de cette tutelle... vous le connaissez?
—Je sais seulement qu’il a été fait en dehors de la famille.
—Que dites-vous? ma sœur confierait sa fille à des étrangers!
—Telle est sa volonté.
Madame de Luxeuil se leva.
—Est-ce bien vrai? s’écria-t-elle; on aurait osé!... Mais c’est une insulte pour tous les parents, Monsieur!
—En effet, dit M. Vorel, qui jeta un regard sourdement scrutateur sur son interlocutrice; il semble que M. le comte de Luxeuil aurait eu plus de droits qu’aucun autre...
—Je ne parle point pour nous, reprit madame de Luxeuil; ces tutelles sont toujours des charges pénibles... et difficiles... Mais il me semble qu’il est des convenances dont on ne peut s’affranchir. Introduire des étrangers dans les affaires de la famille; s’exposer à des procès... c’est de la part de ma sœur une conduite au moins singulière...
—Il faut songer, fit observer le médecin d’un ton conciliant, que la baronne est depuis longtemps souffrante, et que dans sa position on ne juge pas toujours aussi sainement les choses.
La comtesse leva la tête.
—C’est-à-dire que, selon vous, ma sœur ne jouit point de toute la liberté de son esprit, dit-elle vivement.
—Eh! eh! qui sait? répliqua M. Vorel, en pliant les épaules; toute maladie prolongée amène nécessairement un affaiblissement du cerveau.
—Mais, dans ce cas, ne doit-on pas venir au secours d’une intelligence défaillante, et la défendre contre ses propres erreurs?
Le médecin regarda madame de Luxeuil par-dessus ses lunettes bleues, et un éclair de joie traversa ses traits.
—Ce serait sans doute une chose heureuse, dit-il; et, dans l’intérêt de l’enfant, il serait désirable que ce testament fût regardé... comme inutile.
—C’est évident, reprit la comtesse; mais une fois connu, il sera maintenu, peut-être... la justice est si bizarre. En tout cas, il deviendrait l’occasion d’un débat fâcheux. Si ce testament est véritablement jugé préjudiciable à l’enfant... par ceux qui s’y intéressent sincèrement... comme vous et moi, Monsieur... pourquoi... le faire connaître?
—C’est juste, répliqua Vorel avec bonhomie; on pourrait le regarder comme non avenu... ou même... le supprimer.
—Dans l’intérêt d’Honorine! ajouta précipitamment la comtesse.
—C’est cela, reprit le médecin; parlez-en à la baronne, Madame, ou, si vous craignez de la fatiguer... procurez-vous la petite clef qu’elle porte suspendue au cou... elle ouvre le secrétaire d’ébène, et c’est là que se trouvent tous les papiers importants.
Madame de Luxeuil fit un pas vers la chambre de sa sœur.
—Je crains seulement une difficulté, continua Vorel, qui avait repris sa cravache et son chapeau.
—Une difficulté? dit la comtesse.
—M. le docteur Darcy va revenir persuadé que j’ai fait connaître à la malade sa situation: il lui répétera tout ce qu’il nous a répété tout à l’heure, et la baronne, ainsi ramenée à de tristes pensées, pourra prendre de nouvelles dispositions... appeler un notaire, peut-être!
—Ah! vous avez raison! s’écria madame de Luxeuil; j’avais oublié le docteur: il est homme à faire venir ici tous les gardes-notes de Château-Lavallière!... il a si peu de sensibilité!... Mon Dieu! mais comment faire, alors?
—Je ne vois aucun moyen... à moins que madame la comtesse ne puisse le renvoyer.
Madame de Luxeuil parut frappée.
—Attendez donc, dit-elle, il a quelqu’un à voir dans les environs... Mais il ne devait y aller que demain; comment le décider à partir sur-le-champ?
—N’est-ce que cela? demanda M. Vorel en souriant; si madame la comtesse le désire, je m’en charge.
—Vous, et de quelle manière, Monsieur?
—Madame la comtesse va en juger; voici justement le docteur.
Le docteur parut étonné de retrouver M. Vorel au salon.
—Je croyais mon confrère près de la baronne, dit-il, et occupé de lui faire connaître sa situation.
—Ce soin est désormais inutile, Monsieur, répliqua Vorel d’un ton grave; la baronne a compris elle-même que tout espoir était perdu.
—Vous l’avez donc vue?
—Elle vient de faire demander un prêtre.
M. Darcy tressaillit.
—Elle aussi? s’écria-t-il; quoi! madame la baronne Louis! Eh bien! j’avais meilleure opinion de sa raison. Pauvre femme! ils vont la préparer au ciel d’après la méthode recommandée par Pascal, en l’abrutissant.
—Ah! pas d’impiété dans un pareil moment, docteur, interrompit madame de Luxeuil.
—Vous avez raison, reprit Darcy en s’inclinant; la maladie est une royauté, et jamais royauté n’a été tenue d’avoir le sens commun. Aussi, ne ferai-je à la baronne aucune objection.
—Elle attend de vous davantage, Monsieur, reprit Vorel; elle espère que vous ne refuserez point de l’assister dans cette dernière épreuve.
—Comment?
—Elle désire que vous vous trouviez là... avec son confesseur.
Darcy fit un soubresaut.
—Moi! s’écria-t-il.
—C’est une idée de malade, continua Vorel; elle assure que votre présence lui donnera plus de calme... de résolution; qu’elle accomplira avec moins de tremblement ses derniers devoirs religieux.
—C’est-à-dire que je l’encouragerais à se livrer aux prêtres? interrompit le docteur avec une sorte d’indignation; mais elle ne me connaît donc pas, Monsieur? Elle ignore donc mon mépris pour les parades de la superstition?
—Vos opinions resteront libres, fit observer le médecin de Bourgueil, il s’agit seulement d’être présent. Pour les spectateurs, tout se borne à un signe de croix et à une génuflexion.
M. Darcy, qui se promenait dans la salle, s’arrêta court.
—Une génuflexion!... un signe de croix!... répéta-t-il, avec une surprise mêlée de colère; et vous croyez que je me soumettrai à de pareilles conditions, Monsieur? que je participerai à des momeries honteuses?...
—Docteur! interrompit la comtesse scandalisée.
—Honteuses, Madame! insista-t-il avec chaleur; moi, Jean-François Darcy, agenouillé devant une soutane!... mais rien que la proposition est une insulte!
—Pardon, dit M. Vorel, d’un air déconcerté; je puis vous affirmer que mon intention...
—Il ne s’agit pas de votre intention, Monsieur, mais du fond, reprit Darcy vivement. Avez-vous réfléchi à ce que mes amis diraient, à Paris, si je consentais? Je serais déshonoré, Monsieur!... et le clergé! quel triomphe pour lui! Un athée connu, avoué, patenté, qui aurait fait le signe de la croix!!! Il ne me resterait plus, après cela, qu’à obtenir l’absolution et à communier! Non, Monsieur, non, la baronne serait ma propre mère, ma sœur, ma fille, que je refuserais!
—Mon Dieu! que faire alors? dit M. Vorel d’un ton chagrin et désappointé; ma sœur avait tant compté sur la présence du docteur! je crains qu’elle ne voie, dans son refus, une sorte d’abandon...
—Il est certain, fit observer la comtesse, que les motifs de ce refus sont si étranges...
—Le mieux, reprit Vorel indécis, serait, peut-être, de supposer le départ de M. Darcy.
—Parbleu! qu’à cela ne tienne, interrompit le docteur, je puis faire demander des chevaux.
Le médecin de Bourgueil et la comtesse échangèrent un regard; M. Darcy était allé prendre, sur la console, sa canne et son chapeau.
—Vous ne parlez pas sérieusement, dit la comtesse qui voulait hâter le départ en ayant l’air de s’y opposer; il est impossible que vous nous quittiez dans un pareil moment.
—Le moment ne saurait être, au contraire, mieux choisi, belle dame, répliqua Darcy: quand les prêtres viennent, les médecins n’ont plus rien à faire.
—Mais vos soins?...
—Sont malheureusement inutiles. Monsieur Vorel, d’ailleurs, vous reste: de grâce ne me retenez pas; si je demeurais et que le hasard me fît rencontrer vos porteurs d’extrême-onction, je serais capable de commettre quelque énormité. Par amitié, par prudence, laissez-moi partir.
Madame de Luxeuil fit encore quelques objections, puis enfin parut céder; M. Darcy prit congé d’elle, en promettant de revenir le surlendemain et sortit accompagné du médecin de Bourgueil.
Restée seule, la comtesse se hâta de retourner près de la malade.
Elle la trouva livrée à une somnolence agitée qui la rendait étrangère à tout ce qui se passait autour d’elle. Cependant au pied du lit jouait l’enfant riante et ranimée, tandis que la jeune nourrice se tenait assise près du chevet.
Madame de Luxeuil congédia cette dernière et prit sa place à côté de la malade.
Le soin qu’elle mettait à fuir toute sensation pénible l’avait jusqu’alors tenue éloignée de ces lugubres spectacles, et c’était la première fois qu’elle se trouvait en présence d’une mourante. Mais cette vue, qui pénètre habituellement les âmes d’un attendrissement involontaire, n’excita chez elle qu’une répulsion mêlée d’effroi. Au lieu d’y trouver une émotion qui réveillât plus vivement son amitié pour sa sœur, elle n’y trouva qu’un avertissement funèbre qui lui fit faire un retour sur elle-même. Ce cœur, froid pour tout le monde, avait toujours été, pour la baronne, insensible et ennemi. Cette hostilité datait de l’enfance. Restées orphelines presque au berceau, les deux sœurs avaient été élevées séparément par deux tantes mortellement brouillées qui s’étaient efforcées de leur laisser l’héritage de leur haine. La baronne plus tendre et plus généreuse s’était soustraite, en partie, à cette funeste influence; mais madame de Luxeuil avait accepté sans résistance tous les préjugés qui devaient l’éloigner de sa sœur. Les débats d’intérêt et la jalousie vinrent encore envenimer, plus tard, ces dispositions. Confinée dans les rangs de cette portion de noblesse qui était restée hostile à l’Empire, parce que l’Empire ne s’était point soucié d’elle, la comtesse avait vu l’élévation de sa sœur avec un dépit mal déguisé sous l’apparence du dédain. Son aversion s’était ainsi lentement accrue de toutes les souffrances de son orgueil et de son envie. La conversation de la baronne et du médecin de Bourgueil a déjà fait connaître au lecteur comment cette aversion s’était révélée à plusieurs reprises, par des torts toujours renouvelés d’une part, et toujours pardonnés de l’autre.
La confidence que venait de lui faire M. Vorel avait encore aigri la comtesse contre sa sœur. Le testament annoncé trompait trop d’espérances pour qu’elle n’y vît pas une insulte. Aussi, après la première sensation de saisissement dont nous avons parlé, jeta-t-elle sur la mourante un regard qui exprimait plus de ressentiment que de pitié. Cependant, ce regard s’arrêta tout à coup sur un ruban, à l’extrémité duquel une petite clef, d’un travail précieux, se trouvait suspendue. Madame de Luxeuil tourna les yeux vers le secrétaire d’ébène désigné par M. Vorel, afin de juger si c’était bien la clef qui devait l’ouvrir, puis, se levant avec précaution, elle avança doucement la main et saisit le ruban.
Dans ce moment, la malade fit un mouvement, entr’ouvrit les yeux, et, apercevant la comtesse dont le visage était près du sien, elle jeta un bras sur son épaule avec un cri plaintif. Il y eut pour madame de Luxeuil un moment plein d’angoisse. La tête à demi penchée, elle apercevait l’enfant, qui lui souriait, au pied du lit, et sentait la main de sa sœur qui effleurait sa joue. Malgré son insensibilité elle s’arrêta hésitante et troublée; mais bientôt les doigts de la malade redevinrent immobiles. La main glissa de son épaule sur le lit, et les yeux se fermèrent.
Elle attendit un instant, puis dénouant avec adresse le ruban, elle enleva la clef, laissa tomber le rideau de l’alcôve, courut au secrétaire et l’ouvrit.
La plupart des compartiments étaient remplis de lettres soigneusement rangées, ou de notes écrites par la baronne. Quelques-unes renfermaient des nœuds de ruban, des anneaux, des fleurs flétries, trésors mystérieux dont la mourante seule eût pu dire le prix. Au milieu, et dans la plus grande case, se trouvaient des papiers d’affaires. Ce fut là qu’après une assez longue recherche, Madame de Luxeuil découvrit un paquet cacheté sur lequel était écrit:
MES DERNIÈRES VOLONTÉS.
Elle s’en empara vivement, regarda autour d’elle, brisa l’enveloppe et déploya le papier qu’il renfermait.
C’était le testament annoncé par M. Vorel.
La comtesse le parcourut rapidement, et en trouva toutes les dispositions conformes à ce que lui avait dit ce dernier. Elle froissa le papier avec colère et regarda vers le foyer; mais, au moment de refermer le secrétaire, elle s’arrêta indécise. Son œil le parcourut encore une fois, comme si elle eût craint qu’il ne renfermât une seconde copie de l’acte qu’elle tenait. Penchée pour mieux voir, elle prenait successivement chaque papier, qu’elle examinait rapidement, lorsqu’un petit coffret de chagrin, caché au fond du dernier compartiment, frappa tout à coup son regard; elle l’attira à elle, fit jouer le ressort et tressaillit.
C’était le portrait du duc de Saint-Alofe!
Sous la miniature se trouvaient plusieurs lettres de lui et quelques réponses de la baronne.
Un éclair de triomphe illumina les traits de madame de Luxeuil. Ces preuves, si longtemps désirées et sans lesquelles ses accusations contre sa sœur avaient pu être repoussées comme des calomnies, elle les tenait enfin, écrites de la main même des accusés! La joie d’une pareille découverte lui fit oublier tout le reste; elle renversa brusquement le coffret, en éparpilla les lettres sur le secrétaire, ouvrit la première et commença à lire!
Une exclamation étouffée l’interrompit.
Elle se retourna; la mourante avait soulevé le rideau de l’alcôve et la regardait!
Par un mouvement rapide et instinctif, la comtesse s’éloigna du secrétaire, en s’efforçant de cacher les papiers qu’elle tenait; mais sa sœur s’était soulevée avec un effort violent.
—J’ai vu... j’ai vu! bégaya-t-elle.
—Quoi donc? demanda madame de Luxeuil troublée.
—Le testament!... c’est lui... je l’ai reconnu... vous l’avez pris là... A moi! Quelqu’un!... du secours!
La voix de la malade avait un accent de terreur et s’était élevée; sa main rencontra le cordon de la sonnette qu’elle tira avec violence.
—Que faites-vous? s’écria madame de Luxeuil en s’élançant vers l’alcôve.
—Ce papier, répéta la baronne, qui s’efforça de saisir le bras de sa sœur, rendez-le moi, je le veux!
La comtesse sembla hésiter un instant; mais tout à coup elle se dégagea, courut au foyer et jeta le testament dans les flammes.
La mourante poussa un cri et voulut se précipiter hors du lit; mais les forces lui manquèrent. Il y eut pendant quelques instants une lutte affreuse à voir entre sa volonté et sa faiblesse: la tête dressée, les bras tendus, et cherchant un point d’appui dans le vide, le corps tordu dans un effort suprême, elle se souleva trois fois à demi, mais enfin, épuisée, elle se laissa retomber sur son oreiller, la tête renversée en arrière, les deux mains sur ses yeux, et en poussant un gémissement désespéré.
Dans ce moment, madame de Luxeuil entendit un bruit de pas dans l’escalier, et reconnut la voix de la jeune nourrice. Craignant qu’elle n’eût entendu l’appel de sa maîtresse, elle courut à sa rencontre pour l’empêcher d’entrer, et la malade se trouva de nouveau seule avec sa fille.
Pendant quelques minutes tout resta immobile et silencieux autour d’elle. On n’entendait que le bruit du vent qui grondait dans les corridors de la maison isolée, et la respiration précipitée de la mourante, qu’entrecoupaient des sanglots; mais enfin un léger bruit retentit; la petite porte du cabinet, placée près de l’alcôve s’entr’ouvrit lentement et laissa passer la tête pâle du Rageur.
Il regarda d’abord autour de lui, traversa la pièce avec précaution, et, après avoir fermé au verrou les deux autres portes, il revint au lit de la malade et s’agenouilla près du chevet.
Lorsqu’une heure après madame de Luxeuil revint avec M. Vorel, tous deux trouvèrent la malade plongée dans un abattement qui ne lui permettait plus ni le mouvement ni la parole. Son haleine était courte et sifflante, son regard vitreux, ses lèvres convulsivement agitées. Le médecin de Bourgueil connaissait trop bien ces symptômes pour s’y tromper; il examina quelques instants la malade, consulta son pouls et fit un signe à madame de Luxeuil.
Quelle que fut la dureté de la comtesse, cet avertissement sinistre la troubla; elle détourna la tête et s’éloigna brusquement de l’alcôve.
Un imperceptible sourire effleura alors les traits du médecin, et ses regards se reportèrent sur la mourante. La vue de son agonie semblait exciter en lui je ne sais quelle curiosité cruelle; il en suivait les crises avec une insensibilité attentive, comptait les convulsions, et regardait la vie s’échapper goutte à goutte comme une eau fuyante.
L’enfant, appuyée sur l’épaule de sa mère, jouait avec ses cheveux épars, et mêlait au râle de l’agonie ses rires et ses gazouillements. Pendant longtemps on n’entendit dans la chambre que ce double murmure sinistre et joyeux. Enfin, tous deux s’affaiblirent peu à peu et s’éteignirent presque en même temps.
Madame de Luxeuil, qui était debout près de la fenêtre, se retourna saisie, et s’approcha vivement de l’alcôve.
L’enfant venait de s’endormir sur les lèvres de sa mère morte en lui donnant un dernier baiser!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La comtesse se laissa conduire par M. Vorel hors de la chambre funéraire; mais après les premiers moments d’affliction obligée, elle se rappela sa nièce et demanda à la voir.
La nourrice avertie apporta Honorine.
Madame de Luxeuil prit l’enfant dans ses bras et déclara qu’elle ne la quitterait plus.
—Je n’avais qu’un fils, dit-elle en se tournant vers le médecin avec une sensibilité jouée, maintenant j’aurai aussi une fille.
M. Vorel s’inclina.
—Je suis sincèrement touché, pour ma part, des généreuses intentions de madame la comtesse, dit-il; malheureusement elles pourront rencontrer quelques obstacles.
—Des obstacles! répéta madame de Luxeuil étonnée, et lesquels, Monsieur?
—D’après ce que madame la comtesse m’a fait l’honneur de me confier, reprit le médecin, les dispositions testamentaires de notre pauvre et chère baronne peuvent être considérées comme non avenues.
—Eh bien?
—Eh bien! madame la comtesse, dans ce cas l’orpheline rentre sous la loi commune.
—Mais cette loi me permet, je suppose, de remplacer la mère d’Honorine.
—Pour l’affection, sans aucun doute, madame la comtesse; mais pour l’administration des biens elle appartient au tuteur.
—M. le comte de Luxeuil en prendra le titre, Monsieur.
—Pardon, dit Vorel avec déférence; mais je ferai observer à madame la comtesse que ce titre ne se prend pas; on le reçoit du conseil de famille.
—Soit. Pensez-vous qu’il puisse le refuser au comte?
—Je ne présume rien; je rappelle seulement que c’est à ce conseil de faire un choix.
—Et qui pourrait-il choisir, Monsieur? Honorine n’est-elle point la nièce de M. de Luxeuil?
—Incontestablement, madame la comtesse, elle est sa nièce... comme elle est la mienne.
Madame de Luxeuil fit un mouvement et regarda le médecin en face.
—Que voulez-vous dire? demanda-t-elle.
—Je veux dire, répondit M. Vorel tranquillement, que si la famille l’exige, je suis prêt à prouver quel fut mon attachement pour la mère en servant de protecteur à la fille.
La comtesse ne put retenir un cri de surprise. La prétention du médecin était quelque chose de si audacieux, que, dans le premier moment, elle hésita à la prendre au sérieux. Mais l’air et l’accent de M. Vorel ne permettaient aucun doute.
—Ainsi, s’écria-t-elle, vous comptez nous disputer la tutelle?
—C’est sans doute se montrer bien hardi, répliqua Vorel avec humilité; mais je tiens à prouver que mon dévouement ne le cède en rien à celui de madame la comtesse.
Celle-ci rougit de colère et fit un geste violent.
—Ah! je comprends, dit-elle d’un accent indigné; vos confidences de ce matin étaient un piége; vous ne désiriez la suppression du testament que dans l’intérêt de vos propres espérances, et, après vous être servi de moi pour enlever l’obstacle, vous comptez arriver seul au but.
—Je compte seulement témoigner de mon zèle, fit observer tranquillement Vorel, en offrant d’épargner à madame la comtesse la charge de la tutelle.
—Et qu’en voulez-vous faire, enfin, de cette tutelle, Monsieur? demanda madame de Luxeuil poussée à bout.
—C’est une question que l’on pourrait également adresser à madame la comtesse, fit observer doucement le docteur.
—Ah! je vous devine, s’écria celle-ci exaspérée; l’administration des biens de cette enfant vous permettra d’accroître votre fortune.
—Et madame la comtesse, répliqua Vorel, préférerait qu’elle servît à réparer la sienne?
Madame de Luxeuil se leva l’œil menaçant et les lèvres pâles.
—Prenez garde, dit-elle, la voix tremblante de colère, prenez garde à ce que vous dites, Monsieur! Je ne suis point de celles qu’on peut insulter impunément...
—Aussi n’ai-je point songé à insulter madame la comtesse, dit Vorel, respectueusement railleur; elle parle, et je réponds...
—Brisons là, interrompit madame de Luxeuil d’un ton hautain; de plus longues explications sont inutiles. Puisque l’on prétend nous disputer la fille de ma sœur, nous saurons faire valoir nos droits.
—Madame la comtesse en trouvera bientôt l’occasion, ajouta le médecin, car le conseil de famille doit se réunir dans quelques jours.
—Quel conseil de famille, Monsieur?
—Celui que le juge de paix de Château-Lavallière doit convoquer d’office pour la constitution de la tutelle.
La comtesse parut stupéfaite.
—Est-ce possible! s’écria-t-elle, c’est ici que vous ferez décider?... et par un conseil composé de gens que vous connaissez?... dont la complaisance vous est assurée?... Ah! n’espérez pas, Monsieur, que j’accepte ces délibérations.
—Madame la comtesse ne peut songer à arrêter le cours de la loi, objecta Vorel; le conseil sera formé, comme le veut l’article 407, de six parents ou alliés pris dans le voisinage, et son choix, quel qu’il puisse être, restera inattaquable.
—Je prouverai le contraire, dit la comtesse impétueusement, car je l’attaquerai sans relâche et par tous les moyens. Vous avez voulu la guerre, vous l’aurez! Rappelez-vous, Monsieur, qu’à partir d’aujourd’hui je suis votre ennemie!
—Je me le rappellerai, dit le médecin avec une douceur souriante.
Et saluant humblement madame de Luxeuil, il se retira.
Mais cette modération affectée augmenta l’irritation de la comtesse, en même temps que ses inquiétudes. Quelle que fût son inexpérience en affaires, elle avait compris que M. Vorel était appuyé par le Code, et un homme de loi, qu’elle fit demander, confirma toutes ses craintes. Au juge de paix seul appartenait la composition du conseil de famille, et la décision de ce dernier devait être souveraine.
Ce fut donc de ce côté que la comtesse dut diriger toutes ses tentatives. Son titre, ses relations, son crédit, lui donnaient une autorité dont elle s’efforça de tirer parti. Elle visita successivement tous les membres du conseil, employant la flatterie et les promesses pour gagner des voix au comte de Luxeuil.
Mais M. Vorel la suivait partout, et n’épargnait aucun effort pour les lui enlever. A l’influence que son adversaire tenait de la naissance, il opposait celle que lui donnait sa profession. Car, à notre époque, l’autorité du médecin est devenue aussi étendue que redoutable. Confident obligé de secrets honteux, ridicules ou terribles, conseiller des actes les plus intimes de la vie domestique, tenant presque toujours dans ses mains l’honneur des familles, il s’est constitué le véritable prêtre de cette société matérialisée qui ne s’est affranchie de l’âme que pour devenir esclave du corps. La plupart des juges futurs de Vorel étaient ses clients, et il les tenait tous par les liens du souvenir, de la prudence ou de la peur. Il profita habilement de cette position pour combattre madame de Luxeuil et s’assurer l’appui dont il avait besoin.
Cependant, lorsque le jour de la réunion arriva, il lui restait encore quelques doutes sur le résultat de la délibération qui allait avoir lieu.
Les membres du conseil de famille étaient tous rassemblés dans le grand salon de la Maison Verte. Près de l’une des fenêtres se tenait le médecin dont les regards inquiets parcouraient la réunion, comme s’il eût voulu deviner les dispositions secrètes de chacun; un peu plus loin était assise la nourrice avec l’orpheline sur ses genoux; enfin, à ses côtés se tenait madame de Luxeuil en grand deuil, et affichant pour l’enfant les soins les plus tendres.
Le juge de paix avait ouvert la délibération et donné successivement la parole à la comtesse et à M. Vorel qui avaient fait valoir leurs droits. On venait enfin de passer au vote, et le résultat de la délibération allait être connu, lorsque la porte s’ouvrit avec violence, et laissa voir un homme en blouse, debout sur le seuil: c’était le Rageur.
Il promena d’abord un regard rapide sur l’assemblée, puis s’avançant hardiment, il s’écria:
—Qui de vous est le juge?
—Que lui voulez-vous? demanda ce dernier en se levant.
Le Rageur se découvrit.
—Que ce qui vient d’être fait soit détruit, dit-il; car j’apporte un acte qui annule tout.
Et tirant de son sein un papier qu’il posa sur la table placée devant le conseil:
—Lisez, ajouta-t-il; ceci est le testament de la baronne Louis, écrit de sa main et signé par elle!
Les cris poussés par la comtesse et par M. Vorel furent si spontanés, qu’ils se confondirent en un seul cri. Tous deux se levèrent en même temps, coururent au juge et se penchèrent sur le papier qu’il venait d’ouvrir.
C’était bien l’écriture de la morte!
Ils se regardèrent avec une stupéfaction muette.
Les membres du conseil avaient également quitté leurs places et entouraient le juge qu’ils questionnaient tous à la fois; celui-ci les interrompit d’un geste; tous firent silence et il lut ce qui suit:
«J’écris à la hâte, déjà glacée par la mort; mais avec ma raison entière et tout mon souvenir.
»Ceci est ma volonté suprême; j’en recommande l’exécution à tous ceux qui m’ont aimée, à la loi et à Dieu.
»Je donne pour tuteur à Honorine, ma fille, le duc Charles-Henri de Saint-Alofe, et, à son défaut, M. le conseiller de Vercy. Je recommande à tous deux la conservation de ce qui lui appartient et la défense de ses droits.
»Quant à son éducation, je désire qu’elle soit confiée à la mère Thérèse, prieure de Tours.
»Je laisse enfin à ma fille la moitié d’un anneau que j’ai longtemps porté, et je la recommande au souvenir de celui qui possède l’autre moitié.
»Fait au château La Vallière, ce 30 septembre 1818.
»Baronne Louis,
»Née de Mézerais»
Il y eut une assez longue pause après cette lecture. Le Rageur en profita pour s’approcher de l’enfant et lui passa au cou un ruban auquel pendait la moitié d’une bague à garniture d’émeraude. M. Vorel, qui était resté un instant étourdi, tressaillit à cette vue.
—D’où tiens-tu cet anneau? s’écria-t-il en s’avançant brusquement vers le Rageur. Qui es-tu? Comment cette pièce t’a-t-elle été remise?
—Cette pièce m’a été remise par celle qui l’a écrite, répliqua le Rageur avec fermeté. Mon nom est Marc Avril, et je tiens l’anneau de la baronne.
—Tu lui as donc parlé?
—Oui.
—Quand cela?
—Quelques instants avant sa mort.
Le médecin regarda madame de Luxeuil.
—Il ment! s’écria celle-ci, car j’étais là, je l’aurais vu. Que cet homme dise comment il a pu parvenir, à mon insu, jusqu’à la mourante.
Le Rageur parut embarrassé.
—Que vous importe? dit-il.
—Réponds! s’écria M. Vorel frappé de son trouble; je veux savoir par quel moyen tu es entré ici?
—Ah! je le sais, moi, interrompit la nourrice qui venait de s’approcher, et qui, depuis un instant, regardait le Rageur avec effroi.
—Vous avez déjà vu cet homme? demanda le médecin vivement.
—Oui, reprit-elle en reculant... c’est lui... j’en suis sûre...
—Qui donc?
—Un de ceux qui sont venus il y a huit jours... pour nous égorger!
Le Rageur recula en pâlissant et voulut s’élancer vers la porte; mais M. Vorel l’avait déjà refermée.
Au même instant, tous les bras s’avancèrent vers lui, et, après une courte lutte, il fut saisi et garrotté.
Quiconque a essayé la vie de touriste, sait que les voyages n’offrent jamais une continuité d’aspects ni d’impressions, mais qu’ils se composent de stations rares, éparses, et souvent séparées l’une de l’autre par de longs espaces qui ne peuvent intéresser l’esprit ni attirer le regard. La création semble avoir, comme l’art, des musées où elle réunit toutes ses merveilles, et hors desquels on ne trouve que la monotonie ou le vide. Entre la mer aux grèves sauvages et la montagne aux vallons arcadiens, s’étend la plaine unie, paisible, verdoyante, où les bois continuent les bois, où les prairies suivent les prairies, et qu’il faut traverser au galop des chevaux.
Or, le romancier a, comme le touriste, de longs intervalles, qu’il doit faire franchir rapidement au lecteur. Pour lui n’existent ni la distance ni le temps. Semblable à l’ange révolté qui enleva le Christ sur la montagne, il montre à ceux qui l’écoutent, non l’humble campagne qui se déroule à ses pieds, mais tout ce qu’il a pu réunir de tentateur et de merveilleux aux quatre aires de vent. Dédaigneux des lenteurs de la réalité, il parle, et un autre horizon se lève, et l’homme jeune est devenu un vieillard, et l’enfant, transformé, apparaît couronné de force et de jeunesse.
Nous profiterons de ce dernier privilége pour franchir d’un bond seize années, et présenter à nos lecteurs l’orpheline de la Maison-Verte, non plus chétive et souffrante, mais grande et belle jeune fille devant laquelle le monde va s’ouvrir.
Les dernières volontés de la baronne avaient été accomplies; confiée à la supérieure de Tours, Honorine grandit au couvent, sans s’apercevoir qu’il lui manquait une famille.
Celle-ci, de son côté, l’oublia complétement. En perdant l’espérance de la tutelle, madame de Luxeuil et M. Vorel avaient semblé renoncer à tout lien de parenté. La première, devenue veuve, ne s’informa plus de sa nièce, et le médecin, qui avait réussi à se réconcilier avec la mère Louis, alla habiter le domaine des Motteux, d’où il parut demeurer également étranger à tout ce qui concernait l’orpheline.
Mais cette dernière avait trouvé au Sacré-Cœur de quoi la dédommager de cet abandon. La supérieure l’y avait d’abord reçue avec une tendresse passionnée qui se communiqua insensiblement aux autres religieuses. Habituellement consacrées à l’instruction de jeunes filles déjà grandes, celles-ci donnaient pour la première fois leurs soins à une enfant, et cette nouveauté réveilla en elles les instincts de la femme, endormis plutôt qu’étouffés: avec leurs autres élèves, elles n’étaient qu’institutrices, avec Honorine elles devinrent mères. Grâce à elle, chaque recluse connut quelque chose de ces inquiétudes, de ces attentes, de ces saisissements qui sont la vie de famille, et donnent seuls de la saveur à la joie. Il y eut un intérêt et une émotion dans leur solitude.
Aussi ce fut à qui aurait la meilleure part de cette maternité spirituelle; toutes ces âmes, pleines d’expansions retenues, assiégeaient l’âme naissante de l’enfant pour y éveiller une sympathie et prendre date dans sa tendresse.
Honorine, d’abord souffrante, se ranima insensiblement au milieu de cette atmosphère de caresses, et, fières de leur œuvre, les religieuses l’aimèrent davantage en la voyant revivre. Sa santé, sa joie, sa beauté, tout leur appartenait; elles en faisaient leur bonheur et leur gloire, en même temps que leur tourment. Toutes leurs existences tenaient, par le fil invisible du dévouement, à cette existence sauvée.
Tant d’abnégation pouvait amener la mollesse, ou encourager l’égoïsme; l’heureuse nature d’Honorine la sauva de ce danger. Elle accepta l’affection de celles qui lui servaient de mère, avec la simplicité d’un cœur capable de rendre ce qu’on lui donne. Gaie et charmante, elle devint le bonheur du couvent après avoir été sa sollicitude. A mesure qu’elle grandissait, celui-ci semblait s’animer de sa jeunesse; on eût dit un soleil levant dont les rayons, chaque jour plus vifs, réveillent partout la vie qui sommeille.
Et sa présence n’avait point été seulement pour ces pieuses filles une cause de joie, mais d’amélioration; car dans cette affection commune s’étaient fondues toutes ces petites aigreurs des cœurs inoccupés. Chaque religieuse, désormais, avait un intérêt humain, un but visible, et sa vie ne restait point uniquement renfermée dans les énervantes aspirations vers l’inconnu.
Elles se partagèrent l’instruction d’Honorine, qui reçut leurs leçons, pour ainsi dire à son insu, et sans distinguer la récréation de l’étude. Douée d’un de ces esprits heureux où toute graine semée germe d’elle-même, elle ne connut ni la fatigue du travail, ni l’angoisse des réprimandes, et atteignit douze ans presque sans connaître les larmes.
Vers cette époque arriva un événement de peu d’importance, mais qui, dans la vie paisible et uniforme de l’orpheline, ne pouvait manquer de laisser un souvenir. La supérieure prit un nouveau jardinier. C’était un vieillard à cheveux blancs, mais dont l’aspect robuste semblait démentir l’âge. Dès les premiers jours, il distingua Honorine parmi ses compagnes, et se prit pour elle d’une affection singulière. Chaque fois que l’enfant paraissait dans le jardin, il interrompait son travail pour la suivre d’un regard qui semblait s’attendrir; il reconnaissait sa voix et jusqu’à sa manière de courir derrière les charmilles; lors même qu’elle n’était plus là, il continuait à s’occuper d’elle, en soignant le petit parterre qui lui avait été donné.
Il ne lui parlait, du reste, que rarement et toujours pour répondre à quelque question; son dévouement était humble et muet comme celui du chien. Lorsqu’il voulait montrer à l’enfant quelque fleur rare, cultivée à son intention, ou quelque fruit cueilli pour elle, il faisait entendre un sifflement cadencé qu’elle connaissait et qui la faisait accourir. On s’était d’abord un peu étonné, au couvent, de cette préférence passionnée, mais telle était l’amitié de tout le monde pour l’enfant, qu’on avait fini par la trouver naturelle. Quant à Honorine, accoutumée aux soins empressés de ses institutrices, elle accepta ceux d’Étienne avec reconnaissance, mais sans surprise. Elle ne passait jamais près du vieillard sans lui adresser un sourire ou un salut amical, et Étienne, qui tressaillait à sa voix, ne répondait que par un geste, par un coup d’œil, tout au plus par un mot tremblant qui révélait je ne sais quel mélange d’angoisse et de joie.
Le jardin du couvent ne formait qu’une petite partie de son enclos. Celui-ci comprenait, en outre, des vergers, un bois et des prairies, à l’extrémité desquelles se trouvait un vivier assez profond pour porter une nacelle. Les religieuses aimaient à s’y embarquer avec quelques élèves choisies et à faire le tour du petit étang pour couper les joncs et cueillir les fleurs de nénuphar.
Un jour qu’Étienne se trouvait au bout du verger, où il recevait les ordres de la prieure, des cris de détresse se firent entendre vers le vivier. Tous deux accoururent effrayés et aperçurent la barque chavirée. La religieuse et une pensionnaire flottaient, près de s’engloutir au milieu des roseaux!
Étienne laissa tomber sa veste, ses sabots, son tablier, et s’élança à leur secours.
Au bout de quelques instants, toutes deux furent à terre; mais à peine la religieuse eut-elle repris ses sens qu’elle regarda autour d’elle et s’écria avec épouvante:
—Honorine?
—Vous l’aviez avec vous? demanda Étienne qui devint pâle.
—Ah! sauvez-la! sauvez-la!...
Il n’en entendit pas davantage, courut vers l’étang, les bras étendus, il s’élança d’un bond jusqu’à la barque et disparut sous les eaux.
Les religieuses accourues se pressaient sur le bord avec des sanglots. Trois fois Étienne remonta seul en poussant des cris de désespoir; trois fois il replongea au plus profond de l’étang, avec une sorte de rage, enfin il reparut soulevant dans ses bras Honorine, regagna le bord et la déposa à l’ombre des saules.
Les religieuses éperdues s’empressèrent autour de l’enfant inanimée; et, après des efforts longtemps infructueux, un cri de joie partit, elle avait fait un mouvement... elle vivait!
A ce cri, Étienne qui se tenait près d’elle à genoux, le corps penché, tous les membres tremblants et l’œil égaré, joignit les mains avec un sourd gémissement de joie, et s’évanouit.
Le médecin que l’on avait envoyé chercher survint heureusement. Après avoir rassuré les religieuses, il les engagea à reconduire au couvent Honorine, complétement ranimée, tandis qu’il aidait lui-même à transporter le jardinier dans la maisonnette qu’il occupait au bout des prairies.
Il en revint bientôt annonçant qu’il avait repris connaissance et ne courait aucun danger; mais il demanda la supérieure, lui parla à l’écart, et l’on apprit le soir même, avec étonnement, qu’Étienne appelé et longtemps entretenu par elle avait quitté le couvent pour n’y plus revenir.
Honorine se montra sérieusement affligée de ce départ et fit de vaines tentatives pour en connaître la cause; tout ce qu’elle put apprendre, c’est qu’en le jugeant nécessaire, la supérieure l’avait vu avec regret, et conservait pour l’ancien jardinier un profond sentiment de reconnaissance.
Cette aventure fut la seule qui traversa l’enfance d’Honorine; les années suivantes s’écoulèrent sans lui laisser d’autre trace de leur passage que le vague souvenir d’un bonheur toujours renouvelé. Appuyée sur des mains amies, elle passa, par une pente insensible, des gaietés du premier âge aux enchantements de la jeunesse.
On croit en général l’éducation de couvent triste, austère et pleine de pruderie; mais, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, on s’abuse. Nulle part ailleurs, au contraire, la vie n’est plus égayée de ces petits plaisirs qui sont le pain quotidien de la joie, nulle part vous n’avez à craindre moins de contrainte, moins de sévérité. Rassurées par l’isolement, les maîtresses peuvent laisser à leurs élèves une liberté d’expansion qu’on ne pourrait accorder ailleurs sans danger. Aussi, loin de pécher par soumission ou timidité, celles-ci tendent-elles presque toujours à l’excès contraire. Au sortir de ces saintes volières, où ne leur ont jamais manqué le grain, la sûreté, l’espace ni le soleil, elles s’élancent dans la vie comme le pigeon voyageur, curieuses de voir, avides de sentir, mais ne soupçonnant ni la faim ni l’orage, ni les chasseurs.
Le caractère d’Honorine devait lui donner, plus qu’à aucune autre, cette périlleuse confiance. Ame ouverte et tendre, elle participait à la vie de tout ce qui vivait; elle avait besoin d’aimer tout ce qui pouvait être aimé. Rattachée par la sympathie à chaque œuvre de la création, elle ne pouvait voir languir la plante, elle ne pouvait entendre l’animal se plaindre; elle pleurait en regardant pleurer. La bienveillance des autres lui était indispensable comme l’air. Son sourire affectueux cherchait le sourire sur toutes les lèvres; un regard froid la rendait inquiète, un geste mécontent la glaçait. On eût pu la représenter comme ces saintes que l’art naïf du moyen-âge nous a peintes les bras tendus et tenant à la main leur cœur enflammé, symbole d’ardente charité, mais que complète, hélas! toujours la couronne du martyre!
La première douleur qui atteignit Honorine, fut le départ d’une partie des religieuses qui l’avaient élevée. Soit que l’on eût besoin ailleurs de leur zèle, soit qu’obéissant à la règle, on voulût les défendre des attachements que crée l’habitude, elles reçurent l’ordre de quitter le couvent de Tours pour se rendre à Paris.
La séparation fut déchirante: le devoir religieux imposait en vain la résignation à celles qui partaient; l’affliction impétueuse d’Honorine déconcerta toutes leurs résolutions. Les adieux, vingt fois achevés et repris, se continuèrent dans les larmes jusqu’au moment où il fallut s’arracher des bras de l’orpheline. Les religieuses partirent sans espérance de la revoir, et ne pouvant lui donner de rendez-vous que de l’autre côté de la tombe! C’était, pour chacune d’elles, comme une fille qui meurt, et pour Honorine comme une famille qui se disperse.
Cependant, son premier amour, la plus tendre et la plus chérie de ses mères ne lui avait point été enlevée; la supérieure restait. Mais le bonheur ressemble aux plus belles fleurs: qu’une première feuille tombe et bientôt chaque brise en emporte une nouvelle. Peu de temps après, la prieure tomba dans une langueur que ni les soins ni les remèdes ne purent dissiper, et à laquelle elle succomba au bout de quelques mois.
Le désespoir d’Honorine inspira un instant des craintes sérieuses. C’était le premier coup qui frappait ce cœur désarmé, et sa douleur fut horrible; mais si la nouveauté de la blessure la fit plus cuisante, elle rendit aussi plus certaine la guérison. Honorine n’était point épuisée par ces longues luttes qui enlèvent à la volonté son ressort et retiennent l’âme dans l’abattement, faute de vitalité pour revenir à la santé. Armée de toutes ses forces, elle se releva de ce premier choc.
Un grand changement, survenu dans sa destinée, fit d’ailleurs diversion à sa douleur et reporta ailleurs ses préoccupations.
Madame de Luxeuil avait été avertie de ce qui venait d’arriver, et cet événement imprévu réveilla chez elle des projets oubliés. La partie du testament de la baronne qui confiait l’éducation d’Honorine à la prieure de Tours se trouvait naturellement annulée par la mort de celle-ci, et le sort de l’orpheline était désormais remis à la décision du conseiller de Vercy qui, à défaut du duc de Saint-Alofe, avait accepté la tutelle. Ce fut donc à lui que la comtesse s’adressa, en lui dépêchant un de ses amis dévoués, le marquis de Chanteaux.
Bien que fort jeune au moment de la Révolution, M. de Chanteaux avait quitté la France avec la plus grande partie de la noblesse, et s’était mêlé à toutes les intrigues royalistes de l’époque. C’était un des agents les plus actifs de ce comité qui combattait la République au moyen de proclamations supposées et de faux assignats fabriqués par une réunion de prêtres émigrés, sous la direction d’un évêque. Le marquis avait même pris part à cette dernière opération, et y avait acquis une remarquable adresse pour imiter les empreintes et contrefaire les écritures. Rentré en France sous le Consulat, il y avait mené une vie oisive et peu régulière jusqu’à la première rentrée des Bourbons. Les événements des Cent-Jours l’amenèrent dans la Vendée, où il prit le commandement de plusieurs bandes d’insurgés qui se signalèrent par la prise de quelques bourgs et le pillage des diligences; enfin, la seconde restauration reconnut ses services passés et présents en lui accordant une place de gentilhomme à la chambre. L’accident de juillet lui enleva cette position, et depuis, il s’était tenu à l’écart parmi les boudeurs du faubourg Saint-Germain.
M. de Chanteaux, qui joignait aux grandes manières de la vieille noblesse les formes surannées de la galanterie impériale, pouvait passer pour un exemple remarquable de cette génération fossile dont la chambre haute présente de nos jours la plus curieuse et la plus complète exhibition.
Heureusement que la mission dont il avait été chargé par la comtesse offrait peu de difficultés. Il n’eut point de peine à faire comprendre à M. de Vercy, que la mort de la prieure plaçait Honorine dans une situation nouvelle, et que, destinée à vivre hors du couvent, le moment était venu pour elle d’en sortir. Or, nul ne pouvait mieux que madame de Luxeuil, vu son titre de tante et ses habitudes, faciliter à la jeune fille son entrée dans le monde; aussi M. de Vercy accepta-t-il avec reconnaissance la proposition que lui fit faire la comtesse de se charger de sa pupille, et il fut convenu qu’elle viendrait la prendre à Tours, où le conseiller devait se rendre lui-même pour la lui remettre officiellement.
Tout se passa comme on en était convenu. Madame de Luxeuil arriva au jour indiqué, vit M. de Vercy qu’elle enchanta par ses prévenances, et alla avec lui au couvent pour chercher sa nièce.
Cette dernière, qui avait été prévenue, se tenait prête. L’absence et la mort avaient dépeuplé pour elle la maison où elle avait grandi; tout ce qui avait fait là sa joie n’était plus maintenant que source de regrets. Celles qui l’avaient élevée et chérie avaient emporté avec elles les doux échanges d’émotions, les tendres encouragements, les affectueuses réprimandes; désormais le couvent était vide, la famille avait disparu! Elle se résigna donc à suivre la comtesse sans trop de peine, chassée d’un côté par le vide qui s’était fait autour d’elle, attirée de l’autre par cet attrait du changement et de l’inconnu, illusion des premières années.
Ce fut seulement au moment de partir, que tout son passé se redressa sous ses yeux, comme un doux fantôme qui se plaçait devant le monde pour la retenir dans la solitude; mais elle l’écarta de la main, et après avoir jeté, en tremblant, un dernier regard éploré à ce toit sous lequel elle avait épuisé toutes les joies pures du commencement de la vie, elle monta dans la chaise de poste de sa tante et prit avec elle la route de Paris.
Entre Longjumeau et Arcueil se trouve un plateau inculte que la grande route traverse pendant assez longtemps, et qui forme, avec tout le pays environnant, un contraste aussi triste qu’étrange. Vous quittez une campagne arrosée, féconde, ombreuse, que vous allez retrouver, de nouveau, un peu au delà, et, entre ces deux oasis, s’étend une sorte de Sahara où tout manque à la fois. Aussi loin que vos regards peuvent atteindre, vous n’apercevez qu’une terre desséchée sur laquelle rampent quelques bruyères jaunâtres et que déchirent des rocs blanchis par la mousse. Aucun arbre, aucune habitation! Pas même un de ces troupeaux de moutons maigres et fauves qui broutent les landes de la Bretagne ou de la Sologne. Tout est abandonné et désert.
C’est seulement après avoir franchi la moitié de cette solitude désolée que vous rencontrez une masure servant, en même temps, de cabaret et d’atelier pour un maréchal-ferrant. Elle est connue sous le nom de la Forge-aux-Buttes et assez mal famée, même parmi les voituriers et les paysans qui la fréquentent, à cause de sa position.
Trois de ces derniers venaient de s’y arrêter, au déclin du jour, et causaient à quelques pas de la porte, tandis que le maréchal achevait de ferrer le cheval de l’un d’eux.
Tous trois parlaient à demi-voix, comme des gens qui ont des précautions à prendre.
—C’étaient eux, je vous dis, répétait, avec insistance, le plus petit, à qui sa blouse brodée au collet et son fouet passé en bandoulière donnaient l’air d’un charretier momentanément sans attelage; ils sont arrivés tous trois dans la petite auberge de Linas, comme j’allais partir.
—Et ils t’ont vu? demanda le second paysan, qui tenait sous le bras une de ces longues canardières d’affût en usage parmi les braconniers.
—Ah! bien oui, reprit le charretier, il faudrait donc pour ça que j’aurais volé mon surnom de Furet, je me suis couché sur un banc comme si j’avais mon plein, mais à distance convenable pour savoir ce qu’ils disaient.
—Alors, tu les a entendus?
—Oui; il était question d’une voiture bourgeoise que l’Alsacien avait vue arrêtée à Longjumeau et à laquelle il avait préparé un accident.
—Quel accident?
—Ils n’ont pas donné d’explications; tout ce que je sais, c’est qu’ils devaient l’attendre au passage.
—Où allait-elle?
—Il m’a semblé, d’après quelques mots du Parisien, que ça devait être du côté de Souci ou de Bel-Air.
—Alors c’est la route de Fontenay qu’ils ont dû prendre?
—Oui.
—Faut y aller.
—C’est mon opinion.
—Allons-y, dit le braconnier, aussi bien je voudrais en finir avec ces trois gredins. Ils nous empêchent de gagner notre vie en douceur; ils ont été les charlots (assassins) du grand Baptiste: il faut le revenger!
—A propos, reprit le troisième paysan, qui semblait exercer une autorité sur les deux autres, il me semble, Petit-Jean, que tu as parlé tout à l’heure au maréchal comme à une connaissance.
—Tiens, c’est juste, je vous ai pas dit, reprit l’homme à la canardière; c’est un ancien confrère; un cheval de retour (forçat libéré).
—Et il est établi maintenant?
—C’est-à-dire qu’il a essayé; mais l’état ne va pas, et comme voilà un an qu’il oublie de payer son loyer...
—Le propriétaire de la forge lui a donné congé?
—Ce qui le vexe tant, qu’il me disait tout à l’heure qu’avant de partir, il voudrait démolir la baraque.
—Eh bien mais, maintenant qu’il va être sans état, est-ce qu’on ne pourrait rien faire de lui?
—Oh! faudrait pas s’y fier, monsieur Marc, il nous jouerait quelque tour de gueusard; c’est un ami du Parisien, et avec vous faut des lapins qui travaillent en conscience.
—Au fait, c’est à Jacques qu’il faut songer, reprit le paysan. Nous allons partir séparément, mais sans nous perdre de vue, car il est possible que nous ne nous entendions pas avec ces messieurs, et qu’il y ait du grabuge.
—A leur idée, dit le charretier, en passant les mains par les poches de sa blouse, sous laquelle se dessinèrent des crosses de pistolets, j’ai là deux aboyeurs qui ne demandent pas mieux que de faire la conversation. Vous n’avez qu’à monter à cheval, monsieur Marc.
—Oui, le Furet ira devant.
—Et moi, je vous suivrai.
—C’est convenu.
Tous trois se rapprochèrent de la forge, et Marc allait détacher sa monture pour se remettre en route, lorsqu’un nom prononcé par un valet en livrée qui venait de paraître sur le seuil de la forge, attira tout à coup son attention.
—C’est la chaise de poste de madame la comtesse de Luxeuil, disait-il, vous ne perdrez pas votre peine.
—C’est sûr qu’il n’y a rien de brisé? demanda le maréchal.
—Rien, une des petites roues s’est seulement détachée.
—Et vous avez laissé la voiture près d’ici?
—A deux cents pas. Tenez, voici M. le marquis de Chanteaux avec madame la comtesse et sa nièce, qui se sont décidées à descendre.
Marc regarda dans la direction indiquée par le valet, et laissa échapper une exclamation subite.
—Qu’est-ce que c’est? demanda le braconnier qui rebouclait une des gourmettes du cheval.
—C’est elle! balbutia Marc palpitant.
Le braconnier regarda sur la route.
—Tiens! vous connaissez ces dames? dit-il.
Le paysan ne répondit rien, mais il recula, comme s’il eût voulu se cacher derrière son cheval. Dans ce moment, madame de Luxeuil et le marquis passèrent pour entrer à la forge. Honorine, qui les suivait à quelques pas, s’arrêta près de la porte. Marc abandonna aussitôt la bride qu’il tenait à la main, et fit un brusque mouvement vers elle.
—Eh bien, où allez-vous donc, monsieur Marc? demanda le braconnier.
—Tais-toi! murmura le paysan, je ne pars plus!
—Ah! bah! mais les autres alors!
—Tu iras à leur rencontre.
—Seul?
—Avec le Furet. Prends mon cheval; on se retrouvera à la roche.
—A l’entrée du bois?
—Oui, près de la grande barrière.
—Bon.
Toutes ces phrases s’étaient échangées rapidement et à voix basse. Le braconnier se mit en selle sans en demander davantage, et partit suivi du Furet.
Marc se retourna alors vers Honorine.
Celle-ci était debout à la même place, regardant avec un étonnement curieux la campagne qui se déroulait devant elle.
Les dernières lueurs du soleil à son déclin éclairaient le plateau légèrement incliné vers le couchant, et faisait ressembler son sol jaunâtre veiné de bruyères rouges, à une mer de soufre traversée par des sillons de flammes. Les rocs décharnés qui s’élevaient de loin en loin prenaient une sorte de mouvement confus sous le jeu de la lumière et de l’ombre, et un brouillard lumineux ceignait l’horizon entrecoupé de quelques percées plus pâles. Le galop du cheval monté par le braconnier s’était déjà perdu au loin, et l’on n’entendait plus que le murmure de la brise de nuit rasant les rochers et les bruyères.
La jeune fille se mit à contempler cet ensemble sauvage. Les douloureuses émotions dont elle avait été récemment agitée l’avaient, pour ainsi dire, initiée à la rêverie. Elle comprenait maintenant quelle joie pouvait trouver une âme fatiguée de la réalité à se jeter dans ces sommeils éveillés où nous nous créons, à nous-mêmes, nos songes. Puis, tant d’événements s’étaient succédé dans ces derniers temps, tant d’autres se préparaient, que la jeune fille se sentait comme prise de vertige. Sa vie entière, depuis quelques jours, lui semblait un rêve; elle avait peine à distinguer le fait de la pensée, la supposition de la réalité: tout était pour elle incertain, flottant, et elle vivait, depuis quelques heures, comme ces personnes à demi-éveillées qui n’ont point retrouvé la conscience d’elles-mêmes.
Cependant, le bruit que fit Marc en s’approchant, l’arracha à sa contemplation. Ses yeux se portèrent sur lui, indifférents d’abord, puis plus attentifs; ses traits exprimèrent une surprise mêlée de doute. Elle fit un pas vers le paysan, ouvrit la bouche pour parler et s’arrêta troublée.
Celui-ci la salua.
—J’espère que l’accident arrivé à la chaise de poste de madame la comtesse pourra facilement se réparer, dit-il avec un sourire bienveillant.
—Je l’espère, répliqua Honorine, dont les yeux ne pouvaient se détacher du paysan.
—Mademoiselle a dû être bien effrayée...
—C’est sa voix, s’écria la jeune fille avec une sorte d’explosion.
Marc parut déconcerté.
—Pardon, reprit-elle en rougissant un peu, mais vos traits, votre accent me rappellent une personne que j’ai connue... et cependant Étienne était plus vieux, car il avait des cheveux blancs... Mais, dites-moi, n’auriez-vous pas eu un frère aîné, jardinier au couvent du Sacré-Cœur, à Tours?
—Faites excuse, mam’selle, je n’ai jamais eu de frère, répondit Marc.
—Alors la ressemblance m’a trompée, dit Honorine, avec une sorte de regret.
—Il n’y a pas d’affront, observa le paysan d’un ton de bonhomie, pourvu que mademoiselle n’ait pas de reproches à faire à cet Étienne...
—Des reproches, répéta la jeune fille, c’est à lui que je dois de vivre!.... Et il est parti sans que j’aie pu le remercier! Aussi, lorsque j’ai cru le reconnaître en vous, j’ai été saisie d’un mouvement de joie!...
—C’est bien de l’honneur pour moi, dit le paysan, en portant la main à son chapeau; comme ça mam’selle était au Sacré-Cœur de Tours.
—Oui, Monsieur.
—Ah! je connais bien Tours, reprit Marc d’un air ouvert, et le Sacré-Cœur aussi!... Il y a là une sainte femme pour supérieure.
—Hélas! elle n’est plus! interrompit Honorine, dont les yeux se remplirent de larmes.
Le paysan fit un brusque mouvement.
—Est-ce bien possible, s’écria-t-il; la mère Thérèse est morte?
—Depuis un mois.
Marc changea de visage.
—Ah! je comprends alors, dit-il comme s’il se parlait à lui-même, c’est pour ça que vous avez quitté le couvent... que vous allez demeurer avec la comtesse?
Honorine répondit affirmativement, et il se fit un silence. La jeune fille venait d’être ramenée à des souvenirs qu’elle pouvait oublier par intervalles, mais qui, au moindre rappel, lui revenaient aussi cuisants. Quant à Marc, il était tombé dans une préoccupation subite. Il en sortit pourtant au bout de quelques minutes.
—De manière que mam’selle va à Paris, dit-il, en reprenant son ton de liberté bienveillante; ça va être pour elle un fier changement! car je présuppose que mam’selle demeurera chez madame la comtesse?
—En effet, dit Honorine, un peu étonnée de la familiarité causeuse du paysan.
—Oh! c’est une grande maison, reprit celui-ci, et où l’on s’amuse à mort.
—Vous connaissez donc madame de Luxeuil?
—C’est-à-dire que j’en ai entendu parler par un pays, qui avait sa nièce au service de la comtesse; mais il n’a pas voulu la laisser, parce qu’il trouvait que c’était pas assez sûr.
—Comment?
—Madame la comtesse reçoit toute sorte de monde, à ce qu’il paraît, et, à Paris, il y a plus de diables que de saints, sans compter que le fils de madame de Luxeuil est le roi des bons vivants. Vous ne le connaissez pas, M. Arthur?
—Non, répliqua la jeune fille, que les confidences du paysan commençaient à embarrasser, et qui regarda derrière elle, comme si elle eût voulu rejoindre sa tante.
—Eh bien, vous ferez sa connaissance, continua Marc du même ton, c’est un mauvais sujet fini, à ce que l’on dit...
Honorine ne voulut point en écouter davantage, elle avait gagné le seuil de la forge et y entra.
Marc allait la suivre, lorsque la chaise de poste, remise en état, parut précédée du postillon qui conduisait les chevaux au petit pas. Derrière, venait le maréchal avec trois nouveaux compagnons, par lesquels il avait été rejoint sur la route.
Malgré la nuit qui commençait, Marc crut les reconnaître. Il pencha l’oreille pour écouter les voix qui se faisaient entendre dans l’ombre, sembla douter encore, et se glissa derrière le mur ruiné qui servait de clôture à la cour du maréchal.
Presque au même instant les nouveaux venus atteignirent celle-ci, et, à la clarté de la forge, Marc reconnut le Parisien, Moser et le Bruc.
La présence de ces trois hommes fut pour le paysan un trait de lumière. Le Furet s’était évidemment trompé sur la direction qu’ils devaient prendre, et la voiture à laquelle ils avaient préparé un accident était celle de madame de Luxeuil. Quelque circonstance fortuite les avait, sans doute, empêchés de mettre à profit cet accident, mais ils pouvaient retrouver l’occasion manquée, en attendant la chaise de poste vers l’entrée du pont d’Antony. La nuit serait alors complète, la route déserte et l’endroit favorable. Le danger auquel la comtesse et sa nièce venaient d’échapper n’était donc, pour ainsi dire, qu’ajourné. D’un autre côté, le départ des deux compagnons de Marc rendait son intervention impuissante, et, après les avertissements du braconnier, il ne pouvait espérer aucun secours du maréchal-ferrant.
Toutes ces réflexions se présentèrent à lui coup sur coup, et il cherchait encore ce qu’il devait faire, lorsque le Parisien et Moser reparurent sur le seuil de la forge.
Tous deux se consultaient à voix basse et montraient la direction d’Arcueil. Il était clair que Marc avait deviné leurs intentions et qu’ils voulaient prendre les devants, pendant que les voyageuses, qui avaient rejoint la chaise de poste avec le marquis, achevaient quelques arrangements. Le paysan comprit que le moindre retard pouvait tout perdre et son parti fut pris à l’instant même. Sortant de derrière le mur qui le cachait, il s’avança d’un pas ferme vers la forge, passa lentement, sans paraître y prendre garde, devant le groupe qui causait en dehors du seuil et entra chez le maréchal.
A sa vue, le Parisien et le Juif s’étaient rejetés de côté, avec un mouvement de surprise, et ils regardèrent autour d’eux.
—C’est lui! murmura le premier.
—C’est pien lui! répéta l’Alsacien.
—Il est seul!
—Tout zeul!
—Et il ne nous a pas reconnus?
—Non.
—Alors, c’est un quine à la loterie, reprit rapidement Jacques; au diable la chaise de poste! je reste ici.
—Gomment! tu renonces à notre broget?
—Veux-tu laisser échapper ce brigand?
—Non, non, dit Moser, dont l’accent exprimait le combat que se livraient en lui l’avarice et la haine; mais manquer une affaire, c’est pien tur.
—On peut en retrouver une autre, fit observer le Parisien, tandis que nous ne retrouverons jamais une occasion pareille de nous venger. Veille à la porte pour que j’avertisse le Bruc.
Il alla retrouver celui-ci, qui causait avec le maréchal, leur parla quelque temps à voix basse; puis tous trois rejoignirent l’Alsacien.
Dans ce moment le fouet du postillon se fit entendre et la chaise de poste partit au galop.
Marc fit un geste de joie, les voyageurs étaient sauvés.
Mais lui-même se trouvait au pouvoir d’ennemis dont il ne pouvait attendre aucune pitié. Il promena autour de lui un regard rapide, passa dans la seconde pièce, courut à la fenêtre et l’ouvrit; mais au moment où il posait le pied sur le rebord de l’embrasure, les deux volets se fermèrent brusquement, et il entendit qu’on les barrait au dehors.
Il s’élança vers la porte; elle était gardée!
Marc recula en plongeant les deux mains dans les poches de sa longue veste, et alla s’appuyer le dos à la muraille.
Il entendit un chuchotement, comme si les assaillants se fussent consultés, puis il se fit un silence, et le Parisien entra suivi de Moser.
L’homme au gourdin et le maréchal-ferrant restèrent sur le seuil.
Jacques fut, comme d’habitude, le premier à prendre la parole.
—Ah! tu ne nous attendais pas, mon petit, dit-il avec une haine évidemment combattue par la crainte, et en s’arrêtant à quelques pas du paysan.
—Au contraire, répondit Marc tranquillement, car je vous cherchais.
—Tu l’avoues! s’écria Jacques, qui devint bleu de colère. Avez-vous entendu, vous autres? Il avoue qu’il nous cherchait.
—Faut le refroidir! cria le Bruc de la porte.
Le Parisien et Moser firent un mouvement pour se précipiter sur Marc; mais il retira aussitôt les mains de ses larges poches et présenta, à chacun d’eux, le canon d’un pistolet.
L’Alsacien et Jacques regagnèrent précipitamment l’entrée.
—Vous voyez que j’ai de quoi vous servir, reprit-il sans s’émouvoir; ne faites donc pas les méchants, et restons-en à la conversation.
—Y croit nous faire beur, le prigand! dit Moser, qui se tenait en dehors de la baie de la porte et complétement effacé derrière la cloison.
—Pas moi, répondit Marc, mais ces deux joujoux.
—Tire donc si tu as du cœur! cria Jacques.
—J’aime mieux tirer à bout portant.
—Ainsi, tu resteras là?
—Jusqu’à ce que vous me laissiez la route libre.
Le Parisien parut embarrassé: il se tourna vers ses compagnons, et tous quatre se consultèrent assez longtemps à voix basse; enfin, la porte fut repoussée, fermée à double tour, et Marc se trouva prisonnier.
Il prêta l’oreille, cherchant à deviner ce qui se préparait contre lui; mais il n’entendait qu’un murmure confus, à travers lequel retentissait de loin en loin quelques mots isolés prononcés plus haut. Il distingua ceux de loyer... chassé... gueux de bourgeois... Vengeance pour deux. Puis les voix se turent, comme si tout le monde était tombé d’accord; le soufflet de la forge commença à se faire entendre, et une lueur brilla à travers la porte mal jointe.
Marc, inquiet, appuya l’œil contre une des fentes.
Le Parisien et ses compagnons étaient occupés à briser les bancs et les tables, dont ils jetaient les débris dans la forge. Le maréchal-ferrant regardait tranquillement cette destruction de son mobilier et activait lui-même le feu.
Tout ne tarda pas à s’embraser. Alors chacun saisit un des fragments enflammés, qui furent dispersés le long des charpentes, contre la cloison et jusque sous le toit de chaume. L’incendie se déclara en même temps sur dix points séparés.
Marc qui comprit leur intention, se précipita contre la porte et la secoua avec violence; mais la serrure résista à tous ses efforts.
—Ah! le monsieur du cabinet particulier se réveille, dit le Parisien, en éclatant de rire; entendez-vous comme il sonne le garçon?
—Ouvrez, ouvrez, s’écria Marc, qui continuait à agiter inutilement la porte.
—Voilà! bourgeois! reprit Jacques avec la même ironie féroce; vous allez être servi... un plat à l’étuvée avec sauce à la vapeur... Eh! toi le Bruc, mets donc quelques tisons contre la cloison pour que le bourgeois se chauffe de plus près.
—Cartez-fous, interrompit Moser, qui avait gagné le seuil, foilà que ça vlampe partout.
—Vivat! cria le maréchal-ferrant, en faisant voltiger son bonnet, le vieux grippe-sous d’Etrechy en sera pour sa cassine! ça lui apprendra à chasser ses locataires.
—Filons, reprit le Parisien, et veillons surtout à ce que notre gibier ne sorte pas du gîte.
—Nous resterons nous chauffer les mains en dehors.
—C’est ça; au revoir, Rageur.
—Cuis dans ton jus, mon fieux, et que ça te brofite.
Marc ne répondit rien; car depuis un instant, il essayait de forcer le volet de la fenêtre donnant sur le courtil, mais toutes ses tentatives furent, inutiles.
Il revenait vers l’entrée pour parlementer de nouveau, lorsqu’il entendit la porte de la forge se refermer bruyamment, et les voix des quatre compagnons se perdre au dehors.
La flamme commençait à pétiller autour de lui; une fumée épaisse l’entourait, un air brûlant l’empêchait de respirer. Muré dans l’incendie, il était condamné à y périr!
Cette conviction le jeta dans un désespoir furieux. Il se mit à parcourir la pièce, où il était enfermé, avec des cris de rage et en cherchant à tâtons une issue. Les flammes ne tardèrent pas à lui en ouvrir une. La cloison qui le séparait de la forge s’abattit à ses pieds. Il voulut en franchir les débris; mais, de l’autre côté, tout était en feu! Il fut obligé de reculer jusqu’à la fenêtre.
L’incendie, activé par le vent, achevait de tout envahir. Les charpentes, embrasées les premières, croulaient avec le chaume, qui s’éparpillait en pluie de feu; les murs mêmes, calcinés par la flamme, fléchissaient en mugissant, et semaient, dans le brasier, leurs pierres noircies.
Cependant Marc, haletant et aveuglé, continuait à courir au milieu de ces débris fumants en appelant du secours et en cherchant une issue. Enfin, il croit distinguer, au milieu de la fumée, un endroit où les poutres abattues ont entraîné une partie du mur; il y court, il franchit les ruines fumantes, il atteint le sommet de la brèche! Déjà l’air frais du dehors le frappe au visage; encore un effort et il est sauvé!...
Mais, tout à coup, la pierre qui le soutenait se détache; ses mains glissent sur le mur brûlant, il pousse un cri et retombe enseveli sous les décombres!
Environ une heure avant les événements racontés dans le chapitre précédent, trois cavaliers venant de Maillecour, se dirigeaient vers la grande route d’Orléans, en suivant un de ces chemins de traverse, larges et ombragés, qui forment autour de Paris comme un réseau d’avenues dont on aurait supprimé les châteaux.
Il suffisait d’un coup d’œil pour reconnaître que tous trois appartenaient à cette aristocratie que l’on est convenu d’appeler le monde élégant, mélange d’oisifs et d’enrichis qui donnent le ton à la nation, à peu près comme ces chefs d’orchestre de province dont le la est toujours faux.
Les trois cavaliers dont nous parlons occupaient, du reste, des places différentes dans cette société fashionable. Arthur de Luxeuil représentait la classe extravagante dont l’existence entière se perd en folies de convention et en futilités bruyantes; Marcel de Gausson, la portion d’élite qui ne livre à la mode que les surfaces de la vie; Aristide Marquier, enfin, cette fraction des lions imitateurs, qui, à tous les vices décalqués sur les autres, ajoutent le ridicule de leur propre fonds.
Le costume de chasseurs qu’ils portaient tous trois révélait, pour ainsi dire, ces natures différentes. Celui d’Arthur de Luxeuil, composé d’après les dernières prescriptions de la mode, comprenait tous ces perfectionnements compliqués et bizarres empruntés au sport anglais; chaque pièce de son équipement avait une forme inusitée qui annonçait, au premier aspect, le brevet d’invention.
Celui de Marcel de Gausson, au contraire, était si simple, que l’œil s’y arrêtait sans être frappé d’aucun détail. Il saisissait seulement l’élégance de l’ensemble qui présentait une sorte de compromis tellement adroit, que l’on pouvait y voir également, selon ce qu’on était soi-même, le sans-façon du penseur, ou le distingué de la fashion. Marcel paraissait toujours mis comme celui qui le regardait.
Quant à Marquier, c’était un petit homme empâté et myope, que l’on reconnaissait sur-le-champ pour la contrefaçon d’Arthur de Luxeuil. Son costume était surchargé d’une prodigieuse quantité de ganses, de houppes, de plaques, de ciselures, chatoyant ou tintant à chaque geste, qui lui donnaient un air vulgaire et triomphant impossible à décrire. Mais on devinait l’avarice sous cette prodigalité de mouvais goût. A travers ses embellissements inutiles, l’équipement révélait la fabrication fardée des bazars. Il suffisait de regarder avec quelque attention pour reconnaître que l’argent n’était que du cuivre plaqué, l’ivoire que de l’os tourné, la peau de daim que du chien passé à la teinture, l’écaille que de la corne fondue, et la soie que du coton. Marquier ressemblait à la devanture d’une boutique à pris fixe; il n’était revêtu que de mensonges!
Sa monture répondait au reste. C’était un de ces coursiers de manége, habitués à danser sur leurs jarrets pour se donner l’air fougueux, et qui rappellent les chevaux de race comme nos acteurs de tragédie rappellent Achille et Mithridate.
Lucifer était pourtant une des gloires de Marquier; il le prétendait de pur sang arabe, et en parlait toujours comme s’il se fût agi du cheval merveilleux que le fils de Philippe put seul maîtriser. A l’en croire, nul autre que lui n’était capable d’apprécier le superbe animal, ni de s’en faire comprendre.
Or, cette thèse favorite que les adeptes de la fashion se plaisaient à lui faire soutenir, par moquerie, était devenue, depuis quelques instants, le sujet d’un nouveau débat entre de Luxeuil et lui.
—Je vous maintiens, mon cher, disait le premier, que Lucifer est une rosse.
—Une rosse! répéta Marquier scandalisé; un cheval de mille écus!
Arthur le regarda.
—Allons, ne me dites pas de ces choses-là, à moi, mon bon, reprit-il; Lucifer vous aura coûté... ce qu’il vaut.
—Et que vaut-il donc, à votre avis?
—Mais quelque chose comme cinq cents francs.
—Plaît-il?
—C’est trop peut-être; mettons cent écus.
—Il est fou, dit Marquier, en se tournant vers Marcel de Gausson, avec une gaieté forcée. Ah! ah! ah! cent écus!... Ainsi, vous croyez, mon cher, que j’exagère le prix d’achat?
—Oui.
—Et dans quel intérêt?
—D’abord, pour vous donner l’air de monter un cheval de trois mille francs, ce qui est toujours honorable; ensuite pour avoir chance de le revendre avec bénéfice, ce qui ne déshonore jamais.
—Allons, je vois qu’il n’y a moyen de vous rien cacher, dit Marquier, en continuant à rire de mauvaise grâce; vous nous connaissez, mon cheval et moi, mieux que nous-mêmes.
—Cela vous étonne?
—Du tout, mon bon, du tout... je passe condamnation: Lucifer est une rosse qui n’a pas plus de sang arabe que moi.
—Ah! quant à vous, banquier, vous en avez dans toutes les veines; je vous reconnais pour un pur sang.
—Fort bien, fort bien, Arthur, interrompit le petit homme, qui se fût fâché s’il eût osé; mais toutes vos plaisanteries n’empêcheront pas Lucifer d’avoir de la race; demandez plutôt l’avis de M. de Gausson.
—Je me connais fort peu en chevaux, répondit celui-ci, qui désirait évidemment ne point se mêler au débat.
—Mais enfin que pensez-vous?
—Je pense qu’il eût été prudent d’avoir des preuves de la filiation de Lucifer; des titres répondent à tout.
—Bah! des titres! s’écria Marquier, à quoi bon? les titres ne sont rien; c’est le mérite qu’il faut consulter; sans le mérite...
—Ah! grâce, banquier, interrompit de Luxeuil; vous allez nous réciter un discours du centre gauche. J’aime encore mieux vous accepter pour arabes, vous et votre cheval, d’autant plus que voici la nuit, et que nous ferons bien de presser le pas.
—En effet, dit Marcel, M. Arthur doit avoir hâte de revoir la comtesse, qui est sans doute maintenant à Bagatelle.
—Tiens, je l’avais oublié, s’écria le banquier; c’est aujourd’hui que madame de Luxeuil arrive de Tours... avec votre cousine, mon bon!
Arthur fit une réponse affirmative, en effleurant son cheval de l’éperon.
—Eh bien! cette idée-là vous fait aller au trot? continua Marquier en riant; prenez garde, prenez garde! il n’y a rien de dangereux comme ces pensionnaires qui sortent du couvent.
—Pourquoi dangereuses?
—Pourquoi? Ah! ah! ah! la question est excellente!... mais parce qu’on en tombe amoureux, mon cher!
Arthur regarda Marcel.
—Ce garçon devient stupide! dit-il d’un accent de véritable compassion.
—Je maintiens mon dire, s’écria Marquier avec feu; je soutiens que les cousines sont des séductrices à domicile. A force de les voir, de les trouver près de soi à toute heure et en toute occasion, on finit par avoir des idées... Ça m’est arrivé à moi!
—D’avoir des idées? répéta Arthur, vous vous vantez, Marquier.
—Parole d’honneur! j’ai failli devenir amoureux d’une parente, dans mon dernier voyage en Bourgogne; aussi, je vous le répète, mon cher, défiez-vous!
—Je me défierai, Marquier.
—Non, vous plaisantez; mais j’ai de l’observation, moi, voyez-vous! Quand on fait pour plusieurs millions d’affaires, on doit connaître le cœur humain. Aussi, l’arrivée de votre cousine est un événement qui m’inquièterait si j’étais à la place de Clotilde.
Arthur se contenta de lever les épaules; mais Marcel ne put se défendre d’un mouvement d’impatience; il se tourna vers le banquier.
—Je ne comprends pas ce qu’il peut y avoir de commun entre mademoiselle Clotilde et la nièce de madame de Luxeuil, fit-il observer froidement.
—Ce qu’il y a de commun? répéta Marquier, d’un air mauvais sujet, eh pardieu! c’est Arthur. L’une est sa cousine, l’autre sa maîtresse...
—Et il ne vous semble pas, Monsieur, qu’il y ait de différence entre ces deux titres? interrompit Marcel plus sèchement.
—Certainement, balbutia le banquier un peu déconcerté, il y a une différence...
—Capitale, mon cher, dit Arthur, qui avait jusqu’alors écouté tranquillement, car une maîtresse vous amuse en passant, tandis qu’une cousine vous ennuie à perpétuité... Mais voyez donc, ajouta-t-il, en retenant tout à coup son cheval, n’apercevez-vous point une lueur là-bas, au bout du chemin?
—C’est un incendie! s’écria Marquier, dont le regard venait également de s’arrêter sur le point désigné.
—Oui, reprit Marcel, qui se tenait penché sur l’arçon pour mieux voir; vite, Messieurs, nous pourrons peut-être porter quelque secours.
Les trois cavaliers mirent leurs chevaux au galop et arrivèrent, en quelques instants, devant la Forge-des-Buttes.
—Ah! c’est la masure du maréchal, dit Arthur qui s’y était précédemment arrêté.
—Une baraque qui ne vaut pas trente louis, ajouta Marquier avec dédain; c’était bien la peine d’échauffer nos chevaux.
—Il est étrange que tout soit fermé, fit observer de Gausson en s’approchant. La forge serait-elle abandonnée?
—Non, car hier encore je l’ai vue ouverte. Ce feu n’a pu, d’ailleurs, s’allumer seul; regardez donc à cette fenêtre grillée.
Marcel voulut avancer la tête vers l’ouverture qu’on lui désignait: mais un tourbillon de fumée et d’étincelles le força à reculer.
Presque au même instant une plainte sourde arriva jusqu’à lui.
—Avez-vous entendu? s’écria-t-il.
—Cela ressemble à un gémissement, fit observer Arthur.
—Écoutez!
Ils penchèrent l’oreille, et une nouvelle plainte retentit.
—Il y a quelqu’un dans la forge, dit de Gausson, en descendant précipitamment de cheval et courant à la porte qu’il essaya d’ouvrir.
Mais la porte était solidement fermée. Il appela ses compagnons à son aide; le banquier s’excusa en affirmant que Lucifer était trop ombrageux pour qu’il pût ainsi le quitter.
—Sans compter qu’il faudrait vous remettre en selle, objecta Arthur, ce qui est toujours pour vous une opération périlleuse et incertaine.
—Par exemple, s’écria Marquier, moi qui ai deux ans de manége! savez-vous que Ducrou m’a donné des leçons?
—Il eût mieux fait de vous donner des jambes, mon bon; ce sont les jambes qui vous manquent; on ne peut pas monter à cheval avec des nageoires; mais tenez donc Atala, je vois là-bas de Gausson qui s’éreinte.
Il jeta la bride de sa jument à Marquier et rejoignit Marcel qu’il trouva occupé à forcer l’entrée de la forge.
—Dieu me damne, mon cher, vous me faites là l’effet d’un Samson enlevant les portes de Gaza, s’écria-t-il en riant.
—J’entends toujours gémir, interrompit de Gausson, au nom de Dieu aidez-moi.
—Bien volontiers, mais il faudrait quelque chose pour soulever la porte.
—Un fusil.
Arthur courut à Marquier et détacha l’arme suspendue à la selle de son cheval.
—Que voulez-vous? qu’y a-t-il? demanda le banquier effrayé.
De Luxeuil ne prit point le temps de lui répondre; courant à la forge, il passa le canon du fusil entre le seuil et la porte, et s’en servit comme d’un levier.
Marquier poussa une exclamation de désespoir.
—Que faites-vous, Arthur? s’écria-t-il, s’efforçant en vain de faire avancer ses deux chevaux; vous allez briser mon fusil! une arme de mille francs!... Arthur, je ne veux pas... Arthur, vous me répondrez de ce qui arrivera...
Arthur n’écoutait point et continuait son opération. Enfin, la porte, enlevée de ses gonds, s’abattit à l’intérieur. Marcel pénétra dans la forge, arriva jusqu’à l’amas de décombres, sous lequel Marc gisait à demi enseveli, le dégagea avec peine et le porta sur la route.
Le grand air ne tarda pas à dissiper l’espèce de suffocation que la chaleur avait causée au paysan; il rouvrit les yeux et regarda autour de lui, comme s’il eût voulu se reconnaître.
—Allons, il en sera quitte pour quelques brûlures, dit de Luxeuil; le voilà qui reprend connaissance.
—N’êtes-vous point blessé? demanda de Gausson, qui se tenait un genou en terre et penché sur Marc avec sollicitude.
—Blessé? répéta celui-ci, en essayant machinalement à mouvoir ses membres; je ne sais... je souffre un peu... mais il me semble... non, je ne suis pas blessé!
Il avait fait un effort et s’était redressé à moitié.
—Pardieu! nous sommes arrivés à temps, reprit Arthur; mais comment diable vous trouviez-vous dans cette baraque, l’ami?
—On m’y avait enfermé, Monsieur, avant d’y mettre le feu.
—Ah bah! mais alors c’était un guet-apens?
—Qui eût réussi sans votre arrivée; car j’étais déjà évanoui... et, maintenant encore, tout semble tournoyer devant moi...
Il parlait d’une voix entrecoupée et sa tête vacillait. Marcel demanda à Luxeuil s’il n’avait point sa gourde de chasse.
—Elle est vide, répondit Arthur, mais celle du banquier doit être pleine, car il ne la porte qu’en guise d’ornement... Eh! ici, Marquier, arrivez vite, mon bon, on a besoin de vous.
Mais le banquier, qui venait de descendre de cheval, était occupé à regarder son fusil, dont le canon ployé, en soulevant la porte, formait une espèce d’arc irrégulier.
—J’en étais sûr, répétait-il d’un air de consternation tragique; une arme de luxe qui ne m’avait point encore servi; voyez, mon cher, voyez ce que vous avez fait.
—Eh bien! quoi? demanda de Luxeuil en s’approchant, votre mousquet est un peu tordu? c’est preuve qu’il ne valait rien. Vous n’en tuerez pas moins de gibier, allez. Avez-vous quelque chose dans votre gourde?
—C’est une arme perdue! continua Marquier dont les yeux ne pouvaient se détacher du malencontreux fusil; qu’en faire maintenant?
—Vous pourrez l’arranger en arquebuse, répliqua philosophiquement de Luxeuil.
Le banquier fit un geste d’impatience.
—Je ne plaisante pas, moi, s’écria-t-il aigrement, chacun tient à ce qui lui appartient, un fusil est un capital et sa jouissance peut être considérée comme l’intérêt; mais quand on perd à la fois les intérêts et le capital...
—Au diable! interrompit Arthur, ne va-t-il pas nous parler finance maintenant! prenez mon fusil, mon cher, et qu’il n’en soit plus question.
La figure de Marquier s’épanouit subitement.
—Quoi! en vérité, s’écria-t-il, vous consentez à un échange?...
—Je consens à tout ce qu’il vous plaira, pourvu que j’aie votre gourde pour ce pauvre diable dont on a voulu faire un auto-da-fé.
—Voilà, mon cher, voilà! dit Marquier en ramenant le petit flacon enveloppé de cuir tressé qu’il portait en bandoulière, je vais lui donner moi-même...
Il s’avança vers Marc, dont la défaillance continuait, et se pencha pour approcher la gourde de ses lèvres; mais tout à coup, il changea de couleur et resta immobile, la main étendue.
—Eh bien! qu’avez-vous donc? demanda Arthur étonné.
—Rien, balbutia Marquier, dont les gros yeux grands ouverts continuaient à contempler Marc avec effarement, c’est que j’ai cru... c’est qu’il me semble...
—Quoi donc? Vous connaissez cet homme?
—Du tout, du tout!... Mais pardon, voici la gourde, mon cher... J’ai peur que Lucifer ne s’échappe.
Et tournant brusquement les talons, il alla reprendre les brides des chevaux, qui s’étaient éloignés de quelques pas, en flairant l’herbe rare qui garnissait les fossés.
Marcel fit avaler à Marc une gorgée de Madère qui parut le ranimer; il déclara au jeune homme qu’il se trouvait mieux, et le remercia avec effusion. De Gausson l’interrompit pour savoir où il se rendait.
—A Corbeil, répondit le paysan.
—C’est une longue route, reprit Marcel; vous ne pourrez la faire seul et à pied, surtout à cette heure.
—J’en ai peur, dit Marc, qui étendit ses membres brûlés et endoloris.
—Il faudrait qu’il tâchât de gagner le prochain village, fit observer Arthur.
—Je vous proposerai plutôt de le conduire à Bagatelle, où il pourra être secouru et passer la nuit, dit Marcel.
—Bien volontiers, s’il est en état de nous suivre.
—Je le prendrai en croupe.
—Vous?
—Pourquoi pas!
—A cheval avec ce paysan! Ah! ah! ah! ce sera un groupe digne de Charlet.
—Je ne comprends pas ce qu’il aura de ridicule...
—Comment! mais songez donc, mon cher, que vous aurez l’air de la civilisation galopant avec la barbarie! Puis, vous savez parfaitement qu’on ne prend personne en croupe; ça ne se fait pas. Si nos amis du boulevard de Gand l’apprenaient, vous seriez déshonoré!
—Il faut me laisser, Monsieur, dit Marc à de Gausson; j’espère pouvoir arriver seul aux maisons les plus voisines...
—Vous croyez-vous capable de monter à cheval? demanda le jeune homme, sans prendre garde aux rires d’Arthur.
—Je le crois, monsieur, répondit Marc, mais je puis aussi marcher...
—Voyons, appuyez-vous sur moi... nos chevaux sont là, à quelques pas.
—Non, Monsieur, non, je ne veux pas accepter...
—Venez, vous dis-je, nous trouverons justement à Bagatelle le médecin de madame de Luxeuil.
Marc leva brusquement la tête.
—Quoi! s’écria-t-il, c’est chez madame de Luxeuil?...
—La connaissez-vous, l’ami? demanda Arthur.
—Pour avoir entendu son nom seulement, répondit le paysan dont la résistance parut céder tout à coup. Mais puisque monsieur veut bien me prendre... je ne ferai pas l’impolitesse de refuser, et je suis à ses ordres.
De Gausson monta à cheval, aida le paysan à se mettre en croupe, au grand amusement d’Arthur, et tous trois continuèrent leur route vers Bagatelle.
La villa de la comtesse se trouvait située sur l’un des petits versants qui côtoient la Bièvre. C’était moins une maison de campagne qu’un de ces pied-à-terre champêtres où la noblesse de nos jours va étudier la nature, comme celle du dix-huitième siècle allait, dans ses petites maisons, étudier l’amour. Tout y avait été disposé pour la jouissance immédiate et passagère. Rien de naturel ni de durable. On n’y voyait qu’arbres à sèves hâtées et que plantes de serre transportées là pour y briller quelques jours et mourir. Le parterre fleurissait tous les ans sur un ordre écrit de la comtesse, et le jardinier déployait sa verdure quand il voyait tendre les rideaux.
Il en résultait je ne sais quelle abondance artificielle et quelle fraîcheur exagérée qui donnait au parc de madame de Luxeuil l’apparence d’une décoration d’opéra. A force d’être entassées, les fleurs cessaient d’être vraisemblables et faisaient croire à des imitations de gaze peinte, tandis que leurs senteurs trop multipliées vous rappelaient, malgré vous, la boutique du parfumeur. Les pelouses veloutées, unies et tondues aux ciseaux, semblaient autant de tapis d’Aubusson. On eût en vain cherché dans ces quatre arpents une fleurette des champs, une ronce déchirant le feuillage, une touffe d’oseille sauvage couronnée de ses graines roses, une églantine mêlée au chèvrefeuille des bois. A Bagatelle, l’homme avait eu honte des œuvres de Dieu et les avait remplacées par les siennes. Là chaque arbre était une conquête de l’art, chaque fleur portait un nom célèbre; le moindre brin d’herbe venait d’Amérique ou d’Asie, avec de notables perfectionnements: c’était une création revue et corrigée qui l’emportait autant sur l’autre qu’une de nos charmantes pensionnaires corsetées, gantées, coiffées, chaussées, l’emporte sur la jeune Indienne sortant des eaux du Gange, sans autre ornement que sa beauté.
Du reste, Bagatelle était précisément l’habitation qu’il fallait à la comtesse; elle y passait au plus six semaines, employées à recevoir des visites ou à en rendre; puis elle regagnait Paris, dont elle ne s’était absentée que pour faire comme tout le monde. L’Eden arrangé autour de la maison séchait alors sur pied, et tout restait dépouillé jusqu’à la saison suivante, où le parc était remeublé de verdure et de fleurs.
Outre cette villa, madame de Luxeuil avait eu autrefois une terre en Bourgogne; mais ses dépenses excessives et le peu d’ordre apporté à l’administration de ses biens l’avaient obligée de s’en défaire après la mort du comte. Cette vente n’avait cependant pu rétablir ses affaires qui se trouvaient alors plus embarrassées que jamais; mais, grâce à la position qu’elle occupait dans le monde, elle pouvait persister dans ses habitudes, en empiétant chaque année sur les années suivantes, et en creusant un abîme qu’elle ne mesurait plus, parce qu’elle avait cessé d’en voir le fond. Arthur, de son côté, aggravait cette situation par des désordres ruineux qui devenaient, entre lui et sa mère, le motif d’incessantes querelles. Prodigue pour sa satisfaction privée, mais avare pour celle de l’autre, chacun d’eux était toujours armé de reproches, de menaces, de récriminations, suivis de longues froideurs, que l’intérêt seul pouvait dissiper ou suspendre.
Cependant, pour le moment, la comtesse et Arthur se supportaient et paraissaient à peu près d’accord.
Tous deux montrèrent un égal empressement à l’égard d’Honorine. Madame de Luxeuil avait été pleine de prévenances pendant toute la route; Arthur, qui arriva à Bagatelle une heure après sa mère, ne témoigna pas moins d’affection à sa cousine. Il s’excusa de n’avoir pu aller à sa rencontre, s’informa de la manière dont elle avait supporté le voyage, et finit par lui présenter M. Marcel de Gausson. Quant au banquier, il les avait quittés peu après la rencontre de Marc, en prétextant une affaire indispensable.
De Luxeuil raconta ensuite leur aventure à la forge des Buttes, et Honorine n’eut point de peine à reconnaître dans le paysan qu’ils venaient de sauver l’homme précédemment rencontré par elle-même. Elle s’informa avec anxiété de son état, et, malgré les assurances de son cousin, elle allait demander à le voir, lorsque le docteur Darcy entra en affirmant que le blessé n’avait besoin que de repos.
Le reste de la soirée se passa à faire connaissance. La comtesse et Honorine éprouvaient cette espèce de surexcitation que donne le voyage et qui dispose à la causerie. La jeune fille surtout sentait comme un besoin d’expansion qui l’emportait malgré elle. L’espèce d’enivrement que causent les premiers changements de lieux, la nouveauté de ce qui l’entourait, la tendresse de l’accueil qu’elle recevait, tout lui avait ouvert le cœur. Après deux heures passées dans cette nouvelle famille qu’elle adoptait déjà avec tout l’élan d’une âme veuve d’affections, elle se laissa conduire par sa tante dans l’appartement qui lui était destiné.
—Voici votre domaine, chère belle, dit madame de Luxeuil, en lui montrant trois pièces et un cabinet de toilette du meilleur goût; si vous trouvez cela trop petit, on pourra ajouter la bibliothèque.
Honorine se récria en déclarant qu’elle trouvait l’appartement beaucoup trop grand et trop beau.
—D’abord sachez que rien n’est trop beau, ni trop grand pour vous, chère enfant, reprit la comtesse, puis vous vous apercevrez bientôt que je ne vous donne rien qui ne soit indispensable. Une chambre à coucher, un boudoir, un petit salon de musique, on ne saurait se passer de moins. Justine, qui couche là, derrière, sera à votre disposition et n’obéira désormais qu’à vous. Quant à vos habitudes, vous les règlerez à votre fantaisie; l’équipage sera toujours à votre disposition; tous les gens de la maison ont ordre de vous obéir comme à moi-même; je veux enfin que vous soyez complétement libre et maîtresse.
Honorine, attendrie de tant de bontés, ne put répondre que par quelques mots balbutiés, en portant à ses lèvres la main de la comtesse: celle-ci la baisa au front.
—Ne me remerciez pas, reprit-elle amicalement, et surtout, usez largement du droit que je vous donne; mon seul désir est de vous voir heureuse et de pouvoir remplacer, en partie, votre mère!...
Elle s’arrêta comme si ce souvenir l’eût émue, détourna la tête et parut dérober à sa nièce une larme, puis faisant un effort:
—Allons, continua-t-elle, voilà que ces idées me reviennent encore... Malgré moi, tout m’y ramène!... je l’ai tant aimée, cette chère sœur... Vous verrez chez moi mille objets qui lui ont servi et que je conserve comme des reliques saintes!... Mais j’ai tort de vous dire cela maintenant, je vous afflige! pardonnez-moi, Honorine, et soyez plus raisonnable que je ne le suis.
Elle essuya les larmes qui coulaient sur les joues de la jeune fille, lui recommanda de bien dormir et la laissa avec Justine.
Tout en aidant sa nouvelle maîtresse à se déshabiller, celle-ci s’efforça de la distraire de son émotion par des prévenances adroites, des éloges contenus, et Honorine, que son séjour au couvent avait mal préparée à la défiance, se laissa aller insensiblement à lui exprimer sa reconnaissance pour l’accueil reçu à Bagatelle. Justine confirma ses dispositions favorables par une apologie passionnée de la comtesse et de M. Arthur. Celui-ci n’était pas seulement le plus brillant cavalier du faubourg Saint-Germain, nul cœur n’était plus franc, plus dévoué, plus ouvert. Tout cela était dit avec une volubilité qui eût pu faire croire à une leçon apprise; mais inexpérimentée et prévenue, l’orpheline n’y trouva que la preuve d’un dévouement excessif peut-être, mais qui n’en honorait pas moins les maîtres capables de l’inspirer.
Quand la femme de chambre eut épuisé toutes les formes de louanges, elle finit cependant par s’arrêter et se laissa congédier.
Honorine, restée seule, ne songea point à se coucher. Le trouble qu’excitait en elle un changement de position si complet, avait éloigné le sommeil; elle sentait le besoin de regarder de plus près sa nouvelle vie, de mieux comprendre le rôle qui lui était assigné; d’étudier enfin, à l’entrée, ce monde inconnu qui venait de s’ouvrir devant ses pas.
Elle alla s’accouder à la fenêtre, qui était demeurée ouverte, et tomba dans une sérieuse méditation.
La nuit était calme et étoilée; une lumineuse vapeur, glissant sur les arbres, formait de loin en loin, sous leurs ombrages, de vagues clairières. Le vent qui frissonnait dans les feuilles imitait le bruit d’une source, et les mille fleurs du parterre envoyaient au balcon leurs arômes enivrants.
Insensiblement arrachée à ses réflexions par ces parfums, ces murmures et ces lueurs, Honorine regarda à ses pieds et ne tarda pas à éprouver l’influence fascinante de ce qui l’entourait. Une sorte de langueur heureuse coula dans ses veines, et le bien-être de ses sens vint s’ajouter au bien-être de son âme.
Le bonheur dont elle avait joui jusqu’alors était revêtu d’une uniformité qui le rendait pour ainsi dire insensible; on le respirait comme l’air, sans s’en apercevoir. Celui qu’elle éprouvait maintenant contenait, au contraire, je ne sais quelle saveur de nouveauté qui lui donnait quelque chose d’enivrant. Jamais, auparavant, sa joie n’avait eu cette vivacité turbulente et imprévue. Elle était alternativement prise d’élans d’allégresse qu’elle eût voulu exprimer par des chants ou des cris, et d’attendrissements qui remplissaient ses yeux de larmes. Elle remerciait Dieu tout bas de lui avoir réservé pour son abandon de nouveaux protecteurs; elle bénissait dans son cœur la famille qui la recevait si tendrement, et inventait mille moyens impossibles de lui prouver sa reconnaissance.
Dans sa première préoccupation, elle avait à peine pris garde à l’appartement qui lui était destiné; mais, une fois sortie de sa rêverie, elle regarda autour d’elle avec curiosité.
La chambre où elle se trouvait alors, différait tellement de sa riante mais modeste cellule du Sacré-Cœur qu’elle en fut éblouie. Le lit de palissandre incrusté, était recouvert d’une courte-pointe en vieille guipure de Flandres doublée de satin d’un bleu tendre. Les rideaux, de même étoffe et de même couleur, se réunissaient dans un anneau d’ivoire ouvré, et retombaient à larges plis jusqu’au parquet caché par une natte indienne. Le reste du meuble, en palissandre et en drap de soie, n’avait pour ornement qu’une passementerie plus pâle, mais d’un travail charmant.
Après avoir admiré d’un coup d’œil cet ensemble à la fois simple et splendide, Honorine passa dans la pièce voisine, disposée pour salon de travail. Un magnifique piano de Petzold occupait un des côtés; il était encadré par deux bibliothèques de citronnier garnies de livres ou de partitions. De l’autre côté avaient été dressés un chevalet de cèdre et une table à peindre de laque rouge. Enfin, près de la fenêtre, une chiffonnière entr’ouverte laissait voir, dans ses compartiments, une collection de soies et de laines variées. Une causeuse et quelques siéges de bambous complétaient l’ameublement.
Mais ce fut surtout en entrant dans le boudoir que la jeune fille demeura frappée d’admiration. Là, toutes les recherches du luxe et tous les caprices de la coquetterie avaient été épuisés. Les murs étaient garnis d’une étoffe de soie à fond rose retenue par des griffes dorées et interrompue, de loin en loin, par d’immenses glaces qui prenaient toute la hauteur de la pièce. Celle-ci était meublée de divans à franges, de dressoirs en ébène sculpté, et de guéridons de vieux Sèvres. A chaque coin s’élevaient des jardinières de marbre garnies de camellias, encore nouveaux à cette époque, et, un peu plus loin, des consoles de bronze ciselé étaient surchargées de tous ces riens précieux que l’art du monde entier fournit à la curiosité oisive de nos privilégiés. Un store chinois, à moitié soulevé, laissait pénétrer dans la pièce une molle lueur qui glissait à travers ces soies, cet or, ces bronzes, ces fleurs, et leur donnait une fantastique splendeur.
Honorine resta un instant sur le seuil comme éblouie; puis, s’enhardissant peu à peu, elle entra dans le boudoir et se mit à le parcourir lentement en examinant chaque détail. A la surprise succéda bientôt l’admiration, à l’admiration la joie. Tout cela était à elle et pour elle!... Outre le plaisir de la possession, elle trouvait là une nouvelle preuve de la sollicitude de la comtesse. C’était pour lui plaire que celle-ci avait réuni dans son appartement toutes les merveilles du luxe, et l’excès même de ce luxe prouvait l’excès de la bienveillance. Aussi, ce qui frappait les yeux de la jeune fille avait-il moins de prix par sa beauté que par l’intention qui avait présidé à cet arrangement. C’était là ce qui devait lui rendre cette opulence expressive et précieuse.
Elle le comprit vivement et profondément. Chaque admiration nouvelle se traduisait immédiatement, dans son cœur, par une sorte de contre-coup, en élan de reconnaissance pour madame de Luxeuil. Enfin, après avoir parcouru ce que cette dernière avait appelé son domaine, après avoir éprouvé tous les enchantements d’enfant, et tous les orgueils de jeune fille que pouvait faire naître un pareil examen, elle se décida à se coucher et s’endormit ivre de sa joyeuse confiance.
Lorsque Honorine rouvrit les yeux le lendemain, le jour brillait dans tout son éclat, et les oiseaux qui chantaient sur son balcon, semblaient célébrer sa bienvenue à Bagatelle; ce gai réveil lui rendit tout son bonheur de la veille.
Justine, qui entra presque au même instant, lui apprit que sa tante et son cousin s’étaient déjà informés de ses nouvelles. Elle se hâta de s’habiller pour répondre à leur empressement, et envoya demander à les voir; mais, après une assez longue absence, la femme de chambre revint lui dire, avec embarras, que M. Arthur était sorti, et que madame de Luxeuil n’était point encore levée.
Un peu surprise et désappointée, Honorine se préparait à descendre au jardin, lorsqu’elle se rappela le blessé ramené la veille par M. de Gausson, elle s’informa de lui à Justine et apprit qu’il était levé et aurait déjà quitté Bagatelle, s’il n’eût voulu remercier la comtesse de son hospitalité.
La rencontre de cet homme à la Forge-des-Buttes, avait laissé à la jeune fille un souvenir assez vif pour qu’elle désirât le revoir avant son départ. Il pouvait, d’ailleurs, avoir besoin de secours ou de protection, et elle se sentait trop heureuse pour ne pas être disposée à protéger et secourir. Elle se fit donc désigner la chambre occupée par le paysan et s’y rendit.
Cette chambre était située au second étage, dans une partie de la maison uniquement consacrée aux gens de service; pour y arriver il fallait traverser une grande pièce délaissée qui servait de garde-meuble. Là se trouvaient entassés des canapés réformés, des couchettes sans emploi, d’anciens tapis et des piles de vaisselle écornée. A l’extrémité, dans l’endroit le plus apparent, avaient été accrochés plusieurs vieux portraits à encadrements démodés, parmi lesquels se remarquait une toile plus moderne et plus grande.
Au moment où Honorine entra, le paysan était arrêté devant cette dernière peinture, et la contemplait avec une attention si profonde, qu’il n’entendit point la porte s’ouvrir. Il se tenait devant le tableau, debout, les deux mains jointes et la tête légèrement rejetée en arrière, dans une attitude qui exprimait à la fois la douleur et le respect. La jeune fille, surprise, s’avança vers lui; mais, au bruit de ses pas, Marc détourna la tête et laissa voir son visage couvert de larmes.
—Que faites-vous là! qu’avez-vous? s’écria Honorine saisie.
Le paysan continuait à la regarder avec une expression indéfinissable et sans pouvoir répondre; enfin, courant à elle, il la saisit par la main et la conduisit devant le tableau.
Il représentait une femme peinte en pied, dans le costume de la fin de l’Empire. Sa robe de velours à courte taille et lamée d’or était retenue aux épaules par des agrafes de brillants; une ceinture de perles fines entourait sa taille, et un peigne à galerie de diamants réunissait sur le sommet de la tête des flots de cheveux noirs.
Honorine reconnut au premier coup d’œil les traits et le costume d’une miniature qui lui avait été léguée par la supérieure de Tours; c’était le portrait de la baronne, peinte immédiatement après son mariage, dans tout l’éclat de la jeunesse et de la santé.
La jeune fille poussa un cri et recula.
—Ah! vous la reconnaissez? bégaya Marc.
—Ma mère! interrompit Honorine, en étendant involontairement les mains vers le tableau.
—Oui, reprit le paysan. Oh! c’est elle, c’est bien elle.
—Vous l’avez donc connue? s’écria la jeune fille.
—Non pas si jeune... ni si riante, reprit Marc; car ceci est un portrait du temps où elle était heureuse! mais c’est comme cela qu’elle regardait... Tout à l’heure, en sortant, quand mes yeux ont rencontré les siens, j’ai cru la voir elle-même, et, cependant, je ne m’attendais pas à trouver ici ce portrait...
Honorine tressaillit.
—En effet, dit-elle, il ne peut avoir été placé là qu’à l’insu de ma tante; sans quoi, elle n’eût point souffert... Hier encore, elle me parlait de ma mère avec tant d’émotion...
Marc releva la tête.
—Ah! elle vous en a parlé, dit-il en souriant amèrement... et... avec émotion!... Oui, je comprends, c’est un moyen de gagner votre amitié, et la comtesse en a besoin.
—Que voulez-vous dire?
—Rien, rien; sinon que, du temps de la prieure, madame de Luxeuil n’a jamais eu l’idée de s’informer si vous étiez morte ou vivante, et que, pour lui faire penser à vous, il a fallu l’espérance de vous avoir à sa discrétion.
Honorine fut frappée de cette observation, qui avait déjà traversé son esprit; mais la surprise de l’entendre exprimer par le paysan l’empêcha de s’y arrêter. Elle regarda celui-ci avec une défiance inquiète et s’écria:
—D’où savez-vous tout cela, Monsieur, et quel intérêt avez-vous à me le faire remarquer?
Marc parut troublé.
—Que vous importe, répliqua-t-il brusquement, si vous pouvez trouver dans ce que je dis un avertissement utile.
—Pour croire à un avertissement, il faut connaître celui qui le donne, fit observer Honorine avec une certaine fermeté.
Marc se tut un instant.
—Elle a raison, murmura-t-il, comme s’il se fût parlé à lui-même; et cependant... il faut qu’elle ne doute pas... qu’elle ait confiance!
Il s’arrêta et parut encore hésiter; la jeune fille, qui le regardait, attendait anxieuse; enfin, il lui dit lentement:
—Si je vous donne une preuve que j’ai connu votre mère, qu’elle se fiait à mes paroles... que je vous suis dévoué!... promettez-vous de me croire?
—Pourvu que la preuve soit certaine, répondit Honorine agitée.
Marc fit encore une pause.
—Lorsque la baronne mourut, il y a seize ans, reprit-il avec émotion, elle écrivit elle-même ses dernières volontés.
—Je le sais, dit la jeune fille, dont les yeux devinrent humides; la prieure me les a fait relire bien des fois.
—Alors, vous n’avez point oublié la recommandation qui termine ce testament?
—Non, il y est dit: «Je laisse à ma fille la moitié d’un anneau que j’ai longtemps porté.»
—Puis la testatrice ajoute: «Et je la recommande au souvenir de celui qui possède l’autre moitié.»
—Quoi! vous savez?
—Ce dernier don de votre mère..... vous l’avez toujours?
—Le voici! mais l’autre moitié?
Marc tendit à Honorine un fragment de bague orné d’émeraudes; elle le rapprocha, en tremblant, de celui qu’elle conservait, et reconnut la moitié d’anneau léguée par sa mère à un protecteur inconnu!
Il y eut un moment d’indicible saisissement: la jeune fille, éperdue, regardait Marc qui, les deux bras pressés sur sa poitrine, semblait faire un effort pour comprimer quelque élan secret.
—Ah! parle, balbutia-t-elle les mains jointes et tendues, qui êtes-vous? comment avez-vous connu ma mère?...
—Ne me demandez rien, interrompit le paysan, rappelez-vous seulement la dernière recommandation de la baronne, et ne vous étonnez point trop si elle a cru un homme comme moi capable de vous servir. Le dévouement du chien peut être utile au plus riche et au plus puissant.
—Et en quoi ai-je mérité ce dévouement? comment ma mère a-t-elle pu l’espérer...
—Je n’ai rien à répondre; mais souvenez-vous de votre promesse! vous avez dit que si j’apportais une preuve certaine de la confiance de la baronne, vous partageriez cette confiance.
—Ah! je la partage, s’écria la jeune fille, et, quoi que vous disiez, j’y croirai.
Le paysan fit un geste de joie.
—Alors tout est bien, dit-il, et Dieu, j’espère, nous aidera! Soyez prudente avec votre tante et avec votre cousin; défiez-vous des témoignages d’affection..... Je veillerai sur eux et sur vous!
—Ainsi je vous reverrai, dit vivement Honorine.
—Toutes les fois que vous aurez besoin de moi. Tâchez seulement de vous rappeler le signal d’Étienne, au couvent.
—Ah! je ne l’ai point oublié.
—Eh bien! quand vous l’entendrez, je serai là. Voici quelqu’un, adieu!
Il prit la main de la jeune fille, la porta à son cœur, et à ses lèvres, puis, faisant un effort, il s’échappa précipitamment.
Honorine n’avait point encore eu le temps de se remettre, lorsque la femme de chambre vint la prévenir que la comtesse l’attendait.
Elle s’efforça de reprendre une apparence calme, et alla rejoindre cette dernière qui se trouvait au jardin avec M. le marquis de Chanteaux, le docteur Darcy et Marcel de Gausson.
La comtesse quitta vivement la compagnie en apercevant sa nièce, et s’avança vers elle les deux mains tendues.
—Eh! venez donc, chère petite, s’écria-t-elle de cette voix chantante et mignarde, adoptée par les femmes du monde lorsqu’elles veulent se montrer caressantes; nous étions tout tristes de ne pas vous voir. Je craignais que vous ne fussiez souffrante...
—Et madame la comtesse avait droit de s’inquiéter, ajouta le duc, d’un ton de galanterie surannée, car l’aurore montre habituellement plus matin son frais visage!...
—Celui de mademoiselle est fatigué, fit observer le docteur, dont l’œil était habitué à étudier la moindre altération des traits.
—Ah! mon Dieu! c’est sans doute le voyage! reprit madame de Luxeuil; j’ai eu tort de vous faire appeler, chère belle; vous avez besoin de repos; nous allons rentrer, si vous le désirez...
Honorine assura sa tante qu’elle se trouvait bien, et la supplia de ne rien déranger pour elle; mais celle-ci insista en l’interrogeant minutieusement sur la manière dont elle avait passé la nuit, et sur ce qui pouvait lui être agréable ou salutaire.
Dans la disposition d’esprit où se trouvait la jeune fille, cette exagération de sollicitude lui causa une impatience qui l’engagea à y couper court, en demandant la permission de cueillir un bouquet.
—La permission! répéta la comtesse qui se récria; mais ne savez-vous pas que tout ce qui est ici vous appartient? Fauchez le parterre, ma charmante, si cela peut vous distraire.
—Oui, reprit le duc, avec le même sourire madrigalesque, mademoiselle nous restera et cela nous tiendra lieu de toutes les fleurs!...
Honorine courut aux massifs les plus voisins, afin de ne pas en entendre davantage. La comtesse se tourna vers de Gausson, qui avait jusqu’alors tout écouté en silence.
—Vous qui êtes connaisseur, montrez donc ce que nous avons de plus beau à cette chère enfant, dit-elle.
Marcel s’inclina et rejoignit Honorine.
—Savez-vous que votre nièce est adorable! dit avec chaleur M. Darcy, qui s’était arrêté pour regarder la jeune fille s’éloigner.
—J’espère en faire une femme agréable, répondit madame de Luxeuil, dont l’accent admiratif et caressant avait tout à coup fait place à un ton indifférent.
—Agréable! répéta le docteur; mais regardez-la donc; elle est belle... comme le péché!...
—Vous trouvez?
—Et avec cela un esprit cultivé! Je l’ai entretenue hier soir près d’une heure, et elle m’a ravi.
—Laissez donc, docteur, vous êtes en extase devant toutes les petites filles.
—Du tout, madame la comtesse, du tout; je soutiens que votre nièce est un de ces êtres privilégiés, également favorisés par la nature et par une excellente éducation.
—Mon Dieu! elle a reçu l’éducation de tous les couvents.
—Comment! de tous les couvents, s’écria-t-il; elle a été élevée au couvent?
—Sans doute, au Sacré-Cœur de Tours.
—Vous êtes sûre?
—Quelle question! j’en arrive.
—Mais oui, au fait, je me rappelle maintenant; elle avait été confiée à la Générale des béguines. Les malheureuses! encore une créature qu’elles auront abrutie!
—Par exemple! s’écria madame de Luxeuil, en éclatant de rire, vous vantiez tout à l’heure l’excellence de son éducation.
—Parce que je ne savais pas qui l’avait faite, répliqua M. Darcy, un peu déconcerté, vous concevez que quand on n’est pas averti, on peut confondre les dons naturels avec les dons acquis!
La comtesse sourit sans répondre. La monomanie du docteur était tellement connue qu’on n’y prenait plus garde, et ses déclamations contre le catholicisme produisaient l’effet de ces tics nerveux qui font grimacer certains visages, mais que l’habitude empêche de remarquer. Le marquis vint d’ailleurs s’entremettre; il réussit à passer adroitement, par une transition mythologique, du couvent à l’Opéra, et la discussion se transforma aussitôt en une de ces divagations sans suite, et brodées de scandale, que les gens du monde appellent une conversation.
Mais un entretien plus intime et plus important venait de s’engager, à quelques pas de là, entre Honorine et M. de Gausson.
Obéissant à l’invitation de madame de Luxeuil, Marcel avait d’abord indiqué à Honorine les fleurs les plus rares, en joignant quelques explications; mais il s’aperçut bientôt, que, tout en lui prêtant une attention polie, la jeune fille cueillait de préférence les fleurs les moins précieuses et les mieux connues. Il lui en fit la remarque avec un sourire.
—C’est que celles-ci sont de vieilles amies, répondit Honorine en souriant à son tour; je les connais depuis mon enfance, et elles ont pour elles le souvenir, tandis que les autres n’ont que leur beauté.
—Alors je me tais, reprit de Gausson; je me reprocherais de porter la plus légère atteinte à cette fidélité d’affection; mais puisque vous cherchez des souvenirs, en passant de l’autre côté de cette charmille, vous trouverez une tonnelle de clématite et de rosiers du Bengale pareille à celle du Sacré-Cœur.
—Comment savez-vous cela? demanda Honorine étonnée.
—Autant qu’il m’en souvient, reprit Marcel, on la trouvait à droite du grand préau à quelques pas d’une corbeille d’hortensias...
La jeune fille parut stupéfaite.
—Mais vous avez donc visité le jardin du couvent? s’écria-t-elle.
—J’étais bien enfant, reprit de Gausson; cependant tout m’est encore présent. Il y avait alors, au bout du jardin, une petite serre couverte de chaume.
—Elle y est encore! s’écria Honorine, heureuse de trouver quelqu’un qui connût les lieux où elle avait été élevée.
—Plus bas on voyait des couches pour semis...
—Justement. Ah! vous n’avez rien oublié.
—C’est que moi aussi j’ai laissé là un souvenir, dit Marcel doucement. Cette visite au Sacré-Cœur se rattache à une des sensations les plus charmantes de mon enfance.
Honorine le regarda avec une expression de curiosité timide.
—Vous aviez peut-être au couvent... quelque parente? demanda-t-elle.
—Personne, répondit de Gausson; mais ma mère connaissait la supérieure, et ne manquait jamais de lui rendre visite lorsqu’elle passait à Tours. A l’un de ces voyages je l’accompagnais, et elle me conduisit avec elle.
—Il y a longtemps alors?
—J’avais environ neuf ans. La prieure, après m’avoir fait beaucoup de caresses, appela une petite fille de cinq ans au plus, et nous envoya jouer tous deux dans l’enclos. La première enfance a, encore plus que la jeunesse, ces élans de sympathie instinctive qui font nouer une amitié au premier coup d’œil. Au bout de quelques minutes la petite fille et moi nous nous aimions sans avoir encore eu le temps de nous connaître. Elle me fit visiter tout le parc en me montrant le chariot dans lequel on la traînait, la balançoire faite pour elle, le petit jardin qu’on lui cultivait, et chaque fois elle me répétait:—Tout cela sera maintenant pour nous deux! Je tâchais de répondre à cette générosité enfantine par mes jeux et mes caresses. Je l’enlevais dans mes bras et je courais en l’emportant à travers les pelouses; je cueillais les fleurs trop hautes pour ses mains; j’écartais de ses pas les pierres et les ronces; je l’appelais ma petite sœur et elle me répondait en m’appelant son frère! Notre ivresse de joie ne fut interrompue que par l’apparition de la supérieure et de ma mère.
—On venait vous chercher, peut-être? demanda Honorine visiblement intéressée par le récit de Marcel.
—Précisément, reprit-il, mais au premier mot de séparation, la petite fille me saisit dans ses deux bras, en s’écriant qu’elle voulait me garder, que j’étais son frère et que j’avais promis de ne plus la quitter. Tous les raisonnements et toutes les caresses de la prieure restèrent d’abord inutiles. Ce fut seulement sur la promesse de mon prochain retour qu’elle consentit à s’apaiser. Mais au moment où nous allions la quitter, elle nous échappa tout à coup et disparut dans le jardin.
—Et elle ne revint pas? interrompit Honorine, dont la curiosité semblait s’accroître à chaque instant.
—Elle revint au contraire, continua de Gausson, mais portant en faisceau, dans ses petits bras, les plus belles plantes de son jardin arrachées dans leur fleur et elle s’écria, en me les présentant:—Tiens, mon frère, tu planteras tout cela chez toi pour te rappeler que tu as promis de revenir.
Honorine poussa un léger cri.
—Je ne pourrais dire ce que ces paroles et cette action me firent éprouver, ajouta Marcel, mais tout mon cœur se fondit. Je courus à la petite fille et je me mis à l’embrasser en sanglotant. Dans ce moment j’aurais tout sacrifié, tout quitté pour demeurer près d’elle. Il fallut nous séparer de force, et le soir même je quittai Tours avec ma mère.
—Et vous n’avez jamais revu cette enfant? dit vivement Honorine, chez qui la fin du récit de Marcel semblait avoir éveillé une émotion confuse.
—Jamais, dit le jeune homme avec tristesse. Ma mère mourut quelques mois après; je fus envoyé au collége, et je n’entendis plus parler du couvent de Tours. Aussi, cette rencontre a-t-elle conservé tous les caractères d’un souvenir d’enfance. Précis et entier pour ce qui devait me frapper alors, il est resté incomplet sur tout le reste. Je me rappelle les lieux, les paroles de la petite fille, son costume; mais je ne pourrais dire quels étaient ses traits, et j’ignore son nom; tout ce dont je me souviens, c’est que la supérieure l’appelait l’agneau blanc.
Honorine laissa tomber les fleurs qu’elle avait cueillies.
—L’agneau blanc! s’écria-t-elle, mais c’était moi!
Marcel fit un pas en arrière.
—Quoi! dit-il, cette enfant à cheveux blonds et en robe bleue que la prieure appelait sa fille?...
—C’était moi! reprit Honorine; seulement le temps a bruni la chevelure et mis un terme au vœu qui m’imposait le vêtement couleur de ciel; mais le surnom que m’avait fait donner ma prédilection pour l’agneau représenté dans le tableau de saint Jean, m’a été conservé jusqu’à mon départ du couvent; vous pouvez le demander à ma tante.
—Oh! je vous crois! interrompit de Gausson, qui continuait à la regarder avec un mélange d’étonnement et de joie, oui, ce doit être vous... quoique grandie, changée, je n’ose dire embellie, vous pourriez croire à une flatterie vulgaire. Ah! cette rencontre doit être mise au nombre des bonheurs inespérés et je devrais en remercier Dieu!
Il y avait tant de saisissement dans l’accent du jeune homme qu’Honorine elle-même en fut troublée: elle ne trouva à répondre que quelques mots entrecoupés, et, pour se donner une contenance, elle se mit à relever les fleurs qui lui étaient échappées. Marcel la regarda faire sans songer à l’aider. Il était tout entier à l’émotion de cette reconnaissance inattendue.
—Ainsi, ce que nous nous étions promis, le hasard l’a fait, dit-il après un instant de silence, nous nous revoyons! mais seuls tous deux, et privés des protectrices que nous avions à notre première entrevue.
—Ah! c’est là le triste nuage placé entre le présent et tous les souvenirs, dit Honorine dont les yeux devinrent humides.
—Oui, continua de Gausson, et ce n’est point le seul changement apporté par le temps. Alors nous étions des enfants dont le cœur s’ouvrait sans contrainte, maintenant nous avons grandi et nous devons le tenir fermé. Il y a quinze ans j’étais le frère de l’agneau blanc, aujourd’hui je ne suis plus qu’un étranger pour mademoiselle Honorine Louis.
—Je ne puis regarder comme étrangers les amis de ma tante, fit observer la jeune fille avec embarras.
—Ah! je ne veux pas m’appuyer de ce titre, reprit vivement de Gausson; je suis une connaissance trop nouvelle pour oser me mettre au nombre des amis de madame de Luxeuil, et ce n’est point à elle que je puis devoir la bienveillance de sa nièce!... Non, je ne veux faire appel qu’aux souvenirs échangés tout à l’heure, à ces quelques heures passées dans les jardins du couvent, à ces fleurs arrachées que vous veniez m’offrir et dont je ne vous ai point encore payé le sacrifice! c’est au nom de ce passé que je vous prie de retrouver un peu de votre sympathie d’autrefois, de ne pas me confondre avec la foule des admirateurs que le monde va vous envoyer, de me recevoir enfin comme un candidat à votre amitié. Je ne demande rien de plus, et si ma prière vous semble étrange, ne vous arrêtez ni à sa forme, ni au lieu où je vous l’adresse, ni à l’heure choisie! il est des instants où l’on ne peut retenir ce que l’on sent; croyez seulement à sa sincérité!
—J’y crois, Monsieur, dit Honorine, dont le regard s’était arrêté avec une confiance pour ainsi dire involontaire sur les nobles traits du jeune homme.
—Alors c’est assez, reprit-il d’un ton d’émotion contenue; quant à l’amitié que je sollicite, c’est à moi de la mériter.
Il s’inclina respectueusement et rejoignit madame de Luxeuil qui rentrait avec le marquis et le docteur.
Marcel de Gausson fut fidèle à l’espèce de programme qu’il s’était imposé à lui-même. Bien qu’il cherchât toutes les occasions de voir Honorine et qu’il montrât ouvertement son attachement pour la jeune fille, ses manières ne sortirent jamais des limites de la plus scrupuleuse convenance; ses assiduités avaient quelque chose de calme et de respectueux qui ne pouvait faire naître d’autre idée que celle d’une amitié désintéressée. Il ne flattait point Honorine, il ne lui parlait jamais de lui-même; il se montrait dévoué sans bruit et tendre sans mollesse. A le voir près de l’orpheline, avec la gravité un peu exagérée des hommes jeunes qui ont pris la vie au sérieux, on eût dit un de ces frères aînés dont l’affection réunit le double caractère du père et de l’ami. Telle était, du reste, la simplicité et la loyauté visible de sa manière d’être vis-à-vis de la jeune fille, que l’on parut à peine y prendre garde; ceux qui s’en aperçurent n’y virent qu’une originalité à laquelle la conduite précédente de Marcel les avait préparés.
Ce n’était point, en effet, la première fois qu’il sortait des habitudes reçues pour suivre naïvement ses inclinations. Il y avait déjà longtemps que de Gausson s’était fait, à force de naturel, une réputation d’excentricité: mais cette excentricité demeurait si modeste, si inoffensive que nul ne songeait à l’attaquer, et il y avait tant de grâce dans sa droiture qu’on la pardonnait. Son courage et son adresse étaient d’ailleurs connus dans le monde d’oisifs qui l’entouraient: on savait qu’au besoin il pouvait défendre sa loyauté contre le sarcasme ou la calomnie, et cette assurance donnait aux malveillants une prudente indulgence: au total, Marcel de Gausson avait su se faire une position véritablement exceptionnelle; il avait pu rester impunément sincère, pur et dévoué au milieu d’une société de mensonge, de vice et d’égoïsme.
Honorine qui avait accepté d’abord son amitié avec un peu de réserve, finit par s’y abandonner en toute confiance et par y trouver une inexprimable douceur. Elle était arrivée à ce moment de la vie où le cœur des jeunes filles, à peine sorti des limbes de l’adolescence, se prépare, pour ainsi dire, à l’amour par les exaltations de l’amitié. Celle de M. de Gausson était suffisante pour occuper l’âme d’Honorine sans éveiller en elle de troubles ni de remords; elle y trouva tout ce qu’elle désirait alors. Marcel devint son conseiller dans toutes les incertitudes; elle l’interrogeait comme elle eût interrogé autrefois sa mère adoptive; elle avait besoin de son approbation pour s’approuver elle-même.
Cependant il existait un confident encore plus vénéré, auquel elle adressait ses confessions plus intimes, c’était le portrait de sa mère!
Elle l’avait fait descendre du garde-meuble où il était relégué et l’avait placé dans sa chambre, vis-à-vis de son lit. Mais ne voulant point que l’habitude détruisît la puissance de cette douce image, elle la recouvrit d’un rideau qui la cachait tout entière. C’était seulement le soir, lorsqu’elle se trouvait seule et prête à se livrer au sommeil, que la jeune fille venait demi-nue, comme une enfant qui réclame le baiser de sa mère, s’agenouiller devant le portrait découvert. Alors, l’œil fixé sur ce jeune et tendre visage, elle repassait tout bas ses actions, ses pensées du jour en demandant après chacune d’elles:
—Ma mère, es-tu contente?
Et sa conscience donnait à la chère image, selon le souvenir qu’elle venait d’invoquer, une expression d’encouragement ou de blâme!
Ainsi soutenue par une double protection, Honorine se laissa aller sans inquiétude au courant de sa nouvelle vie.
Les rapports journaliers avaient fini par amortir les exagérations de tendresse de madame de Luxeuil, qui s’étaient insensiblement transformées en une bienveillance assez indifférente; mais la liberté complète laissée à Honorine lui suffisait. Heureuse, elle ne chercha pas rigoureusement la part que sa tante pouvait avoir dans ce bonheur, et elle lui en tint compte comme si elle y eût contribué autrement qu’en le permettant.
Celui qui avait éveillé ses soupçons contre la comtesse ne lui avait d’ailleurs fait parvenir aucun avertissement. Une première fois Honorine avait cru le reconnaître, à la promenade, sous un costume de bourgeois, et une seconde fois, à la porte même de la villa, déguisé en marchand colporteur; mais dans l’une et l’autre occasion il s’était si rapidement éclipsé que la jeune fille doutait elle-même de la réalité de ces apparitions.
Quant à la scène du portrait, elle ne se la rappelait qu’avec angoisse, comme un souvenir confus et pénible. Plus elle s’éloignait du moment où cette scène avait eu lieu, plus l’émotion qu’elle lui avait causée s’effaçait, et plus les circonstances lui en semblaient inexplicables. Il y avait même des moments où elle revenait sur ce qu’elle avait cru alors et mettait en doute les droits de Marc à sa confiance.
La modification survenue dans les manières de madame de Luxeuil et la conduite d’Arthur contribuèrent encore à ôter à la jeune fille toute défiance. Son cousin surtout lui témoignait une amitié familière dont la franchise excluait évidemment toute idée de piége tendu. Il avait pris, dès le premier instant avec elle, le ton libre d’un compagnon d’enfance, et Honorine, d’abord étonnée, avait fini par l’accepter comme un privilége que le monde accordait, sans doute, à la parenté. Madame de Luxeuil, si scrupuleuse sur tout ce qui concernait l’usage, justifiait cette familiarité en l’autorisant. Elle permettait à Arthur de la suivre partout et de prendre, en toute occasion, près de sa cousine, le rôle de cavalier servant. Le jeune homme remplissait ces fonctions avec une humeur inégale, se montrant parfois empressé, parfois distrait. C’était, du reste, une de ces natures qui cachent leur vulgarité sous des formes d’une élégance convenue; manants enveloppés d’aristocratie dont la distinction est au dehors et la grossièreté dans le cœur. Uniquement dominé par sa sensualité égoïste, vain sans orgueil, railleur pour tout ce qui était généreux, n’ayant ni la noble répugnance qui fait fuir le mal, au moment de le commettre, ni la honte qui fait qu’on le cache lorsqu’on l’a commis, il personnifiait cette jeunesse riche, titrée, inutile, dont les facultés se corrompent dans l’inaction; espèce de cloaque humain qui attire à lui tout ce qu’il y a de faible ou de misérable, parce qu’en remuant sa fange on y trouve de l’or!
Quant à l’esprit, Arthur en avait, mais du plus facile. Il tirait toute sa gaieté de la malveillance; toute sa profondeur du mépris des hommes. Ne croyant qu’aux vices, c’était toujours en eux qu’il cherchait le moyen et la cause, et ce procédé était chaque jour justifié par l’expérience du milieu dans lequel il vivait. Cependant cette intelligence si bien en garde, était facile à surprendre par un côté. Prévoyante pour le mal, elle était prise au dépourvu par le bien. Elle ne voyait plus, elle ne comprenait plus: pour elle un cœur désintéressé était comme un vase privé d’anses; elle ne savait de quel côté le prendre, elle doutait et restait étourdie.
Malheureusement Honorine n’avait ni l’occasion ni la volonté d’étudier le caractère de son cousin, et, de tout ce que nous venons de dire, elle n’aperçut que quelques dehors. La plupart des vices touchent de si près à des qualités que pour les reconnaître, il faut avoir la volonté de les voir. Le cynisme d’Arthur, contenu devant sa cousine, put paraître à celle-ci du sans-façon; son égoïsme trop souvent justifié, ressemblait à de l’expérience, son ironie perpétuelle frappait tant de sottises et de méchancetés qu’on pouvait la prendre pour de la justice; Honorine n’avait d’ailleurs aucun intérêt à regarder de près dans cette âme; l’occupation de sa vie était d’un autre côté.
Tout se borna donc à une indifférence instinctive pour son cousin.
Celui-ci avait entrepris, peu de temps après l’arrivée de la jeune fille, de lui apprendre à monter à cheval, et ces leçons étaient devenues l’occasion de rapprochements plus fréquents. Honorine mettait une grande ardeur dans ces exercices, qui la retiraient momentanément de l’inaction imposée aux femmes, et lui permettaient d’essayer son audace: elle y était d’ailleurs engagée par l’exemple de plusieurs jeunes femmes, amies de la comtesse, qui venaient à Bagatelle; car madame de Luxeuil, toujours avide des plaisirs du monde, et voulant continuer à y participer, au moins comme spectatrice, avait renoncé à la compagnie de ses contemporaines pour s’entourer de femmes à la mode qui conservaient à son salon l’éclat, la gaieté et l’entrain que communiquent à tout la beauté et la jeunesse.
Parmi ces habituées, deux surtout méritent une mention spéciale; c’étaient madame la marquise de Biezi et madame des Brotteaux.
La première, parente éloignée de la comtesse, avait épousé un Italien fort riche, fanatique touriste que l’on trouvait partout excepté chez lui. Il avait parcouru successivement les cinq parties du monde, non pour les étudier, ni même pour les voir, mais afin de visiter les montagnes les moins accessibles; c’était là sa spécialité. En 1816, il avait gravi le Mont-Blanc; en 1818, il était parvenu au-dessus du plateau des Cèdres, dans le Liban; en 1821, il avait exploré le Kamberg au cap de Bonne-Espérance; en 1823, il était parvenu à traverser les Andes. Mais il lui restait à franchir le Dawalagiri, élevé de huit mille cinq cent vingt-neuf mètres au-dessus de la mer. Sans le Dawalagiri, toutes les autres ascensions étaient vaines; le Dawalagiri seul pouvait faire de lui le premier grimpeur de montagnes du monde civilisé; il balança longtemps, retenu par la difficulté d’une pareille entreprise, et excité par la gloire de l’accomplir! Enfin, la gloire l’emporta; il partit pour le Thibet, emportant les souhaits de la marquise et une note pour l’achat de six cachemires.
On n’avait point encore reçu de ses nouvelles depuis son départ, mais madame Lea de Biezi s’en consolait en se plongeant, avec une ardeur furieuse, dans le tourbillon du monde. C’était une femme de vingt-quatre ans, grande, élancée, et de cette beauté souveraine dont l’art se plairait à parer Aspasie, Cléopâtre ou Diane de Poitiers. Tout son être révélait la résolution et la vigueur, enveloppées de grâces. Son œil était fier, sa voix timbrée, sa démarche ferme, son langage net et hardi. Obéissant à sa seule fantaisie, elle ne reculait ni devant la barrière du devoir, ni devant celle de l’usage. Aussi, le docteur Darcy la comparait-il à ces magnifiques cavales du désert que n’arrêtent ni les sables, ni les rochers, ni les montagnes, et qui, la crinière flottante et les naseaux ouverts, s’élancent partout où les appelle la brise rafraîchie par les sources ou embaumée par les pâturages.
Elle avait alors pour cavalier servant le prince Dovrinski, réfugié polonais, que son brillant courage avait rendu célèbre dans la dernière insurrection contre la Russie. On le trouvait partout où paraissait Léa, jaloux et sombre, mais obéissant au moindre geste. Évidemment malheureux du lien qui le retenait, il était sans force pour le briser. La marquise, qui le savait, se plaisait à essayer sur lui son pouvoir. Fantasque et curieuse, elle jouait avec ce lion apprivoisé pour connaître jusqu’où pouvait aller sa patience; elle l’aiguillonnait de soupçons, secouait sa chaîne, excitait sa colère; puis, au premier rugissement, elle faisait signe, et le lion se couchait à ses pieds.
Ce jeu terrible faisait trembler madame Hortense des Brotteaux, amie de la marquise, mais d’un caractère complétement opposé. Autant celle-ci avait d’activité et de commandement, autant Hortense montrait de langueur et de soumission. A voir ses riches formes, son grand œil noir et son beau visage au teint uni, que sa chevelure brune encadrait de cheveux épais, on eût pu croire à un caractère fort et volontaire; mais, en y regardant mieux, on apercevait je ne sais quel nuage de mollesse qui entourait toute sa personne. Ses cheveux, si abondants, n’avaient point d’attitude qui leur fût propre; les lignes de ce visage charmant flottaient incertaines, et le regard de ses grands yeux noirs était noyé dans une expression de timidité voluptueuse. En réalité, Hortense appartenait à ces natures soumises, douées d’une sorte d’aptitude innée pour la servitude, et qui acceptent les jougs comme des points d’appui.
Rien n’eût été plus facile à M. des Brotteaux que de façonner à son gré cette volonté inconsistante et que de se faire le roi absolu de cette vie sans direction; mais M. des Brotteaux était membre de la cour des comptes et n’avait point le loisir de veiller à une éducation pareille. En épousant Hortense, il avait entendu prendre une femme tout élevée et dont il n’aurait plus à s’occuper. Le maintien de son influence et les soins qu’exigeait son avancement politique ne lui laissaient point un seul instant pour de semblables détails.
Il abandonna donc madame des Brotteaux à ses propres inspirations, c’est-à-dire à celles du premier venu, et ce premier venu se trouva précisément l’homme qu’il fallait pour dominer le caractère vacillant d’Hortense.
M. de Cillart était ancien brigadier garde du corps, et Breton, double raison pour avoir la volonté ferme et le goût du commandement: aussi, devint-il bientôt le maître absolu des actions, des pensées et des sentiments de madame des Brotteaux. Celle-ci obéissait à son impulsion, avec hésitation quelquefois, mais toujours sans révolte. Les tyrannies de M. de Cillart avaient même, pour elle, une sorte de charme; c’était une secousse qui l’arrachait, de loin en loin, à son apathie. Grâce à lui, elle avait, par instant, le plaisir de pleurer ou de se mettre en demi-colère; sans M. de Cillart, elle eût à peine pu distinguer si elle était morte ou vivante.
Parmi beaucoup d’autres fantaisies, l’ancien brigadier des gardes du corps eut celle de transformer madame des Brotteaux en amazone. Depuis quelque temps il l’obligeait à monter à cheval et à faire, avec madame de Biezi, des espèces de courses au clocher, à travers les bois et les bruyères. Honorine avait été de quelques-unes de ces courses dans lesquelles elle avait essayé, tour à tour, de rivaliser d’audace avec la marquise et de rassurer madame des Brotteaux. A son retour à Paris, elle continua à leur tenir compagnie, lorsque le soleil brillait sur Boulogne et permettait à la fashion de se donner rendez-vous dans les longues allées bordées de fagots et de restaurants, que l’on a décorées du nom de bois.
Elle revenait d’une de ces promenades par une belle journée d’octobre, et les chevaux, qui avaient repris le pas, marchaient à peu de distance l’un de l’autre, suivant la chaussée de l’avenue de la Muette. En tête s’avançait madame de Biezi, le teint animé par l’air encore âpre, malgré le soleil, le regard brillant, les narines dilatées, magnifiquement belle et hardie, sur son cheval arabe, qui frémissait d’impatience. A ses côtés marchait le prince Dovrinski, dont la grande tournure formait un singulier contraste avec l’expression inquiète et presque craintive de ses traits.
Un peu en arrière, et parallèlement à la calèche de madame de Luxeuil se tenaient Honorine et de Gausson, de Cillart et madame des Brotteaux. Celle-ci, à peine remise du temps de galop auquel le brigadier des gardes du corps avait forcé son cheval, semblait encore se raffermir en selle et regarder avec effroi l’espace qu’elle venait de franchir, tandis que son tyran la raillait brusquement de sa lâcheté.
Arthur, Marquier et le docteur Darcy suivaient à quelque distance. Enfin, un peu plus loin, venaient plusieurs coureurs à cheval et l’équipage de la marquise de Biezi.
La conversation était fort variée sur les différents points de la caravane élégante. Brève et rare à la tête, plus animée autour de la calèche de madame de Luxeuil, elle devenait bruyante dans le dernier groupe de cavaliers qui se trouvaient assez loin de celle-ci pour ne point être entendus.
—Avez-vous vu comme de Cillart conduit cette pauvre madame des Brotteaux, demandait Arthur au docteur; on dirait un capitaine instructeur avec sa recrue.
—Pardieu! je suis fâché qu’il n’ait point affaire à la marquise, répliqua M. Darcy; elle est superbe d’énergie, cette femme. C’est le plus bel exemple de tempérament bilio-sanguin que j’aie jamais rencontré.
—La marquise est le Martin de la galanterie, reprit Arthur; elle dompte les bêtes fauves.
—Il est certain que ce pauvre prince a l’air d’un tigre apprivoisé malgré lui.
—Le dépit et la jalousie le rongent.
—Il a tellement changé depuis quelque temps que je lui soupçonne une affection au foie.
Arthur hocha la tête d’un air profond.
—Eh bien! voilà ce que rapporte l’amour des grandes dames, mon cher docteur, dit-il; il faut toujours jouer près d’elles le rôle de Dovrinski ou celui du brigadier. Être tyran ou tyrannisé, et, en tous cas, complétement pris. Une pareille liaison est une véritable profession; vous n’avez plus à vous ni temps ni liberté. J’en ai essayé, et le jour où je suis sorti de ce bagne, j’ai bien juré de n’y plus rentrer.
—Et c’est alors que vous vous êtes tourné vers le théâtre? demanda M. Darcy en riant.
—Précisément, docteur. Là, du moins, on n’a besoin ni de soins, ni de précautions; on fait l’amour hors la loi! De chaque côté on conserve son indépendance; il n’y a ni réputation à ménager, ni faux scrupules à combattre, ni convenances à respecter. On peut être sans crainte, de bonne humeur et de mauvais ton. Aussi, voyez-vous, docteur, je ne donnerais pas Clotilde pour toutes nos marquises.
—Parce qu’elle vous coûte plus cher! s’écria en riant Aristide Marquier, qui venait enfin de décider Lucifer à rejoindre nos deux interlocuteurs.
Arthur lui jeta un regard de côté.
—C’est là seulement ce qui frappe le banquier, dit-il, avec une hauteur dédaigneuse; pour lui, une femme est comme tout le reste, une question d’argent, et il va au meilleur marché.
—Du tout, du tout, reprit Marquier sérieusement; vous savez, mon cher, que j’ai à cet égard des principes!... Je ne comprends pas une liaison qui entraîne dans des dépenses! La femme la plus séduisante qui accepterait un cadeau me deviendrait insupportable. C’est peut-être une délicatesse outrée; mais on ne se refait pas...
—Malheureusement! fit observer de Luxeuil, en enveloppant le gros petit capitaliste d’un regard ironique.
—Enfin, continua Marquier, avec chaleur, il me faut un choix désintéressé et je veux être aimé pour moi-même.
—Voilà pourquoi personne ne l’aime! ajouta Arthur en s’adressant au docteur.
Le banquier balança la tête d’un air discret.
—Vous savez que sur ce sujet, je m’abstiens toujours de répondre, dit-il sérieusement: vous mettez votre gloire à publier vos amours, moi je la mets à les cacher. Soyez seulement certain, mon bon, que les affaires de cœur d’Aristide Marquier ne sont pas en plus mauvais état que ses affaires de banque.
—A propos de banque, interrompit Arthur, chez qui un souvenir parut se réveiller tout à coup; connaissez-vous un drôle nommé Clément Raimbaut et s’intitulant banquier.
—Raimbaut!... certainement; c’est un ancien commissionnaire en rouenneries, qui s’est associé à un ancien boucher, pour faire l’usure. Auriez-vous quelque chose à démêler avec lui?
—J’en ai peur. Il m’a avancé autrefois une somme pour laquelle je lui ai souscrit des billets.
—Ah! diable! et leur échéance est arrivée.
—On les a, je crois, présentés hier: du reste, je dois avoir des notes sur toute cette affaire, et je serais bien aise de prendre votre avis.
—Comment donc! je suis à vos ordres, mon bon; nous soupons demain ensemble chez Clotilde; si vous voulez, j’irai vous chercher, et nous examinerons...
—Demain, non, j’ai promis de me trouver à la course de lord Durfort, mais si vous pouviez, aujourd’hui, me conduire à l’hôtel...
—Volontiers. Jusqu’à l’heure de la Bourse je suis libre...—Mais, voyez donc, voilà de Cillart qui a remis cette pauvre madame des Brotteaux au galop. Pardieu! je serais curieux de voir la figure de la victime.
—C’est facile; rejoignons-la.
Les deux cavaliers partirent suivis du docteur, et gagnèrent la tête de la cavalcade, de sorte que de Gausson et Honorine se trouvèrent, à leur tour, seuls en arrière.
Sans que le jeune homme et la jeune fille y eussent pris garde, la calèche les avait un peu devancés, et ils marchaient de front, au petit pas de leurs chevaux, continuant une de ces conversations charmantes qui sont, à la fois, des rêveries et des épanchements. C’était avec Marcel seulement qu’Honorine trouvait l’occasion de ces échanges de sentiments et de pensées qui laissent après eux un souvenir; car lui seul avait la sérénité tendre qui intéresse l’âme en l’élevant. Aussi, quelque brillant que fût l’esprit de la plupart des habitués de la comtesse, la jeune fille leur préférait la gravité de Marcel; les autres ne savaient que causer, tandis que lui, il parlait!
Cependant, depuis quelque temps, sa parole semblait moins calme et moins libre. Souvent, au milieu même de ses élans les plus expansifs, un nuage passait sur son front, et il tombait dans une tristesse silencieuse et embarrassée. Honorine, inquiète, avait alors recours à tous les moyens pour l’y arracher. Faisant appel à cette espèce de fraternité proposée par de Gausson, elle le pressait de questions, elle se montrait tour à tour mécontente, affligée; elle lui reprochait de manquer de confiance! Le jeune homme se débattait avec effort contre les témoignages de cette amitié, mais sa résistance même l’exaltait chaque jour davantage.
Ainsi tous deux se trouvaient, avec des dispositions différentes, sur cette pente glissante qui conduit à l’amour, et, tandis que de Gausson résistait, malgré lui et avec peine, Honorine, ignorante du danger, l’entraînait à sa suite sans s’en apercevoir.
La promenade qu’ils venaient de faire les avait tenus séparés jusqu’au moment où ils demeurèrent tous deux isolés, derrière la calèche de madame de Luxeuil. Cependant, la conversation engagée parut d’abord étrangère à ce qui faisait le sujet ordinaire de leurs querelles. Animée par la course et heureuse de la présence de Marcel, la jeune fille admirait naïvement tout ce qui frappait son oreille ou ses yeux.
—Oui, disait-elle avec un joyeux abandon, j’aime le bruit et le mouvement qui annoncent l’approche de Paris. Ces chariots qui se pressent, ces passants qui courent, ces ouvriers qui s’appellent, tout m’intéresse et m’occupe; il me semble qu’ici les hommes vivent plus qu’ailleurs.
—Je suis comme vous, dit Marcel, mais cette vue, au lien de me réjouir, m’attriste toujours.
—Parce qu’elle me fait faire un retour involontaire sur moi-même. Je ne puis regarder l’activité de la foule sans penser que chacun de ces hommes accomplit sa tâche et remue son grain de poussière dans le monde, tandis que moi je passe oisif et inutile au milieu du travail universel. Alors je me sens pris d’une sorte de mépris pour l’existence inoccupée dans laquelle le hasard m’a jeté!
—N’en pouvez-vous donc sortir? toutes les carrières vous sont ouvertes.
—Sauf celles que m’interdit ma naissance! car chacun porte ici-bas son fardeau originel. Si le peuple reçoit pour héritage la misère et l’ignorance, la noblesse reçoit la folie et l’orgueil. N’ai-je pas ce qu’on appelle un nom à porter, c’est-à-dire l’obligation de ne suivre que certaines routes tracées? encore pour les parcourir faudrait-il une éducation, des habitudes qui ne m’ont point été données. Ceux qui ont fait de moi un homme ne m’ont appris que l’oisiveté; ils y ont mis leur sagesse et mon honneur. Inhabile à tout, grâce à leurs soins, je ne puis jamais prétendre à la joie d’élever pierre à pierre, comme tant d’autres, mon édifice de fortune.
Honorine regarda de Gausson avec une sorte d’étonnement inquiet.
—Mon Dieu! seriez-vous ambitieux? demanda-t-elle.
—Ambitieux de bonheur, répondit Marcel, en souriant.
—Et pour être heureux, il vous faut cet édifice de fortune que vous regrettez?
—Oui.
—Qu’en voulez-vous donc faire?
De Gausson parut hésiter.
—Je voudrais, dit-il, après un moment de silence, je voudrais pouvoir l’offrir à la femme que j’aurais préférée.
—Ainsi ce serait pour l’enrichir?...
—Non, mais pour avoir le droit de choisir librement, de parler sans crainte; ce serait pour qu’une affection loyale ne fût pas exposée à paraître un odieux calcul; pour ne pas être obligé enfin d’échapper à la honte du soupçon en renonçant au bonheur.
—Et pourquoi y renoncer?
—Parce que je n’y ai point droit. L’homme né pour être le bienfaiteur et le soutien de la femme ne peut, sans mentir à son devoir, devenir le soutenu et l’obligé; c’est à lui de se faire place dans la vie, d’en offrir une part à celle qu’il a choisie et de lui donner en travail, en dévouement, en courage, ce qu’elle lui rend en charme et en amour.
Et comme il s’aperçut du mouvement qu’avait fait Honorine:
—Mais, pardon! ajouta-t-il en souriant; je me laisse aller à une véritable confession, et vous devez me trouver bien hardi.
—Hardi? non, dit la jeune fille émue.
—Bien fou, du moins?
—Non, non.
—Quoi donc alors?
—Bien orgueilleux!
Marcel garda un instant le silence.
—Peut-être, dit-il, mais ne soyez pas trop sévère à l’orgueil, car, au milieu de toutes nos faiblesses et de tous nos abaissements, c’est le seul vice qui nous soutienne à l’égal de la vertu. L’âme humaine est une place perpétuellement assiégée, pour le salut il faut accepter tous les défenseurs, sans s’informer de leurs noms ni de leur origine.
—Ainsi, reprit Honorine, qui semblait suivre sa propre idée plus que celle du jeune homme, votre fierté ferait taire vos préférences mêmes?... Parce que d’autres font à la femme un mérite de sa richesse, vous lui en feriez, vous, un titre d’exclusion; vous refuseriez jusqu’à son affection?
—Pourquoi m’interroger sur ce que je ferais? reprit vivement de Gausson; qui peut répondre de mettre toujours d’accord ses sentiments et ses principes? A quoi bon d’ailleurs supposer une tentation impossible? Suis-je donc de ceux qui savent réveiller ces irrésistibles sympathies?...
—Vous ne répondez pas! fit observer Honorine avec une sorte d’impatience.
—Parce que je ne puis admettre votre supposition.
—Admettez-la, je le veux, et répondez.
—Répondre! dit Marcel qui, depuis quelques instants, luttait, avec un effort évident, contre son propre entraînement; répondre!... répéta-t-il en regardant Honorine, dont les yeux continuaient à l’interroger; eh bien!...
Il s’interrompit de nouveau.
—Eh bien? J’attends! insista Honorine.
—Eh bien! dit Marcel d’une voix plus basse, mais d’un accent profond, mes résolutions, mes craintes, mon orgueil... j’oublierais tout... pour la femme... qui vous ressemblerait!
La jeune fille tressaillit de surprise et de saisissement. Dans sa naïve inquiétude, elle avait voulu arracher à de Gausson une rétractation sans prévoir que cette rétractation pouvait entraîner un aveu. Une rougeur subite couvrit ses traits; elle regarda autour d’elle avec trouble; mais l’intervalle qui la séparait de la calèche ne permettait point de craindre que Marcel eût été entendu. Elle tourna les yeux vers lui, voulut murmurer quelques mots, et, semblant céder tout à coup à je ne sais quelle confusion effrayée, elle releva la bride de son cheval et rejoignit rapidement la comtesse.
On était arrivé au rond-point des Champs-Élysées, où celle-ci prenait congé de ses compagnes de promenade. La marquise et madame des Brotteaux se dirigèrent vers le faubourg Saint-Germain, et MM. Darcy et de Gausson continuèrent le quartier du Louvre. Quant à madame de Luxeuil, elle tourna par l’avenue de Marigny pour gagner le faubourg Saint-Honoré avec sa nièce, Arthur et Marquier.
L’habitation de la comtesse, comprise dans le massif d’édifices qui sépare la rue Duras de la rue d’Anjou, avait une double façade comme la plupart des hôtels bâtis sous Louis XV. L’une donnait sur un parterre, récemment disposé en jardin anglais, l’autre sur une cour d’entrée, fermée à droite et à gauche par les bâtiments de service.
Ce fut dans cette cour que la comtesse descendit de calèche, tandis qu’Arthur aidait Honorine à mettre pied à terre. Celle-ci s’élança dans l’escalier, sur les pas de sa tante, et de Luxeuil revenait vers Marquier, lorsqu’un homme en lunettes et vêtu de noir, qui semblait attendre à la porte de la loge, s’avança à sa rencontre.
—C’est bien à monsieur Arthur de Luxeuil que j’ai l’honneur de m’adresser? demanda-t-il le chapeau à la main, et d’un air respectueusement riant.
—Que me voulez-vous? dit Arthur sans s’arrêter.
—Pardon, reprit l’homme noir, en fouillant dans une de ses poches, si monsieur pouvait m’accorder un instant...
—Vite, je suis pressé.
—Il s’agit d’une affaire...
—Après?
—......D’une affaire de billets... souscrit à monsieur Raimbaut.
—Raimbaut! s’écria Arthur, en s’arrêtant court, vous venez alors pour ce paiement?...
—De douze mille sept cent quarante-trois francs, continua l’homme aux lunettes, qui avait tiré de son portefeuille plusieurs papiers; on a déjà eu l’honneur de se présenter hier, mais comme monsieur était absent, j’ai reçu l’ordre de passer ce matin...
—C’est-à-dire que vous êtes huissier, et que vous venez pour le protêt!
—Dans le cas où monsieur ne jugerait pas à propos de faire honneur à sa signature...
De Luxeuil mesura l’huissier d’un regard presque menaçant.
—Attendez, lui dit-il brusquement.
Et s’avançant vers Marquier, qui venait de remettre Lucifer à un domestique, il passa un bras sous le sien, et le conduisit à l’écart, près d’un appenti servant de bûcher.
Leur conversation se prolongea assez longtemps à voix basse. Aux premiers mots prononcés par Arthur, le banquier avait paru se récrier et se défendre; mais une nouvelle confidence sembla l’apaiser subitement; il y eut entre lui et de Luxeuil un échange d’explications rapides, à la suite desquelles Marquier, convaincu, ordonna à l’huissier de le suivre, pour recevoir le paiement de ses billets, tandis qu’Arthur rentrait à l’hôtel.
A peine tous deux eurent-il disparu, qu’un homme en pantalon de velours olive, les bras nus et la scie à la main, se montra à la porte du bûcher: c’était Marc, le paysan de la Forge des-Trois-Buttes, et le dépositaire du fragment d’anneau remis par la baronne! il avait vu tout ce qui venait de se passer, et, parmi les paroles échangées entre de Luxeuil et le banquier, il avait distingué le nom d’Honorine!
Il s’arrêta d’abord près du seuil, paraissant hésiter sur ce qu’il devait faire, réfléchit quelques instants, puis, comme frappé d’un trait de lumière, il déposa précipitamment la scie qu’il tenait, reprit sa casquette de cuir, sa veste de commissionnaire, traversa la cour de l’hôtel, et se dirigea rapidement vers la rue des Morts.
Quiconque a étudié les quartiers populaires de Paris, a nécessairement remarqué le rapport frappant qui existe entre l’aspect extérieur de chacun d’eux et la nature de ses habitants. Il y a un proverbe arabe qui dit que si l’on donnait une enveloppe de colimaçon à la tortue, elle y trouverait place pour ses quatre pattes. Or, ce qui n’est qu’une supposition pour l’animal amphibie est la réalité même pour l’homme. Telle est en effet sa puissance d’appropriation qu’il finit par modifier tout ce qui l’environne, selon ses habitudes et ses goûts. Aussi y a-t-il pour qui regarde bien, dans la situation d’un quartier, dans la physionomie de ses constructions, dans la nature de ses boutiques, dans le choix des marchandises, mille révélations qui ne peuvent tromper. On devine les instincts de la population en voyant quels sont ses besoins.
La communauté même de misères ne peut effacer ces marques distinctives: il y a souvent, entre deux quartiers également pauvres, des contrastes visibles pour l’œil le moins attentif. Comparez, par exemple, la Cité à Saint-Martin-des-Champs. Des deux côtés vous trouverez même indigence, même abandon, et, cependant, quelle différence! les maisons de la Cité à entrées obscures, à fenêtres toujours fermées, entassées l’une sur l’autre, semblent n’avoir d’autre but que de dérober leurs habitants à la clarté du jour; ce sont moins des demeures que des repaires. Là, les rues étroites ne sont bordées que de rogomistes à demi-cachés, de tabagies aux vitres dépolies, de gargotiers sans enseignes, de débits de tabac tenus par des hommes et de cabinets de lecture dont les volets garnis d’affiches illustrées ne présentent que scènes de meurtre et images de mort. Aucun bruit de métier annonçant le travail; nul roulement de charrette prouvant l’activité des transactions commerciales; point d’enfants sur les seuils! Mais, partout des hommes inoccupés qui se croisent ou s’accostent, des femmes en haillons élégants groupés devant les comptoirs des marchands de consolation, et, de temps en temps, un fiacre soigneusement fermé qui rase une des portes obscures, s’arrête un instant, puis repart, sans que l’on puisse dire s’il a pris ou laissé quelqu’un.
Mais c’est surtout la nuit que la Cité prend un aspect sinistre. La plupart des boutiques fermées dès huit heures laissent les rues sans autre clarté que celle des réverbères, que le vent balance et fait crier. De loin en loin seulement, quelques lanternes de marchands de vin ou de tabac brillent sourdement au milieu du brouillard nocturne, tandis que dans chaque enfoncement obscur se montre, comme un fantôme, quelque femme parée de haillons, qui vous appelle d’une voix rauque, ou quelque homme à l’affût, qui semble attendre une proie, le dos appuyé au mur et les deux mains sous son bourgeron.
A Saint-Martin-des-Champs, rien de tout cela! les rues sont larges, les maisons inondées de lumière, les seuils couverts d’enfants qui jouent et s’appellent. Aux fenêtres ouvertes sèche la lessive de chaque ménage, témoignage d’ordre et d’économie autant que de pauvreté. Sous chaque haillon blanchi grimpe la capucine veloutée, le volubilis aux teintes irisées, et le pois de senteur. Des chants se mêlent au bruit des marteaux; les femmes entourent les laitières, entrent chez le fruitier, ou reviennent des fontaines. C’est toujours la pauvreté, sans doute, mais courageuse et sans honte; c’est la pauvreté qui se montre, parce qu’elle n’a rien à se reprocher, et qu’elle n’a perdu aucun des instincts humains; la pauvreté aimant le soleil, les fleurs et les enfants! A la Cité vous trouviez les vices créés ou mal combattus par une société égoïste; à Saint-Martin-des-Champs ce ne sont que les besoins qu’elle néglige de satisfaire, et les souffrances qu’elle oublie de soulager. Là on a un égout que l’on pourrait tarir, ici un champ de blé que l’on ne veut pas bien cultiver; mais, tels qu’ils sont, l’égout répand ses influences malfaisantes et communique la mort, tandis que le champ de blé produit sa moisson!
Or, dans ce quartier de Saint-Martin-des-Champs, dont nous avons essayé de donner une idée, se trouve une rue peu connue, quoiqu’elle relie à leur extrémité les faubourgs Saint-Martin et du Temple; c’est la rue des Morts. Malgré son nom lugubre, la rue des Morts n’a rien de triste, et ses maisons d’ouvriers peuvent même être citées parmi les moins mal entretenues et les mieux aérées. Une d’elles surtout se faisait remarquer à l’époque où se passent les événements rapportés dans notre récit. Elle ne se composait que de deux étages, et avait pour entrée une porte cochère dont l’élégance eût fait croire à une habitation bourgeoise plutôt qu’à une demeure d’ouvriers. Telle n’avait point été non plus sa destination primitive; mais le maître-maçon qui l’avait construite ne trouvant pas des locataires comme il faut, s’était décidé à en faire, selon son expression, un couvent de gueux. Se réservant le rez-de-chaussée, à côté duquel s’étendait un assez vaste chantier, il avait loué le reste, par pièces séparées, à de pauvres diables qui devaient lui payer leur loyer par semaines, et auxquels il n’accordait jamais le moindre répit; car maître Laurent, comme beaucoup d’ouvriers parvenus, se montrait impitoyable pour ceux qui avaient été moins heureux que lui. Favorisé par une santé de fer et par cette activité persistante qui réussit plus sûrement qu’une large intelligence, il était devenu successivement tâcheron, puis maître, puis entrepreneur, et avait fini par s’enrichir. Aussi, fort de sa réussite, s’en armait-il sans cesse contre ses anciens compagnons. A toutes les plaintes, il ne répondait qu’une seule chose:
—Fais comme moi!
C’était le raisonnement de la grenouille échappant à l’épervier en plongeant dans les eaux et criant au roitelet de l’imiter; mais maître Laurent n’en était point encore à savoir que dans ce partage des professions dont notre société laisse le soin au hasard, l’aptitude et la réussite ne peuvent être un fait volontaire, mais une rare exception.
Quoi qu’il en soit, l’exigence du maître-maçon avait eu pour résultat de le débarrasser de tous les mauvais payeurs qui avaient été successivement remplacés par des gens tranquilles et rangés dont le loyer ne se faisait jamais attendre. Ce corps de locataires d’élite, comme les appelait maître Laurent qui, en sa qualité de sergent dans la garde nationale, affectionnait les images militaires, avait pour vaguemestre et pour fourrier le sieur Brousmiche, dit la Montagne, petit bossu qui remplissait dans la maison les fonctions de portier.
Condamné au ridicule par son infirmité, Brousmiche avait pris la vie du côté de la résignation: il eût été difficile de trouver un caractère plus inoffensif et plus conciliant. Comme, d’après son propre dire, aucune femme n’avait jamais pu le regarder sans rire, il s’était résigné au célibat, et avait concentré toutes ses affections sur un chat et un chardonneret, Lolo et Fanfan, qui lui tenaient lieu de famille.
Malheureusement, tous ses efforts pour établir une amitié fraternelle entre ses deux protégés avaient été jusqu’alors inutiles, et il voyait avec douleur se renouveler sous ses yeux l’histoire d’Abel et de Caïn. Plusieurs fois déjà, l’Abel emplumé avait failli tomber sous les griffes du fratricide, et Brousmiche venait de prévenir un nouvel acte de ce genre, lorsqu’une jeune femme en bonnet et enveloppée d’un tartan, entra dans la loge, un carton à la main.
Elle trouva le bossu debout devant son chat auquel il adressait les reproches les plus pathétiques sur son nouvel attentat.
—Comment, s’écria la jeune femme, qui s’était arrêtée à la porte, ce monstre de Lolo a encore voulu plumer le chardonneret?
—Ne m’en parlez pas, madame Charles, dit le bossu, en portant la main à sa calotte grecque, par une habitude machinale de politesse; le malheureux me fera mourir de chagrin.
—Mais il faut le battre, dit la grisette en s’approchant du matou, comme si elle eût voulu joindre l’exemple au conseil.
Le bossu se plaça devant son chat.
—Faites excuse, madame Charles, dit-il en avançant la main d’un air doctoral: mais vous savez que les coups n’entrent point dans mes idées d’éducation.
—Bah! reprit la jeune femme en riant: l’éducation d’un chat! vous respectez trop les bêtes, monsieur Brousmiche.
—En tout cas, je ne suis pas le premier, reprit le bossu, qui se piquait de lecture, et qui avait, au-dessus de son poêle, une étagère couverte de volumes dépareillés; les Égyptiens des pyramides adoraient toutes espèces d’animaux.
—Vrai! interrompit madame Charles.
—Mon Dieu, il ne faut s’étonner de rien, continua Brousmiche d’un air indulgent; on voit encore des choses aussi drôles. Vous savez bien? par exemple, les Anglais, c’est un peuple qui peut passer pour civilisé.
—Je crois bien, ce sont eux qui font les meilleures aiguilles.
—Et les couteaux donc! et les fruits!.... Nous leur devons les poires d’Angleterre.
—Eh bien! quoi, est-ce qu’ils adorent aussi les bêtes?
—Pas précisément; mais je lisais encore l’autre jour dans un journal, qu’il y avait chez eux une loi qui défendait aux cochers de fouetter leurs chevaux.
—C’est-il possible! et comment alors les fiacres peuvent-ils marcher?
—Les chevaux y mettent de la délicatesse, voyez-vous, madame Charles, il suffit de leur parler. Vous ne vous doutez pas combien les animaux sont susceptibles. C’est comme les femmes... sans comparaison... Mais pardon, je vous laisse là, moi, sans vous offrir une chaise et sans prendre même votre carton.
—Oh! de la gaze, ce n’est pas lourd, dit la jeune femme, en posant le carton sur le poêle, je suis allée chercher l’ouvrage de la semaine.
—Pour vos fausses fleurs? et ça va-t-il toujours bien?
—Mais, pas mal.
—Allons, tant mieux, il est juste que les braves gens prospèrent, surtout quand ils ont des charges comme vous, madame Charles.
—Vous dites ça à cause de mon fils... pauvre chérubin! c’est vrai qu’il a une nourrice à quinze francs, mais je veux qu’il ne manque de rien, monsieur Brousmiche, c’est bien assez de n’avoir pu le nourrir moi-même. Cher amour! j’aurais voulu lui donner mon sang, voyez-vous.
En parlant ainsi, la grisette avait la voix émue et les yeux humides. Le portier remua la tête d’un air d’approbation.
—Oui, oui, vous êtes un cœur d’or, madame Charles, dit-il; si tout le monde vous ressemblait, on ne verrait pas des choses si tristes... comme, par exemple, des femmes qui ont toujours le martinet à la main.
—A preuve, madame Lecoq, ma voisine? C’est vrai qu’elle est bien méchante... et ce n’est pas seulement avec ses enfants. Avant-hier encore elle m’a entreprise, parce qu’elle disait qu’en venant chez moi on avait sali le palier. Elle m’a reproché de ne pas être mariée avec Charles.
Brousmiche leva les yeux et les mains au ciel.
—Si on peut faire du chagrin à une véritable brebis du bon Dieu! murmura-t-il.
—Oh! elle ne m’a pas fait de chagrin, reprit la jeune femme, dont la voix tremblante démentait les paroles; comme je lui ai dit, si je ne suis point mariée avec Charles, je ne m’en conduis pas moins comme une honnête femme...
—Ah! Seigneur! à propos de monsieur Charles, reprit le bossu, je ne sais pas, en vérité, où est ma tête ce soir; j’ai là une lettre de lui...
—Une lettre de Charles! s’écria la grisette, ah! donnez, monsieur Brousmiche, donnez donc!...
Elle prit vivement la lettre et regarda l’adresse.
—Oui, oui, c’est bien de lui, dit-elle palpitante de joie; voyez comme il a une jolie écriture, oh! pauvre cher...
Elle effleura le papier de ses lèvres, puis regardant le bossu moitié honteuse, moitié riante:
—Vous devez me trouver folle, monsieur Brousmiche, dit-elle, mais que voulez-vous, je l’aime tant, et puis... c’est le père de mon petit Jules!
—Ça se comprend, madame Charles, croyez bien que ça se comprend, dit le portier, en portant la main à sa poitrine, avec une expression de sensibilité qui eût été touchante si la disgrâce de tous ses mouvements ne l’eût rendue grotesque.
La jeune femme avait ouvert la lettre et s’était mise à la lire: Brousmiche, avec un tact de délicatesse que l’on n’eût attendu ni de son éducation ni de sa classe, détourna la tête pour la laisser plus libre et affecta de rattacher les épis de millet dont la cage de son chardonneret était garnie. Mais la grisette s’écria tout à coup:
—Ah! que bonheur! il viendra aujourd’hui!
—Qui cela? demanda le bossu, monsieur Charles?
—Oui, mon bon monsieur Brousmiche, continua Françoise en se hâtant de replier sa lettre et de reprendre son carton; vite, vite, il faut que je remonte... ma chambre doit être tout en désordre.
—Et puis, dit Brousmiche, d’un ton de moquerie amicale, il faut faire sa toilette?
—Certainement, s’écria la grisette, pour qui donc est-ce qu’on se ferait belle, si ce n’était pas pour l’homme qu’on aime? D’ailleurs, ça fait plaisir à Charles de me voir bien mise, ça me relève à ses yeux, et pour ça, voyez-vous, monsieur Brousmiche, je consentirais à ne manger qu’une fois tous les deux jours. Mais vous me faites jaser et je perds mon temps! Adieu monsieur Brousmiche, adieu mon petit Fanfan; quant à vous, monsieur Lolo, je ne vous dis rien. Au revoir, à demain.
Elle avait allumé son bougeoir à la lampe du bossu et monta lestement l’escalier pour ne s’arrêter qu’au troisième étage.
Comme elle allait ouvrir la porte, elle parut frappée d’un souvenir.
—Ah! mon Dieu! murmura-t-elle à demi-voix, j’allais oublier ce pauvre M. Michel; pourvu que Charles n’arrive pas tout de suite!
Elle entra vivement, déposa son carton, ouvrit une armoire sous tenture qui renfermait toute sa batterie de cuisine, en tira un réchaud qu’elle alluma et sur lequel elle posa un poëlon de terre brune rempli de lait.
Pendant que celui-ci chauffait, elle se débarrassa de son tartan, ôta son bonnet et commença sa toilette.
Madame Charles, que l’on appelait aussi mademoiselle Françoise, de son nom personnel, était une belle fille d’environ vingt-trois ans, dont toute l’apparence annonçait la santé, la force et la bonté. Bien que sa taille fût souple et fine, ses traits délicats et son teint d’une blancheur veloutée, il y avait, dans l’ensemble de sa personne, je ne sais quoi de calme, de simple et de gauchement gracieux qui lui donnait une sorte de beauté paysanne. Rien qu’à la regarder, on la sentait incapable de la plus innocente coquetterie. Ne voyant en toute chose que ce qui était droit devant ses yeux, elle se présentait avec les défauts et avec les dons que Dieu lui avait donnés, sans y rien ajouter et sans en rien cacher. Avec elle on ne pouvait ni espérer le plaisir de la découverte, ni craindre les désappointements de l’examen; du premier coup d’œil on avait tout vu.
Cette droiture native lui donnait un charme pour ainsi dire reposant. On éprouvait à la regarder la même sensation douce et sereine que donne l’aspect d’un lac dont les eaux paisibles reflètent les bois, les fleurs et le ciel.
Après s’être coiffée à la hâte, Françoise passa une robe de mousseline à fleurs roses et mit une guimpe blanche, dont l’élégance champêtre et endimanchée s’harmonisait merveilleusement avec sa physionomie naïve. Elle suspendit à son cou une petite croix d’or retenue par un velours étroit, ajouta à ses boucles d’oreille deux pendoloques en nacre de perles et agrafa à ses poignets des bracelets de corail.
Ainsi parée de ce qu’elle avait de plus riche, elle tourna en tout sens pour se voir tout entière dans son petit miroir d’un pied carré, passa plusieurs fois la main sur ses cheveux, et, satisfaite enfin, se hâta de tout mettre en ordre autour d’elle.
Courant ensuite à son réchaud, elle versa le lait bouillant dans une tasse de porcelaine blanche qu’elle posa sur une assiette, y joignit un petit pain, la seule cuiller d’argent qu’elle possédât, et quitta sa chambre pour monter aux mansardes.
Maître Laurent s’était réservé toutes les mansardes, sauf une seule. Ce fut vers elle que se dirigea Françoise. Elle arriva à une petite porte de sapin qui n’était point peinte, y frappa doucement, et sur la réponse:—Entrez, elle souleva le loquet et se glissa dans la mansarde.
Celle-ci, placée à l’extrémité de la maison, sous la partie la plus basse du toit, méritait à peine ce nom, et celui de grenier lui eût, à tous égards, mieux convenu. Carrelée de briques dépareillées que le maître maçon avait voulu utiliser, et lambrissée seulement à hauteur d’appui, elle laissait voir à nu, partout ailleurs, la charpente et les tuiles entre lesquelles glissait le vent du soir, comme le prouvaient les oscillations du quinquet accroché au-dessous.
Ce dernier éclairait une large table couverte d’états chiffrés, dont la copie faisait vivre le maître de la mansarde, et de plans et de papiers dont il s’occupait à ses instants de loisirs.
Quand Françoise entra, M. Michel (c’était son nom) était courbé sur une grande carte qu’il semblait étudier.
Sa tête chauve au sommet, mais qui avait encore gardé, plus bas, une couronne de cheveux blancs, présentait un développement vaste et harmonieux. Ses traits fortement accentués, avaient une noblesse austère et une sorte de grandeur dont on demeurait frappé malgré soi. Il était de taille moyenne, maigre et courbé, mais la vigueur de son organisation se révélait encore sous sa verte vieillesse. Vêtu d’une pelisse de forme ancienne, et garnie de fourrures maintenant râpées, mais qui avaient été précieuses, il se tenait les pieds et les jambes enveloppés dans un sac de peau de mouton, moyen de chauffage aussi économique que nécessaire, car la mansarde n’avait ni poêle ni foyer. Tout son ameublement consistait en un lit de sangle, à moitié caché par une vieille tapisserie fixée au toit, en une chaise de paille, une petite armoire peinte et quelques rayons de sapin chargés de liasses de papiers.
La table et le fauteuil qui servaient au travail du vieillard formaient seuls contraste avec ce mobilier indigent. Tous deux étaient en ébène massif, précieusement travaillé, et appartenant par la forme au siècle de Louis XIII. Le dos du fauteuil, droit et élevé, se terminait par un chiffre découpé à jour, et surmonté d’une rosace, tandis que le bureau, incrusté de filets d’ivoire souvent brisés ou interrompus, était orné, sur le devant, d’un petit écusson émaillé, qui avait résisté à toutes les injures du temps.
Au bruit que fit la jeune femme en entrant, le vieillard se détourna, et un sourire éclaira son visage austère.
—Ah! c’est ma jolie ménagère, dit-il.
—Je suis peut-être en retard, fit observer Françoise, en posant ce qu’elle apportait sur un petit guéridon qu’elle approcha du bureau; mais, j’étais sortie... puis il a fallu m’habiller...
M. Michel la regarda.
—Eh! je n’y prenais pas garde, dit-il, voilà en effet une toilette dont M. Charles devra être satisfait.
—Il m’a écrit qu’il allait venir, reprit joyeusement Françoise, en regardant vers la porte et en prêtant l’oreille.
—Alors, je ne veux pas vous retenir, chère enfant, dit M. Michel, qui tourna son fauteuil vers le guéridon, il faut descendre tout de suite.
—Non, non, reprit la jeune fille, chez qui la bonté combattait l’impatience, d’ici je puis écouter si l’on frappe à ma porte, et, en attendant, je vous tiendrai compagnie comme d’habitude... Vous m’avez répété bien des fois que vous mangiez de meilleur appétit quand vous n’étiez pas seul...
—Bonne fille! murmura M. Michel, comme s’il se parlait à lui-même; ah! quel malheur qu’elle n’est pas née un siècle plus tard!
—Pourquoi cela, monsieur Michel? demanda Françoise en souriant.
—Pour bien des choses, mon enfant, reprit le vieillard; avant un siècle, il se sera accompli dans le monde, s’il plaît à Dieu et au bon sens des hommes, de grands changements!
—Qu’est-ce que cela pourrait me faire à moi, pauvre fille? demanda la fleuriste.
—D’abord il n’y aura plus alors de pauvres filles, reprit M. Michel, si ce n’est celles à qui la nature aura refusé la santé, la bonne humeur et la beauté... Encore tâchera-t-on de les dédommager par tout ce qui peut se donner; mais les créatures douées comme vous de ce qui fait la richesse et la joie des hommes seront les reines du monde!
—Ah! grand Dieu! je ne voudrais pas être reine, interrompit Françoise, il y a trop de chagrins et d’ennuis...
—La royauté dont je parle n’aura rien de commun avec celle que nous connaissons, chère enfant, reprit le vieillard; ce sera une supériorité spontanée, librement reconnue, et à laquelle pourra prétendre quiconque servira le genre humain. Elle ressemble à la royauté du cheval parmi les animaux domestiques, ou de la rose parmi les fleurs; loin de la contester comme un privilége oppressif, on en jouira comme d’un don concédé au profit de tous.
—A la bonne heure, dit Françoise, qui, dans cette explication, n’avait compris qu’une seule chose, l’espérance en un avenir où tout le monde serait heureux; à la bonne heure, monsieur Michel, mais ce n’est point pour moi qu’il faudrait souhaiter une vie moins triste; je suis jeune, j’ai du travail, et tant que Charles m’aimera, je n’ai rien à demander; mais il y en a d’autres qui sont vieux, dans la peine, et tout seuls! C’est envers ceux-là que le monde n’est pas juste. Ah! vous parliez tout à l’heure de royauté; eh bien! oui, je voudrais être reine, seulement un jour, pour faire du bien aux honnêtes gens qui souffrent sans le mériter.
Le vieillard, qui avait commencé à manger, s’arrêta et regarda la grisette.
—C’est à moi que vous pensez, Françoise? demanda-t-il doucement.
—Faites excuse, Monsieur, répondit celle-ci un peu confuse, je n’ai point voulu vous offenser.
—M’offenser, pauvre enfant! en êtes-vous capable? La pitié ne blesse que les orgueilleux; pour les autres, c’est la meilleure consolation. Si vous désirez être reine, ce serait surtout, je parie, pour enrichir votre vieux voisin!
—Eh bien! oui, s’écria la grisette, puisque je puis le dire sans vous fâcher; oui, je voudrais pouvoir vous donner tout ce qui vous manque... parce que ça me fend le cœur de penser que vous demeurez ici... dans une mansarde où le vent entre de tous côtés... Ah! si seulement vous m’aviez laissé acheter ce poêle que les gens du second proposaient d’échanger.
—Et pour lequel vous vouliez donner votre commode?
—Je n’en ai pas besoin; vrai, mon bon monsieur Michel, le secrétaire me suffit... Mais vous avez refusé si sérieusement... que je n’ai pas osé vous en reparler... et maintenant l’occasion est manquée! peut-être cependant qu’en cherchant...
—Non, Françoise, je ne veux pas. Je vous ai, d’ailleurs, prouvé, ma chère enfant, qu’il n’y avait point ici de place pour le mettre.
—C’est bien là ce qui me tourmente, de vous voir si mal logé, dit la grisette, en regardant autour d’elle. Oh! quelquefois quand je travaille seule, le soir, je me mets à rêver tout éveillée. Je me figure que je deviens riche, tout d’un coup, comme dans les histoires, et alors je règle, en idée, ce que je ferai de ma fortune... mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte ces folies!...
—Continuez, je vous en prie, continuez. Vous réglez donc l’emploi de votre fortune?
—Oui, Monsieur, je fais des parts pour chacun....
—Et je suis sûr que vous ne m’oubliez pas?
—C’est ce qui vous trompe: je ne mets rien pour vous.
—En vérité?
—Non, parce que je me figure que vous êtes habitué à me voir, et que vous aimeriez mieux ne pas me quitter. Aussi, je vous établis chez moi, dans mon hôtel!... car j’ai un hôtel. J’ai déjà choisi votre appartement; une chambre à coucher et un cabinet de travail, garnis de tapis, bien meublés, et en plein midi pour que vous ayez du soleil. Il y aurait un domestique rien que pour vous, une bonne voiture qui vous conduirait tous les jours au jardin des Tuileries; au retour, on dînerait ensemble, rien ne vous manquerait, car je connais vos goûts, et ce serait moi qui ordonnerais les repas!... N’est-ce pas que c’est un beau rêve, et que je serais bien heureuse si j’avais pour marraine une fée!... Mais qu’avez-vous donc? vous ne mangez plus, vous avez l’air de ne plus m’écouter, vous ne répondez pas...
Le vieillard avait en effet cessé de manger, et il gardait le silence, mais il avait tout écouté, et quand il releva son visage, jusqu’alors baissé, Françoise aperçut une petite larme qui glissait le long de ses joues ridées.
—Ah! mon Dieu! est-ce que je vous ai fait du chagrin? s’écria-t-elle.
M. Michel lui prit les deux mains et les serra dans les siennes.
—Je voudrais que vous fussiez ma fille, Françoise, dit-il d’un accent profond.
—Eh bien! regardez que je la suis, cher monsieur Michel, répondit la grisette avec une gaieté tendre, et alors laissez-moi tout arranger ici à ma fantaisie... en attendant que j’aie un hôtel. Je suis sûre que si le poêle...
Le vieillard lui imposa silence.
—Assez, mon enfant, assez, interrompit-il d’un ton de douce autorité, les filles doivent obéissance à leur père, et moi je vous ordonne de me laisser, de peur que monsieur Charles n’arrive sans que vous l’entendiez.
—Mais vous allez demeurer seul?
Il secoua la tête en souriant.
—Je ne suis jamais seul, chère enfant; car j’ai comme vous, mes rêves qui me tiennent compagnie.
—Vos rêves, monsieur Michel?
—Oui, je fais aussi des projets pour un vieillard bien abandonné et bien misérable.
—Quel vieillard?
—Le genre humain, mon enfant. Mais, allons, vous voyez que j’ai fini, Françoise; emportez tout, et descendez, je vous en prie pour l’amour de moi.
La grisette ne se fit pas presser plus longtemps. Elle s’assura que tout était en ordre dans la mansarde, reprit la tasse, la cuiller d’argent, le plateau, souhaita le bonsoir à son voisin et se retira.
Il y avait déjà deux ans qu’elle s’était fait la ménagère de ce dernier, par pure bienveillance, et qu’elle l’entourait de tous les soins qu’eut pu attendre d’elle un vieux parent ou un vieil ami.
M. Michel n’était pourtant ni l’un ni l’autre. Il y avait même sur son passé une sorte de mystère que la grisette n’avait pu pénétrer. A en croire certaines habitudes et certains mots qui lui échappaient parfois, son protégé de la mansarde avait dû connaître des jours meilleurs; mais quelle avait été, au juste, son ancienne position, comment s’était-elle transformée, d’où venait sa réserve affectée sur tout ce qui le concernait? Nul n’avait pu le deviner.
Françoise venait d’ouvrir la porte de son logement et allait y entrer, lorsqu’elle entendit au bas de l’escalier une voix à laquelle répondait celle du portier; elle s’arrêta en penchant la tête par-dessus la rampe; un pas qu’elle reconnut faisait déjà crier les marches, elle rentra avec une exclamation de joie, déposa ce qu’elle portait, et revint en courant sur le palier au moment où un petit homme y arrivait.
—Charles! s’écria-t-elle en s’élançant à sa rencontre.
—Me voilà, ma biche, dit le visiteur, en déposant un baiser retentissant sur la joue que la grisette lui tendait. Tu as reçu ma lettre, n’est-ce-pas?
—Oh! oui, je vous attendais; mais entrez vite, il fait du vent dans cet escalier, et vous avez l’air de souffrir du froid.
—C’est le brouillard, dit le petit homme en suivant Françoise dans sa chambre; il fait un temps à ne pas distinguer un chiffonnier d’un omnibus. Heureusement que j’avais pris mon paletot en caoutchouc et mon cache-nez... Prrr... Attends, ma biche; attends que je me dépouille.
Il enleva la cravate de laine qui l’enveloppait jusqu’aux oreilles, se débarrassa de son surtout, ôta son chapeau, et montra aux yeux de Françoise la petite figure ronde et joufflue d’Aristide Marquier!
C’était en effet le banquier, mais dépouillé de tous les embellissements fashionables dont nous avons précédemment parlé. Son costume, composé d’une redingote bleue trop courte et d’un pantalon trop long, convenait, du reste, si bien à ses traits et à sa tournure, que l’observateur le plus expérimenté n’eût pu soupçonner un déguisement. C’était, de la tête aux pieds, tout ce qui peut personnifier un quatrième clerc d’avoué ou le sixième commis d’une maison de commerce.
Aussi, Marquier s’était-il présenté à Françoise sous ce dernier titre, et le nom de Charles, qu’il avait adopté, était une précaution destinée à maintenir plus sûrement son incognito.
Un pareil déguisement eût sans doute mal réussi près d’une fille avide ou coquette, mais Françoise n’y avait vu qu’une ressemblance de situation qui, dès le premier abord, l’avait disposée à la confiance. Pour la fleuriste, étrangère à tout calcul, l’obscurité du commis était une première cause d’attachement. Son empressement amoureux et ses sollicitations achevèrent de gagner la jeune fille. Durement élevée par une tante qui, pour seule marque de tendresse, l’avait nourrie, habituée à un travail incessant et solitaire, ne connaissant de la vie que ses obligations pénibles, elle n’avait pu concevoir aucune des espérances qui rendent les jeunes filles si difficiles ou si ambitieuses dans un premier attachement. Il avait suffi de lui dire qu’on l’aimait pour qu’elle se sentît saisie de reconnaissance et de joie. C’était quelque chose de si nouveau! Elle y avait si peu compté! Elle entrevoyait dans cet échange d’affection tant de bonheurs charmants!
Marquier profita de cette première ouverture de cœur et se fit aimer, pour ainsi dire, par surprise. Françoise se donna à lui parce qu’il s’était présenté le premier, et apporta, dans cet amour, le dévouement d’une sensibilité qui trouvait pour la première fois à s’épancher. Elle sut gré à Marquier de tout le bonheur qu’elle crut recevoir de lui, et dont la source n’était qu’en elle.
La naissance d’un fils vint encore resserrer cette liaison qui durait déjà depuis deux années. Le banquier continuait à l’entretenir un peu par habitude et beaucoup par raison, certain qu’il était de ne pouvoir trouver ailleurs une maîtresse aussi belle, moins exigeante et surtout plus désintéressée.
Après l’avoir aidé à se débarrasser de son paletot, Françoise s’était empressée de lui avancer le seul fauteuil qu’elle possédât et dans lequel il se laissa tomber tandis qu’elle se plaçait devant lui, à genoux sur un tabouret.
—Cette rue des Morts est au bout du monde, dit Marquier en reprenant haleine avec effort.
—Pourquoi aussi ne pas monter dans notre omnibus, fit observer Françoise, qui lui essuya le front avec son mouchoir.
—Bah! on me recommande l’exercice, dit le banquier en se secouant; puis, j’avais ma soirée libre et je voulais te voir.
—Il y a si longtemps que vous n’êtes venu, Charles!
—Que veux-tu, nous sommes écrasés d’ouvrage; tu n’avais rien à me dire, d’ailleurs, n’est-ce pas?
—Rien! vous croyez cela, reprit la grisette en rapprochant sa figure brillante de joie; eh bien! c’est ce qui vous trompe, Monsieur: j’ai reçu des nouvelles de Normandie.
—Ah!... et le petit... est bien? demanda Marquier d’un ton un peu embarrassé.
—Oui; mais ce n’est pas tout.
—Qu’y a-t-il donc?
—Vous ne devinez pas?
—Non.
—Eh bien... il commence à parler!
A voir l’éclair de bonheur qui brillait dans les yeux de Françoise en prononçant ces mots, il était évident qu’elle s’attendait à un cri de surprise joyeuse de la part de Marquier; mais celui-ci conserva toute sa tranquillité et se contenta de répéter:
—Ah! il commence à parler.
Un nuage passa sur les traits de la jeune femme.
—Cela ne vous rend donc pas content, Charles? demanda-t-elle avec un léger accent de reproche.
—Au contraire, reprit Marquier; mais tu t’y attendais bien, je suppose: il était clair que ce garçon ne pouvait rester muet.
La grisette parut surprise et affligée. Dans son naïf ravissement de mère, elle ne pouvait comprendre que chacun des progrès de l’enfant ne fût point l’occasion d’une fête dans le cœur de son amant.
—Moi qui croyais vous annoncer une si bonne nouvelle, dit-elle tristement.
—Mais elle est excellente, la nouvelle, reprit Marquier en jouant avec ses cheveux; seulement, à la manière dont tu me l’as annoncée, j’ai cru qu’il s’agissait d’une dépêche télégraphique qui allait faire remonter les fonds.
Françoise fit un mouvement.
—Allons, je plaisante, ne te fâche pas, continua-t-il en l’embrassant, mais il est certain que tu es folle de cet enfant.
—C’est votre fils, Charles, répondit-elle en s’appuyant sur l’épaule de Marquier. Ah! si vous saviez, allez, toutes les idées qui me viennent, quand je pense à lui!
—Voyons tes idées...
—D’abord je ne veux pas que Jules gagne sa vie en travaillant de ses mains; je veux qu’il reçoive de l’éducation, qu’il devienne capable d’avoir une place, d’être un Monsieur enfin.
—Pourquoi cela?
—Parce qu’il ne faut pas qu’il soit comme moi... qu’il vous fasse honte...
—C’est un reproche, Françoise?
—Non, Charles, non; je sais bien que si vous sortiez avec moi, que si j’allais chez vous, cela pourrait vous faire tort; aussi je ne me plains pas: ce n’est pas votre faute; mais je voudrais éviter ce chagrin à Jules.
—Et comment feras-tu, pauvre fille? L’instruction d’un garçon coûte cher.
—Oh! je le sais, dit la grisette d’un ton capable; j’ai pris des informations; mais d’abord, notre vieux voisin m’a proposé de donner à l’enfant les premières leçons.
—Et plus tard?
—Plus tard, je paierai des maîtres.
—Mais où trouveras-tu de l’argent?
—Il est trouvé, s’écria Françoise d’un air triomphant.
Marquier la regarda.
—Oui, trouvé, répéta-t-elle; ah! vous ne vous doutiez pas de cela! Vous avez cru que je m’occupais seulement de fabriquer mes roses et mes camélias; mais c’est ce qui vous trompe, Monsieur! moi aussi, j’étudie les affaires, et j’ai préparé une opération... C’est comme cela que vous dites, je crois?
—Pardieu! je serais curieux de connaître cette opération, dit le banquier en riant.
—Eh bien! dit Françoise, vous avez peut-être entendu parler de la tontine des familles?
—C’est une banque de prévoyance?
—Où les enfants qui survivent héritent de ceux qui sont morts.
—C’est cela.
—En y déposant cent francs le 1er janvier, pendant dix ans, je puis assurer à Jules ses frais d’instruction.
—Peut-être; mais ces cent francs, il faut les avoir...
—Je les ai, dit Françoise en courant à sa commode, d’où elle tira une bourse; voyez, Monsieur, cinq pièces d’or toutes neuves.
—Cinq pièces d’or! c’est ma foi vrai.
—Ça fera le paiement de la première année.
—Mais comment as-tu pu te procurer?...
—Voilà mon secret, j’ai trouvé un moyen! mais je n’ai voulu rien vous dire avant d’avoir la somme entière, et il a fallu onze mois d’économie.
—Et sur quoi, diable, as-tu pu économiser cinq louis?
—Ah! cela vous étonne, parce que vous autres hommes vous ne pouvez calculer que pour de grosses sommes; il n’y a que les femmes à savoir faire des petites épargnes. Aussi, moi, depuis longtemps je pensais à mettre un peu plus d’ordre dans mes affaires, à retrancher le superflu.
—Le superflu! répéta Marquier en promenant involontairement un regard sur le modeste logement de la grisette.
—Certainement, reprit Françoise, je me suis dit qu’il y avait des ouvrières qui gagnaient un tiers moins que moi et qui cependant réussissaient à vivre: il était donc bien clair que je pouvais économiser un tiers sur mes dépenses.
—Mais comment?
—Par bien des moyens. D’abord je déjeunais toujours autrefois avec du café, ce qui est très-malsain, à ce que l’on dit; je l’ai supprimé. Ensuite j’ai trouvé qu’il suffisait de s’habiller chaudement pour se passer de feu presque tout l’hiver; enfin j’ai calculé que si je me levais plus tôt chaque matin, j’aurais le temps de savonner et de repasser ce que je donnais autrefois à la blanchisseuse. Tout cela a l’air de peu de chose, n’est-ce pas? Eh bien! savez-vous ce que j’ai économisé par ce moyen, Monsieur? au moins six sous par jour! oui, six sous, ce qui me fait plus de cent francs par an et me permet de payer la rente à la tontine des familles.
—Embrasse-moi, Françoise, s’écria Marquier, évidemment plus émerveillé de l’habileté de la grisette à se créer des ressources qu’attendri de son dévouement; tu es une brave fille... qui mérite qu’on t’encourage: aussi je veux t’aider... j’irai moi-même à la tontine des familles pour savoir si le placement est sûr.
—Ah! merci, Charles.
—Et de plus, ajouta le banquier, chez qui, à défaut de la voix du sang, parlait une honte secrète, de plus, je ferai aussi quelque chose pour Jules... je donnerai cent francs comme toi!
—Oh! non, interrompit vivement Françoise, je ne veux pas; vous êtes obligé à des dépenses, vous. Un homme ne peut pas se réduire comme une femme; il faut qu’il suive les usages, qu’il fasse ce que font ses amis; vous ne pouvez rien économiser, Charles.
—Qu’en sais-tu?
—Vous m’avez souvent répété vous-même que vous aviez peine à vous suffire!... puis, mon ami, ajouta-t-elle avec une expression de tendresse naïve, ça serait m’ôter ma joie! vrai! j’ai besoin de penser que c’est moi qui élève Jules sans qu’il ait rien à te demander... que de l’aimer... c’est peut-être de l’orgueil; mais il faut me le pardonner, car cet orgueil-là donne du courage et rend heureuse. Laissez-moi élever l’enfant, et, quand il sera grand, quand il pourra vous faire honneur, alors vous le prendrez pour l’aider... ne me refusez pas ça, Charles!
—Est-ce que je puis rien te refuser, dit le banquier en l’attirant sur ses genoux; tu sais bien que je ferai tout ce que tu voudras.
Françoise lui passa un bras autour du cou et le remercia par un baiser.
Dans ce moment, trois coups secs et à intervalles inégaux furent frappés à la porte de la chambre. Marquier tressaillit et Françoise se leva; elle avait reconnu la manière de frapper.
—C’est M. Marc qui vient allumer son bougeoir, dit-elle.
Le banquier se rappela subitement la rencontre de la Forge-des-Buttes. Il avait, alors, bien cru reconnaître, dans le paysan sauvé par ses deux compagnons, le garçon de bureau qui logeait sur le même palier que Françoise, et de là était venue sa persistance à lui cacher ses traits; persuadé qu’il avait réussi, il voulut vérifier ses soupçons et dit à Françoise de le faire entrer.
Marc portait le pantalon et l’habit bleu barbeau, exclusivement réservés, par l’usage, aux fonctions qu’il remplissait. A la vue de Marquier, son visage s’éclaircit. Il possédait depuis longtemps le secret du déguisement du banquier, et l’avait parfaitement reconnu à la Forge-des-Buttes: c’était précisément lui qu’il cherchait. Aussi salua-t-il avec le sourire le plus aimable et en s’excusant de son indiscrétion.
—Pardieu! voilà bien longtemps, voisin, que je n’avais eu le plaisir de vous voir, fit observer Marquier qui désirait lier conversation.
—Bien longtemps, en effet, répondit Marc en s’inclinant; il me semble que je n’ai pas eu l’honneur de saluer Monsieur depuis le mois passé; Monsieur n’a pas été indisposé?
—Non, dit le banquier d’un air de négligence et en observant le garçon de bureau du coin de l’œil; mais je me suis absenté de Paris pendant quelques jours.
—Ah! Monsieur a voyagé?
—Dans la banlieue seulement, du côté de Maillecourt... Vous devez connaître ce pays-là?
—Faites excuse, Monsieur: je ne suis jamais allé plus loin que Chantenay pour voir ma famille.
—Vous avez des parents de ce côté?
—Un cousin, ou plutôt un autre moi-même, car on nous a toujours pris pour des jumeaux, et si ce n’était l’habit, tout le monde nous confondrait.
Marquier le regarda. Le ton de Marc était tellement naturel qu’il se demanda s’il n’avait pas été réellement abusé par la ressemblance.
—Et vous avez vu votre cousin depuis peu? demanda-t-il.
—Il y a déjà du temps, répliqua Marc, mais j’ai rencontré l’autre jour sa femme qui m’a appris qu’il avait manqué être brûlé par des vauriens.
—Juste. Comment Monsieur sait-il?...
—Mon Dieu! dit Marquier embarrassé, l’affaire a été racontée dans tous les journaux. Ne l’avait-on pas enfermé dans la forge.
—Oui; et il a été délivré par des voyageurs qui passaient... des fils de famille, à ce qu’il paraît! Seulement, la femme de mon cousin n’a pas pu me dire les noms.
—On les a donnés dans le journal, fit observer le banquier. Il me semble... autant que je puis me rappeler... qu’on citait un monsieur de Gausson et un monsieur... Marquier...
Il avait prononcé ce nom en guettant de l’œil l’effet qu’il allait produire sur le garçon de bureau; mais celui-ci se contenta de le répéter.
—Marquier? dit-il; est-ce que ce serait un parent du banquier?
—C’est le banquier lui-même.
—Ah! bon! bon!
—Vous le connaissez, sans doute?
—Pas lui, mais son garçon de caisse, Jérôme... un grand, maigre, qui prend toujours du tabac dans la tabatière des autres. Ah! M. Marquier était un de ceux qui ont sauvé le cousin? Eh bien! c’est une raison pour que je m’intéresse à sa position...
—Quelle position? demanda le banquier surpris.
—Mon Dieu! ça n’est peut-être pas vrai, reprit le garçon de bureau avec bonhomie, car vous savez comment dans le commerce on se décrie les uns les autres. Il suffit souvent d’un mot pour qu’une maison perde son crédit.
—Est-ce que vous auriez entendu quelque chose qui pût nuire à celui de la maison Marquier? s’écria le banquier, à qui l’intérêt de sa réputation financière fit oublier tout le reste; je veux le savoir, monsieur Marc; cela a pour moi la plus grande importance...
—La maison où vous travaillez a donc des fonds chez M. Marquier?
—Précisément; ne me cachez rien, je vous en prie. Vous avez donc entendu dire qu’il était embarrassé?
—Pas précisément, répliqua Marc; mais on craint qu’il ne se compromette. On prétend qu’il s’est mis à fréquenter les jeunes gens à la mode; qu’il leur prête sans garantie. On cite même le fils d’une comtesse. Je ne me rappelle pas bien le nom...
—De Luxeuil, peut-être?
—Oui, je crois... de Luxeuil... c’est cela!... Eh bien! on assure que M. Marquier lui a prêté plus de cent mille francs, que le fils de la comtesse ne pourra jamais lui rendre, parce que sa mère est ruinée.
—Et ils s’imaginent peut-être qu’on ne le sait pas! s’écria le banquier en se levant avec feu. Je parie que c’est ce polisson de Lannaut qui a répandu de pareils bruits. Mais il n’a qu’à se bien tenir! Et, quant à ceux qui les répètent, monsieur Marc, vous pourrez leur répondre une chose de ma part, c’est que la maison Marquier a en portefeuille de quoi faire face trois fois à tous ses engagements.
—Diable! fit observer le garçon de bureau, il y a bien peu de gens qui pourraient en dire autant.
—Et je vous permets d’ajouter encore, pour l’édification de ces messieurs, que si Arthur de Luxeuil est insolvable, sa cousine ne l’est pas.
—Sa cousine est donc une vieille dont il doit hériter?
—Non, voisin; mais c’est une jeune... qu’il doit épouser!
Marc recula.
—Vous êtes sûr? s’écria-t-il.
—Comme je suis sûr de vous parler, monsieur Marc, reprit le banquier; tout est convenu, et le mariage aura lieu dans trois mois. Voilà ce que Lannaut et consorts auraient dû deviner, et ce que je vous engage à leur dire pour les rassurer sur la maison Marquier.
En prononçant ces mots d’un ton d’importance railleuse et pourtant encore courroucé, le banquier se rassit majestueusement; Françoise, qui pendant toute la conversation avait achevé de ranger la chambre, se rapprocha.
Quant au garçon de bureau, atterré un instant, il se remit aussitôt, saisit vivement le rat de cave qu’il avait posé sur la table, prit congé de Marquier et de Françoise, et sortit.
Le lendemain, vers la brune, Marc se promenait seul et à petits pas dans la partie de la rue Vivienne comprise entre la place de la Bourse et les boulevards. Son œil se fixait souvent sur une élégante calèche arrêtée devant une des maisons. Enfin, la porte s’ouvrit, une grande femme enveloppée dans un burnous de satin s’élança sur le marche-pied de l’équipage, et celui-ci partit rapidement.
Marc demeura encore quelques minutes à la même place: puis, rasant les maisons, il frappa à la porte qui venait de se refermer, monta au premier étage et sonna.
Une femme en robe de soie vint ouvrir.
—Madame Beauclerc? demanda Marc.
La femme de chambre le regarda, et lui répondit sèchement:
—Au bout du corridor.
Marc, qui connaissait le logement, se dirigea sans hésitation vers l’endroit indiqué. En passant devant la première pièce, il aperçut les préparatifs d’un souper, pressa le pas et arriva à la chambre de madame Beauclerc, dont la porte était ouverte.
L’aspect de cette chambre avait quelque chose de caractéristique. Elle était tendue de damas de laine et meublée avec luxe, dans le goût le plus moderne; mais les habitudes de la locataire avaient singulièrement nui à cette élégance. Des bouteilles, des verres, des peignes, des chandeliers étaient dispersés sur tous les meubles, et l’on voyait un reste de jambon, enveloppé de son papier gras, posé sur le velours qui garnissait la cheminée. Dans tous les coins traînaient de vieilles chaussures ou des cafetières de terre brune. La toilette de palissandre avait été transformée en table de cuisine, et une casserole s’enfonçait dans l’ouverture destinée à la cuvette; enfin, une grosse chienne noire avait pris possession, avec toute sa portée, de l’édredon placé sur le pied du lit.
Mais le plus curieux de cet intérieur était madame Beauclerc elle-même. Madame Beauclerc, qui, à l’en croire, avait eu autrefois la légèreté d’une biche, s’était tellement développée avec le temps, qu’on ne pouvait la comparer désormais qu’au mammouth reconstruit par la science de nos naturalistes. Lorsqu’elle parcourait sa chambre en soufflant, tout remuait autour d’elle; sa personne entière ne présentait qu’une masse accidentée par des espèces de cascades de chairs tremblantes sous lesquelles on eût en vain cherché une forme.
Elle était vêtue d’une robe de mérinos noir déchirée aux coudes, d’un foulard déteint qui lui tenait lieu de châle, d’une coiffe de nuit recouverte d’un mouchoir de coton, et de gros souliers dont elle avait coupé les quartiers pour en faire des pantoufles.
Au moment où Marc parut à la porte, elle se trouvait assise devant une petite table sur laquelle étaient posés deux verres, une bouteille et un jeu de cartes. Elle se détourna en entendant le bruit de ses pas, et le reconnut:
—Tiens c’est toi, Monsieur Marc, dit-elle, avec un geste de bienvenue, entre donc, mon petit, entre.
—Je ne vous dérange pas, mère Beauclerc? demanda-t-il.
—Au contraire, mon chéri, je m’ennuyais d’être seule; Clotilde vient de partir pour le théâtre et elle a emmené le cocher qui faisait ma partie; tu vas le remplacer.
—Pardon, mère Beauclerc, c’est que je sais à peine tenir les cartes.
—Bah! bah! il suffit de vouloir; tu connais bien la brisque ou le piquet.
—Je puis jouer un peu le piquet.
—Eh bien! mets-toi là, mon fils, il y a justement le verre du cocher, tu peux boire après lui, c’est un homme très-sain; il a même été vacciné.
Marc prit place et la grosse femme se mit à battre les cartes.
—Sais-tu qu’il y a longtemps que tu n’étais venu? dit-elle, en lui faisant couper.
—J’ai eu à travailler, fit observer Marc.
—Et ça va-t-il un peu?
—Tout doucement.
—Il me semble pourtant que le gibier ne manque pas?
—Peut-être, mais il faut le prendre.
—C’est juste, tout le monde n’a pas le tour de main, comme on dit; faut avoir le génie de la chose.
Et se penchant sur la table en baissant la voix:
—Tu n’as pas encore trouvé quelqu’un qui me remplace, je parie.
—C’est vrai, mère Beauclerc, répliqua Marc en arrangeant son jeu.
La grosse femme se rengorgea.
—Non, non, continua-t-elle d’un air capable, tu peux dire que ça été une perte pour toi, petit, quand j’ai quitté la partie... la mère Beauclerc avait le truc, vois-tu, et c’est quelque chose qui ne se donne pas. Aussi il y a des moments où je regrette de n’avoir plus rien à faire.
—Vous êtes pourtant mieux ici que dans votre loge du Marais, objecta Marc.
—Je ne dis, mon fils, je ne dis pas, reprit la mère Beauclerc, en remplissant les deux verres; mais il n’y a pas de petit chez soi. Là-bas, j’étais reine et maîtresse de mon cordon, tandis qu’ici je suis chez ma fille.
—Il me semble que vous ne manquez de rien.
—Pour ça, je n’ai pas de reproches à lui faire, dit la grosse femme qui vidait son verre à petits coups; Clotilde me laisse tout à discrétion, même la cave; mais, plus elle est bonne fille, plus je dois me tourmenter de son avenir.
—Que craignez-vous donc pour elle, mère Beauclerc?
—Je crains son bon cœur, mon chéri; dans sa position, vois-tu, faut être raisonnable; c’est un malheur qu’elle connaisse ce M. de Luxeuil.
—Pourquoi cela? je le croyais généreux.
—Oui, oui, mais ça éloigne les autres; une femme de théâtre doit avoir des principes: il faut qu’elle ne s’attache à personne.
—Alors, dit Marc en la regardant, selon votre idée il vaudrait mieux, pour mademoiselle Clotilde, se débarrasser de M. de Luxeuil?
—D’autant mieux qu’on le dit ruiné, répliqua la mère Beauclerc; du reste, j’ai averti Clotilde. Prends garde, mon enfant, que je lui ai dit; quand une maison menace de tomber, les rats s’en vont; faut pas montrer moins d’esprit que les bêtes quand on a été éduquée convenablement.
—Et que vous a-t-elle répondu?
—Ah! bah! toutes sortes de mauvaises raisons: que M. de Luxeuil était un bon enfant, et qu’elle ne trouverait pas mieux... est-ce que je sais, moi.
—Mais elle l’aime donc!
—Il ne manquerait plus que ça! Non, non, Dieu merci, elle a trop de bon sens pour s’attacher. Mais c’est cette petite peste de Clara qui est cause de tout... Tu sais bien, Clara de l’Ambigu? Eh bien! elle a parié que ma fille ne saurait pas garder un amant; alors Clotilde y met de l’amour-propre. Ces jeunesses, c’est si glorieux!
—Et elle est décidée à retenir M. de Luxeuil.
—A tout prix! Tu comprends, maintenant, pourquoi je m’inquiète? Je connais ma fille, vois-tu, rien ne la fera renoncer à son idée, et quoi qu’il lui en coûte, elle voudra donner un démenti à sa camarade.
Marc réfléchit un instant: sa première pensée en apprenant le projet de mariage d’Arthur avait été d’y mettre obstacle par le moyen de Clotilde: l’hostilité de la grosse femme à cette liaison l’avait d’abord effrayé; mais ces dernières confidences le rassurèrent.
—Diable! c’est fâcheux que votre fille tienne tant à son Monsieur, dit-il après une pause... d’autant plus fâcheux qu’elle perd son temps et ses peines.
—Qui est-ce qui t’a dit ça! s’écria madame Beauclerc.
Marc cligna des yeux.
—Vous savez bien que ça ne se demande pas, maman, fit-il observer à demi-voix; tout ce que je puis vous dire, c’est que M. de Luxeuil joue de son reste comme garçon.
—Comment! il se marie?
—Avec sa cousine... dont il est fou!
Madame Beauclerc laissa tomber ses cartes.
—C’est-il bien bien possible! s’écria-t-elle; il se marie!... et Clotilde ne sait rien!
—Comptez-vous qu’il l’avertisse, par hasard? Ce sera bien assez tôt quand le moment de rompre sera venu.
—C’est-à-dire qu’il plantera là ma fille! interrompit la grosse femme avec éclat; ah! le gueux! il me passera auparavant par les mains.
Marc la regarda avec surprise.
—Mais que disiez-vous donc tout à l’heure, mère Beauclerc? demanda-t-il.
—Tout à l’heure je disais que Clotilde aurait bien fait de le quitter, s’écria l’ancienne portière au lieur que c’est lui, maintenant, qui la quitte.
—Eh bien?
—Eh bien! c’est un déshonneur pour nous! Il aura l’air de s’être dégoûté de ma fille; c’est de quoi la perdre de réputation.
—Je ne vois alors qu’un moyen, reprit Marc; en avertissant mademoiselle Clotilde, elle réussira peut-être à empêcher ce mariage...
—Oui, dit madame Beauclerc, qui s’appuya des deux mains sur la table pour se lever; il faut qu’elle fasse tout rompre, et, quand tout sera rompu, elle chassera le Luxeuil. Comme ça tout sera profit. Ah! il épouse des cousines sans dire gare! eh bien! on va lui montrer ce qu’on sait faire. Justement... il soupe ici avec des amis.
—Il me semble qu’ils sont déjà arrivés, fit observer Marc qui depuis un instant prêtait l’oreille.
Madame Beauclerc s’approcha de la porte.
—J’entends des voix dans le salon, dit-elle, reste à savoir si Clotilde est revenue.
Elle allait traverser le corridor pour s’en informer, lorsque l’on sonna à la porte d’entrée. Un domestique ouvrit et la jeune actrice parut avec Arthur qui lui tenait la taille enveloppée d’un de ses bras.
Elle avait conservé le costume dans lequel elle venait de jouer, et son burnous de satin blanc, à demi détaché, laissait voir ses belles épaules nues. Au moment où ils entraient, de Luxeuil se pencha pour les baiser.
—Finissez donc, polisson! dit Clotilde sans se déranger et de cet accent traînard adopté, à Paris, par les femmes d’une certaine classe.
De Luxeuil redoubla.
—Eh bien! il me mord, à présent! s’écria l’actrice, avec un mouvement qui fit sortir de sa robe de velours son épaule presque entière et trahit subitement la beauté de ses formes; assez de bêtise, voyons.
—Je ne t’ai jamais vue si jolie! dit Arthur qui continuait à tenir sa taille.
—Laisse-moi, interrompit Clotilde, il y a déjà du monde au salon, il faut que tu entres.
—Et toi!
—Tout à l’heure.
De Luxeuil lui donna encore un baiser et rejoignit les autres convives.
Quant à Clotilde, elle trouva au fond du corridor la mère Beauclerc qui l’attendait et qui, sans lui donner le temps de faire aucune question, l’entraîna dans sa chambre dont elle referma la porte en dedans.
Nous la laissons là occupée à recevoir la confidence de sa mère, pour suivre Arthur dans la pièce où il venait d’entrer.
Les invités, au nombre de huit à dix, étaient la fleur des pois du café de Paris. Chacun d’eux avait son genre de gloire. On y voyait d’abord le duc d’Alpoda, dernier rejeton d’un des plus célèbres généraux de l’Empire, qui excellait dans l’escrime du bâton et dans l’exercice plus vulgaire, connu sous le nom de savate; le marquis de Rovoy, renommé par son talent à entraîner un cheval et à faire maigrir ses jockeys; le vicomte de Rossac, qui n’avait point encore pris possession de son siége à la chambre des pairs, et qui se préparait aux fonctions législatives par des tours d’escamotage à désespérer les Comte et les Philippe; le prince de Kishoff, Russe francisé, dont on citait la collection de pipes; enfin, plusieurs autres moins illustres, mais livrés à quelques spécialités aussi respectables.
Marquier était le seul qui ne fût recommandé par aucun mérite particulier.
De Luxeuil trouva cette élite de la jeunesse française occupée à discuter si la dernière débutante de l’Opéra avait ou non la cheville bien placée. Chacun invoquait, à l’appui de son opinion, celle de quelque célébrité de la fashion, et ce n’étaient que noms princiers et historiques.
L’entrée d’Arthur coupa court au débat. Il avait assisté à la course de lord Durford, et on l’entoura pour en savoir le résultat; mais les dissentiments soulevés à propos de la danseuse ne tardèrent pas à se renouveler au sujet des chevaux appelés à concourir. Le marquis de Rovoy, qui avait dernièrement perdu un pari contre lord Durford, prétendit qu’il ne devait ses succès qu’aux jockeys de ses adversaires, accusation qui fut vivement repoussée par le prince de Kishoff et soutenue par quelques autres. La discussion commençait même à s’envenimer et à dégénérer en querelle, lorsque Marquier l’interrompit par un cri d’admiration; il venait de s’arrêter devant un cabaret en porcelaine, que supportait un petit guéridon de citronnier posé devant une fenêtre.
—Voyez, voyez, Messieurs, s’écria-t-il, une nouvelle acquisition de Clotilde! Du vieux Saxe, et tout ce qu’il y a de plus beau. C’est un plateau de mille francs.
—Il m’en coûte trois mille, mon bon, fit observer de Luxeuil avec négligence.
—Ah! c’est donc un de vos cadeaux, Arthur?
—Oui, comme nous dînions ensemble aujourd’hui, j’ai voulu faire une surprise à notre hôtesse.
—C’est magnifique, reprit Marquier, dont l’admiration avait redoublé depuis qu’il savait le prix du cabaret; mille écus! cent cinquante francs de rentes. Savez-vous, mon cher, que vous avez des manières royales.
—Vous verrez également un surtout en vieille orfèvrerie dont on fait l’essai ce soir, continua de Luxeuil, qui avait, par-dessus tout, la vanité de paraître généreux; mais je ne comprends pas ce qui peut nous empêcher de souper. Clotilde ne devait être qu’un instant... il faut que j’aille m’informer.
—C’est inutile, interrompit M. de Rovoy, la voici.
On entendait, en effet, la voix éclatante de la jeune actrice, mêlée à la voix plus sourde de sa mère, toutes deux se rapprochaient et semblaient animées par la colère.
Tout à coup la porte du salon fut violemment poussée et Clotilde y parut les cheveux déroulés, le corsage à demi défait, pâle et les yeux étincelants.
A sa vue, les jeunes gens s’étaient tous retournés, mais elle ne parut point prendre garde à leur présence et chercha Arthur du regard.
—Ah! le voilà, s’écria-t-elle en le montrant, il faudra bien qu’il réponde!
Et s’élançant vers de Luxeuil qu’elle saisit par les deux bras.
—Est-ce vrai que tu vas te marier? demanda-t-elle en regardant dans ses yeux.
Arthur, pris à l’improviste, fit un mouvement en arrière.
—Quelle question me fais-tu là? balbutia-t-il, et à quel propos...
—Est-ce vrai? est-ce vrai? cria Clotilde, qui secouait les mains qu’elle tenait. Voyons, réponds, si tu as un peu de cœur!
—Mais, que signifie?... qui a pu te dire?...
—Quelqu’un qui en sait long! interrompit de loin la mère Beauclerc, qui n’avait pu franchir la porte du salon dont un seul battant se trouvait ouvert; oh! on veut nous montrer des couleurs; mais faut pas croire qu’on mécanisera ma fille comme la première venue.... Force-le à te répondre, Lolo.
—Et que puis-je répondre, dit vivement Arthur, honteux de la situation ridicule dans laquelle il se trouvait placé, et dont l’avertissaient les ricanements de ses amis; vous êtes folle, Clotilde.
—Folle? répéta l’actrice, en laissant aller la main du jeune homme; c’est-à-dire alors que ça n’est pas?
Arthur fit un geste équivoque.
—Il nie, reprit-elle, en se détournant vers les invités, vous l’avez vu, n’est-ce pas? Eh bien! il a menti.
De Luxeuil voulut l’interrompre.
—Il a menti, il a menti, répéta-t-elle avec une insistance emportée, et, la preuve, c’est que je sais toute l’affaire. Il épouse sa cousine; il l’a dit à ce gros petit qui est là et qui lui a prêté de l’argent!... Qu’il parle plutôt: n’est-ce pas la vérité?
Cette dernière question était adressée à Marquier qui regarda de Luxeuil, en bégayant une réponse évasive; mais celui-ci avait pris son parti.
—Eh bien? quand cela serait? dit-il avec hauteur.
—Alors tu avoues! interrompit Clotilde; vous entendez? le voilà qui avoue maintenant. Il se marie!... et je n’en savais rien! il ne m’avait prévenue de rien! il faisait le sournois et l’hypocrite.
—Clotilde!...
—Oui, l’hypocrite! répéta l’actrice exaspérée; si tu avais été franc avec moi, tu m’aurais dit:—voilà! il faut que je fasse une fin, séparons-nous. On se serait quitté bons amis: mais non, tu m’as tout caché, comme on ferait à une femme légitime! tu as voulu me garder jusqu’au jour des noces pour te faire alors un mérite de me sacrifier! c’était avantageux... et commode! on gardait la maîtresse en attendant la femme; il n’y avait que moi qui pouvais y perdre.
—Je ne vois pas bien ce que vous y avez perdu, ma chère, dit de Luxeuil, en effleurant de l’œil les derniers cadeaux offerts par lui à Clotilde.
Celle-ci comprit sans doute son regard, car, s’élançant d’un bond vers l’une des étagères qu’il avait désignées, elle y saisit les objets précieux qui s’y trouvaient étalés et les brisa à terre.
Les convives poussèrent une exclamation de surprise.
—Que faites-vous? s’écria Marquier, qui voulut l’arrêter.
—Je lui rends ce qu’il m’a donné, dit-elle, en faisant rouler aux pieds d’Arthur un nécessaire en cristal taillé... Ah! je n’ai rien perdu!... attendez, attendez!... ce n’est pas tout! il y a encore ces vases de la console... paff... et ces statuettes... paff! paff! et ce cabaret! ah! un nouveau cabaret!...
—Arrêtez! cria Marquier, les deux bras en avant, il a coûté trois mille francs...
—Paff! paff! paff! interrompit Clotilde, en lançant la cafetière, puis le sucrier, puis le pot à crème, puis le plateau avec toutes les tasses.
De Luxeuil qui avait d’abord voulu s’opposer à cet excès d’emportement finit par perdre patience.
—C’est une furie, dit-il en cherchant son chapeau pour sortir.
Dans ce moment les cris poussés par la mère Beauclerc devinrent plus perçants. Toujours debout à la porte, qu’elle essayait en vain de franchir, elle tendait les bras aux jeunes gens en répétant:
—Retenez-la, elle va tout briser. Seigneur Dieu! il y a de quoi nous ruiner..... Lolo..... Lolo..... Mais tu veux donc nous mettre à la mendicité, malheureuse! faut-il qu’elle soit folle de ce vaurien!...
Ces derniers mots frappèrent Arthur comme il allait ouvrir la seconde porte; il s’arrêta involontairement et retourna la tête vers l’actrice.
Celle-ci ne trouvant plus rien à briser, venait de s’arrêter, mais les mouvements violents auxquels elle s’était abandonnée avaient fait glisser sa robe à demi délacée. Debout dans l’angle le plus obscur du salon, les épaules inondées de ses longs cheveux bruns, la tête haute, un pied en avant, la poitrine nue et haletante, elle était d’une beauté si originale et si souveraine, que de Luxeuil en fut comme ébloui. Il fit un pas vers elle, regarda ces débris qui jonchaient le parquet et dans lesquels un mot de la mère Beauclerc venait de lui montrer des témoignages d’amour, reporta les yeux sur la jeune femme dont les formes hardies se détachaient des draperies rouges de la fenêtre, et, fasciné pour ainsi dire par cette contemplation, il rejeta son chapeau sur un fauteuil.
—Après tout, je suis aussi déraisonnable qu’elle de m’emporter, murmura-t-il, quand d’un mot je puis tout expliquer.
Et se tournant vers les invités:
—Pardon, Messieurs, de cette scène d’intérieur, continua-t-il avec une gaieté forcée, c’est un divertissement splendide et non prévu, mais dont la continuation pourrait devenir ruineuse. Veuillez passer au petit salon, et nous aurons tout à l’heure le plaisir de vous rejoindre.
Les jeunes gens se retirèrent.
De Luxeuil s’approcha alors de Clotilde, dont la première colère était apaisée et qui venait de se jeter sur un divan.
—Tu es bien heureuse d’être si jolie, dit-il en effleurant d’un baiser son cou nu. L’actrice se retira de côté et lui ordonna de la laisser, mais d’un accent plus adouci. La spontanéité de l’exclamation d’Arthur l’avait évidemment flattée; malheureusement la mère Beauclerc, qui venait de réussir à entrer en ouvrant les deux battants, voulut s’entremettre.
—Oui, qu’elle est jolie, reprit-elle aigrement, plus jolie que votre future épouse et que n’importe quelle autre! On n’a qu’à ramasser toutes les belles femmes de Paris et qu’à les amener pour voir, Lolo ne les craint pas.
—Il paraît que ce n’est pas l’avis de Monsieur, fit observer Clotilde sans regarder de Luxeuil.
—Pardonnez-moi, ma chère, reprit celui-ci, en voulant l’entourer d’un de ses bras.
—Et c’est pour cela qu’il veut me quitter, continua la jeune femme ironiquement et en se dégageant.
—Qu’est-ce qui parle de te quitter! reprit Arthur tranquillement.
—Parbleur! pour le deviner, on n’a pas besoin d’avoir inventé la vapeur, s’écria la mère Beauclerc, puisque Monsieur se marie.
—Et si je me mariais précisément dans son intérêt? dit de Luxeuil.
L’actrice qui avait jusqu’alors détourné la tête, le regarda.
—Dans mon intérêt, reprit-elle; ah! par exemple! il est un peu fort de café, celui-là; se marier dans l’intérêt de sa maîtresse! il faut que Monsieur me croie plus bête qu’une danseuse!
—Je crois seulement que tu ne connais rien à mes affaires, reprit Arthur; tu aimes le luxe, n’est-ce pas, tu tiens à ton équipage, à ton mobilier... quand tu ne les brises pas?
—Cette bêtise! dit Clotilde en haussant les épaules, certainement que j’y tiens.
—Eh bien! ma chère, moi je tiens, de mon côté, à ce que tu aies tout à souhait. Jusqu’à présent, j’y ai réussi; mais aujourd’hui mes ressources sont épuisées.
—Est-ce vrai! dit vivement l’actrice en le regardant.
—Quand je te le disais! s’écria la mère; j’en étais sûre. On m’avait averti qu’il allait tomber dans la débine.
—Eh bien! on s’est trompé, ma chère madame Beauclerc, reprit Arthur d’un ton ironiquement hautain; il n’y a à tomber dans la débine, selon votre élégante expression, que les gens d’une certaine classe. Nous autres, nous avons toujours quelque moyen de relever nos affaires.
—Et le mariage en question est un de ces moyens! demanda Clotilde qui commençait à écouter avec intérêt.
—Précisément, ma belle: le ciel m’a donné une cousine embellie d’environ cinquante mille livres de rente.
—Cinquante mille livres! interrompit madame Beauclerc émerveillée...
—Avec une fortune au moins égale en perspective. Vous comprenez qu’il eût fallu être plus maladroit qu’un ministre constitutionnel pour laisser un autre profiter de l’occasion. J’ai donc pris date, et, dans peu de temps, j’espère, nous entrerons en possession de notre modeste million.
—Sapristi! il fallait donc parler, dit la mère avec enthousiasme; si c’est comme ça, je n’ai rien à dire, et je déclare, jeune homme, que je vous rends mon estime.
—Bien bonne! répondit Arthur en s’inclinant; mais si j’ai gardé le silence, c’est qu’il s’agissait seulement d’une négociation d’argent, et que je n’ai pas l’habitude d’ennuyer Clotilde de mes affaires. Maintenant j’espère qu’elle comprend ma position et qu’elle ne m’en veut plus.
—Non, répliqua la grosse femme, elle ne peut pas vous en vouloir puisqu’elle doit profiter de la dot. Tu comprends bien la chose, Lolo? En définitive, il avait raison lorsqu’il disait qu’il se mariait dans ton intérêt.
—Alors, moi, j’en serai pour ma porcelaine, dit l’actrice, à qui le temps de cette explication avait suffi pour passer de la colère à la gaieté. En voilà-t-il un sacage; oh! regardez donc, maman, il y aurait de quoi remplir la hotte d’un chiffonnier.
Madame Beauclerc regarda Arthur.
—Une vraie brebis du bon Dieu, dit-elle en désignant sa fille de l’œil; ça n’a pas plus de fiel qu’un poulet. Elle mettrait le feu à Paris pour un oui ou pour un non, et à peine le verrait-elle flamber qu’elle apporterait de l’eau pour l’éteindre. Je me flatte que vous êtes bien tombé, mon gendre, et que vous devez un fameux cierge à votre patron.
—Ainsi, c’est fini! dit de Luxeuil, qui avait enveloppé Clotilde dans ses bras et la couvrait de baisers.
—Eh bien! oui, reprit-elle en répondant assez faiblement à ses caresses; mais laisse-moi, il faut que je m’habille.
—Tu es si belle ainsi.
—Et les autres qui attendent là-bas! ils doivent mourir de faim.
—C’est vrai, il faut les rejoindre et faire servir.
—Dans un instant je serai prête.
A ces mots elle se pencha, appuya un baiser sur les lèvres d’Arthur, puis s’échappa, suivie de sa mère.
Celle-ci retrouva chez elle Marc, à qui elle raconta en détail tout ce qui s’était passé et qui se retira désespéré.
Ce qu’il venait d’apprendre confirmait toutes ses préventions contre Arthur de Luxeuil, mais lui enlevait la seule chance de prévenir son mariage avec Honorine. Il ignorait d’ailleurs les sentiments de la jeune fille à l’égard de son cousin, et les moyens employés par ce dernier pour faire agréer sa recherche. Après avoir longtemps réfléchi à ce qu’il devait faire, il se décida à écrire deux lettres qu’il s’occupa de faire parvenir sur-le-champ.
En descendant, le lendemain, à l’heure des visites, Honorine trouva au salon la marquise de Biezi, madame des Brotteaux, Arthur, Marquier et le docteur.
La conversation, sans suite comme d’habitude, passa de la politique aux bruits de ville. On parla de grands mariages, des débuts de l’Opéra et du nouveau prédicateur; mais, au nom de ce dernier, M. Darcy, qui causait avec la marquise, se retourna.
—Ah! vous avez donc aussi entendu parler de cet homme-là? demanda-t-il.
—On en raconte des merveilles, fit observer madame des Brotteaux.
—C’est, dit-on, le genre de Bossuet, ajouta madame de Luxeuil.
—La Gazette de France le compare à monsieur de Frayssinous, acheva Marquier.
—Eh bien! ce sont autant de mensonges! reprit le docteur. Votre prédicateur n’est qu’un mauvais avocat de première instance plaidant pour la Trinité.
—Vous l’avez donc entendu?
—Je l’ai entendu.
Tout le monde fit un ah! de surprise.
—Est-ce bien possible! dit madame de Biezi en riant; vous êtes allé au sermon, docteur!
—Grâce à ce misérable Durosoir, reprit M. Darcy avec une indignation plaisante. Vous connaissez bien Durosoir?...
—Le naturaliste?
—Oui, le meilleur athée de Paris, après moi; eh bien! c’est lui qui m’a conduit dans ce guêpier.
—Afin de voir si le prédicateur pourrait vous convertir?
—Au contraire, dans l’espoir que nous le verrions partager notre incrédulité!
—Comment cela?
—Durosoir le prétendait décidé à abjurer le catholicisme. Vous comprenez que ç’eût été une chose curieuse à voir qu’un prêtre quittant sa boutique d’eau bénite, et signifiant son terme au pape. Aussi je me suis laissé entraîner.
—Et le prédicateur a abjuré?
—Il a prêché trois heures sur la nécessité de la foi.
Il s’éleva un éclat de rire général.
—Cela vous paraît plaisant, reprit M. Darcy avec une mauvaise humeur qui redoubla la gaieté de son auditoire; mais j’étais là, moi, écoutant forcément ce fileur de saintes phrases qui me promettait le paradis si je pouvais avoir de la foi gros seulement comme un grain de sénevé.
—Et vous l’avez refusé pour si peu! dit la marquise en riant.
—Parbleu! c’est de l’intolérance, docteur, ajouta Arthur; entre gens qui vivent de nos faiblesses, on devrait mieux s’entendre. Le prédicateur vous passe la rhubarbe, passez-lui le sénevé.
—Non, reprit madame de Biezi avec une hardiesse incisive, la haine du docteur est moins aveugle que vous ne le croyez, c’est un instinct de rivalité; les médecins voudraient tuer l’âme, parce qu’ils sont les maîtres du corps. En supprimant l’Église, on donnerait le monde à la Faculté.
—Et j’ose dire que le monde n’aurait qu’à y gagner, reprit M. Darcy avec une vivacité qui fit sourire Honorine elle-même. Oui, à y gagner, répéta-t-il plus énergiquement, car nous serions une nécessité naturelle, au lieu du prêtre qui est une convention arbitraire. En donnant aux hommes les infirmités, la nature a fondé la légitimité des médecins.
—C’est cela! interrompit Arthur, ils veulent être rois par la grâce de Dieu...
—Auquel ils ne croient pas, ajouta madame de Biezi.
—Mais, savez-vous bien que vous êtes un monstre d’impiété, docteur, dit madame de Luxeuil à demi-fâchée.
—En 93, il nous aurait toutes envoyées à la Conciergerie, ajouta la marquise.
—Est-ce vrai? s’écria madame des Brotteaux presque effrayée.
—C’est sûr, ma chère; ne voyez-vous pas que le docteur est un bâtard de Robespierre.
Le sourire de M. Darcy s’effaça subitement à ce nom.
—Ah! ne me parlez pas de ce misérable, madame la marquise, s’écria-t-il; c’est le seul homme de la Convention que j’abandonne à ses ennemis. On peut le justifier d’avoir voté la mort du roi, permis le massacre des prisons, égorgé les Girondins; mais il restera toujours une accusation dont rien ne pourra l’absoudre: C’est lui qui nous a rendu l’Être suprême!!!
La conclusion était si inattendue, qu’elle n’excita même pas le rire; tous les auditeurs se regardèrent.
—Parle-t-il sérieusement? demanda madame de Biezi, qui fixa les yeux sur le docteur avec curiosité.
—Très-sérieusement, Madame, répondit Darcy en prenant une attitude grave.
—Alors, il est fou, s’écria madame des Brotteaux, qui se recula par un mouvement instinctif.
—C’est-à-dire que c’est à ne plus le voir! ajouta la comtesse scandalisée.
—Et moi, reprit la marquise en riant, qui l’ai invité à venir demain dîner avec l’internonce.
—Quoi! cet Italien que j’ai rencontré hier chez vous? dit le médecin.
—N’est rien de moins qu’un cardinal.
Darcy frappa le bras de la causeuse sur laquelle il était assis.
—Eh bien! n’importe! reprit-il résolûment, j’ai accepté et j’irai.
—Vous?
—Oui. Je suis bien aise de pouvoir dire, une fois dans ma vie, ma façon de penser devant un des familiers de sa sainteté... dût-il me faire brûler plus tard.
—Fanfaron! interrompit la comtesse, vous savez bien que l’Église ne brûle personne.
—C’est vrai, fit observer Darcy, elle se contente de corrompre, en distribuant des recommandations, des places, de l’argent! Quand on n’a pu devenir ni ingénieur, ni avocat, ni commis à cheval dans les droits-réunis, on se fait catholique, et les prêtres se chargent de vous avoir une dot.
—Eh bien! que trouvez-vous de répréhensible?...
—Moi, rien, madame la marquise; autrefois, pour convertir les incrédules on les brûlait; aujourd’hui, on les marie! C’est évidemment un adoucissement.
—Quant au mariage, le docteur a raison, dit madame des Brotteaux; le curé de Saint-Sulpice, que je connais, a toujours à sa disposition une douzaine d’héritières.
—Ah! vous me rappelez qu’il est venu me voir hier, reprit la marquise; savez-vous qui il m’a proposé de marier?
—Qui donc?
—Moi! s’écria Arthur.
—Vous-même! il s’agissait d’une jeune et riche provinciale qui habite la Vendée, où elle se résigne à être une sainte en attendant mieux. Vous deviez aller faire sa connaissance, avec une recommandation de l’archevêché.
—Et qu’avez-vous répondu? demanda madame de Luxeuil.
—Mon Dieu! dit la marquise en laissant son regard glisser sur Honorine, qui se tenait à quelques pas occupée d’une tapisserie, j’ai répondu que monsieur Arthur n’aimait point les déplacements, et que, selon toute apparence, il attendrait le bonheur à domicile.
L’allusion était si claire qu’il y eut un mouvement parmi les auditeurs. Marquier rit d’un air approbatif, la comtesse parut inquiète et le docteur tourna les yeux vers Honorine.
Celle-ci ne comprit point d’abord, mais l’espèce d’attention curieuse dont elle était l’objet l’éclaira enfin; elle rougit, puis devint pâle.
La marquise, qui prenait plaisir à son trouble, se pencha vers elle.
—Eh bien! que faites-vous donc, ma petite, dit-elle avec intention, vous brouillez vos laines.
Honorine voulut répondre; les paroles s’arrêtèrent sur ses lèvres.
—Allons, soyez tranquille, je ne trahirai point votre secret, reprit madame de Biezi plus bas.
—Je n’ai point de secret, reprit la jeune fille.
—Alors, pourquoi rougir et trembler?
—Madame.., je vous jure...
—Bien, bien, nous n’avons rien vu, nous ne savons rien! Mais ne vous défendez pas, ou nous serions obligés de deviner. Quant à monsieur Arthur, j’espère qu’il me pardonnera... Et vous, messieurs, je vous recommande le silence. Vous ne m’en voulez pas au moins, comtesse? Je serais désolée d’avoir commis une inconvenance.
Tout en parlant et en riant, elle s’était levée pour prendre congé; le docteur demanda la permission de la reconduire jusqu’à sa voiture, tandis que Marquier offrait le bras à madame des Brotteaux; de sorte qu’Honorine se trouva bientôt seule avec sa tante et son cousin.
Ces deux derniers échangèrent d’abord des regards qui semblaient s’interroger et se répondre; il y eut comme un moment de délibération, puis ils parurent se décider. Arthur, qui se trouvait près de la porte, la referma sans affectation, pendant que madame de Luxeuil allait s’asseoir sur le divan placé vis-à-vis d’Honorine.
—J’avais toujours prévu ce qui vient d’arriver, dit-elle d’un ton chagrin, et j’aurais juré que la première indiscrétion viendrait de la marquise.
—Je suis véritablement désolé que ces allusions aient pu embarrasser à ce point ma cousine, ajouta Arthur avec contrainte.
—Cela prouve que les positions incertaines sont toujours fausses, reprit fermement la comtesse. Après ce qui vient de se passer, il est clair que vos soins pour votre cousine ont été remarqués par tout le monde, et que vous ne pouvez les continuer plus longtemps sans les justifier.
—Vous savez que c’est mon plus cher désir, dit Arthur en s’approchant d’Honorine; si j’ai gardé le silence jusqu’à ce moment, c’est que je voulais être connu de ma cousine et la mériter; mais à défaut de paroles, mes actions lui ont assez fait connaître ce que je sens. Je suis sûr qu’elle a compris mon amour; il me reste seulement à savoir si elle l’a accepté!
En prononçant ces derniers mots, Arthur s’était approché de la jeune fille, et, posant un genou sur le tabouret placé devant elle, il voulut prendre une de ses mains. Honorine se recula par un mouvement involontaire.
—Allons, parlez sans crainte, chère enfant, reprit madame de Luxeuil, qui s’était penchée vers elle, ne désespérez pas ce pauvre garçon qui vous aime et que vous aimez.
—Moi! bégaya Honorine stupéfaite.
—Vous, ma belle. Ne l’avez-vous point, depuis six mois, pour cavalier servant? Vous êtes faits l’un pour l’autre, chère petite; tout le monde l’a remarqué: rappelez-vous les regards et les sourires qui se sont tournés vers vous quand madame de Biezi nous a déconcertés par son allusion. Voyons, si cela vous coûte trop de répondre, donnez-lui au moins votre main.
En parlant ainsi d’une voix insinuante, madame de Luxeuil poussait doucement vers Arthur la jeune fille troublée.
Ce qui venait de se passer avait été si rapide, si inattendu, qu’Honorine s’était trouvée d’abord comme foudroyée: l’aveu de son cousin amené, et, pour ainsi dire, justifié par les suppositions de madame de Biezi, l’assurance de sa tante qui semblait ne pouvoir soupçonner une hésitation, le manque de présence d’esprit qui est la suite d’un premier saisissement, tout la réduisit au silence; elle avait entendu les déclarations d’Arthur et de madame de Luxeuil se succéder, sans trouver le moyen d’y répondre, et chaque retard lui rendait plus difficile de parler.
Cependant, arrivée à ce moment suprême où l’insistance de la comtesse allait lui arracher une sorte de consentement tacite, elle fit un effort désespéré, laissa tomber la tapisserie qu’elle tenait à la main, et se leva confuse.
—Eh bien! qu’avez-vous donc, enfant, dit madame de Luxeuil, en cherchant à la retenir.
—Pardon, balbutia Honorine avec honte et prière, je ne savais pas... je n’ai point voulu... vous faire croire... oh! pardonnez-moi, Madame... mais vous vous êtes trompée!
La comtesse fit un mouvement, et Arthur se redressa.
—Ma cousine refuse! s’écria-t-il avec une surprise irritée.
—C’est impossible! interrompit vivement madame de Luxeuil: sa réputation même ne lui permet plus de balancer. Pensez-vous donc, ma chère, que l’on puisse accepter impunément, pendant près d’une année, les soins d’un jeune homme, vivre avec lui dans une intimité familière, donner enfin à tout le monde la persuasion que vous venez d’entendre exprimer par la marquise? Votre conduite a été un engagement pris devant le public, et, à moins que mon fils n’ait mérité de déchoir dans votre estime...
—Oh! je ne dis pas cela, interrompit la jeune fille, qui sentait redoubler son embarras; mais j’avais cru... que le titre de parent... justifiait... ces soins... et qu’il suffisait de les payer de mon amitié!
—Eh! qui vous demande autre chose, ma chère? s’écria la comtesse, vous voyez bien que vous l’avouez vous-même? Vous avez de l’amitié pour Arthur.
—Sans doute... Madame.
—Que voulez-vous de plus, alors? Une passion? Songez donc, ma belle, qu’il ne s’agit pas de roman, il s’agit de mariage.
—Mais... Madame, essaya Honorine.
La comtesse l’attira à ses côtés.
—Écoutez-moi, petite, dit-elle en reprenant le ton riant, j’ai plus d’expérience que vous, n’est-ce pas? Je sais ce qu’il vous faut, laissez-vous conduire... en fille soumise... et acceptez le bonheur de confiance. Allons, c’est entendu, n’est-il pas vrai, demain je m’occuperai avec Arthur de la corbeille!...
—Madame, s’écria Honorine, qui sentait sa confusion et sa douleur tourner aux larmes. Oh! j’aurais voulu que mon silence pût être compris sans offenser personne... de grâce, ne me pressez point davantage..., et surtout, pardonnez-moi, car... je ne puis...
Ce dernier mot avait été murmuré presque à l’oreille de la comtesse, sur l’épaule de laquelle Honorine venait de cacher son visage, mais la mère d’Arthur se redressa brusquement. Tous ses traits avaient pris une expression de désappointement.
—Vous ne pouvez! s’écria-t-elle, et quel est l’obstacle? Qui vous retient? Pourquoi ce changement injurieux? voyons, Mademoiselle, donnez au moins une raison. Vous ne répondez pas, vous n’en avez donc aucune et à une résolution arrêtée, nécessaire, vous ne pouvez opposer qu’un caprice! N’espérez pas m’y faire céder, je n’aurai point la responsabilité de vos actes sans en avoir la direction, et ce mariage aura lieu parce qu’il le faut... et que je le veux!
Honorine releva la tête vivement. Jusqu’alors elle s’était sentie enveloppée dans les caresses et les prières de madame de Luxeuil; énervée, pour ainsi dire, par son insidieuse tendresse, elle n’avait point trouvé la force de la repousser et de rendre un coup pour une caresse; mais la menace brisa subitement ces liens de timidité. Elle tressaillit sous l’aiguillon; ses larmes s’arrêtèrent, et elle osa soutenir le regard de sa tante.
—Je sais ce que je dois de respect aux volontés de madame la comtesse, dit-elle avec fermeté; mais elle ne peut désirer que je m’engage sans prudence, et mon choix volontaire met à couvert sa responsabilité: quelles que soient les conséquences de ce choix, je les subirai sans plainte.
—Et moi, je ne les permettrai pas, s’écria madame de Luxeuil, à qui cette résistance avait enlevé tout sang-froid et toute présence d’esprit. Ah! mon indulgence vous a enhardie, vous espérez que je souffrirai patiemment votre révolte et votre ingratitude?
—Madame!
—Vous vous trompez, Mademoiselle, je saurai vous forcer à obéir ou à m’avouer la véritable cause de ce refus...
—Ne la demandez pas à ma cousine, interrompit Arthur, qui avait écouté jusqu’alors ce débat avec un mélange d’impatience et de dépit; un pareil aveu lui coûterait trop sans doute!
—Vous avez donc compris le motif? demanda la comtesse.
—J’ai compris, continua Arthur dont le regard restait appuyé sur la jeune fille, que j’avais à combattre, dans l’esprit de ma cousine, quelque comparaison défavorable...
—Quoi! s’écria madame de Luxeuil, elle en aimerait un autre?
Honorine voulut faire un geste de protestation, mais elle ne l’acheva pas. L’image de Marcel venait de traverser sa pensée, et elle sentit tout à coup pourquoi le projet de madame de Luxeuil l’avait, si douloureusement saisie. Les paroles de son cousin l’éclairaient sur ce qu’elle ne s’était point encore avoué à elle-même.
Cette espèce de révélation la troubla. Elle ne put soutenir le regard d’Arthur, rougit et baissa la tête sans répondre.
—Vous voyez que j’ai deviné juste! reprit celui-ci, avec un emportement amer et en se tournant vers la comtesse: si l’on me repousse, c’est parce qu’un autre est mieux accueilli; c’est pour lui que nous avons dû subir un refus aussi inattendu qu’injurieux! Mais qu’on ne pense pas que je m’y résigne. Non; on a laissé grandir mes espérances, on les a encouragées par tout ce qui peut donner confiance, on les a rendues publiques, et maintenant on voudrait les tromper au profit d’un autre! Je n’accepterai point cette humiliation. Si on peut me désespérer, on ne pourra du moins me faire ni méprisable, ni ridicule; je jure sur l’honneur que celui que l’on me préfère aura à me rendre compte de mes projets détruits, et que la place restera entière à un seul.
A ces mots, Arthur ouvrit brusquement la porte du salon et disparut.
Soit qu’elle voulût l’apaiser ou se concerter avec lui, madame de Luxeuil allait courir sur ses pas, lorsqu’on annonça M. le marquis de Chanteaux. Elle laissa échapper d’abord un geste de contrariété, puis, se ravisant, elle ordonna de le faire entrer dans son boudoir, et sortit pour le rejoindre.
A la menace d’Arthur, la pensée d’Honorine s’était reportée d’un bond vers Marcel. Bien qu’aucune des paroles de son cousin n’eût témoigné qu’il soupçonnât celui-ci, les craintes de la jeune fille devancèrent le danger. Elle comprit qu’en définitive la lutte ne pouvait s’ouvrir que là où était la rivalité, et que, tôt ou tard, de Luxeuil et de Gausson se trouveraient en présence.
Son esprit n’osa aller plus loin! la seule idée de cette rencontre lui donnait le vertige. Elle courut s’enfermer dans sa chambre où la solitude et le silence excitèrent encore ses inquiétudes. Elle se reprochait de n’avoir pas retenu Arthur, de n’avoir rien fait pour le dissuader. Elle se représentait déjà, avec la vivacité d’une imagination effrayée, toutes les conséquences du débat qui allait s’engager; elle se maudissait elle-même d’y donner lieu; elle se demandait, avec d’indicibles angoisses, ce qu’elle devait faire. Enfin, comme il lui arrivait toujours dans ses agitations extrêmes, elle courut au portrait de la baronne pour lui demander conseil et protection.
Ainsi que nous l’avons déjà dit, la tendresse de la jeune fille pour sa mère s’était traduite par une sorte d’adoration superstitieuse envers l’image qui la lui rappelait. Elle s’était habituée à lui adresser ses confidences et ses prières, comme autrefois à l’image de Marie qui ornait sa cellule de pensionnaire. Debout, devant le portrait, le cœur gonflé, les yeux humides, les mains jointes, elle regardait ces traits souriants avec une angoisse suppliante.
—Que faire, murmurait-elle, inspirez-moi, ma mère... aidez-moi!... Comment prévenir une lutte?... Mon Dieu! pourvu qu’il ne soit pas déjà trop tard... Si mon cousin avait soupçonné... S’il était parti..... Si Marcel et lui...
Un coup de pistolet l’interrompit.
Elle se détourna en poussant un cri. Au même instant Justine entra.
—Mademoiselle a eu peur, dit-elle en souriant.
—Qu’y a-t-il, que se passe-t-il? demanda Honorine palpitante.
—Rien, Mademoiselle; c’est M. de Luxeuil qui tire dans le jardin.
La jeune fille courut à la fenêtre et aperçut, en effet, une légère fumée qui s’élevait à travers les arbres dépouillés. Presque au même instant un second coup se fit entendre. Elle recula en frissonnant.
—Mon Dieu! il n’y a aucun danger, fit observer Justine; Mademoiselle sait bien que M. Arthur a fait disposer la grande allée pour le tir et qu’il s’y exerce souvent.
—Il est seul? demanda Honorine.
—Oui, Mademoiselle; j’ai su qu’il allait tirer parce que je l’ai entendu tout à l’heure demander ses pistolets au valet de chambre, en disant qu’il voulait se refaire la main.
Honorine pâlit.
—C’est dommage que Mademoiselle ne puisse pas voir d’ici, continua Justine, qui s’était approchée de la fenêtre, elle prendrait plaisir à admirer l’adresse de Monsieur. Il atteint le but à chaque coup.
—Vous l’avez donc vu? demanda la jeune fille anxieuse.
—Oh! bien des fois, Mademoiselle. Surtout quand il amenait ses amis, MM. Rovoy, d’Alpode, Marquier, de Gausson; mais aucun d’eux ne pouvait lutter avec lui. M. de Rovoy tirait trop bas, M. de Gausson trop haut, et quanta M. Marquier, il lui arrivait toujours quelque accident... Mais le bruit de ces coups de pistolet a l’air de faire mal à Mademoiselle...
—Il est vrai, dit Honorine qui tressaillait à chaque explosion et que les confidences de la femme de chambre achevaient d’épouvanter.
—Je vais prier Monsieur de cesser, reprit celle-ci en faisant un mouvement pour sortir.
—Non, interrompit la jeune fille, je craindrais qu’il ne trouvât étrange...
—De faire une chose agréable à Mademoiselle?... Ah! M. Arthur sera trop heureux. Mademoiselle ne se doute pas combien il lui est dévoué. Je vais l’avertir tout de suite...
—C’est inutile, il ne tire plus.
La femme de chambre se pencha au balcon.
—C’est vrai, dit-elle, voilà Pierre qui rapporte les armes. Je me doutais bien, du reste, que Monsieur ne continuerait pas longtemps; car il avait ordonné d’atteler le tilbury.
—Il va donc sortir?
Le roulement d’une voiture sur le pavé de la cour venait d’ébranler légèrement les vitrages. Honorine courut à la fenêtre opposée et aperçut le tilbury, conduit par son cousin, qui franchissait la porte cochère et disparaissait dans le faubourg.
L’idée qu’il se rendait chez de Gausson la frappa comme un trait. Surexcitée par la série d’émotions qui venaient de l’assaillir, elle en était arrivée à ce moment où un dernier choc jette l’âme hors de toute réserve et rend une plus longue incertitude impossible. Elle se tourna brusquement vers Justine et s’écria qu’elle voulait parler à madame de Luxeuil. La femme de chambre sortit et revint au bout de quelques minutes, avec la comtesse elle-même. Celle-ci fit signe à Justine de se retirer et se trouva seule avec sa nièce.
En demandant à voir madame de Luxeuil, Honorine avait obéi à un élan irréfléchi de douleur et d’épouvante. Elle avait voulu conjurer, à tout prix, le danger qui semblait menacer Marcel; mais à l’aspect de la comtesse, elle se sentit subitement glacée et demeura à la même place, sans voix et sans mouvement.
Madame de Luxeuil l’observa un instant, puis s’assit.
Il y avait dans ses manières quelque chose de solennel, de dur et de résolu. Elle attendit d’abord qu’Honorine prit la parole, mais voyant qu’elle continuait à garder le silence, elle dit enfin d’un accent bref:
—Quand vous m’avez fait demander, j’allais venir, Mademoiselle, car les derniers mots de mon fils, en vous quittant, annonçaient un projet qui m’a effrayée...
—Ah! c’est de ce projet que je voulais vous parler, Madame, interrompit Honorine précipitamment; il ne faut point qu’il s’accomplisse; vous vous opposerez...
—Vous ne pouvez ignorer, Mademoiselle, répliqua froidement la comtesse, que l’autorité d’une femme, et surtout d’une mère, s’arrête toujours aux questions où les hommes ont placé leur honneur. Mes prières seraient inutiles et vous seule pouvez tout empêcher.
—Moi, Madame, et par quel moyen?
—En épargnant à Arthur l’outrage qui l’irrite et l’afflige. Je suppose que vous le pouvez encore, et que vous n’êtes point tellement engagée ailleurs qu’un autre ait désormais le droit de régler votre conduite.
—Je n’ai donné à personne un pareil droit, répliqua Honorine les yeux baissés.
—Alors, reprit vivement la comtesse, il s’agit seulement d’une de ces préférences de jeune fille qui sont notre roman à toutes, au sortir du couvent. Réfléchissez-y, Honorine, vous avez entre vos mains votre réputation, votre bonheur, deux existences peut-être!... Les sacrifierez-vous à une frivole fantaisie?
Madame de Luxeuil prononça ces derniers mots d’un accent plus doux, et, voyant que la jeune fille se taisait, elle crut devoir rappeler toutes les raisons qui rendaient son mariage avec Arthur indispensable pour tous deux.
Elle parla longtemps avec adresse et autorité; Honorine écoutait, appuyée à la fenêtre ouverte, les bras pendants, la tête baissée et dans une attitude d’abattement.
Tout à coup, un sifflement cadencé se fit entendre au-dessous du balcon.
La jeune fille redressa la tête: c’était l’appel autrefois employé au couvent par le vieux jardinier, et dont Marc était convenu pour avertissement.
Au même instant, une flèche de papier traversa l’air et vint tomber à ses pieds.
Elle se pencha précipitamment au balcon, un commissionnaire en veste de velours et la scie sur l’épaule franchissait le seuil de la grande porte.
La comtesse surprise s’était levée.
—Que signifient ce signal et ce papier? demanda-t-elle, en jetant un regard dans la cour déserte.
Au lieu de répondre, Honorine voulut relever la flèche; mais sa tante la prévint.
—Vous savez sans doute ce que renferme cette missive? dit-elle en regardant sa nièce d’un air soupçonneux.
—Nullement... Madame... répliqua Honorine troublée.
La comtesse déroula la flèche et en retira un billet, artistement caché dans la spirale de papier.
—Une lettre! s’écria-t-elle.
—Une lettre! répéta la jeune fille.
—Elle explique, sans doute, la cause de vos refus plus clairement que vous n’avez voulu le faire, ajouta madame de Luxeuil.
—Madame, je proteste que j’ignore ce que peut contenir ce billet.
—Alors vous me permettrez de vous en faire la lecture.
Et dépliant la lettre elle lut tout haut.
«Un grand danger vous menace!
»La première fois que je me suis fait connaître a vous, je n’ai pu que vous dire:—Prenez garde! je ne savais pas encore l’intérêt qu’on pouvait avoir à vous faire des amitiés; maintenant, je le connais; on veut vous marier à votre cousin!
»Ce mariage est promis à ses...»
Ici madame de Luxeuil s’arrêta brusquement, elle parcourut rapidement des yeux le reste de la lettre, poussa deux ou trois exclamations d’étonnement d’abord, puis de colère et arriva enfin à la signature.
—Marc! s’écria-t-elle. Quel est cet homme! vous le connaissez donc?
—Je le connais, dit Honorine, frappée de ce qu’elle venait d’entendre.
—Et quel droit a-t-il de vous écrire? reprit impétueusement la comtesse; qu’est-il enfin? répondez sur-le-champ, répondez, Mademoiselle.
En parlant ainsi, elle s’était avancée vers sa nièce, l’œil étincelant, et froissant le billet de Marc; mais la jeune fille soutint son regard avec une hardiesse presque calme. Étrange mystère de l’âme humaine qu’un seul encouragement retire de ses plus profonds abattements! ce signal et cette lettre avaient suffi pour la relever. Elle n’était plus seule au monde; elle se sentait soutenue! Les quelques lignes qui avaient été lues venaient de lui faire entrevoir dans le mariage proposé une sorte de complot, et elle avait compris que cette révélation changerait sa position vis-à-vis de la comtesse et de son cousin; de suppliante elle pouvait devenir accusatrice! aussi, le courage lui revint-il subitement avec l’espoir.
—Madame la comtesse me permettra de taire un secret qui n’est pas seulement le mien, dit-elle d’un ton ferme.
—Ainsi, vous avouez, dit madame de Luxeuil surprise et irritée d’un changement aussi inattendu: il y a au dehors des gens que vous n’osez faire connaître et dont les conseils vous dirigent, en nous accusant! car cette lettre est une dénonciation infâme!
—Madame la comtesse ne m’a point permis d’en juger, fit observer Honorine.
—Ah! ne feignez point l’ignorance, s’écria la mère d’Arthur, ces mensonges ne sont point les premiers qui vous aient été écrits contre nous; avant la demande de mon fils, vous étiez déjà prévenue! Ne cherchez point à le cacher, Mademoiselle. On vous avait avertie d’être en garde contre nos projets, on les avait noircis, on vous avait présenté ce mariage comme une spéculation qui devait nous enrichir. Pourquoi vous taire? avouez, avouez tout!
Emportée par la colère, la comtesse révélait ainsi à la jeune fille, sans s’en apercevoir, le contenu de la lettre de Marc; Honorine leva les yeux avec une certaine surprise.
—Jusqu’à ce moment j’avais ignoré ces accusations, dit-elle, en regardant madame de Luxeuil, et vous êtes, Madame, la première à m’éclairer.
—Vous éclairer, répéta la comtesse exaspérée de la fermeté de la jeune fille et de sa propre maladresse, c’est-à-dire que vous acceptez pour vraies ces calomnies? votre titre de riche héritière vous paraît un droit suffisant à tous les orgueils!
—C’est la seconde fois que madame la comtesse parle de cette richesse à laquelle je n’avais jamais pensé, interrompit vivement Honorine; mais puisque je l’ai obtenue du hasard, elle reconnaîtra, sans doute, qu’une telle faveur ne peut rien diminuer à ma liberté, et que je reste maîtresse d’en jouir seule ou de choisir celui qui doit la partager.
Madame de Luxeuil recula d’un pas.
—Ah! vous le prenez ainsi, dit-elle, la voix tremblante; vous déclarez enfin votre volonté! A la bonne heure! J’aime mieux la révolte que la dissimulation, vous demandez la guerre, vous l’aurez!...
—Je ne l’ai point cherchée, Madame, fit observer Honorine avec douceur; il n’y a eu, dans mes paroles, ni provocation, ni menace; j’ai seulement réclamé mes droits...
—Tes droits! interrompit la comtesse avec explosion; malheureuse! mais tu n’en as aucun!
—Comment! s’écria Honorine stupéfaite.
—J’ai gardé le silence aussi longtemps que je l’ai pu, continua madame de Luxeuil; ma pitié et ma folle affection m’ont retenue; mais tant d’ingratitude mérite enfin un châtiment. Tu veux nous résister, tu parles de droits! Eh bien! écoute et ne t’en prends qu’à toi-même de ce que tu vas savoir, car tu l’auras voulu!... La position dont tu jouis, la fortune qui te rend fière, le nom que tu portes... tout cela est un vol!
—Grand Dieu! que voulez-vous dire!
—Tu n’es pas la fille du général Louis!
Honorine recula jusqu’au portrait de la baronne.
—Non, continua madame de Luxeuil avec un acharnement haineux; et si le général eût vécu, tu croupirais maintenant au fond d’un hospice de mendiants, car il savait la vérité!
—La vérité! répéta Honorine éperdue; et de qui donc suis-je la fille, Madame?
—De l’amant de ta mère.
—Ah! vous mentez! cria l’orpheline, en se redressant pâle et les yeux indignés.
Un éclair traversa les traits de la comtesse: elle retira brusquement un papier caché dans son corsage et fit un pas vers sa nièce.
—Voilez ce portrait, dit-elle les dents serrées; voilez-le, qu’il ne puisse nous voir, ni nous entendre, et, puisqu’il vous faut des preuves, lisez!...
Elle avait tendu le papier à la jeune fille qui le prit en frissonnant, et l’ouvrit.
—Connaissez-vous cette écriture? demanda madame de Luxeuil.
—C’est celle de ma mère, répliqua Honorine saisie.
—Lisez.
La jeune fille reporta les yeux sur le billet qui ne contenait que quelques mots et lut machinalement ce qui suit:
«Mon ami,
»Le général a tout découvert; il sait qu’Honorine n’est point sa fille! Venez, si vous voulez nous sauver toutes deux!»
Ces trois lignes étaient adressées à M. le duc de Saint-Alofe.
Honorine les lut une seconde fois sans pouvoir en croire ses yeux, puis regarda la comtesse d’un air égaré. La force de la surprise et de l’émotion lui avait ôté la parole.
—Ainsi ce n’est pas moi qui ai menti, reprit madame de Luxeuil en désignant la lettre par un geste d’ironie poignante; non, ce n’est pas moi, mais celle qui a usurpé un nom qu’elle n’a point le droit de porter, une fortune qui est à nous!... Car comprends-tu enfin, malheureuse abandonnée, que tout ce qui fait ton orgueil est un prêt dû à ma pitié; que toi qui parles de liberté de choix, tu serais repoussée de tous si je le voulais; que pour te rejeter dans la honte et la misère, je n’aurais qu’à dire un mot?
—Ah! vous ne le direz pas! s’écria Honorine, arrachée à sa torpeur par cette menace.
—Je le dirai puisqu’on m’y a forcée, continua madame de Luxeuil; ce mariage, je l’ai sollicité avec prière: je vous ai avertie qu’il y allait du bonheur de mon fils, de son repos, de sa vie peut-être; vous n’avez rien écouté, eh bien! moi aussi, je serai implacable. Puisque vous avez parlé de droits, je ferai valoir les miens, et j’irai redemander l’héritage qu’on nous a dérobé, cette lettre à la main...
—Non! cria Honorine, en courant éperdue à la comtesse, dont elle s’efforça de saisir les mains; oh! non, vous ne vous vengerez pas si cruellement, Madame... Pour moi, je ne demande rien; mais pour ma mère, Madame, grâce pour la mémoire de ma mère.
—Et pourquoi montrerais-je plus de dévouement à cette mémoire que sa fille n’en montre elle-même, fit observer madame de Luxeuil; n’est-ce point sa fille qui m’a forcée à cette révélation honteuse? Pour l’éviter, j’avais formé un projet qui confondait ses intérêts avec ceux de mon fils; je voulais justifier par l’alliance une position usurpée, faire que celle qui n’a point droit de se dire ma nièce devînt légitimement ma fille... Elle a repoussé ma demande... Elle a douté de mes intentions... elle m’a insultée!
La comtesse s’interrompit: soit qu’elle eût jugé nécessaire de feindre la sensibilité, soit que la longueur de ce débat eût ébranlé ses nerfs et qu’elle cédât à une émotion physique involontaire, sa voix, d’abord entrecoupée, s’éteignit, et quelques larmes mouillèrent ses paupières.
Cet attendrissement inattendu brisa ce qui restait de force à Honorine. Atteinte par cette contagion des larmes dont il est si difficile de se défendre, et succombant à tant d’épreuves successives, elle se laissa glisser aux pieds de madame de Luxeuil, pencha le front sur ses deux mains qu’elle avait saisies, et lui dit en sanglotant:
—Que l’honneur de ma mère soit sauvé, Madame, et puis... faites de moi ce que vous voudrez!
Dès le lendemain, madame de Luxeuil écrivit à la mère Louis et à M. le conseiller de Vercy, tuteur d’Honorine, pour demander leur autorisation; mais sûre que celle-ci ne pouvait être refusée, elle annonça d’avance le mariage à tous les amis de la famille.
De Gausson en demeura foudroyé; les autres avaient pu, en se méprenant sur l’intimité établie entre Arthur et sa cousine, présager depuis longtemps ce mariage; mais lui, il connaissait trop bien Honorine pour qu’il lui fût possible de le craindre. Depuis une année qu’il étudiait cette nature délicate et tendre, il avait pu comprendre quel abîme la séparait de son cousin.
Son dernier entretien lui avait d’ailleurs persuadé que son amour était compris et accepté. Aussi hésita-t-il à croire, jusqu’au moment où la nouvelle lui fut confirmée par de Luxeuil.
Ce dernier, dont les soupçons s’étaient portés naturellement sur Marcel, lors du premier refus d’Honorine, voulut éclaircir ses doutes en lui parlant longuement de ce mariage; mais de Gausson écouta tout sans exprimer ni surprise, ni trouble apparent. L’expérience du monde l’avait accoutumé à ces épreuves, qui font de nos salons un champ de bataille où le courage est dans l’impassibilité. Comprimant donc la violence de sa douleur, il ne songea plus qu’à voir Honorine afin de s’expliquer avec elle.
L’union annoncée était trop inattendue pour qu’il n’y soupçonnât pas quelque surprise ou quelque piége; mais la difficulté était d’arriver jusqu’à la jeune fille. Dans nos mœurs, pleines de contraintes et de fausses apparences, l’usage a établi une séparation presque absolue entre ceux qui auraient le plus besoin de se voir, de s’étudier, de se connaître. C’est seulement à la dérobée, et par rencontre, que le jeune homme et la jeune fille peuvent échanger librement leurs pensées. Hors ces hasards inespérés, tous deux ne doivent se voir qu’à travers la famille, espèce de voile placé entre leurs âmes, comme on en place ailleurs entre leurs yeux.
De Gausson essaya vainement de parvenir jusqu’à Honorine: il la trouva toujours surveillée, entourée. Madame de Luxeuil avait redoublé de précautions et la quittait à peine. Vingt fois Marcel fut sur le point de s’adresser ouvertement à la jeune fille pour demander à l’entretenir seule un instant, et toujours le joug de l’usage le retint.
Aucune promesse ne lui avait été faite d’ailleurs; il ne pouvait même se recommander d’un aveu reçu! Son amour et celui d’Honorine, visibles pour tous deux, n’étaient point sortis de ce premier crépuscule qui donne tant de charme à la passion naissante; ses droits pouvaient être sentis mais non formulés. Une lettre eût été impuissante à les traduire; pour les faire valoir, il fallait toute l’indépendance d’un long épanchement.
Marcel continua à en chercher l’occasion, mais les jours se succédèrent sans la lui offrir. Le moment du mariage approchait; il comprit enfin que l’heure d’une explication était passée; dans tous les cas, inutile peut-être, elle devenait inopportune et impossible après un si long retard.
La jeune fille, du reste, semblait elle-même la fuir. Tremblante à l’aspect de Marcel, elle évitait de le regarder, de lui parler. Celui-ci finit par croire qu’il s’était trompé. Il se dit que tout ce qui avait eu lieu était un de ces jeux de cœur dont la plupart des jeunes filles s’amusent quelques jours, essais de romans sans portée et sans suite, auxquels elles renoncent en même temps qu’aux longues correspondances et aux amies du couvent.
Cette pensée fut un trait aigu qui s’enfonça au plus profond de son âme; ne pouvant en supporter la douleur, il résolut d’y échapper par la fuite. Avant de partir, il voulut seulement voir Honorine une dernière fois.
Il la trouva en compagnie de sa tante et de madame des Brotteaux; Arthur, Marquier et de Cillart causaient à l’autre bout du salon.
Au moment où on l’annonça, madame des Brotteaux s’écria avec plus de vivacité que d’habitude.
—Ah! tant mieux; nous allons prendre M. de Gausson pour juge!
Honorine, qui avait tressailli au nom de Marcel, voulut la retenir; mais elle continua:
—Non, non, je veux qu’il donne son avis, lui qui vous connaît bien et qui est de vos amis; venez, monsieur Marcel, venez.
Le jeune homme s’approcha en demandant de quoi il s’agissait.
—C’est une grave question, dit la comtesse en riant, et pour la décider, nous avons besoin de toutes vos lumières.
—Ne l’influencez pas! reprit Hortense, il faut qu’il donne son opinion franchement. Il s’agit de la corbeille de noces.
Les lèvres de Marcel se serrèrent, et sa main pressa convulsivement les bords du chapeau qu’il tenait; mais sa voix resta ferme pour demander quelle était la difficulté à juger.
—Faites-moi d’abord le plaisir de regarder cette chère petite, dit madame des Brotteaux, qui se retourna vers Honorine.
Le regard de Marcel suivit la direction indiquée, et rencontra celui de la jeune fille, qui rougit, s’efforça de sourire, puis baissa les yeux avec une affreuse palpitation de cœur.
—Vous la voyez, reprit madame des Brotteaux, eh bien! maintenant, dites-nous quelle est la couleur qui lui sied davantage, le rose ou le bleu?
—En vérité, Madame, dit de Gausson avec effort, vous présumez trop de mon observation ou de mon goût; je craindrais que mon avis ne détruisît la bonne opinion que vous voulez bien en avoir.
—C’est une défaite, répondit Hortense avec insistance, je veux savoir quelle est la couleur que vous préférez voir à Honorine.
—La couleur que je préfère, répéta lentement de Gausson, en jetant vers la jeune fille un regard ému.
—Précisément; est-ce le rose?
—Non, Madame.
—Alors c’est le bleu! s’écria-l-elle en se tournant triomphante vers madame de Luxeuil; vous le voyez, chère comtesse, il est de mon avis.
—Oui, reprit de Gausson, dont les yeux s’étaient pour ainsi dire oubliés sur Honorine; c’était la couleur que Mademoiselle portait la première fois que je la vis... chez la prieure...
Bien que ces mots eussent été prononcés sans intention apparente, il y avait, dans le timbre de la voix, une nuance qui n’échappa point à la jeune fille. C’était à la fois de la tristesse, de l’amour et du reproche. Elle sentit son cœur défaillir.
Madame de Luxeuil avait également paru frappée, non de l’accent de Marcel, mais de ses paroles.
—Vous aviez vu ma nièce avant son arrivée à Paris? demanda-t-elle.
—En passant eu Touraine, Madame, il y a douze ans.
—Douze ans!... Ah! vous étiez des enfants alors, reprit la comtesse soulagée; je m’étonne seulement qu’Honorine ne m’ait jamais parlé de cette rencontre.
—C’était une circonstance peu importante dans la vie de Mademoiselle, fit observer de Gausson, avec une légère nuance d’amertume.
—Mon Dieu! qui se souvient de douze ans? dit madame des Brotteaux, qui avait repris sa nonchalance; mais M. de Gausson a une mémoire miraculeuse. Croiriez-vous qu’il reconnaissait tous les villages, lorsque, pour nous rendre aux bains de mer, nous avons traversé la Normandie?
—J’y ai été élevé, répondit de Gausson; je l’ai vingt fois parcourue en tous sens...
—Et vous avez voulu nous la faire également parcourir, interrompit madame des Brotteaux. Oh! si vous saviez quelles promenades, comtesse! Figurez-vous des dunes exposées au soleil et au vent, des chemins horribles... où l’on est obligé d’aller à pied! J’ai cru en mourir.
—M. de Gausson vante pourtant la beauté de son pays, objecta madame de Luxeuil.
—Laissez donc, je voudrais le voir forcé d’y habiter.
—Votre souhait va s’accomplir, Madame, dit Marcel, car je pars dans quelques jours pour la Normandie.
—Vous! répétèrent à la fuis la comtesse et madame des Brotteaux.
—Je venais vous faire ma visite d’adieux.
Honorine eut peine à retenir un cri. Le souvenir précédemment réveillé par de Gausson l’avait déjà ébranlée, mais cette brusque annonce de départ acheva de briser son courage. L’idée qu’elle ne verrait plus Marcel et qu’il allait partir malheureux, irrité, imposa silence à tout le reste. L’exaltation de dévouement qui l’avait jusqu’alors étourdie, fit place au désespoir, puis à la résolution de se justifier en avouant tout à de Gausson.
Un nouvel incident vint traverser cette tentation.
Pendant l’entretien que nous venons de rapporter, Arthur et les visiteurs réunis à l’autre extrémité du salon, avaient continué, de leur côté, une conversation qui était devenue de plus en plus animée. Marquier en semblait le héros, et, à la multiplicité de ses gestes et de ses affirmations, il était facile de deviner qu’il avait à vaincre l’incrédulité d’une partie de ses auditeurs.
—Quand je vous répète que je le tiens du caissier! s’écria-t-il enfin; qu’il a reçu les deux cent mille francs; qu’il les a comptés!
—Qu’y a-t-il donc? demanda madame de Luxeuil, étonnée de la chaleur du banquier.
—Ah! pardieu il faut raconter la chose à ces dames, s’écria de Cillart en riant; voyons, Marquier, recommencez pour elles votre roman.
—Je soutiens que c’est une histoire, répliqua celui-ci, et j’offre au capitaine de parier cent louis.
—N’acceptez pas! interrompit Arthur; s’il veut parier, c’est qu’il est sûr de gagner.
—Mais de quoi s’agit-il enfin? reprit la comtesse.
—Mon Dieu! d’une folie de philanthrope, reprit Marquier, madame la comtesse doit avoir entendu parler de l’auteur de l’Avenir dévoilé?
Madame de Luxeuil jeta un regard rapide du côté d’Honorine.
—Oui est-ce qui ne connaît pas ce vieux rêveur? reprit de Cillart, en haussant les épaules; il envoyait autrefois ses livres gratuitement à tout le monde, moi-même j’en ai reçu.
—Avec l’épigraphe latine invariable: Omnis omnibus.
—Oui; on lui en avait fait un sobriquet, et les petits journaux ne l’appelaient que le duc omnis omnibus.
—Adoptons le nom, dit vivement madame de Luxeuil, je n’en veux pas d’autre.
—Va pour omnis omnibus, reprit Marquier en riant; voici ce que je racontais de lui à ces Messieurs.
A l’époque où le duc était encore riche, il avait pour ami M. de Lannaut, le père des banquiers actuels, qui était aussi dans les affaires. Il paraît même que le bonhomme goûtait les idées du duc, et qu’il rêvait, comme lui, le bonheur du genre humain!... Ils ont toujours eu quelque chose de détraqué dans cette famille....
—Enfin, demanda madame Luxeuil, qui semblait mal à l’aise et impatientée du récit de Marquier.
—Enfin, continua celui-ci, à force de s’occuper des affaires de la société, le père Lannaut laissa les siennes se déranger, de sorte qu’un beau jour il se trouva avec un passif qui dépassait son actif de près de cent mille écus! Le bonhomme eut beau se retourner, faire argent de tout, la faillite était inévitable. Alors, ne sachant plus où trouver du secours, ruiné, déshonoré, il perdit la tête et prit la fuite. Il avait déjà rejoint le Havre où il allait s’embarquer, quand il reçut une lettre de son caissier, qui lui apprenait que tous les billets présentés avaient été payés.
—Payés! s’écria Honorine, qui, distraite d’abord, avait fini par écouter malgré elle et par s’intéresser.
—Intégralement! ajouta Marquier, et cela par un inconnu.
Toutes les femmes poussèrent une exclamation.
—Voilà où nous tournons au conte de fée, dit de Cillart.
—Pas du tout, reprit Marquier, car le soi-disant inconnu n’était autre que le duc omnis omnibus, qui, de retour d’un petit voyage, avait appris, du caissier lui-même, la fuite de Lannaut, et s’était immédiatement dépouillé de tout ce qu’il avait de fonds disponibles chez son notaire.
—Mais vous passez le plus merveilleux! s’écria Cillart; c’est que votre duc avait exigé le secret de la part du caissier, et que ledit Lannaut est mort sans savoir à qui il devait ces deux cent mille francs.
—Mais il ne les devait pas! s’écria Marquier; je vous ai déjà dit qu’il n’y avait eu ni acte ni reçu.
—Eh bien! je déclare, moi, reprit le garde-du-corps, que je ne puis croire à une pareille folie.
—Vous avez tort, reprit sérieusement de Gausson; j’ai connu le notaire entre les mains duquel les fonds furent remis, et je savais, depuis longtemps, tous les détails de cette affaire.
—Me croirez-vous, maintenant? demanda Marquier en se retournant vers de Cillart.
—Alors, je n’ai qu’un mot à répondre, dit-il, c’est qu’omnis omnibus était un échappé de Charenton.
—Le malheureux! fit observer madame des Brotteaux, perdre deux cent mille francs!
—Encore s’il eût demandé un reçu, ajouta Marquier.
—Mon Dieu! sa vie est pleine de traits semblables, reprit madame de Luxeuil avec le désir évident de mettre fin à cette conversation; il serait plus généreux de ne point les rappeler et d’imiter le charitable silence de M. de Gausson.
—Je voudrais pouvoir accepter l’approbation de madame la comtesse, dit celui-ci, en s’inclinant avec gravité; mais je ne l’ai point méritée, et si je garde le silence, c’est que loin de pouvoir m’associer aux anathèmes dont le duc est l’objet, je ne pourrais exprimer pour lui que de l’admiration.
L’étonnement parut général.
—Quoi! s’écria de Cillart, même pour le cadeau des deux cent mille francs?
—Pour lui surtout, reprit Marcel en s’animant, car ce que M. Marquier ne vous a point dit, c’est que l’homme sauvé par le duc était un de nos industriels les plus ingénieux et les plus hardis; que sa ruine arrêtait vingt tentatives dont la réussite pouvait enrichir le pays; qu’elle réduisait à la misère plusieurs centaines de familles; que la prévenir enfin, n’était pas seulement un acte d’ami, mais de bon citoyen. Il fallait aussi ajouter que le duc ne fit un mystère de sa généreuse assistance que parce qu’il savait M. Lannaut capable de la refuser et de préférer, dans son découragement, une ruine immédiate à des obligations qu’il eût craint de ne pouvoir remplir.
—C’est avec des raisonnements pareils que ce pauvre duc a mangé un million! dit Marquier en ricanant.
—Et qu’il a fini par l’hôpital, ajouta de Cillart.
—Tandis que les fils Lannaut ont équipage et qu’ils se moquent, comme tout le monde, d’omnis omnibus, acheva Arthur.
—Voyez-vous, mon cher de Gausson, reprit le garde-du-corps, tant que le monde restera ce qu’il est, le dévouement sera l’orgueil des niais.
—Non, dit Marcel avec une fermeté calme, ce sera la vertu des courageux! Un jour viendra, je l’espère, où les sociétés plus intelligentes n’auront pas besoin du sacrifice de quelques-uns pour le salut du plus grand nombre et où le bonheur de chacun aidera au bonheur de tous; mais d’ici-là, c’est aux généreux à accepter l’abnégation, à s’oublier pour les autres, à nourrir le monde de leur âme et de leur sang.
—Et le monde, une fois nourri se moquera d’eux, objecta Marquier.
—Peut-être, continua Marcel; mais pour celui qui s’est imposé une tâche, qu’importe l’approbation? Le dévouement est un martyre; il se fortifie de ses souffrances, il s’encourage de son abandon, il tire ses joies et ses récompenses de lui-même. Tout perd son charme à la longue; les passions s’attiédissent, les ambitions trompent, les espérances fatiguent; mais rien ne peut enlever cette douce saveur que laisse le souvenir du bien accompli. Quiconque se dévoue doit accepter la douleur, l’injustice, le dédain, car c’est de ces fleurs amères que se compose le miel qui adoucit les souffrances de la vieillesse!...
De Gausson s’était laissé emporter, sans y prendre garde, à l’expression de ses pensées les plus intimes; les sourires de Marquier, d’Arthur et du garde-du-corps le rappelèrent tout à coup au souvenir du lieu et de l’auditoire; il rougit un peu, s’interrompit brusquement et se leva.
Mais ses paroles avaient frappé Honorine. Prête à regretter le sacrifice qu’elle faisait à la mémoire de sa mère, elle y avait trouvé une sorte d’à-propos qui la saisit. Il lui sembla que cet encouragement au dévouement dans la bouche de Marcel avait quelque chose de plus éloquent que dans aucune autre; que c’était enfin un avertissement providentiel auquel il ne lui était point permis de résister!
Cette sensation fut si complète et si vive que son projet de tout confier au jeune homme fut à l’instant abandonné, et qu’elle revint, avec une sorte d’enthousiasme passionné à l’idée du sacrifice silencieux.
Aussi, lorsque de Gausson s’approcha d’elle, afin de prendre congé, réunit-elle tout ce qui lui restait de forces pour le recevoir d’un air tranquille.
Marcel prit sa main, la porta à ses lèvres et prononça le mot d’adieu avec une expression de désespoir étouffé! Elle sentit un frisson glacé parcourir ses veines; mais ses lèvres répétèrent adieu avec une sorte de froideur machinale.
Ce fut seulement lorsque le jeune homme s’éloigna que ses forces l’abandonnèrent. Elle porta les deux mains à son cœur qui se brisait, se laissa retomber sur son fauteuil, sans pensée et sans mouvement.
Ce trouble, qui n’avait échappé ni à la comtesse ni à son fils, confirma leurs soupçons. Aussi, bien que le départ de M. Marcel de Gausson semblât devoir les rassurer, résolurent-ils de redoubler de surveillance.
La lettre jetée par la fenêtre d’Honorine, et interceptée par la comtesse, était toujours restée pour eux un inexplicable mystère. Quel était ce protecteur caché qui, sous le nom de Marc, veillait sur la jeune fille. Cette dernière eût pu le leur dire, mais madame de Luxeuil craignait, avec raison, qu’une nouvelle explication n’amenât de nouveaux débats, et, par suite, quelque changement dans les résolutions d’Honorine.
L’autorisation demandée à la grand’mère Louis était arrivée, il ne restait plus à recevoir que celle du tuteur, M. de Vercy, dont le silence commençait à étonner de Luxeuil et sa mère; mais ils apprirent enfin la cause de ce retard.
Partageant la répugnance de tous les provinciaux à se servir de la poste, le conseiller avait confié sa lettre à un substitut de la cour d’Angers qui se rendait à Paris et qui avait voulu l’apporter lui-même. Cette réponse renfermait une autorisation régulière pour la publication du mariage avec un modèle de contrat; elle annonçait, en outre, l’arrivée de M. de Vercy, appelé à Paris pour une affaire personnelle.
Cette nouvelle inquiéta Arthur et madame de Luxeuil. Ils interrogèrent adroitement le substitut sur les intentions que pouvait avoir exprimées M. de Vercy, et sur l’affaire qui l’obligeait à quitter Angers, mais celui-ci ne put leur donner aucun éclaircissement. Il leur parla seulement d’une seconde lettre confiée par le conseiller, et qu’il chercha dans son portefeuille. Elle était adressée:
A Monsieur Marc,
Garçon de Bureau.
Rue des Morts, nº 16.
A ce nom de Marc, la mère et le fils échangèrent un coup d’œil.
—J’espère au moins que vous ne porterez pas cette lettre à domicile? fit observer madame de Luxeuil.
—Pardonnez-moi, madame la comtesse, dit le substitut: M. de Vercy m’a bien prié de la remettre en mains propres.
La comtesse se récria.
—Mais il n’y a point songé, dit-elle, c’est hors ville.
—J’ai été, en effet, un peu effrayé en cherchant hier la rue des Morts sur un plan de Paris, avoua le substitut.
—Sans compter que vous pourrez y aller dix fois avant de rencontrer cet homme.
—Ne suffirait-il pas de jeter la lettre à la poste? demanda Arthur.
Le substitut objecta la crainte d’une erreur d’adresse ou d’un changement de domicile.
—Eh bien! donnez-la moi, reprit madame de Luxeuil, je la ferai porter.
—Mille grâces, madame la comtesse; mais je n’oserais abuser à ce point...
—Donnez, vous dis-je, j’enverrai mon chasseur, et il retournera plusieurs fois au besoin. Que Monsieur vienne dîner avec nous après-demain, je pourrai lui apprendre le résultat de ses recherches.
Le substitut se confondit en remerciements, et se retira enfin ravi de l’amabilité de la comtesse.
A peine fut-il parti, qu’Arthur courut fermer la porte, tandis que sa mère ouvrait la lettre de M. de Vercy.
C’était une réponse à celle qui avait été écrite par Marc, au sortir de chez madame Beauclerc, et dans laquelle il dénonçait les véritables motifs d’Arthur, en recherchant la main de sa cousine. Le conseiller, sans rien croire ni rien contester, déclarait qu’il serait à Paris vers la fin du mois pour un placement de fonds et des remboursements, et qu’il demanderait alors des éclaircissements plus détaillés.
La mère et le fils comprirent en même temps que, s’ils ne prévenaient les révélations de Marc, tout était perdu. A quelque prix que ce fût, ils devaient donc le gagner, l’effrayer ou le tromper. Mais pour savoir lequel de ces moyens tenter, il fallait avant tout connaître l’homme auquel on avait affaire.
Comme ils cherchaient les moyens d’y parvenir sans se compromettre, on annonça à de Luxeuil que M. Hartmann, le maquignon, demandait à lui parler.
Ce fut un trait de lumière! Il ordonna de le faire monter à son appartement, demanda la lettre à sa mère, et lui déclara qu’ils auraient tous les renseignements dès le lendemain.
Il trouva l’Allemand qui l’attendait dans son cabinet, debout et le chapeau à la main. Malgré sa grosse cravate de laine rouge, remontant jusqu’au-dessus des oreilles, sa barbe épaisse qui lui cachait les deux tiers du visage, et la capote de castorine blanchâtre sous laquelle sa maigreur se trouvait déguisée, nos lecteurs eussent facilement reconnu, dans le prétendu Hartmann, le juif alsacien dont nous avons donné au commencement de notre récit, le signalement détaillé. C’était bien lui, en effet, mais dans une meilleure position que nous ne l’avons vu d’abord.
Le hasard s’était plu à le favoriser: rencontré par un compatriote qui cherchait précisément un second pour son industrie, il était d’abord entré à son service, et, quelques mois après, la mort de son patron lui avait permis de continuer les affaires pour son propre compte. Quant à la nature de ces affaires, elle était singulièrement obscure. Bien qu’il s’instituât maquignon, M. Hartmann ne vendait point de chevaux, mais il connaissait tous les cochers de grande maison, tous les jockeys, tous les valets d’écurie. Nul ne savait mieux que lui procurer le placement d’une bête tarée, créer une généalogie à un coureur vulgaire, assurer le gain d’un pari en corrompant les jockeys, ou en énervant, par quelque drogue, le cheval redouté. Ses relations étendues lui permettaient de joindre à cette spécialité quelques industries accessoires qui ne laissaient pas que d’avoir aussi leurs profits. Il pouvait, au besoin, faire parvenir une lettre jusqu’au fond de l’hôtel le mieux fermé, donner des renseignements sur les habitudes des maîtres, procurer un logement de passade, loué sous son nom dans quelque maison à double issue où l’on pouvait venir sans éveiller les soupçons, grâce à une affiche de dentiste ou de couturière. Il se chargeait enfin des emprunts sur gage ou de la fabrication des lettres anonymes destinées à servir les haines et les rivalités.
Cette université avait fait de Moser l’agent préféré de ce que la fashion avait de plus méprisable. C’était lui qui mettait en contact toutes les mauvaises passions, associait les vices et mariait les lâchetés.
Arthur l’avait employé plus d’une fois et avec profit; aussi ne balança-t-il pas à s’adresser à lui pour prendre des renseignements sur Marc.
Le juif comprit sur-le-champ de quoi il s’agissait; il demanda la lettre adressée au garçon de bureau, afin qu’elle lui servît d’introduction, et partit en promettant de faire diligence.
Mais au moment où il atteignait l’extrémité du faubourg Saint-Honoré, et où il allait tourner vers la Madeleine, il se trouva en face d’un homme en costume militaire qui à sa vue s’arrêta tout court: c’était Jacques le Parisien.
Tous deux s’étaient séparés peu après l’aventure de la forge des Buttes, et ils ne s’étaient point revus depuis.
Jacques entraîna l’Alsacien chez un marchand de vin du faubourg et monta avec lui à l’entresol, dans un cabinet séparé, afin de pouvoir causer plus librement.
Cinq jours après la rencontre du Parisien et de Moser, ce dernier ne s’était point encore présenté chez Marc, qui attendait avec une inexprimable impatience, la réponse de M. de Vercy. Craignant qu’elle n’arrivât en son absence, il avait même prétexté une indisposition pour ne point quitter la maison, en recommandant à M. Brousmiche de lui apporter sur-le-champ les lettres qui pourraient arriver à son adresse.
Cependant, ce jour-là, une autre préoccupation semblait avoir momentanément remplacé ses inquiétudes. Sorti plusieurs fois le matin, il venait de rentrer suivi d’un commissionnaire chargé, et il avait trouvé à la porte de la loge, Françoise, avec laquelle il échangea un signe d’intelligence, et qui remonta rapidement sur ses pas. M. Brousmiche lui-même ne tarda pas à les suivre, portant une vieille théière bleue à bec ébréché et trois tasses dépareillées avec lesquelles il gagna les mansardes.
Il était évident que quelque chose d’extraordinaire se passait dans le grenier du vieux Michel. On y entendait des pas qui se pressaient, des voix parlant vivement et des rires tantôt éclatants, tantôt étouffés.
L’absence du vieillard pouvait seule expliquer ces bruits inaccoutumés. Françoise, qui avait été forcée de sortir dès le matin, l’avait en effet prié de veiller à son logement, où l’on devait se présenter pour quelques réparations; et, trop heureux de pouvoir rendre à sa voisine ce léger service, M. Michel avait apporté chez elle ses papiers et s’était établi devant la grande table de la jeune fleuriste.
Il y était depuis plusieurs heures quand celle-ci rentra rouge, haletante, et les yeux brillants de gaieté.
—Ah! mon pauvre monsieur Michel, vous aurez cru que je vous avais oublié? s’écria-t-elle; comme vous avez dû vous ennuyer ici, tout seul!
—La solitude m’est familière, dit le vieillard, qui, à la vue de la jeune fille, avait déposé sa plume; j’étais d’ailleurs occupé.
—Encore à vos vilains chiffres, fit observer la jeune fille en jetant les yeux sur les états à colonnes rouges et noires que son vieux voisin achevait; mon Dieu! comment avez-vous pu vous accoutumer à un pareil travail, vous qui détestez les calculs?
—Ne savez-vous pas qu’il faut accepter ici-bas, non la tâche que l’on aime et que l’on sait remplir, mais celle que le hasard vous impose? dit le vieux voisin, avec une triste douceur; ces chiffres me font vivre: c’est un impôt que la faim prélève sur mes goûts et sur ma liberté. Quand je l’ai payé, je puis redevenir moi-même. En consacrant le jour entier à ce travail machinal et stérile, il me reste le soir pour la pensée. Je donne dix heures aux besoins de mon estomac et deux heures à ceux de mon âme. Combien d’autres sont moins heureux!
—C’est vrai, reprit la grisette; mais pour aujourd’hui, monsieur Michel, en voilà assez. Vous n’avez pas déjeuné, d’ailleurs.
—En effet, il doit être plus tard que d’habitude, si j’en juge par mon appétit.
—Vous avez appétit! Ah! tant mieux; donnez ces papiers, mon bon monsieur Michel, et remontons bien vite; j’ai tout préparé chez vous.
Elle avait pris les états et monta rapidement, suivie de M. Michel. Arrivée au logement de ce dernier, elle frappa en disant:
—C’est nous!
Et elle s’effaça de côté, pour laisser entrer le vieillard.
Celui-ci, étonné, franchit le seuil; mais à peine eut-il fait un pas en avant, qu’il s’arrêta stupéfait.
Il ne reconnaissait plus son grenier.
Les fentes du toit, qui laissaient autrefois paraître les tuiles, avaient été garnies de nattes proprement clouées; des rideaux de mousseline, à franges bariolées, ornaient l’étroite fenêtre, et un poêle de faïence tout allumé, derrière lequel apparaissait une petite provision de houille et de bois flotté, occupait un des angles. Enfin, sur une table dressée au milieu de la mansarde et garnie d’une nappe bien blanche, étaient servis plusieurs plats recouverts d’assiettes, au milieu desquels se dressait la cafetière ébréchée de M. Brousmiche. Ce dernier se tenait lui-même debout à quelques pas, le sourire sur les lèvres et son bonnet de soie à la main, tandis qu’un peu plus loin, Marc, appuyé au vieux fauteuil d’ébène, regardait alternativement M. Michel et Françoise.
En voyant la surprise de son vieux voisin, la grisette n’avait pu retenir une exclamation de joie.
—Il ne se doutait de rien! s’écria-t-elle, en battant des mains comme une enfant; il ne se doutait de rien. Oh! la bonne plaisanterie; mais vous ne devinez donc pas, monsieur Michel?... Ce sont vos étrennes!
—Mes étrennes! répéta le vieillard en la regardant; quoi! c’est aujourd’hui...
—Le premier de l’an! Vous ne le saviez pas! Oh! tant mieux. Mais ne trouvez-vous pas que nous avons bien employé notre temps? Voyez donc, il ne vous viendra plus de vent par le toit; il y a des nattes partout; c’est M. Marc qui les a posées; car M. Marc est pour sa part dans tout ceci; et M. Brousmiche aussi. Mais parlez donc, mon bon monsieur Michel, vous avez l’air tout drôle! Dites au moins que vous êtes content.
Le vieillard tendit la main à la jeune fille, puis à Marc, puis à Brousmiche, et une larme vint se suspendre à ses cils blanchis.
La jeune fille et le petit bossu ne purent voir cette émotion sans la partager.
—Allons, allons, ce que nous avons fait... ne vaut pas... tant de remerciements, dit Françoise d’une voix que l’attendrissement faisait trembler: M. Marc avait des économies... et moi aussi... en faisant bourse commune nous avons pu acheter les nattes d’abord et ensuite le poêle... car il n’est pas neuf le poêle, monsieur Michel, c’est une occasion, nous l’avons eu pour rien... et quant au bois, c’est M. Brousmiche qui a donné une partie de sa provision...
—J’en avais trop, interrompit vivement le bossu: foi d’homme, c’est un service que me rend M. Michel. Ça m’empêchera de chauffer la loge comme je faisais toujours, à la température du Sénégal. Madame Berton, la femme de ménage du pharmacien, m’a dit qu’il n’y avait rien de plus malsain pour Lolo et pour Fanfan.
—Ne cherchez donc pas à vous justifier, père Brousmiche, dit Marc, qui voyait que les explications augmentaient l’émotion du vieillard, nous avons fait à M. Michel une politesse de voisin, comme on en a le droit le premier janvier; voilà! Seulement, je le préviens que nous nous sommes invités à déjeuner avec lui, et s’il le permet, nous ne laisserons pas les plats refroidir davantage.
—Vous avez raison, mon ami, dit M. Michel avec un sourire au milieu duquel tremblaient encore des larmes. L’expression manque toujours à la reconnaissance sincère; pour les dons faits avec le cœur, le meilleur remerciement est d’en jouir. Aussi, ne craignez pas que j’affecte des regrets ou de l’humiliation. Vous avez voulu donner quelque aisance à un pauvre vieillard qui ne peut vous récompenser qu’avec sa joie, eh bien! soyez satisfaits, mes amis: il est heureux.
M. Michel se mit alors à parcourir son grenier transformé, à tout regarder en détail, à tout essayer avec l’empressement et les cris d’un enfant. Il ouvrit et ferma les rideaux, s’assura que la brise ne pouvait traverser les nattes qui tapissaient le toit, s’arrêta devant le poêle dont le ronflement annonçait l’activité, vint à la table, où les plats découverts par Françoise commençaient à répandre leur fumet appétissant; puis, son examen achevé, il le recommença avec le même plaisir.
La jeune fille riait, sautait et chantait de joie.
—Allons, c’est assez, monsieur Michel, dit-elle cependant au bout de quelque temps; vous reprendrez votre inventaire plus tard. Vite à table, car j’ai mille choses à faire après le déjeuner... D’abord il faut que j’écrive à Charles.
—Comment, ne viendra-t-il pas vous souhaiter une heureuse année? demanda le vieux voisin en s’asseyant dans le fauteuil que Marc lui avait avancé.
—Il est venu il y a trois jours, dit la jeune fille, qui prit également place à table avec le garçon de bureau et Brousmiche; il m’a même apporté mes étrennes... Une livre de dragées fines! vous en goûterez au dessert... Mais j’ai fait hier une rencontre qui pourra peut-être bien le servir.
—Quelle rencontre?
—Ah! c’est à l’Hôtel des Étrangers, vous savez, rue Richelieu. Madame Ouvrard m’avait commandé des fleurs pour les jardinières du salon, et en les lui apportant, j’ai rencontré, au parloir, un voyageur qui demandait l’adresse d’un monsieur Dufloc, qui s’occupe de banque à ce qu’il paraît; mais il n’a pu le trouver dans l’Almanach du commerce. Vous le connaissez peut-être, vous, monsieur Marc?
—Non, répondit le garçon de bureau.
—Ni moi, mais madame Ouvrard qui, en venant un soir, pour me faire une commande, a vu Charles chez moi, et à qui j’ai été obligée de dire qui il était, ce qu’il faisait... et que nous étions mariés... Madame Ouvrard s’est tout rappelé sur l’instant; elle a répondu que mon mari était commis chez un banquier, et qu’il pourrait peut-être donner l’adresse de M. Dufloc.
—Et l’étranger vous a prié de la lui demander?
—Oh! pas seulement cela! il m’a beaucoup interrogé sur Charles, il a voulu savoir où il travaillait, ce qu’il gagnait, et il a fini par me dire qu’il désirait le voir, qu’il pourrait peut-être le charger d’une affaire qui lui rapporterait beaucoup d’argent. Vous comprenez que j’ai écrit tout de suite à Charles, mais il ne m’a pas répondu, et c’est pourquoi je vais lui adresser une seconde lettre...
—Mille excuses, mademoiselle Françoise, interrompit Brousmiche en dressant la tête; mais il me semble entendre quelqu’un dans l’escalier... J’ai confié le cordon à madame Breton, et j’ai peur que par manque d’habitude elle laisse monter du public peu délicat... Vous m’excuserez si je vérifie par mes yeux...
Tout en parlant le bossu avait gagné la porte qu’il ouvrit.
—Que demande Monsieur? dit-il de l’entrée, en apercevant un homme en veste sur le palier inférieur.
—Monsieur Marc est donc sorti? dit l’inconnu qui montrait la chambre du garçon de bureau.
—Faites excuse, reprit le bossu, il a le plaisir d’être ici en société; et je vais avoir celui de l’avertir...
Mais le visiteur ne lui en donna pas le temps; il franchit l’escalier, repoussa hardiment la porte entrebâillée et se trouva en face des convives.
—Il paraît que ça va mieux, dit-il gaiement, en portant la main à sa casquette.
—Tiens, le Furet! s’écria le garçon de bureau.
—A votre service, monsieur Marc, dit le nouveau venu qui, comme par habitude, promena autour de lui un regard rapide afin de prendre connaissance des lieux, je venais pour vous voir et vous la souhaiter bonne et heureuse.
—Merci, mon garçon, dit Marc en se levant et allant au Furet; je te retourne le souhait.
—Trop honnête, monsieur Marc, j’étais aussi chargé par le patron de savoir si vous étiez moins souffrant...
—Tu avais quelque chose à me dire de sa part? demanda le garçon de bureau plus bas.
—Non, dit le Furet qui échangea avec lui un regard significatif; il n’y a rien de neuf, si ce n’est qu’on aurait besoin de vous au bureau pour trouver l’adresse... d’un mauvais payeur.
—J’irai demain.
—Ça suffit, monsieur Marc, je vous souhaite bon appétit alors, ainsi qu’à la compagnie, bien du plaisir et à l’avantage...
Il allait regagner la porte où M. Brousmiche continuait à se tenir, lorsque Françoise s’entremit.
—Monsieur ne partira pas sans boire à notre santé, dit-elle en se levant pour chercher un verre, priez-le donc de rester un instant, monsieur Marc.
—C’est juste, reprit le garçon de bureau, avance ici, Furet; c’est du bordeaux... et du bouché!
—Pardon, excuse, dit le Furet, c’est que j’ai déjà déjeuné avec le gros Georges.
—N’importe, n’importe, insinua M. Brousmiche, qui, à l’invitation de Françoise avait refermé la porte; le bordeaux est comme le lézard, c’est un ami de l’homme. Aussi les anciens l’avaient appelé le lait des vieillards. Approchez, Monsieur, je vous en prie.
Le Furet céda, on s’excusant, prit le verre que Françoise lui offrait et s’approcha de la table.
M. Michel, qui était resté jusqu’alors étranger à la conversation, se leva la bouteille à la main pour lui verser à boire; mais à sa vue, le Furet demeura le bras tendu, les yeux grands ouverts, et comme pétrifié par la surprise.
—Qu’as-tu donc? demanda Marc.
—Ce que j’ai, répéta l’homme à la veste, dont les regards restaient attachés sur le vieillard, c’est que... il me semble... oui... je ne me trompe pas... j’ai déjà vu monsieur.
—Moi, dit M. Michel en souriant, et quand cela?
—Dans le temps que j’étais gardien à Vanvres.
M. Michel reposa la bouteille sur la table.
—Vous avez été gardien?... s’écria-t-il.
—A Vanvres, répéta Marc; il n’y a là qu’une maison de fous...
—Monsieur avait le numéro 121, répliqua le Furet.
Le vieillard se laissa retomber sur son fauteuil. Françoise, Marc et le bossu demeurèrent stupéfaits.
—Vous ne vous étiez donc aperçu de rien? reprit le Furet plus bas, en regardant M. Michel; au fait, il a de bons moments; c’est ce qui fait qu’on le surveillait moins et qu’il en a profité pour s’échapper.
—Quoi! s’écria Françoise en joignant les mains, il serait possible! M. Michel pourrait... M. Michel aurait été... Non, il faut que vous le preniez pour un autre.
—Il ne me prend point pour un autre, dit le vieillard avec amertume. Oui, mes amis, cette raison dont vous avez cru que je jouissais, la justice l’a déclarée absente! Celui que vous regardiez comme votre égal n’est qu’un fou échappé de sa loge et qu’un mot peut y ramener.
—Mais comment cela a-t-il pu se faire? demanda Françoise anxieuse.
—Ah! ce serait un long récit, chère enfant, dit M. Michel, il faudrait vous raconter l’histoire de toute ma vie.
—Si on la connaissait, on trouverait peut-être moyen de faire réparer l’erreur commise à l’égard de M. Michel, fit observer Marc.
Le vieillard secoua la tête.
—Il n’y a point eu d’erreur commise, dit-il tristement; aux yeux du monde dans lequel nous vivons, ce qui a été fait est bien fait. Mais votre bonté pour moi vous a donné droit de savoir qui je suis. La confiance est la seule générosité que puissent faire les malheureux. Écoutez-moi donc et vous me jugerez ensuite.
Tous les convives reprirent leurs places; le Furet alla chercher une chaise dépaillée, sur laquelle il s’assit, et le vieillard commença.
L’histoire que j’ai à vous raconter, dit-il, pourrait se résumer en quelques phrases, car elle ne renferme guère que des observations. La vie d’un philosophe n’est point celle d’un aventurier, et le drame pour lui est dans les idées bien plus que dans les incidents; mais j’ai promis de me faire connaître à vous, et, pour cela, j’ai besoin de dire par quelle série de faits et d’inductions j’ai pu être conduit à devenir ce que je suis. Peut-être ces détails, qui ont tant d’intérêt à mes yeux, n’en auront-ils que médiocrement aux vôtres. Si je vous fatigue, songez qu’un vieillard ne peut repasser par les chemins qu’il a parcourus depuis trente années sans s’arrêter à certaines places. Cette revue du passé, que je commence à votre intention, je la prolongerai peut-être pour moi-même. Le flot des souvenirs m’emportera, et je pourrai oublier les auditeurs; mais les auditeurs sont des amis, ils se montreront indulgents.
—Dites qu’ils seront trop heureux de vous écouter, reprit Françoise, en remplissant le verre de son voisin et le plaçant à portée de sa main. Racontez à votre manière, allez, mon bon monsieur Michel. On sait bien que des ignorants comme nous ne peuvent pas tout comprendre; mais ça fait toujours du bien de se décharger le cœur. Il y a des instants, moi, où je dirais mes projets et mes chagrins à mes fausses fleurs; faites de même et ne vous inquiétez de rien. Dès que ça vous intéresse, ça ne pourra pas manquer de nous faire plaisir.
Le vieillard adressa à la grisette un sourire attendri et commença:
—Il est des destinées qui s’annoncent de loin, et que l’homme peut deviner dès son enfance; dans la mienne, au contraire, tout a été imprévu. Né, en 1774, d’une des familles les plus riches et les plus titrées de la Touraine, je fus élevé par ma mère qui était veuve, dans le château dont nous portions le nom, sans rien savoir des troubles qui commençaient à agiter la France, et préparaient la grande Révolution de 89. Uniquement appliquée aux œuvres de charité, ma mère vivait étrangère à tous les événements publics, et moi-même mes occupations les plus sérieuses étaient la chasse ou les travaux de mon atelier de tourneur, établi dans une des salles du château. Pour récréations, j’avais les promenades à cheval et les visites aux fermiers; car la noblesse campagnarde de nos provinces ne vivait point à l’exemple de celle des villes, éloignée du peuple qui rendait en haine ce qu’on lui donnait en mépris; loin de là, mêlés à nos paysans, nous les regardions comme une part de notre existence. C’étaient de vieux serviteurs dont les pères avaient connu nos pères, dont les fils avaient grandi avec nos fils; nous les connaissions tous par leurs noms, nous savions l’histoire de chacun d’eux; nous étions leur recours dans toute disgrâce, comme ils étaient notre appui dans tout besoin, et cet échange de services avait établi entre le noble et le vassal une solidarité qui les liait toujours d’habitude et souvent d’affection.
Cependant, lorsque la Révolution éclata, ma mère, entraînée par l’exemple de la noblesse du voisinage qui passait à l’étranger, se décida à me faire partir pour l’Allemagne. En arrivant à Coblentz, j’y trouvai un de mes parents: c’était un cousin du même âge que moi, et qui, n’étant point encore chef de nom et d’armes, se faisait appeler alors le chevalier de Rieul. Il s’était lancé dans ces intrigues de cour par lesquelles l’émigration espérait arrêter l’expansion victorieuse de la république. Il me présenta aux chefs du parti royaliste, mais leurs projets et leurs prétentions me causèrent, dès le premier entretien, une surprise mêlée de répulsion. Élevé dans la pratique d’une égalité presque fraternelle, rien n’avait altéré la droiture de ma raison, et les hommes étaient restés pour moi des créatures diversement douées mais pétries du même limon. Les principes révolutionnaires contre lesquels mes compagnons s’indignaient, étaient précisément dans mon esprit, sans y avoir jamais pensé; je croyais ce qu’ils repoussaient, et je repoussais ce qu’ils voulaient défendre; évidemment le hasard m’avait mal guidé: je m’étais trompé de camp!
Je ne songeai donc qu’à regagner au plus tôt la France, et les événements ne tardèrent pas à m’y aider.
La Prusse et la Hollande s’étaient résignées à la paix après la bataille de Fleurus; le règne de la Terreur venait de cesser, le Directoire favorisait ouvertement la rentrée des proscrits; je me préparais à profiter, avec une partie de la noblesse, de cette clémence inespérée, lorsque j’appris la mort de ma mère. Cette affreuse nouvelle hâta mon départ. Je quittai précipitamment Vienne, suivi de mon cousin, et nous arrivâmes ensemble à Paris.
Le premier soin du chevalier fut de faire effacer nos noms des listes d’émigrés, et de réclamer les biens de sa famille, qui, par un heureux hasard, n’avaient point été vendus. Quant aux miens, ils étaient perdus sans retour. Les bois que nous possédions dans le Poitou avaient été abattus; les fermes de Bretagne morcelées et acquises par différents propriétaires; enfin, le domaine de la Brisaie acheté par un citoyen Michel sur lequel on ne put me donner aucuns renseignements.
Mais en livrant à un autre le château de mes pères, la nation n’avait pu lui vendre mes souvenirs; ce sol qui ne m’appartenait plus n’en restait pas moins le théâtre de mon passé, et j’étais toujours sûr d’y trouver le coin de terre où ma mère reposait. Je ne pris donc aucune autre information, et je partis pour la Touraine.
Quand j’atteignis le bourg de Preuilly, auquel touchait la terre de la Brisaie, le jour commençait déjà à tomber. Je traversai le village rapidement; mais, arrivé aux dernières maisons, je m’arrêtai, le cœur oppressé d’une inexprimable angoisse. Je venais de parcourir un pays ravagé où je n’avais vu que futaies détruites, champs en friche et maisons incendiées! Dans quel état allais-je trouver notre ancien domaine? Le château existait-il encore, et, s’il existait, le nouveau propriétaire me permettrait-il d’y entrer? Voulant m’éclairer à cet égard, je m’approchai d’une vieille femme qui filait près de sa porte, et je lui demandai la route du château.
—Tout droit devant vous, répondit-elle sans lever les yeux.
A cette réponse, mon cœur battit de joie.
—Et peut-on le visiter? ajoutai-je.
—Pourquoi non? répliqua la vieille.
—Alors M. Michel ne l’habite pas?
—M. Michel! répéta-t-elle, en me regardant, que veut le citoyen à M. Michel?
—Je désirerais le voir et lui parler.
—Alors que le citoyen passe son chemin; ce n’est pas ici la porte du château.
Je m’éloignai surpris de la brusquerie de la vieille femme, et m’adressai, un peu plus loin, à un jeune garçon d’une quinzaine d’années, qui répondit avec un empressement jovial à mes premières questions: mais à peine eus-je prononcé le nom de M. Michel, que sa figure changea d’expression; il me regarda d’un air défiant, tourna les talons et disparut derrière la dernière maison du village.
Je demeurai encore plus étonné que la première fois, et ne sachant que penser de cette visible répugnance des vieillards et des enfants à parler du nouveau propriétaire de la Brisaie.
Cependant, je continuai ma route et j’arrivai devant la grande avenue.
Rien n’avait été changé. C’était la même barrière verte ombragée par deux tilleuls; les mêmes poteaux ornés de lions de pierre; la même allée de frênes au bout de laquelle s’élevait le château. Celui-ci m’apparut bientôt de plus près, éclairé par le soleil couchant. Tout y était dans le même état qu’au moment où je l’avais quitté. Le même pied de biche, incrusté d’acier, pendait à la chaîne de la cloche d’entrée; le même banc sur lequel s’asseyaient les vieillards, se dressait au-dessous. Je revoyais la petite porte par laquelle ma mère s’échappait, le matin, pour visiter les malades du voisinage, et je reconnaissais son seuil usé, sa serrure dépeinte par l’usage. J’appuyai le doigt sur le ressort secret qui la faisait agir; la porte s’ouvrit et je me trouvai dans la cour.
Là tout était également à sa place: les vignes, soigneusement taillées, encadraient les fenêtres du rez-de-chaussée; les rosiers du Bengale, mêlés aux jasmins blancs, ombrageaient, comme autrefois, le grand puits; les mêmes caisses d’orangers étaient disposées le long du perron. Pas un brin d’herbe dans les allées sablées, pas une mousse sur les seuils! tout sentait l’habitation sans que rien annonçât le propriétaire nouveau.
Comme j’arrivais près du portail, un chien sortit de la niche de pierre: c’était Fingal, notre ancien gardien; il ne me reconnut pas, sans doute, car ses aboiements attirèrent à la porte du pavillon d’entrée une jeune paysanne qui me demanda ce que je voulais.
Je fis quelques pas pour lui répondre; mais en m’apercevant de plus près, elle joignit les mains.
—Que Dieu nous aide! c’est le jeune maître! s’écria-t-elle épouvantée.
—Comment le savez-vous? demandai-je tout surpris.
—Oh! c’est lui! répéta la jeune fille sans me répondre et en regardant autour d’elle; Jésus! par où est-il venu?
Je lui appris que j’avais ouvert la petite porte.
—Et personne ne vous a vu? ajouta-t-elle.
—Personne.
—Entrez, alors, entrez vite. Quel malheur, mon Dieu! que le vieux père soit sorti.
Je l’avais suivie dans une pièce basse que je reconnus pour le logement du gardien Antoine. Je me rappelai alors tout à coup que ce dernier avait chez lui une petite fille, encore enfant lors de mon départ, et je me retournai vivement vers mon interlocutrice.
—Est-ce possible que vous soyez Mariette! m’écriai-je.
—Ah! vous n’avez donc pas oublié mon nom? monsieur Henri, dit-elle en souriant et rougissant à la fois.
Je courus à elle, je lui pris les deux mains et je la regardai en répétant:
—C’est Mariette! Mariette qui m’apportait tous les dimanches du pain béni... que j’asseyais sur mon cheval pour remonter l’avenue... à qui ma mère apprenait à lire!...
Et tout ému à ces souvenirs, je l’embrassai avec autant de joie et de tendresse que si j’eusse trouvé une jeune sœur.
La pauvre fille se mit à pleurer.
—Ah! monsieur Henri est bien bon de se rappeler tout cela, dit-elle, quel bonheur que monsieur Henri soit revenu en bonne santé!
—Ainsi, vous n’avez point quitté le château, repris-je: le père Antoine est toujours gardien?
—Toujours, monsieur Henri.
—Et vous êtes contents de votre nouveau maître, M. Michel?
Mariette tressaillit.
—Ne prononcez pas ce mot-là, dit-elle tout bas, vous surtout... On pourrait soupçonner...
—Quoi donc? demandai-je, subitement ramené au souvenir de ce qui m’était arrivé en traversant le village.
—Rien, rien, dit précipitamment la jeune fille; le mieux est de se taire... D’autant que voici quelqu’un, écoutez!
Fingal venait en effet d’aboyer; et, en regardant par la fenêtre, nous aperçûmes le père Antoine qui traversait la cour avec un homme vêtu d’un large pantalon et d’une carmagnole bleue.
—Seigneur! dit Mariette effrayée, c’est le municipal; il va vous arrêter s’il apprend qui vous êtes!
Mais il en était déjà instruit. Je m’étais heureusement muni, en quittant Paris, de toutes les pièces qui prouvaient ma radiation de la liste des émigrés. Je les présentai à l’agent de la commune, qui les trouva en règle et me complimenta sur mon heureux retour, en ajoutant que le château était justement vide pour le moment, et que je pourrais encore me regarder comme chez moi.
—M. Michel n’est donc point ici? demandai-je.
—Il doit arriver... dans quelques jours, répliqua Antoine avec embarras.
—Mais, en attendant, le citoyen Henri pourra reprendre possession de son ancienne chambre, fit observer le municipal; il la trouvera absolument telle qu’il l’a laissée.
—Est-ce vrai? m’écriai-je; je veux la voir alors; et si Antoine pense, qu’en effet, je puisse attendre ici le retour de son nouveau maître?...
—Certainement, il n’y a pas d’empêchement, dit timidement le vieux gardien.
—Alors, je reste! m’écriai-je.
Et, sans rien écouter davantage, je m’élançai vers l’escalier, je franchis le corridor et j’arrivai à l’appartement de ma mère qui précédait le mien.
Je craindrais d’allonger ce récit outre mesure, mes amis, si je voulais vous dire tout ce que j’éprouvai dans cet instant et pendant les heures qui le suivirent. Pour comprendre de pareilles émotions, il faut avoir traversé l’exil et trouver, au retour, une de ces maisons vides où les souvenirs sont des regrets.
Antoine était retourné au village pour reprendre les papiers que j’avais dû confier au municipal; je m’étais enfermé, et je passai une partie de la nuit à parcourir ces chambres désertes, où chaque place, chaque objet me parlait de ma mère! enfin, la fatigue l’emporta; je m’endormis.
Il faisait jour depuis longtemps lorsque je fus réveillé par la voix de Mariette, qui me demandait à travers la porte, si je voulais recevoir les fermiers. Je compris qu’Antoine les avait avertis et qu’ils venaient pour féliciter leur ancien maître.
Je les trouvai, en effet, réunis dans la salle d’attente avec le vieux notaire, M. Leroux. A ma vue, celui-ci tendit les deux bras..
—Le voilà, s’écria-t-il; c’est bien lui, mes amis, Dieu nous a écoutés!
Tous les paysans poussèrent une exclamation joyeuse, en prononçant mon nom. Je courus à M. Leroux que j’embrassai, puis à tous les fermiers, auxquels je serrai la main, l’un après l’autre. Il y eut un moment de confusion et d’attendrissement général. Ils m’adressaient, tous à la fois, les mêmes questions. Enfin pourtant le notaire parvint à leur imposer silence.
—Par la sangoi! nous sommes dans la tour de Babel, dit-il, en mettant sa canne entre les paysans et moi; on vous prendrait pour un club de vieilles femmes; voyons, citoyens cultivateurs, c’est assez fraterniser! il ne faut pas fatiguer le jeune gars.
Je l’interrompis en assurant que l’empressement de ces braves gens ne pouvait me fatiguer et que j’étais touché jusqu’au fond de l’âme de leurs témoignages d’affection.
—Oh! pour de l’affection, ce n’est pas ce qui leur manque, reprit le notaire gaiement, et ils en ont donné des preuves. Quand on a voulu vendre le domaine, tous sont venus me trouver en m’apportant leurs économies, pour qu’on le rachetât en votre nom.
—Se peut-il? m’écriai-je attendri.
—Malheureusement la chose était impossible, continua maître Leroux. N’ayant plus, comme émigré, le droit de posséder, vous aviez perdu, à plus forte raison, celui d’acquérir. Ils voulurent alors acheter, sous leurs propres noms, les fermes et le château; mais je leur fis observer que l’on soupçonnerait infailliblement leur intention, et qu’ils s’exposeraient à mille persécutions, aussi renoncèrent-ils à leur projet.
—Et ce fut alors que le citoyen Michel se présenta comme acquéreur! demandai-je.
—C’est-à-dire que je me présentai pour lui, répliqua le notaire.
—Vous, maître Leroux!
—Moi, cher monsieur Henri, et aussitôt l’acquisition faite, j’eus soin de publier partout que ledit citoyen Michel était un des plus chauds sans-culottes de Paris, ami intime de ce qu’il y avait de mieux dans le gouvernement, et en position de faire regarder comme un partisan de Pitt et de Cobourg quiconque prétendrait vexer ses fermiers.
—Et le moyen vous a réussi?
—Assez bien pour que tous les gens du domaine aient été à l’abri des visites domiciliaires, des impôts forcés et des réquisitions.
Les paysans confirmèrent le fait d’une voix unanime.
—Aussi j’espère, reprit le tabellion d’un air riant, que M. Henri sera satisfait de l’état dans lequel il retrouvera la Brisaie.
—Satisfait pour vous, mes amis, répondis-je un peu étonné du manque de tact de maître Leroux; mais il faut surtout en féliciter le citoyen Michel...
—Au diable le citoyen Michel! s’écria le notaire avec un geste de folle gaieté; il n’y en a plus! le terrible sans-culotte était un homme de paille que nous pouvons brûler maintenant; le vrai Michel c’est nous tous, ou plutôt c’est vous seul, monsieur Henri, vous à qui nous avons eu le bonheur de rendre sans retard et sans dommage ce qui lui appartient.
Maître Leroux m’apprit alors comment il avait eu l’idée de racheter la Brisaie avec l’argent des fermiers, pour un patriote supposé dont il avait fait un épouvantail, et cette explication me fit comprendre l’impression produite par le nom de M. Michel sur les gens du pays. Ceux qui croyaient à son existence n’osaient en parler de peur de se compromettre, et ceux qui étaient dans le secret gardaient le silence de peur de se trahir.
Je n’ai pas besoin de vous dire quel avait été mon étonnement, puis quelles furent ma reconnaissance et ma joie: Je ne pus que serrer encore une fois la main à ces braves gens en les remerciant, moins avec des paroles qu’avec des larmes. Mais, à ce moment même, je sentis naître en moi le ferme désir de reconnaître ce bienfait par le dévouement de ma vie entière; c’était comme un défi de générosité jeté à mon âme. Je résolus de me montrer aussi généreux, aussi bon pour tous les hommes que quelques hommes venaient de se montrer pour moi.
Ce ne fut d’abord qu’une sensation, un élan, mais qui se transforma bientôt en une résolution réfléchie. On ne tient pas assez compte, dans l’éducation, de l’influence des premiers événements qui nous révèlent sérieusement les hommes. A notre apparition dans le monde, nous ressemblons tous à ces curieux qui se précipitent instinctivement vers l’entrée que prend la foule. La vie se présentait à moi par le côté du dévouement, je dirigeai mon activité vers cette porte, sans trop savoir d’abord jusqu’où elle me conduirait.
Ma première idée fut de regarder autour de moi et de chercher quel bien je pouvais faire à ceux qui m’entouraient.
Je fus frappé, dès le premier coup d’œil, de tout ce qui leur manquait. Beaucoup de terres restaient en friche; les routes étaient mal entretenues; les édifices d’exploitation insuffisants, mal placés; il y avait des prairies arides, d’autres noyées sous les eaux; partout les richesses du sol se trouvaient inutiles ou mal exploitées. Je fis part de mes observations à maître Leroux qui plia les épaules.
—Cela doit être, dit-il; tout travail d’amélioration exécuté par les fermiers n’aurait pour résultat que d’élever le prix du prochain bail. Nos paysans le savent et se contentent de vivre sur la terre louée, sans se soucier d’une augmentation de valeur qui amènerait une augmentation de redevance. Telle est chez nous la constitution de la propriété, que les dépenses et l’industrie ne tournent qu’au profit du propriétaire. La part est ainsi faite à chacun: celui qui exécute tout, n’a rien; celui qui n’exécute rien, a tout! et l’on s’étonne, après cela, que nos paysans se montrent indifférents à tout perfectionnement; qu’ils persévèrent dans leur routine; qu’ils cultivent au jour le jour; comme si ce n’était pas pour eux prudence et nécessité.
Je demandai au vieux notaire quels remèdes il voyait au mal, et il me parla d’avances faites aux cultivateurs par des caisses agricoles, de baux à longs termes, enfin de ces domaines congéables, en usage dans certaines provinces, et au moyen desquels le fermier, devenu propriétaire de superficies, ne pouvait être renvoyé qu’après paiement de toutes les améliorations accomplies par lui.
Je réfléchis longtemps à ces moyens, et des idées toutes nouvelles s’éveillèrent en moi.
Je fis d’abord, avec les fermiers de la Brisaie, de nouvelles conditions qui, en leur assurant les bénéfices de toute amélioration, donnaient une prime d’encouragement à l’intelligence et au zèle. Je leur procurai les avances de fonds nécessaires; je rétablis les routes; je bâtis des greniers pour les récoltes.
Mais, après avoir songé aux instruments matériels de l’exploitation, restait à s’occuper des instruments humains. Il fallait distribuer les emplois, régulariser les activités, car, à la Brisaie comme ailleurs, tout était laissé au hasard. Je m’efforçai de mettre chacun à sa place. L’un des fermiers avait un fils qui avait combattu deux ans dans les bandes du Maine commandées par Jambe-d’Argent. Ennemi de tout travail, il passait sa vie dans les fourrés, adonné au braconnage et souvent assailli de mauvaises pensées; je le fis venir; je lui proposai une des places de forestier, et le vagabond dangereux devint le gardien le plus vigilant du domaine. La fille d’Antoine, Mariette, était causeuse, alerte, avenante, mais peu disposée aux travaux sédentaires de la maison; j’engageai les fermiers à lui confier les denrées qu’ils envoyaient chaque jour au marché voisin, et la médiocre ménagère devint marchande habile. Une pauvre veuve, affaiblie par la maladie, languissait misérable et inutile; j’en fis une surveillante pleine de sollicitude pour les petits enfants qui ne pouvaient suivre leurs mères aux travaux des champs; enfin, il y avait au village un jeune orphelin auquel l’ancien curé avait autrefois donné des leçons à fin d’en faire un prêtre, et qui, pris de passion pour l’étude se refusait à toute autre occupation; je le chargeai de présider aux veillées des paysans, de leur raconter, de vive voix, ce que les livres lui avaient appris, de tenir leurs sentiments et leur intelligence en éveil, d’être enfin, pour eux, une sorte de bibliothèque vivante et de professeur journalier qui pût les intéresser et les instruire.
Une foule d’autres aptitudes sans emploi furent ainsi utilisées successivement. Je trouvai un commis pour la comptabilité des exploitations agricoles, un mécanicien pour le perfectionnement des outils, un maître d’école pour les enfants.
Ceux-ci se réunissaient en hiver, dans une salle bien chauffée, que je leur avais fait préparer, et qu’ornaient des modèles d’instruments, des gravures, des échantillons de produits formant une sorte de musée agricole. En été, ils s’établissaient sous une tente, au haut d’un tertre, entouré de haies vives, et au pied duquel coulait une fontaine: là, les leçons étaient données sous le ciel, parmi les chants des pinsons et les senteurs de menthes et d’églantines. Les charrettes, en revenant le soir des prairies, passaient près de l’école en plein air, et prenaient les plus petits enfants qui arrivaient aux fermes éloignées, couchés sur l’herbe fleurie.
Ainsi, la prospérité de chacun aidait à la prospérité de tous, et les cœurs devenaient plus confiants et plus tendres dans cette atmosphère de joie; car il n’y a que le bonheur injuste qui déprave; celui que l’on a mérité par ses œuvres améliore et encourage; il est comme une manifestation visible de l’équité de Dieu.
Ces succès joints à des études longtemps poursuivies, me faisaient entrevoir le système d’association humaine que je devais compléter plus lard. La mauvaise organisation de l’ordre social établi commençait à me frapper; je crus qu’il était de mon devoir d’appeler l’attention des hommes de bonne volonté sur les transformations déjà accomplies à la Brisaie, et sur celles que le temps devait amener; je fis imprimer une Adresse aux propriétaires français, dont je répandis les exemplaires à profusion.
J’attendais le résultat de cet appel avec une certaine impatience, lorsque l’arrivée de mon cousin vint m’arracher à cette préoccupation.
Depuis son retour de l’émigration, le chevalier s’était fixé à Tours, où sa fortune, son nom et ses habitudes lui avaient bientôt acquis une des premières places dans la jeunesse dorée du pays. Or, ceux qui n’ont point habité la province à cette époque, ne peuvent même soupçonner ce qu’était la jeunesse oisive de l’Empire. Recrutée dans cette portion de la noblesse qui avait refusé de se rallier au mouvement national, dans la bourgeoisie assez riche pour acheter coup sur coup plusieurs remplaçants, et dans quelques familles privilégiées, que la complaisance d’un préfet ou la corruption d’un chirurgien militaire affranchissait de la conscription, elle se trouvait presque uniquement composée des égoïstes, des corrompus et des lâches que la grande contagion de la gloire n’avait pu entraîner, et qui, au milieu de cette tempête de fortes ambitions et de généreux courages, avaient, maintenu à tout prix leur inutilité malfaisante. Régnant despotiquement dans les villes dépeuplées d’hommes, ces élus se livraient sans réserve aux plus monstrueux excès, et, tandis que le reste de la nation dépensait sa force à combattre l’Europe coalisée, on les vit employer la leur à essayer des vices et à inventer des orgies.
Celles-ci, du reste, étaient presque des batailles. On les avait vus chancelants et aveuglés par l’ivresse, tirer le pistolet en prenant un de leurs compagnons pour but, ou s’élancer par une fenêtre et broyer leurs membres sur le pavé. A Tours, une société formée sous le nom de tribu de Caraïbes, avait entrepris de vivre à la sauvage dans une des îles de la Loire. Hommes et femmes y passaient les journées sans autres vêtements que l’air du ciel, courant parmi les herbes, se poursuivant dans le fleuve, buvant et dansant sous les saulaies. Quelques-uns imaginèrent enfin, à la suite d’une orgie et pour porter plus loin l’imitation, de lier au poteau un des Caraïbes et de l’entourer de feu, en l’engageant à répéter son chant de guerre. Les cris du patient attirèrent heureusement des pêcheurs, qui le délivrèrent et le reconduisirent chez ses parents à demi-mort[C].
Mais, cette fois, les plaintes de la famille réveillèrent l’autorité; on commença une enquête, on parla d’arrestations, et le chevalier, qui avait été un des acteurs les plus compromis dans cette folle saturnale, s’effraya et prit la fuite.
Il arriva à la Brisaie, où il me demanda de le cacher. Quelle que fût ma répugnance, je dus l’accueillir; mais le lendemain de son arrivée, une escouade de gendarmerie se présenta accompagnée du procureur impérial.
A leur entrée, le chevalier avait pâli et s’était levé. Un des magistrats s’avança vers nous, en demandant le maître de la maison. Je me nommai, il fit signe à tout le monde de se retirer, ordonna de garder les issues, et nous restâmes seuls.
Le juge d’instruction s’était assis devant une table, des papiers à la main; mon cousin, saisi, se tenait en arrière et caché dans l’ombre: je me trouvais seul debout devant le procureur impérial.
C’était un homme grand, sévère, magistral, dont tous les mouvements révélaient la haute opinion qu’il avait de ses fonctions et de lui-même. Il me regarda avec gravité et dit d’une voix solennelle:
—Je viens remplir un devoir pénible, Monsieur, d’autant plus pénible que je dois l’exercer contre un homme qui, par son rang et son éducation, semblait destiné à soutenir le bon ordre au lieu de le troubler.
Je m’inclinai sans rien trouver à répondre en faveur du chevalier.
—J’ai lieu de croire, du reste, ajouta le procureur impérial, en remarquant mon silence, que notre visite à la Brisaie était prévue.
—Je dois avouer que je la craignais, répliquai-je.
—Ainsi, vous aviez conscience de la culpabilité de l’acte commis? reprit-il.
Je répondis avec embarras, mais affirmativement.
Les deux magistrats se regardèrent.
—C’est une franchise digne de celui qui a écrit l’Adresse aux propriétaires français, dit le juge d’instruction d’un accent railleur. Elle ne sort pas moins des habitudes que son livre.
—Vous l’avez lu? demandai-je avec l’empressement d’un auteur convaincu, qui désire connaître l’effet produit par son œuvre.
—Oui, Monsieur, dit le procureur impérial en s’avançant vers moi, et la preuve, c’est que nous venons au nom de la loi pour en arrêter l’auteur.
Le chevalier ne put retenir un cri d’étonnement. Je regardai les deux magistrats, persuadé que j’avais mal entendu.
—Vous venez m’arrêter? répétai-je.
—Comme prévenu d’avoir imprimé un écrit pouvant nuire à la sûreté de l’État, continua le juge d’instruction; crime prévu par l’article 102 du Code pénal.
Le coup était si inattendu que je restai d’abord muet. Enfin, revenu de ma première surprise, je me fis répéter l’accusation, et je voulus savoir ce que l’Adresse aux propriétaires français pouvait avoir de dangereux pour la sûreté de l’État.
—Vous le demandez? s’écria le procureur impérial, avec une sorte d’indignation; quand vous y proclamez hautement votre horreur pour la guerre et pour les conquérants... ce qui est une attaque évidente contre Sa Majesté l’Empereur et un plaidoyer indirect contre la conscription; quand vous déclarez que la propriété n’est pas constituée au profit du plus grand nombre... ce qui est une invitation à changer les lois qui la régissent; quand vous proclamez enfin la nécessité d’institutions qui n’ont été ni votées par le corps législatif, ni promulguées par le sénat conservateur, ni recommandées par les décrets impériaux. On ne saurait réprimer trop sévèrement, Monsieur, des déclamations qui tendent à faire croire au peuple français qu’il lui manque quelque chose, et le devoir de tous les magistrats est de combattre ceux que Sa Majesté l’Empereur a si justement flétris du nom d’idéologues.
Je voulus répondre; mais comme tous les accusateurs publics qui trouvent qu’il n’y a plus rien à dire quand ils ont fini de parler, il m’interrompit en déclarant que le moment de plaider la cause n’était point venu. Le juge d’instruction ajouta que j’avais reconnu moi-même l’existence du délit en avouant que je craignais leur visite. Je dus alors expliquer comment je l’avais cru provoquée par la présence du chevalier. Les regards des deux magistrats se dirigèrent vers ce dernier.
—Ah! je comprends, dit le procureur impérial; le mandat d’amener allait, en effet, être signé, lorsque Monsieur a quitté Tours, heureusement pour lui que le jeune Destouches se trouve hors de danger, et que ses parents ont retiré leur plainte.
Le chevalier fit un geste de joie.
—Le ministère public pouvait néanmoins poursuivre, continua le magistrat; mais il eût fallu compromettre des noms estimés, affliger des familles honorablement placées, nous avons cru qu’il était plus sage d’étouffer tout débat et d’éloigner la personne compromise.
—M’éloigner, répéta le chevalier inquiet, comment cela, Monsieur?
—En quittant le pays sans retard, reprit le procureur impérial; notre indulgence est à ce prix.
Le chevalier déclara qu’il partirait le jour même, et sortit précipitamment.
Après de longues perquisitions faites dans le château et la saisie de mes papiers, on me fit monter, avec deux brigadiers, dans une voiture fermée autour de laquelle se rangèrent les gendarmes.
En quittant l’avenue du château, j’aperçus le chevalier qui, penché à la portière de sa calèche de voyage, me fit un signe d’adieu.
Il prenait libre et joyeux la route de Paris, tandis qu’on m’emmenait prisonnier à Tours.
Ici Françoise qui avait déjà poussé plusieurs exclamations ne put se contenir.
—Est-ce bien possible, cria-t-elle, et ce sont des juges qui ont fait cela?
—Pourquoi pas? dit Marc; les juges ne sont pas chargés d’être justes, ils sont chargés d’appliquer les lois. Tu es dans la rue parce que tu ne peux payer un loyer; cela inquiète les bourgeois: en prison! Tu demandes de quoi acheter du pain parce que tu en manques, cela ennuie ceux qui ont dîné: en prison! le juge ne dit pas que la loi est bonne; mais il dit que c’est la loi.
—Alors il faut la changer! reprit vivement la grisette. Quel mal y aurait-il donc à ce que tout le monde fût heureux, comme à la Brisaie?..... Oh! si j’avais pu vivre là! vous m’auriez donné les enfants à soigner, pas vrai, monsieur Michel? pauvres chéris! comme je les aurais aimés, caressés, pomponnés; rien que de voir un enfant, tenez, ça me fait venir des larmes de joie!... Et dire même que le mien... je ne puis pas...
Elle s’arrêta pour essuyer ses yeux.
—Il est certain que si on choisissait, reprit le Furet, ça ne serait pas de courir comme un barbet dans les rues de Paris et de dormir par nichées dans un garni. Pour ma part, je préférerais coucher dans les foins et conduire une bonne paire de bœufs. Deux fortes bêtes, comme ça, qui vous obéissent et font de bon ouvrage sous votre main, ça doit donner du plaisir.
—Moi, j’aime mieux les moutons, reprit Brousmiche; j’aurais été si heureux d’en avoir à garder. On est en plein air et on vit tout seul avec son chien... ce qui fait que personne ne rit de vous.
—Eh bien! voilà ce que M. Michel voulait, reprit Françoise; mettre chacun à sa place: et dire qu’on lui en a fait un crime! J’espère au moins que vous n’êtes pas resté longtemps en prison?
—Six mois seulement.
—Six mois!
—Qui me profitèrent plus que toutes les années passées à la Brisaie.
—Comment cela?
—Parce que ce fut pour moi l’occasion de révélations inconnues et le point de départ d’une nouvelle vie.
Une fois la première surprise et la première indignation passées, ma captivité me parut facile à supporter. Les ordres d’abord sévères, furent bientôt adoucis; l’argent fit le reste et m’acheta tout ce qu’une prison peut renfermer d’aisance et de liberté.
Je ne tardai pas d’ailleurs à reconnaître que le hasard m’avait offert une nouvelle occasion d’études. Après avoir vécu parmi les hommes soumis au joug de la société, j’allais connaître ceux qui l’avaient brisé. Je passais d’un milieu encore sain dans celui des désespérés. Ici j’allais voir toutes les maladies de l’intelligence mal employée, tous les ulcères creusés dans le cœur par des passions sans emploi, toutes les infirmités morales créées par l’ignorance ou la misère. Lugubre examen qui me fut à la fois une affliction et un encouragement! Car, si chaque instant me révélait une nouvelle plaie, chaque réflexion m’en montrait l’origine, et, comme le médecin attentif, je retrouvais jusque sous cette pourriture humaine, les grands principes d’une organisation non pas vicieuse, mais déviée.
Descendant au préau pendant les heures de promenade, j’interrogeais ces malheureux sur leur passé; je cherchais à retrouver, dans leurs récits, le point de départ de chacun des vices qui les avaient perdus plus tard; je m’efforçais enfin de dresser, pour chacun d’eux, cet arbre généalogique des péchés capitaux qui, selon un poëte espagnol, devient, aux enfers, le titre de noblesse de chaque damné.
Cette étude m’ouvrit mille perspectives nouvelles. Les lueurs qui avaient déjà traversé mon esprit se multiplièrent et s’étendirent; je commençai à comprendre que Dieu ne m’avait pas destiné à l’exécution d’un perfectionnement partiel, accompli au profit de quelques-uns, mais à une mission générale au profit de tous. Dès ce moment je résolus du poursuivre, sous toutes les formes et par tous les moyens, cette enquête de l’humanité qui devait me révéler sa véritable loi.
Ce fut une décision lentement prise, mais souveraine. Une fois les doutes écartés, cette idée de régénération devint, pour ainsi dire, la reine absolue de ma vie entière; je lui fis une phalange de tout ce qu’il y avait en moi de forces, de sentiments, de désirs, et quand la phalange eut formé ses rangs, je criai: Allons! et je partis, comme Alexandre, pour la conquête du monde.
Ma mise en liberté vint heureusement seconder ma résolution. Après beaucoup d’interrogatoires, de délais, d’hésitations, on trouva qu’une détention préventive de six mois suffisait à ma punition et l’on m’ouvrit la porte de la prison. L’Adresse aux propriétaires français resta seulement supprimée.
Mais j’y attachais maintenant peu de prix. Depuis un an, mes idées s’étaient agrandies, j’entrevoyais déjà les grandes lignes d’un plan complet et nouveau; il ne me restait plus qu’à achever les études commencées.
Seulement, pour cela, il fallait connaître le peuple des villes, comme je connaissais celui des campagnes, vivre au milieu de lui sur un pied de confiance et d’égalité. Mon parti fut aussitôt pris. J’abandonnai l’administration de la Brisaie à maître Leroux; je pris des mesures pour que les revenus pussent être accumulés pendant cinq années, sans qu’il me fût possible d’en rien enlever et je partis à pied pour Paris, avec quelques centaines de francs et un passe-port accordé à Joseph Michel, tourneur.
Le voyage de l’ouvrier lorsqu’il est jeune et fort, qu’il ne laisse point après lui de famille, et qu’il possède de quoi subvenir aux besoins de la route, offre une continuité d’impressions charmantes. Tandis que le riche passe, emporté dans sa dormeuse et ne connaissant le monde qu’il traverse que par ses plaintes aux maîtres de poste ou ses débats avec les postillons, l’ouvrier, lui, jouit de tout ce qu’il voit, se mêle à tout ce qu’il rencontre. Il boit aux fontaines du chemin, cueille la mûre le long des haies, se repose avec les moissonneurs sous les gerbes en faisceaux. Tout lui est frère et ami: il jette un bon jour à la paysanne qui passe; il parle au jeune pâtre qui ramène les troupeaux de la friche éloignée; il accepte une place près du voiturier qui regagne son village et apprend ce qui fait la tristesse ou la joie de la paroisse. Ainsi, tout devient pour lui plaisir et enseignement. Partout, il laisse quelque chose de sa vie et prend quelque chose de la vie des autres; c’est un continuel échange d’émotions, de regards, de paroles. Quand le riche voyageur passe, ce n’est qu’un attelage qui use le pavé; mais quand l’ouvrier chemine, c’est un homme qui traverse le monde des hommes.
J’éprouvai si vivement cette sensation que le voyage fut pour moi une source de perpétuels enchantements. Profitant du droit que me donnaient ma veste et mes guêtres poudreuses, j’avais quitté la réserve égoïste du monde cultivé pour la joyeuse familiarité du peuple. Je m’arrêtais près du seuil afin de demander ma route et je liais conversation avec tous les passants, libre de la prolonger ou de l’interrompre selon ma fantaisie.
Un matin, en quittant Nemours, je fis la rencontre d’un ouvrier qui fumait à la porte d’un cabaret, et qui me cria du seuil:
—Eh bien! coterie[D], est-ce qu’on ne boit pas le coup du matin pour tuer le ver?
Je m’excusai en répondant que je ne voulais point m’arrêter, de peur de ne pouvoir gagner Fontainebleau avant la chaleur.
—Tu vas donc à Paris? me demanda-t-il; alors nous ferons la route à deux, mon fils, ce qui n’en fera que la moitié pour chacun... Seulement, il faut prouver qu’on est Français en buvant ensemble un coup de schnick.
L’air jovial de mon compagnon me plut, j’entrai avec lui au cabaret; mais, après le premier verre offert par moi, il fallut en accepter un second, puis il proposa de recommencer. Je déclarai que je voulais partir sans plus long retard; et lorsqu’il me vit sortir, il se décida enfin à me suivre.
—Tu me fais l’effet d’un bon enfant, mais un peu bégueule sur la chose du petit verre, me dit-il, quand il m’eut rejoint, ce n’est pas là le tempérament de Robert Brigoire, dit Pompe-à-mort. Il a tant battu de fer qu’il est resté affligé d’une soif d’Anglais..... A propos d’Anglais, comment qu’on t’appelle?
Je lui dis mon nom et ma profession.
—Tiens! je t’ai pris pour un compagnon de la truelle, reprit-il; mais n’importe, je veux t’apprendre à ne pas bouder devant le coup de croc, et, pour commencer, tu accepteras une politesse au premier bouchon. J’ai encore douze livres dix-sept sous qu’il faut fricoter.
Je tâchai de lui faire comprendre qu’il serait plus sage de les réserver pour le cas où il ne trouverait point d’ouvrage, en arrivant à Paris.
—Ah! bien oui, interrompit Robert, si on pensait au lendemain, il n’y aurait jamais de plaisir. Pour nous autres compagnons, vois-tu, le lendemain c’est la misère, les maladies et tout le tremblement; aujourd’hui, c’est le petit verre et la chanson grivoise. Va donc pour aujourd’hui, et au diable le lendemain! Justement voici un cabaret; j’offre le coup de consolation, mon vieux, en avant, marche.
Je déclarai à Pompe-à-mort que ses habitudes n’étaient point les miennes, et que je refusais positivement; il entra donc seul, tandis que je continuais ma route, mais il me rejoignit bientôt et recommença à causer.
Robert ne manquait ni d’intelligence, ni de bons sentiments; par malheur, des habitudes d’ivrognerie menaçaient de tout éteindre. Je tâchai de l’avertir doucement, mais il avait lui-même la conscience du sort qu’il se préparait sans avoir la force de s’arrêter.
—Il est trop tard, vois-tu, Michel, me dit-il avec une certaine tristesse: un ivrogne déclaré ne peut pas plus s’empêcher de boire qu’une éponge de prendre l’eau. Dans le principe, j’avais peu de goût à la chose; l’eau-de-vie me brûlait le gosier, et je n’en buvais que par respect humain, pour ne pas m’entendre traiter de fille; mais petit à petit, je m’y suis accoutumé. Après la journée, on ne sait que faire: nous n’avons pas, comme le bourgeois, des salons où l’on peut causer en se chauffant; chez nous, c’est triste et froid; les femmes ont à raccommoder les nippes, à savonner; il faut parler bas à cause des enfants qui dorment; alors, pour avoir un peu de liberté et d’aisance, on descend chez le marchand de vin. Le dimanche, c’est encore pis: les gens éduqués peuvent lire la gazette, faire des visites en fiacre, chanter des morceaux avec accompagnement de guitare; nous autres, nous n’avons toujours que le cabaret.
—Mais le lundi au moins vous pourriez retourner au travail.
—C’est selon; quand beaucoup d’ouvriers manquent, les maîtres vous renvoient souvent, sous prétexte qu’il n’y a pas de profit à allumer les forges, de sorte que votre bonne volonté ne vous sert à rien, et qu’on se dit: Puisqu’on ne veut pas nous faire travailler quand les autres s’amusent, allons nous amuser avec eux, et voilà comme on devient un noceur fini[E].
En arrivant à Paris, Robert me proposa de me conduire au logement qu’il habitait avant son voyage.
—Ce n’est pas un garni, me dit-il; mais j’y vais de préférence, parce que le bourgeois me connaît et me fait crédit; il y a au-dessous une gargote où l’on trempe la soupe à deux sous, et où l’on vend du vin de vigneron à sept; à moins que tu n’aies l’habitude de te nourrir de Madère et de petits pieds, ça doit t’aller comme un gant de tricot.
J’acceptai l’offre du forgeron, qui me conduisit rue des Arcis, à une maison bâtie en colombage et qui n’avait que deux étages. Le rez-de-chaussée était occupé par le gargotier, principal locataire, qui sous-louait ensuite en détail. Le père la Gloriette était un petit homme ventru, rougeaud, riant, qui tutoyait tout le monde. Dès le premier coup d’œil, je le reconnus pour un de ces égoïstes qui ont adopté la bonhomie comme une enseigne. Il nous accueillit avec force exclamations de joie, nous adressa vingt questions dont il n’attendit pas les réponses et remplit deux petits verres qu’il nous offrit. Robert lui annonça, en me montrant, qu’il lui amenait un nouveau locataire.
—Comme ça se trouve, s’écria le gros homme; justement, j’ai deux lits de sangle disponibles dans le petit cabinet du second; vous serez là avec le père Barrier.
—L’horloger?
—Oui, un assez mauvais locataire, car il ne consomme rien, mais le roi des camarades de chambrée, vu qu’on l’entend à peine respirer.
—Il est toujours occupé d’inventions?
—Il en cherche une qui, à l’entendre, doit tout révolutionner, mais tu sais, il a toujours peur qu’on ne lui vole ses idées, et il fait le cachotier; du reste, vous n’avez qu’à monter pour lui parler de la chose.
Je décidai Robert à me faire voir le chemin, et nous arrivâmes à une chambre basse et obscure, dont tout l’ameublement consistait en trois lits de sangle et en trois tabourets. Près de la fenêtre un homme maigre, chauve et déjà vieux, limait sur un petit établi couvert de fragments de cuivre, de morceaux de fer et d’outils. A notre vue, il s’interrompit brusquement, jeta la pièce qu’il travaillait dans le tiroir de l’établi et le referma avec vivacité.
—Eh bien! est-ce que vous nous prenez pour des cambrioleurs (dévaliseurs de chambre), bonhomme Barrier? demanda Robert.
—Tiens, c’est toi, Pompe-à-mort, dit l’horloger, te voilà donc de retour?
—Avec un camarade de chambrée que je vous amène.
—Ah! vous allez loger ici, reprit Barrier, dont le regard se fixa sur moi avec inquiétude: vous êtes alors compagnon d’état?
—Fi donc! papa Barrier, reprit Robert; regardez-moi les mains de ce garçon et dites si c’est là le cuir d’un batteur de fer?
—Monsieur serait-il mécanicien? demanda l’horloger avec anxiété.
—Juste, dit Pompe-à-mort en riant: mécanicien en bâtons de chaise, constructeur de chabots et ingénieur de rouleaux de serviettes. Si vous êtes gentils, il vous tournera un étui pour mieux cacher vos inventions.
Le front du vieil ouvrier se plissa.
—Les mieux cacher, répéta-t-il; ah! oui, si je l’avais fait, d’autres ne seraient pas devenus riches, en me dépouillant de ce qui était mon bien. Seul, j’ai tout cherché, tout découvert, et le maître qui me faisait travailler en a profité; c’est lui que l’on connaît, c’est lui que l’on vante; c’est lui qui porte la croix que j’ai gagnée.
—Et n’avez-vous pu réclamer votre droit? demandai-je.
—Quel droit? reprit l’horloger amèrement, n’étais-je point aux gages du fabricant; n’avait-il point fourni la matière? La découverte était à lui puisqu’elle venait de ses ateliers, car le cerveau de l’ouvrier fait partie des outils; c’est un creuset loué; tout ce qui en sort appartient au maître. Notre métier, à nous autres, est d’inventer, et à lui d’acheter le brevet de notre invention. Ce n’est pas le capital qui est un instrument pour l’intelligence, mais l’intelligence qui est un instrument pour le capital. Le jour où j’ai voulu réclamer une part dans les bénéfices que le maître me devait, il m’a chassé et les avocats m’ont dit que c’était la loi.
—Eh bien, une autre fois vous ferez vos conditions, dit Robert; vous n’êtes pas à ça près d’une invention et vous pouvez en trouver une autre.
—Pour inventer il faut du temps, de l’espace, des outils, de l’argent, dit l’horloger, et tu vois où j’en suis?
—Il est certain que ça ne peut pas se comparer aux Tuileries, reprit Pompe-à-mort, en promenant autour de lui un regard insouciant; mais pourquoi donc que vous avez quitté la grande chambre de devant?
Barrier n’eut point le temps de répondre; la porte venait de s’ouvrir bruyamment, et une grisette entra en chantant:
—Eh! c’est la voisine Farandole, dit Robert.
—Tiens! Pompe-à-mort, s’écria la jeune fille, comment donc que tu te trouves ici, mauvais sujet?
—Je m’y trouve parce que j’y suis, ma vieille, reprit gaiement Robert, en l’entourant d’un de ses bras et lui donnant un gros baiser sur chaque joue.
—Eh bien comme ça se trouve, dit Farandole qui l’avait laissé faire, moi qui donne justement une soirée aujourd’hui.
—Une soirée?
—Avec de la galette et du punch! rien que ça.
—Tonnerre! voilà qui est un peu bon genre pour le quartier! c’est donc le brigadier qui régale?
—Ah! bien oui, le brigadier: je ne le-connais plus!
—Avec qui que tu es maintenant?
—Avec moi toute seule! ça me fait un changement. Mais, dis donc, c’est-il un de tes amis, ce garçon?
C’était moi qu’elle désignait. Robert répondit que j’étais son nouveau camarade de chambrée.
—Alors, faut qu’il vienne avec toi, reprit Farandole, nous verrons s’il est farceur; et vous aussi, père Barrier, je vous attends; il y aura toute la maison d’abord; même le papa Jérôme, qui a promis de venir quand la marmaille serait couchée. Ainsi, c’est convenu, les enfants; à sept heures la fête commence, une mise décente est de rigueur, on sera reçu en sabots...
A ces mots la grisette prit les deux mains de Robert, fit deux ou trois fois le tour de la chambre en dansant, et sortit sur l’air de la Farandole, ronde favorite à laquelle elle devait son nom.
Robert et moi, nous arrivâmes chez la grisette à l’heure convenue. Quelques-uns des invités s’y trouvaient déjà: c’étaient des ouvrières appartenant aux fabriques du faubourg Saint-Marceau, mais dont la tenue prouvait évidemment l’habitude de faire, dans la rue, leur cinquième quart de journée[F], et deux jeunes gens en casquette, vivant de ces industries équivoques qui préparent au vice par l’oisiveté. Le père Barrier ne tarda pas également à arriver avec la Gloriette, qui apportait le punch dans un saladier.
On s’assit autour de la table; Farandole remplit les verres, et la conversation commença à s’animer.
Robert surtout, qui revenait sans cesse aux rafraîchissements, ne tarda pas à s’égayer outre mesure.
—Allons, Pompe-à-mort, un peu de tenue, dit la grisette en voulant arrêter ses libations; il faut garder la part du papa Jérôme.
—Tant pire pour les absents! cria Robert en remplissant son verre; pourquoi qu’il ne vient pas, cette vieille rosière de Salency. Je parie qu’il donne le sein à un de ses moutards.
—Taisez-vous, vaurien, le voici!
Un petit homme, à figure douce et à manières timides, venait, en effet, d’entr’ouvrir la porte, son bonnet de laine à la main.
—Faites excuse, la compagnie, dit-il en entrant avec précaution; messieurs et mesdemoiselles, j’ai bien l’honneur... Il ne vous est rien arrivé depuis ce matin, mam’zelle Farandole? Bonjour, monsieur Robert, comment va la vôtre?
—Asseyez-vous, vieux papa, dit celui-ci, en avançant une chaise au nouveau venu. Pourquoi donc arrivez-vous si tard?
—C’est pas de ma faute, répondit Jérôme, en s’asseyant à quelque distance de la table; foi d’homme, j’ai fait mon possible; mais j’avais à finir une grosse de boutons que je dois livrer demain.
—Les affaires vont donc à cette heure, papa?
—Vous êtes bien bon, monsieur Robert, ça va pas mal, grâce à Dieu! mais il était temps, car la morte-saison avait consommé tout ce qu’on avait pu mettre dans la tirelire.
—Oui, fit observer Barrier, dans le bon temps on la remplit, en se retranchant tout agrément, et dans les mauvais on la vide, en ne se donnant qu’une partie du nécessaire!... On continue comme ça une quarantaine d’années, et alors, si on est bien avec son commissaire, on obtient une place à l’hôpital.
—On fait comme on peut, mon cher monsieur Barrier; on fait comme on peut, répliqua Jérôme avec douceur. Certainement, c’est triste d’aller à l’hôpital, mais alors les enfants sont élevés!
—Brave père, va! dit Farandole touchée, malgré elle, dans son cœur de femme.
Et elle remplit un verre qu’elle présenta à l’ouvrier boutonnier. Celui-ci parut hésiter à l’accepter.
—Est-ce que vous n’aimez pas le punch? demanda Robert.
—C’est-à-dire, je l’aime peut-être, dit Jérôme, embarrassé et souriant; mais, vous concevez... qu’un père de famille... doit éviter la dépense...; aussi je crois que je n’en ai jamais bu.
—C’est juste! reprit un des jeunes gens en casquette: l’eau filtrée et les pommes de terre, voilà le régime de la vertu! C’est pourtant drôle, dites donc, qu’il y ait comme ça les trois quarts du monde condamnés à vivre en pénitence sur cette gueuse de terre, sans jamais goûter à ce qu’elle donne de bon.
—Voilà ce qui ne me va pas à moi, ajouta son compagnon. Travailler douze heures pour n’avoir qu’une botte de foin, ça peut convenir à un cheval de cabriolet, mais pas à un homme.
—Et c’est pourquoi tu l’es logé dans la rue de Saint-Lâche? demanda Robert: faut prendre garde, mon petit; ce quartier-là est bien près du Palais-de-Justice.
Le jeune homme fut un mouvement d’épaules.
—Connu! dit-il; mais quand il arriverait un malheur!... quelques mois passés à l’ombre n’ont jamais fait de mal à la santé: le gouvernement nous donnera pour rien la pension et le logement, pendant que vous crèverez de faim... et de plus, nous sortirons de là avec une masse!...
—C’est pourtant vrai! dit Barrier pensif.
—Ah bah! faut pas dire ces choses-là! s’écria une de ouvrières; ça fait venir des idées... qui vous ennuient.
—Et ça vexe Jérôme, ajouta Robert.
—Oui, oui, interrompit Farandole, qui venait de vider le saladier dans les verres; ne mécanisez pas les honnêtes gens devant le papa Jérôme.....; il pourrait prendre la chose pour lui, et il a déjà assez de croix.
Jérôme releva la tête. Le punch avait fait monter une légère rougeur à ses joues ternes, et son œil avait pris un peu plus d’assurance.
—Faites excuse, mam’zelle Farandole, dit-il avec une certaine vivacité: j’apprécie l’intention de ce que vous dites; mais je ne voudrais pas laisser croire à la compagnie que j’aie à me plaindre de personne, ni que je ne sois pas bien dans mon ménage...
—Oh! ça, on sait que la mère Jérôme est la reine des braves femmes, interrompit la grisette.
—Oui, je pense pouvoir me permettre de dire qu’on n’a rien à lui reprocher, reprit le boutonnier, dont l’accent trahissait un attendrissement intérieur; depuis douze ans que nous habitons le quartier, elle est connue..... Toujours au travail, et jamais d’humeur, avec ça!..... Les enfants sont encore à savoir ce que c’est que d’être battus.
—Aussi, sont-ils gentils, dit Farandole; ils ne me rencontreraient pas sans me dire bonjour.
—Et jamais de bruit dans les escaliers, ajouta la Gloriette.
—Et ça va tous les jours à l’école, continua l’horloger.
—Tous les jours, monsieur Barrier, reprit l’ouvrier, à qui ces éloges firent venir les larmes aux yeux; l’aîné sait déjà lire, écrire et chiffrer, et les deux petites aident la mère à coudre. Ce sont de vrais anges du bon Dieu!... Aussi quand ils sont autour de moi, voyez-vous, et que j’entends la bonne femme qui tripote dans le ménage en chantonnant, je ne demande rien que de continuer à vivre aussi heureux.
—Eh bien! je comprends ça! s’écria Farandole; oui, voir des mioches qui prospèrent, qui rient, qui vous caressent; ça doit joliment vous assaisonner les épinards. Si le beurre est trop cher, eh bien, on a leur bonheur... et on mange son pain avec.
—Et puis, reprit Jérôme, enhardi par cette approbation, il peut venir une bonne chance. Il y a deux ans, un bourgeois a été sur le point de me faire l’avance qu’il me faut pour fabriquer à mon compte: il m’avait promis cinq cents francs, malheureusement il a fait des pertes...
—Et vous n’avez rien eu? acheva ironiquement Barrier.
—Non, mais une autre occasion peut se présenter; il faut toujours espérer, monsieur Barrier; ça ne fait de mal à personne, et ça vous fait du bien; tandis qu’on se mine à envier ceux qui sont mieux placés et que souvent ça donne de mauvaises tentations. Je sais bien qu’il y en a qui reçoivent une pauvre part dans le monde, mais c’est une raison pour ne pas la rendre plus mauvaise par son manque de raison: quand on vous a mis dans l’eau jusqu’au cou, faut pas y enfoncer encore la tête par mauvaise humeur, ou l’on croira que c’est de votre faute si vous vous noyez... Je ne dis point ça, au moins, pour offenser la compagnie.
—On le sait bien, père Jérôme, allez, dit Farandole, qui était devenue sérieuse.
—Alors, elle m’excusera d’avoir hasardé aussi mon petit mot, reprit le boutonnier qui s’était levé en souriant, et elle me permettra de la saluer, vu que les enfants n’auront pas voulu s’endormir sans me dire bonsoir... c’est une habitude... en vous remerciant mademoiselle Farandole, et la compagnie, à l’avantage!
Il salua plusieurs fois avec son bonnet et sortit.
Ce qu’il venait de dire avait évidemment impressionné les auditeurs. A mesure qu’il parlait, leur cynisme révolté avait fait place à je ne sais quel vague respect pour cette probité si simple et pour cette résignation si heureuse. Robert, qui avait fait demander de l’eau-de-vie, buvait coup sur coup, comme s’il eût voulu s’étourdir plus vite et ne pas entendre; les deux jeunes gens en casquette affectaient une ironie embarrassée, Barrier et les femmes avaient pris un air sérieux. Il y eut un moment de silence après la sortie de l’ouvrier.
—Est-il drôle ce père Jérôme, s’écria enfin tout à coup Farandole, échappant à l’impression reçue par un éclat de rire; ce qu’il nous a dit là, c’était comme un sermon, excepté qu’un sermon ennuie.
—Bah! ajouta une des ouvrières, il a raison et nous aussi... chacun fait comme il peut.
—Bien dit, ma petite mauviette, reprit la grisette en l’embrassant; chacun fait comme il peut... en ayant l’air de faire comme il veut. Laissons-nous donc aller, mes petits... et pour bien finir la soirée, je vous propose un rigodon.
—Ici?
—Non, au bal Mouffetard; c’est ce soir l’ouverture, qui est-ce qui veut être mon cavalier?
—Présent! dit Robert, qui se leva en chancelant.
—Pompe-à-mort!... merci! objecta Farandole; pour danser il faut se tenir debout.
—Sois donc calme, bégaya le forgeron, c’est d’être assis qui m’a étourdi comme ça: quand j’aurai pris l’air, tu me verras plus ferme que le Pont-Neuf. Ton bras que je te dis; je ne te ferai pas d’affront.
La grisette se décida après quelques hésitations et tous partirent ensemble, sauf Barrier et moi qui regagnâmes notre chambre.
Le lendemain, je pris la moitié des mille francs que j’avais emportés et je l’adressai à Jérôme, avec un billet anonyme, déclarant que cet argent lui était donné pour qu’il pût fabriquer à son compte!
Le brave homme faillit devenir fou de joie. Il s’occupa aussitôt d’acheter tout ce qui lui était nécessaire et loua un autre logement dans la rue du Renard. Je pris sa chambre où je m’établis avec ce qui était nécessaire pour ma profession de tourneur. J’eus d’abord quelque peine à obtenir du travail. Il fallut affronter bien des refus, accepter de dures conditions, subir des retards de paiements et même des retenues, m’initier enfui aux difficultés pratiques de la vie du peuple, dont je ne connaissais encore que les grandes misères.
Vous n’attendez pas de moi, sans doute, le récit détaillé de ces années d’épreuves; je vous en ai dit assez pour pouvoir les franchir d’un bond et arriver à l’aventure qui me força de hâter mon changement de position.
Je revenais un matin d’Auteuil, où j’avais rapporté quelques commandes, lorsque, en arrivant à l’extrémité d’une des avenues, j’aperçus une calèche découverte rapidement emportée par des chevaux sans conducteur, et dans laquelle une femme seule poussait des cris perçants. L’attelage venait vers moi, en suivant le milieu de la route. Par un mouvement instinctif, je laissai tomber la règle à mesurer que je tenais à la main, et, au moment où la calèche arriva près de moi, je m’élançai à la tête des chevaux.
Ils me traînèrent quelque temps, puis se ralentirent. Je pus saisir une des rênes, et, la tirant brusquement, je forçai l’attelage à reculer. Les roues allèrent heurter le mur d’un parc qui bordait le chemin, et la calèche s’arrêta.
Comme je m’efforçais de calmer les chevaux en les flattant de la main et de la voix, je fus rejoint par le cocher, qui avait été précipité de son siége sans recevoir aucune blessure. Il se rendit bientôt maître de l’attelage, se retourna vers sa maîtresse, dont les cris avaient cessé, et nous nous aperçûmes alors seulement qu’elle était évanouie.
Je l’aidai à la dégager de son chapeau et de la douillette fourrée qui l’enveloppait. L’air frais la ranima; elle rouvrit les yeux, mais pour tomber dans une crise nerveuse qui nous effraya. Il n’y avait autour de nous aucune habitation ni aucun moyen de secours.
—Remontez vite sur le siége, dis-je au cocher, et gagnez Passy, on vous indiquera un médecin.
Il approuva l’expédient, reprit les rênes et partit.
Je restai debout à la même place, jusqu’à ce qu’il eût tourné l’allée: alors je me baissai pour prendre ma règle à mesurer, et mon regard s’arrêta sur quelque chose de brillant; j’avançai la main, c’était un bracelet à fermoirs de diamants!
Je courus aussitôt dans la direction prise par la voiture, mais elle avait disparu. Je continuai jusqu’à Passy, où toutes mes informations furent inutiles. On avait bien vu passer une calèche peu auparavant, mais elle ne s’était point arrêtée.
Je me trouvais dans un grand embarras. Le bracelet devait avoir une valeur considérable, et, à tout prix, je voulais le rendre. Mais comment retrouver la personne qui l’avait perdu?
En le regardant avec plus d’attention, j’aperçus, par bonheur, un petit écusson émaillé qui occupait le centre du fermoir: je pensai qu’en consultant les principaux joailliers, ils pourraient reconnaître les armoiries et me tirer d’embarras.
Je me rendis, en conséquence, au Palais-Royal; j’entrai dans un des plus riches magasins et je présentai le bracelet, en demandant le renseignement désiré.
Le commis parut émerveillé de la beauté de la monture. Il appela le joaillier, qui déclara, au premier coup d’œil, que c’était un bracelet de mille écus. Je ne pus retenir une exclamation d’étonnement.
—Et connaissez-vous les armes gravées sur le fermoir? demandai-je.
Le joaillier répondit négativement.
—Alors je vais ailleurs, repris-je, en tendant la main pour redemander le bracelet.
Le marchand me regarda et voulut savoir comment j’étais détenteur d’un pareil bijou. Pressé de continuer mes recherches, je répliquai rapidement que je l’avais trouvé, et comme, à bout de patience, je refusais de répondre davantage, il glissa le bracelet dans une de ses montres, la referma à clef et déclara qu’il ne le rendrait qu’à son légitime propriétaire.
Exaspéré, je voulus le reprendre de force; il en résulta un débat à la suite duquel je fus arrêté et conduit chez le commissaire du quartier.
Il fallut nécessairement raconter à celui-ci tout ce qui s’était passé dans l’avenue d’Auteuil. Pendant ce temps un nouveau joaillier avait reconnu l’écusson; c’était celui d’un général devenu dignitaire de l’Empire. On voulut vérifier l’exactitude de mon récit, et je fus obligé de me laisser conduire à l’hôtel qu’il habitait.
Au moment où nous arrivions à l’hôtel, le cocher qui se trouvait dans la cour me reconnut et s’approcha. Quelques paroles suffirent pour me justifier; le commissaire s’excusa en alléguant la nécessité de la défiance et j’allais me retirer, après l’avoir prié de remettre lui-même le bracelet, lorsque la femme du général, avertie que j’étais là, me fit demander.
Malgré ma répugnance, il fallut céder, et, après avoir traversé plusieurs salons richement décorés, j’arrivai à un boudoir où elle m’attendait.
Je l’avais entrevue si rapidement le matin qu’il m’eût été impossible de la reconnaître. Sans être belle, elle avait, dans toute sa personne, quelque chose de doux et de caressant, qui vous attirait dès le premier coup d’œil. Elle se leva vivement à mon entrée, courut à moi et me prit les mains avec une reconnaissance expansive dont je fus surpris.
—Ah! venez, dit-elle, j’ai besoin de vous voir et de vous remercier.
Je voulus protester contre l’importance qu’elle donnait à un service que tout autre eût pu lui rendre, mais elle m’interrompit, me fit asseoir près d’elle et commença à m’adresser des questions sur mon nom, mon état, ma position.
Je répondis avec une contrariété évidente. Elle crut sans doute que je redoutais des offres d’argent qui eussent blessé ma fierté, car elle se hâta de dire:
—Pardon, monsieur Michel, si je vous interroge ainsi; mais la seule récompense que je puisse vous proposer est mon amitié.... et il faut bien connaître ses amis!
Je répondis qu’elle me faisait trop d’honneur.
—Ne dites pas cela, reprit-elle, avec une sensibilité sincère; si le général se fût trouvé à Paris, il eût mieux réussi à vous remercier: un homme fait des offres de service à un autre homme sans l’humilier: mais je suis seule et je ne puis... Je n’ose vous proposer que ma reconnaissance... ne la refusez pas, Monsieur.
Elle me tendait la main, je la pris et la baisai avec émotion.
—Madame me récompense au delà de ce que je mérite, répliquai-je; et désormais c’est moi qui serai son obligé.
Elle me regarda, jeta un rapide coup d’œil sur mon costume, et fit un geste d’étonnement.
Je compris que j’avais oublié mon rôle d’ouvrier, et me levant brusquement:
—J’espère bien, du reste, que si Madame a besoin d’employer un tourneur, elle se souviendra de moi, ajoutai-je en saluant du pied.
—Votre adresse? continua la jeune femme, dont le regard continuait à m’observer.
Je lui remis une des cartes imprimées que j’avais toujours sur moi.
—Vous reviendrez me voir, dit-elle, d’un ton qui exprimait bien moins l’ordre que la prière.
Je le promis en demandant à quelle heure on pouvait parler à madame la baronne.
—Vous, à toute heure, répondit-elle; seulement ne m’appelez point par mon titre, on pourrait vous confondre avec tout le monde, mais par mon nom de baptême. Quand vous viendrez, demandez madame Nancy; c’est le mot de passe pour mes amis.
Je la remerciai et pris congé d’elle; mais au moment où j’allais partir, une femme de chambre annonça plusieurs noms parmi lesquels fut prononcé celui du chevalier de Rieul.
Ce dernier se montra en effet à l’entrée du boudoir donnant le bras à une dame en grande parure et suivi de deux autres groupes.
Il ne parut d’abord frappé que de trouver un homme portant mon costume dans un pareil lieu; mais à cette première surprise en succéda une seconde plus marquée.
Il s’arrêta court, me regarda fixement et jeta un cri: il m’avait reconnu!
Je fis un mouvement vers la porte pour m’échapper; il quitta vivement le bras de la dame qu’il conduisait, me saisit par la main et me ramena vers la fenêtre du boudoir, comme s’il eût voulu s’assurer qu’il ne se trompait pas.
—Dieu me damne! c’est bien lui, s’écria-t-il.
—Quoi! vous connaissez monsieur Michel? demanda vivement la femme du général.
—Michel, répéta le chevalier; il a donc aussi changé de nom en changeant de costume?
Madame Nancy parut stupéfaite.
—Que parlez-vous de changement de costume, reprit-elle; monsieur serait-il donc déguisé?
—Et si habilement, continua de Rieul, que j’ai eu peine à le reconnaître. Je ne soupçonnais point un pareil talent à ce cher duc...
—Comment, s’écria la dame en grande toilette, monsieur serait...
—Mon cousin, madame la comtesse.
Tout le monde se récria de surprise; quant à moi, je regardais toujours la porte, que j’essayais de gagner; mais le chevalier me retint.
—Oh! vous ne vous échapperez pas ainsi, mon bon, dit-il en riant; fermez la porte, colonel; et vous, mesdames, permettez-moi de vous présenter un parent, excellent gentilhomme, sur ma parole, philanthrope de premier ordre et un des plus riches propriétaires de la Touraine.
On s’inclina et je fus obligé de rendre le salut, tandis que la femme du général, qui était d’abord restée muette de surprise, racontait ce qui s’était passé le matin et comment je me trouvais là.
—Mais pourquoi ce costume? demanda la dame conduite par de Rieul.
—Comment vous ne devinez pas, ma chère, s’écria le petit homme à culottes courtes que l’on avait appelé colonel et que je reconnus alors pour un de nos émigrés de l’armée de Condé; c’est un habit de guerre: avec un costume d’ouvrier on entre partout sans inquiéter les jaloux.
—Les jaloux, reprit la dame; ainsi vous pensez que quand monsieur a rencontré Nancy ce matin...
—Il venait, comme Jupiter, de doubler quelque malheureux Amphitryon!...
Les femmes sourirent, et je m’aperçus que les regards se fixaient sur moi avec une curiosité qui n’avait rien de malveillant; l’explication supposée par le colonel émigré avait évidemment donné à mon déguisement quelque chose de galant qui en relevait la vulgarité.
Je ne crus cependant pas devoir accepter les bénéfices d’une pareille erreur. Je déclarai que mon costume était celui de la profession que j’avais adoptée, et, comme le vieux gentilhomme paraissait douter, j’expliquai brièvement les motifs de ce changement, apportant pour preuve la carte remise à la femme du général et qu’elle tenait encore.
A cette révélation, la bienveillance fit subitement place à un étonnement moqueur: des exclamations partirent de tous côtés. La dame, qui avait déjà parlé, et que madame Nancy nommait sa sœur, s’écria que c’était impossible; le colonel répétait que, même en Angleterre, il n’avait jamais entendu parler d’une pareille excentricité; le chevalier seul se déclara convaincu et raconta mes essais à la Brisaie, pour prouver que j’étais capable de tout. Aux regards qui se fixèrent alors sur moi, je compris qu’on me croyait fou. Tout essai de justification eût été inutile: je me hâtai de saluer pour prendre congé; mais madame Nancy s’avança vivement.
—Je n’avais pu offrir que ma reconnaissance à monsieur Michel, dit-elle avec une émotion pleine de grâce; monsieur Henri de la Brisaie me permettra-t-il d’y joindre mes témoignages de sympathie et d’admiration?
—Ah! le ciel vous sert à souhait, Nancy, s’écria sa sœur ironiquement; vous qui avez appris à lire dans le Contrat social et que l’on a dressée au respect pour les amis du genre humain, vous avez trouvé votre héros.
—Il est vrai, dit la jeune femme, d’un accent pénétrant; ce que Monsieur vient de dire, ce qu’il a fait surtout, excite en moi un respect, un attendrissement que je voudrais en vain cacher: maintenant que je connais le noble emploi de ses journées, je crains d’en détourner à mon profit quelques instants... et j’ose à peine renouveler ma prière de tout à l’heure...
—Et moi, je demande à Madame la baronne la permission de me la rappeler, répliquai-je, en baisant la main qu’elle me présentait.
Puis, saluant tout le monde, je sortis bien décidé à revenir.
Ainsi que je vous l’ai dit, je touchais au terme fixé par moi-même à mon espèce d’enquête pratique; la rencontre que je venais de faire me décida à hâter ma transformation. J’avais porté assez longtemps la livrée du peuple, et je m’étais assez mêlé à ses plaisirs, à ses misères, à ses vices pour apprendre ce que j’avais voulu savoir; je déposai la veste de travail et rentrai dans les rangs des privilégiés que je devais aussi étudier.
Mais avant de renoncer à la condition que je venais de traverser, je voulus veiller au sort de ceux que j’avais connus.
Le père Jérôme prospérait, grâce à sa bonne conduite et à son activité; j’accrus cette prospérité par des avances qui lui permirent d’agrandir sa fabrication: Barrier, vieux, malade et sans ressources, continuait à poursuivre ses inventions au milieu des tortures de l’impuissance et de la misère; je lui assurai une place à l’établissement des Petits-Ménages, en lui fournissant tout ce qui pouvait aider à ses recherches; quant à Farandole et à Robert, tombés aux dernières limites de la dégradation, je ne pus que leur constituer un petit revenu inaliénable qui défendît leurs derniers jours contre la faim. Quitte ainsi envers mes amis du peuple, j’abordai le monde des riches et des puissants.
Je rencontrai chez madame Nancy, outre sa sœur et le colonel émigré, son beau-frère, une grande partie de l’ancienne noblesse et de la nouvelle. Ou touchait à la fin de l’Empire, dont les hommes prévoyants pouvaient déjà soupçonner la chute prochaine; les intrigues, des royalistes avaient recommencé, et, afin de les mieux dissimuler, ils avaient soin de se montrer dans les salons fréquentés par les officiers et les fonctionnaires les plus dévoués à l’empereur.
Je passais presque toutes mes soirées chez madame Nancy, dont l’amitié expansive avait fini par me devenir nécessaire: c’était près d’elle que je retrouvais du courage dans mes jours d’abattement, et de la sympathie dans mes jours d’espérance. Toujours prête à s’associer à vos enthousiasmes, devinant vos tristesses sans vous en parler, et sachant rétablir l’équilibre dans vos sentiments troublés, elle devenait, au bout de quelque temps, la ménagère de votre âme, et y maintenait tout en ordre, sans mouvements et sans bruit.
Cette merveilleuse faculté qui en faisait pour moi l’idéal de la femme, n’avait malheureusement trouvé d’emploi ni avec sa sœur, qui l’avait toujours enviée et haïe, ni avec le général, accoutumé à la rude existence des camps. Je fus le premier à la remarquer et à en jouir. Ce fut pour madame Nancy une sensation toute nouvelle que de se voir utile au bonheur de quelqu’un; elle en éprouva une joie qui participait de la reconnaissance.
Plusieurs mois s’écoulèrent pour tous deux dans un enchantement qui est resté le plus doux souvenir de ma vie. La différence d’âge ne se faisait point sentir entre nous, car l’âge est presque autant dans les goûts que dans la somme des années. Etranger jusqu’alors à toute affection individuelle, j’entrais dans ces nouveaux sentiments avec la jeunesse du cœur, tandis que madame Nancy, vieillie par de précoces souffrances, y apportait toute l’énergie que la maturité donne aux passions chez les femmes. Nous nous aimions pourtant sans nous l’être dit, presque sans le savoir, et cette ignorance volontaire éloignait de notre esprit toute angoisse.
La chute de l’Empire et le retour du général vinrent troubler cette innocente intimité; mais ce fut pour peu de temps. Le débarquement de l’empereur à Cannes rappela ce dernier sous les drapeaux, et madame Nancy alla habiter sa villa d’Auteuil où je continuai à la voir tous les jours.
Le colonel avait suivi les Bourbons à Gand, tandis que la comtesse sa femme était demeurée à Paris avec le chevalier de Rieul. Les relations de parti en couvraient d’autres plus intimes, mais l’habileté des deux amants les sauvait du scandale; car dans ce monde frivole, où tout s’arrête à l’apparence, la corruption expérimentée est plus sûre que l’honneur. La comtesse masquait d’ailleurs son indulgence pour elle-même sous sa sévérité pour les autres. Mes assiduités auprès de sa sœur excitèrent ses critiques, et, par suite, les malignes suppositions de ses amis. J’en fus instruit sans pouvoir me décider à interrompre des rapports qui étaient devenus la sérieuse occupation de ma vie.
Cependant, ces rapports avaient insensiblement perdu leur charme paisible. A l’affection indulgente des premiers mois avait succédé une ardeur jalouse, inquiète, querelleuse. Bien que devenus plus indispensables l’un à l’autre, nous nous séparions souvent malheureux et brouillés. Une de ces querelles fut assez vive pour me laisser, le lendemain, un ressentiment qui me décida à ne point retourner ce jour-là à la villa du général. Je maintins assez bien ma résolution pendant les premières heures; mais, peu à peu, mon courage faiblit, les hésitations commencèrent; je pensai aux torts que je pouvais avoir, à l’inquiétude de madame Nancy lorsqu’elle ne me verrait pas, et, tout en discutant sur ce que je devais faire, je pris la route d’Auteuil.
J’arrivai à la villa plus tard que de coutume, et je rencontrai à la porte du parc la comtesse avec le chevalier.
Celui-ci m’apprit qu’il venait prendre congé de la femme du général.
—Il part pour l’ouest, ajouta la comtesse, en donnant à ces mots une intention qui me fit comprendre sur-le-champ de quoi il s’agissait.
—Voulez-vous venir avec moi? reprit de Rieul légèrement; nous nous trouverons là-bas en pays de connaissance.
—En effet, répliquai-je, les journaux m’ont appris que MM. de Lescot et d’Arvière venaient de se mettre à la tête des bandes insurgées.
—Eh bien! nous les verrons à l’œuvre, continua de Rieul, qui ne tenait point évidemment à cacher le but de son voyage; pour un philosophe comme vous, ce doit être une étude à faire.
—Et vous pouvez ajouter que c’est un devoir pour tout gentilhomme, dit la comtesse avec intention.
Je fis observer, en souriant, que j’avais trop dérogé pour oser encore prétendre à ce titre.
—Avouez plutôt que vous ne voulez pas quitter Paris, répliqua le chevalier.
—On ne le permettrait point à Monsieur, ajouta la comtesse avec une sorte d’aigreur.
—Qui donc s’y opposerait? demandai-je.
Elle s’arrêta pour me regarder, puis s’écria avec un rire forcé.
—Il le demande! Mais vous nous croyez donc aveugles et sourds? Que deviendrait ma sœur si vous n’étiez plus là?
Je rougis involontairement.
—Je pense, en effet, repris-je, que madame Nancy ne verrait point avec indifférence le départ d’un de ses amis les plus dévoués... mais je sais aussi que je ne lui suis pas assez nécessaire pour qu’elle essayât de me retenir, si mon devoir m’appelait ailleurs.
—Vous croyez?
—J’en suis sûr, Madame.
—Alors vous me permettrez d’acquérir la même conviction.
—Si vous en trouvez le moyen...
—Je l’ai trouvé, dit vivement la comtesse qui venait d’apercevoir sur le perron sa sœur avec quelques visiteurs qu’elle reconduisait.
—Comment cela? demandai-je étonné.
—Laissez-moi faire et veuillez seulement ne pas me contredire.
Je n’eus point le temps de faire de questions; madame Nancy venait de nous voir et elle accourait à notre rencontre. Après avoir embrassé sa sœur, elle me tendit la main en me reprochant doucement d’arriver si tard.
—Ah! ne le grondez pas! car il a failli ne pas venir, dit la comtesse.
—Pourquoi donc? demanda sa sœur.
—Il avait à vous faire une confidence qu’il redoutait.
—Quelle confidence?
—Vous saurez d’abord que le chevalier part demain pour la Vendée.
—Mais... M. Henri?...
—Eh bien! M. Henri s’est décidé à partir avec lui.
Je voulus protester; la comtesse m’interrompit.
—Oh! il ne faut point nier, reprit-elle vivement; il voulait d’abord partir sans vous revoir, mais je lui ai fait comprendre que vous n’étiez point femme à le retenir quand son devoir l’appelait ailleurs. Aussi l’ai-je décidé à vous faire ses adieux.
Madame Nancy devint pâle. Notre brouillerie de la veille l’avait laissée dans un trouble que l’isolement de la nuit et l’attente de la journée avaient encore exalté. L’ébranlement nerveux, qui en était la suite, l’avait préparée aux douloureuses émotions; aussi, ce départ brusquement annoncé lui parut-il une rupture. Frappée au cœur, elle me regarda, poussa un faible cri et chercha de la main un appui.
Je me précipitai pour la soutenir; mais, en sentant mon bras l’effleurer, le reste de domination qu’elle avait sur elle-même sembla l’abandonner, et, oubliant tout ce qui l’entourait, elle laissa aller sa tête sur mon épaule en fondant en larmes et en criant à travers ses sanglots:
—Ne partez pas!... ne partez pas!...
Tous les assistants demeurèrent embarrassés, et la comtesse recula stupéfaite. Elle avait bien espéré que son épreuve causerait à sa sœur quelque embarras; mais, ignorant ce qui s’était passé la veille, elle n’avait pu prévoir l’espèce d’explosion qui venait d’avoir lieu.
Quant à moi, partagé entre la confusion, la joie, l’attendrissement, je ne pouvais que répéter des protestations entrecoupées, en suppliant madame Nancy de se remettre; mais, livrée à une de ces crises où le cœur s’ouvre malgré nous, sous un choc subit, elle ne songeait plus au lieu, à l’heure, à rien de ce qui l’entourait. Pressée sur ma poitrine, elle continuait de supplier, en ajoutant l’aveu de ses torts passés et mille promesses pour l’avenir.
J’avais d’abord résisté à l’entraînement de cette expansion inattendue, bientôt subjugué moi-même, je répondis tout ce que m’inspirait mon émotion.
La voix de la comtesse m’arracha à ce court égarement. Muette de surprise d’abord, elle venait de saisir la main de sa sœur en s’écriant:
—Que faites-vous, Monsieur? Avez-vous oublié qu’on vous entend, qu’on vous regarde?
Nancy releva la tête, et la conscience de ce qui l’entourait lui revint avec la rapidité de l’éclair. Elle rougit et se dégagea. Je retins sa main qui glissait de mon épaule, et, me tournant vers les visiteurs retirés à quelques pas avec une discrétion ironique:
—On peut nous regarder et nous entendre, Madame la comtesse, répondis-je, car notre affection n’a rien à cacher. La cruelle épreuve que vous venez d’essayer était seulement inutile...
—Pouvais-je prévoir un tel éclat? murmura-t-elle.
—En effet, repris-je amèrement, de plus habiles auraient mieux su maîtriser leur trouble; l’habitude des secrets honteux apprend la dissimulation.
—Monsieur...
—Mais nous, Madame, nous pouvons laisser voir sans crainte notre attachement, car la liberté même de son expression est un témoignage de sa pureté.
—Ainsi, vous osez l’avouer! s’écria la comtesse.
—Et je voudrais que tous ceux qui en doutent pussent m’entendre, répliquai-je exalté par les émotions que je venais d’éprouver; je voudrais pouvoir répéter partout que cet amour est toute ma consolation, toute ma force, toute ma gloire; que je lui dois ce que j’ai goûté de plus douce joie sur la terre! Ah! ne tremblez pas, Nancy, ne baissez point les yeux; cet aveu, je pourrais le faire devant Dieu lui-même sans rougir... et si quelqu’un en doute encore maintenant, qu’il le dise.
En parlant ainsi, je tenais les mains de la jeune femme serrées sur mon cœur qui battait à se briser, et je promenais un regard interrogateur sur le chevalier et sur ses compagnons. J’aurais voulu, dans l’espèce d’ivresse irritée qui me transportait, saisir le plus léger signe d’incertitude ou de raillerie: mais tous restèrent immobiles. La comtesse seule nous jeta un regard dont le dédain affecté déguisait mal la colère.
—A la bonne heure! dit-elle; dès que la menace devient un moyen de justification, je dois garder le silence. Le général saura défendre lui-même son honneur!...
Elle reprit le bras du chevalier et partit.
Je rentrai au salon avec Nancy, qui se laissa tomber sur un canapé et se couvrit le visage de ses mains. Je m’agenouillai devant elle. En me retrouvant seul, toute mon exaltation était tombée, et j’avais peur de ce que je venais de faire.
—Pardonnez-moi, Nancy, murmurai-je tristement. Oh! j’ai eu tort, je le sens; mais je n’ai pu accepter que ces gens-là nous fissent un déshonneur de notre amour. Il eût mieux valu nier, car le monde peut croire à un mensonge, et il ne croit jamais à la pureté d’un attachement. Ah! pourquoi suis-je venu? pourquoi n’ai-je point démenti plus tôt votre sœur quand elle vous a annoncé mon départ? Vous pleurez, Nancy! Mon Dieu! vous pleurez, et c’est moi qui suis cause... c’est moi qui vous ai compromise!
—Je ne pleure point pour cela, dit-elle doucement, mais parce que maintenant il faudra vous quitter.
—Me quitter!...
—Voulez-vous donc que la comtesse me dénonce au général?
—Hélas! quoi que vous fassiez désormais, elle lui révèlera ce qui s’est passé.
—Non, car je la préviendrai, dit Nancy avec résolution. Dès demain, je pars pour le rejoindre, et je lui confesserai tout.
Je fis un mouvement.
—Oh! ne cherchez point à me dissuader, Henri, ajouta-t-elle; bien des fois, déjà, j’ai pensé à tout lui dire. Si dans nos unions formées par le calcul ou le hasard la femme ne peut promettre l’amour, elle doit, au moins, la sincérité: le général saura tout, et puis... lui-même décidera de mon sort.
—Mais s’il vous repousse? m’écriai-je.
—Alors, dit-elle, en se levant et en me tendant la main, je me rappellerai qu’il me reste un ami.
Je couvris cette main de baisers, de larmes, puis Nancy me fit ses adieux en me promettant de m’écrire le résultat de son entrevue avec le général.
Elle partit le lendemain comme elle l’avait décidé, et j’attendis huit jours avec un serrement de cœur inexprimable.
Enfin, je reçus d’elle un billet; il ne renfermait que quelques lignes écrites d’une main tremblante; je les ai toujours retenues; les voici:
«Je ne verrai le général que demain; mais n’attendez aucune nouvelle de moi; quittez Paris, la France; partez pour les États-Unis comme vous en aviez autrefois le projet, tout est fini entre nous!
»Ne me demandez pas pourquoi, ne cherchez jamais à le savoir; aimez-moi assez pour obéir aveuglément.
»Adieu!»
Cette lettre me foudroya. Qu’était-il arrivé et d’où venait cette résolution nouvelle? Pourquoi cette rupture? Pourquoi mon départ? Pourquoi le désespoir visible de cette lettre? Que devais-je faire enfin? Rester ou obéir?
Après une nuit passée dans de déchirantes hésitations, je me décidai à écrire à Nancy en l’avertissant que j’attendais un nouvel ordre. Elle me répondit:
«Partez et oubliez celle qui mourra en vous bénissant.»
Le papier était taché par la trace de ses larmes; je le baisai avec un brisement de cœur indicible, et je partis le soir même pour le Havre.
Huit jours après j’étais en route pour l’Amérique.
Ici le vieillard s’arrêta. La dernière partie de son récit semblait avoir réveillé chez lui des souvenirs ensevelis dans sa mémoire, mais auxquels il revenait avec une joie douloureuse. Il garda quelque temps le silence, comme s’il eût voulu contempler ces fantômes de jeunesse apparus une seule fois dans sa vie, et maintenant si loin de lui.
Les auditeurs respectèrent cette espèce de rêverie. Sans pénétrer le sens de tout ce qu’il venait de leur dire, le portier, Marc et Françoise avaient compris qu’ils entendaient l’histoire d’un grand esprit et d’un grand cœur, et leur amitié pour le vieux voisin s’était insensiblement transformée en une admiration respectueuse. Quant au Furet, il écoutait avec cette patience indifférente des gens qui pensent à autre chose.
Après une assez longue pause, M. Michel releva la tête, et, voyant tous les yeux fixés sur lui:
—Pardon, reprit-il, j’oublie que vous attendez la suite de mon récit; je puis maintenant le terminer rapidement et vous faire franchir, sans nouvelles haltes, un long espace d’années.
Quelques mois après mon arrivée en Amérique, la rencontre d’un voyageur qui arrivait de France me fit apprendre, par hasard, la mort de Nancy.
Cette horrible nouvelle m’ôta tout désir de revenir en Europe: je partis pour les États les plus reculés de l’Union, cherchant à détruire ma douleur par des sensations nouvelles et tâchant de revenir à mes études d’autrefois. Mes efforts réussirent enfin; et, lorsque je repartis pour Paris, six ans plus tard, j’avais complété mes recherches et formulé le système de réorganisation sociale dont je réunissais les éléments depuis tant d’années.
J’avais résolu d’en faire l’essai dans une colonie fondée aux portes mêmes de Paris, afin que son succès ouvrît les yeux aux plus aveuglés. Je consacrai toute ma fortune à cette tentative; mais elle ne suffisait pas, il fallait d’autres ressources. Je m’adressai d’abord au gouvernement, en exposant, dans un mémoire, les misères et l’ignorance du peuple; mais il me fut répondu par l’entremise de mon cousin, qui avait hérité d’un nouveau titre et qui occupait alors d’importantes fonctions, que les gens bien pensants ne désiraient point l’instruction du peuple et ne devaient point parler de sa misère!
J’étais encore tout étourdi de cette réponse, lorsque je reçus la visite d’un homme vêtu de noir, à la mine modeste et au parler caressant, qui avait eu connaissance de mon projet et qui venait me proposer l’appui du clergé. Il demandait seulement quelques petites modifications dans mon plan. J’aurais substitué l’église au théâtre, les processions aux réjouissances publiques, les litanies des saints aux conversations du soir, et le pouvoir absolu du confesseur au pouvoir limité de l’Élu. Ma colonie devenait ainsi un calque des réductions établies par les Jésuites dans le Paraguay. Je remerciai l’homme noir en lui faisant observer que je n’avais point pour but de changer un peuple d’hommes en une troupe d’enfants, et que loin de vouloir organiser la mort, je désirais donner plus d’expansion à la vie.
Après le gouvernement et le clergé restait la bourgeoisie. Je m’adressai à l’un des chefs de cette opposition qui se glorifiait alors de représenter toutes les idées populaires et progressives. Après m’avoir entendu, il me fit observer que la réalisation de mon projet n’aurait aucun résultat sur les élections et serait par conséquent inutile au pays.
Ainsi repoussé par ceux qui avaient en main la richesse ou la puissance, j’en appelai à tous et je fis paraître une exposition de mon système.
Cette publicité, loin de le servir, acheva de le compromettre: je me vis subitement entouré de cette nuée de frelons accoutumés à se nourrir du miel des autres et vivant de piqûres au lieu d’en mourir. Grâce à eux, mes idées furent dénaturées; on m’en prêta que je n’avais jamais eues; on substitua à mon nom un sobriquet grotesque; je devins enfin un de ces jouets qui remplissent, dans la vie, le rôle du niais de mélodrame chargé d’amuser toutes les fois que l’imagination manque à l’auteur, et contre lequel tout est permis.
Voyant que je ne pouvais espérer des autres aucun secours pour mon entreprise, je voulus la tenter seul. Tous mes biens furent engagés et je fis commencer les premiers travaux. Là fut ma faute! J’aurais dû comprendre qu’un système ne pouvait se traduire dans la pratique sans une longue éducation de ceux qui doivent y prendre leur place. Pour que la régénération soit possible, il faut que chacun ait appris son rôle d’homme nouveau, et vouloir lui changer, sans préparation, son atmosphère sociale, c’est transporter subitement dans les zones torrides un habitant né sous le pôle.
Mes ressources étaient insuffisantes d’ailleurs, et, avant que les travaux préparatoires fussent achevés, l’argent manqua.
Ce contre-temps m’affligea, sans me décourager. Désintéressé de ce qui occupe les autres, j’avais reporté tout ce qu’il y avait en moi de force et de patience sur cette idée que je voyais raillée, mais que je sentais féconde. Que m’importait l’injustice des hommes? Christophe Colomb aussi avait été traité de visionnaire, jusqu’au jour où il avait pu montrer à tous son Nouveau-Monde. Or, le mien était là, au milieu même de ceux qui le niaient; il n’y avait qu’à le rendre visible, et une somme médiocre suffisait pour cela.
Mais il fallait l’obtenir à tout prix! Je sollicitai d’abord ceux que j’avais fréquentés dans ma prospérité, puis ceux dont les noms seuls m’étaient connus, puis tout le monde. Enveloppé de mes espérances comme d’un magique nuage qui m’empêchait de voir les regards ironiques et les sourires dédaigneux, j’affrontai tout sans honte. J’avais commencé par m’adresser aux gens qui pouvaient me comprendre et auxquels j’essayai d’expliquer mon projet: mais enfin, repoussé partout, je résolus de m’adresser à la foule.
On voyait alors souvent des mendiants placés debout aux portes des édifices publics, et qui là, une main tendue et la tête voilée, répétaient à chaque passant:
—Pour une pauvre famille!
Ce que leur faisait faire la faim, je voulus le faire pour une idée. Je m’arrêtai un soir près du Louvre, et je présentai la main à ceux qui passaient en disant:
—Pour le bonheur du genre humain!
La singularité de la demande me valut ce soir-là d’abondantes aumônes; elles augmentèrent encore les jours suivants. J’étais devenu un objet de curiosité, et la foule se portait vers le Louvre pour me voir; mais le but même de la quête trahit bientôt celui qui la faisait; mon cousin, informé de quelle manière je déshonorais un nom allié au sien, m’en fit interdire la continuation.
Je me trouvais donc à bout de ressources, lorsque fut votée la loi qui accordait aux émigrés une indemnité pour les biens vendus au profit de la nation.
Outre la Brisaie et ses dépendances, que le dévouement des fermiers m’avait conservées, ma famille possédait, en Bretagne, des domaines considérables dont la Révolution m’avait dépouillé, et qui me donnaient droit à des dédommagements. Je regardai donc la loi nouvelle comme un coup de la Providence. J’étais loin de prévoir ce que celle-ci me préparait.
Un matin je reçus l’invitation de paraître devant un conseil de famille, assemblé d’après l’ordre du tribunal de première instance de la Seine, et j’appris que mon cousin poursuivait mon interdiction.
Je ne m’arrêterai point sur l’interrogatoire que j’eus alors à subir, ni sur celui auquel je fus de nouveau soumis à la chambre du conseil; il suffira de vous dire qu’on s’arma, devant le tribunal, de réponses mal comprises, des passages les plus hardis de mes livres, de l’opinion publique enfin et de mes derniers actes pour me faire déclarer en état de démence.
Mon cousin me fut donné pour tuteur et se trouva ainsi en possession de la nouvelle fortune que je devais à l’indemnité.
Le reste vous est connu. Enfermé dans la maison de santé où cet homme était gardien, j’y suis resté jusqu’à ce que le hasard m’ait permis de fuir. Par un bonheur inespéré, mon ancien propriétaire avait conservé, sans y rien déranger, le petit logement occupé par moi avant ma captivité; je vendis l’ameublement pour satisfaire aux loyers arriérés et je ne gardai que mes papiers, avec ce fauteuil et ce bureau qui avaient appartenu à ma mère.
—Ah! je comprends maintenant pourquoi ils sont si différents de tout le reste, dit Françoise, qui regarda les deux meubles avec attendrissement.
—Oui, reprit doucement le vieillard, ils me parlent de temps meilleurs, mais sans que leur vue ait, pour moi, rien de décourageant: loin de là, il semble qu’elle me réjouisse et me relève, car elle me rappelle ce que j’ai sacrifié à la vérité. En regardant les écussons de ce bureau et la couronne sculptée au haut de ce fauteuil, le pauvre M. Michel se sent fier de n’être plus seigneur de la Brisaie ni duc de Saint-Alofe.
Marc qui écoutait les bras croisés et la tête penchée se redressa à ce mot.
—De Saint-Alofe, répéta-t-il, vous avez dit duc de Saint-Alofe?
—C’est mon nom, reprit M. Michel.
—Et vous êtes seul à le porter?
—Seul.
—Mais alors, s’écria Marc palpitant, la femme que vous avez aimée... c’était la baronne Louis?
Le vieillard tressaillit.
—D’où le savez-vous? demanda-t-il d’une voix altérée.
—C’était elle! reprit Marc avec agitation, ah! je m’explique maintenant son départ pour rejoindre le général en Vendée... puis... plus tard, cette lettre!
Il s’arrêta et passa la main sur son front qui était devenu pâle.
—Achevez, dit le duc.
—Je comprends tout, continua-t-il, sans répondre au vieillard et en se parlant à lui-même; aussi, en mourant, c’était le duc de Saint-Alofe qu’elle appelait..... c’était à lui qu’elle recommandait sa fille.
—Sa fille! interrompit le vieillard saisi, elle a laissé une fille?
—Que son testament confiait à votre tutelle.
—Grand Dieu! et cette fille est vivante?
—Elle est ici, livrée aux mains de la comtesse, sa tante, et bientôt sacrifiée!
—Que voulez-vous dire?
—Que dans quelques jours, elle sera la femme d’un débauché sans cœur, Arthur de Luxeuil.
Le duc fit un mouvement.
—Et elle n’a pour la défendre, ni conseil, ni appui? s’écria-t-il.
—J’en attends un, répliqua Marc, celui-là même qui, en votre absence, a accepté la tutelle, M. de Vercy.
Françoise qui avait jusqu’alors écouté avec un intérêt curieux, interrompit le garçon de bureau.
—Attendez, dit Françoise, de Vercy... il me semble que j’ai déjà entendu ce nom... n’est-ce pas un monsieur qui demeure en province?
—En effet, répliqua Marc.
—Ce doit être lui que j’ai rencontré ce matin à l’hôtel, reprit la grisette; vous savez bien, l’étranger qui demandait l’adresse de M. Dufloc le banquier?... Du reste, je dois avoir la carte qu’il m’a remise; voyez plutôt!
Marc la prit vivement et lut:
DE VERCY,
Conseiller à la Cour Royale d’Angers.
—Ainsi il est arrivé, s’écria-t-il; vous l’avez vu, Madame Charles?
—Hier soir, à l’hôtel des Étrangers. Il faut même que j’y retourne pour l’avertir de ne pas compter sur Charles aujourd’hui; il devait l’attendre vers une heure.
Marc tira sa montre.
—Midi et demi, dit-il; mais avec un cabriolet nous arriverons; vite, mademoiselle Françoise, votre châle, votre bonnet; je vous emmène.
La grisette courut se préparer tandis qu’il cherchait son chapeau.
—Qu’allez-vous faire et qu’espérez-vous? demanda le vieillard anxieux.
—Vous le saurez à mon retour, monsieur le duc, dit Marc en gagnant la porte. Si M. de Vercy fait son devoir, tout peut être encore sauvé. Je ne lui parlerai pas seulement de sa pupille, mais de vous. Il faut que l’interdiction soit annulée, qu’on vous remette en possession de votre nom, de vos biens... Avant la fin du jour, monsieur le duc saura ce que nous pouvons espérer.
Françoise l’attendait aux pieds de l’escalier avec un carton de fleurs qu’elle portait à madame Ouvrard. Tous deux coururent au premier porche, sous lequel stationnait un cabriolet de remise et y montèrent.
En arrivant à l’hôtel la grisette entra au salon pour remettre ses bouquets, tandis que Marc montait au numéro 47.
Les hôtels meublés de Paris ont une physionomie spéciale qui mérite d’être étudiée. Ce ne sont point, comme les auberges de province, des lieux de repos où l’on arrive et d’où l’on part à toute heure, mais des gîtes de nuit que l’on quitte le matin, et où l’on ne rentre qu’après l’heure du spectacle. A voir, pendant le jour, leurs chambres fermées, leurs escaliers déserts, leurs longs corridors silencieux, on dirait une de ces villas royales dont les seuls locataires sont le gardien et le portier.
Le garçon de bureau monta trois étages sans rencontrer personne et arriva à l’appartement indiqué.
Il se composait de deux pièces dont la première servait d’antichambre. Marc y trouva, par hasard, un des garçons de l’hôtel qui sortait avec le plateau du déjeuner et auquel il demanda M. le conseiller de Vercy. Une voix, partant de la pièce voisine, prévint la réponse en criant d’entrer. Le garçon montra la porte au visiteur et se retira.
Mais Marc, après avoir fait un pas en avant, s’arrêta tout à coup sur le seuil qui séparait les deux chambres. Au moment de parler à l’homme qui allait décider du sort d’Honorine, une angoisse douloureuse l’avait saisi; il sembla hésiter.
Or, bien que cette hésitation n’eût duré qu’un instant, elle donna le temps au conseiller, qui se tenait près du foyer, de se retourner et d’apercevoir le garçon de bureau. Il tressaillit, se leva à demi avec une exclamation étouffée et regarda autour de lui, comme s’il eût cherché une issue; mais s’apercevant que Marc venait de se décider à entrer, il se rejeta dans son fauteuil en relevant brusquement le collet de velours qui garnissait son ample redingote verte.
Dominé par sa préoccupation inquiète, le garçon de bureau ne remarqua pas ce singulier mouvement. Il s’avança avec un peu de timidité et s’arrêta, la tête nue, à quelques pas du conseiller. Ce dernier demeura enfoui dans son collet et le mouchoir sur la bouche, de manière à ne laisser voir que ses yeux.
—Monsieur le conseiller m’excusera si je le dérange, dit Marc, en s’assurant par un regard rapide qu’ils étaient seuls; mais il s’agit d’une affaire importante... je viens lui parler de sa pupille, mademoiselle Honorine Louis.
M. de Vercy fit entendre une sorte de grognement et s’agita sur son fauteuil.
—Monsieur le conseiller doit avoir reçu une lettre signée Marc? reprit le garçon de bureau.
—Oui... je crois... me rappeler, murmura l’homme à la redingote verte.
—Ce Marc, c’est moi, Monsieur.
Le conseiller lança au visiteur, par-dessus son collet, un regard flamboyant.
—Après? dit-il brusquement.
—Pardon, reprit le garçon de bureau, un peu étonné des manières du magistrat, mais j’avais promis à Monsieur des explications... que je viens lui donner.
—Plus tard, plus tard! balbutia M. de Vercy, qui semblait éprouver un inexplicable malaise et dont les yeux se tournaient sans cesse vers la porte.
—Plus tard il ne sera plus temps, dit vivement Marc, le mariage de mademoiselle Louis doit avoir lieu demain.
—Eh bien! qu’est-ce que ça me fait? répliqua l’homme à la redingote.
Marc ne put retenir un geste de surprise.
—Monsieur le conseiller a-t-il oublié qu’il est tuteur de mademoiselle Honorine Louis, reprit-il vivement, et, qu’à ce titre, il doit veiller sur son avenir?
—Eh bien? demanda M. de Vercy.
—Eh bien! cet avenir est perdu si elle épouse son cousin, continua le garçon de bureau; car le mariage de M. de Luxeuil n’est qu’un moyen de réparer sa ruine, un arrangement promis à ses créanciers, à sa maîtresse.
En voyant l’agitation de M. de Vercy, qui s’était levé:
—Je puis le prouver, continua-t-il, en élevant la voix; que M. le conseiller s’informe, je fournirai tous les moyens de connaître la vérité. Je lui donnerai les adresses, les noms de ceux qu’il peut interroger.
—Soit, dit le conseiller, qui venait d’entendre la porte de la première chambre s’ouvrir; écrivez-les... sur cette table... je prendrai des renseignements.
Marc, un peu déconcerté du laconisme du tuteur d’Honorine, s’approcha en hésitant de la table qu’il lui avait désignée et s’assit pour écrire. Mais, tout en préparant lentement la plume et le papier, il réfléchissait à ce qu’il devait faire. M. de Vercy avait évidemment un motif pour éviter toute explication, et, d’après son accueil, Marc devait douter au moins de son zèle, sinon de sa loyauté. Il se demandait s’il fallait insister de nouveau ou chercher quelque autre moyen de salut pour la jeune fille, lorsque ses yeux, en se levant, rencontrèrent la glace placée vis-à-vis du bureau sur lequel il écrivait. Tout à coup sa plume s’arrêta, et lui-même demeura immobile de saisissement.
La scène qui se reflétait dans cette glace avait, en effet, quelque chose de trop étrange pour ne pas fixer l’attention.
Le conseiller lui tournait le dos, mais il échangeait des signes rapides avec la personne qui venait d’entrer dans l’antichambre et dont on distinguait de loin la livrée. Il se retournait par instants pour s’assurer que Marc ne pouvait le voir, puis recommençait des gestes qui semblaient devoir signifier:
—Prenez garde! ne vous montrez pas... il est là...
Celui auquel les signes s’adressaient ne les comprit point, sans doute, car il s’approcha à petits pas, et comme en hésitant, jusqu’à l’entrée de la seconde chambre.
Au moment où sa grande taille s’encadra dans la baie de la porte, l’homme à la redingote verte, furieux de ne pouvoir se faire comprendre, lui montra les deux poings fermés et se retourna vers Marc avec effroi.
Dans ce mouvement son collet se rabattit et laissa voir son visage tout entier.
Le garçon de bureau lâcha la plume qu’il tenait, en poussant un cri. Il venait de reconnaître Jacques le Parisien!
Ce qui suivit fut plus prompt que la parole ne peut le dire, aussi prompt que la pensée.
Au cri du garçon de bureau qui s’était levé d’un bond, l’homme en livrée, qui n’était autre que Moser, avait enfin deviné le danger et refermé la porte derrière lui, tandis que Jacques, fouillant dans la poche de côté de sa polonaise, s’était élancé vers Marc: celui-ci se sentit frappé sous l’épaule avant d’avoir pu songer à se mettre en défense. Il recula étourdi; un second coup, puis un troisième l’abattirent.
Le Parisien se précipita à deux genoux sur sa poitrine et lui enveloppa la tête dans le tapis pour étouffer ses gémissements.
—Est-y serfi? demanda Moser qui était resté appuyé contre la porte.
—Ferme, ferme vite! bégaya Jacques.
L’Alsacien fit faire un tour à la clef et accourut.
—Il pouge encore! dit-il en se penchant sur le garçon de bureau.
—Le tourniquet, dit Jacques, dont la voix était épaisse et entrecoupée comme dans l’ivresse.
Le Juif comprit; il releva le couteau que son compagnon avait laissé tomber, passa le manche dans la cravate de Marc, et fit plusieurs tours.
La faible plainte du blessé s’arrêta aussitôt; un frémissement convulsif parcourut ses membres, puis tout resta immobile.
—C’est fait! dit Jacques en rejetant le tapis dont il lui avait couvert le visage.
—Ça été engore blus fite que bour le gonseiller! fit observer Moser.
—Oui, reprit le Parisien; mais pour le conseiller on travaillait en plein air, et il y avait la Loire à côté... tandis qu’ici... qu’est-ce que nous allons faire maintenant de ce ballot?
Avant que l’Alsacien eût en le temps de répondre, un bruit de voix se fit entendre dans la pièce voisine.
Les deux assassins se redressèrent épouvantés.
—Il y a quelqu’un dans l’antichambre, dit Jacques, dont tous les muscles du visage se crispèrent.
—Faut bas oufrir! répliqua le Juif, pâle et les yeux grands ouverts.
—Ils savent que nous sommes ici!
—Ah! c’est frai, gomment sortir alors?
—Faudrait pouvoir cacher la chose, reprit le Parisien qui regardait le cadavre, puis autour de lui.
Tout à coup ses yeux s’arrêtèrent sur une de ces armoires sous tenture, destinées à suspendre les vêtements. Il la montra du doigt à l’Alsacien.
—Là, murmura-t-il; vite, aide-moi!
Moser l’aida à soulever le corps sans mouvement et à le porter jusqu’à la garde-robe. Comme ils le déposaient on frappa doucement à la porte.
—Ne réponds pas, et referme les battants, dit le Parisien en courant au tapis plein de sang qu’il roula dans un coin.
On frappa plus fort.
—Qui est là? demanda-t-il.
—C’est moi, monsieur le conseiller, dit la voix de Françoise; je viens pour cette adresse du banquier...
—Du panquier! répéta le Juif; faut lui barler.
—Tout à l’heure! cria Jacques, je m’habille.
Et se tournant vers Moser:
—Essuie le sang, ajouta-t-il à voix basse; là, près de la fenêtre.
—Et toi, relèfe le gouteau, dit celui-ci.
—Il n’y a plus rien?
—Je crois.
—Ouvre alors.
—Bas encore, bas encore!... Faut bien regarder bartout... Si la betite allait foir quéq’ chose...
—Tant pis pour elle, dit Jacques, dont la main serrait convulsivement le manche du couteau; le garçon qui la conduisait est redescendu... Quoi qu’il arrive, j’empêcherai bien la fille de nous vendre. Ouvre, je te dis.
—Foilà!
—Et surtout garde la porte; on ne sait pas ce qui peut arriver.
Tout cela s’était dit rapidement et à voix basse, tandis que le Juif faisait disparaître les traces du meurtre; il se dirigea enfin vers la porte qu’il ouvrit.
La grisette entra leste et riante.
—Tiens! où est donc monsieur Marc? demanda-t-elle en apercevant seulement les deux, compagnons qu’à leurs costumes elle prenait pour le maître et le valet.
—Quel monsieur Marc? répliqua Jacques d’une voix rauque.
—Eh bien! mais celui qui était tout à l’heure avec monsieur le conseiller, reprit Françoise en souriant; le garçon de l’hôtel m’a dit qu’il vous avait laissés ensemble.
—C’est-y pour le gercher que fous êtes fenue? demanda Moser brusquement.
—Non, dit la jeune fille étonnée; mais je ne comprends pas comment il a pu sortir.
En parlant ainsi, elle promenait autour d’elle un regard curieux, comme si elle eût encore espéré apercevoir le garçon de bureau. Jacques fit un geste d’impatience.
—Tonnerre! vous voyez bien que nous sommes seuls! dit-il d’un ton brutal; je suis pressé; finissons! Qu’est-ce que vous avez à me dire?
A cette violence inattendue, Françoise, qui n’avait point jusqu’alors pris garde à son interlocuteur, releva la tête et fut frappée de l’altération de ses traits.
—Pardonnez-moi, Monsieur, dit-elle d’une voix tremblante; je voulais... j’étais venue...
—Pour l’adresse de M. Tufloc! interrompit Moser; fotre mari toit fous l’afoir tonnée?
—Pas encore, reprit Françoise timidement, et je venais justement pour vous avertir que Charles ne pourrait vous voir avant demain.
—Au diable! interrompit Jacques en frappant du pied, ce serait trop tard pour faire payer le billet.
—Trop tard! c’est bas bossible, s’écria le Juif, un pillet de garante mille francs!
—Veux-tu aller le présenter demain, toi, quand nous aurons quitté l’hôtel, dit le Parisien en jetant un regard significatif vers l’armoire...
Le Juif fit un geste de désespoir.
—Imbécile! d’avoir attendu les renseignements de cette fille, reprit Jacques avec une véritable rage.
—Elle tisait que son mari était tans la panque! fit observer Moser.
—Oui, et grâce à elle nous perdrons tout.
—C’est frai... c’est elle qui est gause...
Tous deux lancèrent à Françoise un regard qui la fit trembler. Le Parisien était appuyé au marbre de la cheminée, pâle et farouche, tandis que Moser barrait l’entrée. La grisette laissa tomber le carton qu’elle tenait, et recula de quelques pas en essayant de se justifier d’une voix entrecoupée; mais tout à coup elle s’interrompit.
Derrière elle, il lui avait semblé qu’un sourd gémissement sortait de la muraille.
Elle se retourna glacée de surprise et prêta l’oreille.
Les deux associés avaient également entendu la plainte et vu le mouvement de la jeune fille, ils se lancèrent un regard; Moser se rapprocha de l’entrée, tandis que le Parisien portait la main à la poche de sa polonaise.
Il se fit une pause, et il y eut une attente terrible; mais tout resta silencieux.
Persuadée qu’elle s’était trompée, Françoise balbutia de nouveau quelques excuses, releva le carton qui lui était échappé, et s’avança vers la porte. Après avoir interrogé Jacques du regard, l’Alsacien tira sans affectation le verrou qu’il avait précédemment poussé, et se rangea pour la laisser passer. La grisette franchit rapidement l’antichambre et disparut.
—Maintenant donnons-nous la (prenons la fuite), dit précipitamment le Parisien en boutonnant sa redingote et saisissant près de la cheminée un rotin plombé.
—Tu as l’archent, au moins? demanda Moser.
—Oui, et le portefeuille?
—Le foici.
—Allons, en route.
—Je fais, je fais, dit le Juif qui se mit à réunir à la hâte quelques effets.
Mais voyant que Jacques partait sans l’attendre et avait déjà gagné l’escalier, il se décida à tout abandonner et à le suivre.
Cependant Françoise, redescendue toute troublée, s’était arrêtée à la loge pour y demander Marc; on ne l’avait point vu sortir. Madame Ouvrard, qui arriva dans ce moment, remarqua la pâleur de la grisette et demanda ce qu’elle avait.
—Ce sont vos voyageurs d’en haut... qui m’ont fait peur... répliqua Françoise haletante.
—Quels voyageurs?
—Ce conseiller, vous savez bien... et son domestique.
—Vous auraient-ils manqué, par hasard?
—Non... oh! non; mais ils se sont mis en colère parce que Charles ne pouvait venir... et ils avaient un air... puis... il m’a semblé entendre...
—Quoi donc?
—Rien... rien, dit la grisette en cherchant à sourire; c’est drôle comme il y a des jours où l’on se saisit pour peu de chose... vrai, j’ai cru un moment qu’ils voulaient me faire du mal... mais voilà qui est fini... Seulement, je ne comprends pas comment M. Marc a pu repartir.
—Repartir, dit madame Ouvrard, c’est impossible; le cabriolet est toujours là.
Françoise regarda à travers le vasistas de la loge.
—C’est pourtant vrai! s’écria-t-elle; comment ça peut-il se faire?... il n’y avait pourtant personne avec ces messieurs.
—Ah! mon Dieu! dans quoi que vous avez marché, m’ame Charles? interrompit la portière; vos pas marquent partout.
Françoise baissa les yeux et aperçut, en effet, la trace de son brodequin imprimée sur le tapis de jonc.
—C’est une empreinte rouge et humide, reprit madame Ouvrard étonnée... on dirait du sang.
Françoise poussa un cri.
—Du sang... en haut... bégaya-t-elle; ah! mon Dieu!... et ce bruit que j’ai entendu.
—Quel bruit? demanda l’hôtesse.
—C’était comme un gémissement!...
Les trois femmes se regardèrent.
—Allons, elle est folle! reprit madame Ouvrard, la peur lui aura fait tinter les oreilles.
—Non, non, insista Françoise, je suis sûre... et puis je me rappelle maintenant... ils n’ont point ouvert tout de suite... et quand je suis entrée à la fin, ils avaient un air!... Oh! ce ne sont pas des voyageurs comme les autres, madame Ouvrard.
—Mon Dieu! reprit l’hôtesse, que le trouble de la jeune ouvrière commençait à gagner, sans qu’elle voulût l’avouer, s’il ne faut que cela pour vous rassurer, je puis envoyer Olivier au numéro 47 où ils logent...
—Les voilà qui sortent! interrompit vivement la portière.
Françoise et madame Ouvrard avancèrent la tête. Moser et Jacques franchissaient rapidement la porte cochère.
—Ils ont l’air de s’enfuir, dit celle-ci frappée de leur précipitation.
—Et ils n’ont point remis la clef, fit observer la portière.
Madame Ouvrard sonna vivement; deux garçons accoururent.
—La double clef du numéro 47? demanda-t-elle.
Un des garçons alla la prendre et tous montèrent ensemble à l’appartement indiqué.
Ils ouvrirent la première porte et traversèrent la pièce qui servait d’antichambre sans rien remarquer; mais arrivés à la seconde, madame Ouvrard fut frappée du désordre dans lequel Jacques et Moser l’avaient laissée. Elle approcha du bureau et aperçut sur le carreau quelques traces de sang mal essuyé; ce sang formait une traînée encore humide jusqu’à l’armoire dont la clef avait été emportée; mais un garçon souleva, avec effort un battant qui s’ouvrit et laissa voir le corps sanglant de Marc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Après le premier moment d’épouvante, le commissaire et le médecin furent appelés. Le premier dressa procès-verbal tandis que le second s’efforçait de ranimer le garçon de bureau qui donnait encore quelques signes de vie. Françoise, à qui la possibilité d’être utile avait rendu tout son courage, l’aida avec autant d’intelligence que de zèle, et, grâce à leurs soins, le blessé finit par reprendre ses sens.
Ses regards, après avoir flotté un instant, s’arrêtèrent sur la fleuriste et il lui tendit la main.
—Voyez, voyez, il me reconnaît, s’écria-t-elle avec ravissement; pas vrai, monsieur Marc, que vous me reconnaissez?
Celui-ci fit, de la tête, un signe affirmatif.
—Si le blessé a recouvré ses facultés, dit le commissaire en s’approchant, nous allons procéder à l’interrogatoire...
—Je m’y oppose! interrompit le médecin; dans l’état où il se trouve, la plus légère fatigue peut être funeste.
—Je ferai observer à monsieur le docteur que le moindre retard peut être irréparable, répliqua vivement le premier interlocuteur; si la victime a peu d’instants à vivre on aura perdu l’occasion d’obtenir d’elle de précieuses lumières.
—Pour le moment, reprit le médecin, il s’agit avant tout de secourir un être qui souffre.
—Il s’agit avant tout de punir des coupables, Monsieur, ajouta le commissaire.
—Je déclare que vous ne l’interrogerez pas! s’écria le docteur.
—Je déclare contradictoirement que je l’interrogerai! répliqua le commissaire.
—Mon Dieu! vous allez le tuer avec vos discussions, interrompit Françoise; à quoi sert de dire qu’il faut ou qu’il ne faut pas l’interroger, est-ce que vous ne voyez pas que le pauvre cher homme veut parler sans pouvoir; ses lèvres remuent et on n’entend rien.
Le commissaire et le docteur constatèrent la justesse de la remarque, en se penchant sur le blessé.
—Dans ce cas, dit le premier, je vais clore mon procès-verbal par la déclaration que ledit Marc, interpellé, s’est trouvé hors d’état de répondre. A-t-on fait demander un brancard?
—Il vient d’arriver, répliquèrent plusieurs voix.
Le commissaire réunit ses papiers.
—Alors c’est à M. le docteur d’indiquer les précautions à prendre pour le transport du blessé, dit-il enfermant son portefeuille de maroquin.
—Mon Dieu! qu’on le porte le plus doucement possible, répliqua le médecin, qui, du moment qu’on cessait de lui disputer le patient, n’avait plus de raison pour y tenir.
Il mit ses gants, le commissaire prit son chapeau, et tous deux sortirent sans se saluer.
Le lendemain, toute la presse parisienne racontait l’événement arrivé à l’Hôtel des Étrangers.
On lisait d’abord dans les journaux ministériels:
«Un meurtre dont les circonstances ne sont point encore connues, vient d’être commis dans un des hôtels de la rue Richelieu. Aussitôt que le commissaire du quartier, M. Levasseur, en a été averti, il s’est transporté sur les lieux et a procédé à l’information du crime avec son zèle et son intelligence accoutumés. Les améliorations apportées dans les services de sûreté publique par la présente administration, ne permettent point de douter que l’on n’arrive à la découverte des coupables.»
Puis, dans les journaux de l’opposition:
«Encore une nouvelle preuve de l’incurie du Pouvoir pour tout ce qui intéresse la fortune ou la vie des citoyens.. Un homme vient d’être assassiné et dépouillé en plein jour, dans un des hôtels de la rue Richelieu; M. le docteur Arnout, qui demeure vis-à-vis, au numéro 24, a été heureusement averti sur-le-champ, et grâce à son habileté le blessé a pu être rappelé à la vie.»
Cependant Françoise, restée seule près du garçon de bureau, avait aidé à le placer sur le brancard, et l’avait suivi jusqu’à l’hôpital. Arrivée là, elle voulut prendre congé de lui en promettant de revenir le lendemain.
Mais cette promesse sembla réveiller chez Marc toute une série de souvenirs; il fit un effort pour relever la tête, et ne put lui faire quitter le traversin qui la soutenait. Une expression de désespoir crispa ses traits.
—Ne craignez rien, répéta Françoise, persuadée qu’il ne l’avait pas comprise; je reviendrai demain, vous dis-je... et de bonne heure!
Le blessé étendit les mains avec angoisse et voulut parler, mais les paroles n’arrivèrent à l’oreille de Françoise que connue un murmure inintelligible. Elle se pencha sur le brancard.
—Allons, tranquillisez-vous, cher monsieur Marc, dit-elle d’un accent attendri; tout ira bien... Vous voudriez me dire quelque chose, n’est-ce pas... est-ce pour me demander d’avertir à votre bureau?... ou de veiller à votre chambre... Non, mon Dieu! quoi donc alors?...
L’expression du blessé était déchirante à voir; ses lèvres s’agitaient pour parler, ses paupières tremblaient et tout son visage était contracté par un effort suprême! enfin, la continuité de cet effort brisa le sceau glacé qui fermait ses lèvres; un faible son arriva jusqu’à la jeune ouvrière, qui se pencha davantage et sentit mourir à son oreille le nom du duc de Saint-Alofe!
C’était lui que le blessé voulait voir; elle courut à la rue des Morts pour le lui ramener.
Depuis le consentement arraché à Honorine et la résolution prise par celle-ci de persister dans son sacrifice, tout avait marché au gré d’Arthur et de sa mère. La veille du mariage était arrivée sans que l’on eût entendu parler de M. de Vercy, et de Luxeuil se réjouissait d’un retard qu’il ne pouvait comprendre, mais dont il espérait bien profiter.
Il venait de quitter le notaire chargé du contrat de mariage, après avoir longtemps discuté avec lui et la comtesse toutes les dispositions qui pouvaient être introduites dans l’acte, à son avantage, et il allait sortir lorsqu’un domestique annonça:
M. le docteur Vorel avec la mère Louis.
La foudre tombant aux pieds de la comtesse et de son fils eût causé, à tous deux, moins de saisissement. Ils se levèrent d’un même mouvement et voulurent faire répéter les noms; mais la porte fut tout à coup poussée avec fracas et laissa voir les deux personnages qu’on venait d’annoncer.
Les années avaient passé sur M. Vorel, sans laisser de traces trop sensibles; elles ne lui avaient donné ni la maigreur ni l’embonpoint qu’amène habituellement la vieillesse. C’était toujours le même homme, sauf un peu moins de souplesse dans les attitudes. La tête seule, devenue chauve au-dessus des tempes et garnie, au milieu, de cheveux grisonnants, avait pris je ne sais quel faux air vénérable qui rendait l’expression du visage plus trompeuse pour la foule et plus redoutable aux vrais observateurs. Quant à la mère Louis, c’était une grosse femme tannée par le soleil, forte en couleurs et portant le costume des paysannes normandes dans toute sa splendeur.
La comtesse et Arthur étaient restés pétrifiés à l’autre extrémité du salon, lorsque la paysanne les aperçut.
—Ah! ah! ça doit être ça le bourgeois et la bourgeoise, dit-elle, en quittant le bras de Vorel.
—Vous ne vous trompez pas, ma mère, répliqua celui-ci, qui salua profondément; c’est madame la comtesse et M. de Luxeuil.
—C’est ça le marieux, s’écria la mère Louis en riant; eh bien! y me va; il est gentil tout plein... Viens embrasser ta grand’mère, mon garçon.
Arthur se contenta d’incliner légèrement la tête.
—C’est là tout ce que tu me fais d’agriotes[G] (caresses), s’écria la mère Louis scandalisée.
—Pardon, ma mère, fit observer Vorel de sa voix pure et caressante; mais notre arrivée est si inattendue.
—Inattendue... répéta aigrement la vieille femme; quand ils m’ont invitée c’était donc pour me faire chaper (promener)? Alors ils n’ont qu’à le dire. Mais, en tous cas, je veux voir la fieule; je suis sa grand’mère. Après tout, on ne peut pas l’épouser contre mon gré; et, comme on dit au pays:
A cette espèce de menace, la comtesse fit un mouvement.
—Que madame Louis nous excuse, dit-elle avec un effort visible, mais comme sa lettre ne disait point qu’elle dût venir...
—Je crois bien, interrompit la grosse femme, je voulais vous sourguer (surprendre); mais si c’est comme ça que vous recevez les gens, on peut retrousser pignole. (s’en aller) avec son fait et sans signer au contrat.
Ces derniers mots, prononcés avec une irritation criarde, rappelèrent brusquement à la comtesse et à son fils ce que l’on pouvait attendre de la mère Louis. Ils se consultèrent de l’œil, échangèrent un signe, et leur froideur disparut à l’instant même, comme par enchantement.
—Que dites-vous là, s’écria madame de Luxeuil, qui courut à la vieille femme et la prit par les mains, vous en retourner!... Ah! nous sommes trop heureux que vous vous soyez décidée à venir... Mais, nous l’espérions si peu, qu’au premier moment j’ai été tout étourdie... j’ai cru que je me trompais... Asseyez-vous donc, chère madame Louis... et vous, docteur...
—Merci, merci, ce n’est pas la peine, dit la mère Louis qui se laissa conduire de mauvaise grâce jusqu’à la causeuse.
—Vous êtes arrivée aujourd’hui? interrompit madame de Luxeuil en s’adressant à Vorel.
—A l’instant, madame la comtesse, répondit le médecin..
—Mais madame Louis doit avoir besoin de repos, interrompit vivement Arthur; il faut faire préparer sa chambre.
Et il tira violemment le cordon de la sonnette.
—C’est inutile! répliqua la paysanne, dont le mécontentement n’était point apaisé.
—Madame Louis préfèrerait peut-être prendre quelque chose, dit la comtesse avec empressement; un bouillon, par exemple!
—Non, dit la vieille femme.
—Du café, alors?
—Non, non.
—Une côtelette et du Madère! proposa Arthur.
La figure de la mère Louis se dérida un peu.
—Du Madère! répéta-t-elle, en se tournant vers le docteur; j’ai jamais bu de ça; est-ce que c’est bon, mon mière (médecin)?
Vorel fit un signe affirmatif.
—Voyons donc la côtelette... et le... comme il a dit, le jeune gars... Puisqu’on est à Paris, faut faire un peu de riotte.
Madame de Luxeuil donna les ordres nécessaires au valet qui venait d’entrer. Honorine, avertie, arriva bientôt émue et se jeta dans les bras de sa grand’mère en sanglotant.
—Eh bien! qu’est-ce qu’elle a donc! s’écria la paysanne, en l’embrassant; ça la fait pleurer de me voir!... Allons, allons, veux-tu bien essuyer tes yeux, petiote; ne geins pas comme ça; je suis tout plein contente; sois contente itou (aussi).
Et elle l’embrassa de nouveau.
Mais dans la disposition où se trouvait Honorine, la brusque arrivée de sa grand’mère était comme un choc inattendu qui avait tout remué au fond de ce cœur bourrelé; ses larmes, loin de s’arrêter sous les caresses de la paysanne, semblèrent redoubler.
—Est-elle picheline (pleureuse) au moins, dit la mère Louis, en se laissant gagner, sans savoir pourquoi, à l’attendrissement de sa petite-fille; voyons, en voilà assez, ma nerchibotte (petite); est-ce qu’on n’est pas contente donc de se marier?
Honorine qui était à genoux sur un tabouret, aux pieds de la vieille femme, lui baisa les mains.
—Ça n’est pas une réponse, continua la mère Louis intéressée malgré elle; allons, Honorine, il ne faut pas tant de beurre pour faire un quarteron; réponds oui ou non.
—Voici les côtelettes et le Madère, interrompit Arthur, qui vit le domestique paraître avec un plateau.
Cette diversion inattendue changea le cours des idées de la mère Louis; elle tourna les yeux vers le déjeuner que l’on venait de poser sur un petit guéridon de laque, et cette expression de gourmandise comprimée, particulière aux paysans, illumina tous ses traits.
—Ah! c’est déjà prêt, dit-elle; eh bien! à la bonne heure! il n’y a pas moyen de muler (bouder) quand on voit un pareil festin.
Et comme Honorine se penchait sur son épaule, elle continua en la forçant à se relever:
—Allons, il y a temps pour tout; ma fieule, voilà assez d’oremus; tu vas manger une bouchée avec moi.
Honorine s’excusa.
—A ton idée, reprit la vieille, qui ne voulait point perdre en explications un temps qu’elle pouvait mieux employer; ton oncle, lui, acceptera. Pas vrai, mon mière, que vous profiterez de la bonne occasion? c’est son droit, voyez-vous; car, comme dit le proverbe:
«S’il pleut sur le curé, il dégoutte sur le vicaire.»
La manie des proverbes normands était une des infirmités de la vieille paysanne.
M. Vorel s’inclina en signe d’assentiment, et se mit à table avec sa belle-mère.
Celle-ci trouva tout excellent, surtout le Madère qu’Arthur lui versa, et auquel elle revint avec une persistance qui finit par alarmer madame de Luxeuil. La gaieté de l’ancienne meunière devenait à chaque instant plus bruyante et plus communicative; elle s’écria enfin, en frappant sur les genoux de la comtesse:
—Pardi! vous êtes une bonne chrétienne, mam’ Luxeuil, et qui avez pas de grecquerie (avarice); j’aime ça, moi; aussi, je vous le revaudrai. Vous verrez ce que je ferai pour la petiote et pour le gars; quéque chose qui les aidera! car tout le monde a besoin d’aide: on aide bien au bon Dieu à faire le bon blé.
La comtesse et Arthur voulurent la remercier, mais elle les interrompit en disant qu’il fallait attendre au lendemain, après la noce, que pour le quart d’heure c’était assez jacasser et qu’elle voulait se reposer.
Madame de Luxeuil proposa de la conduire à l’appartement qu’elle devait occuper.
—Non pas vous, dit la grosse femme que le vin de Madère avait rendue égrillarde, mais votre jeune gars: je veux qu’il soit mon valantin (galant); sans te faire tort, pourtant, fieule, ajouta-t-elle en se tournant du côté d’Honorine; je ne le garderai pas longtemps: «ce qui vient de flot s’en va de marée.»
Et se retournant vers le docteur:
—Eh bien! mon mière, est-ce que vous ne voulez pas vous mettre aussi un peu en galatine (vous coucher)? Vous devez avoir besoin de dormir, car vous êtes tout évêque d’Avranche (tout absorbé).
M. Vorel déclara qu’il préférait jouir de la compagnie de madame de Luxeuil, et la mère Louis sortit avec Arthur.
Mais celui-ci ne tarda point à revenir, en annonçant que la vieille paysanne avait trouvé une payse parmi les servantes de l’hôtel et qu’il les avait laissées ensemble parlant patois. La comtesse ne put retenir un geste de contrariété; le médecin sourit.
Bien qu’il eût jusqu’alors gardé le silence, rien ne lui avait échappé. Il avait seul décidé la mère Louis à faire le voyage de Paris, et ce voyage n’était point pour lui sans motifs; mais il voulait, avant tout, bien connaître le terrain et savoir par quel côté on pouvait s’avancer. Dès le premier coup d’œil, il crut comprendre que le mariage projeté souriait peu à la jeune fille. Quelques questions adroites achevèrent de le convaincre et il laissa voir qu’il l’avait deviné.
La comtesse et Arthur, qui connaissaient l’habileté du docteur, furent sérieusement effrayés. La première se hâta de saisir un prétexte pour faire sortir Honorine.
M. Vorel la suivit du regard jusqu’à ce qu’elle eût disparu.
—C’est singulier, dit-il, avec une sorte d’hésitation, mais je ne trouve point à notre chère nièce la joyeuse émotion que donne habituellement l’approche du mariage; elle paraît triste, tourmentée; on dirait qu’elle cache un secret toujours prêt de faire explosion.
—Honorine! s’écria madame de Luxeuil, qui cacha son inquiétude sous un air de gaieté; en vérité, docteur, vous la trouvez triste?... vous pensez qu’elle cache un secret!... ah! ah! ah! mais vous n’avez donc jamais vu de jeune fille qui se marie?
—Il se peut que je sois, à cet égard, mauvais observateur, dit Vorel avec humilité; mais, en tout cas, on pourrait interroger la jeune fille, et si sa grand’mère voit comme moi... de travers, vous pouvez compter qu’elle n’y manquera pas.
—Et quand elle le ferait, reprit Arthur avec impatience; le docteur pense-t-il donc que nous ayons fait violence à ma cousine?
Vorel le regarda à travers ses lunettes bleues.
—Je suis persuadé du contraire, dit-il avec une lenteur et une immobilité dont l’expression contredisait évidemment sa protestation; le choix de notre chère nièce n’a pu être déterminé par aucune menace, ni par aucune captation, il a été complétement libre; mais monsieur de Luxeuil sait comme moi que la volonté d’une jeune fille est variable.
—Que voulez-vous dire, Monsieur?
—Je veux dire que si la grand’mère Louis se mettait à interroger sa petite-fille sur son air triste, c’est une supposition... et que celle-ci exprimât, par hasard, le désir de voir ajourner le mariage... ou d’y renoncer... je fais encore une supposition... la grand’mère serait capable de tout rompre.
Arthur fit un mouvement.
—Oh! c’est une femme terrible, ajouta Vorel d’un air paterne, et elle n’écoute jamais que son inspiration...
—Vous oubliez qu’elle a donné son consentement, fit observer madame de Luxeuil.
—Sans doute, sans doute, répliqua le médecin avec déférence; mais madame la comtesse comprend bien que ce consentement deviendrait inutile si notre chère nièce changeait d’avis... Il est bien entendu que c’est toujours une supposition...
—Dont monsieur Vorel voudrait faire une réalité! acheva Arthur qui était à bout de patience.
Le médecin feignit l’étonnement.
—Moi, dit-il: monsieur de Luxeuil ne me rend pas justice; nul ne désire au contraire plus vivement que moi la conclusion de son mariage... d’autant qu’il me permettra de terminer une affaire qui m’occupe depuis longtemps.
La mère et le fils échangèrent un regard; ils venaient de comprendre le but du voyage de Vorel.
—Monsieur le docteur devait débuter par cet aveu, dit madame de Luxeuil d’un ton railleur.
—Je tâche de commencer par le commencement, madame la comtesse, répliqua le docteur avec le sourire équivoque dont il avait l’habitude.
—Et peut-on savoir de quoi il s’agit? demanda Arthur.
—Mon Dieu, rien de plus simple! La baronne possédait en Touraine une petite forêt enclavée dans un domaine appartenant à mon fils, du chef de sa mère, et que je voudrais acquérir à des conditions raisonnables. Jusqu’à présent la minorité d’Honorine a été un obstacle; mais désormais je puis traiter avec monsieur de Luxeuil.
—Soit, dit Arthur, après le mariage.
—Oh! non, reprit Vorel en souriant, après le mariage il serait trop tard; une rédaction de contrat troublerait les enchantements de la lune de miel; puis, je repars sur-le-champ. Je voulais proposer au contraire à monsieur de Luxeuil de tout régler aujourd’hui.
—Aujourd’hui, répéta Arthur; mais je n’ai encore aucun droit.
—Qu’importe? L’acte peut être post-daté de deux jours; le notaire de madame la comtesse connaît trop bien les affaires pour se refuser à un pareil arrangement.
—Cependant, Monsieur...
—Allons, ne me refusez pas, interrompit le médecin avec son sourire embarrassant, c’est un moyen de m’obliger à faire des souhaits pour que ce mariage ne rencontre aucun obstacle, et je suis généralement heureux dans ce que je souhaite.
Arthur parut hésiter.
—J’ai avec moi l’argent, ajouta Vorel, voudriez-vous m’obliger à le remporter?
L’idée d’un paiement immédiat décida de Luxeuil.
—Eh bien, soit, pardieu! dit-il; puisque vous voulez que je vende d’avance la peau de l’ours, allons chez le notaire et nous discuterons le prix.
Lorsqu’ils revinrent tous deux quelques heures après, la vente de la forêt était conclue, et leurs deux signatures données; quant à celle d’Honorine, M. Vorel se faisait fort de l’obtenir.
La jeune fille se trouvait, en effet, dans une situation d’esprit qui ne lui permettait guère de rien débattre ni de rien refuser. Arrivée au moment d’accomplir le sacrifice, son courage avait fait place à une sorte de stupeur résignée. Elle se laissa parer sans émotion, sans regret, sans effroi; elle avait cessé de sentir et de penser. La mère Louis avait beau lui répéter qu’elle allait avoir un fel gars (brave garçon) pour mari, et qu’une épouseuse devait avoir la mine plus acoquetée (fraîche), Honorine répondait affirmativement à tout, mais sans avoir compris ce qu’on lui disait, ni ce qu’elle répliquait elle-même. Enfin, l’heure venue, elle descendit au salon où attendaient le notaire et les témoins. C’étaient le marquis de Chanteaux, le prince Dovrinski, Marquier et de Cillart. Le contrat de mariage fut lu sans donner lieu à aucune observation; mais au moment de signer, la mère Louis prit la parole.
—Un instant, s’écria-t-elle: maintenant que le grand noir a fini, c’est à mon tour. Vous avez mis là tout ce que les épouseurs se donnaient l’un à l’autre... en fortune s’entend... eh bien! ajoutez un article pour la mère Louis.
Le notaire s’inclina et prit une plume.
—Mettez, reprit la paysanne en se rengorgeant, que le jour où la petite aura son premier, la grand’mère promet d’envoyer pour le trousseau deux cents écus!...
Ces mots avaient été prononcés d’un air de majesté si triomphante que le notaire crut avoir mal compris.
—Pardon, madame, reprit-il; vous avez dit?...
—Deux cents écus! répéta la mère Louis, en appuyant sur chaque syllabe.
Le notaire promena autour de lui un regard embarrassé.
—Écrivez, écrivez, Monsieur, dit Arthur, qui cachait son désappointement sous une gaieté forcée; les petits présents entretiennent l’amitié. Madame Louis m’a, en outre, promis ma provision de mascapié (confiture de pomme).
—Et je ne m’en dédis pas, mon gars, continua la paysanne, qui n’avait point saisi la raillerie; je vous l’enverrai toutes fois et quantes il y aura du cidre, comme on doit en avoir cette année, car vous connaissez la règle:
Seulement faut pas parler du mascapié dans l’acte; parce que je veux envoyer ça d’amitié!...
L’addition demandée par la mère Louis une fois faite, les signatures furent données, et l’on vint avertir que les voitures étaient attelées.
M. le marquis de Chanteaux s’avança vers Honorine le sourire sur les lèvres; mais, à ce moment suprême, la vie, pour ainsi dire suspendue chez la jeune fille, se réveilla brusquement: elle eut tout à coup conscience de ce qui venait d’avoir lieu, de ce qui se préparait, et elle se sentit glacée d’épouvante.
Le marquis resta quelques instants devant elle, le bras tendu, et répéta l’annonce qui venait d’être faite; mais Honorine, pâle, les yeux fixes, les deux mains crispées sur les bras du fauteuil, demeura immobile. Une crise terrible s’opérait en elle. Près d’accomplir le sacrifice accepté, une de ces répugnances, qui sont comme l’instinct de conservation de l’âme, venait d’anéantir subitement son courage. En vain la volonté luttait, en vain elle se répétait il le faut! il le faut! une force invincible la retenait enchaînée.
M. de Chanteaux, déconcerté de son silence et de son immobilité, se tourna vers madame de Luxeuil, qui s’approcha vivement et voulut lui prendre la main; elle était raide et glacée! La comtesse essaya de l’encourager par quelques paroles affectueuses; la jeune fille n’entendait plus: l’espèce de combat que se livraient en elle deux puissances contraires, était au-dessus de ses forces; après quelques instants d’une apparente insensibilité, ses lèvres pâlirent, sa tête flottante se renversa et elle s’évanouit.
Il y eut un moment d’effroi parmi les assistants; mais M. Vorel les rassura. Il fit transporter la jeune fille dans une pièce voisine et revint bientôt avec madame de Luxeuil, en annonçant qu’elle avait repris ses sens et qu’un repos de quelques instants suffirait pour la remettre. Arthur s’excusa près des témoins de ce retard imprévu et, pour rendre l’attente plus facile, leur proposa d’entrer chez lui, où ils pourraient parcourir les journaux, tandis que la mère Louis, à qui l’accident de sa petite fille avait tourné le cœur, passait à l’office pour prendre quelque chose.
Restés seuls, la comtesse et le docteur allaient retourner près d’Honorine, quand la porte du salon s’ouvrit tout à coup à deux battants: le domestique entra et annonça à haute voix: Monsieur le duc de Saint-Alofe.
En renonçant au nom de M. Michel, le vieillard avait également quitté le costume sous lequel nous l’avons jusqu’à présent montré aux lecteurs, le pantalon à pied se trouvait remplacé par une culotte de casimir blanc, serrée sur les bas de soie au moyen d’une boucle de vermeil, et la douillette fourrée, par un habit bleu, à collet étroit, qui laissait voir un gilet de piqué, couleur paille. Sa cravate de batiste, jaunie par le temps, était brodée aux coins et retombait sur un jabot de Malines presque droit; enfin la chaussure découverte et arrondie avait pour ornement une petite cocarde de ruban noir satiné.
C’était un costume de l’Empire avec toute cette fraîcheur flétrie des vêtements longtemps conservés sans qu’on en ait fait usage, et il ne fallait pas moins que la physionomie austère du vieillard pour lui ôter ce qu’il pouvait avoir de ridicule et de suranné.
A ce nom de Saint-Alofe annoncé par le laquais, madame de Luxeuil s’était détournée stupéfaite; mais en apercevant le duc dans le même costume qu’il portait lors de leur dernière rencontre, elle le reconnut sur-le-champ, malgré les ravages des années, et poussa une exclamation d’épouvante.
L’arrivée de M. de Saint-Alofe dans un pareil moment avait, en effet, quelque chose de si redoutable que toute sa présence d’esprit l’abandonna; elle demeura debout à la même place et comme hallucinée par un fantôme.
Cependant le duc, s’étant avancé lentement vers elle, s’inclina; par un mouvement machinal la comtesse rendit le salut, lui montra un fauteuil et se laissa retomber elle-même sur la causeuse qu’elle occupait un instant auparavant.
Jusqu’alors aucune parole n’avait été échangée. Vorel, étonné, regardait alternativement madame de Luxeuil et le duc; enfin celui-ci, qui était resté debout comme s’il eût attendu la sortie du médecin, se tourna vers la mère d’Arthur.
—Je crains que ma visite ne paraisse importune, dit-il avec une froideur polie; je sais qu’elle interrompt une solennité de famille...
—Il est vrai, balbutia madame de Luxeuil en s’efforçant de se remettre; c’est aujourd’hui que mon fils se marie; le contrat vient d’être signé...
—Déjà! interrompit le duc; vous avez fait diligence, madame la comtesse.
—Loin de là, Monsieur, reprit madame de Luxeuil qui, en parlant, retrouvait peu à peu son sang-froid; nous sommes au contraire en retard, et depuis longtemps les témoins attendent...
—Ah! vous avez les témoins, répéta le duc en regardant fixement la comtesse; et... parmi eux, Madame, s’en trouve-t-il un qui puisse être pour mademoiselle Honorine Louis un défenseur éclairé et sérieux?
—Un défenseur... Qui vous fait supposer qu’elle en ait besoin, Monsieur?
—Sa position, madame la comtesse, et surtout son âge qui lui donne droit à l’appui d’un tuteur.
—Aussi avions-nous espéré M. de Vercy, fit observer madame de Luxeuil; mais, malgré ses promesses, il n’est point arrivé...
—Et il n’arrivera pas, ajouta le vieillard avec gravité; car M. le conseiller de Vercy est mort assassiné!
La comtesse jeta un cri.
—Assassiné! répéta-t-elle; où cela? grand Dieu!
—M. de Vercy a succombé en chemin, reprit le duc, sous les coups de deux misérables qui se sont ensuite présentés à Paris, à sa place, dans l’espoir de se faire payer des sommes qui lui étaient dues. Un homme les a reconnus, ils l’ont frappé, et c’est en écoutant tout à l’heure son interrogatoire que j’ai tout appris.
La mère d’Arthur joignit les mains avec une exclamation d’horreur.
—La mort a subitement privé mademoiselle Honorine Louis de son appui, continua M. de Saint-Alofe; voilà pourquoi je viens ici prendre sa place et réclamer près d’elle mes droits de premier tuteur.
Madame de Luxeuil parut plus saisie que surprise. Dès l’apparition du duc elle avait pressenti qu’il arrivait pour s’entremettre et faire obstacle au mariage d’Arthur: mais uniquement préoccupée d’une crainte que le lecteur connaîtra bientôt, elle n’avait point songé au titre qu’il venait d’invoquer, aussi se trouva-t-elle, pour ainsi dire, prise au dépourvu. Cependant, elle s’efforça d’échapper à son embarras par l’audace.
—Monsieur le duc n’espère point, sans doute, nous faire prendre au sérieux ses prétentions, dit-elle avec hauteur; dans quelques instants, mademoiselle Honorine Louis portera un nom qui lui rendra inutile toute protection étrangère.
—Mais elle ne le porte point encore, madame la comtesse, objecta M. de Saint-Alofe, et d’ici là, vous ne pouvez repousser la demande que je viens vous faire.
—Et quelle est-elle, Monsieur?
—Obligé, par mon devoir, de veiller sur la pupille que M. de Vercy ne peut plus protéger, je désire l’entretenir ici une fois, une seule, mais sans témoins, sans interruptions et librement.
Les traits de la comtesse s’assombrirent.
—Et dans quel but cet entretien? reprit-elle.
—Un autre refuserait peut-être de le dire, répliqua le vieillard, mais je crois devoir la vérité à madame la comtesse. Je veux voir la jeune fille dont l’avenir va s’engager, pour savoir si cet engagement est spontané, réfléchi; si elle connaît bien celui qu’elle épouse; si ce mariage, enfin, est une libre préférence ou une condition qu’elle subit.
—Et vous avez pensé que nous pourrions permettre cet injurieux examen? s’écria madame de Luxeuil.
—J’ai pensé que madame la comtesse comprendrait la nécessité de s’y soumettre, dit M. de Saint-Alofe toujours calme.
—Jamais! Monsieur, jamais! interrompit la mère d’Arthur. Toutes les conditions exigées par la loi ont été remplies; nul ne peut s’opposer désormais à ce mariage, et monsieur le duc moins que tout autre, car le titre de tuteur qu’il invoque, son absence le lui a fait perdre: ni mon fils ni moi ne reconnaissons son autorité, et nous n’avons rien à démêler avec lui.
—Vous pouvez, en effet, contester mes droits, dit le vieillard tranquillement, les annuler peut-être; je ne me suis fait à cet égard aucune illusion; mais, avant que les juges aient décidé entre nous, tout projet de mariage devra demeurer suspendu, et c’est là, pour le moment, ma seule prétention.
—Et si nous passons outre, Monsieur? demanda madame de Luxeuil avec une ironie emportée.
—Alors, répéta le duc d’un ton ferme, je vous suivrai devant l’officier de l’état civil, et, là, publiquement, toutes portes ouvertes et le testament de la baronne à la main, je déclarerai m’opposer à la célébration du mariage; j’interrogerai tout haut mademoiselle Honorine Louis, je lui dirai les vrais motifs de la recherche de son cousin; je l’avertirai du sort qui l’attend, et si elle doute, je lui offrirai des preuves.
—Des preuves!
—Les voici! des lettres écrites par votre fils à la maîtresse que son mariage doit enrichir! Vous voyez que rien ne me manque, et que je suis assez fort pour n’avoir pas besoin de vous surprendre.
Le vieillard parlait avec une fermeté nette et sûre d’elle-même qui épouvanta la comtesse. Rien ne pouvait l’empêcher de faire ce qu’il venait d’annoncer, et, s’il le faisait, tout était évidemment perdu. Aussi, madame de Luxeuil demeura-t-elle un instant étourdie; puis, passant, comme toutes les femmes, du saisissement au dépit, elle chercha à masquer ses craintes sous des paroles de menace.
Mais Vorel l’interrompit. Il s’était borné, jusqu’alors, au rôle d’auditeur silencieux, regardant alternativement les deux interlocuteurs; lorsqu’il comprit enfin, au trouble irrité de la mère d’Arthur, que le danger devenait sérieux, il prit à son tour la parole.
—Pardon, dit-il vivement, mais comme oncle de mademoiselle Honorine Louis, je crois avoir droit de prendre part à ce débat. La résolution que vient d’annoncer M. le duc ne pourrait s’accomplir sans un scandale également fâcheux pour tout le monde, et nous devons l’éviter à tout prix.
M. de Saint-Alofe fit un signe d’assentiment.
—J’ajouterai, reprit le docteur, que la demande adressée par lui à madame la comtesse me paraît trop juste pour pouvoir être repoussée.
Madame de Luxeuil le regarda avec surprise.
—Quoi! s’écria-t-elle, vous voulez que je consente à un interrogatoire...
—Que vous ne pouvez craindre, madame la comtesse, interrompit rapidement Vorel; les inquiétudes de M. le duc, bien que mal fondées, j’en ai la certitude, sont excusables; je les approuve, et s’il le faut, j’appuierai sa prière.
Madame de Luxeuil voulut protester.
—Oh! de grâce, ne persistez pas dans votre refus, reprit le docteur avec un accent marqué qui rendit la comtesse attentive; une plus longue résistance justifierait des soupçons qu’il faut dissiper. Je demanderai seulement à M. le duc, comme médecin, de retarder cette entrevue de quelques instants. L’émotion de cette journée a déjà éprouvé mademoiselle Honorine; elle vient de s’évanouir et se trouve encore dans un état nerveux qui rendrait toute agitation nouvelle dangereuse.
Le duc répondit qu’il avait appris, en arrivant à l’hôtel, l’évanouissement de la jeune fille, et qu’il attendrait tout le temps nécessaire.
—Dans ce cas, reprit Vorel, en tirant un portefeuille et écrivant quelques mots au crayon, que madame la comtesse veuille bien exécuter cette simple prescription; l’entrevue pourra ensuite avoir lieu sans aucun danger.
Il déchira la feuille sur laquelle il avait écrit et la présenta à madame de Luxeuil; celle-ci parut d’abord disposée à résister, mais à peine eut-elle jeté les yeux sur les mots tracés par le médecin, qu’elle changea de visage.
—Soit, dit-elle, avec un reste d’irritation mal maîtrisée; puisque c’est le seul moyen d’éviter un débat ridicule, je l’accepte. M. le duc peut attendre ici.
Elle salua légèrement et sortit.
Le médecin s’approcha alors du vieillard et le regarda fixement.
—Pardonnez-moi d’interrompre un instant les préoccupations qui vous amènent ici, monsieur le duc, dit-il avec gravité; mais vous m’excuserez quand vous saurez que depuis vingt ans je souhaite cette rencontre.
—Vous! dit le duc étonné.
—Depuis le jour où votre Adresse aux propriétaires français me tomba par hasard sous les yeux, reprit Vorel; comme vous, monsieur le duc, j’avais été frappé des vices de notre société; j’attendais sa réforme avec une douloureuse impatience; j’espérais que vos recherchés amèneraient enfin la découverte des lois de l’avenir...
—Et cette espérance n’a point été trompée, interrompit le duc, dont l’œil s’anima d’un subit enthousiasme; la réforme que vous attendiez est désormais facile; j’en ai trouvé le plan, les moyens, les détails; la salle de fête est bâtie, le banquet dressé, la robe blanche préparée; l’homme n’a plus qu’à se dépouiller, sur le seuil, des haillons du passé.
—Qui l’arrête alors?
—Hélas! l’ignorance et la crainte. Le malheureux se défie de sa force, et doute de la bonté de Dieu. Quand on lui montre le but, il reste immobile en criant comme ce fou qui se croyait de verre:—Si je marche je suis brisé! et pourtant, le bonheur est là, devant lui. Pour créer le monde nouveau, il suffit qu’il dise comme le Dieu de la Genèse: que le monde soit, et le monde sortira du néant!
Vorel secoua la tête.
—Monsieur le duc est-il sur d’avoir prévu tous les obstacles? dit-il d’un air pensif. Ce n’est point chose facile que de déménager ainsi l’humanité, et s’il m’était permis de hasarder quelques objections...
—Parlez, Monsieur, dit vivement M. de Saint-Alofe, je n’ai jamais évité la discussion, ni refusé les éclaircissements; quels que soient vos doutes, exposez-les sans crainte, je vous écoute.
Un étrange sourire traversa les traits du médecin; il jeta, de côté, un regard vers la pendule, puis montrant un fauteuil à son interlocuteur, il commença une série d’objections lentes et embarrassées. A chaque instant l’expression semblait lui faire défaut; mais le duc venait au secours de son impuissance: devinant ce qu’il avait voulu dire, ajoutant ce qu’il avait omis, il semblait recruter lui-même cette armée d’arguments ennemis pour les combattre et les vaincre. En le ramenant aux pensées qui avaient été l’intérêt de sa vie entière, M. Vorel était sûr de lui faire oublier tout le reste. Reporté au milieu de son rêve sublime, comme au milieu d’un océan sur lequel il ne voyait plus rien de la terre, le vieillard se mit à décrire avec une éloquence hardie le nouveau monde qu’il avait deviné; il célébrait d’avance cette Amérique sociale, encore invisible, mais perçue par son génie, et, enivré de sa propre parole, la foi s’exaltait en lui, la réalité s’effaçait à ses yeux, il sentait ses espérances se détacher de son esprit et revêtir une forme. Ce qu’il avait pensé, il le voyait, il l’entendait! il était au milieu de cette Jérusalem céleste, sortie tout achevée de son cerveau: il n’avait plus conscience du temps, de la matière, de l’espace! Merveilleuse folie, connue de Socrate, quand il entendait, au dehors de lui-même, son inspiration qui lui parlait comme un démon familier, de Moïse qui écoutait son génie sur la montagne et croyait entendre la voix de Dieu, de Swedenborg dont les idées devenaient des sensations.
A mesure que cette hallucination grandissait, la parole du vieillard devenait plus entrecoupée, plus ardente. Enlevé dans les hautes régions, il ne voyait plus que les sommets de son rêve: il ne racontait plus la nouvelle création, il ne l’expliquait plus, il la chantait.
«L’homme a vu s’accomplir la promesse de Dieu; il a conquis la royauté du monde. Désormais, la matière domptée s’est faite son esclave, les fléaux sont devenus ses agents soumis. Il demande au volcan ses feux, à la tempête ses ailes, à la foudre sa lumière: la foudre, la tempête, le volcan obéissent; et lui, roi couronné de son intelligence, il passe, doucement penseur, au milieu de ces esclaves qui l’ont affranchi du travail grossier.
»Et ce qu’il a fait au dehors, il l’a fait en lui-même. Dans son sein coulaient des sources fécondes qui, toujours comprimées, étaient devenues des torrents; il leur a donné un lit: les passions qui grondaient, tigres enchaînés, sont devenues des coursiers dociles attelés au char de l’humanité.
»L’humanité! elle forme désormais une grande famille où le fort est la confiance du faible, le faible la joie du fort. Les saints ne sont plus des martyrs; à la couronne d’épines qui déchirait leurs fronts a succédé la couronne de myosotis et de menthe que surmonte une étoile! Doux symbole de la divinisation, de l’intelligence, de la pureté et de l’amour.
»La brume se déchire, le soleil dore la montagne, l’homme joyeux se lève et chante son hymne de triomphe.
»—Au travail! au travail! non pour un maître qui boira dans l’or mes sueurs et mes larmes, mais pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même! Au travail! au travail! non pour user mon corps et abrutir mon âme dans une fatigue monotone, mais pour les vivifier par le mouvement et la variété.
»Et la femme qui passe, en roulant les anneaux de sa chevelure, répond:
»—Au travail! au travail! non pour flétrir la beauté dont Dieu m’a couronnée, mais pour la mêler à toute œuvre humaine, comme les étoiles aux nues, comme les fleurs aux blés mûrs; au travail! au travail! non pour languir dans la solitude et l’indigence ou pour vendre au plus riche mon amour, mais pour choisir librement mon fiancé parmi les plus doux et les plus aimants.
»Et l’enfant qui la suit en bondissant, s’écrie à son tour:
»—Au travail! au travail! non dans l’air étouffant de la classe ou de l’atelier, non sous la menace du maître, non pour le pain noir du présent ou pour le pain douteux de l’avenir; mais dans l’air pur, sous l’œil de l’ami, pour l’honneur de l’avenir, et pour le bonheur du présent! Au travail! au travail! non pour l’œuvre qui nous répugne, et selon la famille que le hasard nous a donnée, mais là où les voix intérieures nous appellent!
»Et au milieu de ce chœur d’activités riantes, la voix des pères répète, plus grave et plus lente:
»—Au travail! au travail! non pour disputer à la faim les jours qui nous restent, car nos fils ont fait la part des pères et nous pouvons nous reposer au soleil de leur prospérité; mais nos conseils éclairent, nos voix encouragent! Au travail! au travail! et puissions-nous nous éteindre, sans nous en apercevoir, au milieu des mouvements et des murmures de la vie.»
Ici le vieillard s’arrêta; sa voix était tremblante, des larmes coulaient sur ses joues animées d’une légère rougeur. Attendri de joie devant sa vision, il croisa les mains et ferma les yeux comme s’il eût voulu la retenir.
Il y eut une longue pause. Pendant cette improvisation exaltée, les yeux de Vorel s’étaient plusieurs fois tournés vers la pendule; il semblait mesurer, avec anxiété, la marche de l’aiguille sur le cadran émaillé. Tout à coup l’heure sonna! son tintement strident et mesuré arracha le duc à son extase. Il tressaillit, passa sa main sur son front, regarda autour de lui et parut se reconnaître.
—Deux heures! s’écria-t-il en se levant brusquement... Ah! je me suis oublié... Votre nièce doit être depuis longtemps prête à me recevoir, Monsieur...
Le médecin interrompit par un geste qui réclamait le silence, et prêta l’oreille: le roulement de plusieurs voitures venait d’ébranler le pavé. Une expression de triomphe illumina le visage de Vorel: le duc parut saisi.
—Voudrait-on emmener mademoiselle Honorine Louis à mon insu et tandis que je l’attends ici, s’écria-t-il; songez, Monsieur, que je me suis fié à votre parole, à celle de la comtesse, et que ce serait une odieuse perfidie!
Au lieu de répondre, le docteur courut à la porte, l’ouvrit, et madame de Luxeuil parut.
M. Vorel interrogea la comtesse du regard; elle répondit par un signe qui parut le rassurer; mais le duc s’avança vivement à leur rencontre.
—Pourquoi mademoiselle Honorine Louis ne suit-elle point madame la comtesse? dit-il avec inquiétude; je veux la voir sur-le-champ!...
La comtesse le regarda de toute sa hauteur.
—Honorine Louis! répéta-t-elle, il n’y a plus ici personne de ce nom, monsieur le duc; celle à qui vous le donnez s’appelle maintenant madame Arthur de Luxeuil.
—Que dites-vous? s’écria le vieillard.
—Vos menaces nous ont forcé à faire diligence, continua la comtesse d’un ton railleur, et pendant que vous attendiez ici votre pupille, elle s’engageait ailleurs...
—C’est impossible! interrompit le duc frappé de stupeur; vous n’avez pu... vous n’auriez point osé... c’est impossible... je veux la preuve!
Madame de Luxeuil lui tendit silencieusement l’acte qui constatait le mariage. Le vieillard y jeta les yeux, puis pâlit et porta les mains à son front.
—C’est vrai, balbutia-t-il, bien vrai; mais alors la maladie de votre nièce était un mensonge, cette prétendue ordonnance de Monsieur un avertissement de vous hâter, l’entretien qui me faisait oublier ici les heures, un piège convenu d’avance!... Cet homme n’affectait de s’intéresser à mes croyances qu’afin de me distraire, de me retenir! Il vous avait promis d’éveiller ma folie pour me faire oublier mon devoir! Lâche qui a pris la porte de la confiance pour se glisser en ennemi, qui s’est armé contre un vieillard de ce qui fait son courage et sa consolation, qui a cherché à lui rendre sa religion moins chère, en y attachant un remords! Ainsi, ce n’était point assez d’avoir sacrifié à ma foi mes biens, mon repos, ma liberté, il fallait y sacrifier encore le bonheur de cette enfant... Ah! cette épreuve est de trop, mon Dieu! et vous deviez, détourner de moi ce calice.
Il y avait dans l’accent du vieillard une noblesse douloureuse dont madame de Luxeuil fut, non pas attendrie, mais embarrassée.
—Si les craintes de monsieur le duc n’étaient point une injure, dit-elle, on pourrait prendre la peine de les dissiper en lui apprenant que le choix de ma nièce a été libre.
—Et qui me prouvera la vérité de cette affirmation? répliqua M. de Saint-Alofe amèrement. Ah! maintenant, je ne veux plus croire que mademoiselle Louis elle-même.
—Que Monsieur le duc l’interroge donc, car la voici, interrompit Vorel, en montrant, avec une expression étrange, la seconde porte qui venait de s’ouvrir, et par laquelle entrait Honorine, donnant la main au marquis de Chanteaux.
A cette apparition inattendue, madame de Luxeuil recula en pâlissant, et le duc resta stupéfait. Quant au médecin, il raffermit ses lunettes pour mieux voir. Assuré désormais de la régularité de la vente faite à son profit, il était revenu à sa vieille haine contre la comtesse, et contemplait son embarras avec une malveillance joyeuse.
Ni le marquis ni Honorine ne remarquèrent d’abord l’impression produite par leur entrée: celle-ci, pâle et distraite, semblait se soutenir à peine, tandis que M. de Chanteaux, penché vers elle, achevait un compliment commencé dans l’autre salon. Mais lorsque tous deux s’arrêtèrent enfin, les yeux du marquis tombèrent sur le vieillard qui était demeuré immobile à la même place. Il tressaillit, s’approcha d’un pas, comme s’il eût voulu s’assurer qu’il ne se trompait pas, puis fit un mouvement en arrière en s’écriant:
—Le duc!
Celui-ci ne parut ni le voir, ni l’entendre. Debout devant Honorine, le regard fixe, les narines gonflées, les lèvres tremblantes, il était en proie à un de ces attendrissements silencieux qui ne laissent place à aucune sensation. Cependant il fit un effort, s’avança lentement vers la jeune fille les bras tendus, saisit une de ses mains, et l’attirant à lui la regarda de plus près.
—Oui... balbutia-t-il enfin; ce sont ses traits... ses cheveux... ses mouvements!... Oui,... c’est bien la fille de Nancy.
—De Nancy! répéta Honorine qui releva la tête... Vous avez connu ma mère, monsieur?
—Sa voix aussi... c’est sa voix, dit le vieillard en continuant à se parler à lui-même.
La jeune fille sentit comme un éclair traverser son esprit. Ce trouble, au souvenir de la baronne, le titre de duc donné par M. de Chanteaux, cette espèce d’ivresse avec laquelle le vieillard la contemplait..., tout la saisit! Elle joignit les mains, regarda le marquis, madame de Luxeuil, puis, réunissant tout ce qui lui restait de force, elle balbutia:
—Vous êtes le duc de Saint-Alofe?
—Qui vous a dit mon nom? demanda le vieillard étonné.
Honorine ne répondit pas. Le cri qu’elle essaya de pousser s’arrêta lui-même étouffé par l’émotion; elle ne put que tendre les bras et se laisser glisser aux genoux du duc.
Madame de Luxeuil, jusqu’alors enchaînée par la surprise, s’élança vers elle et voulut s’entremettre, mais la jeune fille, sanglotante, éperdue, ne put l’entendre. Toujours aux pieds du vieillard, elle continuait à bégayer des phrases sans suite, au milieu desquelles revenait à chaque instant le nom de sa mère.
Le duc, brisé par tant d’agitations, s’était laissé tomber sur un fauteuil et baisait les mains de la jeune fille en s’efforçant de la calmer.
—Au nom de Dieu! essuyez vos larmes, chère enfant, répétait-il attendri. D’où vient que ma vue vous trouble à ce point? Ne savez-vous pas que je veux être votre protecteur, votre ami?
—Oh! oui, balbutia Honorine. Vous ne me quitterez plus... Vous me conseillerez!... Ah! pourquoi... n’êtes-vous pas venu... plus tôt?
—Avez-vous donc eu besoin d’appui?... demanda le duc. Ce mariage...
Honorine poussa un gémissement et cacha sa tête sur la poitrine du vieillard.
—On vous l’a imposé, s’écria-t-il; vous avez cédé à la violence?
—Non, répliqua la jeune fille toujours pressée sur son cœur, non; il le fallait... j’ai consenti... pour ma mère.
—Que dites-vous?
—Ils savaient tout, murmura-t-elle; ils voulaient se servir de la lettre!...
—Une lettre, et que pouvait-elle contenir qui vous forçât?...
La jeune fille tira de son sein le billet remis par sa tante et le tendit, sans lever les yeux, à M. de Saint-Alofe. En apercevant son nom sur l’adresse, celui-ci l’ouvrit précipitamment et le parcourut, mais arrivé à la signature, il jeta un cri.
—Nancy, répéta-t-il, et ce billet m’est adressé! malheureuse! mais ce n’est pas ta mère qui l’a écrit, c’est un faux!
Honorine se redressa égarée et madame de Luxeuil jeta au marquis un regard d’épouvante. Celui-ci hésita un instant, puis la rassurant d’un geste, il se glissa vers la porte, qui était restée ouverte, et disparut...
Quant au duc, après avoir de nouveau parcouru le billet il s’était levé et avait fait un pas vers la comtesse.
Les rides de son front chauve frémissaient d’indignation, et ses yeux lançaient des éclairs. La tête rejetée en arrière, froissant le billet dans une de ses mains crispées, et l’autre étendue avec un geste de commandement et de menace, il était à la fois si majestueux et si terrible que madame de Luxeuil demeura devant lui comme fascinée.
—C’est vous qui avez écrit cette lettre infâme, dit-il d’un accent bas et entrecoupé; c’est vous ou plutôt cet homme qui vient de fuir et qui s’est exercé de longue main à cette habileté de faussaire. Ainsi, rien ne vous a coûté pour vaincre la résistance de cette enfant... pour vous enrichir de ses dépouilles!... O mon Dieu, et vous avez permis que le complot de cette femme réussît! et le monde la compte au nombre de ses élus! et elle aura pu briser impunément le bonheur de la fille et l’honneur de la mère?... Non, qu’elle rétracte au moins ses mensonges!
Il s’était avancé vers madame de Luxeuil et lui avait saisi la main. La comtesse effrayée voulut se dégager; mais le vieillard, dressé de toute sa hauteur, ses cheveux blancs épars et l’œil implacable, la tint immobile.
—Demandez grâce, Madame, dit-il d’une voix fulminante, demandez grâce à celle que vous avez calomniée après l’avoir fait mourir!
Et forçant la comtesse à plier sur ses genoux, il la fit tomber à ses pieds.
Là, suffoquée de honte, de rage et d’épouvante, elle ne put que pousser un cri.
M. Vorel, jusqu’alors témoin impassible, pensa qu’il devait enfin s’interposer. Au premier mot qu’il prononça, M. de Saint-Alofe, rappelé à lui-même, laissa aller la main qu’il tenait.
—Monsieur le duc oublie que la violence envers une femme a toujours été regardée comme indigne d’un gentilhomme, dit le médecin avec son accent doucereusement ironique, et en aidant madame de Luxeuil à se relever; les reproches et les emportements sont d’ailleurs inutiles désormais, et ne peuvent rien changer à ce qui est accompli.
—Vous vous trompez, reprit M. de Saint-Alofe redevenu plus calme; un mariage surpris par la fraude peut être rompu, et je jure d’y employer tous mes efforts.
Honorine qui était restée à la même place atterrée et étrangère à tout ce qui venait de se passer, releva la tête à ces derniers mots.
—Rompre mon mariage! s’écria-t-elle, en courant au duc, est-ce bien possible? ah! s’il est vrai, ne m’abandonnez pas! ma mère m’a confiée à vous, monsieur le duc: c’est à vous de me sauver; emmenez-moi!
—Que dit-elle? interrompit la comtesse.
—Oui, reprit impétueusement Honorine, il est mon protecteur légitime, c’est lui que je dois suivre; je ne veux pas rester plus longtemps près de ceux qui m’ont lâchement trompée!...
—Elle a raison, dit M. de Saint-Alofe, jusqu’à ce que les juges aient prononcé, elle ne peut demeurer ici.
—Emmenez-moi, s’écria la jeune fille; mon cousin va venir; il voudra s’opposer!... par pitié emmenez-moi!
—Restez! dit une voix qui retentit tout à coup derrière elle.
Honorine se détourna et aperçut M. de Chanteaux qui venait d’entrer avec un inconnu en écharpe.
Elle recula effrayée.
—Que mademoiselle se rassure, dit poliment l’inconnu: nous cherchons M. le duc de Saint-Alofe.
—C’est moi, dit le vieillard, qui avait tressailli à la vue de l’écharpe.
Celui qui la portait s’inclina légèrement.
—Monsieur le duc n’a-t-il point habité la maison du docteur Monard, à Vanvres? demanda-t-il.
—En effet, répondit M. de Saint-Alofe.
—Et il s’en est échappé il y a cinq années?
—Il est vrai.
L’étranger fit un pas en avant.
—Alors, reprit-il, au nom du roi, Monsieur, je vous arrête!
Le duc courba la tête avec un gémissement; Honorine regarda le commissaire.
—L’arrêter! s’écria-t-elle, et par quel ordre?
Il lui présenta un papier.
—En vertu d’un jugement du tribunal de la Seine, dit-il froidement, lequel jugement place M. le duc sous la tutelle du marquis de Chanteaux.
—Que dites-vous?
—Donnant, en outre, audit marquis l’autorisation de faire enfermer son pupille.
—Se peut-il!... et la cause d’un pareil arrêt, Monsieur?
—La cause! répéta le commissaire, avec un peu d’embarras en tournant les yeux vers le vieillard.
—Eh bien?...
—Eh bien, Mademoiselle, la cause... c’est que M. le duc de Saint-Alofe est fou!
Le coup était si terrible, et il avait été précédé de tant d’émotions affreuses, qu’Honorine eut à peine la force de pousser un cri; elle regarda le duc, chancela, étendit les mains pour chercher un appui, et tomba dans les bras de Vorel, qui s’était avancé pour la soutenir.
FIN DU PREMIER VOLUME.
| Pages. | ||
| Au lecteur. | 1 | |
| I. | Une maison isolée. | 5 |
| II. | Les trois compagnons. | 19 |
| III. | Les parents. | 40 |
| IV. | La tutelle. | 57 |
| V. | Seize ans après. | 65 |
| VI. | La Forge des Buttes. | 74 |
| VII. | Trois amis du grand monde. | 87 |
| VIII. | La villa de madame de Luxeuil. | 98 |
| IX. | Le vieux portrait. | 106 |
| X. | L’agneau blanc. | 114 |
| XI. | Esquisses du grand monde. | 122 |
| XII. | Une maison de la rue des Morts. | 137 |
| XIII. | Un vieil ami du genre humain. | 146 |
| XIV. | Une fille mère. | 153 |
| XV. | Le ménage de mademoiselle Clotilde. | 163 |
| XVI. | Un complot de famille. | 178 |
| XVII. | La révélation. | 188 |
| XVIII. | . . . . . | 198 |
| XIX. | Une fête dans un grenier. | 213 |
| XX. | M. Michel. | 221 |
| XXI. | Les deux cousins. | 232 |
| XXII. | Esquisses du peuple. | 240 |
| XXIII. | Une rencontre. | 255 |
| XXIV. | Denoûment. | 265 |
| XXV. | Le voyageur de l’hôtel des Étrangers. | 278 |
| XXVI. | La mère Louis. | 292 |
| XXVII. | L’idée fixe. | 303 |
| XXVIII. | Explications. | 314 |
FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.
NOTES:
[A] Ecolier qui se rend à la ville pour étudier et se préparer à recevoir les ordres sacrés. Les kloareks bretons forment une classe à part dans la race armoricaine; c’est l’anneau vivant qui lie la vieille tradition aux idées plus nouvelles. (Voir les derniers Bretons.)
[B] Nom donné par les chouans aux patriotes.
[C] Tous ces faits sont réels et se sont passés vers la fin de l’Empire, non à Tours, mais dans une grande ville de l’ouest, où les souvenirs de ces étranges divertissements sont encore vivants dans toutes les mémoires. Des faits analogues se reproduisirent, du reste, sur plusieurs points de la France.
[D] Nom que les maçons se donnent entre eux.
[E] Tout ceci n’est point inventé; voyez le curieux ouvrage du docteur Villermé: Tableau de l’état physique et normal des ouvriers, où il analyse, d’après des conversations avec des travailleurs, les causes les plus ordinaires de l’ivrognerie parmi les ouvriers.
[F] Expression employée par les ouvriers des fabriques pour désigner les ouvrières qui quittent le travail à la brune pour chercher aventure.
[G] Cette expression et les suivantes sont empruntées au patois normand.
| On a effectué les corrections suivantes: |
|---|
| Rentré en France sous le Consultat=> Rentré en France sous le Consulat {pg 73} |
| dévouememt=> dévouement {pg 133} |
| reprit-il résolument=> reprit-il résolûment {pg 181} |
| le le baisai avec un brisement=> je le baisai avec un brisement {pg 271} |