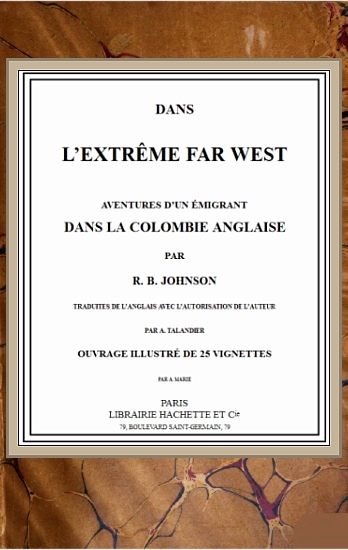
Project Gutenberg's Dans l'extrême Far West, by Richard Byron Johnson
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Dans l'extrême Far West
Aventures d'un émigrant dans la Colombie anglaise
Author: Richard Byron Johnson
Illustrator: A. Marie
Translator: Alfred Talandier
Release Date: April 24, 2013 [EBook #42590]
Language: French
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DANS L'EXTRÊME FAR WEST ***
Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
book was produced from scanned images of public domain
material from the Google Print project and The Internet
Archive/Canadian Libraries.)
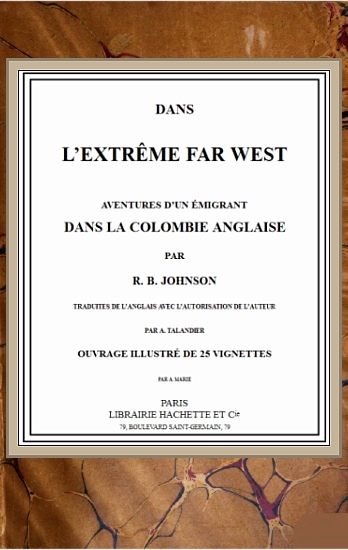
BIBLIOTHÈQUE ROSE ILLUSTRÉE
PAR
R. B. JOHNSON
TRADUITES DE L’ANGLAIS AVEC L’AUTORISATION DE L’AUTEUR
PAR A. TALANDIER
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 25 VIGNETTES
PAR A. MARIE
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
DANS
L’EXTRÊME FAR WEST
——
PARIS.—IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2
——
PAR
R. B. JOHNSON
TRADUITES DE L’ANGLAIS AVEC L’AUTORISATION DE L’AUTEUR
PAR A. TALANDIER
O U V R A G E I L L U S T R É D E 25 V I G N E T T E S
Par A. MARIE
DEUXIÈME ÉDITION
——
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE & Cie
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
——
1874
Tous droits réservés
DANS
L’EXTRÊME FAR WEST[A]
A V E N T U R E S
D’UN ÉMIGRANT DANS LA COLOMBIE ANGLAISE
Un pays dont on entend rarement parler aujourd’hui fit soudainement—il nous semble qu’il n’y a de cela que quelques années—un fort grand bruit dans le monde: ce pays était la Colombie anglaise. Des récits merveilleux parurent dans le Times, et, dans ces récits, il n’était question que de la prodigieuse richesse des mines d’or de cet Eldorado, et des nouveaux et vastes champs qu’il offrait à l’esprit d’aventure des émigrants.
Jeune alors et plein de cet amour des entreprises lointaines qui caractérise la race anglo-saxonne, je ne pus lire ces récits sans en être d’autant plus fortement impressionné, que la situation de cette colonie, isolée du monde civilisé, et sa nature vierge et sauvage, ajoutaient quelque chose de romanesque à ses autres charmes. Ce fut ainsi qu’ayant fait par hasard la connaissance d’un chercheur d’or récemment revenu d’Australie, et qui se proposait de mordre encore à l’hameçon, je me déterminai à lui offrir de l’accompagner, pour chercher avec lui les aventures et, si possible, la fortune.
Nous eûmes bientôt formé nos plans, bouclé nos malles et pris passage pour l’Eldorado (via Panama et San-Francisco) à bord du steamer qui fait le service de la malle entre Southampton et les Indes occidentales. Cent cinquante aventuriers environ avaient pris comme nous passage sur l’avant, et faisaient sensation, sur ce navire aux allures tranquilles, aristocratiques, respectables.
Bien que la plupart d’entre nous appartinssent par leurs antécédents à une classe supérieure à celle des passagers qui voyagent en troisième, nous formions, à l’avant, une compagnie fort mêlée. Il y avait un grand nombre de clercs, de commis, et d’autres jeunes gens de la même classe, qui, de leur vie, n’avaient touché un instrument de travail manuel; quelques fils de clergymen (pour la plupart mauvais sujets accomplis), quelques hommes en qui on pouvait reconnaître les traces d’une éducation universitaire; un petit nombre d’israélites acharnés au commerce; et enfin quelques gaillards solides, reconnaissables à leur teint bronzé et à leur costume de mineur, pour des gens qui, de même que mon compagnon, avaient abandonné d’autres pays aurifères pour tenter la chance dans celui que l’on venait de découvrir. Ces derniers étaient nos héros. Que l’un d’eux vînt à s’asseoir n’importe où, et aussitôt un cercle de «nouveaux camarades» se formait autour de lui pour lui demander quelque récit de ses aventures ou profiter des leçons de son expérience.
L’opinion la plus généralement émise par ces vieux routiers était que leurs auditeurs n’étaient qu’un troupeau d’imbéciles, qui, s’ils avaient la moindre lueur de bon sens, s’empresseraient de retourner chez eux par le prochain steamer.
Notre voyage, en dépit des inconvénients inséparables d’un passage en troisième classe, fut très-agréable. J’eus l’occasion pour ma part de faire de curieuses études de mœurs.
L’esprit de caste est la première chose (le mal de mer excepté) qui se manifeste parmi les voyageurs lancés sur les flots bleus. Il y a d’abord les passagers du grand salon, qui sont généralement de nobles hidalgos, et leurs familles, des officiers récemment mariés, des docteurs et des chapelains de régiments, se rendant à quelque station des Indes occidentales, et enfin quelques négociants aisés.
Tout ce monde tombe bientôt sous la tutelle d’une sorte de comité de surveillance, formé de deux ou trois vieux messieurs, importants et bavards, qui ont déjà fait plusieurs fois le voyage, et qui prennent en peu de temps un empire despotique sur leurs malheureux compagnons. Ces ennuyeux personnages assomment sans cesse le capitaine et les officiers du bord d’absurdes questions nautiques dont ils ne comprennent pas eux-mêmes le sens, et qui n’ont d’autre objet que de tenir la masse ignorante et inexpérimentée de leurs compagnons sous le prestige de leur importance et de leur savoir. Ils sont toujours sur le chemin des matelots de service, qui, en récompense, les envoient de temps en temps (sans le vouloir, naturellement) faire un plat-ventre sur un cordage oublié, ou les gratifient d’un seau d’eau sale détourné (toujours par hasard) de sa destination. Il y a aussi, généralement, une ou deux vieilles femmes qui appartiennent à la même espèce, et qui maintiennent parmi les dames de la société une discipline encore plus sévère que celle des hommes.
C’est un point d’honneur chez les passagers de grand salon que de ne jamais adresser la parole à un voyageur de la seconde classe; quant à la vile multitude de l’avant, il ne saurait pour eux en être question.
Les voyageurs qui occupent les cabines des secondes sont une humble et inoffensive race qui fait ses délices des restes dûment arrangés du dîner du grand salon. On peut les voir souvent monter la garde à l’entrée des premières, et d’un œil avide, noter au passage les plats qui reviennent et qu’ils pourront bientôt reconnaître sur leur propre table. C’est alors le moment de donner des pourboires aux stewards ou garçons de service, afin d’être favorisé de tel ou tel plat, et l’on peut dire que, sur ce point, il existe à bord un véritable système de surenchère.
Les passagers de la seconde classe se font un point d’honneur de ne jamais adresser la parole aux passagers de la troisième, on peut même dire que ceux-là ont une certaine peur de ceux-ci; mais ils cherchent en revanche, et par tous les moyens, à nouer, en passant, quelques relations fugitives avec l’un ou l’autre des gros bonnets de la première classe. On les voit, pour la satisfaction de cette louable ambition, supporter avec une grande égalité d’âme les plus effroyables humiliations.
La foule des passagers de troisième classe, cantonnés à l’avant, se compose en général de gens fort indépendants, et que l’exclusivisme des classes supérieures touche peu.
Pour nous jeunes aventuriers, ce qui nous manquait, ce n’était ni le courage ni l’espérance; ces vertus, au contraire, formaient le plus clair de notre capital, et je crois pouvoir dire que nous étions aussi heureux qu’en pareille circonstance on peut l’être à notre âge. Flâner et rire; nous chauffer comme des lézards au brillant soleil du tropique ou chercher l’ombre des bastingages et du gaillard d’avant; ne quitter la pipe qu’à l’heure des repas, où notre appétit féroce avait, en un clin d’œil, raison de notre modeste ordinaire; guetter les bonitos[B], les poissons volants et les requins; jouer au palet, au whist (et à quel whist admirablement mal joué!) et à toutes sortes de jeux de hasard; danser la gigue, l’écossaise, le branle, et mille autres danses connues ou inconnues au lecteur; boxer, faire des armes, nous livrer à toutes sortes de farces et de plaisanteries: voilà comment nous passions le temps, sans jamais penser autrement au lendemain que comme au jour qui devait nous apporter la fortune.
Mais revenons à notre traversée. Après avoir changé de bateau à Saint-Thomas, très-jolie petite ville, remarquable par ses trois collines, nous arrivâmes enfin à Colon ou Aspinwall, où nous prîmes le train pour Panama. Bien que cette voie ferrée n’ait que 48 milles (77 kilom.) de longueur, il faut environ six heures pour aller d’un Océan à l’autre.
Là je vis, au départ, un grand personnage, reconnaissable pour tel à la blancheur de son linge, monter en voiture, et, presque aussitôt, chercher de tous côtés son bagage dont une partie était absente. Nous venions de partir et étions déjà à environ 200 mètres de la station. Ayant mis la tête à la portière, j’aperçus un nègre qui, porteur d’un énorme sac de nuit, courait après le train en faisant des gestes les plus extravagants. Je m’adressai au conducteur du train, un Américain, qui se tenait dans le wagon, et je lui demandai s’il allait donner le signal d’arrêter pour donner le temps d’arriver au brave nègre qui courait si vaillamment.
«Ce n’est pas moi que vous prendrez à ce jeu-là! dit-il; si ce gaillard-là est seulement la moitié d’un nègre, il nous aura rattrapés avant que nous ayons eu le temps de nous arrêter.»
Et le train continua de marcher, et le nègre de courir, se rapprochant de plus en plus, si bien que nous pouvions l’entendre haleter. Enfin, d’un dernier et vaillant effort, il franchit en quelques enjambées formidables l’espace qui le séparait encore de nous, saisit d’une main le garde-fou qui entourait la plate-forme, lança son sac dans le wagon, et se hala lui-même après le sac, à la force du poignet.
«Bon nègre! cria le conducteur, d’un ton approbateur.
—Diable de train! répliquai-je. Est-ce que vous n’allez jamais plus vite que cela?
—Pas ici, en tout cas, dit-il. Car si nous le faisions, en moins de deux minutes et demie nous irions patauger dans ce vilain marais!»
Je voulus inviter le nègre à se rafraîchir au comptoir (presque tous les trains en Amérique ont un comptoir—a bar—où l’on peut boire pendant le voyage)[C], mais je n’oublierai jamais l’expression d’horreur avec laquelle cette proposition fut accueillie par l’intelligent et distingué personnage qui servait à boire aux voyageurs.
D’abord il donna cours à son indignation, en enfilant à la suite les uns des autres une série de jurons effroyables; il se mit ensuite à cracher violemment autour de lui, reprit haleine, cassa un verre pour calmer son émotion, et finalement, voyant ma confusion et se radoucissant, me dit:
«Ah! je comprends, vous êtes étranger; vous n’êtes pas au fait de nos libres institutions; vous avez été élevé dans un pays où l’on regarde presque ces êtres-là (montrant du doigt le pauvre nègre essoufflé) comme des créatures humaines. Mais qu’il ne vous arrive plus d’inviter des nègres à boire à mon bar, ou il y aura du tapage, entendez-vous!»
Je donnai donc une petite pièce au malheureux nègre, et me réconciliai avec le bar-keeper, qui n’était pas un mauvais garçon, à part ce que je considérais alors comme son injustifiable préjugé contre les gens de couleur (je dois avouer que mes opinions se sont depuis un peu rapprochées des siennes). Il me fit un verre d’excellent mint-julep[D], et ne voulut pas entendre parler de payement. Ce fut là, je crois, ce qui me disposa tout particulièrement en sa faveur.
Panama, bien que situé au milieu du plus magnifique paysage, nous fit l’effet d’une assez vilaine et sale ville. Il n’y avait rien qui valût la peine d’être vu, sauf les ruines, dont l’aspect rappelait les dévastations commises par les pirates qui, du temps de la reine Élisabeth, infestaient ces parages.
Le jour de notre arrivée, le pays était, comme d’habitude, en révolution, ou pour mieux dire en émeute. Le lendemain l’émeute était finie, et tous les habitants se remirent à leur occupation habituelle, qui consiste à rançonner les voyageurs durant le peu de jours que ceux-ci ont à passer chez eux. Les voyageurs partis, les dissensions renaissent et amènent la mort de quelques chiens perdus et de quelques cormorans inoffensifs.
Soit dit en passant, ces oiseaux, qui portent le nom «d’oiseaux récureurs», sont, dans cette ville et dans plusieurs autres du même genre, les seuls agents de la salubrité publique. Ils dévorent toutes les épluchures et les immondices, que les habitants se contentent de jeter dans la rue, et rendent de si indispensables services, que le meurtre volontaire d’un de ces oiseaux est puni d’une forte amende.
Nous avions tout à fait assez de ce délicieux endroit où il nous fallut rester quelques jours pour attendre les voyageurs de New-York. Aussitôt qu’ils furent arrivés, nous nous embarquâmes pour San-Francisco, sur un vapeur américain qui n’attendait, pour partir, que ce petit complément de quinze cents passagers.
L’oncle Sam[E] n’a pas pour ses enfants, lorsqu’ils sont à bord, les soins paternels que John Bull a pour les siens; aussi peut-on se figurer aisément que l’avant d’un steamer américain, avec neuf cents personnes entassées dans l’entrepont, comme des harengs dans un baril, n’est pas le lieu du monde le plus agréable. La plupart des nouveaux venus étaient des Irlandais ou des Allemands, et comme ils n’étaient d’une propreté recherchée ni sur leur personne ni dans leurs habitudes, je puis certifier à mes lecteurs qu’une étable à porcs, qui n’aurait pas été nettoyée depuis un an, serait un véritable lieu de délices, comparée à l’endroit qui devait nous servir de salon et de chambre à coucher.
Nos lits consistaient en trois rangées de couchettes de sangle, dont deux sur les côtés et la troisième au milieu de l’entrepont, disposées sur toute la longueur de l’avant à l’arrière. Chacun de ces lits de sangle était occupé par quatre personnes, et l’on comprend que chacun ne devait avoir que juste la place nécessaire pour s’étendre. Pour ma part, je préférai de beaucoup étendre ma couverture sur le pont, et dormir à la belle étoile, au risque d’être en butte aux injures et même aux coups de pied des hommes de service, ou de me voir asperger par la pompe, qui inondait le pont de grand matin pour le service journalier.
Les dispositions prises pour nourrir tout ce monde-là n’étaient guère plus satisfaisantes. Nos repas, grossiers mais à coup sûr suffisants à ne considérer que la quantité, nous étaient servis sur des tables suspendues qu’on laissait tomber du plancher supérieur. Nous avions à manger debout, et heureux ceux qui, même en se tenant debout, pouvaient obtenir une place. Les tables, vu le nombre des passagers, devaient être desservies et resservies trois fois à chaque repas, et pour trouver place à la première ou à la seconde table, c’était une mêlée régulière dont il fallait sortir vainqueur. Puis, bien souvent, la place conquise se trouvait tout près des bossoirs, et l’on avait alors la chance de recevoir quelque coup de pied de l’un ou de l’autre des pauvres animaux qui étaient entassés là et traités avec à peu près autant d’humanité et de propreté que les hommes. Quand le temps était mauvais, il est facile de concevoir que, dans de pareilles circonstances, on recevait sur ses habits une plus grande portion du dîner qu’on n’en portait à sa bouche. Heureusement, les gros temps sont rares dans ces parages.
En dépit de tout, nous étions assez gais, mais nous appelions de tous nos vœux le jour où nous arriverions à cette ville de San-Francisco dont nous avions tant entendu parler avant et surtout depuis notre départ. Ceux qui avaient des revolvers passaient leur temps à les nettoyer et à les mettre en état de service, San-Francisco passant encore pour le lieu du monde où régnait la licence la plus effrénée.
Je me souviens que c’est durant cette partie de notre voyage que tomba l’anniversaire de Sa Majesté la reine d’Angleterre, et je ne doute pas que notre souveraine n’eût ressenti une joie véritable à voir l’entrain avec lequel nos compatriotes donnèrent en cette occasion carrière à leurs sentiments. Malheureusement, l’un d’eux poussa l’enthousiasme jusqu’à dire des injures à un homme de l’Ouest, dont la patience n’était pas la vertu dominante. Celui-ci, dans la chaleur de la discussion, tira son revolver, et notre compatriote, qui n’eut que le temps de s’esquiver, reçut, au moment où il franchissait la porte, une balle dans certaine partie de sa personne qu’il ne put de quelques jours faire servir à sa fonction normale, celle de s’asseoir. L’homme de l’Ouest fut, pour la forme, mis aux fers pendant un jour ou deux, puis remis en liberté sur la parole qu’il donna de ne plus avoir recours à ce genre d’argument. L’affaire s’arrangea, et tout finit par force poignées de mains et force rasades.
En remontant la côte du Mexique, nous touchâmes à Acapulco pour faire du charbon, et nous eûmes le plaisir d’une course à terre et d’un bon repas d’œufs et de volaille. Les seuls animaux vivants que l’on put trouver dans la ville nous parurent être des poules et des poulets.
Les indigènes nageaient par centaines autour du steamer et paraissaient passer la plus grande partie de la journée dans l’eau. Pendant tout ce temps, de nombreux requins ne cessaient de se montrer autour du vaisseau; mais les moricauds ne semblaient pas s’en préoccuper le moins du monde. Ils portaient tous un couteau attaché à une ceinture de cuir et, lorsque nous leur demandions s’ils n’avaient pas peur des requins, ils nous montraient leur arme en riant. On les voyait plonger dans dix brasses d’eau pour la plus petite pièce d’argent que les passagers leur lançaient par-dessus bord, et la plupart d’entre eux avaient la bouche pleine de ces menues monnaies lorsque nous nous éloignâmes.
Je suppose que c’est la chaleur qui a porté les indigènes à contracter de pareilles habitudes, car Acapulco doit être, ou peu s’en faut, l’endroit le plus chaud de la terre.
Peu de jours après avoir quitté ce four brûlant, nous passâmes par la Porte d’Or: c’est le nom donné à l’entrée du magnifique port de San-Francisco. Il me serait difficile de dire quelle était notre joie à la pensée que nous allions enfin être délivrés de notre infecte prison.
La plupart de nos compagnons de voyage n’allaient pas plus loin, et, comme le bateau qui devait nous porter à l’île Vancouver ne partait pas de quelques jours, nous fûmes enchantés de l’occasion qui nous permettait de faire un court séjour dans la Golden City (cité de l’or).
L’emplacement où s’élève aujourd’hui la ville de San-Francisco n’offrait, avant l’année 1849, un spectacle digne d’admiration ni à l’amant de la nature ni au chercheur de nouvelles relations commerciales.
Une moitié de cet emplacement était alors occupée par les basses eaux de la baie, et l’autre moitié n’était qu’un amas de collines de sable presque absolument dénuées de végétation. Les pères de la mission de Dolorès et quelques colons et pêcheurs éparpillés dans le voisinage formaient toute la population. Il eût été difficile de trouver sur la surface du globe un lieu plus paisible et ayant plus complétement l’apparence de devoir rester indéfiniment ce qu’il était.
Telle est cependant la magique puissance d’attraction que l’or exerce sur les hommes, qu’à la fin de la susdite année, où commença l’immigration des chercheurs d’or, il ne pouvait pas y avoir moins de quatre-vingt mille personnes réunies sur la plage où s’élève maintenant la métropole du Pacifique septentrional. La rade, dont les eaux n’avaient jusque-là porté aucun bâtiment plus lourd que le canot de l’Indien ou le bateau du pêcheur, fut soudain couverte de vaisseaux de toutes les nations du monde, et couverte pour longtemps; car de longs mois s’écoulèrent avant que la plupart de ces navires pussent repartir, vu l’impossibilité absolue de retenir les équipages qui les avaient amenés ou d’en trouver d’autres pour le retour.
Parmi les vieux forty-niners (immigrants de 1849), comme s’appellent avec fierté ceux des anciens pionniers qui restent encore, il est curieux de noter le grand nombre de ceux dont les bras tatoués indiquent quelle fut autrefois leur profession.
Cette année 1849 vit donc une multitude de tentes blanchir à perte de vue les rivages de la baie, et bientôt s’élevèrent, avec une rapidité qui tenait du prodige, d’immenses hôtels, des magasins, des bâtiments de toute espèce, uniformément construits en bois.
Vraiment, l’énergie déployée par ceux qui ont bâti cette ville et surmonté les obstacles naturels qu’offre sa position, est merveilleuse. Nulle autre cité d’une grandeur et d’une importance comparable (Melbourne exceptée peut-être) n’atteignit un pareil développement dans le court espace de vingt ans. Les collines de sable ont été littéralement chargées à la pelle dans des tombereaux et portées à la mer, de sorte qu’en même temps qu’on gagnait sur la terre l’emplacement occupé par la colline, on gagnait sur la mer un emplacement correspondant, rempli par la colline qu’on y jetait.
Aujourd’hui même, la partie basse de la ville est entièrement bâtie sur pilotis, et le sous-sol des maisons, qui faisait autrefois partie de la baie, est maintenant complétement à sec, grâce à ce travail continu d’empiétement sur la mer.
Ce sous-sol sert d’habitation à des milliers de rats, de chiens et de porcs, qui, les épluchures et ordures de toutes sortes ne manquant jamais, semblent vivre dans la plus heureuse abondance et la plus parfaite tranquillité. On ne peut, en visitant ce quartier de la ville, s’empêcher de se féliciter que le choléra soit inconnu sur la côte du Pacifique.
Il n’est pas étonnant qu’un lieu exerçant de si puissantes séductions sur les chercheurs d’or ait été, dès l’origine, le rendez-vous des coquins les plus audacieux du monde entier. Le revolver et le «bowie-knife» (sorte de long couteau-poignard) commençaient les querelles et les terminaient, et la justice, rendue du reste par les agresseurs, n’était qu’une cruelle dérision.
Les choses en arrivèrent à ce point que, quatre ou cinq ans plus tard, les plus honnêtes parmi les habitants de la ville se dirent qu’après tout il fallait, pour produire une réaction suffisante, avoir recours aux mesures extrêmes, et, partant de ce principe que la fin justifie les moyens, l’administration de la justice fut enlevée aux autorités régulières et confiée à un Comité de vigilance choisi parmi les citoyens. Tous les suspects reçurent l’ordre de partir dans les vingt-quatre heures, sous peine de mort s’ils s’avisaient de reparaître, et tous ceux contre lesquels s’élevèrent les moindres preuves de vol ou de crimes plus noirs, furent immédiatement exécutés conformément à la procédure sommaire de la Lynch Law (loi de Lynch)[F]. Parmi ceux dont on se débarrassa ainsi se trouvait un des juges du district, qui fut convaincu d’avoir fait partie d’une bande de voleurs et d’assassins.
Ces mesures terribles eurent bientôt l’effet désiré, et—quoiqu’il soit malheureusement probable que bien des innocents ont été sacrifiés—San-Francisco est peu à peu devenue aussi sûre que la plupart des autres villes du monde. Toutefois il faut convenir qu’au point de vue des mœurs il y règne une liberté qui trop souvent touche à la licence.
Ce fut un dimanche que nous entrâmes dans le port, et nous nous attendions en conséquence à y voir régner un calme religieux; nous fûmes donc très-surpris de voir—du pont du navire qui longeait les quais, sur lesquels s’élevaient de longues rangées de docks et d’entrepôts construits en bois—tous les hôtels et toutes les bar-rooms ouverts et pleins de monde. Partout on entendait le choc des billes dans les salles de billard, et nous ne fûmes pas plus tôt à terre que nous apprîmes que, le soir, les théâtres seraient ouverts. On peut penser si tout cela offusquait les sentiments religieux des passagers anglais, si sévères observateurs du repos dominical.
Le port offrait un spectacle des plus animés. Les quais et les rues fourmillaient de monde. Ici, des parents ou des amis accouraient pour recevoir les voyageurs attendus d’Europe; là, des foules joyeuses profitaient du dimanche pour faire des excursions à Oaklands et sur divers autres points de cette rade, la plus vaste du monde. Le mouvement et le bruit étaient tels, qu’on pouvait à peine s’y reconnaître. Le grondement d’innombrables omnibus, camions, voitures et chariots de toute espèce, roulant sur les routes pavées en bois, était assourdissant; et, pour mettre le comble à ce tumulte, on entendait de tous côtés le sifflet strident des bateaux à vapeur, le claquement des fouets, les jurons des conducteurs, le hennissement des chevaux, les cris des porteurs et des garçons d’hôtel: bref, une tempête de bruits dont on ne peut se faire une idée si l’on ne s’est trouvé jeté, au moins une fois, dans une pareille Babel.
Après un pugilat sérieux, soutenu pour la possession de nos bagages contre les représentants des divers hôtels,—où figuraient côte à côte un Irlandais à la figure sale et aux vêtements plus sales encore, un lourd enfant de l’Allemagne, dont la seule chance d’attirer l’attention était son énorme stature, un agile et bouillant Français, et un regular New York tout[G] avec ses boutons de faux diamants et son énorme chaîne de similor,—nous nous trouvâmes enfin, mon ami et moi, dans l’omnibus d’un modeste hôtel situé dans l’une des rues qui débouchent à angle droit sur l’artère principale de la cité, la Montgomery Street. Nous eûmes le bonheur peu ordinaire, une fois assis, de nous retrouver en possession de tout notre bagage, plus une cinquantaine de cartes d’hôtel dont on avait bourré nos poches.
La vie n’est pas chère à San-Francisco. Le vivre et le logement n’y coûtent pas, et cela dans les meilleurs hôtels, plus de trois dollars (16 fr. 25 c.) par jour. Il y a des salons pour les fumeurs, des salles de billard, des salles de lecture tenues sur le pied le plus somptueux, et une foule d’arrangements qui nous rappellent bien plutôt nos clubs (cercles) que nos hôtels, ces affreux hôtels où le voyageur n’a pour se distraire que la contemplation d’un vieux et lourd mobilier d’acajou, un indicateur des chemins de fer vieux de trois mois, une table à écrire qui semble disposée pour ôter au voyageur découragé l’envie de s’en servir, et quelque vieux livre, sale et jauni, qui a toute l’apparence de n’avoir jamais été ouvert.
Il y a aux États-Unis quelques coutumes très-singulières. L’une d’elles est le free lunch. Voici en quoi il consiste. Un prix fixe est demandé dans certains bars ou restaurants pour une boisson quelconque, et, lorsqu’il s’agit de spiritueux, la bouteille et un verre sont placés devant le consommateur, qui prend ce qu’il veut, sans que personne regarde à la quantité. Une collation ou lunch est toujours servie, et, comme pour les boissons, on compte naturellement que le consommateur en usera avec discrétion. On doit présumer que la consommation moyenne reste dans les bornes du prix demandé, car, s’il en était autrement, les propriétaires de ces établissements en seraient bientôt réduits à fermer boutique; mais ce qu’il y a de certain, c’est que la coutume du free lunch tend à entretenir dans la paresse une armée de loafers (fainéants, vagabonds), qui, ayant chacun de quoi payer son bit ou son quarter dollar (65 centimes ou 1 fr. 35 c.), se gorgent, comme le boa constrictor, de façon à pouvoir attendre le jour suivant. Quand ces pratiques-là sont une fois connues, on s’arrange pour leur administrer, à leur insu, une bonne purgation, ce qui leur apprend à se montrer un peu plus réservés dans leurs visites.
Il y a fort peu de villes aussi grandes qui soient plus vivantes et plus gaies que Frisco[H]. La ville elle-même est composée de trois parties principales. La plus basse, au bord de l’eau, est la partie commerçante de la cité, et, à l’exception de l’inévitable bar-room qu’on rencontre à chaque pas, elle est entièrement occupée par d’immenses entrepôts et des magasins de gros. Les quais et la partie du port qui les avoisine sont couverts de navires venus de toutes les parties du monde, et la vue de cette rade immense est vraiment magnifique. La partie centrale est, pour toute la côte nord du Pacifique, le rendez-vous du monde fashionable. Elle se compose de Montgomery-Street et des rues avoisinantes, et la description la plus exacte qu’on en puisse faire consiste à dire qu’elle tient à la fois du quartier du Strand et de celui de Regent-Street, à Londres. C’est dans cette partie de la ville que se trouvent les principaux hôtels, les beaux magasins et les théâtres; c’est là que se fait admirer la fleur du beau monde, et que les dames se distinguent par l’exagération des modes parisiennes de l’année précédente. Les voitures légères et les beaux attelages ne font qu’aller et venir entre cette partie de la ville et la partie supérieure. Cette dernière, où se trouvent les villas des résidents riches, s’étend jusqu’au pied des collines de sable, qu’elle transforme peu à peu en Élysées parsemés de maisons jolies comme des bonbonnières.
Les rues ont toute l’animation que donne le commerce le plus actif, et fourmillent de monde appartenant à toutes les nations et à toutes les classes de la société. Un trait toutefois est commun à tous, c’est le cosmopolitisme, qui fait que personne ne s’offense des manières ou des habitudes de ses voisins. Les Chinois constituent un des éléments importants de la population et vivent dans un quartier à part. Toutefois je conseille à ceux qui voudraient visiter ce dernier, de ne pas le faire sans un flacon de sels sous le nez, pour peu qu’ils aient cet organe délicat.
Dans le voisinage immédiat de la ville, la campagne est d’un aspect stérile, et le climat n’est pas des plus agréables. Il y règne un vent froid, qui pendant toute l’année souffle de la mer dans le milieu du jour, et vous remplit les yeux, la bouche et tous les pores des particules les plus fines du sable qui couvre partout cette plage. Mais pour peu que l’on quitte la côte, le pays et le climat sont également délicieux.
Nous fîmes nombre de charmantes excursions dans le voisinage, et nous aurions bien voulu, mon ami et moi, pouvoir rester plus longtemps; mais, comme ni nos projets ni nos finances ne nous le permettaient, nous partîmes pour l’île Vancouver, en compagnie de la plupart de ceux de nos compagnons de voyage qui étaient venus avec nous d’Angleterre.
Nous étions en outre accompagnés par trois ou quatre cents mineurs californiens que la réputation grandissante des nouveaux terrains aurifères attirait vers la Colombie anglaise.
Le nombre beaucoup moins grand des passagers nous permettant d’avoir un peu plus nos aises à bord, notre voyage fut infiniment plus agréable de San-Francisco à Vancouver qu’il ne l’avait été de Panama à San-Francisco.
Toutefois, lorsque nous approchâmes enfin du but de cette longue traversée, un changement profond se manifesta parmi les «jeunes». Ce voyage, à vrai dire, n’avait été pour nous, jusque-là, qu’un voyage d’agrément; mais le moment arrivait de songer que nous allions être aux prises avec de dures réalités, et que notre vie d’aventures ne faisait que de commencer.
En peu de jours, l’air d’insouciante gaieté qui, pour ainsi dire, ne nous avait pas quittés depuis notre départ, fit place à un sentiment d’impatience, à une sorte d’agacement nerveux qui, sans bannir l’espérance, trahissait nos inquiétudes. L’adolescent (la plupart d’entre nous n’étaient encore que cela) se sentit presque soudainement transformé, changé en homme. Les liens de l’amitié, qui n’avaient été qu’ébauchés, se resserrèrent plus étroitement; on forma des plans d’association; on se mit, d’un œil plein parfois de regrets et de repentirs, à compter son argent et à tirer plus fréquemment de sa cachette le portrait chéri d’une mère ou d’une fiancée.
Comme contraste à nos manières et à notre conduite, on ne saurait rien concevoir de plus complet que la conduite et les manières des vieux routiers qui se trouvaient parmi nous. D’abord, en thèse générale, rien n’égale le stoïcisme et le sang-froid de celui qui, depuis longtemps, a fait de la recherche de l’or sa profession. Des alternatives successives de bonheur et de malheur, dans lesquelles le malheur n’a que trop souvent prédominé, l’ont rendu plus indifférent que qui que ce soit au monde et aux circonstances qu’il traverse.
Le vieux chercheur d’or est la plupart du temps une espèce de bourru bienfaisant. Son existence solitaire a fini par le rendre réservé et contemplatif. Il n’est pas rare que ses connaissances, grâce à la lecture dont il a pris l’habitude pour charmer les loisirs de son isolement, soient très-supérieures à ce que l’on s’attendrait à trouver chez un mineur. Quelquefois, naturellement, il se produit une réaction, violente comme on peut le croire chez des hommes d’un tempérament pareil, et alors notre ours devient un vrai diable auquel il ne manque que les cornes et le pied fourchu.
C’était d’un air protecteur et en quelque sorte paternel que nous autres jeunes novices étions regardés par ces «honnêtes mineurs», qui aimaient à nous entendre parler du pays et éveiller en eux des souvenirs du jeune âge, depuis longtemps oubliés. En échange, bien qu’ils fussent généralement plus disposés à écouter qu’à parler, ils nous donnaient maint conseil utile, maint avis précieux pour notre conduite future.
Le cinquième jour, nous pénétrâmes dans le détroit de Fuca, qui sépare l’île Vancouver du territoire de Washington, et nous saluâmes la plus éloignée à l’ouest des provinces de cet empire britannique «sur lequel le soleil ne se couche jamais». Quelques heures après, nous jetions l’ancre dans le port d’Esquimalt, l’une des principales stations navales que possède l’Angleterre sur la côte nord du Pacifique. Deux ou trois vaisseaux de guerre se balançaient doucement sur l’eau tranquille de cette rade où se réfléchissaient, comme dans un miroir, les collines couvertes de pins qui l’environnent.
Nous nous croyions tous arrivés à Victoria, capitale de la colonie, et nous nous attendions par conséquent à voir une ville assez considérable; aussi grand fut notre désappointement en voyant que la soi-disant métropole ne comptait que quelques douzaines de log-huts (cabanes faites de troncs d’arbres superposés) et de hangars couverts de planches. Nous nous regardions les uns les autres avec un air de profonde consternation. Les vieux chercheurs d’or eux-mêmes ne pouvaient s’empêcher de partager notre inquiétude.
L’amas de cabanes et de hangars que nous prenions pour la ville était dominé par une construction plus ambitieuse, mais faite aussi de troncs d’arbres, en face de laquelle s’élevait un sémaphore au haut duquel flottait un drapeau portant les initiales de la Compagnie de la Baie d’Hudson «H. B. C.» (Hudson’s Bay Company).
Étant monté sur la dunette pour porter plus loin mes regards, j’entendis entre deux vieux Californiens le dialogue suivant, peu fait, il faut le reconnaître, pour modifier favorablement mes premières impressions.
«Hé! Bill, ça me fait l’effet d’une drôle de colonie! Où sont donc les habitants?
—Je ne saurais dire. Je suppose qu’ils vivent sous terre, à moins qu’après s’être faits naturaliser Peaux-rouges, ils ne se soient retirés dans le désert pour y compléter leur éducation et faire exécuter leur tatouage de guerre.
—Bon! et maintenant, qu’est-ce que c’est donc que ce drapeau-là?
—Ça, dit Bill, après avoir considéré avec attention le drapeau et lu les lettres qui se déroulaient dans ses plis, «B. C.,» en histoire ancienne, si je me rappelle bien ce que nous disait autrefois notre maîtresse d’école, signifie «Before Christ» (avant Jésus-Christ); je soupçonne donc ces trois lettres «H. B. C.,» de vouloir dire «Here before Christ» (ici avant Jésus-Christ), et en effet cet établissement ne semble pas avoir été visité par beaucoup d’étrangers depuis cette époque. Je parie que ce que nous aurons de mieux à faire sera de retourner de ce pas en Californie! Qui est-ce qui veut parier?»
Heureusement pour nous, un changement de scène ne se fit pas attendre. Nous vîmes de longues files de camions et de voitures—celles-ci, il est vrai, simples charrettes posées sur les essieux sans le moindre ressort—s’avancer, conduites par des nègres, le long du quai, et nous apprîmes avec ravissement que Victoria était situé à trois milles (environ cinq kilom.) de là, sur le bord d’une autre baie dont les eaux sont trop basses pour admettre des vaisseaux de haut bord, et que Sambo ou Cuffey se feraient un plaisir de nous y transporter, nous et tout ce qui nous appartenait, pour la modique somme d’un demi-dollar par tête.
Nous partîmes aussitôt, et après avoir suivi pendant une demi-heure environ une route bordée de bois, qui, de distance en distance, nous laissaient apercevoir la mer par quelque échappée, nous vîmes tout d’un coup se dérouler devant nous le panorama du port et de la ville de Victoria. De tous côtés la vue s’étendait sur un ravissant paysage qui nous apparaissait baigné dans l’atmosphère limpide d’un soir de printemps.
La ville, composée à ce moment de maisons de bois peintes de diverses couleurs, s’élevait en amphithéâtre sur une légère éminence descendant en pente douce jusqu’au bord de l’eau, de sorte qu’on pouvait parfaitement distinguer tous les édifices. Dans le voisinage immédiat de la ville, la campagne ressemblait à un parc parsemé çà et là de bouquets de chênes et d’amas de roches noires se détachant vigoureusement sur le vert de l’ensemble.
De nombreuses villas surgissaient de tous côtés au sein de la forêt, pour la plus grande partie vierge encore, qui formait le fond du paysage, ou couronnaient les hauteurs dominant les environs. De hautes collines rocheuses, ombragées de bois de pins et de sapins, derrière lesquels le soleil se couchait en les colorant de ses teintes changeantes, fermaient la vue du côté de la terre. Du côté de la mer, au delà du golfe de Géorgie, les monts Olympe montraient leurs cimes neigeuses encore empourprées par les derniers rayons du soleil, tandis que sur leurs flancs montait rapidement l’ombre épaisse de la nuit. Dans le port, quelques bateaux à voile ou à vapeur étaient paisiblement à l’ancre, immobiles au milieu des rapides canots indiens qui glissaient comme furtivement autour d’eux, sous l’effort léger des pagayes maniées par leurs pittoresques occupants. De temps à autre, quelques notes de la plaintive mélodie que chantent les canotiers indiens, en battant la mesure avec leurs pagayes, arrivaient jusqu’à nous, portées sur l’air calme du soir.
En face de la ville, de notre côté, s’élevait la «rancherie» ou village de la tribu indigène. Ses énormes huttes, dispersées au hasard et formées de blocs de cèdre mal équarris et noircis par le temps, faisaient un contraste curieux avec les demeures aux couleurs gaies que les envahisseurs multipliaient sans cesse. Non loin de là on pouvait voir, près du chemin même que nous avions à suivre, un assez grand nombre de tentes, formant à l’écart un village tout blanc, d’où venait jusqu’à nous le son de voix joyeuses.
Le calme enchanteur du paysage qui se déroulait devant nos yeux invitait à la contemplation et au repos. Nous nous arrêtâmes d’un mouvement instinctif, sans nous consulter, pour attacher nos regards sur cette contrée que nous devions habiter pendant notre séjour dans le nouveau monde. Nous restions là pensifs, osant à peine faire un pas en avant, craignant que le charme ne vînt à se rompre et que tous ces rêves dorés ne s’évanouissent en fumée. Un de nos compagnons, d’une nature moins poétique que la nôtre et dont l’estomac exigeant était en outre excité par l’odeur de cuisine qui s’exhalait des campements du voisinage, nous tira de notre rêverie. Nous nous remîmes en marche, et, quelques instants plus tard, après avoir traversé le pont jeté sur le port, nous entrions dans Victoria, port principal de la Colombie anglaise.
Arrivé à l’hôtel, où nous conduisit notre voiturier, qui sans doute portait quelque intérêt à la prospérité de cet établissement, je ne fus pas peu surpris de voir l’entreprenant propriétaire m’introduire, lorsque je lui demandai un lit pour la nuit, dans une salle de billard. Il me montra sur le plancher, et cela de l’air le plus aimable du monde, un espace d’environ trois pieds de large où je pouvais, en compagnie de quarante ou cinquante autres individus aussi confortablement installés que moi, étendre mes propres couvertures et passer la nuit pour la bagatelle de cinquante cents.
Je commençai à regretter de ne pas m’être pourvu d’une tente à San-Francisco ou de ne pas m’être arrêté au camp de Canvas Town (ville de toile), où j’aurais pu jouir pour rien du droit de possession d’un espace un peu moins étroit. J’adressai de timides remontrances à mon hôte, qui me parut légèrement animé par la perspective de gain que lui offrait le grand nombre de voyageurs à loger; mais tout ce que je pus obtenir de lui fut la réponse suivante: «Il faudrait avoir bien mauvais caractère pour élever la moindre plainte en pareille circonstance. Vous pouvez, si vous en avez envie, ajouta-t-il, étendre vos couvertures sur le bord du chemin ou demander à un Indien de partager sa hutte avec vous, mais le prix d’une nuit passée à mon hôtel est pour les blancs de cinquante cents, les nègres rigoureusement exclus.»
L’originalité de ce singulier aubergiste nous amusa et fut cause, plus que toute autre chose, que nous nous soumîmes à ce désagrément et à cette extorsion. Nous allâmes, du reste, dans la soirée, visiter d’autres maisons; mais nous les trouvâmes toutes pleines et fûmes, en fin de compte, heureux d’avoir, pour nous étendre, nos six pieds de parquet en longueur sur trois de largeur.
J’allai me coucher d’assez bonne heure sur ma part de plancher. J’aurais même assez bien dormi, car je m’étais habitué à n’avoir pour lit que le pont du vaisseau, si deux messieurs qui arrivèrent fort tard ne nous eussent demandé la permission de jouer au billard une partie dont l’enjeu était de cent dollars. Ils ne manquèrent pas de nous promettre qu’ils ne nous dérangeraient point, et pendant quelque temps ils tinrent assez bien leur promesse. Mais un des joueurs, oubliant, dans l’accès de mauvaise humeur que lui causait la perte de la partie, les conditions auxquelles on lui avait permis de jouer, frappa du gros bout de sa queue un coup violent sur ce qu’il supposait être le plancher. Le coup porta en plein dans la poitrine d’un jeune Anglais solide et rageur qui, ne goûtant pas ce genre de plaisanterie, sauta sur le joueur et l’envoya, d’un coup de poing dans l’œil, rouler sur les dormeurs étendus sur le plancher. Une horrible confusion s’ensuivit; les lumières furent subitement éteintes et chacun se mit à frapper à tour de bras sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Quelqu’un, au milieu du bruit et de l’obscurité, tira un coup de revolver, et la bagarre ne finit que par la fuite des deux joueurs.
Depuis lors, éclairé par une connaissance plus intime des roueries inimaginables des joueurs américains, je me suis demandé plus d’une fois si le coup de queue final n’avait pas été prémédité de la part du joueur qui perdait.
Il n’y a pas plus d’une quinzaine d’années, les seuls êtres civilisés (si on peut leur donner ce titre) qui s’aventurassent dans les déserts de la Colombie anglaise, étaient les trafiquants et les employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ils occupaient quelques forts disséminés sur d’immenses espaces et servant de postes avancés au vaste système établi par la Compagnie pour l’exploitation du commerce des fourrures, et vivaient en termes d’amitié avec les membres des nombreuses tribus indiennes qui peuplaient le pays.
Ces forts ont été conservés, mais dans un but bien différent de leur destination première. Quelques-uns d’entre eux forment aujourd’hui le centre de petites villes et, au lieu d’être des entrepôts de fourrures et de pelleteries, contiennent les entrepôts où s’approvisionnent les blancs.
Le pays, au point de vue agricole, offre si peu de ressources, que, selon toute probabilité, aucun changement ne serait venu, pendant un siècle ou deux, changer son aspect primitif, sans les découvertes de l’or faites sur les bords du Fraser en 1858. Aussitôt que le bruit de ces découvertes parvint en Californie, les mineurs accoururent en foule. C’étaient pour la plupart de vrais pionniers américains, entreprenants, expérimentés, et qui poussèrent si avant leurs recherches, qu’en 1861 ils découvrirent le district du Caribou. Ce fut cette même année-là que les premières nouvelles de l’existence de l’or dans la Colombie anglaise parvinrent en Angleterre et y excitèrent l’effervescence dont nous avons déjà entretenu le lecteur.
Un grand nombre de ces premiers pionniers américains sont restés dans le pays, de sorte que la colonie, bien qu’anglaise de nom, se compose d’une population dont la moitié au moins est étrangère à l’Angleterre. Du reste, le caractère cosmopolite commun aux populations de la côte du Pacifique se retrouve là parfaitement marqué: il y a, outre les Américains et les Anglais, des Français, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Chinois, en un mot des représentants de presque toutes les races humaines.
Il est difficile de concevoir un pays d’une si vaste étendue ayant une si petite proportion de sa superficie propre à l’agriculture. On dirait que, sur ce point du globe, il n’y a que des rocs, des bois de pins et des torrents dévastateurs. Les estuaires des rivières sont bordés sans doute de terres qui pourraient être de la plus grande fertilité; mais ces terres sont couvertes de bois de haute futaie, entremêlés de buissons épais, et les défrichements exigeraient de trop grands travaux et de trop fortes dépenses pour qu’on s’y risquât à la légère. Dans le haut pays, il y a quelques vallées dont les terres arables, d’une étendue relativement insignifiante, offrent un sol tout à la fois léger et fertile. Partout où l’irrigation a été possible, on en a tiré bon parti. Mais quand la fertilité naturelle de ce sol vierge sera épuisée, ce qui ne tardera pas, le malheureux cultivateur trouvera difficilement d’autres terres qui ne soient pas trop éloignées des marchés où il peut écouler ses produits. Quant à fumer les terres dans cette partie du monde, on ne peut même pas y songer: les frais à faire pour cela porteraient les produits de l’agriculture à un prix hors de toute proportion avec ceux du commerce extérieur d’approvisionnement.
La véritable richesse du pays consiste en mines, en bois de haute futaie, en pêcheries, et, sous tous ces rapports, elle offre incontestablement de puissantes attractions au capitaliste disposé à courir la chance de tout perdre ou de faire une fortune colossale.
Pour moi, j’étais pressé de donner suite à mes projets, et je me hâtai d’en conférer avec mon compagnon de voyage. En discutant, nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que nos vues ne cadraient nullement. Les miennes—cela tenait sans doute à ce que mon esprit n’avait pas été mûri, comme le sien, par de fréquentes désillusions—étaient d’une nature beaucoup plus aventureuse que les siennes. Il désirait, quant à lui, rester où il était pendant quelque temps et y gagner un peu d’argent, avant de s’exposer à toutes les vicissitudes de fortune que ne peut manquer d’offrir la recherche de l’or. Je voulais, au contraire, me jeter immédiatement au milieu de la mêlée, et je le trouvais même bien pusillanime de ne pas partager mon ardeur. Mais, comme sa détermination était tout aussi irrévocable que la mienne, toute discussion ultérieure était inutile. Nous nous séparâmes en nous souhaitant l’un à l’autre toutes sortes de succès.
Je dois dire que, pas plus tard que le jour suivant, ma résolution eut un rude assaut à soutenir. Une offre très-séduisante me fut faite par un homme de loi dont j’avais, par hasard, fait la connaissance et qui me conseilla fortement de ne point me rendre aux mines. «Un mineur, me dit-il, n’est rien autre chose que le canal qui sert à conduire l’or dans la poche des autres. Sans doute le mineur n’admettra jamais qu’il en soit ainsi; mais il n’en est pas moins vrai qu’il n’est qu’un agent qui travaille pour nous. Pour deux ou trois mineurs qui ont su garder l’or qu’ils ont trouvé, je pourrais vous en citer des centaines entre les doigts desquels l’or a coulé comme l’eau. Pour nous, au contraire, gens de la ville, nous n’avons qu’à attendre à la côte que le flot de ces pauvres êtres abusés vienne nous apporter les richesses, fruit de leurs durs travaux.»
Mais l’esprit d’aventure était alors trop puissant chez moi pour me permettre d’écouter la voix de la raison, et je me bouchai les oreilles pour ne pas entendre ces sages conseils. Il est extrêmement probable que, si j’eusse écouté les avis de ce disciple de Blackstone (célèbre légiste anglais), je serais maintenant assez riche pour n’avoir plus besoin de travailler; car, avec une prescience digne de son état, il me recommanda vivement d’employer les deux ou trois cents livres sterling (de 5 à 7500 fr.) qui formaient mon petit capital, à l’achat de quelques lots de terrain qui longeaient le port. Je ne manquai pas d’aller examiner les terrains en question; mais je n’y vis qu’un amas de roches abruptes, éloigné de toute habitation et destiné, selon toute apparence, à faire éternellement tache sur le paysage au milieu duquel ils s’élevaient. Il n’en est pas moins vrai que cet emplacement affreux à voir se vendit cinq ans plus tard dix mille livres sterling (250 000 fr.), et que l’on y voit aujourd’hui les plus vastes entrepôts de la ville.
Quelque absurde que fût l’agitation à laquelle j’étais en proie, elle était d’autant plus pardonnable que presque tout le monde la partageait. Il n’était pas jusqu’aux hôteliers, gardes-magasins et autres rapaces de tous genres, qui ne fussent éblouis par les histoires de fortunes soudaines qui nous étaient rapportées tous les jours, au point d’abandonner les bénéfices assurés de leur état pour courir les chances incertaines de la recherche de l’or. La ville tout entière était dans un état de surexcitation indescriptible, et il aurait vraiment fallu une fermeté à toute épreuve pour résister aux tentations que faisaient naître ces récits merveilleux.
Une fois ma résolution prise, je ne perdis point de temps. J’achetai une paire de mules, autant de provisions qu’elles en pouvaient porter, les quelques outils indispensables, et, ayant rejoint quelques-uns de mes compagnons de voyage qui venaient de s’équiper de la même façon, je me dirigeai avec eux vers un des bateaux à vapeur qui s’apprêtaient à partir pour New Westminster. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que nous persuadâmes à nos mules de quitter la terre ferme; mais, étant parvenus, à force de coups de pied et de coups de bâton, à les convaincre de l’inconvenance de leur conduite, nous réussîmes à les conduire à bord et à les attacher à leurs râteliers. Après les avoir débarrassées de leurs fardeaux, nous leur donnâmes une assez forte ration pour qu’elles pussent être de bonne humeur durant la longue traversée qu’elles avaient à faire le lendemain, et nous revînmes à terre pour prendre congé des amis que nous quittions et passer une dernière nuit à rêver aux lingots d’or que le Fraser ne pouvait manquer de tenir en réserve pour nous... sinon pour d’autres.
Le matin suivant, au lever du jour, nous partîmes, après avoir eu la petite aventure suivante.
Un de nos compagnons de voyage, dont les pas mal assurés se ressentaient des libations trop copieuses de la veille, ne trouvant pas assez large la planche qui conduisait du quai au bateau, tomba dans l’eau, à la grande consternation de tous. Comme le pauvre garçon ne savait pas nager et que personne ne s’empressait de lui porter secours, je me jetai après lui et je parvins à le conduire jusqu’à un endroit, où prenant pied, je cherchai à le tirer hors de l’eau. C’était en vain que je le tenais par le bras: mon protégé n’avait plus de jambes, et il retomba à l’eau, m’entraînant avec lui et me serrant si fort que je ne pouvais lui être d’aucun secours ni me sauver moi-même. Je commençais à boire et à perdre ma présence d’esprit, lorsque, saisissant un moment favorable, je lui administrai un si violent coup de poing sur le nez, qu’il lui fallut bien me lâcher et couler à fond sans moi. Un bateau arriva à notre secours sur ces entrefaites, je me hissai dedans tout à fait épuisé, et l’objet de mes tendres soins ayant reparu à la surface, fut rattrapé et mis à bord plus mort que vif.
Quand il eut entièrement repris ses sens (et le repos qu’il prit après le bain ne lui fut pas inutile), il m’embarrassa autant par la chaleur de ses remercîments—il était d’origine irlandaise—qu’il m’avait auparavant embarrassé par la vigueur de ses étreintes aquatiques. Heureusement, son nez enflé nous fournit matière à rire: il protesta longuement de la joie qu’il éprouverait à voir son nez rester assez longtemps dans cet état pour lui servir d’avertissement contre l’abus des liqueurs fortes. Je crois que le brave garçon se serait après cela fait couper en morceaux pour moi, et, en vérité, quand plus tard l’occasion s’en présenta, il ne manqua pas d’en profiter pour me témoigner sa reconnaissance.
Au bout de dix heures environ de tours et de détours au milieu des îles nombreuses qui font du golfe de Géorgie le lieu du monde le plus charmant que l’on puisse imaginer, nous atteignîmes l’embouchure du Fraser, et nous fûmes bientôt en vue de New-Westminster, capitale de la Colombie anglaise, petite ville nouvellement éclose sur un des plus beaux sites que présentent les rives du fleuve. La ville est souvent désignée par le surnom de Stump City (la ville des troncs d’arbre), et il faut avouer que nul surnom ne fut mieux mérité. Une immense forêt de cèdres et de pins a été en partie abattue pour faire place aux rues irrégulières et aux chalets épars qui forment la noble capitale de la colonie. Les troncs noirs des arbres énormes s’élèvent de toutes parts, comme pour railler la puissance de destruction de l’homme, depuis la berge du fleuve jusqu’aux sombres massifs de la forêt sur lesquels il n’a pas encore étendu son domaine, et défient les impuissants efforts de leurs chétifs ennemis.
L’aspect de la ville ne nous en causa pas moins un sensible plaisir, car nous pouvions espérer d’être promptement délivrés de la nuée de moustiques qui s’était abattue sur nous depuis le moment que nous étions entrés en rivière. Ce fut pleins de joie que nous débarquâmes, en présence de tout ce que la population comprenait d’hommes, de femmes et d’enfants accourus à l’arrivée du bateau, seul événement qui vînt faire diversion à la monotonie de leur existence et leur offrir la chance de gagner de quoi vivre en exploitant sans pitié les voyageurs.
Nous nous consolâmes très-facilement de n’avoir à passer qu’une nuit à New-Westminster.
La capitale de la Colombie anglaise était alors dans un état tellement embryonnaire, que bon nombre de rues, situées sur le penchant de la colline, n’étaient que des carrières; le confiant étranger s’y trouvait à chaque instant exposé à faire des chutes d’une hauteur de dix à vingt pieds, à supposer que la première de ces chutes ne l’eût pas rendu incapable d’aller plus loin. La ville d’ailleurs n’était pas éclairée, et, comme ce soir-là il faisait nuit noire, il fallait pousser très-loin la curiosité pour entreprendre de la visiter.
Je le fis cependant, et je revenais sain et sauf à mon hôtel sur le quai, fier de mon succès et sifflant gaiement un air quelconque le long du chemin, lorsque... patatras! me voilà à quatre pattes, tombé, d’une hauteur de huit ou dix pieds, sur une masse vivante qui se met à se tordre, à gémir, à piailler, à pousser des cris de toute espèce. Je me rejette en arrière, pour me frotter les tibias, où j’éprouvais une vive douleur, et je tire une boîte d’allumettes de ma poche. J’aperçois alors devant moi un Indien dans une attitude pleine de menaces et la hache levée. Près de lui sa femme et ses enfants gesticulaient et poussaient des cris sauvages contre l’étranger qui était ainsi venu troubler leur sommeil.
Ne sachant pas un mot de la langue de l’Indien, et ne pouvant par conséquent lui faire mes excuses, alarmé d’ailleurs par son attitude, je tirai mon revolver. Aussitôt il laissa tomber sa hache, s’enfuit avec sa femme et ses rejetons cuivrés, et me laissa maître du terrain. Un examen plus attentif me montra que j’étais tombé sur la tente grossière que ces Indiens avaient plantée dans un enfoncement de la route, et que, dans ma chute, j’avais entraîné le tout sur la pauvre famille endormie.
Je m’en retournai en boitant, et arrivai à l’hôtel dans une humeur aussi noire que les rues de New-Westminster.
Nous devions partir le lendemain pour Fort Yale, situé à environ 100 milles (160 kilom.) en amont de New Westminster, et tête de ligne des bateaux à vapeur qui naviguent sur le Fraser.
Je ne crois pas qu’aucun autre fleuve aussi rapide ait jamais eu un service régulier de bateaux à vapeur. A certains endroits, près de Yale, le courant n’a jamais moins de douze à quatorze milles (de 19 à 22 kilom.) de vitesse à l’heure, et tout le cours du fleuve est semé d’écueils de toute espèce.
Les bateaux sont spécialement construits en vue des difficultés de cette navigation. Ils sont aussi plats que possible, et leur tirant d’eau n’est que d’environ deux pieds; mais ils reprennent en longueur et en largeur ce qu’ils perdent en profondeur. Leur moteur est une énorme roue de dix-huit à vingt-quatre pieds de diamètre, placée à l’arrière et aussi large que le bateau lui-même. Les palettes seules plongent dans l’eau, à une profondeur d’environ dix-huit pouces, et la roue est attachée à la machine par un système assez compliqué de tiges et de leviers. Les chaudières sont tout à fait à l’avant, et les foyers au niveau même du pont, afin qu’ils puissent profiter de tout le courant d’air que produit le mouvement du navire. La vapeur est conduite des chaudières aux cylindres de la machine qui est placée tout à fait à l’arrière dans l’entrepont, par de longs tuyaux qui, en été, donnent une chaleur insupportable. Il y a quatre gouvernails parallèles. Les machines sont à haute pression, et ce n’est pas, quand on s’embarque, sans quelque inquiétude que l’on examine les chaudières; car on peut être sûr qu’elles seront mises à une rude épreuve pendant le voyage, surtout si les eaux de la rivière sont ou trop hautes ou trop basses.
Nous eûmes la chance de trouver des places sur un des meilleurs bateaux, et nous partîmes accompagnés des bénédictions de toute la population qui nous montrait le plus touchant intérêt. Elle espérait sans doute qu’à notre retour nous nous arrêterions à New-Westminster, au lieu de courir en toute hâte dépenser, pendant l’hiver, tout notre avoir à Victoria.
La première partie de notre voyage ne fut pas particulièrement agréable, car l’épaisseur des bois qui bordent les rives du fleuve était telle qu’il nous était impossible d’observer le pays à travers lequel nous passions. Nous eûmes donc tout le temps d’examiner nos compagnons. Tous allaient aux mines. Les trois quarts étaient de vrais mineurs, à la mise et à la tenue desquels on ne pouvait se méprendre. L’autre quart était composé de boutiquiers et de joueurs, et de dames, dont une blanchisseuse, qui fit, ainsi que je l’appris plus tard, une belle fortune en exerçant son état, et une jeune femme pleine de courage qui allait rejoindre son mari.
Quand le dîner fut servi, la foule se précipita dans le salon, renversant sur son passage un ou deux nègres et les plats qu’ils portaient. Il semblait vraiment que le premier arrivé dût tout avaler et ne rien laisser aux autres. Je regrette d’avoir à dire que le capitaine eut toutes les peines du monde à réserver trois places pour les deux dames et pour lui.
Le dîner fini—et ce ne fut pas long,—la nappe ne fut pas plus tôt enlevée que les joueurs, joueurs de profession, grecs et autres, s’emparèrent de la longue table. L’or et les billets de banque sortirent des poches et changèrent rapidement de mains. D’énormes piles de pièces de vingt dollars (108 fr. 40 c.) s’étalaient sur la table de la façon la plus provocante, et le tintement de l’or mêlé au bruit des voix formait un concert absolument étourdissant. Les joueurs s’abandonnant à leur passion faisaient retentir le salon d’exclamations et de jurons effroyables. Tous, même ceux qui, par prudence ou manque d’argent, ne jouaient pas, suivaient le jeu avec une émotion presque aussi vive que celle des intéressés.
La nuit nous surprit ainsi occupés, et, laissant arriver à terre l’avant de notre bateau, les matelots l’amarrèrent à un arbre pour attendre que la lune vînt éclairer le fleuve.
Nous cherchâmes, mon compagnon et moi, un coin où l’on pût dormir tranquillement; mais, sans le mécanicien, avec lequel nous avions fait connaissance et qui nous permit d’étendre nos couvertures dans son sanctuaire, notre recherche eût été infructueuse.
Au bout d’une heure environ, nous fûmes réveillés par le bruit de la machine; nous étions de nouveau en marche. Le mécanicien nous pria poliment de le débarrasser de notre présence. Désespérant de dormir, nous allumâmes nos pipes et montâmes sur le pont.
Il faisait un brillant clair de lune. Nous remontions le fleuve, non sans difficulté, vu la force croissante du courant. L’aspect du pays environnant était complétement changé. A droite et à gauche s’élevaient d’effrayantes montagnes dont le pied plongeait presque à pic dans les eaux rapides du fleuve. Çà et là des rochers et des arbres submergés brisaient le courant et le diapraient de rides argentées. D’un côté, la lune projetait sa douce et brillante lumière; de l’autre, les montagnes étendaient leurs grandes ombres, au sein desquelles on ne pouvait rien distinguer que la lueur expirante de quelque feu révélant un campement d’Indiens. Plus loin, à un coude de la rivière, une ligne d’écume, bouillonnant sous les rayons de la lune, trahissait les écueils cachés, et, sur nos têtes, les étoiles brillaient paisibles, tandis qu’à nos pieds elles se miraient tremblantes dans les eaux froides du fleuve. Rien ne troublait le calme de cette scène, si ce n’est la bruyante respiration du monstre enflammé grâce auquel, luttant résolument contre les ondes, nous remontions le courant rapide. Le bruit des voix qui s’échappaient de la cabine faisait un étrange contraste avec la solennelle tranquillité de la nuit.
Soudain un bruit nouveau vint nous arracher à la contemplation des beautés de ce lieu et de cette nuit. Courant à l’arrière du navire pour me rendre compte de ce qui se passait, je vis des étincelles s’échapper de la cheminée d’un autre steamer, et la lueur rouge du foyer de sa machine se refléter sur les eaux, qu’il déplaçait rapidement dans ses efforts pour nous atteindre.
Afin de nous rejoindre, le capitaine du navire en question n’avait pas craint d’avoir recours au dangereux expédient de remonter la rivière dans l’obscurité, pendant que nous attendions, attachés au rivage, le lever de la lune.
Notre capitaine, qui avait l’œil à tout, s’aperçut aussitôt que moi des projets de notre rival, et se mit à faire retentir les échos de la rive de ses exclamations et de ses jurements. «Nous le battrons ou nous sauterons!» disait-il en donnant ses ordres à son équipage. Pour se confirmer dans cette résolution, il se fit verser deux ou trois rasades coup sur coup et ne sauta (il est vrai qu’il n’y eut pas de sa faute) qu’en paroles.
«Eh bien, fainéants! cria-t-il aux malheureux chauffeurs, est-ce que vous allez vous donner un peu de mouvement là-bas!
—Vous en parlez à votre aise, crièrent les autres, vous qui n’avez rien à faire qu’à rester là-haut à souffler comme une baleine. Si vous ne voulez pas être dépassé par l’autre bateau, vous ferez bien de vous procurer les services de quelques-uns des flâneurs qui s’amusent là-haut; car nous sommes à bout de forces, nous autres.»
Le capitaine et son second ne répondirent à ces observations que par de nouveaux jurons. Les Indiens engagés pour faire la provision de bois furent envoyés, à grands coups de pied et avec force objurgations en jargon chinouk, servir d’aides aux chauffeurs, et bientôt l’ardent foyer, dont la gueule embrasée était sans cesse alimentée de bois résineux, commença à ronfler bruyamment et à projeter au loin ses rouges lueurs.
Notre marche devint plus rapide; mais notre rival gagnait sur nous; il fallut donc adopter l’avis des chauffeurs.
Le capitaine se mit à crier: «Cinq dollars par tête, mes enfants, à tous ceux qui voudront donner un coup de main aux machines!
—Présent! capitaine.—Voilà le cheval de renfort demandé!—Accepté, pardieu!»

Ils se passèrent les grosses bûches avec la rapidité de l’éclair.
![]()
Une demi-douzaine de volontaires se précipitèrent dans l’étroit espace occupé par les chauffeurs et se passèrent les grosses bûches de bois résineux avec la rapidité de l’éclair. La chaleur les força bientôt à se mettre nus jusqu’à la ceinture; ils furent en un instant noirs de suie et de résine; la sueur qui les inondait dessinait sur eux des tatouages qui leur donnait l’air de vrais sauvages. C’était une scène à copier pour l’illustration de l’Enfer de Dante.
Notre rival avançait toujours; notre capitaine enrageait.
«Hé! Gluson! cria-t-il à son second, est-ce qu’il n’y a pas quelque part du lard et des jambons? Il me semble en avoir vu mettre une provision à bord. La marque est un O.
—Quoi! les jambons d’Oppheimer?
—Sans doute. Quel droit cet israélite a-t-il d’avoir du porc? Faites-moi jeter tout ça au feu, et vite!
—Très-bien, capitaine.»
Plusieurs sacs de lard et de jambon furent jetés dans les flammes, qui rugirent comme une tempête. Le manomètre indiqua cent soixante livres de pression par pouce carré, c’est-à-dire quarante de plus que n’en permettait le règlement encadré sous verre dans la cabine.
Le mécanicien crut devoir appeler l’attention du capitaine sur ce fait; mais ce dernier n’était pas d’humeur à entendre raison.
«Eh bien! dit-il, si l’inspecteur du gouvernement est à bord et s’il a peur pour sa personne, dites-lui qu’il se place aussi loin qu’il pourra à l’arrière, et qu’il se tienne prêt à se sauver. Le vieux bateau n’a jamais trouvé son maître, il ne le trouvera pas, à moins qu’il ne saute!»
A ce moment, les deux bateaux étaient bord à bord, et, des deux ponts, passagers et équipages se défiaient, se raillaient, en proie à une surexcitation qui avait gagné tout le monde.
Mais le destin nous était contraire. Soudain nous sentîmes et entendîmes tout à la fois un choc et un fracas terribles: nous nous trouvâmes immobiles, enferrés sur un arbre submergé qui venait de pénétrer à travers la quille de notre navire. Le bateau rival nous envoya en passant ses rires et ses quolibets, et ne s’arrêta même pas pour voir si nous allions couler.
L’arbre submergé était un tronc pointu sur lequel nous nous étions jetés avec tant de violence, qu’après avoir traversé notre charpente il s’était enfoncé de plus de dix pieds dans l’entrepont, où il avait tué un malheureux cheval appartenant à l’une des dames.
On put scier l’arbre et, après un léger mouvement de recul, boucher immédiatement le trou avec des couvertures empruntées aux passagers. L’eau n’en montait pas moins rapidement; le choc avait été si violent que toute la charpente du navire avait été ébranlée et disjointe.
Nous dûmes donc gagner la rive et y débarquer avec tout notre bagage. Nous attendîmes là deux jours qu’un autre bateau vînt nous prendre, n’ayant pour tout abri que le feuillage des arbres. Pour compléter notre déconvenue, il plut pendant tout le temps, et nos mules et nous fûmes réduits à la portion congrue. Mais les joueurs, même sous les sapins qui les protégeaient à peine contre la pluie, n’en continuèrent pas moins à jouer.
Ayant pu repartir enfin, nous arrivâmes, non sans peine, à Fort Yale. A partir de là, nous allions avoir à faire encore près de quatre cents milles (640 kil.), et cela à pied, avant d’atteindre le district minier.
Ce fut alors que commencèrent véritablement nos peines. Notre voyage avait été jusque-là si facile, que nous n’avions eu l’occasion de mettre à l’épreuve ni nos forces physiques, ni notre patience.
Le premier de nos soucis, avant de nous mettre en route, fut de distribuer entre nos mules les fardeaux qu’elles devaient porter. Cela exige plus d’habileté qu’on ne le croirait; l’absence d’équilibre produit sur le dos des animaux des écorchures qui souvent forcent les voyageurs à s’arrêter à moitié chemin.
Fort Yale était alors encombré de caravanes de bêtes de somme à destination du district minier; nous eûmes donc une excellente occasion de nous initier aux mystères du chargement des mulets.
A cette époque, il n’y avait, en fait de route, qu’un sentier escarpé qui tantôt montait du marais à la montagne, tantôt descendait de la montagne au marais, jusqu’à ce qu’on arrivât enfin à William’s Creek, centre du district minier du Caribou, où se trouvait agglomérée une population d’environ huit à dix mille hommes. On peut aisément se figurer quelle procession continuelle de bêtes de somme il fallait pour subvenir aux besoins de cette population.
Yale était un petit centre très-vivant et avait bien plus l’apparence d’une ville commerçante que New Westminster, la capitale de notre colonie.
Les chargeurs de profession sont presque tous Mexicains et ont tout l’air d’une race de véritables bandits. Quand ils sont absolument sans argent, ils travaillent comme des esclaves pendant un mois, et puis dépensent en quelques jours tout ce qu’ils ont gagné.
J’eus le bonheur de faire la connaissance d’un de ces gentlemen qui venait de perdre son dernier dollar à une table de jeu. Avec son vaste sombrero[I], ses guêtres brodées d’argent, son poncho[J], c’était bien l’un des plus beaux spécimens de sa race qu’on pût trouver. Il condescendit, avec tous les airs d’un grand seigneur qui a éprouvé des revers de fortune, à nous aider de ses services pendant le premier jour de notre voyage, moyennant la bagatelle de 5 dollars (27 fr. 10 c.).
La première chose qu’il fit, en voyant les bâts que nous avions apportés de Victoria, fut de déclarer, en haussant les épaules, qu’ils ne pouvaient servir à rien, et que, si nous n’avions pas des aparejos convenables, nous n’arriverions jamais aux mines. Sur ce, il sortit et revint, peu de temps après, avec d’énormes bâts de cuir, en forme de bissac et rembourrés de foin. Ce ne fut pas pour nous une mince dépense; mais il fallut en passer par là.
Nos bagages et nos provisions ayant été, avec beaucoup d’adresse, divisés en huit paquets de 150 livres, et chargés sur nos quatre mulets, nous nous mîmes en marche le long du sentier tortueux qui se dirige vers l’intérieur à travers les cañons[K] ou gorges du Fraser. Ce sentier, jusqu’à environ soixante milles (96 kilom.) de Yale, court à travers des montagnes qui ont reçu le nom de Cascade Mountains (monts des Cascades).
Durant notre premier jour de marche, le Mexicain devait nous accompagner pour nous apprendre à conduire nos bêtes réfractaires, à assujettir leurs fardeaux quand leurs courroies se relâchaient, enfin à les décharger le soir. Nous fîmes ainsi une douzaine de milles (19 kilom.).
A de longues distances, nous voyions s’élever sur le bord du chemin une hutte où le voyageur trop confiant trouvait, pour tout rafraîchissement, du whiskey capable de tuer un homme, et où nous ne rencontrions que quelques mineurs, dont les vêtements en haillons disaient assez à quel point la fortune leur avait été défavorable. Les histoires que ces pauvres diables racontaient ne ressemblaient guère aux récits merveilleux des journaux ou à ceux des rares favoris de la fortune que nous avions pu rencontrer; et notre enthousiasme était singulièrement refroidi quand nous arrivâmes à Spuzzum Ferry (bac de Spuzzum), où nous passâmes le fleuve dans un de ces bacs qui sont manœuvrés d’un bord à l’autre à l’aide de poulies courant le long d’un câble suspendu au-dessus du fleuve.
Ce passage n’eut pas grands charmes pour moi; car, juste au-dessous de nous, le Fraser faisait une chute profonde, et la force du courant était telle que le bateau, tout solidement construit qu’il était, se renflait et se tordait, quand nous fûmes au milieu du fleuve, comme une feuille de papier que l’on approche du feu.
A quelque distance de là, nous rencontrâmes deux hommes, dont l’un était le brave Irlandais que j’avais eu le bonheur de tirer de l’eau. Il était monté sur une mule, vieille mais ombrageuse, qui avait l’habitude de ruer toutes les fois qu’elle sentait quelqu’un derrière elle. Je fus heureux de retrouver ce joyeux garçon, qui, grâce à son goût tout particulier pour les coq-à-l’âne, promettait de nous divertir le long de la route. Il ne fut pas moins heureux que nous de la rencontre; son camarade et lui nous demandèrent à se joindre à nous pour le reste du voyage.
La nuit venue, nous nous arrêtâmes dans un renfoncement de la montagne, près d’une cascade qui tombait d’une hauteur d’environ deux cents pieds dans un bassin dont la profondeur interrompait la rapidité de sa course. Trouvant à notre portée, dans ce lieu, les deux objets de première nécessité, le bois et l’eau, nous nous y établîmes pour la nuit, et notre Mexicain nous fit ses adieux.
Les mulets, débarrassés de leurs fardeaux, furent mis en liberté, sous la conduite de l’un d’eux qui portait une clochette au cou; puis chacun se livra au travail pour lequel il se sentait des dispositions particulières. L’un planta la tente; un autre coupa du bois; un troisième alluma le feu; Pat, l’Irlandais, qui, entre autres professions variées, avait exercé celle de cuisinier, se mit à préparer le souper.
Les chercheurs d’or et autres membres des tribus errantes de la côte nord du Pacifique ont une excellente et prompte méthode de faire une très-bonne espèce de pain. Ils mêlent de la levûre en poudre à la farine qui leur sert à faire la pâte, et, sans plus attendre, divisent leur pâte en tranches assez larges pour couvrir le fond d’une poêle à frire. Celle-ci est alors placée avec son contenu au-dessus d’un feu clair; quand un côté de la galette est cuit, on la retourne et l’on fait cuire l’autre côté. Il faut de cinq à dix minutes pour cuire chaque pain, de sorte qu’en moins d’une heure, à partir du moment où le feu est allumé, on peut faire une quantité de pain suffisante pour une nombreuse compagnie[L].
Nous avions un appétit féroce, et nous dévorâmes notre frugal repas avec plus de plaisir que jamais alderman de la cité de Londres n’en a trouvé aux banquets de Guildhall; puis, après avoir fumé nos pipes et causé autour du feu, nous nous enveloppâmes dans nos couvertures et nous endormîmes sous les sapins odoriférants.
L’aube nous trouva debout; Pat, fidèle à la tâche qu’il avait choisie, s’occupa du déjeuner, pendant que les autres couraient après les mules, pliaient la tente et préparaient tout pour le départ.
Notre voyage, ce jour-là, fut moins agréable que le jour précédent. Il se mit à pleuvoir à torrents, et, en peu de temps, le sentier devint glissant et dangereux; mais il n’y avait qu’à se résigner et à achever tant bien que mal notre étape.
Après bien des peines, nous arrivâmes au sommet d’une énorme falaise appelée le Nicaragua slide. Il nous fallait redescendre jusqu’au bord de la rivière qui coule à plus de mille pieds au-dessous. Les flancs de cette montagne sont presque perpendiculaires, et l’on ne croirait pas, à première vue, que même un chamois pût la gravir; mais, en y regardant de plus près, on aperçoit un étroit sentier coupé en zigzag et descendant jusqu’au fond de la vallée. De la hauteur vertigineuse où nous étions, c’est à peine si nous osions regarder en bas, mais il n’y avait pas à reculer; la mule porte-clochette (qui malheureusement était à moi) fut donc chassée devant nous, et, bêtes et gens, tout le monde suivit.
A mi-côte arrivèrent jusqu’à nous les tintements d’une autre clochette et les cris d’hommes qui conduisaient un train de mulets revenant des mines. A chaque tournant du zigzag, un petit refuge était ménagé dans le roc pour donner libre passage à ceux qui se rencontraient. Nous nous rangeâmes avec tous les animaux dans un de ces refuges pour laisser passer ceux qui montaient; mais la mule porte-clochette étant trop loin en avant, nous ne pûmes la rappeler; nous supposions d’ailleurs qu’en animal expérimenté elle aurait l’intelligence de se garer.
Malheureusement, notre confiance était mal placée: car la sotte bête poursuivit sa route jusqu’à la rencontre de l’animal qui montait et qui, mieux avisé, prit obstinément le côté du rocher. Il était impossible aux deux mulets, vu la largeur de leurs fardeaux, de se croiser en cet endroit. Ne pouvant s’arrêter à cause de la rapidité de la descente et de l’impulsion que lui imprimait la lourdeur de sa charge, mon mulet tâcha de passer sur le bord du précipice; mais, au passage, les paquets s’accrochèrent, l’animal perdit pied, et, après avoir rebondi une ou deux fois contre les rochers, alla tomber comme une masse dans les eaux écumantes du torrent.
Au moment de sa chute, la pauvre bête avait été débarrassée d’une partie de sa charge. Nous pûmes retrouver quelques paquets non sans peine et sans péril, et les diviser entre les autres mulets. C’était malgré tout pour moi une perte sérieuse, car la valeur de cet animal représentait près de la moitié de mon capital. Ce fut ainsi que, dès le début, je reçus ma première leçon dans l’art de mettre en pratique la patiente résolution si nécessaire à un aventurier.
Nous continuâmes à remonter le Fraser, longeant le flanc des montagnes qui, sur une longueur d’environ soixante milles au-dessus de Yale, se rapprochent à ce point qu’il semble qu’elles se soient brusquement fendues pour livrer passage au fleuve puissant et torrentueux qui coule à leur pied.
Parfois il nous arrivait de rencontrer une longue file d’Indiens qui, négligeant leurs occupations habituelles pour gagner les dollars de l’homme blanc, faisaient l’office de bêtes de somme. Comme cela se pratique ordinairement parmi les sauvages, les malheureuses squaws (femmes des Indiens) avaient plus que leur part de la peine. Chacune d’elles portaient deux sacs de farine de cinquante livres chaque, quelquefois trois, et souvent un bébé perché sur le haut de cette énorme charge, pendant que son seigneur et maître marchait en avant, portant d’un air calme un seul sac sur ses épaules aristocratiques.
Mais j’ai omis jusqu’à présent de parler des Chinois, qui forment cependant aujourd’hui le fond le plus important de la population de ce pays. On ne saurait trop louer la patiente industrie de cette race. Ce sont eux qui exploitent les placers[M] dont les blancs ne voudraient pas seulement entendre parler, et qui, à force d’ordre et de frugalité, réussissent à faire des économies là où d’autres ne trouvaient pas de quoi vivre.
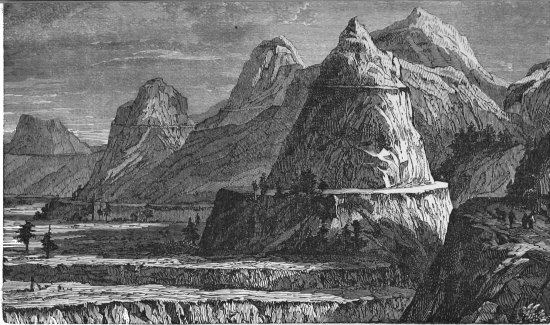
Les terrasses du bassin de Fraser.
![]()
Leur ambition, quand ils ont amassé un peu d’argent, est d’ouvrir un magasin d’épicerie ou de s’établir blanchisseurs. Ils sont arrivés à avoir le monopole presque absolu de cette dernière profession en Californie et dans les autres contrées aurifères de la côte du Pacifique. Dans les villes, les emplois de domestiques et de garçons de bureau sont presque tous remplis par des Chinois. Il y a à San-Francisco des maisons chinoises dont l’importance dépasse de beaucoup celle des plus fortes maisons américaines ou européennes.
Mais laissons pour le moment les Chinois, et revenons à notre voyage.
Deux autres journées de marche nous amenèrent, sans incident digne de remarque, à la petite ville de Lytton, située au confluent du Fraser et de la Thompson. A partir de là, c’était le cours de cette dernière rivière que nous avions à remonter.
De tous les sites d’aspect morne et lugubre qui existent au monde, c’est assurément à la vallée de la Thompson, ou du moins aux premiers quinze ou vingt milles de cette vallée, à partir de son embouchure, qu’il faut donner la palme. Les cañons du Fraser sont cependant d’un aspect bien sauvage; on n’y voit que rochers entassés où même le sapin refuse de croître.
Nous nous dirigeâmes en toute hâte à travers cette affreuse solitude, vers Cook’s Ferry (le bac de Cook), où nous traversâmes la rivière. De là il nous fallut remonter, le long de la rive nord de ce cours d’eau, à travers un pays plus ouvert où les prairies abondent, jusqu’à une petite rivière appelée la Buonaparte.
Les rives de cette dernière sont basses et marécageuses, et nous y fûmes tourmentés par les moustiques au point que nos mains et nos visages ressemblaient à des oranges bouillies, barbouillées de jus de betterave.
Deux ou trois jours de marche nous amenèrent à un plateau d’une altitude d’environ mille pieds, où toute l’eau que nous pûmes trouver était fortement alcaline. Là, nos animaux nous donnèrent une peine infinie, car chaque nuit ils s’écartaient de six ou sept milles (9 à 11 kilom.) à la recherche d’un peu d’eau douce. C’était pour nous un exercice fatigant, mais excellent, car il nous rendit bientôt aussi habiles que des Indiens à découvrir la piste de nos bêtes égarées.
Une nuit, nous fûmes joints par un marchand de bestiaux qui ramenait de l’Orégon environ cinq cents têtes de bétail et un troupeau de moutons. Nous fûmes heureux, comme on peut le croire, de pouvoir remplacer notre lard rance par quelques tranches de succulent bifteck.
La compagnie du marchand de bœufs, qui se trouva être un membre de l’Assemblée législative de l’Orégon, nous fut particulièrement agréable. Je crois bien qu’en fait d’instruction littéraire il pouvait, à la rigueur, écrire son nom; mais dans ces pays nouveaux un bras vigoureux a, la plupart du temps, plus de prix qu’une forte tête, et, comme il possédait incontestablement le premier de ces deux avantages, il est à présumer que ses commettants l’avaient nommé en connaissance de cause.
Cet homme était vraiment un magnifique spécimen du colon de l’Ouest. Haut de six pieds quatre pouces[N], avec un dos et des épaules larges et forts comme une muraille, droit comme un Indien, il portait tous les signes de la franchise et de l’intrépidité sur son visage bruni par le grand air. On voyait, à la résolution qui brillait dans son regard, que c’était un homme devant lequel plus d’un maraudeur ou voleur de chevaux avait dû trembler. Avec cela, gai, bon compagnon, et sans la moindre tendance à abuser de sa force.
Le matin qui suivit notre rencontre, j’allai, au lever du soleil, rassembler nos mules, et les trouvai, à l’exception de deux, à l’endroit où je supposais qu’elles devaient être. En cherchant les deux bêtes absentes, je rencontrai un des bouviers du marchand de bestiaux. Cet homme avait l’air chagrin, et, comme je lui en demandais la cause, il me dit qu’il leur manquait quarante têtes de bétail et qu’il commençait à craindre qu’il n’y eût des voleurs dans les environs. Nous cherchâmes encore ensemble quelque temps, mais sans succès, et nous dûmes enfin retourner à notre campement.
En arrivant, nous vîmes Pete[O], le marchand de bestiaux, et l’un de ses Mexicains explorer d’un œil soucieux les environs, pendant que les bêtes du troupeau couraient çà et là, mugissant, renâclant, et contenues avec peine par les autres toucheurs de bœufs. Quand Pete vit revenir son homme sans les bêtes qu’il attendait et apprit qu’il nous manquait aussi deux mules, ses soupçons se changèrent en certitude, et il s’écria: «Allons, mes enfants, je me doute que nous allons avoir à donner la chasse à ces incorrigibles gredins; qui veut en être?»
Nous voulions tous en être; mais comme il n’y avait pas assez de chevaux pour tout le monde, et qu’il fallait laisser quelqu’un pour garder ce qu’on ne nous avait pas volé, Pete, l’Irlandais Pat, un Mexicain et moi, formâmes l’expédition. Le marchand de bœufs avait sa longue carabine qu’il portait en travers de sa selle; nous avions, nous, des revolvers à six coups, et nous étions tous bien montés, Pete ayant d’excellents chevaux.
La difficulté était de retrouver la piste des voleurs, et nous tînmes conseil avant de partir. En premier lieu, il était bien évident qu’ils n’avaient pas dû suivre le chemin tracé, mais trouver quelque moyen de gagner la chaîne de montagne qui était entre nous et la Thompson, afin de passer cette rivière à la nage et de se jeter dans le pays ouvert qui de là s’étend vers la Colombie, sur un espace d’environ trois cents milles (480 kilom.). Une fois la rivière passée, inutile de chercher à les atteindre, car ils pouvaient prendre à travers les plaines une douzaine de directions différentes. L’important était donc de se hâter, sans pourtant tout risquer en se précipitant à l’aventure sur la première piste venue.
Dans cette conjoncture, le Mexicain (dont nous ignorions les antécédents et qui très-probablement avait quitté les charmes d’une vie de brigandage pour ceux d’une honnête existence) se trouva être un atout dans notre jeu.
Nous conduisant, à un mille environ, vers une petite colline qui semblait avoir été placée là par quelque caprice de la nature, notre guide nous fit monter au sommet. Nous eûmes de là une vue si magnifique du pays environnant, que nous ne pûmes nous empêcher de pousser des cris d’admiration.
A l’est tournait une longue et large vallée, de l’autre côté de laquelle s’élevaient les montagnes qui nous cachaient la fourche septentrionale de la Thompson. Entre ces montagnes et nous, quelque part dans la vallée, nous savions que devaient se trouver nos ennemis, hâtant leur marche vers l’un des cols de la chaîne qui étaient au nombre de trois: l’un très-grand, à quelque distance au nord, au-dessus de nous; les deux autres presque en face de nous et plus rapprochés l’un de l’autre, mais de moindres dimensions et, selon toute apparence, d’un accès moins facile que le premier.
Au loin, à travers ces ouvertures, on pouvait apercevoir les sommets escarpés et neigeux des montagnes Rocheuses. Comme je m’abandonnais à la contemplation de ce spectacle grandiose, Pete me saisit le bras: «Eh bien! jeune homme, allons-nous cesser de regarder le ciel et nous occuper de nos affaires? Écoutons ce que le Mexicain veut nous dire.»
Juan regarda d’abord en amont, puis en aval, comme s’il voulait lever le plan de la vallée. Au bout de quelques instants, il sembla fixé, et indiquant du doigt les deux cols de la montagne rapprochés l’un de l’autre en face de nous:
«Voleurs de chevaux par là, Pedro.
—J’aurais cru qu’ils se seraient dirigés vers cette passe, dit Pete en montrant, vers le nord, la gorge la plus large, ils y trouveraient un chemin plus facile.
—Voleurs de chevaux pas chercher chemins faciles; chercher, s’en aller vite. Nous les trouver par ici.»
Restait à découvrir un chemin pour arriver au pied des deux passes, ce à quoi notre position élevée nous aida beaucoup. Nous apercevions, non loin de nous, un petit lac presque à sec, mais qui, à l’époque de la fonte des neiges, donnait naissance à un cours d’eau qui se dirigeait vers la vallée, à travers un bois épais de sapins rabougris.
Nous descendîmes de notre observatoire, remontâmes à cheval et nous dirigeâmes en toute hâte vers le cours d’eau dont nous avions reconnu la direction.
Nous parlions à peine, tant notre rage était grande, car dans le Far West, après l’assassin, il n’est pas de plus grand ennemi de l’homme que le voleur de bestiaux. Les deux professions, du reste, sont en général assez intimement associées.
Il nous était impossible, dans un rayon assez étendu autour de notre camp, de reconnaître par les traces ordinaires la route qu’avaient suivie les fugitifs. En effet, pendant la nuit tous les bestiaux avaient erré au loin en quête d’eau potable, et c’était dans toutes les directions et dans tous les sens que se voyaient les traces de leurs pas. Il fallait donc arriver à l’extrême limite des excursions de nos bêtes pour trouver des indices qui pussent nous mettre sur la piste de nos voleurs.
Nous avions déjà fait sans rien trouver deux ou trois milles le long du lit desséché du lac et de la petite rivière qui s’en échappe. Pete commençait à soupçonner Juan de s’entendre avec nos ennemis, lorsque nous arrivâmes sur le bord d’un ruisseau qui se jetait dans le lit de la rivière dont nous suivions le cours, et le remplissait d’un ou deux pieds d’eau. Un peu plus loin le ruisseau se divisait en deux branches; nous résolûmes de suivre la plus large.
Juan dit qu’il suivrait l’autre pendant quelque temps et puis nous rejoindrait; ce que voyant, je me décidai à l’accompagner.
Nous piétinâmes dans l’eau pendant quelques minutes; le fond était doux, sablonneux, et la profondeur diminuait à mesure que nous avancions. Il était évident que l’eau du ruisseau se perdait dans ce sol léger et spongieux.
Soudain, à l’endroit même où l’eau cessait et où le terrain redevenait sec, j’entendis Juan s’écrier: «Ah! lui, rusé coquin! passé dans l’eau pour cacher ses pieds.»
Nous courûmes au grand galop rejoindre Pete et l’Irlandais, que nous trouvâmes désolés de n’avoir rien découvert.
Pete, électrisé par les nouvelles que nous lui apportions, partit à fond de train. Nous avions peine à le suivre. Une fois sur la vraie piste, nous nous savions sûrs de notre proie, car on ne peut faire marcher des bestiaux aussi vite que nous les poursuivions. Pete demanda à Juan qui il croyait pouvoir être le chef de nos voleurs.
«Slippery Jack», dit Juan. Jack l’insaisissable était en effet le plus fameux voleur du pays et l’un des plus grands scélérats de tout l’Orégon.
«Dire que je l’ai tenu au bout d’une corde, dit Pete, et que je n’ai pas serré le nœud parce que j’avais besoin d’une voix pour mon élection à l’Assemblée législative!»
Je fis mes compliments à Pete.
«Oh! dit-il, les affaires politiques sont réglées maintenant, et il serait bien possible que d’ici à ce soir j’aie diminué d’une unité le nombre de mes commettants.»
Il frappa d’une manière significative la crosse de sa longue carabine, et notre discussion cessa.
Nous approchions du revers du plateau qui descendait dans la vallée. Les traces de nos voleurs devenaient de plus en plus fraîches et nombreuses. Juan nous dit qu’il lui semblait entendre au loin le mugissement d’un taureau.
Au bout d’une autre demi-heure de galop effréné, nous vîmes le ruisseau tourner soudainement à droite. A gauche s’étendait une prairie d’où je crus pouvoir obtenir une vue de la vallée. Je m’y élançai et me trouvai bientôt arrêté sur le bord d’un immense ravin large de cent à deux cents mètres et profond d’au moins trois cents.
Cette énorme fissure allait, se creusant et s’élargissant, jusqu’au fond de la vallée, dans laquelle elle se confondait à environ deux milles de l’endroit où j’étais. Guidé par un filet de fumée bleuâtre, si mince et si vaporeux que pendant quelques minutes je me demandai si c’était bien de la fumée, je courus avec toutes les précautions possibles le long du ravin, jusqu’à ce que j’arrivai à environ un demi-mille (800 mètres) du lieu où j’apercevais la fumée. Alors, mettant pied à terre et m’avançant avec précaution en me cachant derrière les arbres, j’explorai de nouveau du regard les profondeurs de la vallée, où, délicieux spectacle! je vis enfin nos bestiaux, nos mules et trois atroces gredins qui faisaient tranquillement cuire leur dîner.
Je courus à l’endroit où j’avais laissé mon cheval, l’enfourchai et rejoignis Pete et les autres, à qui je dis qu’ils faisaient fausse route. Il n’en était rien cependant, car les traces que nous avions reconnues se multipliaient. Le lit du ruisseau changea bientôt de direction et par une descente rapide nous mena bientôt à la vallée, où il rejoignait un petit cours d’eau qui descendait du ravin que j’avais reconnu.
Les voleurs, il n’y avait pas à en douter, avaient remonté ce nouveau cours d’eau, en passant dans l’eau pour cacher leurs traces, et étaient arrivés au ravin où, se croyant en sûreté, ils s’étaient arrêtés pour laisser reposer leurs bêtes. Sans mon heureuse diversion, ils auraient fort bien pu nous échapper, car nous aurions pu les chercher toute la nuit dans la vallée sans les trouver.
Nous attachâmes, pour plus de précaution, nos chevaux à des arbres et continuâmes notre poursuite à pied, marchant sur le flanc de la colline pour éviter les coups de feu de quelque sentinelle en embuscade sur le bord de la petite rivière.
Cette précaution n’était pas superflue: car, en arrivant près du ravin où nos adversaires étaient cachés, Pete me montra un homme qui montait la garde en se promenant à pas de loup le long d’un petit bouquet d’arbres.
M’ayant enjoint de rester où j’étais et d’arrêter la marche en avant de nos camarades, Pete s’avança, tantôt rampant sur le sol et tirant sa carabine après lui, tantôt s’élançant rapidement derrière un arbre ou un buisson pour se mettre à couvert derrière un autre, jusqu’à ce qu’enfin il fut à courte portée de l’ennemi. Il reconnut Slippery Jack lui-même. Abattant aussitôt son fusil, il visa et fit feu: l’homme fit un bond et retomba roide mort.
Sachant que la détonation donnerait l’éveil à ses compagnons, nous nous élançâmes aussitôt et arrivâmes sur eux avant qu’ils eussent eu le temps de courir à leurs armes. Les tenant au bout de nos revolvers, nous leur dîmes que, leur chef étant mort, nous leur ferions grâce de la vie s’ils se rendaient. Ils étaient complétement démoralisés, et nous n’eûmes qu’à leur lier les mains avec une branche d’osier que nous trouvâmes sur le bord de l’eau.
Cela fait, nous attachâmes nos prisonniers sur leurs propres chevaux, nous les chassâmes devant nous jusqu’à ce que nous trouvâmes un bon campement pour la nuit. Deux d’entre nous retournèrent enterrer le corps du malheureux Slippery Jack, pendant que deux autres veillaient sur nos prisonniers.
Le lendemain nous rejoignîmes nos compagnons, qui furent ravis du succès de notre expédition. Continuant notre voyage, nous arrivâmes bientôt à William’s Lake, où nous abandonnâmes nos trois captifs aux tristes rigueurs de la loi. De William’s Lake nous nous dirigeâmes vers la Quesnelle. C’est des deux côtés de cette rivière que s’étend le riche district minier du Caribou.
Il nous restait, après avoir traversé la Quesnelle, environ soixante milles (96 kilomètres) à faire pour atteindre William’s Creek; mais quelle route! Il est impossible de donner une idée de ce qu’était alors ce chemin. Ici un marais, océan de boue dont les écueils étaient des racines ou des troncs d’arbres; là les flancs glissants d’une montagne, détrempés par la fonte des neiges et par une pluie fine qui tombait en moyenne trois jours sur quatre; plus loin, entre Antler Creek et William’s Creek, la Bald Mountain (montagne Chauve) de sept ou huit mille pieds, et dont les sommets, même vers la fin de juin, étaient couverts de neige. Chaque nuit un froid vif durcissait assez la neige pour qu’on pût y marcher le matin, avant que la chaleur fût assez forte pour la fondre.
Nos mules ne pouvant venir jusque-là, il nous fallut les vendre à Keithley’s Creek pour la moitié de ce qu’elles valaient, diviser nos bagages en paquets de quatre-vingts livres, les charger sur notre dos et faire deux fois, ainsi chargés, ce pénible voyage.
Enfin, après seize jours de fatigues inouïes, nous nous trouvâmes sains et saufs, avec nos bagages, à William’s Creek, où nous commençâmes par nous accorder deux jours d’un repos indispensable.
Personne au monde n’est autant que le chercheur d’or le jouet des circonstances; personne n’a moins que lui le temps et les moyens de calculer les chances bonnes ou mauvaises du parti qu’il va prendre; personne enfin n’est plus que lui la victime ou le favori de la fortune: sa profession n’est qu’un jeu de hasard et il n’est lui-même qu’un joueur déterminé.
La science, contrairement à ce qui se passe pour les métaux moins précieux, ne lui est pour ainsi dire d’aucun secours. L’expérience pratique a plus de valeur; car, pour ce qui est de l’existence de l’or sur un point donné, l’opinion de quelques vieux chercheurs d’or a plus de poids que celle de tous les membres de n’importe quelle société de géologie. Mais, il faut bien le dire, l’expérience elle-même est à chaque pas en défaut. Il y a—peut-être faudrait-il dire aujourd’hui il y avait—en Californie des placers appelés par les vieux mineurs Greenhorn (pointe des inexpérimentés, des nigauds), et qui, exploités, devinrent un jour les gisements les plus riches.
On raconte ainsi l’origine de ce nom. Vers 1851, une foule de mineurs étaient à l’œuvre sur les bords de la rivière où se trouvent ces placers et recueillaient une grande quantité d’or. Un des axiomes reconnus de la profession est que le précieux métal a existé d’abord dans les veines de quartz dont la colline est en partie formée, et que, la surface du sol se décomposant par l’action des influences atmosphériques, l’eau a entraîné l’or, qui, en vertu de sa pesanteur spécifique, s’est déposé dans le lit du fleuve. Jugez, d’après cela, de la surprise des vieux mineurs quand ils virent une compagnie d’émigrants nouvellement arrivés s’établir au faîte d’une colline détachée au centre de la vallée, et là, creuser et bêcher avec toute l’ardeur dont ils étaient capables. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand il fut constaté que cette colline dont pas un mineur expérimenté n’aurait voulu entendre parler, et sur laquelle les autres ne s’étaient établis que par pure ignorance, était l’un des terrains aurifères les plus riches des environs! Greenhorn, ainsi nommée pour caractériser l’inexpérience des pionniers qui s’y étaient établis, devint un des plus grands centres aurifères dont on ait jamais entendu parler.
Nous nous trouvâmes, lorsqu’il fallut enfin nous décider nous-mêmes, dans une grande perplexité. Chacun était d’un avis différent et nous ne savions à quoi nous arrêter.
Sur un espace de deux ou trois milles, tout le pays était occupé, et William’s Creek ressemblait nuit et jour à une vaste fourmilière. Les fourmis humaines travaillaient, car dans les terrains humides le travail ne peut pas être suspendu, pas même le dimanche. Aussi était-ce un curieux spectacle que de voir la nuit, dans la vallée, chaque puits avec son petit feu, sa lanterne et ses ombres allant de l’obscurité à la lumière, pour rentrer de la lumière dans l’obscurité, comme les démons dans une féerie, pendant que, de temps à autre, une hutte s’éclairait, lorsque quelque travailleur fatigué allait enfin se reposer de son labeur nocturne.
Il semblait qu’il n’y eût qu’un mot d’ordre, travailler, toujours travailler. Des loafers (flâneurs) et des joueurs se voyaient bien parfois dans les bar-rooms et autour des tables de jeu; mais ne rien faire était un luxe trop coûteux dans un endroit où les salaires s’élevaient à deux ou trois livres sterling (50 ou 75 francs) par jour, et où la farine coûtait six shillings (7 fr. 50) la livre.
Les bruits de toute sorte que l’on entendait étaient aussi curieux que les objets qui frappaient la vue. De tous côtés, sur les collines, c’était le craquement des branches, les coups sourds des haches, le fracas des arbres dans leur chute et le grincement des scies qui changeaient les troncs en madriers et en planches; au fond de la vallée, c’était le clapotement de l’eau, le ronflement des roues hydrauliques, le frottement des pelles sur les cailloux, le tintement des marteaux des forgerons, et les cris de ceux qui du dehors faisaient passer les seaux vides à ceux qui travaillaient au fond des puits.
Il n’était pas probable que qui que ce fût, dans une Babel pareille, se dérangeât pour nous donner des renseignements. Cependant je trouvai enfin un individu qui voulut bien répondre à mes nombreuses questions, tout en m’indiquant les puits qui représentaient les placers ou claims les plus riches.
Mon nouvel ami me dit que son nom était Jake Walker; qu’il était un de ceux qui avaient découvert le Caribou; que précédemment il avait travaillé à la recherche de l’or sur les bancs de sable du Fraser; et qu’il était venu en 1858 de la Californie, où, en 1849, ayant abordé comme matelot, il avait quitté son vaisseau pour courir aux mines.
Le pauvre homme faisait triste figure et ne nous cacha pas qu’il était réduit aux plus dures extrémités. Je l’emmenai donc à notre tente et il dîna avec nous. Pendant notre frugal repas, je lui dis qu’il me semblait fort étonnant qu’un homme expérimenté comme lui, et que tout le monde serait heureux d’employer, n’allât pas travailler sur l’un des claims où de simples manœuvres étaient payés seize dollars par jour. Sa réponse fut caractéristique:
«Voilà treize ans, me dit-il, que je suis mon maître, et je compte bien ne jamais travailler sous les ordres de personne. Il n’y a pas un marchand dans la vallée qui ne soit prêt à faire crédit au vieux Jake pour son ordinaire et son whiskey, et je finirai toujours bien par payer. Du reste, je vous parie l’océan Pacifique contre un verre d’eau douce que j’aurai fait fortune avant la fin de la saison.»
Honteux de ma présomption, je changeai de conversation et lui parlai du lit d’un torrent voisin appelé Jack of Clubs Creek, et lui demandai s’il avait examiné ce terrain.
«Oui, je l’ai examiné, dit-il, et je compte bien y réussir. Mais, il faut que je vous le dise, il sera difficile d’extraire l’or de cet endroit-là. Il faudra creuser profondément, dans un sol détrempé, et travailler comme des chevaux avant d’arriver à la couche d’argile. Par exemple, une fois là, si l’on n’est pas noyé avant d’y arriver, croyez-en ma parole, on y fera fortune.
»Tenez, continua-t-il, je veux faire une affaire avec vous. Je vois que vous avez des provisions pour deux ou trois mois, tandis que je n’ai ni provisions ni argent; mais j’ai payé mon claim, et il y a tout à l’entour autant de terrain que nous en voudrons acheter: si vous êtes des hommes, associons-nous et mettons-nous immédiatement à creuser un puits.»
Nous débattîmes l’affaire avec Jake et convînmes d’aller examiner les lieux le lendemain.
Jake passa donc la nuit dans notre tente, et au point du jour nous partîmes et atteignîmes la montagne Chauve comme le soleil venait de se lever.
De cette montagne descendent, dans différentes directions, de nombreux torrents qui ont creusé chacun leur vallée. Jack of Clubs Creek avait sa source à 100 mètres environ de celle de William’s Creek, et, d’après la théorie qui explique les gisements de l’or par l’action des torrents sur le flanc des montagnes, si William’s Creek était riche, Jack of Clubs devait l’être aussi. Partout, sur cette montagne, le quartz, matrice de l’or, abondait et faisait pressentir les richesses merveilleuses de l’intérieur.
Nous suivîmes le cours du torrent sur une longueur de deux ou trois milles, et la vue de l’endroit où notre guide avait marqué son claim nous remplit d’espérance; car, s’il existait de l’or dans le lit de la vallée, il semblait impossible qu’il nous échappât. Nous décidâmes donc à l’unanimité de nous associer pour la saison.
La semaine suivante fut employée à transporter nos provisions, nos outils, et à construire une hutte assez grande pour cinq. Nous marquâmes aussi nos claims, payâmes les droits et nous mîmes au travail. Deux d’entre nous s’occupèrent d’abattre le bois dont nous avions besoin, un autre de creuser une tranchée le long de la colline pour nous procurer une chute d’eau, et les deux autres de creuser le puits.
Nous étions parvenus, à force de travail, à creuser un trou de quarante pieds de profondeur lorsqu’une crue soudaine du torrent inonda notre puits, le remplit presque jusqu’au bord de débris de toute espèce et, en une nuit, détruisit tout notre ouvrage. En vain essayâmes-nous d’une pompe de notre invention pour vider notre puits; nous n’y pûmes réussir, et il nous fallut en creuser un autre à une petite distance du premier. Une nouvelle inondation détruisit encore notre ouvrage, et, malgré les nombreuses histoires du vieux Jake sur l’inévitable succès des gens qui savent persévérer, nous commençâmes à désespérer de jamais atteindre le fond.
Après un travail persévérant qui nous prit tout l’été et une partie de l’automne, nous parvînmes à creuser un nouveau puits profond de cinquante pieds. La nature des couches traversées nous faisait espérer que nous approchions de la roche dans le voisinage de laquelle nous nous figurions qu’était cachée notre fortune; mais nos provisions tiraient à leur fin, nos finances aussi, et nos vêtements n’étaient plus que des haillons. Les boutiquiers, inexorables, refusaient de nous faire crédit sur nos espérances: il ne nous restait donc qu’à abandonner notre claim jusqu’à la saison prochaine et à remettre à cette époque éloignée la réalisation de nos rêves d’or.
Laissant donc ce qui nous restait de provisions au vieux Jake, qui ne voulait pas quitter le claim et entendait passer l’hiver à trapper les martres, Pat et moi retournâmes de nouveau nos pas vers la civilisation, le cœur plus gros que la bourse, mais peu fâchés, après tout, de quitter notre désert pour six mois de séjour dans des lieux plus agréables.
Nous partîmes à pied, portant chacun une paire de couvertures sur nos épaules, et quelques jours de vivres. C’est en vain que nous demandions du travail à toutes les maisons que nous rencontrions le long de la route; toute chance d’en obtenir avait été depuis longtemps saisie par quelques-uns des mineurs ruinés qui nous avaient précédés sur ce triste chemin.
Au bout de quelques jours, nous fûmes réduits, pour toute nourriture, aux navets que nous pouvions ramasser dans les champs avoisinant les maisons, échelonnées sur la route à des distances de dix ou quinze milles. Nous n’étions ni gras ni fiers quand nous arrivâmes à Fort Yale. Là encore nous essayâmes d’obtenir du travail, mais sans le moindre succès. A bout de forces et d’énergie, nous fîmes encore quatre milles pour gagner Emery’s Bar, où se trouve la station des bateaux à vapeur, nous proposant de solliciter de l’un des capitaines un passage gratuit pour Victoria.
Arrivés à Emery’s Bar, nous allumâmes un feu sur le bord d’un petit plateau et étendîmes nos couvertures, dans l’espérance de faire servir le sommeil à remplacer le souper. Un bateau était attendu le lendemain matin, et comme, à cette époque de l’année, il ne pouvait remonter jusqu’à Yale, nous entretenions le vague espoir de gagner un bon déjeuner à travailler au déchargement du bateau.
Nous fumions notre pipe, ayant encore, par bonheur, un peu de tabac, lorsque soudain j’entendis un rire joyeux partir de la rive, au-dessous de nous, pendant que mes narines, avec une finesse de perception très-explicable en pareille circonstance, humaient, portée sur la brise du soir, une délicieuse odeur de lard grillé. Incapables de résister à une pareille attraction, Pat et moi bondîmes vers le fleuve et nous nous trouvâmes bientôt en présence du plus attachant spectacle que nous pussions rêver alors,—un feu pétillant et quatre personnes assises en rond, prenant leur part d’un bon souper de lard et de pain frais servi par terre sur une toile. Trois grandes barques étaient amarrées au rivage, tout près de là, et on avait établi près du feu une tente formée de voiles tendues sur des rames.
Un des quatre s’écria aussitôt:
«Eh bien, mes enfants, nous ne savions pas avoir de si proches voisins ce soir. Asseyez-vous près du feu. Vous êtes sortis du bois aussi soudainement qu’un ours d’une tanière enfumée. Vous avez failli m’effrayer, sur mon âme! Voulez-vous souper avec nous?»
Inutile de dire que nous ne refusâmes point cette bonne invitation, que suivit celle d’apporter nos couvertures dans la tente, où il y avait assez de place pour nous. Nous fîmes si bien honneur au festin, que nos hôtes en furent surpris; mais ce fut à l’envi l’un de l’autre qu’ils mirent leurs vivres à notre disposition. En dépit de la rudesse de leur extérieur et de la simplicité de leurs manières, il y a plus de vraie bonté de cœur chez ces rudes pionniers d’une terre nouvelle que chez toute la foule de nos élégants parasites des villes.
Nous paraissions si épuisés, si misérables, qu’on nous demanda d’où nous venions et ce que nous comptions faire. Alors je racontai en quelques mots notre histoire; ajoutant que tout ce que nous désirions était de trouver du travail, et que nous serions heureux de donner un coup de main à nos hôtes le jour suivant, en échange du bon souper qu’ils nous avaient offert.
«Je ne suis point un aubergiste, dit celui qui paraissait être le chef de la troupe, et vous êtes les bienvenus à notre modeste repas; mais si vous ne craignez pas de risquer votre vie sur cette maudite rivière, je puis vous donner du travail et un bon salaire.»
On comprend avec quel empressement Pat et moi nous acceptâmes cette offre bienveillante, et bientôt, enveloppés dans nos couvertures, nous dormions d’un meilleur sommeil que nous ne l’avions fait depuis longtemps.
A l’aube, nous fûmes réveillés par le sifflet du bateau à vapeur qui arrivait, et bientôt nous nous mîmes à l’œuvre, travaillant comme des nègres, au milieu d’une foule d’Indiens et de matelots occupés à décharger le navire et à empiler les colis que nous devions transporter sur nos embarcations. En deux ou trois heures nous eûmes fini, et nous nous mîmes à préparer nos canots, qui étaient de quatre tonnes chacun. Ils avaient près de cinquante pieds de longueur sur six de large, et chacun d’eux avait été taillé et creusé, à l’aide du feu, dans un seul tronc de cèdre. Ils étaient montés par huit rameurs, et, au lieu de gouvernail, portaient à l’arrière une rame de vingt pieds de longueur: un gouvernail ordinaire n’aurait pas eu assez de force pour les diriger sur un fleuve pareil. A la proue, où était un fort étançon pour fixer le câble de remorque, un homme devait stationner pour observer le courant et éviter les écueils cachés. Ce fut ce dernier poste que l’on nous confia à Pat et à moi.
Nous nous acquittâmes à notre honneur de notre tâche et eûmes six voyages à faire d’Emery’s Bar à Fort Yale pour transporter toute la cargaison.
Cela fait, nous nous jugeâmes capables, Pat et moi, d’entreprendre une expédition infiniment plus hasardeuse à travers les cañons. Ce n’était pas une petite affaire et il y avait de grands dangers à courir; mais notre misérable état ne permettait pas à la crainte de nous dominer, et nous nous jetâmes dans cette nouvelle entreprise avec les sentiments du soldat qui sait que sa vie est l’enjeu de la bataille.
Au bout d’une semaine environ, nous eûmes un chargement complet pour Lytton, et, après avoir examiné avec soin notre flottille et réparé nos avaries, nous partîmes à la pointe du jour. Notre voyage, à partir de Fort Yale, où nous arrivâmes vers les neuf heures du matin, fut des plus dangereux et des plus pénibles. Ce n’étaient pas seulement les marchandises qu’il fallait mettre à terre et transporter à force de bras par-dessus les rochers, aux endroits appelés portages, jusqu’à un endroit où l’on pût se rembarquer, mais il fallait tirer de l’eau les bateaux mêmes et les pousser à grand renfort de rouleaux et de leviers jusqu’au lieu de rembarquement.
Ainsi, nous passions nos journées de l’aube à la nuit, tantôt naviguant sur le fleuve le plus dangereux du monde, tantôt transportant bateaux et chargement le long de la rive accidentée. Nous étions le plus souvent trop fatigués, le soir venu, pour changer nos vêtements humides contre des vêtements secs ou pour faire cuire notre souper. Nous nous contentions de nous rouler dans nos couvertures auprès du feu que nous allumions sur le bord du fleuve et de nous abandonner à un sommeil fiévreux.
Le jour venu, nous nous remettions à cette rude besogne, pour ne nous voir quelquefois, après une longue journée de travail, qu’à une couple de milles de l’endroit que nous avions quitté le matin.
Pour donner à mes lecteurs une idée de l’inconcevable force du courant avec lequel nous avions à combattre, je leur dirai qu’à dix milles (16 kilom.) en amont d’Yale, le Fraser, qui a douze cents milles de longueur et reçoit dans son cours de nombreux affluents aussi considérables que lui-même, passe à travers des roches énormes par un chenal qui n’a que cinquante-deux mètres de largeur. Les bords de ce chenal, bien nommé Hell’s Gate (porte de l’Enfer), sont presque perpendiculaires, et le niveau des hautes eaux en été, après la fonte des neiges, n’est pas à moins de cent pieds au-dessus du niveau des basses eaux en hiver.
Vers la fin du douzième jour nous aperçûmes les eaux bleues de la Thompson qui, sur une petite distance, courent presque parallèlement aux eaux jaunes du Fraser, et quelques vigoureux efforts nous amenèrent au but de notre voyage. Nous bénîmes le ciel d’avoir échappé aux dangers de cette navigation, et fûmes bien heureux de pouvoir nous reposer un peu.
Notre repos toutefois ne devait pas être de longue durée. Le voyage avait été si avantageux aux entrepreneurs qu’ils étaient pressés de recommencer. La descente du fleuve était la partie la plus dangereuse de notre tâche, car, au lieu de nous traîner péniblement en longeant la rive, il fallait se laisser emporter au gré de ce terrible courant et passer, avec une rapidité vertigineuse, au milieu même des écueils que nous avions évités à la remonte, en débarquant. A deux endroits cependant, aux grandes et aux petites chutes, nous dûmes faire encore des portages.
Aussi il ne nous fallut que quatre heures pour accomplir presque la moitié du voyage et atteindre Boston Bar. Là, nous nous arrêtâmes pour prendre un peu de repos, car nous avions eu une rude besogne à gouverner nos canots à travers les rapides.
Une barque montée par sept hommes, dont six rameurs et un homme au gouvernail, n’ayant pu, faute d’avoir pris les précautions nécessaires, éviter un tourbillon, fut engloutie corps et biens sous nos yeux, sans qu’il nous fût possible de lui porter secours. En vain avions-nous donné aux hommes qui la montaient avis du danger, recommandé de ne pas abandonner un instant la direction de leur bateau, crié de faire force de rames, tout fut inutile. L’homme à la barre perdit la tête; l’agitation des rameurs croissant avec le danger, la barque, qui ne gouvernait plus, arriva sur les brisants qui la remplirent d’eau, et bientôt elle s’enfonça avec une lenteur qui, pour nous, fit durer un siècle cet affreux spectacle. Un des rameurs, jeune et beau garçon, essaya de franchir d’un bond le cercle maudit, mais il y fut ramené par le contre-courant. Les autres, convaincus que tout était fini, se tenaient debout dans la barque, qui sombrait lentement, levant au ciel leurs bras impuissants. L’eau semblait monter pour étouffer leurs cris et noyer leurs regards désespérés. Tout disparut; mais cet effrayant spectacle, ces figures pâles, éperdues, s’enfonçant lentement dans leur tombe liquide, ne sortiront jamais de ma mémoire.
Peu d’instants après nous passions nous-mêmes, avec la rapidité de l’éclair, près du lieu où venait de se produire cette horrible catastrophe. Arrivés à un endroit où la furie du fleuve se calme un peu, nous nous arrêtâmes, dans l’espérance que nous pourrions encore être de quelque secours à quelqu’un des naufragés; mais nous attendîmes en vain, rien ne se montra, pas même un débris quelconque du bateau, dont aucune épave ne fut retrouvée.
De retour à Yale, nous dûmes attendre plusieurs jours qu’un nouveau chargement pour Lytton fût complété, et, les eaux ayant baissé, nous fîmes ce voyage en un peu moins de temps que le premier. Nous eûmes aussi, par la même raison, un peu moins de dangers à courir; mais Pat et moi commencions à être exténués, et à notre second retour à Yale nous fûmes assez satisfaits de ne pas trouver un nouveau chargement. On paya et congédia les Indiens; il fut convenu que quatre d’entre nous et le capitaine descendraient dans un des canots jusqu’à Victoria, et que nous ferions, en passant, une partie de chasse et de pêche dans les îles du golfe de Géorgie.
La veille même de notre départ, je fus en grand danger de périr dans les flots du Fraser. Nous étions campés sur la rive à un endroit où un banc de sable produit avec le courant un vaste remous. Nous avions besoin de sucre pour notre voyage, et il fallait traverser le fleuve pour en aller chercher à une petite boutique tenue par un Chinois.

Je me mis à nager de toutes mes forces.
![]()
Je partis seul dans un petit bateau très-léger. L’endroit difficile à passer était celui où se rencontraient les deux courants contraires: le moindre faux mouvement pouvait faire chavirer ma frêle embarcation. Heureusement pour moi, il faisait chaud et je n’avais que ma chemise, mon pantalon et des pantoufles. J’avais aperçu des Indiens et leurs femmes qui se baignaient à un coude formé par le banc de sable, et, comme j’arrivais au passage dangereux, j’entendis une des baigneuses pousser un cri. Ce n’était rien; la femme s’était un peu coupé le pied sur un rocher. Je m’étais follement retourné au moment même où je n’aurais pas dû perdre un seul instant de vue mon bateau. Tout à coup je sentis qu’il me manquait sous les pieds et je tombai à plat dans l’eau: l’embarcation s’en allait, emportée comme un morceau de bois.
Je me mis à nager de toutes mes forces; mais, quoique bon nageur, j’étais stupéfait du peu de chemin que je faisais. Personne ne pouvait me porter secours, et je savais ne pouvoir compter que sur mes propres efforts. Voyant que je n’avançais pas et comprenant que, si je luttais ainsi, je verrais bientôt mes forces s’épuiser, je fis la planche et fus emporté par le courant, auquel je n’avais nullement la force de résister.
Je commençais à désespérer de mon sort et à penser tristement à ma famille et à mes amis, lorsque l’idée me vint que mon seul moyen de salut était de suivre le courant; si j’étais entraîné au delà du tourbillon, je pouvais peu à peu me rapprocher du bord en descendant. Ce fut ce qui arriva; une fois le plus grand danger passé, je jetai les yeux sur la rive et vit le pauvre Pat qui courait de toutes ses forces en criant et faisant des gestes désespérés. Un peu plus bas je vis quelque chose qui pour le moment valait encore mieux, une branche d’arbre flottant tranquillement sur l’eau. Quelques brassées m’y amenèrent, et, me jetant sur la branche que je serrai d’un bras, je me servis de l’autre pour me diriger vers le rivage.
Je descendis ainsi le fleuve sur une longueur d’environ deux milles (3 kilom.) jusqu’à un endroit où les rives se rapprochaient un peu. L’eau était mortellement froide et les forces étaient sur le point de manquer à mes membres engourdis. Cependant à quelque distance j’aperçus un arbre déraciné donc le tronc, encore attaché à la rive, plongeait dans le fleuve. Je réussis à l’atteindre et m’y cramponnai avec la force du désespoir. Quelques minutes après, Pat arrivait, suivi du capitaine, qui portait une corde et une bouteille d’eau-de-vie. Ils me jetèrent la corde, que je saisis, et me tirèrent sur la rive, où je perdis connaissance.
Quand je revins à moi, je vis Pat et le capitaine occupés à me bassiner les tempes avec de l’eau-de-vie. Ils me présentèrent la bouteille et j’en pris une gorgée qui, en toute autre circonstance, m’aurait ôté toute espèce de force, mais qui, après le bain froid que je venais de prendre, me remit sur mes jambes et me permit de gagner le camp avec l’aide de mes amis.
Le lendemain, à la pointe du jour, nous partîmes et descendîmes le fleuve sans autre peine que de gouverner notre embarcation. Une fois Fort Hope passé, nous pûmes déployer nos voiles, et vers midi nous arrivâmes à l’embouchure de la rivière Harrison. Nous avions une commission à faire dans le voisinage, à un endroit où d’immenses prairies, submergées à l’époque des hautes eaux, étaient alors à sec. Des hommes, en dépit des moustiques, y étaient occupés à faucher les foins. Pat fut envoyé comme messager, préalablement muni d’un voile de mousseline qui lui enveloppait la tête et le cou, et averti qu’il ne devait pas sortir ses mains de ses poches.
Conformément à ses instructions, Pat traversa la prairie au milieu d’un nuage ailé de moustiques qui bourdonnaient autour de lui et, dans leur vaine rage, s’efforçaient de percer ses habits d’épais velours de coton. Ayant fait sa commission, il revenait au bateau par le chemin le plus court, lorsqu’il rencontra un troupeau de bœufs espagnols. Un taureau ombrageux, apercevant sa chemise rouge, courut sur lui, suivi par le reste du bétail. Pat n’eut que le temps de gagner, en courant comme un fou, le bois qui longeait la rivière, et, pour respirer, il jeta le voile qui le protégeait contre les moustiques. Au sortir du bois, il tomba dans un marais où les bœufs se gardèrent bien de le suivre; mais lui-même ne s’en tira pas aisément, et, s’il échappa aux bœufs, il n’échappa point aux moustiques: il en était noir quand il sortit du marais.
Voyant les insectes voler autour de lui par milliers, nous lui criâmes de se tenir à l’écart et nous nous éloignâmes du bord: nous savions que si ces insectes gagnaient le canot, ils nous suivraient et qu’ils ne nous donneraient aucun repos.
«Et comment irai-je au bateau? demanda Pat.
—A la nage, pardieu! répliqua le capitaine.
—Mais, capitaine, je ne sais pas nager.
—Vous aurez donc à rester où vous êtes; car je n’entends pas être dévoré par ces enragés buveurs de sang.
—Alors il est sûr que je me noierai. Que faire?»
Je tirai un long aviron du bateau et le dirigeai vers Pat en tenant ferme la poignée. L’Irlandais, faisant appel à tout son courage et aiguillonné par les piqûres des insectes, plongea dans la rivière et, en remontant à la surface, saisit l’aviron à l’aide duquel nous le tirâmes à bord.
Nous ne nous arrêtâmes à New Westminster que le temps de faire quelques emplettes et de nous équiper pour la chasse et la pêche.
Le soir du même jour nous atteignîmes l’embouchure du Fraser et nous arrêtâmes à Point Roberts, limite du territoire américain. Là, nous trouvâmes un matelot retiré, du nom de Joe, qui, en ajoutant aux revenus d’une petite exploitation agricole les produits de la chasse et de la pêche, menait une existence très-confortable. La place ne manquait point chez lui, ni le whiskey, et le gibier et le poisson ne coûtaient que la peine de les prendre. Nous pouvions donc, sans trop nous flatter, compter sur d’agréables loisirs après la saison de rudes labeurs que nous venions de passer.
Si parmi nos lecteurs il en est qui aient eu le bonheur de voir le golfe de Géorgie, ses charmants rivages et ses îles nombreuses, ils attesteront, je crois, avec moi, qu’il est difficile de rien concevoir de plus beau.
Fermé à ce point que, sur une longueur d’environ 200 milles, ce golfe ressemble à une mer intérieure de 50 à 60 milles de largeur, sa surface azurée est parsemée d’îles innombrables couvertes de forêts vierges au milieu desquelles paraissent çà et là de ravissantes clairières de prairies naturelles. Du côté du continent, l’horizon est fermé par des montagnes aux sommets neigeux, au-dessus desquelles, vers le sud, s’élève majestueusement le cône du mont Baker, volcan éteint d’environ 13 000 pieds de haut. Du côté de l’île de Vancouver s’élèvent aussi des montagnes, mais moins hautes et formant, par la variété de leurs teintes, un ravissant contraste avec celles de la rive opposée.
De ce côté aussi se montrent plus abondants les signes de la vie sauvage. Les eaux sont çà et là tachetées de blanc par les voiles des canots, et les rives sont bordées de villages indiens dont les habitants, vêtus de couvertures diversement coloriées, font sur le paysage la tache de couleur brillante si chère aux artistes.
Les Indiens n’enterrent point leurs morts; ils les mettent, revêtus de tout ce qu’ils ont de plus précieux, dans des boîtes d’environ un mètre de hauteur et de longueur, sur deux pieds de large, de façon que les genoux se trouvent ramenés à peu près à la hauteur de la tête, et que le cadavre est dans la position affectionnée par les Indiens lorsqu’ils s’assoient en cercle autour du feu. Le cercueil est ensuite hissé assez haut dans un arbre où on l’attache solidement. Tout autour on pend les armes et les instruments favoris du mort.
Je me rappelle avoir admiré une fois les reliques d’un chef de tribu. Elles se composaient d’un canot de grande dimension suspendu à un arbre, à une trentaine de pieds de hauteur, par des cordes faites d’écorce tressée. Aux flancs du canot étaient attachés divers articles parmi lesquels plusieurs pagayes, le squelette d’un chien favori, des couvertures qui avaient dû être rouges, mais qui, au vent et à la pluie, avaient fini par devenir noires, le canon rouillé d’un vieux fusil à pierre, un arc, un épieu, deux peaux d’ours, un pantalon en haillons, et, brochant sur le tout, un vieux chapeau de castor avec... une crinoline. Ce dernier objet avait sans doute été mis là par quelque tendre fille du défunt, dans l’espoir que, lorsque l’esprit de son père serait appelé au bienheureux pays de chasse qui constitue le paradis des Peaux-rouges, il pourrait emporter cet article de toilette pour l’offrir à la femme qu’il prendrait dans sa nouvelle sphère. Quant au castor (article peu commun dans cette partie du monde), il faut croire qu’il avait été mis là pour contre-balancer, toujours en vue du pèlerinage céleste, la pauvreté de la garde-robe du défunt.
L’endroit où Joe avait établi ses pénates était particulièrement agréable. La maison, abritée par un promontoire contre les vents froids du nord et de l’est, se trouvait tout au bord de la mer, au centre d’une belle prairie bordée de bois; un joli cours d’eau murmurant tombait des collines et courait à la mer, et comme la marée ne se faisait que faiblement sentir en cet endroit, la maison et la prairie étaient tout à fait à l’abri des inondations.
Au point du jour, Pat et moi allâmes à la chasse aux canards sauvages, et, étant tombés au milieu d’un vol de sarcelles, nous pûmes en rapporter une demi-douzaine à la maison. Quel déjeuner! quelle profusion! Huîtres, saumon, truites, venaison, canards sauvages, gelinottes, formaient notre menu; et pour faire couler tout cela, du bon café à discrétion. Nous avions aussi du lait et du beurre, car Joe avait une paire de vaches dans son enclos.
Après déjeuner, nous retournâmes à la chasse, et ayant aperçu dans une petite baie des canards en telle quantité que la mer en était noire sur un espace d’un demi-mille, nous revînmes en toute hâte à la maison chercher un petit canon à pivot et à large gueule que nous y avions vu. Nous voulions tout simplement voir combien il nous serait possible de tuer d’oiseaux d’un seul coup. A la faveur d’une pointe avancée couverte de bambous, nous montâmes le vieux canon sur l’avant du canot et fîmes feu dans le tas. L’énorme bande d’oiseaux s’envola comme un nuage noir, et, quand nous comptâmes les morts (le lecteur ne voudra pas le croire), il y en avait quatre-vingt-trois!
Il faut dire que dans ces parages le gibier est si peu familiarisé avec le danger qu’il ne se doute de rien et attend le chasseur. J’ai souvent tué dans les arbres des gelinottes à coups de pierre ou de bâton; on peut les manquer trois ou quatre fois sans qu’elles bougent, et lorsqu’elles s’envolent, c’est pour aller s’abattre à quelques mètres plus loin.
Le capitaine, qui était allé à la pêche avec quelques-uns des nôtres, revint avec une quantité de morue et de halibut (flétan, sorte de grosse plie qui ressemble au turbot); et Joe, qui rentra plus tard, parut avec un chevreuil sur les épaules, apportant la bonne nouvelle qu’il avait aperçu dans la forêt les traces d’un troupeau d’élans.
Le lendemain, Joe, le capitaine et moi étant partis longtemps avant le jour avec les trois seuls fusils que la compagnie possédât, nous aperçûmes, à l’aube, des traces fraîches se dirigeant vers un petit lac situé à une dizaine de milles dans l’intérieur. N’ayant pas de chiens, nous dûmes user de beaucoup de précautions pour pouvoir retrouver le gibier. Au bout de trois heures de marche pénible à travers les bois et le long des marécages, nous vîmes soudain une quinzaine de ces belles bêtes broutant dans une jolie petite clairière, sur le bord du lac.
Le bois s’étendant en demi-cercle autour de la clairière, le capitaine s’en alla d’un côté, en suivant la lisière du bois, et moi de l’autre, Joe restant à l’endroit où nous nous étions d’abord arrêtés. Lorsque nous eûmes atteint tous les deux notre poste, nous fîmes signe à Joe, et nous nous avançâmes tous ensemble vers le troupeau, de manière à ne lui laisser d’autre retraite que le lac.
Bientôt les élans nous aperçurent et, levant leurs belles têtes, ils aspirèrent bruyamment l’air et se formèrent en phalange serrée; puis le chef partit, et tous les autres le suivirent, se dirigeant le long du lac vers l’endroit où je me trouvais. Je les laissai arriver à une bonne portée et fis feu; le chef tomba. Les autres s’arrêtèrent d’un air étonné, puis, sentant soudain l’odeur du sang de leur compagnon, ils comprirent qu’un danger inconnu les menaçait, et, faisant volte-face, s’enfuirent dans la direction d’où ils étaient venus. Joe et le capitaine accouraient; se voyant cernés, les élans sautèrent dans le lac, mais trop tard pour empêcher deux des leurs de tomber sous nos balles.
Ayant fait, à l’aide d’une hachette que nous portions, un radeau de branches liées avec des cordes d’osier, nous plaçâmes notre gibier sur cette embarcation d’un nouveau genre, et, nous servant de perches, nous atteignîmes l’endroit où la petite rivière sort du lac. Le courant était si violent que nous ne pûmes remonter que de 2 milles, et surpris par la nuit tombante, nous quittâmes notre embarcation et nous en allâmes à travers bois, marquant les arbres à coups de hache tout le long du chemin, pour retrouver le lendemain l’endroit où nous avions laissé notre radeau.
Le jour suivant, avec l’aide de nos compagnons, nous amenâmes notre chargement de gibier à la maison. Un des élans fut laissé à Joe. Les deux autres, chargés sur notre canot, furent transportés à New-Westminster, où nous les vendîmes 30 dollars (168 fr.) pièce, les bois étant des trophées de prix. Nous y vendîmes aussi des canards sauvages dont nous obtînmes eighteen pence (1 fr. 80 c.) la paire. On voit que la chasse, même comme spéculation, n’est pas une mauvaise affaire dans cette partie du monde.
Quinze jours durant, nous jouîmes de cette délicieuse existence, ne faisant rien que pêcher, chasser, nous promener en canot, jusqu’à ce qu’enfin nos esprits aventureux s’échauffant de nouveau, nous résolûmes tous (à l’exception de Joe) de faire un petit voyage de découverte aux sources de la Squawmish, rivière qui se jette dans le golfe de Géorgie, à Burrard’s Inlet (baie de Burrard), près de l’embouchure du Fraser. Nous voulions savoir s’il y avait quelque chance d’y trouver de l’or. Aucun homme blanc n’avait encore visité ces lieux, et les Indiens passaient pour ne pas être animés d’intentions très-bienveillantes; aussi d’assez vives émotions nous attendaient dans cette expédition.
Ayant fait provision de vivres pour une quinzaine de jours, acheté quelques outils de mineurs, renouvelé notre provision de munitions, et nous étant procuré les services d’un Indien Squawmish qui avait exercé quelque temps, à New Westminster, la profession de guide, nous nous embarquâmes dans un grand canot indien.
Nous eûmes fort mauvais temps au départ et notre embarcation fut mise à la plus rude épreuve, lorsque nous eûmes à passer l’entrée de Burrard’s Inlet; mais elle flottait sur les vagues comme un canard, et nous n’eûmes aucun mal. Nous entrâmes alors dans le magnifique lac ou estuaire d’eau salée, long d’environ 40 milles (64 kilomètres), dans lequel se déverse la rivière Squawmish, le but de notre expédition.
Tout le reste du jour, par une pluie battante, nous fîmes force de rames et remontâmes l’estuaire sur une longueur de 30 milles. Ayant aperçu un petit courant d’eau douce descendant des collines, nous abordâmes à cet endroit et y plantâmes notre tente pour la nuit. Nous n’étions pas en pays ami, et chacun de nous eut à monter la garde à son tour pendant deux heures.
La nuit se passa tranquillement; nous n’avions point vu d’Indiens, car ils étaient presque tous à la mer, occupés à faire leur provision de poisson pour l’hiver qui approchait. Nos craintes se calmèrent donc sensiblement. Le jour suivant, étant partis de bonne heure, nous atteignîmes avant midi l’embouchure de la rivière. Nous nous dirigeâmes vers ce qui nous parut être la plus considérable de plusieurs bouches, et remontâmes sans peine le courant à travers un delta de terres basses et marécageuses, sur une longueur de 4 ou 5 milles.
La rivière changeait de caractère et devenait rapide et très-accidentée; nous arrivions au cœur même de la chaîne des Cascades, où nous devions trouver les traces géologiques des gisements de l’or, si toutefois il en existait. Un grand village indien, momentanément abandonné, était situé non loin de là; nous prîmes, pour la nuit, possession d’une des huttes, et, ayant rencontré quelques Indiens que l’âge ou la maladie avait empêchés de suivre les autres, nous obtînmes, à l’aide de notre guide, qu’ils nous louassent une paire de petits canots avec lesquels il nous fût possible de remonter le courant; notre grand canot était beaucoup trop lourd pour les eaux basses et rapides qu’il nous fallait affronter.
Le lendemain, nous fîmes plusieurs haltes pour explorer le lit de la rivière. Nous y trouvâmes de l’or, en si petite quantité que le produit n’aurait pas couvert la dépense. Le quartz ne manquait pas; mais il était trop dur pour qu’on pût espérer que les trésors qu’il contenait eussent été emportés par les eaux. Nous pûmes constater l’existence de nombreux dépôts de charbon de terre; et si jamais les incontestables richesses minérales de ce pays sont exploitées, l’industrie y trouvera réunies par la nature toutes les conditions nécessaires à son développement.
Pendant deux ou trois jours nous poursuivîmes ainsi notre route, jusqu’à ce qu’enfin toute navigation devînt absolument impossible. Alors nous dressâmes notre tente, la laissant à la garde de deux d’entre nous, pendant que le capitaine, Pat et moi, chargés de nos couvertures et de quelques provisions, partions, avec notre guide, pour finir notre exploration à pied.
La seconde journée de marche nous conduisit à la source de la rivière, située dans une passe élevée, au milieu même de la chaîne de montagnes. On dominait de là la chaîne de moindre hauteur qui circonscrit le Fraser à Lillooet, à environ 230 milles de son embouchure. De tous côtés ces montagnes nous offraient des traces évidentes de leur énorme richesse minérale, parmi lesquelles nous pouvions surtout distinguer des minerais de cuivre, de plomb et de fer. Nous y trouvâmes un village indien, gardé par quelques vieillards des deux sexes; mais ils n’appartenaient pas à la même tribu que notre guide, et, bien que voisins, ils pouvaient à peine se comprendre. Ces Indiens n’avaient jamais vu d’hommes blancs; ils en avaient seulement beaucoup entendu parler, et ils nous regardaient avec une surprise qui n’était pas exempte de terreur.
Nous leur donnâmes du tabac et un pain, ce qui leur inspira un peu de confiance; notre guide leur montrait tantôt les montagnes et quelques échantillons de nos minerais, et tantôt se frappait la tête et riait, pour leur expliquer que nous étions de pauvres fous peu dangereux.
Sur ce, un vieil Indien, le patriarche de la tribu, alla chercher dans sa hutte une petite boîte pleine de morceaux de quartz fraîchement brisés et couverts de pyrites de fer d’un jaune brillant. Le vieil Indien prenait évidemment cela pour de l’or, idole de l’homme blanc; et j’en ai connu bien d’autres que des Indiens qui s’y laissaient prendre. Ce fut avec beaucoup d’intérêt que j’observai ces échantillons, car, à première vue, je reconnus qu’un grand nombre de ces morceaux de quartz contenaient des fragments de minerai d’argent exactement semblables à ceux qui provienait des territoires de Washoe et d’Idaho.
Je fis mon possible pour obtenir quelques-uns de ces échantillons que j’aurais voulu faire essayer, mais mes offres n’étaient pas à la hauteur de la cupidité du propriétaire; plus je lui en offrais un prix élevé, plus il se faisait une haute idée de la valeur d’un objet que l’homme blanc était désireux d’avoir. J’essayai, par signes, de lui faire indiquer l’endroit de la montagne d’où provenaient ces échantillons; mais je ne pus obtenir de lui qu’un mouvement de bras qui s’étendait à tout l’horizon, après quoi il se retrancha dans ce silence absolu d’où il est impossible de faire sortir un Indien; si bien que, nos provisions s’épuisant, il nous fallut nous en retourner sans avoir acquis autre chose que les vagues indices des richesses infinies qui attendent, dans quelques siècles d’ici peut-être, de hardis aventuriers.
Nous rejoignîmes le lendemain soir, après une longue journée de marche, les deux camarades que nous avions commis à la garde de nos canots, et nous fûmes heureux de pouvoir jouir d’un jour de repos.
Nous résolûmes de retourner aussitôt à New-Westminster, et emmenâmes un des petits canots que nous achetâmes. Près de l’embouchure de la rivière, sur la déclivité d’une colline escarpée, nous tuâmes un mouton sauvage. C’est un animal très-rare, et qui ressemble plus à une chèvre qu’à un mouton; il a le poil long et des cornes comme celles d’un bélier de race anglaise.
Deux jours plus tard nous arrivions à l’endroit où nous avions campé pour la première fois sur les bords de l’estuaire de la rivière Squamwish. Nous avions attendu la nuit pour nous arrêter, dans l’espérance que nous ne serions pas observés par les Indiens qui occupaient un vaste camp dont nous voyions les feux à environ cinq milles de là. Assez tard dans la soirée, après avoir fait cuire notre souper à un petit feu que nous avions allumé derrière de gros rochers, pour le dérober aux regards perçants de nos voisins, nous avions remarqué l’absence de notre guide indien. En le cherchant de tous côtés, nous nous aperçûmes qu’il s’était enfui avec notre petit bateau et une bonne partie de nos provisions. Heureusement pour nous, nos armes à feu et nos avirons étaient dans notre tente sous la garde constante de l’un de nous: sans quoi le gredin nous aurait sans doute dépouillés tout à la fois de nos moyens de défense et de nos moyens de fuite.
Nous comprenions parfaitement que son projet était d’avertir les Indiens et de revenir avec eux nous dépouiller et, si possible, nous tuer, pour éviter toute conséquence fâcheuse. Quelle poursuite d’ailleurs eût été possible dans les défilés inaccessibles des montagnes que nous venions de quitter!
En explorant de tous nos yeux le cours du fleuve, nous aperçûmes le traître à moitié chemin de l’autre rive, mais il était déjà trop tard pour lui donner la chasse. En toute hâte donc nous levâmes le camp, et jouâmes si bien de nos avirons qu’au bout de quelques heures nous n’étions plus qu’à environ dix milles de l’entrée de la baie. Arrivés là, nous étions tellement rendus de fatigue, que nous tirâmes le canot à terre et nous nous endormîmes, après avoir convenu que chacun monterait la garde pendant une heure à tour de rôle.
Au point du jour je m’éveillai et, jetant les yeux sur la rivière, j’aperçus, à environ un mille de nous, une dizaine de canots faisant force de rames pour nous atteindre. Celui de nous qui était de garde s’était laissé aller au sommeil et nous plaçait ainsi dans une position critique. J’éveillai en hâte tout le monde, et, profitant d’une brise matinale, nous mîmes aussitôt à la voile en nous aidant de nos rames. Mais notre canot était grand et lourd, et nous n’étions pas assez nombreux pour le manœuvrer comme il aurait fallu pour échapper à nos ennemis. D’un côté, nous pouvions voir, à quelques milles de nous, l’entrée de la baie, et au delà une mer agitée et dangereuse même pour un canot comme le nôtre; de l’autre côté, les nombreuses barques des Indiens lancées à notre poursuite.
C’était entre eux et nous une course dont l’objectif était l’entrée de la baie. Nous savions qu’ils ne pourraient nous suivre jusque-là, leurs canots étant trop petits pour braver cette mer orageuse, qui nous offrait notre seule chance de salut. Dans cette conviction, nous luttions vaillamment, oubliant nos fatigues et nos insomnies; mais il devenait de plus en plus évident que nous ne pourrions gagner la haute mer avant d’être rejoints. Nous commencions à désespérer et à maudire le malheureux qui s’était endormi étant de garde, lorsque le capitaine nous rappela à la raison en jurant qu’il brûlerait la cervelle au premier qui interromprait son travail pour se plaindre.
«Nous aurons encore raison de ces misérables, je vous le parie, nous dit-il. Ayez bon courage, et si nous réussissons à mettre du plomb dans la tête à deux ou trois de ces enragés qui nous poursuivent, peut-être bien cela donnera-t-il à réfléchir aux autres. Mais si vous vous mettez à vous quereller comme de vieilles femmes, nous pouvons dès à présent renoncer à défendre notre vie.»
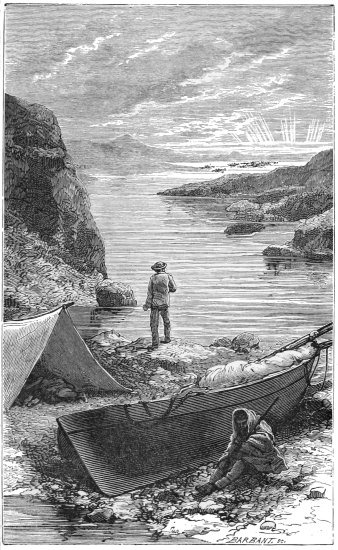
J’aperçus une dizaine de canots.
![]()
Nous étions en ce moment à environ 3 milles de la passe, et le canot le plus près de nous à moins de 400 mètres. Dans ce canot nous pouvions reconnaître notre misérable guide. Le capitaine me confia le gouvernail, et examina avec soin l’amorce de sa carabine, ordonnant en même temps qu’on chargeât les deux autres. Le vent devenait plus violent à mesure que nous approchions de la mer, et le mouvement du bateau n’eût pas permis, à la distance où étaient encore les Indiens, de bien ajuster.
«Tenez-vous prêt, me dit le capitaine, et quand je vous dirai: maintenant! tournez au vent, et je ferai une petite surprise à nos amis là-bas. Après quoi, nous reprendrons notre course, et vivement.»
Quelques instants après, tout étant prêt, le capitaine me dit à voix basse: maintenant, Dick! et, au risque de chavirer, je tirai brusquement la barre. Trois coups de feu se succédèrent rapidement, et je vis Squawmish Jack, notre ex-guide, tomber au fond du canot; l’Indien qui dirigeait la barque, blessé au bras, laissa échapper en même temps son aviron et l’écoute de la voile, et l’embarcation présentant le flanc aux vagues s’emplit d’eau et sombra.
Ce fut notre salut; car les autres canots interrompirent leur poursuite pour secourir leurs camarades qui, à l’exception de Squawmish Jack, tué roide sans doute, furent tirés de l’eau. Pendant ce temps, nous fîmes force de rames, et, ayant réussi à prendre le vent près d’un des promontoires qui bordent l’entrée de la baie, nous entrâmes dans le golfe.
Comme nous ne pouvions plus gagner l’embouchure du Fraser, nous prîmes quelques jours de repos dans le chenal de Plumper’s Pass et résolûmes ensuite de nous rendre tout droit à Victoria pour y passer l’hiver sans retourner à New Westminster. Nous y arrivâmes sans autre mésaventure, et ne fûmes pas fâchés, après notre téméraire expédition, de nous retrouver pour quelque temps au milieu d’une société civilisée.
De grands et heureux changements s’étaient accomplis à Victoria depuis que nous l’avions quittée. La jolie petite ville contenait maintenant plus de dix mille habitants et grandissait à vue d’œil. D’immenses hôtels s’élevaient pour recevoir et héberger les chercheurs d’or. On construisait des entrepôts et même des églises. Je remarquai notamment, et non sans un vif chagrin, qu’une nombreuse troupe d’ouvriers carriers était occupée à faire disparaître, pour élever à leur place de vastes magasins, les rochers qui couvraient les terrains qu’avait voulu me faire acheter l’homme de loi dont j’avais fait la connaissance lors de mon premier passage à Victoria.
Mais je vis aussi d’autres indices qui me plurent beaucoup moins et qui m’inspirèrent même de sérieuses craintes. Des milliers d’hommes, sans ressource ni travail d’aucune espèce, s’attroupaient aux portes des bar-rooms, et quand ils rencontraient quelqu’un de leur connaissance moins pauvre qu’eux, s’attachaient à lui dans l’espérance d’en obtenir l’argent nécessaire au repas du jour. En longeant la rue du Gouvernement, je ne fus pas mis à contribution moins de quatre fois, et chaque fois d’un demi-dollar. Cela m’alarma fort, car ma bourse était légère et je ne voyais aucun moyen de gagner ma vie.
Pat, après être resté avec moi quelques jours, me quitta pour aller exercer, pendant l’hiver, sur l’une des scieries établies de l’autre côté du Puget sound (détroit du Puget), son ancien état de cuisinier; et, pour ménager mes ressources, je louai, dans une impasse un peu écartée, une petite cabane et y mis des provisions pour un mois, me promettant de ne pas faire le difficile et d’accepter tout travail qui me permettrait de retourner au commencement de l’été à notre placer.
Au bout de deux mois, mes provisions étaient épuisées; il ne me restait, outre les habits que j’avais sur le corps et qui étaient déjà en piteux état, qu’une paire de vieilles couvertures sans valeur.
Plus de cinq mille hommes n’avaient pour passer l’hiver d’autre ressource que la charité publique. Cependant, bien qu’à cette époque je fusse réduit la plupart du temps à m’envelopper le soir dans mes couvertures sans savoir d’où me viendrait le déjeuner du lendemain, je parvins à vivre sans emprunter à mes voisins et sans rien demander à l’hospitalité coloniale; mais j’eus des moments bien durs. J’avais passé trois jours sans manger et me traînais par les rues, me demandant si je n’entrerais pas mendier un dîner dans le premier restaurant venu, lorsque je me sentis frapper amicalement sur l’épaule. Je me retournai, et mon cœur bondit de joie dans ma poitrine, lorsque je reconnus mon vieil ami le capitaine, avec lequel j’avais navigué sur le Fraser.
«Eh bien, jeune homme, me dit-il, que faites-vous là à regarder cette fenêtre de restaurant comme si vous vouliez l’avaler? Venez prendre un grog avec moi.»
Nous en bûmes deux et j’en aurais bu davantage, car, à défaut de nourriture solide, j’étais décidé à me contenter de liquide, lorsqu’il me dit:
«Si maintenant nous allions souper à ce restaurant devant lequel vous étiez arrêté il n’y a qu’un instant? qu’en dites-vous? La traversée m’a aiguisé l’appétit.»
J’acceptai avec empressement, et, le capitaine m’ayant chargé de faire la carte du dîner, je ne me fis aucun scrupule de satisfaire mes propres désirs et de laisser languir la conversation pour donner toute mon attention au repas. Cependant mon compagnon ayant terminé me regardait; et comme je continuais à manger avec un appétit féroce, il finit par me dire:
«Parbleu! mon ami, vous me faites l’effet d’être singulièrement affamé; et maintenant je m’aperçois que les habits que vous portez sont tout à fait usés. Les temps ont-ils été si durs que cela, mon pauvre garçon?»
Je lui dis que ce repas, en dépit de tous mes efforts pour gagner de quoi vivre, était le premier que j’eusse fait depuis trois jours. Il sauta sur sa chaise.
«Et les gens d’ici se disent civilisés! Morbleu! tiens, mon fils, ajouta-t-il en plongeant sa large main dans sa poche, tiens, tu me rendras cela quand les temps seront meilleurs!»
En parlant ainsi et devenant pourpre jusqu’aux oreilles, il plaça devant moi une grosse pièce d’or de vingt dollars. Je ne pus retenir une larme lorsque je serrai la généreuse main de celui qui, pour la seconde fois, me sauvait des cruelles atteintes de l’extrême misère.

Vous me faites l’effet d’être singulièrement affamé.
![]()
Le lendemain matin, le capitaine repartit pour le Fraser. En me quittant, il me fit toutes sortes d’amitiés et m’exprima le désir de me voir bientôt le rejoindre pour faire avec lui quelques expéditions à travers les cañons. L’argent qu’il m’avait prêté me permit de vivre jusqu’au jour où je trouvai une place de camionneur dans une brasserie. J’étais assez satisfait de mon emploi; mais un soir, revenant tard par de mauvais chemins, je fus violemment lancé de mon siége sur la route et me cassai le bras. Une fois guéri, j’eus la bonne fortune de trouver une place d’aide-chimiste dans un bureau de vérification de l’or. Ayant fait autrefois, à la grande terreur des servantes, quelques expériences de chimie dans la cuisine paternelle et ayant, à l’école, failli suffoquer un appariteur au moyen d’un flacon d’acide chlorhydrique adroitement renversé dans son pupitre, au moment où il y mettait le nez, je me jugeai suffisamment apte à remplir cette fonction.
Après les jours de détresse que je venais de traverser, je trouvai fort agréable de remplir une place dont le seul inconvénient était le sentiment d’envie que je ne pouvais m’empêcher d’éprouver parfois à la vue des tas de poussière d’or que d’heureux mineurs nous apportaient pour les faire changer en barres brillantes, poinçonnées de façon à constater à tous les yeux leur titre et leur valeur.
Pendant que j’étais ainsi occupé, le printemps arriva, et, un jour, en allant à mon bureau, j’aperçus une affiche annonçant que des régates devaient prochainement avoir lieu. Je résolus de tirer parti de cette circonstance; je m’associai donc avec un jeune et vigoureux gaillard qui m’avait accompagné dans quelques parties de bateau, et nous nous fîmes inscrire pour toutes les courses à deux rames ou à un seul aviron. Au bout d’une semaine d’entraînement, nous nous jugeâmes de force à nous mesurer avec n’importe quels adversaires.
Le jour attendu arriva enfin; c’était avec des sentiments mélangés d’espoir et d’appréhension que nous mesurions du regard l’étendue que nous avions à parcourir, car de notre succès dépendait la chance que nous avions de retourner à notre placer, qui sans cela serait confisqué.
La distance à parcourir, à partir d’un pont qui traverse une partie du port jusqu’à une petite île qu’il fallait tourner avant de revenir, était d’environ deux milles, et comme nous devions disputer trois prix, nous avions de l’ouvrage devant nous.
Notre première course fut une course à deux rames, et nous n’eûmes affaire qu’à un seul bateau monté par deux robustes bateliers du port d’Esquimalt. Nous comprîmes, dès le premier demi-mille, que nous n’avions pas grand’chose à craindre de nos rivaux, qui n’étaient habitués qu’à de petites courses de moins d’un mille, du port aux navires en rade.
Les spectateurs en jugeaient tout autrement et regardaient comme frisant l’effronterie que nous eussions l’audace de nous mesurer, nous jeunes gens inexpérimentés, avec deux bateliers ayant dix fois notre expérience. Les spectateurs américains tout particulièrement nous poursuivaient de leurs sarcasmes; ils tinrent contre nous tous les paris que nous voulûmes accepter, sur le pied de trois à cinq contre un. Aussi notre carnet était-il rempli quand sonna l’heure du départ.
La course, ainsi que nous nous y attendions, fut très-mal disputée. Nos adversaires partirent avec force embarras, en gens sûrs d’une victoire facile. Ils nous distancèrent pendant le premier demi-mille; mais quand nous atteignîmes le point extrême de notre course, ils étaient déjà essoufflés, et nous les dépassâmes facilement. Lorsque nous arrivâmes, ils étaient, au grand étonnement des parieurs, considérablement distancés.
La course suivante était une course à un seul aviron, dans laquelle nous étions quatre engagés. Je jouai le jeu de mon ami, qui arriva facilement premier.
La dernière course de la journée fut une course à deux avirons, dans laquelle nous courûmes seuls, personne ne se souciant de nous disputer le prix. Cette journée nous procura de quoi retourner aux mines et recommencer à nouveaux frais notre entreprise. J’écrivis à Pat de revenir, et nos autres associés étant aussi prêts, nous repartîmes tous pour notre placer de Jack of Clubs Creek.
Le gouvernement colonial poussait activement la construction d’une route qui devait relier Fort Yale aux mines. Comme nous ne pouvions commencer nos opérations minières avant un mois, nous conclûmes un engagement avec l’un des entrepreneurs de travaux pour cette courte période de temps.
Notre tâche, consistant à abattre des arbres, à remplir de fascines les ravins et les fossés, à construire des ponts en bois sur les cours d’eau, n’avait rien pour nous de désagréable, et ce moment fut bientôt passé.
Après un mois employé à cette occupation, nous continuâmes notre route vers les mines, que nous n’atteignîmes que vers le milieu de mai. Cependant la neige était encore épaisse sur les montagnes, et aucun sentier n’ayant été frayé à travers la neige, il fallut nous pourvoir de souliers à raquettes pour arriver aux mines.
Nous trouvâmes à notre claim notre vieil ami Jake, occupé à apprêter les peaux de martre qu’il avait recueillies en grand nombre durant l’hiver. Le vieux semblait aussi gai qu’un oiseau dans sa solitude, et quand nous lui demandâmes comment il avait passé l’hiver, il nous répondit que pendant ces longs mois il n’avait eu d’autre compagnon que les martres et quelques élans. Il avait été plusieurs fois à William’s Creek chercher des provisions, et avait failli une nuit être gelé; il avait presque perdu l’usage d’un de ses orteils.
«Rien de nouveau, je suppose, à notre claim? lui dis-je; en passant, j’ai vu que le puits était plein d’eau et complétement gelé.
—Oh! pour ce qui est de ça, j’ai quelque chose à vous montrer. Regardez, qu’en pensez-vous?» et il nous montra quelques jolies pépites d’or pesant ensemble environ deux onces. On peut se figurer avec quelle joie nous contemplions ce premier produit de notre mine.
«Savez-vous, continua Jake, que ces spécimens ont failli me coûter la vie?
—Comment cela?
—Peu après votre départ, tout en m’occupant de préparer mes piéges à martre, j’eus l’idée de creuser un peu notre puits, avant que les fortes gelées rendissent tout travail impossible. Comme il me fallait quelqu’un pour manœuvrer le treuil, je me rendis à William’s Creek, où je trouvai un pauvre diable, dénué de tout, que j’engageai pour m’aider.
»Après souper, nous nous mîmes à fumer et à causer de choses et d’autres, et en particulier de ce district et de notre placer. Il était fort curieux et me fit une foule de questions sur notre concession de terrain, nos espérances, le nombre des associés, l’époque où nous reviendrions. Pendant ce temps, il examinait tout autour de lui d’un œil curieux, il semblait faire l’inventaire de tout ce que nous possédions. Mais sur le moment je ne fis pas grande attention à tout cela.
»Le premier jour nous mîmes le puits complétement à sec, et armé d’une pioche et d’une pelle, je me fis descendre par mon homme à l’aide du treuil. Après avoir traversé une couche fort dure, ma pioche rencontra soudain une roche plus molle; je me baissai et grattant avec mon couteau, je trouvai les pépites que voilà. Transporté de joie, je m’écriai: «Enfin, grâce à Dieu! nous y voilà.» A ce moment, levant les yeux, je vis mon homme penché sur le bord du puits. Sa figure étant en pleine lumière me parut avoir un air fort peu rassurant. Je lui criai de me remonter.
—Nous allons voir ça! me répondit-il.
»Je me mis donc à rire comme si c’eût été une plaisanterie de sa part, et, mettant ces pépites dans ma poche, je m’assis, en lui disant que sans doute il en aurait bientôt assez de ce jeu-là; mais il s’en alla sans me répondre.
»L’affaire commençait à prendre mauvaise tournure; cependant je ne pouvais croire encore qu’il eût l’infamie de m’abandonner au fond du puits, où je devais infailliblement mourir de faim, car il était peu probable que quelqu’un vînt à passer par là. Et puis, je me disais que notre cabine était vraiment trop pauvre pour tenter sa cupidité. Il me vint à l’esprit toutes sortes d’idées: je pensai qu’il était peut-être fou, ou qu’il s’imaginait que nous avions quelque trésor caché dans la cabine et qu’il était en train de le chercher; d’un autre côté, je me dis qu’il ne s’en irait pas sans revenir voir où j’en étais, et je me promis de lui demander de prendre mon revolver dans la cachette où je le gardais près de ma couchette et de me tuer du coup pour en finir. Puis je pensai qu’après tout je ne tenais pas à quitter la vie de sitôt, et je me mis à chercher quelque moyen de sortir de ma prison. Grimper contre les parois du puits, il n’y avait pas à y songer; il avait retiré le seau, et, ne l’eût-il pas fait, il est probable qu’il eût coupé la corde. Je pensai que peut-être il me serait possible de sortir à l’aide de mon couteau et de ma pioche, en les plantant alternativement dans les parois du puits et m’en servant comme d’échelons; mais si je venais à glisser! Cette pensée me fit passer un frisson dans tout le corps.
»Cependant je ne pouvais découvrir aucun autre moyen de sortir de là, et je me résolus d’attendre que mon ennemi fût parti pour tenter l’aventure. En attendant, l’eau montait dans le puits, car il avait détourné l’eau de la roue et la pompe ne fonctionnait plus. Il y avait dans ce dernier détail une espèce de consolation, car, mourir pour mourir, mieux valait être noyé du coup que de succomber lentement à la faim et au froid.
»Pendant que je songeais ainsi à mon triste sort, le scélérat vint voir, avant de partir, ce que je faisais.
—Eh! en bas! dit-il, en se montrant à l’ouverture du puits.
»Je crus qu’il venait enfin pour me tirer dehors; mais lorsque je levai les yeux, le cœur me faillit, car je vis qu’il avait sur ses épaules un paquet de tout ce qu’il avait pu prendre dans la cabine.
«Infâme gredin! lui criai-je du fond de mon trou; vas-tu donc me laisser mourir ici comme un chien?
—Au revoir, me répondit-il en ricanant; désolé que vous ne soyez pas mieux logé!
»Je poussai des cris, je jurai, je tempêtai, je lui promis de lui tordre le cou si jamais je sortais de là; prières, menaces, tout fut inutile: il s’en alla.
—Mais comment, au nom du ciel, fîtes-vous pour vous tirer de là, Jake?
—Après le départ de ce misérable, je regardai encore une fois autour de moi. Tout à coup je vis le moyen de sortir de ma prison et je faillis devenir fou de joie plus encore à l’idée de pouvoir me venger de ce misérable qu’à celle d’échapper à la mort. Il y avait la pompe! Je n’avais qu’à fixer solidement au fond du puits, avec ma pioche enfoncée dans une des parois, la courroie qui portait les augets, et à grimper en me servant des augets comme d’échelons.
—Ce fut pour vous une véritable échelle de Jacob, Jake.
—Oui, en effet. Pour plus de prudence, j’attendis que mon ennemi se fût éloigné, car au moindre bruit il aurait pu revenir, couper la courroie et m’envoyer au diable en une minute.
»Quand je jugeai qu’il était assez loin, je mis mon projet à exécution, et je sortis facilement du puits; une fois là, je tombai la face contre terre, brisé de fatigue et d’émotion. Puis je courus à la cabine pour m’assurer s’il n’avait pas trouvé mon revolver qui était caché; l’ayant pris, je mangeai un morceau et partis à la poursuite de mon homme.
»Je suivis ses traces pendant quelque temps le long de la vallée; puis je reconnus qu’il s’était dirigé vers les fourches de la Quesnelle. Je me demandai alors s’il ne vaudrait pas mieux, plutôt que de le suivre seul et de le tuer sans témoins, d’aller chercher quelques-uns de nos camarades pour apprendre à ce monsieur à respecter la loi de Lynch. Je me rendis donc à William’s Creek et pris avec moi une demi-douzaine d’hommes.
»Nous n’eûmes pas de peine à retrouver ses traces, et, après avoir fait une dizaine de milles, nous l’aperçûmes marchant tranquillement, chargé de mes dépouilles. Il venait de se remettre en route, après s’être reposé un peu sans doute pour faire cuire son repas, car nous trouvâmes encore du feu à l’endroit où il s’était arrêté. Quand il nous entendit, il se retourna et, nous apercevant, il jeta son fardeau et prit la fuite; mais nous l’eûmes bientôt rejoint. Alors il fit volte-face, m’ajusta et tira. La balle m’effleura le bras et me fit même un peu saigner, mais sans me causer d’autre mal. Nous fûmes bientôt maîtres de lui.
»Revenu avec tous les autres à la cabine de Jack of Clubs Creek, je racontai en détail toute l’histoire; je montrai à mes compagnons l’intérieur du puits et la courroie de la pompe encore attachée comme je viens de le dire; il n’y avait pas à nier le fait.
»Séance tenante, le scélérat fut amené dans la forêt, où nous le pendîmes à un arbre, après lui avoir lu un chapitre de la Bible.
»Nous retournâmes tous à William’s Creek, car je ne me souciais pas de dormir cette nuit-là dans la cabine si près de cet homme mort, et, le lendemain matin, deux hommes vinrent le détacher et l’enterrer au pied de l’arbre. Je vous montrerai l’endroit si vous le désirez.»
Nous allâmes, en effet, voir le lieu où s’était accomplie cette scène tragique: au pied de l’arbre s’élevait un petit tumulus surmonté d’une croix de bois accompagnée d’une planchette où l’on avait inscrit le nom de l’homme (trouvé sur une lettre en sa possession), et la date de son exécution, 21 décembre 1862.
Nous ne pûmes que féliciter le vieux Jake de la façon dont il avait échappé à un si grand danger.
Il nous fallut attendre, avant de nous mettre au travail, l’arrivée de nos compagnons, car nous reconnûmes qu’il était impossible de dessécher notre puits tant que nos voisins ne travailleraient pas de leur côté au desséchement de leurs claims. Pour utiliser notre temps, en attendant nous nous mîmes à travailler dans le bois et à préparer quantité de planches et de madriers qui devaient nous être fort utiles pour nos travaux de mine.
Vers la fin du mois, nos associés arrivèrent; nos voisins se mirent au travail et nous parvînmes à dessécher notre puits. Le vieux Jake avait montré ses spécimens aux marchands, et l’on nous avait offert à chacun 2000 livres (50000 francs) de notre part dans l’entreprise. Mais nous avions repoussé ces offres comme bien au-dessous de nos espérances.
Nous avions ouvert au fond de notre puits un tunnel ou galerie; mais nous nous aperçûmes bientôt que la roche fuyait à mesure que nous creusions, de sorte qu’il ne restait qu’à en creuser un autre plus loin. Les pépites de Jake n’étaient que le contenu d’une petite «poche» qui fut bientôt épuisée. Nous nous remîmes cependant au travail avec ardeur, et bientôt nous eûmes atteint une profondeur de soixante pieds. Mais l’eau filtrait à travers le sable poreux en si grande quantité qu’aucune des pompes que nous avions ne pouvait empêcher ses progrès. Nos voisins étaient exactement dans la même situation que nous, et l’impossibilité d’arriver au but devenait de plus en plus évidente à mesure que nous approchions de l’endroit où nous savions que devait se trouver l’objet de nos convoitises. Il nous fallait donc de nouveau attendre la saison prochaine; alors les routes, dans le haut pays, seraient faites, et nous pourrions faire venir des machines à vapeur pour entreprendre une dernière lutte contre l’infiltration des eaux.
Combien je regrettais de n’avoir pas accepté l’offre des 2000 livres lorsqu’il me fallut, après trois mois du plus dur travail, partir en quête de quelque moyen d’existence qui me permît d’attendre l’été suivant!
A quelle nouvelle industrie allais-je me livrer? Comme je quittais notre malheureux claim, des muletiers vinrent à passer. Le chef, un ex-matelot anglais auquel je m’adressai, offrit de me prendre à son service; ce que j’acceptai avec empressement.
L’existence des muletiers n’a rien de désagréable en été: toujours par voie et par chemin, avec une besogne facile, au grand air. Aussi ce ne fut pas sans chagrin que je dus, à la fin de la saison, dire adieu à mon excellent patron, qui, après avoir gagné une petite fortune, se retirait des affaires et s’en retournait en Angleterre. Heureux homme! l’industrie des transports à dos de mulets valait mieux que celle de la recherche de l’or. Il avait commencé l’année précédente avec un modeste capital de 500 livres (12 500 francs), et il se retirait avec 20 000 livres (500 000 francs); tandis que moi j’avais encore à passer misérablement l’hiver, avec le faible espoir de faire une nouvelle et plus heureuse tentative à notre malheureux claim de Jack of Clubs Creek.
Rustling est un américanisme employé pour désigner dans la société humaine la lutte pour l’existence avec toutes les chances contre soi. C’est, à proprement parler, lutter[P] en désespéré et par tous les moyens possibles contre la mauvaise chance, et telle était exactement ma situation lorsque je débarquai, pour commencer ma seconde campagne d’hiver, sur le quai de Victoria.
Il y a naturellement des degrés dans la lutte contre la misère. Pour commencer par le bas de l’échelle, il y a l’existence du pauvre diable qui arrive à peine, à force de travail, à garder la peau sur les os, comme je l’avais fait l’hiver précédent, et qui s’estime assez heureux s’il parvient à ne pas mourir de faim et à reposer la nuit ses membres fatigués sur un plancher qui n’est pas trop dur.
Il y a, quelques degrés au-dessus de ce pauvre hère, le rustler bourgeois, qui, selon le crédit qu’il trouve, monte un magasin, un café, un restaurant, fait des conférences ou organise une table de jeu.
Au-dessus de tous plane le rustler aux manières aristocratiques, marchand aux faillites nombreuses, politicien aux principes élastiques, oracle des couloirs, homme qui vit toujours au Grand-Hôtel, s’habille à la dernière mode, patronne les rédacteurs de journaux, dirige des explorations aux frais du gouvernement, et dont nos cousins d’Amérique disent que l’essence de son être consiste dans la roideur dédaigneuse de sa lèvre supérieure.
N’ayant que trop présent à l’esprit les souvenirs de mes malheurs de l’année précédente, je résolus de lutter contre la mauvaise fortune; je m’empressai donc de me faire habiller à la dernière mode et d’élire domicile dans un des meilleurs hôtels de Victoria, où je me trouvai en compagnie d’un juge du territoire de Washington, d’un sénateur de l’Orégon, d’un rédacteur en chef d’un des journaux de la ville, et d’un de mes compatriotes qui était venu en Colombie pour coloniser et perdre son argent, sans parler de plusieurs membres de ma nouvelle profession sur laquelle il est inutile que j’insiste plus longuement. Je me contentai, pendant les premiers jours, d’écouter et de profiter de tout ce que j’entendais pour tracer avec soin ma propre ligne de conduite. Ce fut le rédacteur en chef que je résolus de gagner d’abord à mes projets. Je réussis à lui faire accepter une série d’articles suggérant la formation d’une compagnie pour l’application des machines à vapeur à l’exploitation des mines. J’espérais naturellement que notre claim serait le premier à en profiter.
Mes articles firent sensation, et bientôt je fus l’objet des attentions d’une foule de marchands et de spéculateurs. Une compagnie fut formée sous le nom de Cariboo Steam Machinery Company (Compagnies des machines à vapeur du Caribou), et mon nom fut des premiers sur la liste des directeurs. Je reçus, en outre, comme promoteur de l’affaire, des honoraires considérables en actions libérées que je m’empressai de partager avec le rédacteur en chef du journal, qui m’avait fourni le premier échelon de ma nouvelle fortune.
Je passai ainsi l’hiver, me berçant des plus flatteuses espérances. Quand le printemps arriva, nous avions une longue liste d’actionnaires. Nous importâmes un grand nombre de machines de San-Francisco, nous en fîmes construire d’autres à Victoria, et prîmes nos arrangements pour les faire transporter aux mines. L’idée était excellente, comme des milliers d’autres; mais nous n’avions pas tenu suffisamment compte des difficultés d’une telle entreprise. D’abord, il nous fallut payer des prix excessifs pour le transport; le printemps fut tardif; les routes, qui n’avaient été tracées que l’été précédent, furent mises hors de service en plusieurs endroits par les inondations. Bref, quand nos machines arrivèrent aux mines, la saison était fort avancée et les prix que nous étions obligés de demander pour leur usage étaient trop élevés pour que les mineurs pussent nous les payer. Il fallut les vendre à perte, et notre compagnie fit faillite.
J’avais fait, par mon influence, établir une machine sur notre claim; mais comme nos voisins n’en avaient pas, le travail d’une seule fut insuffisant, et la saison se passa encore sans amener de résultat. Mon désappointement fut grand lorsque Pat, qui m’avait représenté aux mines, m’apporta ces tristes nouvelles.
Mon rédacteur en chef, furieux de l’insuccès de notre entreprise, exaspéré par les articles mordants de ses rivaux, m’annonça qu’il se passerait de mes services, de sorte que je me trouvais de nouveau à la recherche d’une position sociale.
J’entrai d’abord comme garçon chez un épicier; puis je passai comme comptable sur un bateau à vapeur du Fraser; et enfin, un beau jour, je me trouvai, à ma grande joie, promu au grade de capitaine d’un de ces navires à bord desquels j’avais si souvent travaillé comme simple porte-faix.
C’était de tous les genres de vie celui qui avait pour moi le plus de charmes. Après avoir été déjà si souvent le jouet des circonstances, quel plaisir pour un homme de mon âge que l’exercice du commandement! Puis le sentiment émouvant des dangers de cette navigation périlleuse convenait à mon tempérament. J’avais vu que la vigueur, le courage et le sang-froid étaient les principales qualités requises, et je me flattais de les posséder.
Je me rappelle, comme si c’était hier, le sentiment de pouvoir absolu que j’éprouvais lorsque, à quelque endroit particulièrement dangereux de ce fleuve terrible, le bateau presque immobile, arrêté par la force énorme du courant, tremblait dans toute sa membrure et se tordait sous les efforts de la vapeur portée à sa plus haute pression. Au dedans grondait le foyer incandescent de la machine; au dehors rugissait le fleuve; la sûreté de tous ceux qui étaient à bord dépendait de moi, et le moindre tour de roue donné mal à propos pouvait nous envoyer tous dans l’autre monde en laissant le courant prendre le dessus sur nous et nous jeter, nous briser contre ces effrayantes murailles de rochers entre lesquelles le fleuve précipitait sa course furieuse. En de tels instants, seul dans ma petite cabine de verre, les dents serrées, les yeux immobiles, la poitrine gonflée, oubliant jusqu’à l’existence des personnes à bord, il me semblait être le dernier homme livrant un combat à la nature et le gagnant. Puis, après cette violente émotion, c’était l’agréable repos que le danger passé fait succéder à une extrême tension d’esprit: je quittais mon poste où je me faisais remplacer par mon second ou par quelque matelot; je me mêlais à la société de mes passagers et je prenais plaisir à causer joyeusement avec les dames quand j’étais assez heureux pour en avoir à bord. C’est une chose étrange que la façon dont le mépris pour le danger croît en nous; par la force de l’habitude, nous nous faisons peu à peu à tout, et nous en arrivons à envisager si fermement le danger que toute son imminence ne peut nous empêcher dans les moments les plus terribles à ne penser qu’aux choses les plus futiles. Nous sommes en cela comme l’homme qui, sur le point de se marier ou d’être pendu, voit son attention se porter malgré lui sur l’étoffe dont est fait le surplis du prêtre ou sur la forme des bottes du bourreau: toujours en nous le remous de l’absurdité remonte côte à côte du plein et fort courant de la vie sérieuse.
Une aventure me mit surtout en renom. Nous remontions un jour un rapide très-dangereux, et le fleuve était gonflé à un tel point que tout le monde disait que nous ne franchirions jamais ce passage. Le manomètre de la machine à vapeur montrait déjà des chiffres tout à fait inaccoutumés, et il semblait impossible d’obtenir une plus haute pression. Nous arrivâmes jusqu’au haut du rapide, à l’endroit même où l’eau d’agitée devient calme; mais là nous nous arrêtâmes soudain: impossible d’avancer d’un pouce. Je compris immédiatement que nous n’en sortirions pas si le mécanicien ne pouvait, par quelque moyen inusité, augmenter la force de la vapeur.
«Que pourriez-vous faire? lui demandai-je.
—Rien, me répondit-il, absolument rien; et si nous ne sortons pas immédiatement de là, nous sauterons et serons tous envoyés à tous les diables.»
Je résolus de ne m’en rapporter qu’à moi-même. M’étant donc fait remplacer au gouvernail par mon fidèle second et lui ayant bien recommandé de maintenir le bateau absolument immobile jusqu’à mon retour, je descendis en bas et vis que le mécanicien avait fait réellement tout son possible, excepté en un point: il n’avait pas pensé à fermer la soupape de sûreté! Tout autour de la chaudière se trouvait justement un groupe d’Indiens à moitié endormis par suite de l’extrême chaleur qu’il faisait en cet endroit. Une idée soudaine, suggérée par une vieille histoire de voyage sur le Mississipi, se présenta à mon esprit.
«Viens, dis-je à celui des Indiens qui me parut le plus lourd et le plus obtus de la compagnie. Tu aimerais à être un grand chef, comme moi qui suis le chef du bateau?
—Oui, capitaine, répondit-il, ses yeux se dilatant à la vue d’une pièce d’or de cinq dollars que je lui montrai.
—Parfait! Eh bien, assieds-toi sur ce petit rond de fer, et bientôt vous verrez tous le bateau monter. (Je ne savais trop si le bateau ne monterait pas très-haut en l’air au lieu de remonter le courant du fleuve, mais il n’y avait pas pour moi d’autre alternative.) Je suis un grand sorcier, ajoutai-je, et vous allez voir que je dis la vérité.»
L’Indien se mit sur son siége sans dire un mot, et je plaçai la pièce de cinq dollars dans sa main en lui disant de la bien tenir, parce que c’était un talisman et que le charme serait détruit s’il la laissait échapper. Il resta là, majestueux comme un sauvage seul peut l’être, serrant de toutes ses forces la pièce dans sa main et jetant sur ses camarades un regard de souverain mépris. Heureusement la chaudière était neuve et solide et elle résista. En deux minutes nous eûmes franchi l’endroit dangereux, et je fis aussitôt échapper la vapeur et presque éteindre le feu. Quant à l’Indien, je lui fis gagner sa pièce de cinq dollars en le gardant sur son trône quelque temps encore après que le danger fut passé. Outre les cinq dollars, il gagna à cette affaire le sobriquet de safety-walve Jack (Jack-soupape), et moi je passai plus que jamais auprès des Indiens pour un très-grand sorcier.
Mes lecteurs jugeront peut-être après cela que ce fut, pour moi et pour d’autres, une chose fort heureuse que je ne gardasse pas longtemps mon poste de capitaine. Quoi qu’il en soit, cette aventure me mit fort en relief parmi les gens du métier.
Au bout de quelque temps, la compagnie ayant fait faillite, je me trouvai de nouveau sans emploi et je dus retourner à Victoria.
Un matin que je me promenais sur le port, je vis venir à moi un de mes amis, nommé Walton, marin déserteur, qui avait quitté la mer pour les mines et brûlait maintenant du désir de quitter les mines pour la mer.
«Vous regardiez ce schooner? me dit-il en me montrant un charmant petit navire. Il est à vendre, et plût au ciel que j’eusse de quoi l’acheter! j’aurais bientôt fait fortune en trafiquant avec les Peaux-rouges. C’est un navire d’une trentaine de tonnes; je le chargerais de whiskey, et avec cela j’achèterais toutes les fourrures qui se peuvent trouver d’ici à Sitka.
—Oui, lui répondis-je, et vous vous feriez confisquer, à votre retour, et le bâtiment, et tout ce que vous auriez obtenu à vil prix des Indiens. Mais combien veut-on de cette goëlette?

L’Indien se mit sur son siège.
![]()
—Environ deux mille dollars, mais je n’en ai que mille, et malheureusement il n’est guère possible de trouver en ce moment à emprunter le restant de la somme.
—Peut-être, lui dis-je. Voyons, vous êtes un marin de profession, et vous savez que je ne suis pas tout à fait novice à ce métier-là. Si j’avais les autres mille dollars et si je vous proposais de nous associer pour acheter le navire et faire ensemble un voyage de commerce, que penseriez-vous de ma proposition?
—Par Jupiter! s’écria-t-il, c’est justement la bonne fortune que j’appelle de tous mes vœux! Si vous le voulez, c’est une affaire faite!»
Nous allâmes aussitôt inspecter le navire et, avant la fin du jour, nous en avions fait l’acquisition en commun. Nous eûmes alors à nous occuper de la cargaison, que nous obtînmes facilement à crédit comme propriétaires du navire, et nous passâmes quelques jours à courir la ville en quête des articles dont nous avions besoin: cotonnades de Manchester, farines, couvertures, mélasses, bottes, souliers et autres objets recherchés par les Indiens. Quant au whiskey, je refusai absolument d’en faire le commerce. C’était un grand sacrifice, car l’honnête négociant qui ne vend pas de whiskey aux Indiens est sûr de se voir distancer par des rivaux moins scrupuleux. Aussi mon associé me fit d’énergiques représentations, mais je restai ferme.
Cela fait, il nous restait à compléter notre équipage. Walton, naturellement, devait être capitaine, et moi je dirigerais les opérations commerciales. Nous engageâmes comme matelot un brave et robuste loup de mer, et je fis prévenir Pat, qui arriva le jour suivant, ravi d’être de nouveau dans ma compagnie. Ayant mis notre cargaison à bord, et, ayant régularisé nos papiers, nous partîmes pour une croisière de six mois parmi les sauvages.
Le Fort Rupert, à quelque deux cents milles au nord, fut le premier endroit où nous nous arrêtâmes, et, après avoir passé trois ou quatre jours à étudier les courants et les marées et à attendre le moment favorable, nous jetâmes l’ancre à la hauteur du village indien.
Walton et moi descendîmes à terre pour voir ce que les indigènes possédaient en fait de fourrures et pour leur offrir les marchandises que nous avions à bord. Les Peaux-rouges firent une grimace fort dédaigneuse quand ils surent que nous n’apportions pas de whiskey.
Cependant, poussés par leurs femmes, ils se décidèrent à mettre leurs fourrures dans leurs canots et à venir inspecter notre cargaison. Nous ne fîmes pas de très-bonnes affaires avec ces Indiens, qui étaient trop rapprochés de la civilisation et qui, pour cette raison, étaient de plus grands coquins et de plus incorrigibles voleurs que leurs frères sauvages.
De là nous nous rendîmes à Bella Coola, sur le continent, et puis, toujours en tirant vers le nord, à l’île de la Reine-Charlotte et à Fort Simpson; enfin, en quittant la rivière Stickeen, sur les frontières de la Colombie anglaise et de ce qui était alors l’Amérique russe, nous remontâmes loin au nord de Sitka jusqu’aux îles Aléoutiennes, près du détroit de Behring.
Nous étions, il faut l’avouer, de vrais contrebandiers dans cette dernière partie du monde; car le gouvernement russe ne souffrait dans ses eaux aucuns trafiquants étrangers autres que la Compagnie de la Baie d’Hudson, à laquelle il avait accordé le monopole du commerce dans la Russie d’Amérique; mais nous nous inquiétions fort peu de cette prohibition: nous savions qu’il n’y avait qu’un seul navire de guerre russe dans ces parages, et qu’il était confortablement à l’ancre dans le port de Pétropavlowski; nous n’étions donc point d’humeur à renoncer, par crainte d’un danger imaginaire, à un commerce qui, là plus que partout ailleurs, devait nous être avantageux.
Cette expédition nous procura une quantité de fourrures magnifiques. Les loutres de mer, les renards argentés et une foule d’autres espèces abondaient, et bien que nous eussions quelques difficultés à nous entendre avec des peuplades dont nous ne comprenions point les dialectes, nous réussîmes à nous défaire de presque toute notre cargaison, et dûmes prendre du lest pour notre retour.
Notre genre de vie était passablement monotone et fatigant. Aussi j’éprouvai un vif plaisir lorsque, ayant tout vendu, moins un petit stock que nous destinions aux habitants de la côte occidentale de Vancouver, nous nous décidâmes à revenir.
Nous avions fait d’excellentes affaires, et je me berçais de l’agréable idée que, ce voyage fini, je me trouverais assez riche pour pouvoir bénéficier d’expéditions futures sans y prendre part de ma personne.
En quittant l’île de la Reine-Charlotte, nous nous arrêtâmes à Quatseemo, au nord de l’île Vancouver, et nous y engageâmes un jeune indigène pour nous servir d’interprète le long de la côte.
Cet Indien, nommé Jack, nous fut très-utile et se montra d’une fidélité à toute épreuve.
Dans la journée, nous nous arrêtions parfois pour camper sur la côte, mais à la tombée de la nuit, nous gagnions le large, de crainte de quelque surprise des sauvages. Nous arrivâmes ainsi à un grand village situé sur le bord d’une petite rade naturelle, à quelques milles à l’ouest de la baie Esperanza. Nous y vendîmes ce qui nous restait de marchandises et nous songeâmes à regagner au plus tôt Victoria, dont nous n’étions plus qu’à quelques journées de navigation.
Ce jour-là le vent soufflait avec violence du nord-ouest, circonstance assez extraordinaire à cette époque de l’année (fin septembre), mais la baie était si complétement abritée par des collines boisées, qu’il nous était impossible de nous faire une idée de la force de la tempête qui agitait l’Océan. Ce ne fut qu’après avoir doublé une pointe de terre qui nous cachait la pleine mer, que nous nous en rendîmes compte. La marée était basse; il ne devait y avoir que peu d’eau au-dessus de la barre, et, à supposer qu’il y eût un chenal, nous ne le connaissions point, étant entrés à marée haute. De plus, le temps au dehors était si effroyable que, sans la crainte que nous inspirait le voisinage des Indiens, nous eussions été fort heureux de passer la nuit à l’ancre où nous nous trouvions.
Walton observait d’un œil vigilant ce qui se passait à terre, et il me signala deux ou trois fois l’agitation extraordinaire qui régnait parmi les sauvages. Un vieillard, qui, ainsi que notre guide nous en informa, était le chef, haranguait une foule d’hommes à l’entrée du village, et nous pouvions reconnaître à leurs gestes que nous étions l’objet de leur attention. Nous cherchâmes une explication naturelle à cette agitation dans le fait que nous étions les seuls blancs qu’ils eussent vus depuis longtemps, mais nous ne pouvions nous empêcher de nous dire que plus tôt nous nous éloignerions, mieux cela vaudrait.
Notre Indien Jack, consulté sur ce point, corrobora nos pressentiments en nous disant qu’une petite goëlette russe, de la force de la nôtre, ayant fait naufrage sur ce point de la côte, l’année précédente, cette tribu avait massacré l’équipage jusqu’au dernier homme. Jack nous suppliait de partir à l’instant même, si cela se pouvait. Son conseil était évidemment désintéressé, car un Indien, s’il peut l’éviter, se soucie médiocrement de s’aventurer sur une mer orageuse.
Le récit de notre interprète était loin de nous tranquilliser, mais c’eût été folie que de vouloir traverser en ce moment les brisants de la barre, et nous cherchâmes avec notre longue-vue un endroit de la baie où l’eau plus unie indiquât l’existence d’une passe. Il nous sembla apercevoir des indices de ce genre tout à fait à l’extrémité opposée de la baie; mais nous jugeâmes qu’il serait dangereux de diviser nos forces en envoyant quelques-uns d’entre nous en reconnaissance dans le petit canot que nous avions à bord. Nous nous résignâmes donc à surveiller les mouvements des Indiens tant que le jour nous le permettrait, et, la nuit venue, à redoubler de vigilance.
A la tombée du jour, une activité nouvelle se manifesta parmi les indigènes. Ils se mirent à tirer leurs canots à terre, à les nettoyer, à les débarrasser de tout ce qui les encombrait. Le pauvre Jack nous supplia de gagner la haute mer à tout hasard, car, bien sûr, les Indiens allaient nous attaquer dans leurs embarcations aussitôt que la nuit serait venue.
Vivement impressionné par ces préparatifs, je me décidai à aller avec Pat, dans notre petit canot, pour examiner de près la passe. Nous la trouvâmes si étroite et la mer était si agitée au dehors, qu’il était impossible de savoir s’il existait ou non des écueils à l’entrée de la passe. Somme toute, nous revînmes peu satisfaits de notre reconnaissance, mais avec la certitude qu’au pis aller il nous restait encore une chance de nous échapper.
De retour au navire, nous allâmes, Walton et moi, examiner nos armes et délibérer sur le choix d’un plan de défense, laissant Pat sur le pont surveiller les mouvements des indigènes.
Tout d’abord Jemmy, notre vieux matelot, fut chargé de couper dans les bordages quelques embrasures de cinq à six pouces carrés. Les Indiens n’ayant pour toutes armes que des arcs, des flèches et des épieux de bois durci, nous pensions que nos légers bordages suffiraient à nous protéger jusqu’au moment où l’ennemi parviendrait à nous aborder.
Nous avions deux ou trois fusils que nous chargeâmes avec des balles et des lingots, et quatre bons revolvers de Colt. Jack devait avoir soin des armes pendant le combat, mais, ne l’ayant pas encore mis à l’épreuve, nous avions des doutes sur lui. Nous le fîmes venir dans la cabine. Sa pâleur et son air effrayé ne nous disaient rien de bon. Mais il avait sans doute le courage du désespoir, car il déclara sans ambages que, la tribu à laquelle nous avions affaire étant ennemie de la sienne, il serait tué s’il était pris et que, par conséquent, il combattrait, s’il y avait lieu, jusqu’à la dernière goutte de son sang.
Il nous restait encore comme dernière ressource de nous retirer dans notre petite cabine, dans le cas où les sauvages parviendraient à se rendre maîtres du pont, et de nous y défendre encore vigoureusement. Nous avions aussi quelques feux de Bengale qui pouvaient nous servir à effrayer nos ennemis s’ils escaladaient nos bordages.
Pendant que nous délibérions encore, nous entendîmes Pat s’écrier:
«Les voilà! Ils arrivent en force!»
Après avoir jeté un dernier coup d’œil sur nos préparatifs, passé nos revolvers à notre ceinture, et rangé les fusils près de l’écoutille, nous montâmes sur le pont. L’obscurité déjà croissante permettait à peine de distinguer à environ un demi-mille de nous un assez grand nombre de canots qui venaient de quitter le rivage.
Lorsque les premiers canots furent arrivés à une distance d’environ deux ou trois cents mètres, nous ordonnâmes à notre Indien de leur demander ce qu’ils voulaient. N’obtenant aucune réponse, il leur déclara de notre part que, s’ils avançaient, nous ferions feu sur eux. Cette menace ne produisit aucun effet.
Pat, qui était un tireur de première force, demanda alors à Walton la permission de tirer sur eux; posant son revolver sur le bordage, il visa soigneusement et fit feu. Un des Indiens tomba en poussant un cri; mais il n’était sans doute blessé que légèrement, car il se releva aussitôt et nous menaça en brandissant son javelot. Cependant les deux canots, qui étaient en avant, s’arrêtèrent et attendirent les autres pour délibérer. Jack essaya de nouveau de leur parler; mais ils criaient et gesticulaient tous à la fois, et il ne put se faire entendre.
Nous avions devant nous cent cinquante à deux cents hommes montés sur une vingtaine de canots. A ce moment-là ils n’étaient guère à plus de cent mètres de nous. Ils hésitèrent un instant, mais ils ne se rendaient point compte de l’effet des armes à feu, et, bien que déconcertés par leur premier échec, l’impression n’était évidemment pas assez forte pour les arrêter. Ils savaient, étant venus à notre bord, que nous n’étions que cinq, y compris Jack, et ils se fiaient à la supériorité de leur nombre. Ils tenaient évidemment conseil avant de recommencer l’attaque, car tous les canots étaient réunis, et deux ou trois d’entre eux haranguaient le reste à tour de rôle.
Profitant de ce moment de répit, Walton envoya Jemmy, Pat et Jack lever l’ancre, pour nous éviter de couper le câble, pendant que, de mon côté, je coupais l’amarre d’une ancre plus petite qui tenait notre poupe immobile. En deux ou trois minutes, nos voiles furent déployées et nous nous dirigeâmes lentement vers la passe que nous avions été reconnaître quelques heures auparavant.
Aussitôt qu’ils s’aperçurent que nous nous en allions, ils firent force de rames vers la passe, et, comme ils marchaient très-vite, ils nous eurent bientôt dépassés, et se placèrent de façon à nous barrer le passage.
Walton et moi étions à la barre du gouvernail, cherchant ce que nous pourrions bien faire pour nous tirer de là avec aussi peu d’effusion de sang que possible, quand deux ou trois flèches sifflèrent au-dessus de nos têtes. Il n’y avait pas à s’y méprendre: ce qu’ils voulaient, c’était nous piller et nous assassiner par-dessus le marché.
«Il va faire chaud ici tout à l’heure, dis-je en me baissant derrière le bordage; mais tiens-toi dans l’écoutille, Walton, et veille au gouvernail.»
Walton suivit mon conseil.
«Maintenant, me dit-il, fais de ton mieux. Moi je tiendrai la barre tant qu’il nous restera une chance de leur échapper. De temps à autre je tâcherai bien de leur envoyer quelques dragées.»
Je me plaçai avec Pat aux embrasures de tribord, et Jemmy et l’Indien se tinrent à celles de bâbord.
«Attention au commandement! dis-je; Jemmy et moi, nous tirerons d’abord nos six coups, et nous rechargerons pendant que Pat fera feu de son revolver et Jack de son fusil. En joue! feu!»
Je commençai en visant de mon mieux au milieu du groupe le plus compacte, car la nuit était tout à fait venue et ne permettait de distinguer que confusément les formes. J’entendis les coups de Jemmy suivre chacun des miens, et bientôt des cris et des gémissements qui me firent passer un frisson dans les veines nous donnèrent l’assurance que la plupart de nos balles avaient porté. De nombreuses flèches volèrent à travers nos agrès ou se piquèrent dans nos voiles, mais ne purent nous atteindre, à couvert comme nous l’étions.
Bientôt nous entendîmes dans toutes les directions le bruit des rames, et nous vîmes que l’ennemi s’enfuyait. Pendant que nous nous dépêchions de recharger nos armes, Pat continuait à tirer, quand tout à coup nous entendîmes un bruit épouvantable, comme si le navire venait de sauter: c’était l’un des fusils de Jack qui avait éclaté, sans faire d’autre mal heureusement que de briser en éclats une planche du bordage et de causer une terrible peur au pauvre Jack. Les sauvages se réunirent et allèrent tenir conseil à environ un quart de mille sur notre chemin.
Cela nous donnait le temps de réfléchir. Que faire? la nuit était si noire que c’était folie de s’exposer, à moins d’y être absolument forcé, au danger de franchir la passe. Il était plus que probable que, dans le cas où nous échouerions, nous serions brisés contre les rochers par l’épouvantable houle qui roulait à l’extérieur de la baie. Nous résolûmes donc de rester, jusqu’à nouvel ordre, où nous étions, espérant que les sauvages profiteraient de la leçon qu’ils venaient de recevoir et se retireraient.
Notre surexcitation avait été si grande pendant la demi-heure qui venait de s’écouler, que nous n’avions pas même eu le temps d’avoir peur; mais quand nous pûmes respirer, je sentis une sueur froide me couler le long du dos, et, courant à la cabine pour y prendre la bouteille de whiskey, je m’aperçus qu’elle n’y était plus.
Ce fut pour moi un trait de lumière; quelqu’un de ces pillards avait dû, pendant le jour, se glisser, à notre insu, dans la cabine et s’emparer de cette malheureuse bouteille; cela avait suffi pour que deux ou trois d’entre eux s’enivrassent, et leur vue avait dû enflammer le reste du fol espoir d’atteindre le même état de béatitude. Je tirai vite une autre bouteille de whiskey de notre soute aux provisions, et nous en prîmes chacun une bonne gorgée.
Nous savions à quoi s’exposeraient les Indiens pour obtenir de l’eau de feu, et la découverte que je venais de faire nous remplit de nouvelles inquiétudes; il était évident qu’ils ne se tiendraient pas pour battus, et qu’après avoir compté leurs pertes et respiré un instant, ils reviendraient à l’attaque.
En effet, nous entendîmes bientôt de nouveau le bruit des pagayes. Cette fois, nous les laissâmes approcher, et quand ils furent à portée, nous déchargeâmes nos armes dans le tas aussi rapidement que possible. Plusieurs durent être blessés et quelques-uns tués, car de tous côtés s’élevèrent des gémissements, et le bruit de corps tombant dans l’eau parvint jusqu’à nous.
«Il faut en courir la chance et tâcher de sortir d’ici, Dick, me dit Walton. Si les Indiens persistent dans leur projet, nous ne pourrons résister plus longtemps; gagner la mer est donc notre seule chance de salut.»
Tout à coup, un bruit de rames nous fit retourner et nous n’eûmes que le temps de baisser la tête pour éviter trois ou quatre flèches et un lourd javelot, qui s’enfonça en vibrant dans notre bordage.
Au même instant nous arrivait le bruit d’une lutte sur l’avant du navire; c’étaient les sauvages qui essayaient de nous aborder. Je me précipitai dans l’entre pont pour y prendre quelques feux de Bengale; en allumant un, je courus à la proue, où j’arrivai à temps pour voir Jemmy aux prises avec deux ou trois Indiens qui essayaient de monter en s’accrochant aux chaînes du navire.
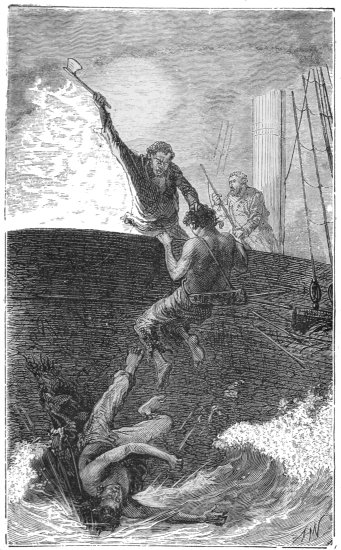
Jemmy aux prises avec deux Indiens.
![]()
Je venais de mettre en place le feu de Bengale, lorsque j’entendis un coup violent frappé derrière moi, et, me relevant précipitamment, je vis Pat tenant encore la hache levée au-dessus du cadavre d’un Indien qui roulait à ses pieds.
«Vous l’avez échappé belle, me dit-il; ce maudit gredin s’était glissé sur le bordage et allait vous frapper par derrière de son javelot, quand je lui ai fait son affaire.»
La lumière soudaine du feu de Bengale paralysa nos adversaires et nous donna un instant de répit qui nous permit de recharger nos armes et de faire un affreux carnage parmi nos ennemis. La lueur qui se projetait au loin nous montrait à une très-petite distance de nous l’entrée de la passe. Nous mîmes aussitôt toutes voiles dehors pour forcer le passage, et, pour éclairer notre route, nous allumâmes quelques autres feux de Bengale, à la grande stupéfaction des sauvages, qui poussaient des hurlements de surprise et de rage en voyant que malgré tous leurs efforts nous allions leur échapper.
Cependant quelques-uns des plus téméraires continuaient à nous lancer des flèches. Nous étions presque hors de la baie et nous nous préparions à replier nos voiles pour faire face à la tempête, lorsque le pauvre Walton, poussant un grand cri, tomba mort, le cœur percé d’une flèche égarée.
La barre du gouvernail se mit à osciller et faillit me renverser lorsque j’accourus. Avant que j’eusse pu m’en emparer, un bruit horrible se fit entendre; nous touchions, et les vagues, dont l’écume eut en un instant éteint nos lumières, déferlaient sur nous. Mes compagnons accoururent, mais ce ne fut que pour voir combien notre désastre était complet.
Cher et brave Walton! les effroyables dangers qui nous entouraient ne purent m’empêcher de donner libre carrière à mon émotion depuis si longtemps comprimée. Je ne pouvais en ce moment penser qu’à lui, à lui qui, pendant toute cette affaire, était resté si bravement à son poste. Penché sur son cadavre, je pleurais comme un enfant, en pensant à sa mère, à ses sœurs, dont il m’avait si souvent parlé près du feu de notre petite cabine, et le cœur me manquait lorsque je me demandais comment je m’y prendrais pour leur annoncer cette affreuse nouvelle.
Cette pensée me rappela à l’horrible réalité. N’étions-nous pas perdus, perdus sans retour?
Notre situation était désespérée. Ce n’est pas que nous eussions pour le moment rien à craindre des Indiens, qui n’oseraient pas s’aventurer jusqu’ici avant le jour; mais d’ici là notre petit navire serait brisé en mille morceaux sur les écueils.
«Eh bien, capitaine, me dit Jemmy (je vous appelle capitaine, maintenant que le pauvre monsieur Walton est mort), je ne vois pas que nous puissions faire autre chose que de rester où nous sommes jusqu’à ce que la tempête se calme; si le vent tournait un peu et soufflait de terre, nous pourrions nous mettre dans le petit canot et nous en aller en côtoyant le bord.»
Le bruit des flots qui battaient furieusement les flancs de notre navire nous empêchait presque de nous entendre.
«Croyez-vous, lui criai-je, qu’avec le vent qu’il fait nous puissions passer la nuit entière sans être mis en pièces?
—Ce serait bien possible, car le navire est solide; mais nous aurons de nouveau les sauvages à nos trousses. Nous n’avons qu’une chose à faire, c’est de partir aussitôt que nous aurons la moindre chance de le faire. J’ai bien peur cependant que ce pauvre petit canot ne tienne pas la mer une minute.»
Le canot, abrité par le navire, flottait sous le vent, dansant comme un bouchon sur les vagues. Nous parvînmes, non sans peine, à réunir quelques provisions (biscuits, eau-de-vie, etc.) et des couvertures que nous nous tînmes prêts à jeter dans le canot; nous trouvâmes aussi quelques avirons de rechange, et je serrai précieusement dans ma ceinture quelques allumettes chimiques enveloppées dans un morceau de toile cirée. Alors chacun de nous mit dans sa ceinture ce qu’il avait de plus précieux, ceignit son revolver et attendit le moment favorable pour se confier à la légère et frêle embarcation.
Au bout d’une heure, le vent, comme Jemmy l’avait espéré, se calma un peu, puis recommença à souffler, mais du rivage. Nous cessâmes d’être secoués violemment sur l’écueil, et je conçus même l’espoir de sauver le navire quand la marée serait tout à fait haute, car la coque ne semblait pas fort endommagée et nous n’avions pas plus d’un pied d’eau dans la cale.
Ayant trouvé un de nos feux de Bengale, je l’allumai pour me rendre compte aussi bien que possible de notre position, et je vis alors qu’il n’y avait absolument aucun espoir de sauver le navire. Nous avions été poussés très-loin du chenal, au milieu de brisants, et il eût fallu un remorqueur pour nous en tirer. Les Indiens avaient complétement disparu.
La mer s’étant un peu calmée, nous plaçâmes dans la chaloupe le corps du pauvre Walton, ainsi que quelques objets de première nécessité, et nous nous embarquâmes. Une fois hors du chenal, nous pûmes doubler un cap, derrière lequel la mer se trouvait relativement calme. La tempête s’était apaisée, de sorte que nous pûmes gagner la haute mer et faire au pauvre Walton les funérailles du marin.
Au bout de huit ou dix jours, nous arrivâmes à Victoria, épuisés de fatigue, n’ayant que la plus triste des histoires à raconter, et la perspective d’un long hiver à passer non dans la misère, car nous avions eu soin de faire assurer notre schooner, mais avec la désolante pensée qu’avec notre navire nous avions perdu la petite fortune que nous avions si péniblement gagnée.
L’hiver se passa sans incident remarquable. Pat et moi, désormais inséparables, le passâmes ensemble, et dès le retour du printemps nous résolûmes de tenter une dernière fois la fortune aux mines, nous promettant que ce serait notre dernier effort, et que si le sort nous était encore défavorable, nous quitterions le pays.
Nous étions décidés à abandonner définitivement Jack of Clubs Creek, et à faire notre dernière tentative sur un terrain vierge où nul homme blanc n’eût encore mis le pied. A cet effet, sitôt arrivés à William’s Creek, nous achetâmes pour un mois environ de farine, de lard et d’autres provisions; nous nous munîmes d’une pioche, d’une pelle, d’une poêle à laver le minerai, et nous prîmes la direction de la Bear River (rivière de l’Ours), ayant chacun sur notre dos une centaine de livres.
Bien que nous fussions à la fin de mai, la neige n’avait pas entièrement disparu, et nous en trouvions encore de deux à trois pieds dans les bois que nous traversions; ce qui, chargés comme nous étions, rendait notre marche très-pénible. Il n’y avait point de chemin tracé, et tout ce que nous pouvions faire était de suivre d’aussi près que possible le cours de la rivière, qui tantôt se précipitait impétueusement à travers les cañons, tantôt se perdait dans des marais couverts d’osiers. Le seul instant du jour où la fatigue du voyage fût tolérable était l’heure matinale où la neige était encore dure par suite du froid intense de la nuit. Aussitôt que le soleil se montrait, la surface de la neige fondait et il devenait impossible de faire plus d’une douzaine de pas sans enfoncer et buter contre les troncs d’arbre cachés sous la nappe blanche. Puis de temps en temps nous avions à escalader des pentes escarpées ou à suivre la crête de précipices s’élevant à pic au-dessus de torrents coulant à une profondeur vertigineuse.
Un matin, en me laissant glisser sur une pente couverte de neige, je faillis périr. Ne voyant, en regardant du haut de la montagne, qu’un talus très-uni présentant une pente à l’inclinaison d’environ 45 degrés: «Parbleu, dis-je, voilà une magnifique occasion de se reposer: je vais me laisser glisser jusqu’en bas. Viens-tu, Pat?»
Ce projet ne lui souriant point, Pat assujettit son fardeau sur ses épaules et se mit à descendre prudemment en mettant lentement un pied devant l’autre.
«Je tiendrai le déjeuner prêt pour quand tu arriveras au bas de la montagne», dis-je à Pat; et m’étendant sur le dos, mon paquet sous moi, je me laissai glisser rapidement sur la surface unie.
Soudain, à peu près à mi-côte, j’aperçus à 30 mètres devant moi le sommet d’un sapin se montrant au-dessus de la nappe blanche, et en regardant plus attentivement, je vis que, sur une assez grande étendue, les sommets d’autres arbres couverts d’une épaisse couche de neige formaient comme une continuation du talus sur lequel je glissais rapidement. Le précipice, mesuré du sommet à la base de ces sapins, devait être d’environ deux cents pieds, et quelques secondes de plus de cette glissade devaient m’y précipiter. A une très-petite distance de moi, un peu sur la gauche, était un jeune pin. Ne pouvant m’arrêter, je réussis à donner à ma course la direction de cet arbre, et, en passant, je l’embrassai et m’y cramponnai de toutes mes forces. L’impulsion acquise, doublée par le poids du fardeau que je portais, était si forte que l’arbre plia et que je craignis un instant qu’il ne cédât; mais il tint bon et je fus sauvé. Cet instant critique fut suivi chez moi d’une réaction nerveuse qui me laissa aussi faible qu’un enfant. Je remontai avec précaution, et j’aperçus bientôt Pat qui avait trouvé un peu plus loin un chemin que ne coupait point le précipice où j’avais failli tomber; j’étais complétement épuisé et je tremblais si fort que, ne pouvant plus porter mon paquet, je me mis à le faire rouler devant moi jusqu’à ce que nous eûmes atteint le bas de la montagne, où je calmai mes nerfs à l’aide d’un bol de thé que Pat s’empressa de me préparer.
Plusieurs jours de suite nous marchâmes ainsi, n’avançant que bien lentement, à travers un pays aussi accidenté. Nous étions déjà bien loin de toute habitation des blancs et seuls avec la nature, dans sa grandeur, sa beauté et sa sauvagerie primitives. La rivière s’élargissait ainsi que la vallée, et sur son cours s’entassaient çà et là des piles de bois mort, charrié et blanchi par les eaux. Des prairies naturelles s’étendaient sur les deux rives jusqu’au pied des montagnes, sur les flancs desquelles croissait une végétation qui du pin et du sapin allait, en diminuant sans cesse de force et de grandeur, se perdre dans les régions des neiges éternelles où rien ne rompait l’uniforme monotonie de cette blancheur éblouissante que quelques pics noirs et pointus, trop escarpés pour que les flocons de neige pussent s’y arrêter. Bien loin à l’est, à travers l’atmosphère limpide des montagnes, on pouvait distinguer sous toute espèce de formes, châteaux, pointes d’aiguille, les prodigieux sommets des montagnes Rocheuses. A la lumière d’un brillant lever ou d’un éclatant coucher de soleil, cette vue dépassait de beaucoup par son inexprimable grandeur tout ce que le pinceau de l’artiste peut rendre, tout ce que la parole du poëte peut exprimer.
A mesure que la vallée s’élargissait, l’air devenait plus chaud, la végétation changeait de caractère et la stérilité faisait place à la fertilité. Le climat était de deux mois en avance sur l’inhospitalière région du Caribou que nous venions de quitter. La neige avait depuis longtemps disparu dans les plaines: arbres, arbustes, fleurs sauvages, tout poussait ou s’ouvrait à la chaleur du bienfaisant soleil, et de tous côtés des baies se gonflaient sur les buissons. Le gibier abondait dans les bois autant que le poisson dans les rivières. La nuit nous entendions le cri de l’élan, le grognement de l’ours et l’aboiement du coyote (chien sauvage); et le jour la gelinotte et la perdrix traversaient presque à chaque pas notre chemin. Si l’on eût pu y arriver sans risquer cent fois par jour de se casser le cou, ce pays eût été un vrai paradis pour le chasseur ou l’amateur de la nature vierge. Nous faisions bombance avec tout le gibier et le poisson que nous tuions avec notre vieux revolver, ou que nous prenions avec un petit filet que nous avions fabriqué. Du reste la chasse ne nous faisait pas perdre de vue le but de notre voyage, et toutes les fois que nous rencontrions un endroit où il y avait la moindre probabilité de trouver de l’or, notre poêle à laver entrait en jeu. Nous obtînmes ainsi à plusieurs reprises de petites quantités du précieux métal, mais jamais assez pour nous faire espérer une exploitation fructueuse.
Un matin, après une marche fatigante de quatre ou cinq milles, nous aperçûmes sur le versant opposé de la vallée un ruisseau dont les bords nous offraient des apparences favorables à notre entreprise, et nous résolûmes de passer la rivière pour explorer le lit de ce cours d’eau.
Il ne fallait pas penser à traverser la rivière à l’endroit où nous étions. Un incendie avait détruit jusqu’au dernier morceau de bois sur un espace de plusieurs milles et il était impossible de faire un radeau.
A environ deux milles, au-dessus de nous, à un endroit où, la vallée se rétrécissant, la rivière se précipitait entre ses rives avec une rapidité terrible, nous avions observé un long et mince érable que l’incendie avait épargné et qui était resté couché en travers d’une rive à l’autre, dans la position où un ou deux ans auparavant, à en juger par les apparences, quelque Indien l’avait fait tomber pour effectuer le passage de la rivière. Mais ce long arbre était si mince! Figurez-vous une longue perche, la plus longue que l’on puisse imaginer, et encore toute hérissée d’un inextricable fouillis de branches.
Nous hésitions à nous aventurer sur ce pont étroit et fragile, car notre poids, auquel s’ajoutait celui des lourds fardeaux que nous portions, devait le faire balancer de bas en haut comme une corde mal tendue, et le moindre faux pas, le moindre coup de pied contre une des branches latérales nous aurait précipités dans le torrent impétueux où nous aurions infailliblement péri; nous suivîmes donc le cours de la rivière dans l’espoir de trouver plus bas assez d’arbres pour faire un radeau.
La fortune nous favorisa plus tôt que nous ne l’espérions, car deux ou trois milles plus bas nous vîmes au milieu de la rivière une île, et tout près du bord, de notre côté, un immense pin qui, se trouvant tout à fait seul, avait échappé à l’incendie.
Nous nous mîmes aussitôt à jouer de la hache, et nous le fîmes tomber de telle façon que sa tête porta en plein dans l’île et qu’il nous offrit un pont très-solide. Le bras de la rivière, de l’autre côté de l’île, n’était pas très-large et n’avait que trois pieds de profondeur; nous pûmes donc le traverser à gué, mais plus d’une fois la force du courant nous fit perdre pied; nous réussîmes cependant à gagner sans encombre la rive opposée. Nous nous hâtâmes de remonter le cours de la rivière jusqu’au ruisseau que nous avions observé, et comme la nuit approchait, nous fîmes du feu et soupâmes, après quoi nous allumâmes nos pipes, et ayant étendu nos couvertures sur des jeunes branches de pin, nous nous étendîmes les pieds contre le foyer.
Après nous être entretenus de nos espérances, chacun de nous s’étendit sur sa couverture, et nous fûmes bientôt plongés dans un profond sommeil. Environ deux heures après, autant que j’en pus juger à la hauteur de la lune, nous fûmes réveillés en même temps par un fort grognement poussé tout près de nous. Me levant en sursaut, je saisis la hache qui se trouvait à portée de ma main, pendant que Pat tirait le vieux revolver de dessous le sac de farine qui lui servait d’oreiller. L’éclat de notre feu qui brûlait encore nous empêchait de rien distinguer; mais nous entendions le bruit de pas lourds et mesurés. Nos yeux s’habituant peu à peu à l’obscurité, nous aperçûmes un énorme ours brun qui tournait autour de nous.
Cet animal, très-rare et d’une grande férocité, s’était probablement réveillé depuis peu de sa torpeur hivernale, et sentant, au sortir de sa caverne, l’odeur de notre cuisine, il était accouru pour satisfaire son appétit bien justifiable après une si longue abstinence.
Nous l’observâmes pendant quelques minutes, nous tenant sur le qui-vive, comme on le pense bien. Il continuait à tourner autour de nous, se maintenant à une distance d’une vingtaine de mètres. Que n’aurions-nous donné, Pat et moi, pour avoir en cet instant une bonne carabine! Nous suivions d’un œil circonspect les pas de l’animal, et voyant qu’il restait toujours à la même distance de nous, nous reprîmes quelque confiance et discutâmes le plan de défense que nous devrions adopter en cas d’attaque.
D’abord nous savions parfaitement que, tant que le feu brûlerait, il ne se risquerait pas à s’avancer jusque sur nous; mais sur un espace de plus de 100 mètres il ne restait pas un copeau de bois pour entretenir notre foyer, qui nécessairement devait s’éteindre au bout d’une heure ou de deux au plus. Il était évident, d’après l’obstination de maître Martin, qu’il était bien déterminé à ne pas s’en retourner bredouille et à se régaler de nos provisions ou de nos personnes. Or l’existence de ces dernières dépendait des premières, car, dans les pays montagneux et arides que nous avions à traverser, nous serions morts de faim en route si nous avions perdu nos provisions. Il fallait donc nous préparer à la lutte. Nos seules armes étaient le vieux revolver déjà mentionné, une hache et une pioche. Nous devions bien nous garder de provoquer notre ennemi par un coup de feu de nature à le blesser seulement et à lui faire surmonter même son horreur du feu. Il fallait attendre l’attaque et ne tirer que lorsque nous serions sûrs de le frapper dans un de ses organes vitaux. Avec quel soin j’examinai notre vieil engin de destruction, j’en graissai les rouages, et je m’assurai qu’il ne nous jouerait pas de mauvais tours! car s’il nous avait raté dans la main, comme cela lui était arrivé plus d’une fois, cela eût très-bien pu coûter la vie à l’un de nous.
Il y avait aussi des conditions stratégiques à considérer. Immédiatement derrière nous se trouvait une petite élévation de terrain d’environ trois pieds de hauteur, qui avait la forme d’un fer à cheval et qui pendant notre sommeil nous avait abrités contre le vent. Ce pouvait être, pour le cas où nous aurions à faire de l’escrime avec maître Martin, une position avantageuse.
Je proposai d’abord un plan qui ne péchait pas par le manque de hardiesse: c’était d’aller, en s’approchant de l’ours aussi près que possible, lui lancer un brandon enflammé à la figure, et de revenir se placer de nouveau sous la protection du feu avant qu’il eût le temps de se remettre de son émotion. Si le coup portait en pleine figure, cela pourrait l’effrayer assez pour qu’il se retirât; et si nous avions seulement le temps d’aller ramasser du bois pour faire un grand feu qui pût durer jusqu’au jour, nous serions sauvés. D’un autre côté, cela pourrait le jeter dans une rage folle et nous mettre dans une attitude de défense moins calme que si nous attendions patiemment qu’il nous attaquât. Mais la tête de Pat, en dépit de sa nationalité, était plus froide que la mienne.
«J’ai notre affaire, s’écria-t-il. Je reste où je suis et j’attends mon gentleman avec le vieux revolver. Quand il ne sera plus qu’à 10 mètres, je lui envoie une cheville dans le coffre, et je saute près de vous sur la levée. Vous, si je ne le tue pas du coup et qu’il s’élance après moi, vous vous tiendrez prêt à lui fendre la tête avec votre hache, et cela me donnera le temps de lui servir une autre dragée qui cette fois fera, j’espère, son affaire.»
Je me rangeai à l’avis de Pat, me contentant de substituer à la hache la pioche, arme plus lourde et tournant moins facilement dans la main, et nous nous assîmes près du feu, attendant les événements, mais en proie, je dois l’avouer, à de vives inquiétudes. A mesure que le feu baissait, le cercle que l’ours continuait à décrire se rétrécissait, et lorsque la dernière langue de flamme s’évanouit, il n’était plus qu’à une douzaine de mètres. Nous le suivions en tournant dans un cercle plus petit et gardant toujours le brasier entre nous et lui. A la fin, il s’arrêta, se leva lourdement sur ses pattes de derrière et, avec sa gaucherie apparente, fit vers nous quelques pas.
«Tire, Pat! m’écriai-je en levant ma pioche, prêt à la laisser tomber de tout son poids sur le crâne de maître Martin.
—Oui, mon ami, répondit Pat, voilà!» et faisant feu sur l’ours, qu’il atteignit en pleine poitrine, il courut se placer aussitôt sur la levée à côté de moi.
L’animal chancela; puis, avec un rugissement de fureur, s’élança vers Pat. Je le frappai sur le crâne avec la pioche; mais, comme j’avais dû frapper de côté, le fer, au lieu de lui entrer dans la tête, lui traversa l’épaule et s’enfonça dans la poitrine. Au même instant, Pat fit feu pour la seconde fois, et le monstre, touché au cœur, alla rouler près des cendres de notre foyer.
Ce fut avec un inexprimable sentiment de soulagement et de joie que nous contemplâmes notre ennemi gisant à nos pieds. Nous nous hâtâmes de rassembler tout le bois nécessaire pour entretenir un grand feu, résolus à nous assurer contre toute visite nocturne du même genre, et notamment contre celle de la femelle de l’ours, qui aurait bien pu venir à la recherche de son seigneur. Le feu flamba bientôt de nouveau, et, fatigués tout à la fois par la surexcitation de la lutte et la longue veille qui l’avait précédée, nous nous roulâmes dans nos couvertures et dormîmes d’un sommeil de plomb jusqu’au milieu du jour suivant.
Notre première occupation, le lendemain, fut de dépouiller l’ours de sa peau, que nous voulions porter en trophée à William’s Creek. Puis, ayant creusé un trou, nous y plaçâmes les pattes de maître Martin, et nous allumâmes un grand feu par-dessus. Nous recommandons ce procédé indien à nos lecteurs: il n’y a pas de mets recherché qui puisse se comparer à des pattes d’ours cuites de cette façon.
Cette agréable besogne terminée, nous reprîmes notre travail sur les rives du ruisseau; mais n’ayant rien trouvé, nous revînmes dîner un peu découragés. Après ce repas, nous résolûmes de faire une dernière tentative à environ deux milles plus haut vers les sources du ruisseau.
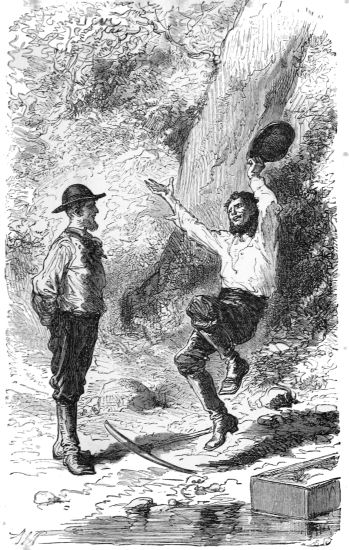
Il se mit à exécuter une danse folle.
![]()
Quelques coups de pioche nous amenèrent au rocher, et pendant que je continuais à creuser, Pat prit une bonne pelletée de la terre que nous venions d’extraire et descendit au bord du ruisseau pour procéder au lavage.
Tout à coup, j’entendis sa voix joyeuse qui m’appelait. Je laissai tomber ma pioche et me mis à courir vers lui. Il était assis par terre, la boîte à laver entre les jambes.
«Eh bien, qu’y a-t-il? As-tu vu un autre ours? lui dis-je en regardant autour de moi, tout essoufflé par ma course après les rochers.
—Au diable l’ours, répondit-il; tenez!» Et prenant dans ses doigts une poignée de terre humide, il se leva et se mit à exécuter une danse folle et bizarre.
Je crus qu’il perdait la raison, et je l’apostrophai avec véhémence. Il se contenta de hausser les épaules en me disant de regarder dans la boîte.
J’examinai attentivement l’intérieur et n’y vis rien que de la boue. Pat continuait à battre des entrechats autour de moi. Fatigué enfin, hors d’haleine, il vint se rasseoir près de la boîte.
«Remuez donc un peu cette boue avec vos doigts», me dit-il.
Je fis ce qu’il désirait; je retirai un grand nombre de pierres, et au bout d’un instant j’aperçus comme un éclair jaune dans la masse; c’était un petit lingot de la grosseur d’une noix. Presque aussi ému que Pat, je ne pus que me jeter par terre et fermer les yeux, tant était forte la sensation de joie que j’éprouvais. Bientôt me relevant, je courus au bord de l’eau avec la boîte, je lavai complétement tout ce qu’elle contenait, et je trouvai au fond un petit lingot avec plusieurs pépites. Nous restions là, absorbés dans cette vision extatique, trop émus l’un et l’autre pour pouvoir parler.
«Mais si tout cela, dis-je enfin, n’était que le contenu d’une petite poche égarée dans le rocher, et si nous allions ne plus rien trouver?
—C’est ce que je craindrais aussi, répondit Pat, si nous n’avions que le gros morceau; mais regardez ces jolies pépites; c’est une preuve que nous tenons un filon.»
Nous reprîmes notre travail avec courage, et chaque lavage nous donna non plus de gros morceaux, mais une foule de petits.
Le succès n’étant plus douteux, nous résolûmes de retourner immédiatement à William’s Creek pour chercher des outils et des provisions. Je coupai avec l’aide de Pat un jeune sapin, dont je fis six poteaux; puis ayant tracé sur le sol un carré de deux cents pieds de côté pour chacun de nous (c’est l’étendue accordée à ceux qui découvrent de nouveaux gisements), je plantai les poteaux en terre et j’y écrivis nos noms en grosses lettres.
Il plut à torrents pendant toute la nuit, mais nous étions parfaitement abrités sous les branches d’un sapin géant qui formait au-dessus de nous un véritable parapluie. Nous entendions la rivière mugir de plus en plus fort à mesure qu’elle se gonflait sous l’orage; mais que nous importaient le temps et la rivière et l’endroit perdu, ignoré du monde, où nous étions? Nous n’avions de pensée que pour la fortune qui enfin nous souriait.
Le matin, à notre réveil, nous trouvâmes que la rivière avait crû de trois pieds durant la nuit, et qu’il était plus difficile que jamais de la traverser. L’arbre sur lequel nous étions parvenus à atteindre l’île, quelques milles plus bas, avait été emporté par la crue, et en tout cas il nous eût été impossible de passer à gué le petit bras qui nous séparait de l’île. A un mille de nous, entre les deux branches principales de la rivière, s’élevait un rocher au pied duquel était tombé, en travers du courant, un arbre long et mince qui semblait être notre dernière ressource. Le temps avait désormais pour nous une telle valeur que nous décidâmes de tenter le passage au moyen de cet arbre.
Cet arbre, qui semblait être notre dernière ressource, à moins que nous ne descendissions beaucoup plus bas jusqu’à un endroit où nous trouverions des arbres pour faire un radeau. Nous étions si pleins du sentiment de notre richesse prochaine, que la valeur de notre existence avait augmenté à nos yeux de mille pour cent depuis l’instant où, de l’autre bord, nous avions examiné d’un œil soupçonneux ce même arbre et l’avions dédaigné. Le temps, d’un autre côté, avait désormais pour nous une telle valeur que nous ne nous sentions pas d’humeur à perdre trois ou quatre jours pour descendre le cours de la rivière: nous nous décidâmes donc à tenter le passage sur l’arbre, dont la souche fort heureusement était de notre côté.
Nous cachâmes, à la manière des Indiens, la moitié de nos provisions et les outils dont nous n’avions pas besoin; et, chargés de nos paquets beaucoup plus légers cette fois, nous nous mîmes en route.
L’endroit nous parut terrible vu de près. Au centre de la rivière, le poids seul de l’arbre lui faisait subir une dépression de deux ou trois pieds, et l’eau se brisait contre ce frêle obstacle; il était évident que le poids d’un homme le ferait encore plus enfoncer. Le courant, dans sa rapidité furieuse, détachait de temps à autre de la rive de gros rochers qui tombaient dans l’eau avec un bruit sourd, et il était à craindre que quelque débris flottant n’entraînât le frêle sapin qui devait nous servir de passerelle.
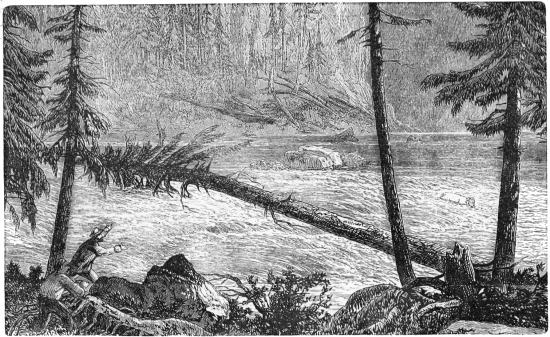
L’endroit nous parut terrible vu de près.
![]()
Cependant le rapide au-dessus de nous était long d’un mille et en droite ligne, de sorte que nous pouvions voir assez loin pour être sûrs qu’aucun accident de ce genre n’arriverait pendant que nous serions en train de passer. Pour ne négliger aucune chance de salut, nous changeâmes la disposition de nos paquets et les attachâmes en travers de la poitrine.
Nous tenions notre couteau à la main, prêts à couper la corde dans le cas où le pied nous aurait manqué et où nous serions tombés à l’eau.
Les chances de Pat eussent à coup sûr été assez minces, car il ne savait pas nager; mais même pour un bon nageur la question était de savoir si le courant le pousserait vers le bord ou l’entraînerait vers quelque gouffre.
Comme nous étions ainsi à délibérer sur la rive, peu ravis de la perspective qui s’offrait à nous, Pat regarda en amont et s’écria: «Pardieu! voici venir quelque chose qui va faire cesser nos hésitations!»
En effet, vers le haut du rapide commençait à paraître une masse informe d’arbres, de souches et de branches entremêlés. A chaque instant cette espèce d’île flottante s’accrochait à quelque projection de la rive, s’arrêtait quelques secondes, et, l’obstacle vaincu par la force du courant, reprenait sa marche.
«Je me risque, Dick!» s’écria Pat. Et, retroussant son pantalon, enfonçant son chapeau sur sa tête, il monta sur le tronc renversé et s’avança d’un pas ferme, évitant habilement les petites branches qu’il rencontrait çà et là. Nous ne pouvions passer en même temps, et j’attendis sur le bord, surveillant Pat, qui bientôt arriva au centre de la rivière où, l’arbre s’enfonçant sous lui, l’eau lui monta jusqu’à mi-jambes. Il chancela un instant; mais il reprit son équilibre, et bientôt je le vis, à ma grande joie, atteindre la rive opposée sain et sauf.
Alors vint mon tour. Tant que je fus sur la partie la plus grosse de l’arbre, tout alla bien; mais lorsque j’arrivai au centre, et que sentant l’eau me battre les jambes, je ne pus voir bien distinctement où placer le pied, la sensation que j’éprouvai fut absolument le contraire d’agréable. Comme Pat, je m’arrêtai quelques secondes pour reprendre haleine; mais, en levant les yeux, je vis que l’île flottante approchait; je ne pouvais rester là une minute de plus; je repartis donc; mais juste au moment où je venais de passer l’endroit le plus difficile et où j’approchais de la rive, je butai contre une de ces maudites branches latérales et faillis tomber. Le cœur en cet instant fut près de me manquer, toutefois je réussis à regagner mon équilibre; mais cela me causa un tremblement nerveux, et je sentis que je ne pouvais continuer à marcher d’un pas aussi sûr qu’auparavant; je me décidai donc à courir, et, étant arrivé ainsi tout près de la rive, je tombai moitié à terre, moitié dans l’eau; mais Pat, qui m’attendait, me saisit par les épaules et m’arracha à l’étreinte mortelle du courant où j’avais été si près de périr. Quelques minutes plus tard arrivait l’énorme masse d’arbres déracinés, brisant comme une paille l’arbre qui nous avait servi de pont.
Une fois la rivière derrière nous, nous nous sentîmes fort à l’aise, et, marchant d’un pas rapide, nous arrivâmes en peu de jours à William’s Creek.
La première chose que nous fîmes fut de faire enregistrer notre claim chez le commissaire du gouvernement. Il nous fallut décrire aussi exactement que possible l’emplacement et payer les droits de cinq dollars. Nous nous occupâmes ensuite de réunir les provisions et les outils nécessaires. Nous ne désirions pour le moment nous associer personne, le travail de deux hommes étant suffisant pour l’exploitation d’un claim où il n’était pas nécessaire de creuser de puits profonds; mais nous ne manquâmes pas de faire part en secret de notre découverte à nos anciens associés de Jack of Clubs Creek, et nous les engageâmes fort à venir aussitôt que possible choisir des terrains et s’établir auprès de nous.
Ce qui nous causait le plus d’embarras était de savoir comment transporter nos outils et nos provisions. Notre claim était à plusieurs journées de marche, et c’était tout ce qu’un homme pouvait faire que de porter jusque-là de quoi se nourrir en chemin. Il était donc évident que nous ne pouvions nous passer de mulets, et pour cela il nous fallait l’aide d’un marchand. Je frappai à plusieurs portes et n’essuyai que des refus. A la fin, je trouvai un juif allemand nommé Schwartz, qui avait ouvert récemment boutique et venait de recevoir du bas pays un certain nombre de mulets. Nos récits et la vue de notre or, qui ne ressemblait nullement à celui qu’il avait vu jusque-là (les marchands et les mineurs expérimentés savent très-bien dire à première vue de quelle creek du voisinage vient l’or qu’on leur montre), l’excitèrent au plus haut point; mais nous eûmes de la peine à nous entendre. Il voulait d’abord avoir, en échange des provisions et des outils qu’il fournirait, la moitié de tout ce que nous trouverions. Nous n’entendions point de cette oreille, et il eut beau nous raconter comment il avait été maintes fois victime de sa confiance, cela ne nous toucha nullement.
Enfin, après bien des débats, notre juif devenant plus raisonnable, nous conclûmes l’arrangement suivant: il s’engageait à nous fournir dix mulets avec leur chargement de provisions et d’outils, et à nous accompagner avec un seul homme qu’il laisserait avec nous pour veiller à ses intérêts; de notre côté, nous nous engagions à prendre 100 mètres carrés de terrain pour lui près des nôtres, à ne faire des 300 mètres carrés qu’un seul claim, et à payer, sur le produit brut de notre travail, 10 dollars par jour à l’homme qui le représenterait.

Le chemin devint très-mauvais.
![]()
Nous nous gardâmes bien de dire à cet homme où nous allions, de crainte qu’il ne commît quelque indiscrétion; et le lendemain matin, après avoir chargé nos mulets de tout ce qui nous était nécessaire, nous partîmes en suivant le cours de la William’s Creek pour gagner Antler Creek, source de la rivière de l’Ours, par une route différente et moins connue que la route ordinairement suivie. Nous ne manquâmes pas cette fois d’emporter deux bonnes carabines que Schwartz nous procura et une provision de poudre, de balles et d’autres munitions.
Le premier jour, le chemin fut assez praticable; mais les deux jours suivants il devint très-mauvais; nous ne pûmes faire qu’une douzaine de milles, et malgré cela nos pauvres animaux étaient horriblement fatigués. Nous arrivâmes enfin à un endroit situé à deux milles au-dessus de notre creek, sur le bord opposé du cours d’eau principal. Pendant notre absence, la neige avait fondu dans le haut pays et la rivière avait repris son niveau habituel: nous n’éprouvâmes aucune difficulté à construire un radeau. Nous eûmes deux ou trois traversées à faire pour transporter nos animaux et nos provisions de l’autre côté, ce qui, avec les allées et venues, nous prit encore quelques jours.
Une fois arrivés à notre claim, nous abattîmes des arbres pour construire une confortable hutte qui fut bâtie en trois jours; puis, comme c’était convenu, je laissai Pat et le représentant de Schwartz compléter la cabine, couper des planches pour les vannes et creuser un fossé pour amener une rigole à l’endroit où nous voulions travailler, et je retournai à William’s Creek pour y reconduire les mules. Cela fait, je revins en hâte me remettre au travail.
A mon retour, je trouvai la cabine finie, et l’eau amenée sur les lieux par une suite d’écluses complétées le jour précédent et dans lesquelles Pat et Jim (l’homme de Schwartz) jetaient à tour de rôle des pelletées de cette boue dans laquelle était cachée notre fortune future. Ils avaient, durant mon absence, travaillé comme des nègres.
Pendant trois mois nous ne vîmes personne; mais à la fin du troisième mois Schwartz vint accompagné d’un homme, nous amenant cinq chevaux chargés de provisions fraîches et d’outils neufs dont nous commencions à avoir grand besoin. Nous avions amassé un joli tas de poussière d’or; Pat partit avec Schwartz pour placer notre trésor à la banque.

Exploitation des mines d’or, dans le Caribou.
![]()
Plusieurs de ces individus qui sont toujours à l’affût des nouvelles eurent vent de cette seconde expédition, et peu après le retour de Pat nous eûmes une invasion de vingt à trente mineurs, à la tête desquels je reconnus l’homme même que Schwartz avait amené avec lui. Mais il ne nous molestèrent en aucune façon, et se mirent diligemment au travail. Au reste, il y avait amplement de la place pour nous tous, et nous fûmes plutôt satisfaits que contrariés de les voir s’établir près de nous. Notre petite colonie, avec ses six ou sept huttes de troncs d’arbres, ne manquait pas d’animation; les bords du ruisseau offraient même le spectacle d’une grande activité; tous les travailleurs étaient à l’ouvrage, piochant la terre, lavant les roches, triant le minerai.
A la fin de la saison, notre claim étant presque épuisé, nous cédâmes notre terrain à un prix très-modéré à quelques-uns de nos anciens amis qui étaient venus s’établir auprès de nous.
Par un hasard assez fréquent dans la recherche aventureuse des gisements aurifères, la partie de la creek sur laquelle était tombé notre choix se trouva de beaucoup la plus riche du voisinage, et au bout de cinq mois de travail nous avions amassé une somme très-considérable.
Lorsqu’on sut que nous étions devenus riches, on nous fit à Victoria l’accueil le plus sympathique et l’on nous entoura d’un respect tout particulier. Le journal auquel j’avais autrefois collaboré publia quelques articles où Pat et moi étions désignés comme «deux des principaux et des plus entreprenants pionniers»; mais lorsqu’on sut que nous n’avions point l’intention de semer sur les lieux les richesses que nous venions d’acquérir, on changea de ton, et le journal se livra à une véritable explosion d’indignation contre «ces avides et ingrats personnages qui viennent faire leur fortune dans le pays et s’en vont la dépenser ailleurs».
Pat fut de beaucoup le plus sage de nous deux. L’ambition n’était point un des traits dominants de son caractère; et c’est pourquoi, se voyant désormais riche pour la vie, il se fit habiller convenablement, se munit de tout ce qui pouvait lui être utile ou agréable durant la traversée, et prit un passage de première classe sur un navire qui retournait en Irlande. Deux ans plus tard il m’écrivit pour m’apprendre que sa fiancée Brigitte et lui étaient mariés et possédaient une jolie petite propriété située non loin du lieu de sa naissance. Il m’engageait fort à l’imiter, et ajoutait, dans le langage imagé d’un vieux mineur, que si je voulais abandonner l’exploration des montagnes du Far West pour celle de sa propriété, j’étais sûr d’y trouver, sans longues recherches, le roc solide de sa vieille affection. Il me faisait les amitiés de Brigitte, et me disait qu’en dépit du regret qu’elle avait eu de donner à son premier enfant «le nom saxon et païen de Richard», elle l’avait cependant ainsi baptisé en souvenir de moi et de mon amitié pour son mari.
Pour ma part, je n’avais nullement le désir de rentrer de sitôt au pays et de faire une fin. Je me livrais alors avec acharnement à la spéculation, et j’avais déjà amassé une grande fortune; mais le sort ne me fut pas longtemps favorable et je perdis une grande partie de mon avoir. J’eus le bonheur toutefois de retrouver mon vieil ami le capitaine, qui n’avait pas été fort heureux dans ses dernières entreprises; et ce fut pour moi une grande joie de pouvoir lui témoigner ma reconnaissance et lui venir en aide à mon tour.
Après un hiver agréable à Victoria, je partis, avec un de mes vieux amis, pour San-Francisco, d’où je comptais aller explorer le riche district argentifère de Washoe, et c’est au moment d’entreprendre cette nouvelle expédition que je ferme ce volume et dis adieu à ceux de mes lecteurs qui ont bien voulu me suivre jusqu’ici.
FIN
PARIS.—IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.
| CHAP. Ier. | Le départ | 1 |
| II. | San-Francisco | 18 |
| III. | L’arrivée | 32 |
| IV. | L’île Vancouver | 46 |
| V. | En remontant le Fraser | 55 |
| VI. | En route pour les mines | 68 |
| VII. | La vallée de la Thompson | 84 |
| VIII. | Les voleurs de bestiaux | 91 |
| IX. | William’s creek | 100 |
| X. | Navigation sur le Fraser | 116 |
| XI. | Nos vacances | 128 |
| XII. | Une expédition dangereuse | 139 |
| XIII. | Un hiver à Victoria | 151 |
| XIV. | Seconde saison aux mines | 160 |
| XV. | Nouvelles aventures | 174 |
| XVI. | Une triste aventure | 189 |
| XVII. | A la découverte de l’or | 208 |
| XVIII. | La dernière chance | 222 |
| Conclusion | 243 |
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES
PARIS.—IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79, A PARIS
LE JOURNAL DE LA JEUNESSE
NOUVEAU RECUEIL HEBDOMADAIRE
POUR LES ENFANTS DE 10 A 15 ANS
PUBLIÉ
PAR LA LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
Et très-richement illustré par les plus célèbres artistes
PROSPECTUS
Ce nouveau recueil hebdomadaire est spécialement destiné aux jeunes gens et aux jeunes filles de dix à quinze ans.
Il forme, chaque semaine, une magnifique livraison de seize pages imprimées sur deux colonnes, contenant environ 1200 lignes de texte et de belles gravures d’après nos meilleurs artistes. La première partie est consacrée aux œuvres d’imagination, aux voyages; l’autre, à ces mille notions de science, d’art, d’industrie, qu’il est si utile de présenter à la jeunesse et qui l’intéressent d’autant plus, qu’elles lui sont présentées avec tout l’attrait de l’actualité.
Les trois premiers semestres du Journal de la Jeunesse forment trois magnifiques volumes in-8º, richement illustrés par les plus célèbres artistes.
Ces volumes sont les livres les plus attrayants et les plus instructifs que l’on puisse mettre entre les mains de la jeunesse. Il suffira de jeter un coup d’œil sur le rapide énoncé des principaux articles qui les composent pour se convaincre que le Journal de la Jeunesse a fidèlement observé le programme qu’il s’était proposé.
MATIÈRES CONTENUES DANS LES PREMIERS VOLUMES DU
JOURNAL DE LA JEUNESSE
Nouvelles, contes, récits.—Les Braves gens, la Ferme des Quatre Chênes, Panade, la Terre de Servitude, par J. Girardin; Une sœur, par Mme de Witt; En congé, par Mlle Fleuriot; Gertrude, par la comtesse de Sannois; la Récompense partagée, le Marchand de Venise, le Sultan et les Fauvettes, le Chasseur indien, par Ét. Leroux; le Chien de Newton, l’Énigme du sphinx, une Réhabilitation, une Mouche qui vole, par Mlle Marie Maréchal; la Fille aux pieds nus, les Hirondelles de mon oncle, par Eug. Muller; le Tailleur de pierres, Tamerlan et la fourmi, le Cadi du Caire, par P. Vincent; le Poisson d’avril, le Parapluie omnibus, par J. Levoisin; le Violoneux de la Sapinière, la fille de Carilès, par Mme Colomb, etc.
Causeries.—Le Jury, Incendies et pompiers, Oberkampf, les Oranges, une Croisade d’enfants, Copernic, la Monnaie, Bonjour, les Jeux floraux, l’Hôtel de Ville, les Écoliers soldats, la Jambe de bois, par l’oncle Anselme, le Parapluie, le Jeu d’échecs, par P. Vincent; le Bal costumé, par J. Levoisin; le Panorama des Champs-Élysées, une Chasse aux crocodiles en Cochinchine, par Claparot; l’Hôtel des Invalides, par Louis Rousselet, etc.
Géographie, voyages, aventures.—Dans l’extrême Far-West, par Johnson; Livingstone, par R. Cortambert; la Marine française et les pirates chinois, Éruption du Mauna Loa, Henry Stanley, les Mines de diamants du Cap, les Sources du Nil, Sir S. Baker, le Turkestan, la Guinée, l’Indo-Chine, par Louis Rousselet; les Naufragés du détroit de Magellan, le Sahara algérien, un Nouveau Robinson Crusoé, les Modocs, les Indes hollandaises, par Ét. Leroux; les Premiers explorateurs des régions arctiques, l’Expédition du capitaine Hall au pôle Nord, l’Équipage du Polaris, les Naufragés au Spitzberg, le royaume de Dahomey, par Lucien d’Elne; la Grotte d’Adelsberg, par Louis Énault, etc.
Histoire naturelle, zoologie, botanique.—Le Cormoran, le Pélican, l’Amour maternel chez les oiseaux, par E. Menault; l’Hippopotame du Jardin zoologique, le Hamster, l’Autruche, le Bouquetin du Tyrol, les Invasions de sauterelles en Algérie, la Taupe, la Pêche du hareng, le Départ des hirondelles, l’Éléphant, le Calmar, par Th. Lally; un Perroquet centenaire, le Cresson, le Mégathérium, par H. Norval; le Jardinage de la jeunesse, par L. Châtenay; les Oiseaux gigantesques, par Marcel Devic; la Mer chez soi, l’Aquarium d’eau douce, par H. de la Blanchère; le Phylloxera, par Albert Lévy, etc.
Astronomie.—La Terre rencontrée par une comète, la Planète Vénus, l’Éclipse du 26 mai, Comment on mesure la distance du soleil à la terre, par A. Guillemin.
Inventions, découvertes.—Les Bateaux à vapeur de la Manche, par A. Guillemin; les Dépêches microscopiques et les Pigeons voyageurs, Impressions de voyage en ballon, le Professeur Charles, par G. Tissandier; la Bouée de l’espérance, par Ét. Leroux; un Nouvel appareil de sauvetage, le Pyrophone, par A. Lévy; un Fanal inextinguible, une Mine de gaz d’éclairage, les Omnibus, par P. Vincent; les Navires cuirassés, par Léon Renard; le Chemin de fer du Rigi, le Scaphandre, par H. Norval, etc.
Causeries industrielles.—La Laine, le Coton, Thomas Highs ou le Métier à filer le chanvre, par Eug. Muller; Comment on obtient la glace dans l’Inde, par Louis Rousselet; Les Huiles de pétrole, par G. Tissandier; Comment se fait une aiguille, les Vendanges, Emploi de l’air comprimé, les Eaux de Paris, par P. Vincent; les Bonbons, par H. Norval.
Actualités, contemporains, variétés.—Les Inondations, par A. Guillemin l’Incendie de Boston, par R. Cortambert; le Naufrage du Northfleet, la Famille Durand à l’Exposition de Vienne, par Eug. Muller; Découvertes au Forum romain, par Fr. Wey; les Cyclones, par G. Tissandier; l’Exposition de Vienne, les Bohémiens, une Réception à Péking, par L. Rousselet; le Naufrage de l’Atlantic, le Tremblement de terre de San-Salvador, Horace Greeley, le Voyage du chah de Perse, par P. Vincent; l’Ouverture de la chasse, l’Exposition des races canines, par Th. Lally; les Funérailles d’un roi indien, Agassiz, Livingstone, Latour d’Auvergne, Kaméhaméha V, par Ét. Leroux; l’Arc, par H. de la Blanchère; Paganini, Nélaton et Coste, par H. Norval, etc.
CONDITIONS ET MODE DE LA PUBLICATION
LE JOURNAL DE LA JEUNESSE paraît le samedi de chaque semaine à partir du 7 décembre 1872. Chaque numéro, imprimé sur deux colonnes par M. Martinet, contient 16 pages de texte et de gravures, et est protégé par une couverture.—Le prix du numéro est de 40 centimes.
Chaque année de la publication forme deux beaux volumes in-8º richement illustrés. Prix de chaque vol.: broché, 10 fr., cartonné en percaline rouge, tranches dorées, 13 fr.
PRIX DE L’ABONNEMENT
POUR PARIS ET LES DÉPARTEMENTS
| Un an (2 volumes) | 20 | FRANCS |
| Six mois (1 volume) | 10 | — |
Les abonnements ne se prennent que pour un an ou six mois, du 1er décembre et du 1er juin
ON S’ABONNE A PARIS
A la Librairie HACHETTE et Cie, boulevard Saint-Germain, 79
ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DE LA FRANCE ET DE L’ÉTRANGER
PARIS.—IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
NOTES:
[A] Le Far West (Grand Ouest) est le nom donné en anglais aux pays qui s’étendent du Mississipi et des grands Lacs jusqu’au rivage de l’océan Pacifique.
[B] Sorte de thon à ventre rayé qu’on trouve dans les mers intertropicales.
[C] Le lecteur doit se souvenir qu’en Amérique les wagons, au lieu d’être des voitures fermées et séparées les unes des autres comme sur les lignes d’Europe, communiquent ensemble au moyen de passerelles et sont traversés par un couloir qui permet aux voyageurs de circuler d’une extrémité à l’autre du train.
[D] Boisson faite d’eau glacée, de sucre, d’eau-de-vie et de feuilles de menthe que l’on y laisse infuser pendant quelques minutes.
[E] Oncle Sam et cousin Jonathan sont les sobriquets donnés aux Américains des États-Unis par les Anglais, qui portent eux-mêmes celui de John Bull.
[F] Cette loi, ou plutôt cette coutume sauvage, n’est que l’application par la collectivité du droit primitif de défense individuelle. A défaut de tribunal, le peuple s’assemble, constate le flagrant délit et pend le coupable sans autre forme de procès. Il n’est pas rare que, dans les pays nouvellement occupés, on soit obligé d’avoir recours à cette justice sommaire.
[G] Les touts ou touters sont les commissionnaires qui se trouvent à l’arrivée des trains ou bateaux pour recommander les hôtels aux voyageurs.
[H] C’est le nom que les habitants donnent, par abréviation, à San-Francisco.
[I] Chapeau espagnol à larges bords.
[J] Manteau américain fait d’une couverture de couleur au milieu de laquelle on a ménagé une ouverture pour la tête.
[K] Cañon, en espagnol, signifie tuyau et s’emploie aujourd’hui, dans l’Amérique du Nord, pour désigner les gorges, cols ou défilés des montagnes.
[L] Ce procédé nous paraît ressembler fort, sauf l’usage de la Yeast powder, levûre en poudre, à celui que, de temps immémorial, suivent nos paysans de la Bretagne et du Limousin, pour faire leurs galettes de farine de blé noir. (Note du traducteur.)
[M] Placer, nom donné par les Espagnols aux gisements de métaux précieux, et appliqué depuis aux mines d’or.
[N] Le pied anglais n’a que 0m,30.
[O] Abréviation de Peter, Pierre.
[P] Le verbe to rustle signifie frôler, braire, et, au figuré, se pavaner. Rustle, dérivé de to rustle, veut dire, au fond, en imposer, gagner sa vie en faisant croire à des ressources que l’on n’a point. (Note du traducteur.)
| On a effectué les corrections suivantes: |
|---|
| se destination=> sa destination {pg 6} |
| retourner de ce pas en Califournie=> retourner de ce pas en Californie {pg 38} |
| lui demandai s’ii avait examiné=> lui demandai s’il avait examiné {pg 106} |
| ceux qui proviennait=> ceux qui provienait {pg 143} |
| cette avanture=> cette aventure {pg 182} |
| marche très-penible=> marche très-pénible {pg 208} |
| à Wiliam’s Creek=> à William’s Creek {pg 222} |
| nous fûmes plutôt satisfait=> nous fûmes plutôt satisfaits {pg 241} |
| haranguait une une foule=> haranguait une foule {pg 190} |
End of Project Gutenberg's Dans l'extrême Far West, by Richard Byron Johnson
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DANS L'EXTRÊME FAR WEST ***
***** This file should be named 42590-h.htm or 42590-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/2/5/9/42590/
Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
book was produced from scanned images of public domain
material from the Google Print project and The Internet
Archive/Canadian Libraries.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.