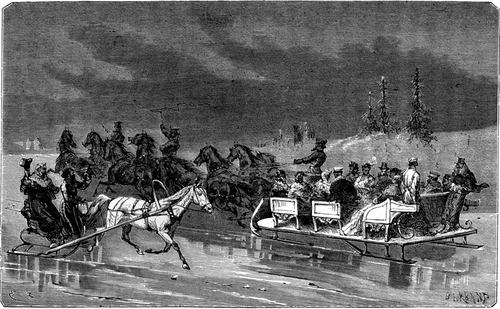
Fig. 1.—Traîneau impérial à Saint-Pétersbourg.
BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES
PAR
E. DEHARME
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 77 VIGNETTES
PAR
B. BONNAFOUX, A. JAHANDIER ET A. MARIE
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
1874
Droits de propriété et de traduction réservés
BIBLIOTHÈQUE
DES MERVEILLES
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION
DE M. ÉDOUARD CHARTON
LES MERVEILLES
DE LA LOCOMOTION
PARIS.—IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.
Tout est mouvement dans la nature. Que nos yeux se dirigent sur la terre ou s'élèvent vers le ciel, ils ne voient que mouvement et progrès. Ici, des transformations géologiques, des îles qui s'abîment et des volcans qui jaillissent, une mer immense montant soir et matin; des graines qui germent et des forêts qui s'élèvent; et, pour régner sur ce monde, des animaux qui s'y agitent sans cesse; le tout emporté dans l'espace d'un mouvement régulier, dont nous ne pouvons prévoir la fin. Là haut, ce sont des mondes dont (p. 2) les révolutions s'exécutent avec la même régularité et dont les mouvements sont liés à celui de notre planète comme celui-ci l'est aux leurs, tous ces mouvements enchaînés par cette loi fatale que la chute d'une pomme a révélé au génie de Newton et qui s'appelle l'attraction universelle.
Quels sont les caractères qui différencient ces mouvements et nous font apparaître la vie sous ces divers aspects?
Nous voyons les corps du règne minéral (ils sont 70 à peine) s'unir les uns aux autres, en obéissant à leurs affinités réciproques,—ces affections de la matière,—et constituer l'infinie variété de corps que la chimie et la minéralogie apprennent à connaître. Nous les voyons changer de forme et se mouvoir, passer d'un état d'équilibre à un autre, jaillir en gerbe au-dessus du sol, bondir en cascades ou s'écouler paisiblement vers l'Océan, en se soumettant aux lois physiques sur lesquelles repose l'harmonie de l'univers. Tous ces mouvements, les uns passagers, les autres permanents, ont lieu avec une passivité absolue de la part des corps qui les exécutent.
Mais ce caractère se modifie dans le règne végétal, et les mouvements de certaines plantes deviennent instinctifs. C'est ainsi que les feuilles se dirigent du côté d'où leur viennent l'air et le soleil, que les racines se cramponnent au morceau d'engrais qui leur apporte une nourriture plus riche; qu'au moment de la floraison, les étamines embrassent le pistil et que certaines (p. 3) plantes quittent le fond des eaux pour venir éclore leur fleur à la surface.
L'intelligence enfin, s'élevant au-dessus de l'instinct aveugle, se révèle chez les animaux, et c'est, non-seulement dans leurs rapports avec l'homme, mais encore dans leur vie privée qu'on en voit des preuves irrécusables. Leurs mouvements ne sont plus automatiques, ni instinctifs, ils sont raisonnés, conscients.
Au-dessus de ces êtres des trois règnes, dont les déplacements ne sont que des infiniment petits auprès des mouvements accomplis dans l'espace par les mondes qui les portent, s'élève l'homme, soumis comme eux aux forces naturelles et à l'instinct qui les guide, mais possédant à un degré supérieur l'intelligence qui règle chacun de ses pas.
Mais cette intelligence, en étendant son empire, rend ses membres impuissants à lui en faire parcourir les différentes parties. Ses seuls efforts ne peuvent le conduire bien loin. Il use de sa supériorité sur tous les êtres de la création pour les soumettre à ses volontés, et, si les animaux eux-mêmes ne le servent pas assez selon ses désirs, il asservit les forces naturelles, les dompte comme il a fait de ces animaux, s'en fait souvent un levier sur lequel il s'appuie pour courir sur la terre ou pénétrer dans son sein, pour franchir l'Océan ou s'enfoncer dans ses eaux, ou bien enfin pour s'élever dans l'air.
Être supérieur vis-à-vis de tous les autres êtres de la création, c'est, il est vrai, un pygmée vis-à-vis du Créateur lui-même, mais un pygmée grandissant sans (p. 4) cesse et pour qui le progrès est une loi aussi fatale que le mouvement est un besoin inné.
Nous nous proposons de faire connaître dans ce livre les moyens les plus remarquables employés par l'homme pour se mouvoir sur la terre ou dans la terre.
Tandis que la plupart des animaux ne peuvent vivre que dans un milieu spécial et peu étendu, l'homme est moins qu'aucun d'eux l'esclave de ses habitudes. S'il aime ses dieux lares et le ciel de sa patrie, il peut cependant changer de gîte et de climat pour son intérêt, pour ses plaisirs même.
Les insectes ont chacun leur loge secrète, ceux-ci dans la terre, ceux-là dans le tissu des végétaux ou des animaux; les poissons ne peuvent vivre que dans l'eau: froide pour ceux-ci, tempérée pour ceux-là, douce pour les uns, salée pour les autres, calme au sein des lacs, agitée au cours des torrents, coulant en mince filet dans les petits ruisseaux, dormant en grande masse dans les bas-fonds de l'Océan. Le lion et la panthère se plaisent au désert, l'ours blanc au milieu des glaces des mers polaires, le serpent et la chauve-souris dans l'atmosphère lourde et viciée des cavernes, le condor dans l'air raréfié des plus hauts pics de la Cordillère des Andes; c'est enfin pour vivre toujours dans une atmosphère tempérée que l'hirondelle regagne à l'approche de l'hiver les pays du soleil et revient, avec les feuilles, faire son nid sous le toit qui l'a abritée pendant ses premières années.
(p. 5) Les grandes agglomérations humaines se sont fixées dans les pays tempérés, mais les régions équatoriales et polaires sont aussi habitées, et si l'Abyssin et le Lapon ne quittent pas leur pays, ils sont visités souvent par les Européens. L'homme se lance sans crainte sur l'Océan, et s'il ne peut, comme les sirènes, vivre aussi facilement dans l'eau que dans l'air, il sait plonger au sein de la masse liquide pour y cueillir le corail et les huîtres perlières aussi aisément qu'il s'enfonce dans la terre à la recherche du charbon et des métaux précieux. Grâce aux procédés ingénieux qu'il emploie pour varier ses vêtements et sa demeure, il vit dans l'air humide des mines comme dans l'air comprimé du scaphandre ou dans l'air raréfié des hautes régions de l'atmosphère où le portent les aérostats.
Avec de l'air en provision, il peut tout braver: les miasmes délétères des exploitations souterraines, l'inconnu des vallées sous-océaniques, le feu même.
Pour des courses longues et souvent aventureuses, les jambes de l'homme sont trop fragiles et trop courtes, et celles des animaux doivent lui venir en aide. Le chameau sert de monture et de bête de somme, le bœuf est bête de trait, et le cheval sert à la fois aux deux usages.
(p. 6) À côté de ces animaux viennent s'en placer quelques autres, utilisés seulement en certains pays, ou consacrés à des usages spéciaux: l'âne et le mulet sont les auxiliaires du cheval, mais moins forts, ils rendent de moindres services; l'hémione remplace ce dernier dans l'Inde; le yack et le bison, parents du bœuf, peuvent le suppléer dans certains cas; l'éléphant sert de monture dans l'Inde, le chameau dans le désert et l'autruche dans quelques parties de l'Afrique; le renne et le chien sont enfin les bêtes de trait des pays glacés.
Tels sont, en résumé, les animaux dont l'homme a emprunté le secours. Mais les plus puissants d'entre eux ne portant encore que des charges bien faibles, il a fallu pour transporter de lourds fardeaux recourir à la voiture.
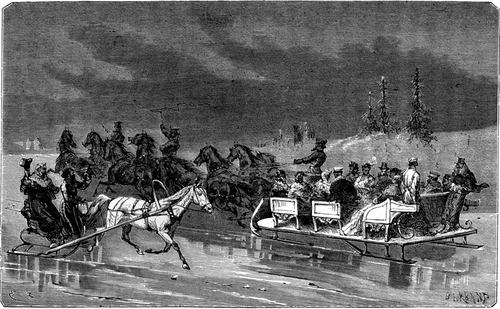
Fig. 1.—Traîneau impérial à Saint-Pétersbourg.
C'est à Cyrus que l'invention en est généralement attribuée; mais il est très-permis de croire que l'emploi des roues a été habituel de temps immémorial en plusieurs points de la terre, et l'on peut rechercher quels ont été les faits ou les idées qui ont dû conduire à cette simple découverte. Il est vraisemblable que, ne pouvant charger telle bête de somme de tout le fardeau qu'il avait à lui imposer, l'homme aura imaginé de les lui faire tirer. De là le traîneau, qui, selon toute probabilité, a été le point de départ de la voiture. Quelques pierres auront été placées sous le véhicule improvisé, peut-être même des pièces de bois de forme arrondie, des rouleaux enfin, différant peu de ceux qui servent dans nos chantiers de construction (p. 9) actuels pour le transport des lourds matériaux, pierre, bois ou fer; et des rouleaux à la roue, la transition est simple. La roue n'est qu'une tranche du rouleau, rendue plus légère par des évidements intelligemment ménagés, et plus résistante grâce à une ferrure destinée à la garantir de l'usure et des chocs produits par les inégalités du chemin.
Cette série d'hypothèses, d'ailleurs très-naturelles, se trouve parfaitement justifiée par la forme des roues des premiers chars dans l'antiquité, forme rudimentaire que l'on retrouve encore aujourd'hui, dans toute sa simplicité, aux roues des chariots catalans entre autres. Ces roues sont de simples disques ferrés, ayant 4 ou 5 centimètres de largeur, assujettis d'une façon grossière au véhicule qu'ils supportent et produisant dans les chemins montueux des Pyrénées un bruit strident et criard que prolonge encore la lente allure des bœufs qui y sont attelés.
Le traîneau, cet état primitif du plus somptueux de nos carrosses ou de nos wagons d'aujourd'hui, est d'ailleurs utilisé avec avantage dans plusieurs pays, et notamment dans les contrées septentrionales et dans les pays de montagnes.
Dans les contrées septentrionales, deux raisons principales en ont maintenu et en maintiendront l'usage: la dureté de la terre glacée et l'absence ou la rareté des voies de communication. Quel que soit l'objet qu'on ait à faire mouvoir sur le sol, on favorisera son mouvement en réduisant le frottement qui se produit lorsqu'on cherche à le déplacer, frottement (p. 10) qui dépend tout d'abord de la nature des surfaces en contact. Le sol glacé des pays du Nord se prête merveilleusement à ce déplacement. Les surfaces du patin et du sol acquièrent par l'usage un poli essentiellement favorable au mouvement. Qu'arriverait-il si des roues étaient substituées aux longs patins de glissement? Elles pénétreraient dans la neige au lieu de rester à la surface et deviendraient un obstacle à la marche. Le véhicule procéderait par ressauts et par saccades, se fatigant lui-même, fatigant ceux qui y seraient placés et la bête qui le tirerait. Le traîneau, en abaissant le centre de gravité du véhicule presque au niveau du sol, et en lui fournissant une large base de sustentation, empêche ces accidents de se produire. Le traîneau passe partout, la roue sur les bons chemins seulement.
Tout le monde connaît le sabot qu'employaient nos anciennes diligences. À la montée d'une côte, tous les voyageurs descendaient et suivaient au pas le véhicule pesamment chargé. À la cime, on remontait en voiture, le sabot était assujetti sous l'une des roues de derrière pour descendre le versant et les chevaux partaient. La voiture devenait momentanément un traîneau: trois des roues conservaient leur liberté et le frottement de roulement de la quatrième était transformé en frottement de glissement. C'est en traîneau qu'on faisait une partie de la traversée du Mont-Cenis, avant que le chemin de fer de Fell, qui a précédé l'ouverture du souterrain, fût établi.

Fig. 2.—Traîneaux à New-York.
Les forêts, dans les pays de montagnes, sont exploitées (p. 13) de la sorte. De jeunes arbres, ou même des branches à peine dégrossies, réunis par quelques liens tordus, servent à improviser un traîneau, qui est démembré à l'arrivée ou que le charbonnier remonte sur ses épaules. Le lit d'un ravin est le chemin suivi; les pierres roulent sous le véhicule et descendent avec lui. C'est en traîneau qu'on fait parcourir aux touristes certains passages rapides des Alpes ou des Pyrénées. Une de ces descentes renommées est celle de Brame-Farine, près d'Allevard, dans le département de l'Isère.
Avant de décrire la première de ces voitures à roues dont l'invention a été un progrès considérable demeuré sans date dans l'histoire de la locomotion, arrêtons-nous pour esquisser rapidement les faits si intéressants qui expliquent l'avantage de la voiture sur le traîneau, puis du wagon de nos chemins de fer sur la voiture elle-même.
Tous les progrès de la locomotion reposent sur les améliorations apportées aux deux surfaces en contact durant le mouvement: patin et roue d'une part, chaussée ou rail d'une autre. Les améliorations introduites dans la construction du véhicule lui-même n'ont été que la conséquence des premières. L'emploi de la vapeur (p. 14) comme moteur a marqué une nouvelle étape que nous décrirons avec tous les développements qu'elle comporte.
Lorsqu'on examine à la loupe les objets les mieux polis, on aperçoit à leur surface une innombrable quantité d'aspérités et de cavités, qui forment, entre deux objets rapprochés, comme autant de petites dents d'engrenage s'enchevêtrant les unes dans les autres. Chacun des deux objets agit sur celui qui lui est opposé comme un morceau de pierre ponce sur notre main. Il y a entre eux:
1o Production d'une résistance au mouvement qu'on veut déterminer et qui est le frottement;
2o Destruction des aspérités existantes, polissage des surfaces, d'où usure.
C'est l'effet qui se produit lorsqu'on pousse un dé d'ivoire sur le drap d'un billard. L'impulsion cessant, le dé s'arrête; mais si au dé on substitue une bille, la moindre impulsion produit un mouvement qui se prolonge encore après que l'action a cessé d'être exercée. Le frottement n'est pas détruit, il est seulement réduit par le changement de forme de la surface. Dans le premier cas, il y avait frottement de glissement, dans le second, il y a frottement de roulement.
Si, au lieu de placer cette bille d'ivoire sur une table recouverte de drap, nous la plaçons sur une table polie de bois ou de métal, une impulsion bien moindre que la première suffira à lui faire parcourir le même chemin.
Ces faits, tout simples et tout familiers, que nous (p. 15) venons d'observer sur une petite échelle, se produisent en grand.
Qu'un traîneau glisse sur le sol, qu'une voiture roule sur une chaussée, ou un wagon sur des rails, qu'un bateau se meuve sur l'eau ou un ballon dans l'air, il y a frottement. Une force se développe, au moment où le mouvement commence, de la part du sol, de l'eau ou de l'air avec lequel le véhicule est en contact. Elle est faible, presque insignifiante dans l'air, elle n'est pas négligeable dans l'eau, ou à sa surface, et prend des valeurs très-diverses et parfois considérables sur le sol. En somme, on peut dire, d'une manière générale, que toutes les fois que deux corps, en contact, viennent à être animés de vitesses variables,—ou l'un d'une certaine vitesse, l'autre restant à l'état de repos,—il se produit une force retardatrice du mouvement, et il y a frottement.
Quelles sont les lois du frottement? Les géomètres et les ingénieurs ont cherché beaucoup et longtemps, et cherchent encore, car les opinions les plus opposées se sont produites. Nous n'avons pas l'intention de les relater toutes ici; mais il convient d'indiquer les faits principaux, ceux sur lesquels on est généralement tombé d'accord et qui sont, par suite, hors de conteste.
Amontons est le premier qui s'occupa de la recherche des lois du frottement. Il se servait, pour ses expériences, d'un plan mobile autour d'une charnière et dont il faisait varier l'inclinaison. Mais les résultats auxquels il fut conduit paraissent contradictoires. Coulomb, en 1781, reprit ces recherches.
(p. 16) Sur deux madriers horizontaux juxtaposés était fixé un troisième madrier en chêne, long de 8 pieds, large de 16 pouces. Un traîneau, en forme de caisse, de 18 pouces de large, qu'il chargeait de poids, pouvait glisser sur ce dernier madrier et le parcourir dans sa longueur. Une corde flexible, attachée au traîneau, venait, dans une direction horizontale, s'enrouler sur la gorge d'une poulie très-mobile. Un plateau attaché à son extrémité recevait des poids et pouvait descendre dans un puits de 4 pieds de profondeur. Les poids, successivement placés dans le plateau, déterminaient le mouvement du traîneau. Un pendule, battant les demi-secondes, permettait d'étudier ainsi la loi du mouvement. La nature et l'étendue des surfaces frottantes, modifiées tour à tour, donnaient le moyen de varier à l'infini les conditions de ces expériences.
Le général Morin, en 1831, M. J. Poirée, en 1851, M. Bochet, en 1856 d'abord, puis en 1861, ont repris et étendu les études commencées par Coulomb.
On admettait, avant les travaux de ces deux derniers ingénieurs, que le frottement était proportionnel à la pression normale que les surfaces exercent l'une sur l'autre, qu'il variait selon la nature et l'état des surfaces en contact, et qu'il était indépendant de la vitesse et de l'étendue de ces surfaces.
M. Poirée a démontré que pour des vitesses supérieures à 4 ou 5 mètres par seconde, le frottement diminuait à mesure que la vitesse augmentait.
Dans un mémoire fort intéressant, et à la suite de nombreuses expériences exécutées sur le chemin de (p. 17) fer de l'Ouest avec un wagon-traîneau du système Didier, M. Bochet a réfuté les premières lois admises et a conclu:
1o Que le frottement diminue à mesure que la vitesse augmente;
2o Que le frottement n'est plus proportionnel à la pression et, par suite, n'est plus indépendant de l'étendue des surfaces frottantes, dès que la pression cesse d'être petite;
3o Qu'il n'y a pas, en général, de frottement spécial au départ.
Ces nouvelles lois viennent renverser les opinions précédemment admises. Est-ce à dire, pour cela, qu'elles sont la dernière expression de la vérité et qu'elles ne souffriront pas de modification? Nous n'oserions pas l'affirmer.
On ne peut se faire une idée exacte des difficultés qui entourent l'exécution de ces expériences: les circonstances, en apparence les plus insignifiantes, exercent souvent une influence considérable, qui échappe même aux yeux les plus perspicaces, à l'attention la plus vigilante. L'observation de ces phénomènes, où la constitution moléculaire des corps est immédiatement en jeu, présente bien autrement d'obstacles que celle des faits chimiques où les qualités et les affinités particulières de ces mêmes molécules se révèlent.
Nombre d'opérations exécutées dans des circonstances en apparence complètement identiques, donnent des résultats différents et déroutent l'expérimentateur; (p. 18) nous disons: en apparence identiques, car nos yeux ou nos moyens de mesure ou de contrôle doivent nous égarer. Les deux morceaux de fer que nous faisons frotter l'un contre l'autre, bien qu'ils soient pris dans une masse que nous croyons homogène et qui a subi les mêmes opérations préparatoires, peuvent présenter, et présentent sans doute, des différences de contexture que nous ne pouvons saisir. Les fibres de tel morceau de bois ne sont pas dirigées comme celles de tel autre; les parties tendres sont plus nombreuses dans celui-ci que dans celui-là; l'état hygroscopique des deux échantillons est différent. En somme, l'homogénéité, l'identité, dans le sens le plus absolu et le plus général que l'on accorde à ces deux mots, n'existent pas. Les différences constatées n'offrent donc rien de surprenant.
Il en est absolument, de ce qui se passe entre ces deux morceaux de matière, comme de ce qui se produit entre deux individus de mœurs, de caractères et d'esprits bien définis et entraînés dans une action commune. Doutez-vous que les circonstances les plus inappréciables ne puissent agir sur leurs tempéraments à tous deux ou sur celui de l'un des deux seulement, et modifier d'une manière très-sensible le résultat auquel ils concourent tous deux? Est-il déraisonnable de croire que des influences d'une autre nature, mais tout aussi bien modificatrices, aient pu agir sur la constitution moléculaire des deux échantillons mis en contact, et n'est-il pas permis de supposer à ces atomes matériels et inertes une impressionnabilité que nous constatons chez les êtres vivants et matériels aussi?
(p. 19) Lorsque nous modifions, par l'interposition d'un nouveau corps ou par une altération quelconque des surfaces en contact, les conditions de ces expériences, nous obtenons les résultats les plus divers. Des aspérités, des stries, la juxtaposition sur l'une des surfaces de bandes de cuir ou de caoutchouc, en multipliant les points de connexion et d'enchevêtrement, créent un obstacle au mouvement, tandis que l'interposition d'un corps gras, de plombagine, de suif ou de telle ou telle huile, en unissant et en polissant les surfaces rapprochées, diminue le frottement. De là, l'avantage que l'on retire de l'emploi des matières lubrifiantes.
Le cri strident des chars catalans, dont nous avons parlé, celui de toutes les voitures dont les roues sont insuffisamment graissées, résultent d'une attaque plus ou moins profonde des surfaces en contact. Ce grincement est accompagné d'un échauffement de ces surfaces, qui, s'il n'y est porté remède, peut avoir les conséquences les plus graves.
Les faits que l'on constate dans l'étude du frottement de glissement s'observent dans celle du frottement de roulement, mais avec cette différence qu'ils sont moins accusés. Les aspérités de la surface roulante s'engrènent dans les cavités de la surface fixe et réciproquement, et le mouvement s'opère sans déterminer ces arrachements et ces érosions particulaires qui constituent, en grande partie, le frottement et qui exigent sans cesse, de la part du moteur, une production de force additionnelle. Les deux surfaces s'épousent successivement l'une l'autre, les petites aspérités (p. 20) abandonnent leur mutuelle étreinte avec d'autant plus de facilité qu'elles se sont plus facilement réunies, et que la pénétration a eu lieu dans une direction plus normale à la surface fixe, ou que le diamètre de la surface roulante a été choisi de plus grande dimension.
L'accroissement du diamètre des roues des véhicules, est, en effet, le but vers lequel tendent les constructeurs, mais divers obstacles les arrêtent, entre autres l'instabilité de la machine de transport, accrue par l'élévation de son centre de gravité. Ils cherchent alors des artifices pour abaisser la charge, ils la placent parfois en dessous des essieux, ainsi que cela s'est fait pour certaines voitures et pour quelques fardiers, destinés au transport des matériaux de construction, réalisant ainsi des combinaisons plus ou moins ingénieuses, et qui répondent d'une manière plus ou moins satisfaisante à des besoins déterminés.
Des préoccupations de l'ingénieur, la principale est celle qui a pour objet la diminution des aspérités des deux surfaces en contact. Tel est le but que remplissent les cercles garnissant les roues des véhicules, les semelles métalliques fixées aux patins des traîneaux. (p. 21) Pour diminuer les aspérités de la surface de roulement, on emploie les pavés de granit ou de grès ou les cailloux fichés dans une forme incompressible en sable et que les lourdes charges et les temps alternativement secs et pluvieux ne peuvent facilement déformer. On choisit les cailloux de la meilleure qualité pour les chaussées empierrées ou macadamisées, et avant de les livrer à la circulation des voitures, on a soin d'en comprimer la surface à l'aide de ces rouleaux tantôt en pierre, tantôt en métal, chargés de sable, de pavés ou d'eau et que remorquent péniblement de longs attelages de chevaux, ou, plus aisément, une machine à vapeur superposée. À cette chaussée imparfaite, aux ornières, aux aspérités ou aux dépressions plus ou moins profondes, on substitue des poutres ou longrines en bois, des morceaux de fonte ou des lames de fer et d'acier, et on a le merveilleux moyen de transport qui s'appelle un chemin de fer.
Adieu les durs cahots avec les vieilles pataches dans les mauvais chemins! adieu la musique des grelots au collier des chevaux, interrompue de temps en temps par les coups de fouet du postillon ou par la trompette du conducteur! adieu ces relations qui se nouaient au cours du voyage et se prolongeaient parfois après lui! On ne met plus que dix heures au lieu de onze jours, pour aller de Paris à Strasbourg. Quelques coups de sifflet et, comme en un songe, durant une nuit, on passe du Nord au Sud ou du Levant au Couchant.
(p. 22) Voyez-vous ce tombereau qui ne contient qu'une tonne de cailloux? Un cheval a peine à le tirer sur cette route bien entretenue. Voyez à côté: un même cheval fait avancer sur ces rails un wagon chargé de 8 à 10 tonnes.
Mais les rails de fer n'offrent pas de garanties de durée suffisantes lorsque la voie est très-inclinée et doit résister à l'usage réitéré des freins ou au passage fréquent de lourdes charges. Dans ce cas, on a recours aux rails d'acier. Les progrès de la carrosserie et du charronnage, nous le verrons plus loin, sont contemporains des progrès apportés à la construction des chemins et des routes, et le degré de civilisation d'un peuple est en rapport intime avec l'état de ses voies de communication. Que l'on considère les pays excentriques de notre Europe: la Russie, la Turquie, et, sans aller chercher si loin, l'Espagne, dont nous connaissons les chemins par les récits de Théophile Gautier et les dessins de Gustave Doré, ne trouve-t-on pas les mêmes ornières à l'esprit qu'à la chaussée? Le chemin de fer a contribué à faire le dix-neuvième siècle. Sans lui, nous n'aurions pas accompli ces progrès rapides que tout le monde admire.
Qu'on ne se méprenne pas cependant sur l'importance du rôle que peut jouer un chemin de fer et qu'on ne le croie pas capable d'opérer des transformations dans un pays qui n'offre des ressources ni par l'esprit ou l'industrie de ses habitants, ni par la richesse ou la fertilité de son sol. C'est pour avoir cru à la possibilité de semblables transformations que (p. 23) de nombreux chemins de fer, construits en pays étranger, n'ont produit d'autre résultat que la ruine de ceux qui les avaient construits, sans changer d'une manière notable la face des pays déshérités qui en avaient été dotés. Nous ne nous arrêterons pas, d'ailleurs, à cette question économique qui nous ferait sortir de notre sujet et n'a d'ailleurs rien que de très-facile à expliquer.
Les anciens avaient bien compris tout l'intérêt que peuvent offrir de bonnes voies de communication. Ils employaient à leur construction les peuples vaincus, et les établissaient avec une telle solidité qu'on en retrouve encore aujourd'hui quelques-unes en parfait état de conservation. Les voies romaines étaient remarquables par leur beauté et leur solidité. Elles étaient formées de blocs énormes de pierre de taille, parfois superposés, reposant sur une couche épaisse de béton, c'est-à-dire de pierres cassées réunies entre elles par un ciment très-résistant. Si nos pères ne connaissaient pas les causes de l'hydraulicité des chaux et des ciments révélées par Vicat, ils connaissaient du moins les mélanges capables d'acquérir par le temps une dureté comparable à celle de la pierre la plus résistante.
Les plus célèbres voies qui nous restent de l'antiquité sont celles qu'on connaît sous les noms de voies Appienne, Aurélienne, Flaminienne, etc. La première doit son nom au censeur Appius Claudius (311 avant J.-C.), qui la prolongea jusqu'au delà de Capoue, pendant environ 142 milles. La voie Flaminienne (p. 24) allait de Rome à Ariminum (aujourd'hui Rimini). Elle avait 360 milles de longueur. Commencée par le consul Flaminius, en 222 avant J.-C., elle fut prolongée ensuite jusqu'à Aquilée, au fond de l'Adriatique.
Dans le nord de la France, en Belgique et en Bourgogne, on rencontre encore de belles chaussées, auxquelles on a donné le nom de Brunehaut, mais dont la construction remonte sans doute aux Romains. Il est peu probable que cette reine, à travers les troubles qui ont agité son règne, ait pu donner ses soins à l'exécution des grands travaux qu'on lui attribue.
Ce qui est certain, c'est que les chaussées dont nous venons de parler, dues ou non à Brunehaut, remontent à une date très-ancienne. Leur existence actuelle ne fait que mieux prouver l'excellence de leur construction.
Mais ce que pouvaient faire les Romains, grâce aux armées dont ils disposaient et malgré des moyens d'exécution grossiers, est devenu après eux, et pour longtemps, tout à fait impossible. À la fin du douzième siècle, Philippe Auguste améliora les rues et les routes du royaume.
Plus tard, Colbert créa de nouveaux moyens de communication. Il s'occupa de la réparation des routes existantes et de la construction de voies nouvelles. C'est lui, rappelons-le en passant, qui fit construire le célèbre canal du Languedoc et projeta celui de Bourgogne.
À cette époque, le corps des ponts et chaussées (p. 25) était déjà créé. Sa fondation remonte à Louis XIII, mais c'est seulement à dater de 1739, époque de son organisation par Trudaine et Perronnet, que les travaux de viabilité reçurent une impulsion considérable: les grands ponts de Neuilly, de Mantes et d'Orléans furent construits. Toutefois, le corps des ponts et chaussées ne reçut sa constitution définitive qu'à dater du décret impérial du 7 fructidor, an XII (25 août 1804), complété par les décrets des 13 octobre 1851 et 17 juin 1854.
Dès lors, on s'occupa de la construction de ces routes magnifiques, à chaussée entièrement pavée, mesurant, y compris les accotements destinés aux piétons, jusqu'à 14 mètres de largeur.
À côté des routes nationales, réparties en trois classes, selon qu'elles unissent Paris à un État voisin ou à un port militaire,—à une des principales villes de France,—ou qu'elles établissent une communication transversale entre plusieurs départements,—se placent les routes départementales construites et entretenues avec les fonds votés par les conseils généraux des départements,—puis, les chemins vicinaux, qui relient les routes aux villages ou les villages entre eux, et enfin les chemins ruraux destinés à faciliter les travaux de l'agriculture et entretenus, comme les précédents, par les communes intéressées. Nous comptons:
| Routes nationales et départementales | 86,628 | kilom. |
| Chemins vicinaux | 518,000 | — |
(p. 26) La circulation sur les routes nationales a été l'objet de comptages qui permettent d'en apprécier l'importance. Elle est de 3,200 millions de colliers à 1 kilomètre, ce qui signifie qu'elle est représentée par 5,200 millions de chevaux, ayant parcouru 1 kilomètre ou par environ 1,800,000 tonnes transportées à la même distance.
Quant au nombre des inspecteurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs ordinaires et élèves-ingénieurs, chargés des travaux de construction et d'entretien des routes nationales, il est de 575. Indépendamment du service des routes nationales, ces ingénieurs ont encore celui des rivières, des canaux, des ports et des travaux maritimes, etc., et sont, d'ordinaire, chargés des travaux à exécuter pour les routes départementales.
On peut se faire une idée des sacrifices que fait l'État pour la construction et l'entretien des voies de communication, par les sommes énormes qu'il consacre à l'enseignement du personnel auquel il confie la direction des travaux. Un ingénieur des ponts et chaussées, à sa sortie de l'école, se trouve avoir coûté à l'État 10,000 francs; un ingénieur des mines plus du triple: 61,000 francs[1].
Les voies de terre perdant de leur importance, depuis l'impulsion donnée à la construction des voies ferrées, les ingénieurs des ponts et chaussées passent au service des compagnies et contribuent avec les (p. 27) ingénieurs sortis de l'École Centrale et de quelques autres écoles à la construction et à l'exploitation de ces nouvelles voies.
Le personnel qui appartient aux compagnies de chemins de fer est considérable. Peu de personnes s'en font une idée exacte. Voici, à cet égard, les renseignements, que nous extrayons de l'ouvrage de M. Jacqmin, directeur de l'exploitation du chemin de fer de l'Est.
Le seul personnel de l'exploitation de la Compagnie de l'Est se composait, au 31 décembre 1865, de:
| 5517 hommes commissionnés | } | 7966 agents. |
| 2449 hommes en régie |
Ce chiffre étant pris comme base, le nombre des agents attachés à l'exploitation des voies ferrées, en France, est de 43,000 environ.
La sécurité de la locomotion sur le sol, sur cette terre, qui est notre élément, cesse au moment où nous l'abandonnons pour nous lancer sur l'eau. Nous n'avons plus cette base ferme et solide sur laquelle nos pieds, malgré leur faible étendue, trouvaient un appui suffisant, et, pour nous soutenir sur l'eau, nous devons (p. 28) nous développer de tout notre corps et fournir la plus grande surface possible.
Encore ne nous éloignons-nous jamais du rivage auquel nos forces épuisées nous rappellent bientôt. Pour tenter de longs voyages, nous devons emprunter un véhicule et nous demandons à nos bras, au flot lui-même, au vent, à la vapeur, enfin, un secours indispensable. Il est impossible de dire, avec Gessner, quel fut le «premier navigateur.» Le premier homme qui tenta l'aventure vit-il une feuille tombée dans l'eau, emportée par le vent, ou bien une branche, un roseau peut-être, ou un tronc d'arbre entraîné par un courant, et l'idée lui vint-elle de faire comme la fourmi sur la feuille ou l'oiseau sur la branche? On ne sait; mais bientôt il creusa l'arbre pour le rendre plus léger, se fit une voile d'un morceau de toile, imagina la rame et le gouvernail.
Qui saurait dire ce que le sombre gouffre a englouti de victimes et de combien de vies a été payé chaque progrès accompli dans l'art de la navigation!
Les rivières, les fleuves et encore moins les canaux n'offrent, eu égard à leur faible largeur et à leur faible profondeur, aucun danger sérieux dont la navigation ne se soit rendue maîtresse depuis longtemps. Un cours plus ou moins rapide, un lit plus ou moins profond, pas plus de vent que sur la terre et un abordage presque toujours facile à tout moment du parcours, telles sont les conditions générales de la navigation fluviale, qui n'a d'autre inconvénient que sa lenteur; telles sont aussi les conditions de la navigation (p. 29) sur les lacs, à cela près que, sur quelques-uns d'entre eux, le vent soulève parfois des bourrasques, devant lesquelles les légères embarcations doivent fuir et regagner la rive.
Mais, il en est tout autrement de cette grande étendue d'eau salée qui couvre les trois quarts de notre globe, de l'Océan et des mers secondaires.
Combien diffère du sol qui conserve la trace éternelle des travaux de l'homme, cette masse liquide incessamment mobile, incessamment agitée, plissée d'ondulations que le moindre zéphyr gonfle, grossit, et que le vent grandissant fait éclater en tempêtes, vaste champ d'observations que l'homme ne connaît pas encore, vaste corps insondé dont les savants n'ont pu mesurer encore les capricieuses pulsations!
Le problème, que nous avons indiqué, de la recherche des lois du frottement entre deux corps solides, problème dont la solution dernière n'a pas encore été donnée, paraît bien simple à côté de celui du déplacement d'un corps solide à la surface des eaux. Les plus grands géomètres ont cherché à le résoudre: Newton, Lagrange, Laplace, Cauchy, Airy, Fronde, Macquorne Rankine, etc.; et cette question, si elle a été quelque peu éclaircie, ne laisse pas que d'être encore enveloppée de ténèbres épaisses.
Une pierre jetée dans l'eau donne naissance à des courbes dessinant à sa surface des cercles concentriques d'un rayon croissant. L'eau paraît fuir le centre frappé, et pourtant elle ne se déplace pas. Ce phénomène n'est autre que celui qu'on produit avec une (p. 30) corde étendue sur le sol, puis relevée et abaissée brusquement. Les divers points de la corde montent et descendent et, l'action cessant, reprennent sensiblement leur position première. Les cercles concentriques, qui se sont produits sur l'eau, sont le résultat de l'incompressibilité du liquide, de son inélasticité. Comprimées par la chute de la pierre, les molécules aqueuses, placées sous celle-ci, ont soulevé celles qui étaient à l'entour en un cercle saillant. Celles-ci, s'abaissant en vertu de leur poids, ont déterminé la formation d'un second cercle, celui-ci d'un troisième et ainsi de suite; les saillies diminuant, les intervalles augmentant, les ondulations se sont éteintes et, après une série d'oscillations, le calme s'est rétabli.
Quelles sont les lois de ces ondulations dues à la chute d'un corps dans l'eau, dues aussi à la progression d'un corps solide à sa surface?
Il n'y a que trouble dans l'esprit des savants sur la nature, la direction et l'amplitude du mouvement moléculaire dans l'ondulation.
Ils sont à peu près d'accord sur ce fait: que la direction du mouvement est verticale ou sensiblement verticale; mais sur ce point seul ils s'entendent.
Indépendamment de ces mouvements que prend la masse liquide sous l'action du navire qui progresse à sa surface, il s'en produit encore d'autres qui sont dus aux attractions de la lune et du soleil combinées, au mouvement de rotation de la terre, aux différences de densité résultant des différences de température et de salure des eaux, enfin aux courants et aux vents.
(p. 31) Le soleil et la lune exercent sur les eaux une attraction d'autant plus sensible que l'étendue des mers est plus considérable. Telle est la cause du phénomène des marées.
La surface des mers se trouve, dans son immense étendue, soumise à des différences de température,—élévation dans les régions équatoriales, abaissement dans les régions tropicales,—à des différences de salure qui déterminent des différences de densité. L'équilibre cesse tous les jours d'exister dans la masse des eaux, les mêmes causes amenant les mêmes variations de densité. Les parties les plus denses gagnent l'équateur, sous l'influence du mouvement de rotation de la terre; les parties les moins denses ou les plus légères se dirigent, au contraire, vers les pôles, où elles se refroidissent de nouveau.
La masse d'air, qui règne au-dessus des mers, est soumise aux mêmes causes de perturbation que celle des eaux. L'air enlève des quantités de vapeur considérables, qui gagnent les parties supérieures de l'atmosphère où elles se condensent. Les mêmes variations de densité déterminent, à des degrés divers, les mêmes mouvements dans la masse gazeuse et donnent naissance aux vents, d'intensité et de direction fixes ou variables.
Ainsi donc, trois causes, incessamment renaissantes, troublent la surface des eaux: les marées, les courants et les vents.
Les marées ne produisent d'action sensible sur la navigation que dans le voisinage des côtes et passent (p. 32) inaperçues au milieu de l'Océan. Les marins doivent cependant avoir égard aux mouvements d'élévation et d'abaissement des eaux qui se produisent dans certaines mers. «La Manche et la mer du Nord se vident et se remplissent. L'Adriatique subit une différence de niveau à laquelle la Méditerranée semble ne participer que faiblement. La mer Rouge subit des différences de niveau de un à deux mètres, et dans le golfe Persique ces différences sont beaucoup plus fortes[2].»
Les courants, aussi bien que les vents, sont des auxiliaires ou des entraves pour la navigation. Aussi, les navires à voile, qui se rendent dans certains pays, ont-ils soin de faire coïncider l'époque de leur voyage avec celle des courants et des vents favorables dans les mers qu'ils doivent parcourir. C'est ainsi, par exemple, que les navires à voile parcourant la mer Rouge, allant de Suez aux Indes, exécutent ce voyage entre avril et mi-septembre,—période durant laquelle soufflent les vents du nord,—et reviennent du détroit de Bab-el-Mandeb à Suez entre octobre et avril, époque à laquelle les vents ont changé de direction et soufflent du sud.
La vitesse des courants généraux varie, en mer, entre 0m,25 et 0m,75 par seconde; les courants locaux, dus aux marées, dépassent rarement 2m,00. En certains points, cependant, cette vitesse peut atteindre 5m,00 par seconde.
Mais la principale cause d'agitation de la mer est l'action du vent, dont l'intensité varie depuis la brise (p. 33) jusqu'à l'ouragan, depuis une vitesse nulle jusqu'à 45 mètres par seconde et peut exercer, dans cet intervalle, des pressions variables de 0 à 277 kilogram. par mètre carré; c'est alors l'ouragan qui déracine les arbres et renverse les édifices, et les navires doivent le fuir.
Jusqu'à quelle profondeur s'étend cette agitation de la mer sous l'action du vent? On ne sait. La vie animale se maintient à 160 mètres. L'extraction du fond de la mer de tronçons de câbles sous-marins a prouvé qu'elle avait lieu à 2,000 et 3,000 mètres, mais il est peu probable que l'agitation de la mer atteigne ces grandes profondeurs et on doit plutôt attribuer les mouvements qui ont été constatés, à des différences de densité dont la fonction est de maintenir un équilibre de composition, une homogénéité constante entre les diverses parties des océans.
L'agitation de la mer se traduit à sa surface par la formation des ondulations que, dans le langage ordinaire, on nomme des vagues. Tant que le vent reste faible, les vagues sont peu accusées, et il ne se produit qu'un phénomène de soulèvement et d'abaissement alternatifs de la surface liquide, phénomène absolument semblable à celui que l'on constate, au moment de la moisson, à la surface d'un grand champ de blé; les épis s'inclinent, se relèvent, puis s'inclinent encore et se relèvent de nouveau, par zones plus ou moins étendues; les oscillations se succèdent à intervalles plus rapprochés, quand la violence du vent augmente; les épis semblent fuir et cependant restent (p. 34) fixés au sol. Il faut une tempête violente pour les en arracher et les transporter au loin. De même, quand sur la mer les ondulations grandissent et les vagues s'élèvent, le vent qui frappe leur crête, la brise et la rejette en une volute d'écume sur le flanc de la vague. Il y a, dans ce cas, un réel mouvement de translation.
Les vagues ne sont pas, d'ailleurs, ces montagnes liquides qu'a cru voir une imagination trop vive au fort de la tempête. Les navigateurs les plus expérimentés, dont les observations méritent le plus de créance, n'ont pas constaté de hauteurs supérieures à 15 mètres. C'est le quart du chiffre indiqué, d'une manière approximative, par certaines personnes dont les yeux seuls ont servi d'instrument de mesure. Les dangers auxquels on est exposé au milieu d'une tempête, sont assez nombreux pour qu'on cherche à détruire les préjugés que l'ignorance ou la frayeur fait naître.
Il ne faut pas juger non plus des secousses que ces vagues peuvent produire sur la coque d'un bâtiment, par les effets qui résultent de leur choc contre les falaises, les jetées ou les murs de quais, obstacles immobiles opposés à la fureur de la mer. Sous un effort trop violent, le bâtiment s'incline, puis, l'effort cessant, se redresse. Mais si la falaise est de roche peu résistante, si le mur n'est pas fait de bons matériaux, reliés par le meilleur mortier, s'il n'est pas suffisamment épais, la vague l'ébranle et bientôt le détruit.
La seule condition à remplir pour que le navire résiste, c'est qu'il constitue une masse parfaitement indéformable et de dimensions assez grandes pour rester (p. 35) insensible aux agitations de l'Océan. Ces dimensions sont celles des bâtiments qui font aujourd'hui le service de l'Amérique et de l'Australie.
Résumons les quelques indications qui précèdent:
L'immense plaine nue de l'Océan est la carrière libre des vents, et les véhicules ou les navires qui se lancent à sa surface n'ont ni un sol solide comme appui, ni une atmosphère calme comme milieu; instabilité constante au-dessous, instabilité constante au-dessus, toutes deux indissolublement unies, mais non pas sans limites dans leurs ébranlements et dans leurs fureurs.
L'homme a su les maîtriser, et l'expérience l'a plus servi dans la lutte que ses calculs, car c'est à peine s'il a entrevu la vérité et pénétré l'un des innombrables mystères qui se passent au sein des eaux.
Peut-on chiffrer l'importance des moyens de communications maritimes offerts à l'activité des nations?
La mer appartient à tous les peuples, et on peut dire que sa surface, presque tout entière, est ouverte à leur commerce et à leur industrie.
Le réseau des voies navigables intérieures qui sillonnent notre pays, comprend:
| 500 | kilom. de rivières flottables; |
| 7000 | kilom. de rivières navigables; |
| 4800 | kilom. de canaux. |
Soit, en totalité, 12,300 kilomètres.
Nous connaissons déjà l'air parce que nous en avons dit à propos des tempêtes qu'il soulève à la surface des mers, et nous n'avons pas besoin d'insister de nouveau sur la violence des mouvements dont sa masse est souvent agitée pour faire comprendre les difficultés que trouve l'homme à s'y mouvoir dans une direction déterminée. En passant de la terre sur l'eau, du corps solide sur le corps liquide, les points d'appui qui doivent servir de base à la locomotion perdent de leur fixité, et le véhicule ne devient stable qu'en intéressant à ses mouvements une grande masse de liquide; dans l'air, dont les propriétés essentielles sont la mobilité et la compressibilité, les points d'appui manquent presque absolument, nous disons presque, car le vide seul admet dans ce cas l'absolu: un morceau de papier, que nous laissons tomber dans l'air tranquille, ne descend jamais verticalement; il est dévié de cette direction par l'air qui presse sa surface; dans un tube, où nous aurons fait le vide, ce même morceau de papier tombera dans une direction qui se rapprochera d'autant plus de la verticale que le vide aura été fait d'une manière plus parfaite, et il suivra rigoureusement la verticale, si le vide est absolu.
C'est seulement en comprimant la masse gazeuse (p. 37) environnante que le véhicule aérien se crée un appui et peut se mouvoir dans telle ou telle direction.
L'air est le lieu de locomotion de tous les animaux ailés qui le parcourent en dépit du vent,—tant que ce vent n'est pas tempête,—avec une vitesse qui varie selon l'espèce, et dans toutes les directions, en demeurant toutefois dans une zone qui ne s'étend pas au delà de 7,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est à la limite des neiges éternelles, au sommet de la Cordillère des Andes, entre 3,300 et 4,800 mètres au-dessus du niveau de la mer, que le condor fixe d'ordinaire sa demeure. La frégate s'avance en mer à des distances de plus de 400 lieues, saisissant au vol à la surface de l'eau les poissons dont elle fait sa nourriture.
Mais quels appareils merveilleux que ces ailes qui servent aux oiseaux à se soutenir et à progresser dans l'air! Voyez d'abord leur charpente, la solidité des points d'attache de leurs os au thorax, la construction de ces os, tubes creux et cellulaires, unissant la force à la légèreté, voyez maintenant les rémiges, les barbes, rames à large surface, capables de prendre des inclinaisons diverses et de concourir avec les pennes rectrices de la queue à gouverner leur vol! Et quelle force dans l'oiseau, eu égard à la petitesse de sa taille, pour faire mouvoir ces instruments si simples et si complets!
Qu'on rapproche à présent cette admirable structure de la construction grossière des appareils avec lesquels, jusqu'à présent, on s'est élevé dans l'air. Un globe énorme de forme sphéroïdale, gonflé d'un gaz plus léger que l'air, dont la force ascensionnelle croît (p. 38) en raison de son volume et de la différence des densités, voilà l'appareil. On a donné à l'aérostat jusqu'à 6000 mètres cubes de capacité, avec une surface exposée au vent d'environ 400 mètres carrés; telles sont les dimensions du Géant; tel est l'appareil que les aéronautes ont eu parfois la pensée de gouverner, à l'aide de trois ou quatre palettes d'une surface relativement insignifiante, à l'aide d'une ou de plusieurs hélices, d'une ou de plusieurs roues!
Il n'est personne qui n'ait éprouvé l'effet d'un vent un peu violent et qui ne se soit senti entraîné par lui. Et cependant la plus grande surface que notre corps offre au vent n'est guère que de 1 mètre carré. Qu'on juge par là, de la pression que produit sur la surface 400 fois plus grande d'un corps qui ne repose sur aucun point solide, un vent dont la direction peut changer à chaque instant et dont la vitesse est variable, depuis 30 mètres par minute pour le vent le plus faible, jusqu'à 2,700 mètres pour l'ouragan, ce qui, dans ce dernier cas, représente 162 kilomètres à l'heure, c'est-à-dire plus de trois fois la vitesse du train rapide de Paris à Marseille!
M. Babinet a dit à l'Association polytechnique: «La théorie de la direction des ballons est absurde. Comment faire?
«Comment faire résister et manœuvrer, contre les courants, des ballons comme le Flesselles, par exemple, qui mesurait 120 pieds de diamètre? Il faudrait une force de 400 chevaux pour mettre en lutte à peu près égale avec le vent une voile de vaisseau. Supposez, ce (p. 39) qui est impossible, qu'un ballon pût emporter avec lui une force de 400 chevaux; ce grand effort ne servirait absolument à rien, car nous apprécions tout de suite que, sous cette pression, votre ballon s'écraserait dans sa fragile enveloppe.
«Supposez tous les chevaux d'un régiment attachés par une corde à la nacelle d'un ballon, vous obtiendriez pour tout résultat de voir voler en éclats votre ballon.
«C'est tout à fait ailleurs que l'homme doit chercher les moyens de s'élever, ce qui veut dire en même temps de se diriger dans l'air.»
Les faits qui précèdent sont si simples qu'on ne s'explique pas comment un si grand nombre d'inventeurs n'en ont pas été frappés et ont vainement poursuivi la recherche de la direction des ballons.
Le problème de la navigation aérienne, comme celui de la navigation maritime, est double. Le véhicule doit trouver sa base de sustentation sur le milieu, eau ou air, qu'il doit parcourir; il doit, en outre, être dirigeable. Les ballons satisfont à la première partie de la question, mais leur volume rend incompatibles les deux parties du problème. La seule ressource de l'aéronaute est de s'élever ou de s'abaisser dans l'air, à la recherche d'un courant soufflant dans la direction qu'il veut suivre. S'il ne le trouve pas, il doit abandonner la lutte, car il ne pourra que s'éloigner de sa destination. En résumé, la direction des ballons est entourée de telles difficultés qu'on peut la considérer comme irréalisable.
La question nous paraît donc devoir se poser de la (p. 40) manière suivante: Trouver un moteur qui, sous un volume restreint, réunisse une très-grande puissance à une très-grande légèreté. On peut être certain que le jour où ce moteur sera trouvé, la direction des ballons le sera du même coup, car il ne s'agira plus que de l'application d'une force à un appareil ailé dont la nature nous offre un assez grand nombre de spécimens et que l'homme pourra construire de toutes pièces dans un temps certainement limité. La question du gouvernement de l'appareil deviendra l'objet d'une étude pratique dont un certain nombre d'expériences fourniront la solution.
Il est incontestable que l'une des voies qui pourraient conduire à la découverte du moteur nécessaire est celle qui reposerait sur l'utilisation d'une des propriétés physiques ou chimiques de l'air, ou de l'un de ses gaz constituants, oxygène ou azote, et plutôt du premier, source de combustion et de vie, que du second, qui n'a que des propriétés négatives. Le moteur aurait ainsi son aliment au sein de la masse même où il se meut.
Il y a des corps que l'homme a trouvé le moyen de lancer et de diriger dans l'air, avec une vitesse qui défie celle des vents, au plus fort de l'ouragan. Ce sont les projectiles qui sortent des armes à feu et qui ont été utilisés comme moyens de transport, comme porte-amarres, etc. La poudre vient d'être appliquée récemment aux sonnettes qui servent à enfoncer les pieux. La charge d'un fusil suffit pour actionner un mouton de 180 kilogrammes. Que le lecteur ne sourie pas! Nous n'avons pas l'intention de le mettre à cheval sur (p. 41) un boulet ou sur un javelot ailé et de le lancer ainsi dans l'air, à la vitesse vertigineuse que produit l'explosion de la poudre ou celle d'un picrate quelconque; mais, en présence des effets foudroyants dus à la combustion instantanée et à l'explosion de certaines matières fulminantes, n'est-il pas permis de supposer que l'homme pourra fixer le régime de ces sources de forces, en rendre l'action continue et la régler enfin selon le but particulier qu'il se propose?
L'homme doit-il prétendre lutter contre toutes les tempêtes de l'atmosphère? Nous ne le croyons pas. Ses efforts doivent tendre à triompher du vent, tant que son intensité ne dépasse pas certaines limites, à tirer parti des courants naturels de l'air, comme il le fait de ceux de la mer ou des rivières, ces chemins qui marchent, ainsi qu'a dit Pascal; mais il doit se résigner, quant à présent, à fuir les ouragans de l'air comme il fuit ceux de l'Océan, se rappelant sans cesse son infimité vis-à-vis du grand maître de la nature.
Quelle a dû être la situation de notre premier père à sa sortie des mains du Créateur, et quel ressort a pu le pousser à se mettre sur ses jambes et à quitter la place où Dieu l'avait fait naître? Est-ce la faim, est-ce le désir de contempler les beautés du monde terrestre qui lui était donné comme séjour? Est-ce une sensation, est-ce un sentiment qui a parlé le premier? L'être matériel s'est-il révélé avant l'être moral? Les philosophes résoudront, s'il leur plaît, cette question. Pour nous, nous supposerons tout simplement que les muscles de la locomotion ont bien pu être impressionnés par ceux de l'estomac et que, la manne ne tombant pas du ciel, l'homme alla chercher des fruits pour satisfaire son appétit.
Quant à ses descendants, ils suivirent l'exemple de leur père, à cela près que peut-être ils commencèrent (p. 43) à marcher à quatre pattes, pour ne plus marcher bien tôt que sur deux et pour finir avec trois, comme l'a fait remarquer le fils de Laïus et de Jocaste.
Mais nous laissons l'enfance et la vieillesse de l'homme pour ne nous occuper que de son âge mûr et de l'individu à l'état parfait.
Tandis que la plante meurt où elle a poussé, que la bête broute le sol qui l'a vu naître, l'homme seul va chercher bien loin les aliments nécessaires à sa vie matérielle, à sa vie intellectuelle. Aussi comprend-on bien que les anciens aient tenu en si grand honneur les exercices de la marche et de la course, les seuls moyens qu'avait l'homme, aux époques primitives, de pourvoir à entretenir les forces de son corps et à l'activité de son cerveau.
On sait que des couronnes étaient réservées aux vainqueurs des courses aux jeux olympiques. C'est qu'alors on attachait plus d'importance qu'on n'en donne aujourd'hui à la forte constitution de l'homme. La guerre était le but principal dans lequel on formait des jeunes gens vigoureux, mais les travaux de la paix bénéficiaient aussi des exercices du gymnase, et la santé du corps, l'équilibre maintenu dans l'accomplissement de toutes ses fonctions n'étaient pas sans influence sur les productions du cerveau: Athènes et Rome resteront le berceau toujours admiré des lettres, des sciences et des arts.
La jeunesse tout entière était formée aux exercices du corps, les hommes étaient généralement bon marcheurs (on se rappelle l'usage qui existait à Sparte de (p. 44) sacrifier, dès leur naissance, les enfants difformes). Mais, parmi tous ces hommes, quelques-uns se sont trouvés doués de cette poitrine plus large, de ces jambes mieux musclées et plus longues, dont les médailles ou les vases anciens nous ont laissé l'image et dont les historiens et les poëtes nous ont raconté les hauts faits.
Sans parler d'Achille aux pieds légers, que tout le monde connaît, on peut citer Hermogène, de Xante (en Lycie), qui remporta huit victoires en trois olympiades, Lasthine le Thébain, qui battit un cheval à la course, et Polymestor, jeune chevrier de Milet, qui attrapait un lièvre à la course.
Au moyen âge, on trouve des coureurs émérites au service de la noblesse. De grands gaillards «fort bien fendus,» à l'haleine longue, au costume léger, ornés de plumes, de clochettes, de rubans, s'en allaient en avant du carrosse de leur maître pour annoncer son arrivée. Tantôt ils étaient pieds nus, tantôt ils n'avaient que des chaussures légères. Ils portaient à la main une longue canne terminée par une pomme d'argent, dans laquelle ils enfermaient leur repas. Inutile de dire que ces hommes vivaient peu et que, du jour où leurs membres épuisés réclamaient le repos, le corps tout entier cédait à l'excès de la fatigue, et ils succombaient.
De ces coureurs, il n'est guère resté que le nom; il existe encore des valets de pied en France et des footmen en Angleterre; mais l'aristocratie a très-heureusement renoncé au privilége qu'elle tenait de la féodalité d'avoir à son service des hommes dont (p. 45) elle faisait des esclaves, honteusement soumis à tous ses caprices. Les valets de pied usent maintenant des voitures comme leurs maîtres, et ce n'est plus qu'aux cortéges des rois, à des occasions solennelles, qu'on les voit cheminer à côté des chevaux d'apparat, dont ils servent à régler l'allure et à diriger la marche.
On rencontre encore des coureurs dans quelques pays primitifs, où ils sont chargés du service de la poste, chez les Cafres, par exemple. Munis du message de leur maître pour un chef voisin, les coureurs partent dans le plus simple appareil, mâchant seulement quelques feuilles de tabac, dont le jus sert à tromper leur soif. Dès qu'ils ont la réponse attendue, ils repartent en courant.
Les plus singuliers coureurs sont ces petits négrillons, à peine vêtus de lambeaux, qui se cramponnent à la queue des chevaux arabes et les suivent à la course. Le cheval arrêté, ils vont de la queue à la tête et gardent le coursier pendant que le maître vaque à ses plaisirs ou à ses affaires.
Mais s'il n'y a plus d'autres coureurs que ceux que l'on voit paraître en maillot, de temps en temps, dans les villes de province et qui en font le tour pour quelques pièces de monnaie, il y a encore des marcheurs.
Ceux que j'admire le plus sont ces soldats qui, avec des charges de 15 à 20 kilogrammes, des vêtements étouffants et une coiffure aussi pesante que ridicule, font des étapes variables de 30 à 40 kilomètres pendant quinze à vingt jours consécutifs; et je mets au (p. 46) nombre des faits les plus remarquables, les marches forcées des armées en campagne. Les distances parcourues en un jour, durant les guerres du premier empire, ont atteint 48 et même 60 kilomètres. Qu'on se rappelle le passage des Alpes ou la retraite de Russie: dans un cas, un faîte à franchir avec des canons et tout un matériel de guerre; dans l'autre, une longue marche à fournir dans la neige ou dans la boue, en dépit du froid et de la faim. Il faut, chez les hommes qui accomplissent de semblables hauts faits, une force physique doublée d'une force morale exceptionnelle, comme peuvent seuls en faire naître des événements exceptionnels. Mais fallait-il bien tant de gloire et tant de vertu pour verser tant de sang?
Le soldat rentrant au village devient souvent facteur rural; nous le voyons, dans certaines parties montagneuses de la France, faire, pour un salaire des plus modestes, un service des plus fatigants. Les vélocipèdes, dont nous parlerons plus loin, viendront-ils quelque jour rendre leur tâche moins rude? Nous n'osons l'espérer; car, tandis que le facteur passe partout, à travers champs, dans les sentiers, sur les rochers, le vélocipède ne passe que sur les chemins frayés, sur les chaussées unies et peu inclinées. Combien de nos chemins vicinaux ne pourraient convenir à ces légers véhicules!
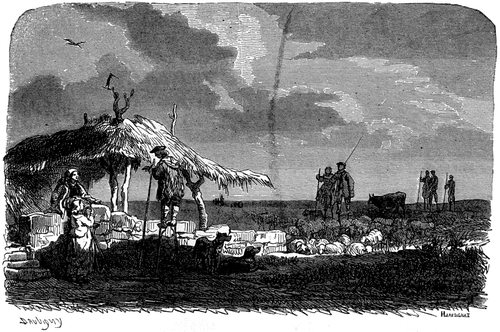
Fig. 3.—Habitants des Landes.
Indépendamment de ces marcheurs de profession, il apparaît de loin en loin quelque marcheur hors ligne. L'un des plus remarquables est le capitaine Barclay. C'était en juillet 1809; il paria 3,000 livres sterling (p. 49) (75,000 francs) qu'il parcourrait en 1,000 heures consécutives un espace de 1,000 milles. Les paris s'élevèrent même jusqu'à 100,000 livres sterling (2,500,000 francs): 41 jours et 41 nuits de marche non interrompue! La distance de 1,000 milles correspond à 1,609 kilomètres ou 402 lieues. Le pari fut gagné, et le retour du capitaine Barclay salué par les cloches sonnant à toute volée.
Mais qu'importent ces tours de force, aussi dépourvus d'utilité pour celui qui les exécute que d'intérêt réel pour celui qui les observe? La marche des Landais dans les pays marécageux qui s'étendent entre la Garonne et l'Adour, depuis la Gélise jusqu'aux dunes de l'Océan, ou des Hollandais sur le miroir glacé de leurs canaux, nous paraît plus digne de fixer l'attention.
C'est du haut de ses échasses, qui l'élèvent de 1 mètre à 1m,60 au-dessus du sol, que le berger landais garde son troupeau. Un bourrelet de bois, de corne ou d'os, appelé cret ou pedis, garnit la partie inférieure de ces échasses et les empêche de pénétrer dans la vase. Le pâtre porte à la main un long bâton, appelé paou tchanquey, et qui lui sert de balancier quand il marche ou de point d'appui quand il veut se reposer. Ainsi perché sur ces chanques, il domine la bruyère, traverse les marais, garde ses troupeaux et se garde lui-même des attaques des loups. Il s'en va ainsi tous les jours, insoucieux, entre ciel et terre, et tricotant quelque paire de bas de laine couleur de bête.
C'est au moment où l'hiver semble ralentir l'activité de tous les êtres que les Hollandais se livrent (p. 50) au plaisir tant aimé de Klopstock et de Gœthe. La surface polie des canaux qui sillonnent la Hollande forme comme autant de chemins propres à la circulation. Ce sont, non-seulement des champs ouverts à leurs jeux et sur lesquels ils se livrent, hommes et femmes, à des courses de vitesse, ce sont encore des voies de communication rapide, que les femmes suivent pour aller au marché, les hommes pour se rendre à leurs travaux. Le patin est aussi appliqué à l'art militaire, et il s'est formé, dans différents pays du Nord, des corps de patineurs, armés à la légère, et qui, grâce à la rapidité de leur course, peuvent rendre, dans certains cas, de très-utiles services.
Mais le patin et l'échasse ne s'emploient que dans ces cas particuliers où la surface du sol est fangeuse ou glacée. Hors de là, l'homme retombe sur ses jambes, c'est-à-dire sur des organes qui ne doivent fournir, d'une manière normale, qu'une course de peu d'étendue. Que l'on rapproche, en effet, la constitution anatomique de l'homme de celle des animaux le mieux doués pour la marche, ou pour la course, et l'on remarque qu'il manque de ces deux qualités essentielles, qui font le mérite de ces animaux: la force des muscles des membres locomoteurs, le développement de la capacité thoracique et des organes respiratoires qui y sont renfermés.
L'homme s'est emparé du cheval et l'a dompté.
«La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal...» a dit Buffon. «Non-seulement il fléchit sous la main de celui qui le guide, mais il semble consulter ses désirs; et, obéissant toujours aux impressions qu'il en reçoit, il se précipite, se modère ou s'arrête et n'agit que pour y satisfaire. C'est une créature qui renonce à son être pour n'exister que par la volonté d'un autre; qui sait même la prévenir, qui, par la promptitude et la précision de ses mouvements, l'exprime et l'exécute; qui sent autant que l'on désire et ne rend qu'autant qu'on veut; qui, se livrant sans réserve, ne se refuse à rien, sert de toutes ses forces, s'excède et même meurt pour mieux obéir.»
Selon la Fable, les dieux s'en servaient comme de monture ordinaire ou l'attelaient à leurs chars. La Bible, dans Esther, raconte «que l'on envoya des lettres par des courriers à cheval sur des coursiers rapides, sur des dromadaires issus de juments.»
Le cheval semble avoir toujours été l'auxiliaire de l'homme. Chez tous les peuples on le rencontre à l'état domestique. Dans le nord de l'Afrique, on trouve le cheval arabe, le kochlané ou pur sang, le type de la race, (p. 52) ou le kadisché provenant de croisements inconnus, tous deux remarquables par l'élégance de leurs formes et la rapidité de leur course. Dans la Barbarie, on emploie des chevaux pour le manége; en Espagne, des chevaux pour le manége ou la cavalerie; en Angleterre, des chevaux de course, et dans les différentes régions de la France, des chevaux pour tous les usages. En Normandie ce sont des chevaux de trait et de manége; dans le Limousin, des chevaux de selle; dans la Franche-Comté, des chevaux de trait; en Auvergne on élève le bidet et dans le Poitou le mulet.
Le cheval se plie à tous les travaux qu'on lui impose, prend le pas, le trot, l'amble ou le galop, selon le bon plaisir de celui qui le dirige. C'est avec la même allure résignée qu'il suit le sillon de la charrue, l'ornière du chemin, la piste du champ de courses ou du manége. Il ira en ligne droite le long d'une voie ferrée, tournera en cercle pour élever l'eau du maraîcher, ou marchera sur lui-même sans avancer, comme l'écureuil dans sa cage, ou comme le chien du cloutier. C'est le premier instrument de l'agriculture et de l'industrie.
Sans vitesse, il peut produire un effort de 360 kilogrammes; à la vitesse moyenne de 1 mètre par seconde, cet effort n'est plus que de 80 à 90 kilogrammes; encore faut-il que le travail ne soit pas trop prolongé. Aussi ne compte-t-on d'ordinaire que sur 70 kilogrammes seulement.
Des expériences très-nettes ont permis de comparer le travail de l'homme et celui du cheval: tandis que (p. 53) l'homme, qui roule un fardeau sur une voiture à deux roues et revient au point de départ chercher un nouveau chargement, peut travailler durant dix heures, avec une vitesse de 50 centimètres par seconde et exercer un effort moyen de 100 kilogrammes, le cheval peut, travaillant le même temps, mais avec une vitesse de 60 centimètres par seconde, exercer un effort moyen de 700 kilogrammes. La quantité de travail journalière est représentée, pour l'homme, par 1,800,000 kilogrammètres[3], et, pour le cheval, par 15,120,000 kilogrammètres.—Tandis que le portefaix peut exercer, durant une journée de 7 heures, et à une vitesse de 75 centimètres par seconde, un effort moyen de 40 kilogrammes, le cheval, chargé sur le dos, peut, durant 10 heures de travail et en marchant avec une vitesse de 1m,10 par seconde, développer un effort moyen de 120 kilogrammes.
Ces chiffres représentent, bien entendu, des résultats moyens; car le poids que l'homme peut porter s'élève jusqu'à 150 kilogrammes. Il a même atteint le chiffre de 450 kilogrammes. Les portefaix de Rive-de-Gier, qui chargent les bateaux, portent un hectolitre de houille de 85 kilogrammes à 36 mètres, et font de 290 à 300 voyages par jour.
Il est assez intéressant de comparer aussi les vitesses que peuvent prendre l'homme et le cheval à la course.
La vitesse du coureur peut être de 13 mètres par (p. 54) seconde pendant quelques instants; la vitesse ordinaire est de 7 mètres. (Le marcheur ne s'avance qu'avec une vitesse de 2 mètres et le voyageur ne parcourt que 1m,60 par seconde.)
La plus grande vitesse que puisse prendre un cheval dans une course d'un quart d'heure, ne dépasse pas 14 à 15 mètres. La vitesse au galop est de 10 mètres, au trot de 3m,50 à 4 mètres, au grand pas de 2 mètres et au petit pas de 1 mètre.
Il y a quelques années, le service des postes employait un grand nombre de chevaux de choix, que les chemins de fer ont presque complétement dispersés. Les chevaux des malles-postes traînaient 500 kilogrammes à la vitesse de 4m,44, et parcouraient 20 kilomètres par jour; ceux des diligences allant moins vite (3m,33 par seconde), traînaient 800 kilogrammes et parcouraient 24 kilomètres par jour. Enfin, les chevaux des chasse-marée, qui parcourent 32 kilomètres par jour, avec une vitesse de 2m,20 par seconde, ne traînent que 560 kilogrammes.
Moins vif, moins valeureux, moins beau que le cheval,
L'âne est son suppléant et non pas son rival.
Il n'en est pas moins vrai que le coursier de Silène, qui l'emporte sur son maître par sa sobriété, rend, comme porteur, de précieux services à l'agriculture.
Les petites exploitations l'utilisent avec avantage pour les transports à faible distance, et les gens pauvres le préfèrent à raison de la facilité qu'ils ont à le (p. 55) nourrir et à le loger. C'est le souffre-douleur de la famille domestique, c'est pour lui que sont tous les coups. Qui n'a pris en pitié le sort de ces pauvres bêtes, en Espagne et en Afrique, où on leur voit suivre par troupes nombreuses des chemins à peine tracés, pliant sous la charge de lourds sacs de blé ou sous le faix de longs Arabes, aux jambes traînantes?
Le mulet est le cheval du montagnard. À lui les chemins étroits dans les rochers et le transport du bois réduit en charbon. Bon pied, bon œil, tête sûre, à l'abri du vertige et défiant les précipices; mais allure lente, due à l'ampleur de sa taille.
Plus vite que les meilleurs chevaux arabes court l'hémione, et nous nous demandons pourquoi le Dziggetai, très-répandu dans le pays des Katch, au nord de Guzzerat, dans l'Inde, et dont on se sert à Bombay comme cheval de selle et de trait, n'a pas encore été acclimaté.
Puisque nous sommes dans l'Inde, nous parlerons de l'éléphant, le géant des bêtes de transport sinon la plus utile et dont on se sert dans diverses contrées de l'Asie. L'éléphant peut parcourir 80 kilomètres par jour en portant un poids de 1000 kilogrammes. D'après le chev. P. Armandi, auteur d'un ouvrage fort intéressant sur l'histoire militaire des éléphants, ces animaux ne pouvaient faire, avec une semblable charge, que 12 à 15 lieues par jour (48 à 60 kilomètres). «La marche ordinaire de l'éléphant, dit cet écrivain, n'est guère plus rapide que celle du cheval; mais, quand on le pousse, il prend une sorte de pas (p. 56) d'amble, qui, pour la vitesse, équivaut au galop. Il a le pied très-sûr, il marche avec circonspection et il lui arrive rarement de broncher. Malgré cela, c'est toujours une monture incommode, à cause de son balancement continuel et de son allure saccadée.»

Fig. 4.—Éléphant portant un a'méry.
L'éléphant était autrefois employé dans les combats et portait sur son dos une tour abritant cinq ou six soldats au plus, armés de piques ou de traits. Plus tard, le sénat romain attela deux éléphants aux chars des empereurs revenant vainqueurs de l'Orient. (p. 57) Aujourd'hui, l'éléphant sert aux voyages dans l'Inde. On lui met sur le dos soit une galerie découverte, de construction légère, simplement garnie de coussins, appelée howdah ou haudah, et qui peut contenir deux ou trois voyageurs, ou bien, pour les dames ou les grands personnages, une galerie couverte de rideaux de soie, ornée de banderoles et connue sous le nom d'a'méry.
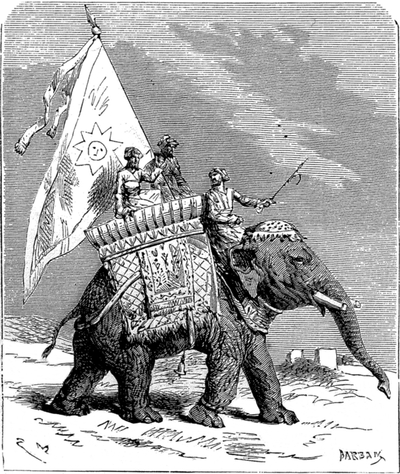
Fig. 5.—Éléphant portant un haudah.
Mais l'éléphant ne se reproduit pas dans la vie domestique; (p. 58) il lui faut la profondeur et le silence des forêts; aussi n'y a-t-il guère à espérer qu'il se répande jamais en Europe.

Fig. 6.—Petits éléphants du Jardin d'acclimatation.
S'il ne l'emporte par la taille, le chameau l'emporte sur l'éléphant par les services qu'il rend aux populations africaines. C'est le navire du désert, a-t-on dit avec beaucoup de vérité. Et, en effet, les sables sahariens ne forment-ils pas une vaste mer mouvante qui a ses tempêtes, quand souffle le Simoun (les poisons), ou comme les Arabes le nomment: le Kamsin, «qui sèche l'eau des puits». «Dans le désert, l'homme redevient promptement un animal féroce; le soin de son propre salut le préoccupe à ce point (p. 61) qu'il ne se retournerait seulement pas pour secourir son semblable en danger[4].» Si l'Arabe n'avait le chameau, quel autre animal pourrait lui faire parcourir le désert? Admirable prévoyance de Dieu qui, à côté de la vaste plaine brûlante, a mis la monture propre à en faciliter l'accès!
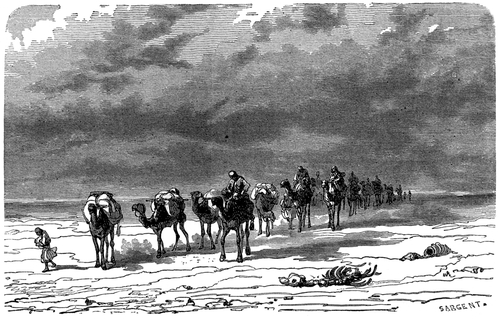
Fig. 7.—Caravane dans le désert.
Tout le monde connaît la sobriété du chameau. Il peut marcher pendant des semaines entières, à raison de 16 à 18 heures par jour, avec un fardeau de 400 kilogrammes en moyenne, sans demander autre chose qu'un litre d'eau chaque jour, et une livre d'une nourriture quelconque: paille, orge, chardons, herbes ou noyaux de dattes. Pour une traversée de 40 à 50 heures, comme celle du Caire à Suez, il peut se passer de toute boisson et de toute nourriture.
La soumission du chameau, sa patience, ressemblent à celles du bœuf; mais tandis que l'un rentre dans la catégorie des bêtes de somme, l'autre appartient plus spécialement à celle des bêtes de trait. De même que le cheval, le bœuf se trouve dans tous les pays et partage avec lui les rudes travaux de l'agriculture. C'est dans les régions montagneuses et dans les pays chauds que l'usage du bœuf s'est le plus répandu. Là, il tire la charrue et fait tous les transports qui ne réclament pas de vitesse. Attelé au manége d'une noria, il peut développer un effort moyen de 60 kilogrammes, tandis que le cheval n'est capable de produire qu'un effort de 45 kilogrammes; sa (p. 62) vitesse, il est vrai, n'est, dans ce cas, que de 0m,60 par seconde, tandis que celle du cheval est de moitié plus grande, ou de 0m,90 dans le même temps.
À côté du bœuf viennent se ranger les membres de la même famille: le yack, des montagnes du Thibet, qui se monte et dont l'agilité est supérieure à celle du bœuf; le bison, qui abonde dans l'Amérique septentrionale, et que M. Lamare-Picquot a proposé d'acclimater en 1849, comme bête de trait et de boucherie.
Les usages que l'on tire du bœuf, lorsque l'âge ne lui permet plus de fournir un service actif, sont plus nombreux encore que ceux des différentes parties du corps du chameau. Sa chair, sa peau, sa graisse, son poil, ses cornes, ses os, ses nerfs, ses intestins, son sang, ses issus même, sont utilisés. Aussi, en pensant au culte public que les Égyptiens rendaient au bœuf Apis, est-on surpris qu'il n'ait produit que l'insignifiante et ridicule mascarade du bœuf gras, où les grands prêtres sont remplacés par des garçons bouchers, travestis en hercules assommeurs.
L'homme n'a pas d'autres auxiliaires dans les pays chauds et dans les pays tempérés que ceux dont nous venons de parler.
Dans les contrées septentrionales, en Russie, en Norwége, le renne remplace avantageusement le cheval. Il sert à la fois de bête de trait et de somme et peut faire jusqu'à 120 kilomètres par jour, se contentant seulement de quelques bourgeons, d'écorces ou de lichen qu'il déterre sous la neige.
(p. 63)
Fig. 8.—Traîneau tiré par des chiens.
(p. 65) Comme le renne, le chien se met au traîneau et rend au voyageur qui se lance sur les glaces des mers polaires de précieux services. Le docteur J.-J. Hayes, chirurgien de la marine des États-Unis, raconte ainsi la dernière partie de son voyage à la mer libre du pôle arctique: «Notre traversée n'a pas eu sa pareille dans les aventures arctiques.... Les soixante-quinze derniers kilomètres, où nous n'avions plus que nos chiens, nous ont pris quatorze journées; et on comprendra mieux combien la tâche était rude, si l'on se rappelle qu'une semblable étape peut être parcourue en cinq heures par un attelage de force moyenne sur de la glace ordinaire, et ne le fatiguerait pas moitié autant qu'une seule heure de tirage au milieu de ces hummocks qui semblaient se multiplier sous nos pas.—Le chien de cette race court plus volontiers sur la glace unie avec un fardeau de cent livres, qu'il n'en traîne vingt-cinq sur une route qui le force à marcher à pas lents.»
Nous avons parlé de la plupart des quadrupèdes que l'homme emploie à le porter ou à le traîner. Mais il est un bipède que certains peuples de l'Afrique emploient aussi comme coursier: l'autruche. Sa force ne le cède en rien à la rapidité de sa course. Il semble voler; et on se fera une idée de sa vitesse quand on saura que le chasseur qui la poursuit est souvent forcé de courir huit à dix heures avant de l'atteindre.
Ainsi qu'on le voit, dans quelque pays, sous quelque latitude que l'homme se place, il trouve à ses côtés l'animal capable de suppléer à sa faiblesse et de (p. 66) prolonger sa course aussi loin qu'il le désire: mers de glaces ou de sables brûlants, il peut tout aborder. Est-il seul à voyager? il enfourche une monture; a-t-il lourd à porter? il attelle la bête à un véhicule. De force, il n'en a pas à produire et son cerveau peut être seul à travailler.
Les véhicules le plus en usage dans les temps anciens, ceux dont les bas-reliefs de la Grèce ou de Rome nous ont conservé l'image, et dont les historiens nous font le récit, sont les chars à deux roues qui servaient dans les combats, dans les courses du cirque, dans les fêtes triomphales ou dans les cérémonies religieuses.
La biga était une sorte de caisse montée sur deux roues, ouverte à l'arrière et sans aucun siége. Elle était tirée par deux chevaux attelés de front de chaque côté d'une flèche unique ou timon. Cette caisse était tantôt en bois, tantôt en métal et plus ou moins ornée suivant les circonstances. Dans les jeux du cirque, le lutteur conduisait lui-même l'attelage; à la guerre, un conducteur spécial dirigeait (p. 68) les chevaux pour laisser au combattant le libre usage de ses armes.
Nous ne voyons plus ces chars qu'aux courses de l'Hippodrome, à Paris. Tous les ans aussi, Florence a ses courses de chars. Des cocchi, vêtus à la romaine, montés sur leur theda, soulèvent des nuages de poussière aux applaudissements de la foule qui entoure la place Sainte-Marie-Nouvelle.
Ces chars s'appelaient autrefois bigæ, trigæ, quadrigæ, suivant qu'il étaient traînés par deux, trois ou quatre chevaux de front. Il y avait aussi des sejugæ, ou chars à six chevaux, et des septijugæ ou chars à sept chevaux.
On attribue l'invention des chars à Erichthonius, roi d'Athènes, qui institua les fêtes des Panathénées, si célèbres dans toute la Grèce. D'autres historiens croient pouvoir en faire remonter la découverte jusqu'à Triptolème, ou même jusqu'à Pallas ou à Neptune. Nous ne chercherons pas à vider le différend qui les divise à ce sujet. L'invention des chars date de la plus haute antiquité, c'est incontestable; mais nous doutons fort que les dieux de la Fable aient fait, de leurs mains, les chars sur lesquels on les représente si souvent montés et à l'aide desquels ils voyagent au milieu de l'éther ou sur les vagues de l'Océan.
Le carpentum était la riche voiture à deux ou à quatre roues et à deux ou à quatre chevaux, attelés de front. Le carpentum était d'ordinaire couvert et servait aux prêtres et aux dames romaines. C'était la voiture de la mariée, celle qu'en Grèce on appelait apène.
(p. 69) Notre cabriolet moderne portait autrefois le nom de cisium, mais il différait notablement de celui que nous connaissons. Il s'ouvrait par devant et avait un siége, mais la caisse n'était pas suspendue; le siége seul était porté par des courroies destinées à adoucir les chocs des chemins qui, à cette époque, étaient très-imparfaits. On sait, en effet, qu'à part les quelques voies stratégiques qui furent faites de bonne heure en Italie, et qui réunissaient Rome aux principales villes de la péninsule, les voies de communication manquaient presque complétement. Le cisium, n'ayant que deux roues, pouvait, plus facilement que le carpentum, passer dans tous les chemins, aussi l'employait-on comme voiture de voyage.
La voiture de ville des matrones romaines, celle des vestales, dont la loi interdisait l'usage aux courtisanes, s'appelait pilentum. Elle était découverte, à deux places, à deux ou à quatre roues. Des colonnettes en bois, en cuivre, ou même en argent ou en ivoire, richement sculptées, soutenaient la toiture de la voiture. Les arabas des dames du sérail et des patriciennes musulmanes d'aujourd'hui ont quelque ressemblance avec le pilentum. Les arabas sont les voitures dans lesquelles l'aristocratie féminine musulmane va se promener, à certains jours de liesse, aux Eaux douces d'Europe ou d'Asie, sur la rive orientale du Bosphore de Thrace: lourds carrosses, tirés par des bœufs à la lente allure, et conduits par des eunuques[5]. (p. 70) Un diminutif de ces voitures, destiné à être traîné par des chèvres, est au musée de Trianon à Versailles. Il a été donné par le sultan au prince impérial.

Fig. 9.—L'Araba.
Une voiture très à la mode depuis quelques années, le panier, la voiture de campagne, était aussi très en vogue autrefois. On la trouve chez les Romains où elle s'appelle sirpea, chez les Spartiates où elle se nomme canathra, chez les Grecs où elle porte le nom de plecta, et enfin chez les Gaulois qui l'appellent benna. La benna servait à la guerre et, durant la paix, au transport des personnes et des choses.
Telles étaient les principales voitures en usage dans (p. 71) l'antiquité; mais, à côté de ces voitures dont chacun se servait suivant ses fonctions ou dans telle ou telle circonstance, il s'en est trouvé de particulièrement remarquables par le luxe de leur construction.
«Héliogabale, le Sardanapale de Rome, nous dit M. Ramée, dans son histoire des chars, carrosses, etc., d'après l'historien Lampride, avait des voitures couvertes de pierres précieuses et d'or, ne faisant aucun cas de celles qui étaient garnies d'argent, d'ivoire ou d'airain. Il attelait parfois à un char deux, trois et quatre femmes des plus belles, ayant le sein découvert et par lesquelles il se faisait traîner. Cet empereur n'étant encore que particulier, ne se mettait jamais en route avec moins de soixante chariots. Empereur, il se faisait suivre de six cents voitures, alléguant que le roi des Perses voyageait avec dix mille chameaux et Néron avec cinq cents carrosses.»
Le même Héliogabale avait pour son dieu Elégabale un char orné d'or et de pierres précieuses, traîné par six chevaux blancs richement caparaçonnés. Le dieu conduisait ou mieux semblait conduire. Héliogabale allait en avant du char à reculons. Le chemin à parcourir était couvert de poudre d'or pour prévenir ses faux pas et l'empêcher de glisser sous les pieds des chevaux dont il réglait l'allure.
L'un des chars les plus remarquables est celui dont Diodore de Sicile donne la description et qui transporta le corps d'Alexandre de Babylone en Égypte. La voûte était d'or, recouverte d'écailles en pierres précieuses au sommet. Le trône et les ornements placés sur ce (p. 72) char étaient en or; les raies et les moyeux des roues étaient dorés. Soixante-quatre mules, par seize de front, portant des couronnes d'or et des colliers de pierres précieuses, traînaient ce char, dont la construction avait exigé deux années de travail.
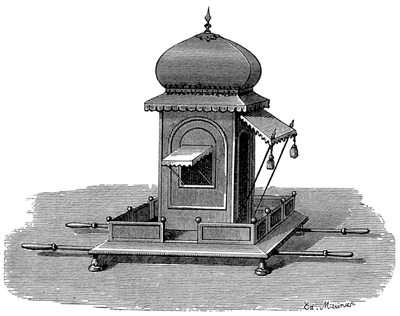
Fig. 10.—Litière à deux porteurs.
Indépendamment des chars de différents genres qui sont venus jusqu'à nous plus ou moins transformés, les anciens avaient encore les litières et les basternes, qui ont donné naissance aux palanquins et aux chaises à porteurs.
La litière était le plus souvent portée par des hommes, mais quelquefois on la plaçait sur un chameau ou sur un éléphant. Elle subit, avec le luxe croissant, les (p. 73) modifications des autres moyens de transport. Elle fut d'abord découverte et très-simple. On la couvrit plus tard et on l'orna. La basterne n'est autre chose qu'une grande chaise à porteurs à deux places portée par deux chevaux, deux mules ou deux bœufs.
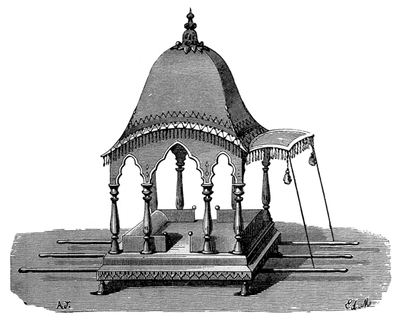
Fig. 11.—Litière à quatre porteurs.
La litière employée aujourd'hui dans le Dahomey n'est pas plus primitive que la litière des anciens. Aux extrémités d'une longue perche sont fixées les attaches d'un hamac dans lequel le promeneur est étendu. Une draperie tendue sur un cadre, relié lui-même à cette perche, fait tente au-dessus de la litière et garantit des ardeurs du soleil. Deux nègres vigoureux la portent en courant. De temps en temps, deux hommes se détachent (p. 74) de la petite troupe d'esclaves qui sert d'escorte et viennent les remplacer, de manière que l'allure ne soit jamais ralentie.
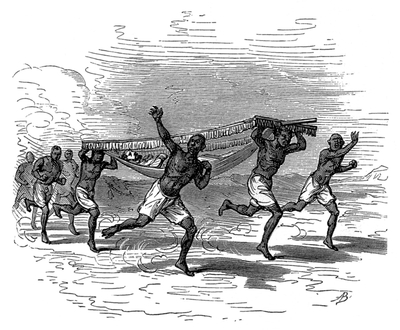
Fig. 12.—Litière au Dahomey.
Ce moyen de transport primitif, où l'homme remplace la bête et porte l'homme, rappelle bien ce qui se passait au temps de la domination romaine où les esclaves étaient forcés de se plier honteusement aux volontés et aux caprices de leurs maîtres.
Les moyens de transport se perfectionnent avec une lenteur extrême. Le cheval est celui qu'on emploie de préférence.

Fig. 13.—Un abbé en voyage.
Eginhard, le premier de nos historiens, nous raconte comment les princes de la famille des Mérovingiens s'en allaient en voyage. «S'il était nécessaire que l'un d'eux allât quelque part, dit-il, il voyageait monté sur un chariot traîné par des bœufs qu'un bouvier conduisait à la manière des paysans. C'est ainsi qu'il se rendait à l'Assemblée générale de la nation, qui se réunissait une fois chaque (p. 76) année pour les affaires du royaume.» Il nous faut aller aujourd'hui en Turquie et dans l'Inde pour trouver des attelages du même genre.
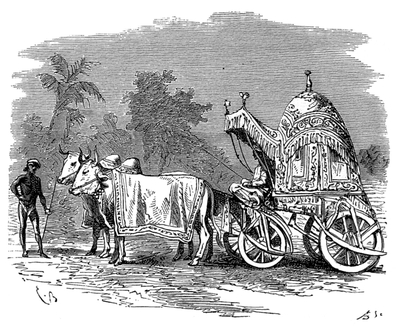
Fig. 14.—Voiture de promenade dans l'Inde.
On peut juger de la manière dont voyageaient les simples citoyens par la manière dont voyageaient les rois. Les routes étaient rares et celles qui existaient étaient en très-mauvais état. Les seigneurs féodaux, qui auraient dû les faire entretenir par leurs vassaux, ne s'en occupaient nullement. Ils concédaient le droit de conduite sur les routes pour escorter les marchands, «mais on n'entendait parler que de brigandages sur les voies publiques». «Des brigands, ceints du glaive, raconte Guillaume, archevêque de Tyr, assiégeaient les (p. 77) routes, dressaient des embûches et n'épargnaient ni les étrangers, ni les hommes consacrés à Dieu. Les villes et les places fortes n'étaient pas même à l'abri de ces calamités; des sicaires en rendaient les rues et les places dangereuses pour les gens de bien.» Cet état de choses dura plusieurs siècles, pendant lesquels la sécurité ne régna nulle part. Au douzième siècle, ce sont les Routiers, Brabançons et Cottereaux; au quatorzième, les Malandrins et les Écorcheurs, qui pillent et dévalisent. «Tout le pays en était rempli et personne n'osait sortir des villes et châteaux, par crainte de ces mécréants qui n'avaient nul souci de Dieu.» On pouvait être tranquille à l'intérieur des villes ou dans leur voisinage, mais les paysans n'osaient se risquer dans la campagne, loin des châteaux forts et des monastères. Durant la belle saison, ils restaient aux champs; mais, à l'approche de l'hiver, ils rentraient avec le bétail dans les faubourgs. Le marchand, le commis-voyageur d'autrefois, devaient payer un droit d'escorte à chaque seigneur dont il traversait les terres pour être garanti de toute rapine.
Les seigneurs ne dédaignaient pas de s'associer parfois à ces détrousseurs de grands chemins. C'est ainsi que Richard Cœur de lion, n'étant encore que duc d'Aquitaine, se fit le compagnon de Mercadier, chef de routiers célèbre, et lui donna plus tard les biens d'un seigneur du Périgord. L'archevêque de Bordeaux lui-même fit ravager sa province par le même Mercadier, à ce que rapporte le pape Innocent III.
Les rois de France, à différentes époques, s'efforcèrent (p. 78) de porter remède à cette déplorable situation. Louis VI était toujours à cheval et la lance au poing pour châtier les nobles qui pillaient les voyageurs. Philippe Auguste, jaloux de relever la France au point où Charlemagne l'avait placée, continua la lutte. Il réprima les brigandages des grands seigneurs, fit paver les rues et les places de Paris, qui étaient en tel état que les chevaux et les voitures, remuant la boue, en faisaient sortir des odeurs insupportables. On juge ce que pouvaient être les routes de la France, à cette époque, par ce qu'étaient les rues de sa capitale.
Saint Louis remit en vigueur un capitulaire de Charlemagne qui forçait les seigneurs prenant péage à entretenir les routes et à garantir la sûreté des voyageurs.
Qui donc aurait osé entreprendre de longs voyages en ces temps de troubles et de force brutale? Les seigneurs seuls pouvaient courir ces aventures, et encore ne sortaient-ils guère de leurs domaines ou de ceux de leurs voisins amis. Allaient-ils à quelque fête, c'était sur des palefrois, richement caparaçonnés. Leurs dames les accompagnaient, chevauchant à leurs côtés sur des haquenées ou des mules encore plus brillamment ornées.
Certaines de ces montures sont restées célèbres dans les annales de la chevalerie. Les quatre fils Aymon, Renaud, Guichard, Alard et Richardet, combattaient sur un seul cheval qui s'appelait Bayard.
Le légendaire paladin Roland, avec sa Durandal qui fendait roc et granit, son olifant (cor enchanté), dont
(p. 79) Bruient li mont et li vauls resona;
Bien quinze lieues li oïes en ala,
montait Bride d'or.
Oger le Danois, immortalisé par nos jeux de cartes sous le nom d'Hogier, avait Beiffror et Flori.
Charlemagne avait deux palefrois: Blanchard et Entencendur. Enfin, le Cid avait sa Babieça, et, plus tard, Don Quichotte a eu Rossinante.
Les chariots ne servaient, au moyen âge, que pour le transport des choses et peu pour celui des gens.
Lorsque Thomas Becket, plus tard archevêque de Cantorbéry, vint en France demander la main de Marguerite, fille de Louis VII, pour le fils aîné d'Henri II roi d'Angleterre, il se fit suivre de deux cents cavaliers, tant soldats que serviteurs, tous habillés à ses couleurs et richement vêtus. Quand il entrait dans les villes et les villages, tout le monde se pressait pour voir défiler le long cortége du chancelier, son armée de serviteurs, ses chariots qui faisaient retentir les pierres, ses écuyers, ses chiens, ses oiseaux, ses singes. Il avait douze chariots pour les présents destinés au roi, un pour ses tapis, un pour sa vaisselle, un pour sa cuisine, un pour sa chapelle et ses livres, et je ne sais combien pour ses bagages et ceux de ses gens.
Les litières n'étaient employées que pour les personnes malades et pour les dames à certaines cérémonies d'apparat. C'est ainsi que le comte de Toulouse, Raymond VI, étant malade en Aragon, se fit construire une litière pour aller à Toulouse.
(p. 80) Isabelle de Bavière fit son entrée à Paris le 20 août 1389. La cérémonie surpassa en magnificence tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Le cortége se forma à Saint-Denis. Les seigneurs et les dames s'étaient portés dans cette ville à la rencontre de la princesse: les plus hauts barons rivalisaient de luxe et tenaient à honneur d'escorter les litières des duchesses de Berry, de Bourgogne, d'Orléans et de la reine Isabelle..... La suite de la fête fut un vrai triomphe. Les litières dont il est question dans ce récit étaient-elles portées par des hommes ou par des bêtes de somme, mules ou chevaux? C'est ce que l'histoire ne nous dit pas.
Les Houspilleurs, les Écorcheurs et les Retondeurs, qui avaient continué l'œuvre de déprédation des Routiers, furent poursuivis par Charles VII, qui réorganisa l'armée et protégea enfin les bourgeois et les paysans.
Louis XI rendit les routes plus sûres que n'étaient les environs de son redoutable château de Plessis-lès-Tours. Le service des postes fut organisé par lui, le 19 juin 1464. Un grand maître était nommé par le roi, avec des maîtres-coureurs royaux sous ses ordres, et deux cent trente courriers pour agents. La circulation devenait donc plus facile. Des nuntii volantes, qui se chargeaient du transport des lettres, des paquets et des personnes, avaient bien été établis précédemment par l'Université pour les relations des écoliers avec leurs familles, mais aucun service d'ensemble n'avait été organisé.
Sous le règne de Louis XII, «les poules couraient (p. 81) aux champs hardiment et sans risques», car les pillards étaient exécutés; mais sous François Ier, le pillage recommença dans les campagnes et les Mauvais Garçons et les Bandouliers continuèrent les exploits des Routiers et autres Malandrins des siècles précédents. Le fils du roi, lui-même, le duc d'Orléans, s'en allait, par partie de plaisir, ferrailler contre les laquais sur les ponts de Paris. Les bons chemins et les voitures étaient rares. Charles-Quint, le 10 mai 1552, malade de la goutte et poursuivi par Maurice de Saxe, fut forcé de fuir dans une litière au milieu d'un affreux orage, par des sentiers impraticables, à la lueur des torches.
Les moyens de transport les plus populaires étaient alors employés par les gens riches.
On rapporte que Gilles le Maître, premier président du Parlement sous Henri II, stipula, dans un bail avec un de ses fermiers, qu'aux «quatre bonnes fêtes de l'année et aux vendanges, on lui amènerait une charrette couverte et de la paille fraîche dedans, pour y asseoir sa femme et sa fille, et de plus, un ânon ou une ânesse pour sa chambrière, lui se contentant d'aller devant, sur sa mule, accompagné de son clerc à pied».
Cependant, la France s'unifiait; les gens d'armes, de création récente, faisaient la guerre aux pillards; la Renaissance s'ouvrait comme une ère d'apaisement favorable à la fois au commerce, à l'industrie, au développement des voies de communication par terre et par eau, leurs auxiliaires naturels, des moyens de transport, enfin, leurs instruments indispensables.
(p. 82) C'est sous le règne de François Ier que l'on voit apparaître les premiers carrosses. Isabelle, la détestable femme de Charles VI, s'était bien montrée, en 1405, dans un chariot branlant, la première, ou du moins l'une des premières voitures suspendues. Mais ce n'est qu'un fait isolé et sans portée.
Les chroniqueurs font surtout mention des carrosses qui ont appartenu à Diane, fille naturelle d'Henri II, et à Jean de Laval Bois-Dauphin, homme obèse et qui ne pouvait monter à cheval. Les uns prétendent que les voitures restèrent en petit nombre, d'autres, au contraire, «que les dames les plus qualifiées ne tardèrent pas à s'en procurer. Le faste, ajoutent-ils, fut porté si loin, qu'en 1563, lors de l'enregistrement des lettres patentes de Charles IX pour la réformation du luxe, le Parlement arrêta que le roi serait supplié de défendre les coches par la ville. Les conseillers et présidents continuèrent d'aller au Palais sur des mules jusqu'au commencement du dix-septième siècle.»
Les voitures n'étaient certainement pas encore en grand nombre à cette époque.
Le passage suivant, extrait de Brantôme, le montre d'ailleurs bien nettement. Il nous fait connaître ce qu'était un maître-général des postes sous Henri III.
Brusquet avait une centaine de chevaux dans ses écuries, et «je vous laisse à penser le gain qu'il pouvoit faire de sa poste, n'y ayant point alors de coches, de chevaux de relays, ny de louage que peu, comme j'ay dict, pour lors dans Paris, et prenant pour chasque (p. 83) cheval vingt solz, s'il estoit françois, et vingt-cinq s'il estoit espagnol, ou autre estranger».
Les voitures étaient encore peu nombreuses sous le règne d'Henri IV; on peut en juger par ce qu'en avait le bon roi: «Je ne sçaurois vous aller voir aujourd'hui, parce que ma femme se sert de ma coche.» Il n'eut donc, à une certaine époque, qu'une voiture pour lui et la reine. Le nombre de ses équipages augmenta sans doute plus tard, car on trouve dans les Estampes de la Bibliothèque les dessins de plusieurs carrosses armoriés aux initiales royales et qui ont dû appartenir à la cour.
Ces voitures diffèrent notablement de celles que nous voyons aujourd'hui. Elles se composent d'une caisse rectangulaire non suspendue, pouvant recevoir quatre personnes sous une toiture ou impériale que supportent des colonnettes en quenouilles sculptées. De simples rideaux, ordinairement relevés sous la toiture ou contre les colonnes, servent à garantir des injures du temps ou de l'ardeur du soleil.—Cette voiture primitive ne peut mieux se comparer qu'à nos tapissières modernes, enrichies, mais moins légères.
Sully, qui réunissait dans ses mains les charges les plus importantes du royaume, qui était à la fois «superintendant des fortifications, bâtiments, ouvrages publics, ports, havres, canaux et navigations des rivières, grand maître de l'artillerie et grand voyer de France, etc.», prenant en aussi grand souci les intérêts de l'agriculture que ceux du commerce et de l'industrie, améliora les moyens de communication, fit (p. 84) planter, le long des routes, ces ormes qui, suivant les uns, devaient servir à réparer les affûts brisés des canons, mais, suivant d'autres, à abriter les voyageurs. Il se connaissait en chevaux et ne dédaignait pas d'en faire commerce, encourageant ainsi l'élève des auxiliaires les plus indispensables de l'agriculture. N'a-t-il pas dit «que le labourage et le pâturage étaient les deux mamelles qui nourrissaient la France, les vrais mines et trésors du Pérou.» À l'Assemblée du commerce, qui fut réunie en 1604, le roi proposa la fondation d'un haras, pour éviter l'achat des chevaux à l'étranger. Les postes, aussi bien que l'artillerie, devaient profiter de cette nouvelle création, car ce service prenait une importance croissante. Les chevaux de poste faisaient partie du domaine royal et étaient marqués de l'H fleurdelisée.
Le ministre d'Henri IV, malgré son horreur pour les superfluités et les excès en habits, pierreries et festins, bâtiments et carrosses, ne laissait pas que d'avoir de touchants regrets pour la cour du roi Henri, lorsqu'il la quitta, après la mort de son maître. Nous ne pouvons résister au désir de rappeler les jolis vers dans lesquels il peint son chagrin. Le ministre se fait poëte:
Adieu maison, chasteaux, armes, canons du roy;
Adieu conseils, trésors, déposez à ma foy;
Adieu munitions; adieu grands équipages;
Adieu tant de rachapts, adieu tant de mesnages;
Adieu..............
................
(p. 85) Adieu soin de l'Estat, amour de ma patrie;
Laissez-moi en repos finir aux champs ma vie.
Sur tout adieu, mon maistre, ô mon cher maistre, adieu;
................
Nous arrivons au règne de Louis XIII et de Louis XIV, de Richelieu et de Mazarin.
Les voitures se multiplient, aussi bien à Paris qu'en province. Le maréchal de Bassompierre rapporte d'Italie, en 1599, le premier carrosse avec des glaces[6]. L'ancien chariot branlant d'Isabelle est devenu un carrosse suspendu sur des soupentes, avec cocher au devant et laquais par derrière. Les rues de Paris, celles de plusieurs villes du royaume, sont pavées et bien entretenues: la sécurité y règne durant le jour, et si, la nuit, quelques-unes sont encore obscures, le guet aide à les franchir. Les lanternes de La Reynie ont succédé aux flambeaux à chandelle de Laudati, aux falots alimentés de goudron ou de résine de Pierre des Essarts, et Paris devient la grand'ville, la ville du Roi-Soleil.
L'ancien coche, appelé corbillard, assez semblable d'ailleurs aux voitures actuelles des pompes funèbres, a fait place au carrosse. La forme est devenue plus gracieuse. Les côtés de la voiture, le devant et le fond ne sont plus fermés de leurs mantelets de cuir ou d'étoffe, mais de parties pleines, ajourées par des glaces. La saillie des portières n'existe plus. Celles-ci (p. 86) ont toute la hauteur de la voiture et sont garnies de glaces mobiles. Le carrosse a sept pieds de longueur sur quatre pieds quatre pouces de largeur à la ceinture et cinq pieds neuf pouces de hauteur à la portière. Sa construction est solide, mais il est lourd et convient mieux aux grands attelages de la cour qu'à ceux plus modestes des petits seigneurs. Les uns ont quatre ou six chevaux, les autres en ont huit.
Tels étaient les carrosses dans lesquels on allait se promener au Cours-la-Reine, à l'extrémité des Tuileries. On y faisait assaut de plumes, de rubans, de canons..., de toilettes, enfin, comme on fait aujourd'hui aux Champs-Élysées ou au Bois. Ou bien on allait à la foire Saint-Germain, qui durait deux mois, à partir du 3 février. Dans les ruelles obscures de ce marché, où l'on vendait toutes choses, comme dans celles de l'hôtel Rambouillet, ou dans la maison du Baigneur, les «raffinés» d'alors, devenus les «petits crevés» ou les «gommeux» d'aujourd'hui, étalaient leurs dentelles et leur esprit. On y causait, un masque au visage, en jouant à la loterie, au profit des religieux du couvent voisin.
Les riches n'étaient pas seuls à user de la faculté d'aller en voiture. Nicolas Sauvage avait établi rue Saint-Martin, à l'enseigne de Saint-Fiacre, des remises de carrosses qu'il louait à l'heure ou à la journée. L'enseigne donna son nom aux voitures. C'est ainsi que les Meritoria vehicula des Romains se sont appelés des fiacres sous la minorité de Louis XIV.
D'autres industriels suivirent l'exemple de Sauvage. (p. 87) Après Charles Villerme, M. de Givry, en mai 1657, puis les frères Francini, en septembre 1666, se firent entrepreneurs de voitures publiques.
M. de Givry avait obtenu «la faculté de faire établir dans les carrefours, lieux publics et commodes de la ville et faubourgs de Paris, tel nombre de carrosses, calèches et chariots attelés de deux chevaux chacun, qu'il jugerait à propos, pour y être exposés depuis les sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir et être loués à ceux qui en auraient besoin, soit par heure, demi-heure, journée ou autrement, à la volonté de ceux qui voudraient s'en servir pour être menés d'un lieu à un autre où leurs affaires les appelleraient, tant dans la ville et faubourgs de Paris, qu'à quatre et cinq lieues aux environs; soit pour les promenades des particuliers, soit pour aller à leurs maisons de campagne.»
Un règlement de 1688 fixa l'emplacement des stations et une ordonnance du 20 janvier 1696 le tarif des fiacres; on payait 25 sous pour la première heure et 20 sous pour les suivantes.
Ce qui nous semble si naturel aujourd'hui était à cette époque l'objet d'un grand étonnement. «Ce fut en ce temps-là, dit Voltaire, qu'on inventa la commodité magnifique de ces carrosses, ornés de glaces et suspendus par des ressorts; de sorte qu'un citoyen de Paris se promenait dans cette grande ville avec plus de luxe que les citoyens romains n'allaient autrefois au Capitole.»
Le Cathéchisme des courtisans de la cour de Mazarin (1649) n'est pas moins expressif: «Qu'est-ce que Paris?—Le (p. 88) paradis des femmes, le purgatoire des hommes et l'enfer des chevaux!»
À côté des fiacres, les carrosses à cinq sols, les omnibus circulent. Pascal en est l'inventeur. Ils furent inaugurés le 18 mars 1662, ainsi que le constate Jean Loret, poëte normand, dans sa muse historique:
L'établissement des carrosses,
Tirez par des chevaux non rosses
(Mais qui pourraient à l'avenir
Par le travail le devenir),
A commencé d'aujourd'hui même.
Commodité sans doute extrême,
Et que les bourgeois de Paris,
Considérant le peu de prix
Qu'on donne pour chaque voyage,
Prétendent bien mettre en usage.
...........
Le dix-huit de mars, notre veine,
D'écrire cecy prit la peine.
Mais ce ne fut pas l'auteur des Provinciales qui tira parti de sa découverte. Des lettres patentes, de janvier 1662, confèrent au duc de Roanès et aux marquis de Sourches et de Crenan la faculté d'établir des carrosses, en tel nombre qu'ils jugeront à propos, aux lieux qu'ils trouveront le plus commode, à des heures déterminées pour chaque route, chaque voyageur ne payant qu'un prix modique.
L'Administration laissait plus de latitude, à cette époque, aux concessionnaires d'entreprises diverses qu'elle n'en donne aujourd'hui. Le prix des places fut fixé à cinq sols; le nombre des voyageurs, qui n'était (p. 89) primitivement que de six, fut porté à huit. Ce n'était pas la grande voiture démocratique, égalitaire de nos jours, où, moyennant payement, quiconque peut prendre place. Il était interdit à tous soldats, pages, laquais et tous autres gens de livrée, manœuvres et gens de bras, d'y entrer, pour la plus grande commodité et liberté des bourgeois, lit-on sur un placard,—pour la plus grande commodité et liberté des gens de mérite, lit-on à côté.
Les voitures n'étaient autres que ces lourds carrosses que nous avons déjà décrits. Il y en avait sept par ligne ou par route, comme on les appelait alors, et cinq routes furent successivement créées du 18 mars au 5 juillet 1662. Les armes de la ville étaient peintes sur les voitures. Des fleurs de lis, en plus ou moins grand nombre, servaient à les distinguer. Les cochers étaient aussi vêtus aux couleurs de la ville, et galonnés de différentes nuances selon les routes qu'ils desservaient.
Les innovations de la capitale furent promptement connues en province. Le service des postes devenait plus parfait et s'étendait chaque jour. Le port d'une lettre de Paris à Lyon n'était que de deux sous (aujourd'hui vingt-cinq centimes). En 1653, la petite poste fut établie à Paris, pour l'intérieur de la ville. On se fait d'ailleurs une idée de l'importance croissante prise par les postes en rapprochant le prix des baux payés par les contrôleurs généraux à différentes époques. En 1602, la ferme des postes était de 97,800 livres; en 1700, elle s'élevait à 2,500,000 livres.
Louis XIV, en 1676, voulut réunir en une seule et (p. 90) même administration les divers services des coches, des carrosses, des messageries et des postes. Mais cette tentative de centralisation n'aboutit pas, et, au bout de quelques années, les services de voitures publiques furent donnés à bail, à prix débattu, à divers entrepreneurs.
Tandis qu'en 1517 il n'existait qu'un service public de carrosses de Paris à Orléans, les coches, en 1610, cent ans après environ, desservaient Orléans, Châlons, Vitry, Château-Thierry et quelques autres villes. Sous l'administration de Richelieu et de Mazarin, de nouveaux services étaient établis, et à la fin du dix-septième siècle les principales villes du royaume étaient en relation avec la capitale.
La France n'était pas seule à se servir de carrosses. En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, les voitures se répandaient.
Selon Anderson, les premières voitures auraient été importées d'Allemagne en Angleterre par Fitz Allan, comte d'Arundel. Certains commentateurs prétendent, au contraire, qu'un Hollandais, Guylliam Boonen, aurait introduit l'usage des voitures en Angleterre, vers 1564. D'autres enfin indiquent une date plus récente et rapportent que Walter Ripon fabriqua en 1555 un carrosse pour le comte de Rutland, carrosse ayant un train de devant mobile et tournant.
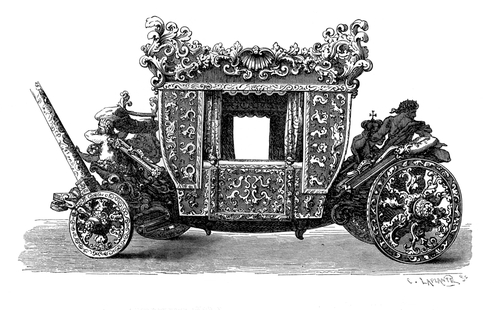
Fig 15.—Voiture du comte de Castelmaine, ambassadeur extraordinaire de Jacques II.
Mais si la date de l'apparition du premier carrosse est incertaine, il n'est, du moins, pas douteux que l'usage des voitures se répandit promptement. L'Italie, où la France alla chercher ces artistes de tous genres qui (p. 93) firent briller la Renaissance d'un si vif éclat, l'Italie était au premier rang par le luxe qu'elle déployait dans la construction de ses voitures.
Dans le récit de la solennité organisée à Rome, le 8 janvier 1687, en l'honneur du comte de Castelmaine, ambassadeur extraordinaire de Jacques II, roi d'Angleterre, auprès du pape Innocent XI, se trouvent la description et les dessins des voitures dans lesquelles l'ambassadeur se rendit à l'audience du saint-père.
Nous traduisons cette description de l'italien de l'époque, en l'abrégeant et en ne laissant qu'une partie des nombreux superlatifs qui s'y trouvent. «La machine doit sa grandeur et sa merveilleuse majesté tant aux étranges et très-remarquables ciselures qui l'ornent et l'enrichissent qu'aux grandes proportions, au goût, à la bonne direction qui ont été donnés à ce grand ouvrage. Il n'y a, dans toute la voiture, aucune partie qui ne soit majestueusement enrichie de figures d'un dessin parfait, de grandeur naturelle, de feuillages riches et gracieux, de ferrements ciselés et contournés en merveilleuses arabesques. Tout est recouvert d'or et fait avec tant de richesses qu'il semble à l'œil que la masse ait été coulée d'une seule pièce avec du métal pur.
«Le grand coffre et le plafond du carrosse sont doublés extérieurement du plus riche et du plus remarquable velours cramoisi qu'il soit possible de trouver. Sur cette doublure, qui sert de fond, ressortent de nombreuses et somptueuses arabesques de broderies d'or, entièrement en relief, fixées d'une manière nouvelle (p. 94) et splendide avec les clous les plus riches, sur les arêtes, les panneaux, les portières et les autres parties du carrosse. De grandes et magnifiques volutes naissent des replis d'une riche coquille placée au milieu de la bordure du haut et vont en grandissant vers les quatre coins, dans les proportions indiquées par le dessin. Elles se détachent de cette bordure et viennent former, avec un arrangement de feuillage des plus somptueux, de riches fleurons brodés d'or, se dressant en grandes gerbes à plusieurs palmes de hauteur et retombant sur le plafond du carrosse qu'elles recouvrent en grande partie, de façon à produire un bel et pompeux effet.
«La richesse de l'ornementation ne nuit pas, comme il arrive souvent, aux proportions du dessin et à la valeur de la matière, grâce aux petits espaces de couleur qui, de distance en distance, ont été laissés à découvert pour ne pas aveugler les regards par une trop grande vivacité.
«À l'intérieur, le plafond est caché, sur cinq palmes de longueur et quatre de largeur, par les armoiries de Son Excellence, brodées en relief en argent et en or et nuancées selon les règles de la science héraldique.
«Les arabesques des quatre coins se raccordent à ces armoiries. En dedans comme en dehors, une grande frange d'argent et d'or garnit la bordure et se développe comme une dentelle en flocons et cascades, d'un éclat éblouissant. L'intérieur du coffre est doublé du plus riche brocart. Les rideaux sont faits d'une superbe bande semée de fleurs.
(p. 95) «La partie postérieure du carrosse est merveilleusement ornée de feuillages et de figures d'une composition et d'une exécution remarquables, exprimant la grandeur de la puissance de la Grande-Bretagne. La possession des vastes royaumes soumis à la couronne d'Angleterre est symbolisée par la déesse Cybèle et par Neptune, le souverain de la mer.
«Ces personnages, à l'attitude majestueuse, soutiennent chacun d'une main la couronne royale, s'appuyant de l'autre sur deux grands tritons, enlacés de gracieux feuillages. La licorne et le lion, soutien des armes d'Angleterre, paraissent entraîner toute la machine. Entre eux s'agitent deux gracieux enfants.
«Du côté du timon, éclate la richesse de ferrements refouillés de la manière la plus variée et la plus riche, recouverts d'or comme le reste. Au milieu, le siége soutenu par deux tritons. Deux dauphins supportent une coquille remarquablement grande, qui sert d'appuie-pieds pour le cocher et en avant de laquelle un enfant semble indiquer la route.
«Tout, au dedans comme au dehors de la voiture, est si parfaitement et si complétement achevé qu'une simple description et un dessin peuvent difficilement le faire concevoir. Il faudrait voir de près.»
Ainsi qu'on le comprend par la profusion des épithètes qu'a employées Giovanni Michele, majordome du comte de Castelmaine, auteur de ce récit, ce carrosse devait être tout ce que l'art du temps pouvait produire de plus beau et de plus achevé. La richesse du texte et des gravures destinées à faire passer à la postérité le (p. 96) souvenir de si grandes merveilles montre que rien ne pouvait être trop beau pour une voiture si rare.
Nous le verrons bientôt: les plus riches carrosses de nos jours ne sont pas plus remarquables par leurs ornements que celui dont nous venons de rapporter la description, mais ils l'emportent tous sans exception sur celui-ci par la légèreté de leurs formes, la grâce de leurs contours. Le fer et l'acier prennent sous la main de nos ouvriers les formes les plus diverses et les plus contournées. Les bois les plus précieux se travaillent et se découpent comme de fines dentelles. Les étoffes enfin sont plus riches et plus remarquables qu'elles n'ont jamais été.
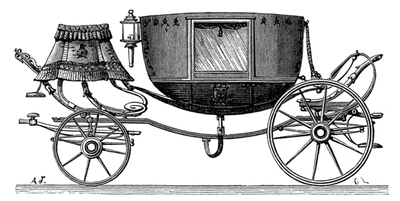
Fig. 16.—Voiture d'apparat.
Les voitures ressemblent aux habitations. Les détails de leur construction exigent le concours d'artistes nombreux, qui poursuivent tous isolément ce même but, dont ils approchent de plus près chaque jour, sans jamais l'atteindre, la perfection.
Le faste du règne de Louis XIV, le luxe et les plaisirs du règne de Louis XV développent au dix-huitième siècle le goût des carrosses et font naître leurs nombreuses variétés.
À côté des voitures de la cour qui se distinguent par la richesse de leur ornementation, l'ampleur de leurs formes, mais aussi par leur poids, circulent les carrosses modernes, les berlines, les diligences.
Les voitures qui donnent l'idée la plus exacte de ce qu'étaient les berlines d'autrefois, sont nos fiacres actuels. Les berlines (on prétend qu'elles furent inventées à Berlin) étaient d'abord portées par des soupentes de cuir attachées aux deux extrémités du train; ces soupentes ont été plus tard remplacées par des ressorts. Elles contenaient quatre personnes assises sur deux siéges. Au-dessous de la voiture était souvent un coffre appelé cave, où l'on plaçait les provisions de voyage.
(p. 98)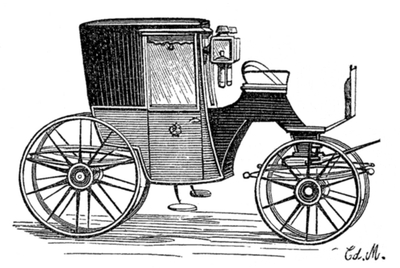
Fig. 17.—Coupé.
La berline ne contenait parfois que deux places, et prenait alors le nom de vis-à-vis.
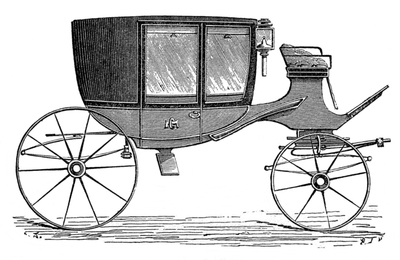
Fig. 18.—Berline.
Les diligences, carrosses-coupés ou berlingots ne sont autres que des berlines rendues plus légères par la suppression de la partie située en avant de la portière. Ces voitures ne contiennent plus alors que deux personnes placées sur le siége de derrière, ou trois lorsqu'il existe un strapontin. La désobligeante n'est (p. 99) autre que la diligence réduite de moitié dans le sens de la largeur ou que le vis-à-vis coupé au milieu de sa longueur. Il ne donne place qu'à une personne.
Telles sont les voitures de ville, qui ont donné naissance à nos élégantes voitures modernes: la berline, le coupé, le coupé trois-quarts et leurs variétés. Les longues soupentes et leurs moutons, les ressorts qui se remontaient avec des crics, ont été remplacés par les ressorts en col de cygne et par les ressorts à pincettes. La caisse est devenue plus légère; les formes massives commandées par le mauvais état des voies publiques ont disparu; les roues d'autrefois, dont nos paysans voudraient à peine aujourd'hui pour leurs voitures de foire, débarrassées d'un trop lourd fardeau, se font remarquer maintenant par cette exquise finesse dont l'araignée offre le plus remarquable spécimen.
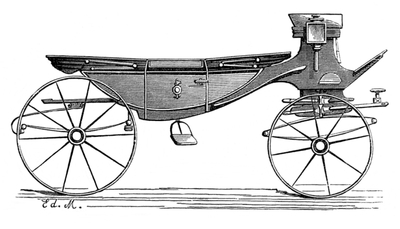
Fig. 19.—Landau.
Les voitures de campagne, on l'a déjà pressenti, étaient encore plus lourdes que les voitures de ville. (p. 100) On avait la gondole, qui pouvait contenir douze personnes assises. C'était un grand coffre, avec banquette sur les quatre faces, éclairé par huit petites fenêtres, trois de chaque côté, une à l'avant, une à l'arrière. Au-dessous du plancher se trouvait, comme dans la plupart des voitures de cette époque, la cave destinée à contenir les provisions et les hardes. D'ailleurs, cette voiture était extrêmement lourde, d'un accès difficile, et semblait refuser aux voyageurs, par la petitesse de ses ouvertures, l'air qu'ils allaient chercher à la campagne.
La berline à quatre portières, ou berline allemande, était aussi voiture de campagne. Le roi et les princes s'en servaient bien à la ville, mais elle s'employait spécialement pour les promenades. Elle ne contenait que six personnes, disposées tout autrement que dans la gondole: au lieu d'un siége circulaire, il y avait trois banquettes parallèles, deux contre les fonds, une au milieu. Il y avait donc deux ruelles desservies chacune par deux portières, une sur chaque face latérale.
La gondole mesurait 8 pieds sur 4 pieds 3 pouces en moyenne à la ceinture. La berline allemande était un peu plus petite: 6 pieds ½ de longueur sur 44 à 46 pouces de largeur.
On le voit, la différence est grande de ces voitures dans lesquelles nos arrière-grands-pères allaient respirer l'air des champs, à celles que nous avons aujourd'hui. Quel sentiment de gêne et de malaise n'éprouverions-nous pas s'il nous fallait changer notre calèche découverte, qui permet de respirer librement, (p. 101) de s'allonger, de jouir à l'aise de la vue de la campagne, pour une de ces grandes et lourdes boîtes fermées, privées d'air et de lumière, et où l'on ne pouvait s'étendre pour dormir qu'à la condition d'en défoncer les parties antérieure et postérieure, pour y passer la tête et les jambes! Dans les dormeuses d'autrefois, le fond et le devant de la voiture, au lieu d'être fixes comme dans les voitures ordinaires, étaient rendus mobiles à l'aide de charnières. Le fond s'abaissait sous les reins du voyageur, une petite niche creuse se formait à l'avant, dans laquelle il pouvait loger ses pieds!
Ces artifices de construction ne seraient plus admis aujourd'hui que dans les voitures de malades.
Notre landau moderne, pouvant s'ouvrir et se fermer à volonté, servir à la ville ou à la campagne, par le beau ou par le mauvais temps, l'emporte de beaucoup sur toutes les voitures anciennes dépourvues de grâce et de légèreté, aussi bien que de confortable. Il peut servir à mesurer les progrès qu'a faits la carrosserie depuis l'époque où Roubo, le fils, écrivait son Art du menuisier-carrossier, c'est-à-dire depuis cent ans.
Ces progrès sont encore plus appréciables dans la carrosserie de voyage que dans la carrosserie de ville ou de campagne.
Les voitures de voyage du siècle dernier s'appelaient coches. Les coches qui faisaient le service de Paris à Lyon étaient composés d'une caisse, mesurant 7 pieds de longueur sur 5 pieds de largeur à la ceinture, (p. 102) éclairée par trois fenêtres étroites sur chaque face et suspendue à l'aide de soupentes sur un train portant à l'avant le cocher et à l'arrière les bagages. Le coche de Lyon avait reçu le nom de diligence, ce qui tend à montrer la rapidité du trajet: cinq jours l'été et six jours l'hiver! Douze personnes pouvaient prendre place dans la diligence, à raison de 100 livres par voyageur, nourriture comprise.
Aujourd'hui, la distance de Paris à Lyon est franchie en dix heures, moyennant 63f,05, 47f,30, ou 34f,70 selon qu'on prend place en 1re, en 2e ou en 3e classe.
Pour aller à Strasbourg, le coche mettait douze jours! La vapeur met douze heures.
La voiture de Lille mettait deux jours. Le voyage coûtait 55 livres, y compris la nourriture, ou 48 livres sans nourriture. Aujourd'hui, on va à Lille en 4h,30m, moyennant 30f,80 en 1re classe.
La voiture de Rouen partait trois fois par semaine et mettait un jour et demi à faire le trajet. Le prix des places était de 12 livres. Aujourd'hui, le prix des places pour Rouen est de 16f,75, 12f,50, 9f,20, et la durée du trajet est de 2h,40m.
Il y avait aussi des coches ou des carrosses pour Chartres, Rennes, Orléans, Angers, Arras, etc., partant à des heures régulières et accomplissant leur service dans une durée plus ou moins longue suivant le temps, les accidents de la route, la promptitude des hôteliers et des aubergistes où l'on s'arrêtait pour prendre les repas et passer les nuits.
(p. 103)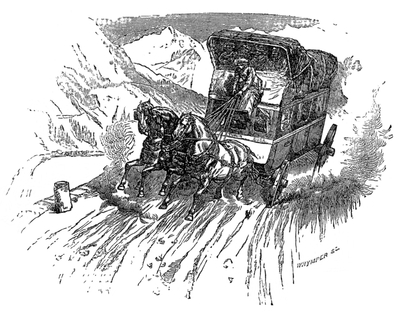
Fig. 20.—Diligence.
Les mauvaises voitures publiques qui existent encore sur quelques routes de la France et qui font le service de la correspondance des chemins de fer sont des modèles de perfection à côté de celles qui existaient au siècle dernier. C'est seulement en 1775 que les Messageries royales s'établirent rue Notre-Dame-des-Victoires, où elles sont encore, après avoir changé de nom sous les divers régimes qu'elles ont traversés, s'appelant tantôt royales, tantôt nationales, tantôt impériales. Les grandes entreprises peuvent aisément perfectionner leur matériel, grâce aux capitaux importants dont elles disposent: la turgotine des messageries vécut de longues années, et en 1818 enfin, on vit apparaître (p. 104) les grandes diligences à trois compartiments: coupé, intérieur, rotonde, surmontés d'une impériale pour les bagages avec banquette pour les fumeurs. Ces diligences disparaissent tous les jours, ou sont refoulées loin des grands centres et dans les pays de montagnes.
Là, elles se modifient pour répondre à de nouvelles exigences. Le plus souvent, leurs dimensions diminuent, et au lieu des cinq chevaux d'autrefois, deux ou trois suffisent au véhicule amoindri. Sur les routes accidentées de la Suisse, il faut augmenter leur stabilité, sans réduire leurs dimensions. Les bagages sont placés à la base de l'édifice roulant, les voyageurs sont élevés pour mieux jouir des beautés du paysage, et, le centre de gravité étant abaissé, le véhicule court moins de risques de rouler au fond des précipices ou de verser sur les talus rapides des voies de montagne.
Nous nous rappelons avoir vu, il y a une vingtaine d'années, une modification assez curieuse du train des grandes diligences des messageries royales. Elle consistait dans l'adjonction d'un troisième essieu aux deux essieux primitifs. La charge placée sur ces grandes diligences aux abords de Paris était devenue tellement considérable, que pour attribuer à chaque essieu une charge moindre, pour moins fatiguer les chaussées, et donner enfin plus de stabilité à ces grands édifices roulants, on avait cru devoir augmenter le nombre des supports et créer un troisième essieu. Mais cette tentative n'eut pas de suite. Les inconvénients qu'elle présentait la firent promptement abandonner, et l'on revint à l'ancienne diligence à quatre roues.
(p. 105) À côté des diligences destinées au public, circulaient il y a quelques années les chaises de poste, devenues bien rares aujourd'hui. Le postillon est une espèce disparue. Les fourgons du Petit Journal à Paris, les voitures de quelque fils de famille, qui veulent faire du bruit.... avec des grelots, nous en montrent seuls de rares spécimens. Mais disons d'abord ce qu'étaient les chaises en général.
«Ces voitures, dit Roubo, sont à une ou deux places et diffèrent des carrosses-coupés ou diligences en ce que leur caisse descend plus bas que les brancards de leur train, de sorte qu'il ne peut y avoir de portières par les côtés, puisqu'elles ne pourraient pas s'ouvrir, mais qu'au contraire il n'y a qu'une portière par devant, dont la ferrure est placée horizontalement, de sorte que la portière se renverse au lieu de s'ouvrir. Ces espèces de chaises sont d'une nouvelle invention (1771); les plus anciennes, que l'on nomme chaises de poste, n'ont été construites dans l'état où nous les voyons maintenant qu'en 1664. Celles qui existaient auparavant, quoique peu antérieures à ces dernières, n'étaient qu'une espèce de fauteuil suspendu entre deux brancards supportés par deux roues.» On attribue l'invention des chaises de poste à un certain de la Grugère. Le privilége exclusif en fut accordé au marquis de Crenan, qui les nomma chaises de Crenan.
Les chaises de Crenan furent trouvées trop pesantes, et on leur substitua une autre espèce de voiture roulante, faite sur le modèle de celles dont on se servait en Allemagne depuis longtemps et qui subsistaient (p. 106) encore, au milieu du siècle dernier, sous le nom de soufflets.
Les chaises de poste, encore très en usage au commencement de ce siècle, disparaissent tous les jours. Elles ne peuvent offrir ni la rapidité, ni le confortable de nos chemins de fer, et il faut aimer l'isolement, les secousses et les aventures plus que de raison, pour les préférer aux avantages d'un coupé ou d'un wagon-salon, qu'une bourse bien garnie peut toujours se donner.
Une autre voiture de voyage, très-employée en Angleterre, et dans la construction de laquelle les carrossiers anglais ont montré un art tout particulier, est le coach-mall: c'est l'ancienne voiture des postes. Une grande caisse centrale, dans laquelle prennent place les domestiques, est précédée et suivie de plusieurs banquettes destinées aux maîtres de l'équipage. Deux grands coffres servent à loger les paniers ou les caisses qui contiennent les vivres et les ustensiles de service nécessaires pour faire un repas en plein air ou sur le turf. On pourrait parfaitement leur conserver le nom de caves des voitures d'autrefois, car les vins généreux y sont toujours en abondance. Quatre chevaux ornés de rubans, de fleurs, de grelots ou de clochettes, conduits en poste ou à grandes guides, traînent le véhicule, et lui donnent cet air de noblesse qui convient à l'aristocratie britannique.
C'est là, à notre avis, la vraie voiture de voyage, la vraie voiture de touriste. Toute une famille, avec ses serviteurs, peut y prendre place et entreprendre le (p. 107) plus grand voyage continental. Par le beau temps, les maîtres seront au dehors, sur les banquettes; s'il vient à pleuvoir, ils rentreront. Les chevaux se reposeront pendant les repas et l'heure de la sieste; et on ira ainsi, par monts et par vaux, libres de tous soucis, oublier bien loin l'énervante activité, l'atmosphère accablante de la grande ville et se replonger dans le sein de la mère nature, sous les ombrages frais et l'air du ciel qui vivifient.
Mais différons encore ces longues et attrayantes entreprises, et revenons à nos chaises.
Nous ne pouvons donner une meilleure idée de ces voitures qu'en les comparant à notre cabriolet à deux roues, ou tilbury moderne, à cela près que la caisse était fermée, comme celle d'un coupé. Fixée en avant de l'essieu, elle pesait lourdement sur le cheval, lorsqu'elle n'était pas équilibrée par le poids des laquais ou des bagages placés sur la plate-forme d'arrière. Les conditions d'équilibre étaient aussi mal observées que dans la volante havanaise, vaste cabriolet découvert, pesant lourdement sur le petit cheval qui y est attelé et sur le dos duquel on a placé, comme par surcroît, un postillon nègre, en grande livrée.
Les chaises à porteurs sont assez semblables, pour la forme de la caisse, aux chaises dont nous venons de parler, mais l'usage en est tout différent. La chaise proprement dite est une voiture, tandis que la chaise à porteurs dérive du palanquin, de la litière. Le palanquin, usité encore dans les Indes, en Chine, dans les pays chauds et dans quelques parties de l'Amérique, (p. 108) convient aux habitudes indolentes et paresseuses des Orientaux. Un dais et des éventails garantissent des ardeurs du soleil; la pluie est rarement à redouter. L'air peut circuler autour des colonnettes et des tentures de ce léger édifice.

Fig. 21.—Volante havanaise.
Dans nos climats, on doit prendre d'autres précautions. Les litières et les chaises à porteurs sont fermées. Les premières peuvent contenir deux personnes, elles sont portées par des chevaux ou des mulets au moyen de brancards passant de chaque côté de la caisse, qui mesure d'ordinaire 24 à 26 pouces de largeur, 5 pieds de long et 4 pieds 8 pouces de hauteur. Les (p. 109) secondes, ne contenant qu'une personne, ont seulement 22 pouces à 2 pieds de largeur, 30 pouces de longueur, 4 pieds 6 pouces de hauteur.
Nous n'avons pas besoin de dire que les chaises à porteurs, aussi bien que les litières, ont complétement disparu. Elles pouvaient convenir à une époque où la circulation était moins active qu'elle ne l'est aujourd'hui, à une époque où le temps avait moins de prix et la vitesse moins de valeur qu'au temps où nous vivons. On n'en voit plus de spécimen que dans quelques opéras et au musée de Trianon à Versailles. Là, on conserve précieusement deux chaises à porteurs, dont les panneaux sont enrichis de peintures qui sont de vraies œuvres d'art: l'une a appartenu à Marie Lezczinska, elle est peinte par Watteau; l'autre, celle de Marie-Antoinette, est peinte par Boucher.
D'autres voitures étaient en usage à la même époque que la chaise à porteurs. Les brouettes étaient montées sur roues et, au lieu de deux porteurs, avaient un traîneur, «ce qui, malgré l'usage, ne faisait pas beaucoup d'honneur à l'urbanité française.»
Il y avait aussi des chaises de jardin, à une seule ou à plusieurs banquettes, mais ces voitures sont sans intérêt. C'est le type qui s'est maintenu jusqu'à nos jours, et qui a fourni la voiture de malade, la voiture-invalide, avec ou sans leviers, pédales ou manivelles. Nous ne nous y arrêterons donc pas.
Une seule de ces nombreuses voitures du siècle dernier s'est conservée, nous a-t-on dit, sans modification notable. Le wourst ou wource, voiture de (p. 110) chasse, importée d'Allemagne, se retrouve encore dans les montagnes de la Savoie. Le wourst est une voiture à quatre roues, qui se compose essentiellement d'une longue banquette sur laquelle les chasseurs se placent à califourchon. Une banquette à deux places, à l'avant, reçoit le conducteur. Une banquette semblable est placée à l'arrière. Enfin, une large tablette, reposant sur l'essieu de derrière, reçoit les paquets et les provisions que les chasseurs emportent avec eux. La voiture est très-effilée, les roues sont aussi rapprochées que possible, de manière à passer facilement dans les sentiers étroits des forêts.
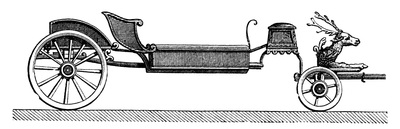
Fig. 22.—Wourst.
La calèche, le char à bancs, le break, sont généralement employés aujourd'hui comme voitures de chasse. Le wourst pouvait satisfaire à certaines exigences, mais il n'avait pas les avantages recherchés dans toutes les voitures modernes.
À mesure que les peuples se civilisent, leur goût pour le confortable et pour le luxe augmente. En général, pour que les voitures obtiennent quelque succès, il faut que leurs formes extérieures aient la grâce qui convient aux choses de luxe et que leur aménagement (p. 111) intérieur donne le confortable auquel nos habitations modernes nous ont accoutumés.
M. Brice Thomas, dans son Guide du carrossier, nous dit avoir connu un inventeur qui avait trouvé le moyen de transformer une voiture à deux roues et à deux places, en voiture à quatre roues et à six ou huit places. La voiture à deux roues était un tilbury monté sur quatre ressorts en châssis. On la transformait en phaéton et il n'y avait plus qu'à rapporter un avant-train mobile; le tilbury à deux roues se trouvait ainsi transformé en voiture à quatre roues et à quatre places. Voulait-on obtenir deux places de plus: on sortait un second tiroir du premier, pour recevoir un autre siége, et ainsi de suite.
Une autre disposition permet de changer le cocher en groom et vice versâ, en plaçant le siége tantôt devant, tantôt derrière la voiture, sans s'inquiéter des changements apportés à la suspension, ou bien à faire du cocher un postillon, ou du postillon un cocher, en supprimant le siége de devant ou en le maintenant.
Il est certain qu'il faut des ressorts complaisants pour se plier ainsi à tous les caprices du maître, et que ce n'est pas sans porter gravement atteinte à la solidité de la voiture qu'on peut tour à tour la charger en avant ou en arrière, selon son bon plaisir.
Les voitures de luxe varient donc à l'infini: le goût du constructeur, le pays, le climat et la saison où on les emploie, le but auquel on les destine, modifient complétement leurs dispositions; mais c'est toujours (p. 112) une caisse montée sur roues et supportée par des ressorts. Le génie des inventeurs ou le caprice des gens riches a modifié de mille manières les diverses parties de la voiture, les roues seules ont résisté; on n'a pas su encore faire autre chose qu'un cercle.
Dans cette foule de voitures de toute espèce que Paris réunit sur ses boulevards et sur ses grandes voies publiques en plus grande quantité que nulle autre ville de France, on retrouve toujours en plus grand nombre ces fiacres avec leur allure modeste, leurs deux chevaux trottinant lentement,—plus lentement à l'heure qu'à la course,—et leur cocher sorti de la Lorraine, de la Normandie, de l'Auvergne ou de la Savoie ou du sein même de Paris, de cette classe à part qui se recrute, dit-on, parmi les huissiers sans contrainte et les photographes sans ouvrage.
Tels sont les descendants de Sauvage, qui ont tour à tour conduit dans la grande ville les citadines, les urbaines, les lutéciennes, les mylords, les thérèses, les cabs et toutes ces variétés plus ou moins disparues qui ont fait place aux petites voitures de la Compagnie générale.
Paris grandissant, les exigences de la circulation se sont accrues. Le nombre des voitures de louage, qui n'était que de 170 en 1755, était de 4,487 en 1855. Il est en ce moment de plus de 9,000, dont un tiers de voitures de grande remise. Ces voitures appartiennent à dix-huit cents entrepreneurs et à la Compagnie générale qui, en 1855, a racheté tous les numéros roulants des entrepreneurs qui ont consenti à se retirer.
(p. 113) Elle seule présente des types de voitures convenables, aux formes étudiées, sans luxe, à la vérité, mais ayant le confortable qui convient au public, ouvrier ou bourgeois, habitué à s'en servir. L'ancien cabriolet a complétement disparu, ce cabriolet à deux roues où l'on avait le plaisir de causer avec le cocher. Il n'y a plus que des voitures à quatre roues, ouvertes ou fermées; les unes et les autres sont à quatre places ou à deux places, et valent en moyenne 1,007 fr. 66.
La Compagnie les construit elle-même. Elle a ses ateliers, ses machines, ses ouvriers, et produit annuellement environ 500 de ces voitures, dont la durée varie de 10 à 12 ans.
En 1866, la Compagnie générale avait mis en circulation 3,200 voitures, desservies par 10,741 chevaux, d'une valeur moyenne de 650 à 800 francs, et d'une valeur totale de près de 8 millions.
Les grandes industries parisiennes méritent la plus grande attention: il faut pénétrer au sein de leur organisation et se rendre un compte exact de leur importance pour comprendre les exigences de cette population dont la fièvre est l'état normal. M. Maxime Du Camp, dans son ouvrage intitulé Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, décrit de main de maître ce grand Paris incessamment agité.
Dans son chapitre des fiacres, auquel nous empruntons quelques-uns des renseignements qui précèdent, il nous dit encore: «Les fourrages consommés en 1866 ont représenté la somme de 9,113,750 fr. 88 c., soit (p. 114) près de 25,000 francs par jour, 7 fr. 64 par voiture et 2 fr. 42 par ration.
Les seuls dépôts, non compris les stations de remise louées dans divers quartiers, représentent une valeur de plus de 13 millions.
Les contributions de toute sorte montent à plus de 2 millions.
Le personnel se compose de 6,800 agents environ.
Ces charges sont énormes, et il arrive, quand les fourrages sont chers, que les recettes n'équilibrent pas les dépenses. En 1864, chaque voiture coûtait 13 fr. 42 par jour et rapportait 14 fr. 55, bénéfice 1 fr. 60. En 1865, au contraire, bien que la recette se soit élevée à 14 fr. 67, la dépense a été de 15 fr. 27 et a entraîné une perte de 0 fr. 60 par voiture, ou de 700 à 800 francs pour l'année.
On comprend ce qu'il faut de science dans la direction d'une grande entreprise de ce genre, où les petites dépenses sont multipliées par de si gros coefficients, pour équilibrer les recettes et les dépenses, et pour faire que les actionnaires, aux assemblées générales, ne s'entendent pas dire quelque phrase de ce genre: «Messieurs, l'année que nous avons eu à traverser n'a pas été heureuse pour notre entreprise; nous avons eu à lutter..., etc.» Quand le mot de lutte apparaît, la défaite n'est pas loin.

Fig. 23.—L'omnibus des boulevards.
Quoi qu'il en soit, on ne peut que rendre hommage au mérite des hommes qui conduisent ces grandes affaires. Il faut connaître les difficultés, sans cesse renaissantes (p. 117) qu'ils ont à vaincre, et l'énergie qu'ils mettent à les combattre, pour les apprécier à leur juste valeur.
La Compagnie des Omnibus n'est pas moins intéressante que celle des Petites Voitures. Les services qu'elle rend à la population parisienne n'éveillent pas moins l'attention que les détails intimes de son excellente organisation.
En 1872, la Compagnie des Omnibus a transporté près de 109 millions de voyageurs, c'est-à-dire plus de cinquante fois la population de Paris, et ces transports ont eu lieu à l'aide de 644 voitures.
Leur trajet annuel est de 22 millions de kilomètres environ, ou plus de 65 fois la distance de la terre à la lune.
Il faut considérer les voitures de la Compagnie au point de vue de l'ingénieur pour bien comprendre la valeur de chacune des dispositions, en apparence insignifiantes, qui ont été adoptées. Les améliorations apportées à la construction de ces voitures depuis leur création sont considérables. La plus importante est la création de l'impériale. C'est par là que l'omnibus, presque exclusivement réservé, à cause du prix de ses places, à la classe bourgeoise, est devenu aussi la voiture du peuple. Tandis qu'au dedans on trouve souvent des toilettes parfumées, on voit sur l'impériale des ouvriers en blouse, la pipe à la bouche. On pourrait presque dire que l'agrandissement de Paris a eu pour conséquence la création des impériales, sans lesquelles la population ouvrière, reléguée dans les (p. 118) quartiers éloignés, n'aurait pu venir au centre où ses travaux l'appellent.
Ces impériales ont aujourd'hui 12 places; à l'origine, elles n'en avaient que 10. Il a fallu, pour placer deux nouveaux voyageurs, avancer le cocher, établir le passage d'arrière un peu en porte-à-faux. Le centre de gravité du véhicule s'est élevé lorsque le chargement a été réparti entre le dedans et le dehors. On ne pouvait abaisser les essieux sans diminuer le diamètre des roues: on les a coudés.
Les siéges ont été améliorés; les marchepieds, les mains courantes sont mieux établis. Il n'est pas jusqu'aux écriteaux, jusqu'au moindre boulon, qui n'ait été l'objet d'études spéciales, et que l'on n'ait modifié et perfectionné conformément aux indications de la pratique.
Les omnibus ont donc aujourd'hui 26 voyageurs: 14 au dedans, 12 sur l'impériale, soit 28 avec le cocher et le conducteur. La voiture pesant 1,700 kilog., et les voyageurs 70 kilog. en moyenne, l'ensemble pèse 3,660 kilog., c'est-à-dire 1,830 kilog. par cheval.
Il faut, pour remorquer de telles charges, dans les conditions difficiles de la circulation parisienne, des chevaux d'une vigueur exceptionnelle: la Normandie, le Perche, les Ardennes, la Bretagne, les fournissent, et leur ration revient à 2 fr. 35 par jour. Aussi bien que les voitures, les chevaux sont examinés avec soin et doivent avoir, pour être admis, des qualités spéciales, et surtout de bonnes jambes de devant, capables (p. 119) de résister longtemps à la fatigue de ces arrêts prompts et répétés de la voiture à laquelle ils sont attelés.
La Compagnie des Omnibus possède environ 8,300 chevaux. Son matériel roulant et sa cavalerie sont répartis dans 40 dépôts qui occupent une surface considérable. Il faut des cours très-vastes pour le lavage des voitures, des remises très-étendues pour les garer et des écuries très-spacieuses pour que les chevaux qui desservent (par dix) chaque voiture, s'y trouvent à l'aise et sainement: certaines écuries sont à deux étages. Il faut enfin des hangars, des greniers, des magasins très-vastes pour contenir les approvisionnements de grains et de fourrages nécessaires à la nourriture de tous ces animaux.
Leurs repas sont réglés, aussi bien que la durée de leur travail quotidien, qui est de 16 kilomètres en moyenne,—aussi bien que leur fatigue, car on leur adjoint des renforts pour gravir les rues trop rapides,—aussi bien que la vitesse de leur marche, car les cochers sont surveillés attentivement.
Comme la Compagnie des Petites Voitures, la Compagnie des Omnibus fabrique elle-même ses voitures. Elle les a ainsi à meilleur marché et est plus sûre de les avoir solides et bien construites. Chaque voiture revient à 3,500 francs environ.
Le tableau suivant donne, d'une manière succincte, une idée de l'importance de l'entreprise:
(p. 120)| Établissements immobiliers, écuries, greniers | 19,367,000 | fr. |
| Chevaux | 7,700,000 | |
| Fourrage en approvisionnement | 1,760,000 | |
| Matériel roulant (voitures, harnais) | 4,120,000 | |
| Ateliers, outillage, rechange, mobilier industriel | 3,599,000 | |
| Voie ferrée et son matériel d'exploitation | 2,144,000 | |
| Divers fonds de roulement | 2,310,000 | |
| ————— | ||
| Total | 41,000,000 | fr. |
Le public réclame parfois la mise en service d'une voiture nouvelle ou la création d'une ligne. Les chiffres qui précèdent lui apprendront qu'une voiture nouvelle exige un capital de 56,810 francs, et une ligne de 20 voitures une somme de 1,100,000 francs.
L'existence d'une aussi vaste entreprise au dedans du mur d'octroi élève dans de très-fortes proportions les dépenses annuelles.
| En 1872, la recette a été de | 21,802,297 | fr. | |
| et la dépense, de | 19,898,146 | ||
| ————— | |||
| D'où résulte un produit net de | 1,904,151 | fr. | |
| Auquel correspond, par journée de voiture, un produit de | 89 | fr. | 74 |
| Or, chaque voiture coûte, par jour | 84 | 40 | |
| ————— | |||
| Reste comme produit net | 5 | fr. | 34 |
Qui croirait, à voir ces omnibus si souvent complets, que le revenu soit aussi faible? Les choses sont telles cependant et, fait remarquable, mais que le calcul démontre (p. 121) nettement, l'omnibus serait-il complet tout le jour de la station de départ à la station d'arrivée, la Compagnie serait en perte. Le renouvellement seul du voyageur durant le trajet produit un bénéfice.
La Compagnie des omnibus possède encore les grands omnibus sur rails qui font le service de la place du Palais-Royal à Sèvres; mais ce n'est là qu'une annexe d'une importance relative peu considérable. Nous ne nous y arrêterons donc pas.
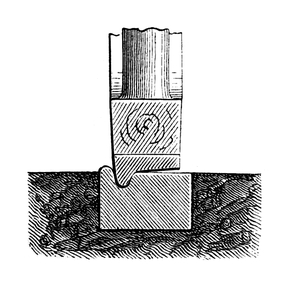
Fig. 24.—Coupe d'un rail de chemin de fer américain.
Nous allons aborder la description de la locomotive sur les voie ferrées. Au lieu des rues limitées d'une cité, nous allons parcourir le territoire d'un pays tout entier; au lieu du souffle borné du cheval, nous aurons le souffle puissant d'une machine qui travaille presque aussi longtemps qu'elle a du charbon et de l'eau à digérer; au lieu de l'industrie de quelques habitants, nous allons servir l'industrie d'un peuple ou d'un continent. Les frontières s'abaisseront et la civilisation progressera.
De toutes les découvertes de ce siècle qui comptera certainement parmi les plus féconds en productions nouvelles, il n'en est aucune qui soit plus importante dans son application, plus considérable dans ses résultats que celle des chemins de fer. Les rails sont aux produits de l'industrie humaine ce que les caractères de l'imprimerie sont à ceux de la pensée. Les noms de Stephenson et de Séguin doivent être inscrits à côté de celui de Gutenberg.
Tout instrument qui contribue à rendre le travail de l'homme plus parfait en multipliant les ressources dont il dispose et en associant de la manière la plus favorable les mérites et les aptitudes variés des peuples répandus à la surface de la terre est certainement appelé à en accroître la valeur dans de très grandes proportions. Or, tel est le résultat des chemins de fer que (p. 123) leur développement rapide rend chaque jour plus remarquable. Ces nouvelles voies unissent les intérêts des nations comme en un même faisceau et font entrevoir la base d'une alliance universelle. Ils effacent les frontières et contribuent bien plus que les traités de paix,—œuvres essentiellement fragiles,—à resserrer les liens sur lesquels repose l'union des membres de la grande famille humaine. Les pays déshérités changent de face sous leur influence régénératrice. L'ignorance disparaît et, où régnait la misère, apparaît le bien-être. La communauté des intérêts entraîne la communauté des affections: élévation matérielle, intellectuelle et morale, tel est le triple résultat de l'invention des chemins de fer.
Quelques chiffres suffisent à donner la mesure du développement actuel des voies ferrées:
| 176,000 | kilomètres | dans le monde entier, | 44 | milliards dépensés; |
| 96,000 | — | en Europe, | 38 | — |
| 17,000 | — | en France, | 8 | — |
| Près de | 3000 | millions de francs de recette brute annuelle. |
| — | 8000 | millions de francs d'économie annuelle sur les anciens transports. |
| — | 2000 | millions de francs d'économie annuelle sur les anciens transports pour la France seulement. |
| On compte: | en Amérique | 74,628 | kilomètres exploités. |
| — | en Europe | 95,888 | — |
| — | en Asie | 6,759 | — |
| — | en Afrique | 1,070 | — |
| — | en Australie | 1,261 | — |
| ——— | |||
| Soit dans le monde entier | 179,606 | kilomètres exploités. | |
(p. 124) Le tableau suivant indique la situation des chemins de fer exploités dans les différents États de l'Europe.
SITUATION DES CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION DANS LES DIVERS ÉTATS
DE L'EUROPE
(Annuaire officiel des chemins de fer, année 1871.)
| ÉTATS. | LONGUEURS EXPLOITÉES. | SUPERFICIE. | POPULATION. | LONGUEURS | |
| par myriam. carré. |
par million d'habitants. |
||||
| kilom. | kilom. c. | habitants. | kil. | kil. | |
| Belgique | 3.052 | 29.455 | 4.897.794 | 10.36 | 623 |
| Gr.-Bretagne et Irlande | 24.760 | 315.640 | 30.000.000 | 7.85 | 825 |
| Pays-Bas | 1.480 | 32.840 | 3.628.468 | 4.51 | 408 |
| Suisse | 1.380 | 41.418 | 2.510.494 | 3.33 | 350 |
| Allemagne | 17.322 | 530.367 | 38.325.858 | 3.27 | 452 |
| France | 16.954 | 543.051 | 38.192.064 | 3.12 | 444 |
| Italie | 5.772 | 284.223 | 25.527.915 | 2.03 | 226 |
| Danemark | 682 | 38.230 | 1.753.787 | 1.78 | 389 |
| Autriche | 8.051 | 620.400 | 31.530.002 | 1.30 | 248 |
| Espagne | 5.407 | 494.946 | 15.752.607 | 1.09 | 343 |
| Portugal | 694 | 89.353 | 3.927.392 | 0.78 | 177 |
| Suède et Norwége | 2.136 | 758.585 | 5.874.836 | 0.28 | 364 |
| Russie | 7.674 | 4.973.786 | 61.231.526 | 0.15 | 125 |
| Turquie, Roumanie, Grèce | 524 | 566.089 | 17.786.032 | 0.09 | 29 |
| Totaux et moyennes | 95.888 | 9.318.385 | 281.938.775 | 1.03 | 240 |
Ces résultats nous rappellent les paroles que prononçait un ministre, à la tribune, après une visite qu'il venait de faire au chemin de Liverpool. «Il n'y a pas aujourd'hui, disait-il, huit ou dix lieues de chemins de fer en France, et, pour mon compte, si l'on venait m'assurer qu'on en fera cinq par année, je me tiendrais pour fort heureux... Il faut voir la réalité; c'est que, même en supposant beaucoup de succès aux chemins de fer, le développement ne serait pas ce que l'on (p. 125) avait supposé.—Vous voulez que je propose aux Chambres de vous concéder le chemin de Rouen, disait le même ministre un ou deux ans plus tard, je ne le ferai certainement pas; on me jetterait-en bas de la tribune!...»
On pouvait alors penser ainsi, mais heureusement, les économistes, les ingénieurs, les capitalistes, les Michel Chevalier, les Séguin, les Talabot, les Didion, les Clapeyron, les Flachat, les Perdonnet, les Pereire et les Rothschild entrevoyaient l'avenir réservé aux chemins de fer.
L'étude d'un chemin de fer comprend deux parties distinctes: la voie, qui est le moyen de transport; le matériel roulant, véhicules et machines, qui sont les instruments du transport. L'un, en diminuant le frottement, produit l'économie; l'autre donne la vitesse; tous deux concourent d'ailleurs à ce double résultat:
Économie de temps et d'argent,
et par suite:
Accroissement de vie et de capital.
À ces deux parties constitutives d'un chemin de fer se rapportent deux périodes distinctes de son existence: la construction et l'exploitation, toutes deux pleines du plus vif intérêt par les problèmes multiples qu'elles donnent tous les jours à résoudre.
Nous passerons rapidement en revue les faits qui se rapportent à la construction.
Une première période, période d'incubation, précède toujours le premier coup de pioche. C'est celle des études. Lorsque les deux points extrêmes d'une ligne ont été déterminés, il reste à fixer les points intermédiaires qu'elle doit desservir. Les considérations les plus diverses interviennent dans la solution de ce problème; les unes sont de l'ordre purement moral, les autres de l'ordre matériel, en ce qui touche, du moins, à la science de l'ingénieur, et si la nature du sol est l'un des premiers éléments du problème à résoudre, il n'est pas tel du moins qu'il impose d'une manière absolue le tracé qui doit être adopté.
Le tracé sera-t-il direct, sera-t-il indirect? Quelles sont les limites d'inclinaison et de courbure qu'il convient d'imposer à son exploitation; aura-t-il deux voies ou n'en aura-t-il qu'une seule et quelle sera la largeur de cette voie ou de ces voies? Quel sera le moteur? Toutes ces questions qui se rattachent à la question capitale du tracé exigent de la part de l'ingénieur une série d'études préliminaires très-délicates, qui sont la base de ce qu'on appelle un avant-projet. Auprès avoir reconnu le terrain et construit le futur chemin sur le papier, il doit se transporter par l'esprit au temps de l'exploitation, chiffrer les revenus, estimer l'importance du trafic et rapprocher la recette probable des dépenses approximatives de construction et d'exploitation. Ce n'est jamais qu'après de longs tâtonnements (p. 127) qu'il arrive à tracer la ligne qui répond de la manière la plus satisfaisante aux intérêts des populations traversées et à ceux des actionnaires qui ont engagé leurs capitaux dans l'entreprise.
Les études de chemins de fer, en France, où nous avons la superbe carte de l'état-major, et dans les pays dont la topographie a été bien représentée, sont généralement faciles; mais, dans les pays neufs, en Russie, en Espagne, en Afrique et dans tant d'autres qu'on a abordés sans aucun guide sûr, le travail est plein de difficultés. On part comme le soldat à la recherche de l'ennemi, bagages et instruments sur le dos, on campe en plein champ, on mange comme on peut, on boit quand on a de l'eau, on se repose quand on tombe de fatigue et on dort souvent à la belle étoile. On lance des lignes d'opération dans différentes directions et souvent, après avoir laissé sa peau et ses vêtements aux ronces du chemin, on vient se butter contre une montagne que les rampes les plus rapides ou les souterrains les plus longs ne pourront franchir. Force est de rebrousser chemin et de chercher un passage dans une nouvelle direction. Les pays de montagne fournissent souvent des accidents de ce genre. Nous pourrions citer telle chaîne dans l'Andalousie contre laquelle trois brigades d'études dirigées par des ingénieurs différents sont venues successivement se heurter et qu'une quatrième enfin a réussi à forcer; travaux pénibles, longs et difficiles, réclamant un coup d'œil juste, une précision rigoureuse et une grande persévérance.
Cette étude du sol qui doit porter l'édifice, n'exige (p. 128) pas des soins moins délicats que la recherche des éléments qui doivent servir à l'évaluation des produits de la future ligne. Partout où la circulation des gens et des choses a été notée d'une manière exacte, le travail est facile; mais, ailleurs, il faut se lancer dans le champ des tâtonnements et des hypothèses. En France, l'administration des ponts et chaussées a fait constater par des comptages, opérés à différentes époques de l'année, l'importance de la circulation sur les routes. Les relevés des contributions indirectes sont une autre source de renseignements précieux. Les octrois des villes et des communes sont aussi d'un puissant secours. Enfin, les indications fournies par les industriels, les grands négociants, complètent la série des documents sur lesquels on peut baser une évaluation sérieuse. Mais, si les premiers éléments d'information méritent une confiance absolue, les seconds, plus ou moins intéressés, réclament un contrôle minutieux et attentif. L'intérêt général disparaît devant l'intérêt privé chez l'usinier qui compte sur l'établissement du chemin de fer pour obtenir ses matières premières à meilleur marché et revendre ses produits à plus haut prix; chez l'agriculteur qui voit par avance monter le prix de ses propriétés et celui de ses récoltes. Luttes de villes, de communes, d'individus, réclamations de toutes sortes s'élèvent durant l'étude du tracé et au moment des enquêtes. L'ingénieur doit tout entendre et se constituer juge suprême du débat. L'administration souveraine prononce, mais sur les rapports qui lui sont fournis par les ingénieurs.
Aux avant-projets généralement étudiés dans différentes directions, succèdent les projets; à l'esquisse, le tracé définitif. Les balises, les jalons, les piquets sont plantés, et sur le coteau ou dans la plaine on voit se dessiner la ligne future. Les études d'ensemble sont suivies des études de détail. Les ouvrages destinés au maintien de la circulation et à l'écoulement des eaux sont projetés aux traversées de chemins et de cours d'eau. Les souterrains et les viaducs sont étudiés. Les variantes du tracé aux abords des faîtes ou des cours d'eau à franchir sont étudiées et comparées au tracé primitif, les terrains sont reconnus par des sondages dans l'emplacement des tranchées à ouvrir, des souterrains à percer ou des ponts à établir, les matériaux de construction sont recherchés, les carrières ouvertes, les briqueteries et les fours à chaux montés.
L'œuvre se prépare: l'appareilleur dresse l'aire sur laquelle il dessine ses épures de coupes de pierres, le charpentier approvisionne ses bois, élève les baraques, met en train la construction des brouettes, des wagons de terrassement, des chariots, des chèvres, des grues, des engins et des échafaudages de toutes sortes, nécessaires à l'exécution des travaux de terrassement et des ouvrages en maçonnerie. Les magasins se garnissent, le fer arrive, voici des rails pour l'établissement (p. 130) des voies provisoires, puis des pompes pour les épuisements, des ventilateurs pour l'aérage des souterrains, des locomobiles pour la mise en marche de ce gros matériel, enfin des locomotives pour le transport rapide des terres déblayées.
Le travail va commencer. Les contre-maîtres envoyés dans différentes directions pour racoler des ouvriers, reviennent avec de nombreuses recrues: ce sont des terrassiers belges, des mineurs piémontais, des maçons ou des tailleurs de pierre d'Ivrée ou de Bielle (dans les États Sardes), des Limousins pour la construction des stations et des maisons de garde. Il a fallu prévoir l'arrivée de toute cette armée d'ouvriers. Les auberges des localités situées dans le voisinage du tracé sont ou trop rares, ou insuffisantes pour abriter tout ce monde. Des cantines sont construites, des baraquements installés, des magasins de vivres approvisionnés, des ambulances fournies de leur matériel et de leur personnel d'infirmiers, de sœurs de charité et de médecins, pour les premiers soins à donner en cas d'accidents, ou pour suppléer à l'absence ou à l'insuffisance des maisons de secours existantes. Enfin, on a dû penser aux besoins de la religion, construire une chapelle pour le culte le plus répandu et lui donner un desservant. Et comme le représentant du Dieu de paix est souvent impuissant à maintenir la bonne harmonie entre ces hommes venus de tous les points de l'horizon et qui trouvent dans l'alcool et dans des liqueurs frelatées le soutien de leurs forces, à côté de la chapelle, on a installé un corps-de-garde, forcés parfois (p. 131) de recourir à des moyens plus persuasifs, à des arguments plus énergiques que la parole.
Telles sont, en résumé, les installations que nécessite la construction d'un chemin de fer, installations préliminaires et qui ne laissent pas que d'avoir une influence notable sur la bonne et la prompte exécution des travaux.
Les tranchées sont attaquées et nos Belges à la grande encolure poussent la brouette. Dans un bon chantier, jamais la brouette pleine ne touche terre. Lorsqu'un rouleur arrive au relai, il ralentit sa marche, son camarade se présente de côté, prend la brouette pleine, fléchit les reins, souvent découverts jusqu'à la ceinture, et reçoit de la main de son camarade l'impulsion du départ. Même reprise au relai suivant, et ainsi de suite jusqu'à la décharge.
Lorsque la distance de transport atteint 100 mètres, les brouettes cèdent la place aux tombereaux, qui bientôt sont remplacés par des wagons traînés par des chevaux ou par la locomotive. Une plus grande activité se déploie sur le chantier, des pentes sont ménagées pour faciliter le transport des déblais, personne ne chôme. Depuis l'enfant qui porte le bidon à l'eau aromatisée de vinaigre, de café ou d'eau-de-vie, qui manœuvre l'aiguille et s'occupe du graissage des wagons, jusqu'au cheval au large poitrail, à la croupe solide et brillante, tout le monde rivalise d'ardeur. Avez-vous remarqué jamais l'intelligence de ces chevaux qui, sur les grands chantiers, leur ont fait attribuer des fonctions spéciales? Attelés au tombereau, (p. 132) ils vont sans guide de la charge à la décharge, sans jamais abandonner le chemin tracé sur l'étroit remblai qu'ils doivent parcourir. Arrivés au but, ils tournent; un homme ou un enfant culbute le véhicule et la bête revient chercher une nouvelle charge. Attelé au wagon, le cheval prend le nom de lanceur. À quelque distance de la décharge, il fait, sur un cri du charretier, un effort énergique, tend ses traits, raidit ses muscles, fléchit ses jarrets, et de tout son corps élevé sur ses jambes de derrière et buté sur les traverses de la voie, il entraîne sa lourde charge. Pendant quelques secondes, il chemine entre les deux rails. Mais l'impulsion donnée est déjà suffisante pour que le wagon atteigne seul les traverses formant barrage à l'extrémité de la voie; l'attelage est rompu au moyen d'une ficelle et d'une attache à ressort. D'un bond, le cheval escalade le rail et les traverses saillantes qui le portent, et se range sur le côté du remblai. Le wagon vidé, il se retourne et le reconduit à quelques pas sur une voie d'évitement. Tout cela se passe en moins de temps que nous n'en mettons à le dire. Le cheval entend, voit, suit toutes ces manœuvres et les exécute avec une intelligence merveilleuse.
Même docilité, même soumission dans les travaux souterrains. Une lanterne fixée à la joue de son collier, il passe dans les galeries les plus étroites, sur un sol constamment inégal, tantôt rocher, tantôt terre, tantôt poussière, tantôt flaque d'eau; il se glisse, tourne au milieu des étais, se heurte parfois, mais sans jamais refuser ses services. Il se met au manége, s'attelle à la (p. 133) corde d'une grue, se meut en ligne droite ou en cercle avec la même facilité. Admirable animal, que ne protégent pas assez nos lois contre la brutalité de ses gardiens!
Ne voulant pas faire de la technologie, nous n'entrerons dans aucun détail sur l'installation des grands chantiers de chemins de fer; nous nous contenterons de dire que, tandis qu'aujourd'hui l'exécution d'une voie ferrée est devenue familière à nos entrepreneurs, elle était à l'origine chose complétement neuve. L'ouverture d'un canal, que l'on mettait des années à creuser, s'opérait à de si rares intervalles et dans des conditions si différentes, quelle n'avait formé aucun ouvrier expert; aussi, les ingénieurs qui curent à construire les premiers chemins de fer durent-ils se façonner eux-mêmes à ce nouveau genre de travaux, en dressant leurs entrepreneurs comme leurs propres employés. Aucune difficulté n'existe plus de ce côté depuis longtemps.
Rappelons seulement les noms des plus grandes tranchées donnant passage à des voies ferrées:
La tranchée de Tring sur le chemin de Birmingham, mesurant 1,100,000 mètres cubes;
Gadelbach, sur le chemin d'Ulm à Augsbourg, de 1,000,000 de mètres;
Tabatsofen: 860,000 mètres cubes;
Cowran, sur le chemin de Carlisle: 700,000 mètres cubes;
Blisworth, sur le chemin de Birmingham: 620,000 mètres cubes;
(p. 134) Poincy, au chemin de Strasbourg: 500,000 mètres cubes;
Pont-sur-Yonne, au chemin de Lyon: 470,000 mètres cubes;
Clamart, sur le chemin de Versailles, rive gauche: 400,000 mètres environ.
Les tranchées n'ont jamais plus de 15 mètres de profondeur, à moins qu'elles ne soient très-courtes.
Si la voie doit être placée plus profondément dans le sol, on perce un souterrain: il y a économie. Quant aux talus des tranchées, leur inclinaison varie entre la verticale et une ligne inclinée à 45° sur l'horizon. On ne descend au-dessous de ce chiffre qu'à la traversée des terrains d'une très-mauvaise nature, sans consistance et dont les éboulements fréquents nécessiteraient un entretien trop coûteux.
Les remblais s'élèvent aux deux extrémités des tranchées avec les déblais qui en sont sortis. Si ces déblais sont en excès, on les met en dépôt; si, au contraire, ils sont insuffisants, on a recours à un emprunt, qui se fait, suivant les cas, en élargissement dans la tranchée ou sur les côtés du remblai à construire. La hauteur des remblais n'excède pas 20 mètres et l'inclinaison des talus est le plus souvent de 1½ de base pour 1 de hauteur.
L'ingénieur ne cherche pas, comme il le fait pour la construction d'une route, à équilibrer rigoureusement les volumes des déblais et des remblais. Les conditions de tracé d'un chemin de fer sont autrement impérieuses. Les questions de pente et de courbure (p. 135) dominent toute autre considération, et la compensation, même approximative, des terres à déblayer et à remblayer n'est pour lui qu'une préoccupation secondaire.
L'un des premiers travaux attaqués et celui qui exige de la part de l'ingénieur les soins les plus assidus au point de vue du tracé, au point de vue de la conduite des travaux, est le percement des souterrains. Qu'on se figure un trou de plusieurs kilomètres de longueur parfois, d'une section de 30 à 50 mètres carrés, percé sous le sol, tantôt en ligne droite, tantôt suivant une courbe régulière au moyen d'attaques multipliées dont le nombre a varié depuis 2 jusqu'à 50, et installés au fond d'une autre série de trous verticaux ou de puits, dont la profondeur atteint souvent 200 mètres, et au fond desquels on trouve tout d'abord un air vicié par la fumée de la poudre et par la respiration des ouvriers, des infiltrations plus ou moins abondantes, qu'une pierre, un caillou qui tombe peut faire dégénérer en ruisseaux envahissants.
Une ligne droite ou une courbe est dessinée à l'aide de jalons, de pieux au travers du faîte à franchir. Tantôt elle monte sur un mamelon, tantôt elle descend dans une crevasse; là elle traverse un bois, là elle plonge dans une source voilée sous un bouquet d'arbres, et ne ménage aucune habitation. Tous les points bas qu'elle a touchés, sont notés, espacés régulièrement, plus ou moins, selon les difficultés présumées du percement et la durée probable de leur exécution. En chacun de ces points se trouve l'ouverture d'un puits. On se met à l'œuvre. Le puits descend; le manége (p. 136) ou la locomobile s'installe, fait marcher le ventilateur et le treuil. Tout va bien: les premières couches tendres sont traversées sans difficultés; on blinde avec quelques planches, un peu de foin, des étais; parfois on a recours au cuvelage en maçonnerie; mais de légers suintements se produisent, il est nécessaire d'installer des pompes; on descend, l'eau augmente, les pompes sont insuffisantes, on en installe de nouvelles, la locomobile est doublée; on continue. Un caillou, comme une noix, se détache de la paroi du puits, un homme tombe pour ne plus se relever, première victime;—un éboulement survient, l'eau envahit le puits, plusieurs hommes sont ensevelis; du secours au plus vite, on ne retire que des cadavres. C'est une alerte permanente, qui se répète en dix, quinze, vingt points différents.
Enfin, on arrive à la profondeur voulue. Il faut indiquer la direction des attaques. Nouvelle opération et l'une des plus délicates, sinon la plus délicate, à accomplir. Les ouvriers sont écartés. La locomobile reste en feu, quelques hommes sont au fond du puits, quelques autres à la surface. On trace à l'orifice un petit élément, une petite fraction de cette grande ligne dessinée sur le faîte, et, à l'aide de plombs suspendus à de légers fils, on reproduit au fond du puits cette petite ligne tracée à son ouverture. Le plus grand calme, le plus grand silence règnent autour des opérations. Il semble que le bruit seul de la voix va troubler le repos attendu de ces deux fils ou agiter l'air au milieu duquel ils sont suspendus. Le plomb (p. 137) est trop léger, on en augmente le poids, le fil se rompt, et l'on recommence: les heures se passent et les ouvriers attendent. On fait plonger le grave dans un vase plein d'eau. Enfin les deux fils sont immobiles, ou leurs oscillations d'assez peu d'étendue pour qu'on puisse en prendre aisément la mesure et partager leur amplitude. Les points sont fixés et, sur ce petit tronçon de ligne comme base, on va construire toute une nouvelle ligne, la vraie cette fois, que maintes opérations nouvelles viendront encore contrôler, car la certitude en pareil cas ne résulte que de la multiplicité des tracés.
Souvent la difficulté est augmentée par la situation des puits en dehors de l'axe du souterrain, disposition adoptée pour faciliter les manœuvres futures, mais poursuivons notre description.
Les ouvriers reprennent possession de leur chantier souterrain, qui présente désormais deux attaques dirigées en sens contraire. L'activité s'accroît. La poudre et les bois descendent, les déblais remontent; les hommes se remplacent toutes les six heures, le travail ne chôme pas un moment. En avant, marche la petite galerie que le tracé accompagne et dirige. Derrière vient le battage au large, l'ouverture à grande section. Un muraillement ou un revêtement général est à faire; on procède alors par tronçons ou par chambres alternatives, les éventails sont établis, les cintres sont dressés, les maçons suivent les boiseurs, et chaque jour, à pas lents, au milieu d'incidents sans gravité ou d'accidents épouvantables, le travail s'avance. C'est (p. 138) un vrai trou de taupe, car dans certains terrains l'homme le creuse avec ses mains, tantôt sur le ventre, tantôt sur le côté, tantôt sur le dos. L'ouvrier des souterrains s'identifie à sa besogne; à la lumière du soleil, il préfère celle de sa lampe, au grand air l'atmosphère humide, fumeuse et parfois fétide de son chantier. Son visage a pris une teinte pâle uniforme; ses yeux, ses narines et ses lèvres sont d'un rose maladif et ses cheveux sont parfois décolorés. On croirait à la souffrance, si le soleil, l'air vivifiant du dehors, une nourriture plus forte et plus substantielle, ne venaient le transformer et lui donner la force brutale qu'il montre dans ces rixes qu'amènent parfois la jalousie ou la colère, et que termine trop souvent le couteau.
Les souterrains les plus remarquables sont:
La Nerthe, entre Avignon et Marseille, d'une longueur de 4,600 mètres;
Blaisy, entre Tonnerre et Dijon, de 4,100 mètres;
Le Credo, sur le chemin de Lyon à Genève, de 3,900 mètres;
Rilly, sur l'embranchement de Reims, de 3,500 mètres;
Le tunnel des Alpes ou du Mont-Cenis, de 12,220 mètres de longueur.
L'un des tunnels les plus connus est celui de Blaisy, à 288 kilomètres de Paris. Voici quelques détails sur sa construction: Sa longueur, avons-nous dit, est de 4,100 mètres, sa largeur entre les pieds-droits de 8 mètres et sa hauteur sous clef de 8 mètres également. On a percé 22 puits pour sa construction; le (p. 139) plus profond a 197 mètres de hauteur. Quinze de ces puits sont conservés pour l'aérage du souterrain. L'ensemble des 22 puits a coûté deux millions. Le cube des déblais extraits du souterrain est évalué à 350,000 mètres et celui des matériaux de construction à 150,000. On a employé plus de 150,000 kilogrammes de poudre. Ce souterrain a coûté, sans les puits, 1,900 francs par mètre courant, soit 7,900,000 francs pour l'ensemble.
Disons quelques mots encore du tunnel des Alpes. Ce qui le distingue essentiellement des autres souterrains construits jusqu'à présent, c'est sa grande longueur (12kil,220) et l'impossibilité où l'on a été, en raison de la grande hauteur de la calotte, de l'attaquer par des puits. Il n'y a donc eu que deux chantiers partis des deux têtes, de Modane et de Bardonèche, et allant à la rencontre l'un de l'autre. L'ouverture à l'exploitation remonte au mois d'octobre 1871. Il a fallu, en raison du nombre restreint des attaques, employer les moyens de perforation les plus rapides. Voici ce qu'on a fait: On a appliqué à la compression de l'air la force produite par la chute des cours d'eau descendant du faîte. L'air comprimé, à son tour, a servi à mettre en mouvement de petites machines perforatrices qui remplacent le travail lent et pénible des ouvriers. MM. Grandis, Grattone et Sommeiller sont les inventeurs de ces machines. Aujourd'hui, une voie nouvelle, franchie en 20 ou 25 minutes, remplace l'ancienne route de la montagne, que les chevaux de poste mettaient 10 à 12 heures à parcourir et que le (p. 140) chemin de fer Fell[7], dont nous aurons bientôt à parler, a fait franchir en 5 heures seulement. Maintenant, une communion plus intime peut s'établir entre la France et l'Italie et permettre à notre industrie d'aller puiser de nouvelles et vivifiantes inspirations dans la péninsule;—à nos voisins de venir étudier nos procédés rapides et perfectionnés de fabrication.
La nécessité de traverser de larges fleuves et des vallées profondes, imposée par le tracé des grandes voies ferrées, a donné naissance à des ouvrages dont nos pères n'abordaient la construction qu'à de rares intervalles et qu'ils mettaient de longues années à élever. Nous voulons parler d'abord de ces imposants viaducs en maçonnerie qui l'emportent bien, à notre avis, sur les aqueducs tant vantés des Romains et des Sarrazins, puis de ces ouvrages en tôle portés sur piles en maçonnerie ou sur piles métalliques, dont la construction remonte à quelques années seulement et qui s'est déjà beaucoup répandue, tant elle fournit un moyen économique et facile de franchir les vallées profondes.
Les viaducs en maçonnerie, construits pour le passage des chemins de fer, sont remarquables à divers titres: leur longueur, leur hauteur, la mauvaise nature du terrain qui les supporte, augmentent les difficultés de leur construction et en élèvent le prix de revient.
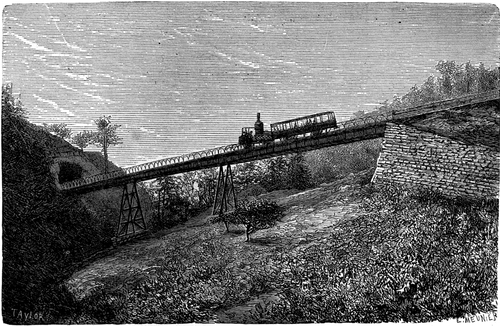
Fig. 25.—Le chemin de fer du Righi.
Parmi les viaducs les plus longs, on cite surtout (p. 143) celui qui a été construit sur les lagunes de Venise pour le passage du chemin de Vicence, et qui a 3,598 mètres de longueur;
Celui qui traverse la ville de Nîmes, ayant 1,670 mètres de longueur, sur le chemin de Tarascon à Cette;
Celui de Wittemberg, qui a 1,147 mètres de longueur;
Enfin celui d'Arles, sur le chemin de Lyon à Marseille, et qui a 769 mètres de longueur.
La hauteur la plus grande de ces viaducs ne dépasse pas 15 mètres.
Les viaducs les plus remarquables par leur grande longueur et par leur grande hauteur, sont: celui de Nogent-sur-Marne, qui a une longueur totale de 830 mètres et une hauteur de 29 mètres. Ce viaduc franchit la rivière au moyen de trois arches de 50 mètres d'ouverture. Il a été construit en dix-huit mois. Le viaduc de l'Indre mesure 751 mètres de longueur totale et 23 mètres de hauteur maxima.
L'un des ouvrages les plus renommés par sa légèreté est le viaduc de Chaumont, sur le chemin de Mulhouse à Gray. Sa longueur est de 600 mètres et sa plus grande hauteur de 50 mètres. Il a été exécuté en quinze mois.
L'un des viaducs les plus remarquables par ses dimensions et le plus grand de ceux construits en Allemagne pour le passage d'un chemin de fer, est celui du Goeltzschthal, sur le chemin de fer saxo-bavarois, entre Reichenbach et Plauen. Il a 579 mètres de longueur et sa hauteur maxima est de 80m,37; c'est à (p. 144) peu près la même que celle de notre aqueduc de Roquefavour, qui a 81 mètres. C'est la hauteur des tours de Notre-Dame.
Nous pourrions citer encore plusieurs ouvrages en maçonnerie dignes de fixer l'attention; la France, les environs de Paris même en offrent de nombreux, mais nous devons indiquer maintenant quelques-uns des magnifiques travaux en charpente construits en Amérique, en Allemagne et en Russie, et qui, forêts suspendues, sont de véritables merveilles d'assemblage. Les uns sont à poutres droites, comme celui de Peacock, celui du Connecticut (384 mètres de longueur, avec des travées de 54 mètres);
Celui de Landore (496 mètres de longueur);
Celui de la Mesta, sur le chemin de Saint-Pétersbourg à Moscou (547 mètres de longueur, avec des travées de 60 mètres et une hauteur maxima de 32 mètres);
Les autres sont en arc de cercle, comme celui de Willington (319 mètres de longueur avec des arcs de 39 à 35 mètres de largeur);
Celui de la rivière l'Etherow (long de 158 mètres, avec une arche de 54 mètres d'ouverture et une hauteur maxima de 41 mètres);
Celui de la Cascade-Glen (présentant un arc de cercle de 84 mètres d'ouverture, le plus grand qu'on ait encore construit, et 53 mètres de hauteur).
Mais le plus remarquable de ces ouvrages est le pont du Haut-Portage sur le chemin de Buffalon à New-York; sa longueur est de 267 mètres et sa hauteur de 79m,50!
(p. 145) Le fer vient parer d'une manière avantageuse aux inconvénients des constructions en charpente. On peut dire que la construction des chemins de fer a produit les ponts en tôle, de même aussi que ces combles légers abritant nos grandes gares et une foule de constructions métalliques de différents genres.
Les ponts en tôle sont ou à poutres droites, pleines ou à treillis, ou en arc de cercle. Les plus remarquables, parmi les premiers, sont: le grand pont Britannia, sur le détroit de Menai, dont l'ingénieur est Robert Stephenson (longueur entre culées: 453 mètres en quatre travées; hauteur de la pile du milieu 67 mètres);
Le viaduc de Crumlin, pour le chemin de fer de Pontypool à Swansea (longueur: 498 mètres, 10 travées de 45m,75, hauteur du rail, au-dessus du fond de la vallée: 58m,56);
Le grand pont sur la Vistule, à Dirschau (chemin de fer de l'Est de la Prusse: six travées de 138m,40 de long chacune; longueur totale, 882 mètres);
Le pont sur le Sitter (163 mètres de long en trois travées, 62 mètres de hauteur);
Le pont de Marienbourg (en deux travées de 106 mètres chacune).
Le premier pont en tôle construit en France est celui d'Asnières, sur le chemin de l'Ouest, qui est dû à M. Eug. Flachat; il a remplacé le pont de bois brûlé en 1848 (sa longueur est de 168 mètres en cinq travées).
D'autres ponts du même genre se sont succédé bientôt (p. 146) en grand nombre. On remarque surtout le pont de Langon (228 mètres en trois travées) et celui de Bordeaux (629m,11), sur la Garonne.—Dans ces dernières, années, on a construit sur le Rhin le fameux pont de Kehl (235 mètres de longueur), qui réunit le duché de Bade à la France, et que ses fondations, sur un sol de gravier d'une profondeur indéfinie, rend particulièrement remarquable. Il a coûté 8 millions.
Nous ne citerons, comme type de légèreté des ponts en arc, que le pont d'Arcole, construit à Paris, en face de l'Hôtel de ville, pour remplacer l'ancien pont suspendu, qui donnait seulement passage aux piétons.
Mentionnons aussi le fameux pont de Saltash, sur le bras de mer de Hamoaze, près de Plymouth, et dont Brunel est l'ingénieur (deux travées de 138m,68 chacune, laissent aux navires, au moment de la haute mer, un passage libre de 30m,48 de hauteur).
Mais un des ouvrages construits avec le plus de hardiesse est celui qui a été lancé par l'ingénieur Rœbling au-dessus des chutes du Niagara (249m,75 de longueur en une seule travée, à 74 mètres au-dessus de la rivière). Ce pont est à la fois en treillis et suspendu. Quatre câbles s'appuient sur les piles élevées, placées sur les deux rives; deux supportent le tablier supérieur sur lequel passe la voie unique de fer, deux autres supportent le tablier inférieur qui sert au passage des voitures et des piétons. Mais, comme les grands vents, qui soufflent dans ces parages, auraient pu soulever le tablier, des haubans, partant des parois de la roche, viennent s'attacher, en divergeant, à différents (p. 147) points du tablier et lui donner une rigidité considérable. Cet ouvrage n'a coûté que deux millions.
Parmi les ponts en fonte, nous ne citerons que le beau pont de Tarascon (592 mètres de longueur, sept arches de 60 mètres d'ouverture), et le viaduc de Newcastle (408 mètres de longueur, six travées de 39 mètres). Tous les ouvrages en fonte, dès qu'ils atteignent une portée de 8 à 10 mètres, sont en arc; les défauts, inhérents à la fabrication de la fonte, ne permettent pas son emploi en grandes poutres droites.
Tels sont les plus remarquables des grands ouvrages dont les chemins de fer ont nécessité l'exécution. Ils occupent, dans la construction des voies ferrées, une place si importante et ils excitent à un si haut point l'admiration, que nous n'avons pas cru devoir sans en faire connaître au moins les noms et les dimensions principales.
La plate-forme du chemin est dressée, l'infrastructure est maintenant terminée. Les stations et les maisons de garde s'élèvent, depuis l'humble halte, qui n'a parfois qu'une femme pour tout personnel, jusqu'à la grande gare avec ses centaines d'agents. Les rails et les traverses sont en dépôt aux extrémités de (p. 148) la ligne et sur divers points de son parcours. La pose commence, les wagons, les locomotives la suivent; le ballast, cette matière perméable et élastique qui doit former son lit, est apporté, et la commission administrative peut procéder à la réception du chemin.
Avant de parler des machines et des wagons, du matériel locomoteur, en un mot, arrêtons-nous au matériel fixe, à ces humbles barres de fer couchées sur la poudre des chemins, comme on les a nommées.
C'est à la fin du dix-huitième siècle que l'on fait remonter l'emploi des premières ornières saillantes en bois, et c'est dans le voisinage des mines de Newcastle que ces rails furent employés pour la première fois. Les wagonnets, ou chaldrons, pleins de houille, allaient sur les voies artificielles de l'orifice du puits aux bords de la Tyne, où ils déchargeaient leur contenu dans les bateaux. Mais ces bois s'usaient, se fendillaient et exigeaient un remplacement fréquent et coûteux. L'action alternative du soleil et de la pluie hâtait leur fin. C'est alors qu'on eut l'idée de les recouvrir, pour en prolonger la durée, de bandes de fer dans les parties les plus sujettes aux détériorations. Cette amélioration partielle de la voie de transport devint bientôt générale: le bois, enfin, fut écarté comme rail et remplacé par la fonte. Cette application est due à l'ingénieur William Reynolds et date de cent ans environ. Elle remonte à l'année 1768, selon les uns, à l'année 1780, selon les autres. Mais les rails n'avaient pas la forme qu'ils ont aujourd'hui; ils étaient plats, avec un rebord saillant intérieur, la roue était (p. 149) semblable à celle des voitures ordinaires. Vers 1789, Jessop transforma la jante des roues et leur donna le rebord qu'on voit aujourd'hui aux roues des wagons; les rails se réduisirent alors à de simples barres de fer fixées sur des traverses en bois.
Pour utiliser toute la résistance du fer, ces barres ou mieux ces lames de fer étaient placées sur leur tranche ou de champ, comme disent les ouvriers, et maintenues dans cette position par le serrage d'un coin en bois dans l'entaille d'une traverse. La voie était donc bien simple: rails, traverses et coins, c'était tout. Les petites voies de terrassement ne sont pas autres encore aujourd'hui. Les rails en fer s'obtenaient par le laminage; c'était la méthode appliquée depuis plus de deux siècles à la fabrication des monnaies, à Paris, et que l'Angleterre pratiquait depuis l'année 1663.
Les améliorations de la voie actuelle de nos chemins de fer résultent principalement des perfectionnements qui ont été apportés à la préparation de ces parties essentielles. On reconnut bientôt que les rails méplats, sous les fortes charges, creusaient des sillons dans la jante des roues et les mettaient promptement hors de service, qu'au passage des courbes et sous l'action de la force centrifuge ils se déjetaient en dehors de la courbe et faisaient ventre entre leurs supports. De là, la nécessité d'abandonner la forme méplate, pour donner aux rails une saillie latérale, capable à la fois d'empêcher ces déformations et de fournir une surface de roulement bombée et non plus tranchante. Le (p. 150) champignon du rail était inventé. Le désir d'utiliser le rail après l'usure de son champignon supérieur, donna l'idée de lui ajouter un champignon inférieur, symétrique du premier, permettant son retournement dans ses supports et donnant un nouveau service.
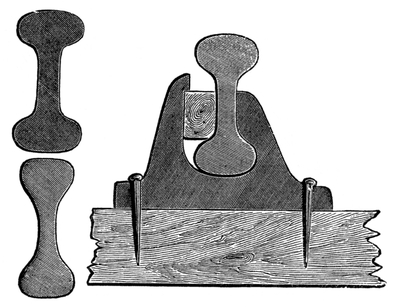
Fig. 26.—Rail à double champignon.
Notre rail actuel, à double champignon, n'est autre que celui que nous venons de décrire. C'est le propre des grandes inventions d'atteindre dès le début le degré de perfectionnement qu'elles ne doivent guère dépasser. Tantôt l'âme du rail est plus haute et plus étroite, le champignon plus ou moins bombé, plus ou moins large; mais ces variations se chiffrent par millimètres ou par fractions de millimètre. La forme et les dimensions générales varient peu. Il en est de même du coussinet ou chair, de cette main de fonte (p. 151) dans laquelle on serre le rail à l'aide d'un coin en bois, et de ce coin lui-même.
La traverse est une bille de bois, de forme quadrangulaire, triangulaire ou semi-circulaire dont la nature varie suivant les pays. En France et en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, on emploie le chêne, le hêtre, le sapin et le pin préparé. En Suisse, on emploie le mélèze; en Amérique, on a employé le gaïac.
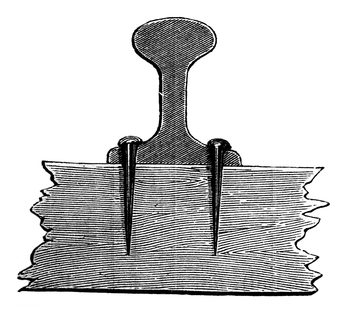
Fig. 27.—Rail Vignoles.
Les coins sont en chêne et ne présentent rien de particulier.
Une autre espèce de rail est employée en Amérique, en Allemagne, et sur quelques-unes de nos lignes françaises. C'est le rail à patin, américain, ou Vignoles, du nom de l'ingénieur anglais qui, le premier, l'a employé en Angleterre. Il ne diffère du rail à double champignon qu'en ce que le champignon inférieur a été remplacé par un patin qui lui sert d'appui sur la (p. 152) traverse, à laquelle il est relié par des crampons en fer. Ce rail ne peut donc pas être retourné comme le premier, mais l'avantage dont il est privé est diversement apprécié par les ingénieurs et contesté par certains d'entre eux.
Nous indiquerons encore deux sortes de rails, dont l'usage tend de plus en plus à disparaître et que les Compagnies utilisent seulement aujourd'hui pour l'établissement de leurs voies de garage; ce sont: le rail Brunel (bridge-rail), qui a la forme d'un U renversé, se posant sur longrines, et le rail Barlow, dont la section est celle d'un V renversé, s'appuyant directement sur le ballast.

Fig. 29.—Rail Barlow.
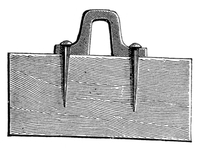
Fig. 28.—Rail Brunel.
La dernière Exposition universelle a fait connaître une nouvelle espèce de rails employée en Allemagne, et qui présenterait des avantages notables sur les précédents, c'est le rail Hartwich, essayé sur les chemins de fer de Coblentz à Oberlahnstein et de Euskirchen à Mechernich. Ce rail n'est autre que le rail Vignoles dont l'âme a augmenté de hauteur, et dont le patin s'est élargi. Il se pose directement dans le ballast sans (p. 153) aucun intermédiaire. Mais il pèse 60 kilogr. environ le mètre courant: il coûte par conséquent fort cher. Et, comme le temps seul permet de porter un jugement sur les mérites de ce rail, on doit, avant d'abandonner les systèmes déjà essayés, attendre, pour l'adopter, que l'expérience ait fait connaître sa véritable valeur.
Les charges imposées aux véhicules des chemins de fer, wagons et machines, ont tellement augmenté depuis leur origine, que, pour ne pas voir les rails s'écraser et se déformer promptement, on a dû en augmenter la résistance en en forçant les dimensions et par conséquent le poids. Les premiers rails employés au chemin de Saint-Étienne, à Lyon, pesaient 13 kilogr. le mètre courant. Bientôt ce poids dut être porté à 25 kilogr., et aujourd'hui, sur nos grandes lignes, il est de 30 à 37 kilogr. Ce chiffre s'élève même parfois à 40 kilogr. Encore les rails ne durent-ils guère qu'une quinzaine d'années! On comprend que ce chiffre varie dans d'assez grandes limites, suivant la qualité des rails, leur position en plaine, en rampe ou en courbe, et la circulation qui s'opère à leur surface. Au bout de ce temps, ils ont perdu environ 100 francs par tonne de leur valeur, repassent à la forge, où ils sont employés à fabriquer des rails neufs, qui rentrent dans les parcs de la voie.
Malgré l'économie qui résulte de ce réemploi des vieux rails, l'opération de la réfection des voies ne laisse pas que d'être très-coûteuse, aussi a-t-on cherché à employer des rails capables de résister plus longtemps aux causes de destruction rapide auxquelles ils (p. 154) sont soumis dans certains cas. On a associé le fer à l'acier, celui-ci occupant la surface des tables de roulement, qui s'altèrent par le frottement, mais on a été peu satisfait du résultat obtenu, le fer et l'acier ne se soudant que difficilement. On en est venu à fabriquer des rails exclusivement en acier fondu Bessemer. Plusieurs Compagnies en ont fait déjà des commandes importantes pour les parties les plus fatiguées de leur réseau.
Quant aux traverses, on cherche de plus en plus à substituer la tôle au bois. La durée et la résistance du fer, qualités si précieuses pour des travaux dont l'existence doit être indéfinie, justifient ces recherches; mais des difficultés sérieuses, telles que le mode de fixation du rail sur la traverse, le bourrage facile de celle-ci, retardent la solution du problème. On ne peut, d'ailleurs, contrairement à un préjugé assez répandu, adopter promptement toutes les innovations qui sont proposées pour l'amélioration des voies. Les Compagnies travaillent sans cesse à perfectionner ce qui existe; leurs essais sont constants, mais elles sont trop soucieuses de la sécurité des voyageurs (elles savent ce que coûtent les bras ou les jambes cassés), elles sont trop soucieuses aussi des intérêts qui leur sont confiés (l'emploi d'un rail, trop promptement adopté, a coûté à une Compagnie 14 millions et a entraîné une perte de 8 millions), pour s'engager à la légère dans des innovations d'une valeur incertaine et que leur application sur une grande échelle peut rendre des plus compromettantes.
(p. 155) On se fera une idée de l'importance de ces questions quand on saura qu'au cours de 210 francs la tonne, la valeur des rails du réseau exploité était représentée, en 1867, par une somme de 386 millions de francs.
Mais revenons aux traverses métalliques. Les essais continuent, les Compagnies font des commandes, constatent les avantages et les inconvénients. Elles vont avec la prudence qu'exige le renouvellement, au fur et à mesure des besoins, de 25 millions de traverses en bois, qui, au prix variable de 3 à 6 francs, représentent un capital de 113 millions de francs. En comptant les traverses en tôle à 180 francs la tonne, leur ensemble coûterait 180 millions, soit 67 millions de plus. Quelle sera la durée? Là est la question. L'avenir répondra.
Nous ne nous arrêterons pas aux pièces accessoires, éclisses, selles, boulons, chevillettes, crampons, etc., qui servent à réunir deux rails qui se suivent, à leur fournir un appui sur la traverse ou à les fixer à celle-ci. Ce sont choses de détail. Nous parlerons maintenant des véhicules des chemins de fer.
La construction de la première voiture de chemins de fer n'a pas été aussi simple qu'on serait tout d'abord tenté de le croire. Il semble, en effet, a priori, qu'il y a bien moins de difficulté à faire suivre aux roues (p. 156) munies de rebords, d'un véhicule, deux ornières saillantes ou deux ornières creuses, qu'à les faire courir sur un chemin semé d'obstacles. Il n'en est rien.
On a reconnu, dès le début, que l'emploi des voitures à deux roues était absolument impossible.
On a essayé alors des voitures à quatre roues, en laissant aux essieux la faculté de se placer dans une direction normale aux courbes parcourues, et aux roues la mobilité sur ces essieux qu'on regardait aussi comme indispensable au parcours de chemins de différentes longueurs sur les deux files de rails. Mais la pratique, ainsi qu'il arrive parfois, a renversé ces prévisions, et l'on a bientôt reconnu que le véhicule ne pouvait être maintenu sur le rail qu'à la double condition d'avoir ses essieux toujours parallèles et solidaires du châssis du véhicule, et les roues jumelles invariablement fixées sur l'essieu qui les porte.
On a créé ainsi des résistances accessoires, mais on a assuré le maintien du véhicule sur la voie.
Du wagon à quatre roues, on est passé au wagon à six roues, l'un des essieux pouvant se déplacer d'une petite quantité dans un plan parallèle à celui de la voie, de manière à prendre, au passage d'une courbe, la direction de son rayon; les roues restant, d'ailleurs, toujours calées sur les essieux.
Enfin, on a fait des wagons à huit roues, en groupant les essieux deux par deux et composant deux trucks indépendants, reliés à la caisse du véhicule au moyen de chevilles ouvrières, comme celles qui sont à l'avant-train des voitures ordinaires.
(p. 157) Ces premières expériences achevées, on s'est occupé de la construction du wagon, en faisant de chacune de ses parties, appelées à répondre à des besoins nouveaux, une étude minutieuse.
Il fallait s'occuper des attaches des wagons les uns aux autres, des chocs des wagons entre eux, de la suspension du véhicule sur les roues, des moyens de modérer la vitesse à certains moments de la marche. On composa alors un châssis, sorte de cadre en charpente, rendu indéformable par des pièces mises en croix: on eut une carcasse s'appliquant, d'une manière à peu près générale, à tous les véhicules quelle que fût leur destination spéciale, et portant, à ses extrémités, les crochets d'attelage et les tampons de choc, les premiers reliés à la partie centrale, les seconds aux extrémités des ressorts disposés au centre du châssis; sur les côtés, les plaques de garde qui assurent le parallélisme des essieux tout en permettant les mouvements d'oscillation des boîtes à graisse sous l'action des ressorts de suspension.
À ces parties essentielles, on ajouta les ferrures, les chaînes de sûreté et, selon la destination du wagon, des marchepieds, un frein, etc.
Sur le châssis, que nous avons décrit, se place une caisse appropriée au transport auquel le véhicule est (p. 158) destiné. On fait des wagons pour le transport des déblais, du ballast, de la houille, du coke, du charbon de bois, des marchandises de diverses natures, des voitures de rouliers et des voitures ordinaires, montées sur leurs roues, des diligences, des bestiaux de grande et de petite taille, des chevaux, du lait, des bagages, des pièces de charpente, et enfin des voyageurs.
Les wagons de terrassement sont d'une construction grossière, ainsi qu'il convient à l'usage auquel ils sont destinés. Leur caisse est placée en porte-à-faux, de manière à pouvoir basculer aisément et se vider d'elle-même. Ces wagons à ballast sont, d'ordinaire, des wagons plats que l'on vide à la pelle.
Pour le transport des houilles, on a employé longtemps des wagons de forme trapézoïdale se vidant par le fond au moyen d'une trappe; on y a renoncé et on n'emploie plus que des wagons de forme prismatique se vidant par les portes. Le transport du coke s'effectue souvent à l'aide de caisses posées sur le wagon et que de puissantes grues élèvent et basculent au lieu du déchargement. La quantité des houilles et cokes transportés, en 1865, par les six Compagnies françaises a été de 9,548,540 tonnes. Elle augmente tous les jours.
Le transport du charbon de bois s'opère parfois de la même manière, au moyen de caisses qui peuvent tenir, au nombre de quatre, sur un wagon. C'est la même caisse qui passe successivement de la voiture du charbonnier en forêt sur le wagon qui la mène à l'usine. Lorsque le transport du charbon se fait dans des sacs, on dispose ceux-ci sur des plates-formes qui viennent (p. 159) de la meule au dépôt de la ville et qui passent successivement de la charrette sur le wagon et de celui-ci sur la charrette.
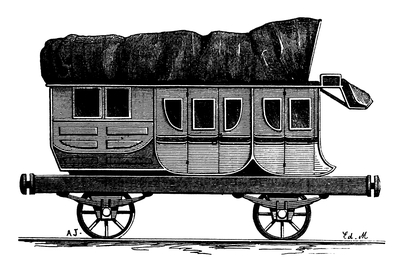
Fig. 30.—Diligence montée sur un truck.
Les voitures de rouliers se chargent sur des wagons plats appelés maringottes. Les chaises de poste passent avec leurs roues sur des wagons plates-formes, de même que les diligences, mais les roues de celles-ci sont enlevées au départ et remises à l'arrivée. Ce transport a, d'ailleurs, beaucoup perdu de l'importance qu'il avait à l'origine des chemins de fer, alors que les voies ferrées présentaient de nombreuses discontinuités. On se rappelle les émotions qu'on éprouvait en arrivant sous la grue chargée d'enlever le lourd véhicule, et chacun de se dire: «Si l'une des chaînes cassait!» Une fois séparée de ses essieux, la diligence était emportée latéralement par le treuil roulant auquel elle (p. 160) était suspendue, puis redescendue sur le wagon qui devait l'emporter. À l'arrivée, c'était une manœuvre inverse. Les chaînes ne cassaient pas, mais les craquements qu'elles faisaient entendre en s'enroulant ou en se déroulant, ne contribuaient pas peu à augmenter les craintes qu'on avait à cette époque sur les voyages en chemin de fer.
Quant aux wagons destinés au transport des marchandises, ils sont généralement de deux formes. Ce sont des wagons plats, munis de bâches en toile ou en bourre de soie et recouvertes d'un enduit dont la base est le caoutchouc; ou bien des wagons à parois latérales, les uns couverts, les autres découverts. Ces wagons, à l'origine des chemins de fer, ne recevaient que de faibles charges, cinq tonnes seulement; aujourd'hui, ce poids a beaucoup augmenté; il a même été porté au double, soit dix tonnes par certaines Compagnies, et le rapport du poids mort au poids utile s'est ainsi abaissé de 0,90 à 0,47.
Le transport du lait s'effectue dans de grandes boîtes en fer-blanc de vingt litres, qui peuvent se charger au nombre de deux cents dans une caisse à claire-voie.
La ville de Paris a reçu en moyenne, chaque jour de l'année 1865, 260,621 litres de lait. On estime la consommation journalière à 320,000 litres. Les quatre cinquièmes sont donc fournis par les chemins de fer, et si leur service venait à manquer subitement, fait remarquer M. Jacqmin, directeur de l'exploitation de la Compagnie de l'Est, au livre duquel nous empruntons (p. 161) ces chiffres, 700 à 800 mille personnes seraient chaque matin privées de leur tasse de café au lait.
Les bestiaux se transportent dans des wagons qui diffèrent peu des wagons à marchandises couverts, nous parlons des bestiaux de grande taille; quant aux moutons, on les superpose et on les fait voyager dans des voitures à deux étages, munis de planchers étanches. Aux prix des tarifs généraux, les moutons, les brebis, les agneaux et les chèvres payent en petite vitesse 0 fr. 02 par kilomètre et par tête; les veaux et les porcs payent le double; les bœufs, les vaches, les taureaux, les chevaux, les mulets et les bêtes de trait payent 0 fr. 10. Les tarifs spéciaux sont pour eux des tarifs de faveur, mais le transport en grande vitesse double le prix de leur place. Lorsque ces animaux sont envoyés aux concours agricoles pour y faire admirer la rondeur de leurs formes ou leurs belles proportions, les Compagnies leur accordent encore une réduction de 50 pour 100 sur les prix des tarifs généraux. Veut-on savoir maintenant à quel chiffre énorme s'est élevé le transport des bestiaux en 1863 sur les six grands réseaux français? à 4,145,287. Les moutons seuls entrent dans ce chiffre pour 2,131,936.
Les transports de bestiaux amenés, à Paris seulement se sont élevés dans la même année à 79,034 wagons, ce qui donne environ 1,500,000 têtes.
Quant aux filets de bœuf amenés par la Compagnie de l'Est, de la Suisse allemande et du grand-duché de Bade, le poids, qui n'était que de 602,615 kilogrammes en 1863, s'est élevé à 1,421,030 kilogrammes en 1866, (p. 162) et, à l'époque de la chasse, les arrivages de gibier se sont élevés, certains jours, jusqu'à 30,000 kilogrammes, soit: 6,000 lièvres et 500 chevreuils.
Qui aurait songé, il y a trente ans, que les chemins de fer donneraient lieu à des transports d'une telle nature et d'une telle importance?
Et puisque nous parlons du transport des choses délicates au goût, nous dirons ce qu'il sort de vins mousseux, par le chemin de fer, de la seule Champagne: 17,940,000 bouteilles en 1866; ce chiffre n'était que de 9,210,000 bouteilles en 1845, et, tandis que l'Amérique ne nous en enlevait que 4,380,000 bouteilles en 1845, elle en a pris 10,413,000 en 1866. Je laisse à penser si le tout est du pur jus de la vigne!
Le transport des fromages de Brie, venant de Meaux seulement, chaque samedi, exige douze ou quinze wagons; parfois trente wagons ont été nécessaires.
Les chevaux se transportent dans des wagons spéciaux, appelés wagons-écuries, qui ne diffèrent des wagons à bestiaux, employés souvent à cet usage, que par une division de la caisse en stalles isolant ces animaux les uns des autres. Les portes sont placées sur les parois extrêmes, l'une s'abat pour servir de pont, l'autre se relève en forme de toit; les cloisons étant mobiles sur charnières, les portes livrent toutes deux accès aux chevaux dans toute la longueur du wagon. Un compartiment spécial est réservé au palefrenier qui les accompagne.
Les wagons à bagages sont de grands wagons fermés, à portes roulantes, ayant, d'ordinaire, une guérite de (p. 163) vigie pour le conducteur du train, quelques petites armoires ou casiers pour le rangement des petits colis, pour des valeurs, pour la boîte de secours et deux ou trois niches à chiens. La Compagnie du Midi a fait construire de nouveaux fourgons à bagages destinés au service des trains express et qui contiennent des water-closets, avec deux petits compartiments d'attente, dans lesquels un voyageur peut monter durant le trajet entre deux stations.
Le service des postes, depuis l'ouverture de nos grandes voies ferrées, a lieu dans les wagons mêmes qui servent au transport des dépêches. Toutes les opérations de classement, de triage, qui se faisaient autrefois avant le départ du courrier, se font maintenant durant le trajet. Les postes ont, dans ce but, de grands wagons, appelés bureaux ambulants, garnis de tablettes et de casiers, chauffés et éclairés comme le seraient des bureaux ordinaires.
Ces voitures, en Angleterre, présentent latéralement des filets destinés à prendre les dépêches et à les laisser au passage des stations. Lorsque le transport des dépêches exige plusieurs wagons, des ponts volants s'abaissent sur les tampons, abrités par des espèces de cages à soufflet, en cuir, qui s'appliquent exactement contre les parois des baies de communication. En Prusse, on a aussi un filet pour les dépêches à prendre en marche; mais pour celles qu'on doit laisser, on se contente de les jeter sur le trottoir. En France, nous n'avons rien ni pour prendre les dépêches, ni pour les laisser!
Nous arrivons enfin à la description des voitures à voyageurs, mais les détails de leur agencement sont tellement connus aujourd'hui que nous nous bornerons à appeler l'attention sur les innovations récentes introduites dans leur construction.
On juge des progrès réalisés quand on se rappelle les anciennes voitures de troisième classe, ouvertes à l'origine et sans toiture, des chemins de Rouen, d'Orléans et d'Alsace. Plus tard, ces voitures ont été couvertes; elles n'avaient pour parois que de légers filets en ficelle livrant passage au soleil, durant l'été, au vent et à la pluie, durant l'hiver. Les voitures de troisième classe, sans être aujourd'hui tout ce que l'on peut désirer, sont néanmoins complètement exemptes des défauts de leur origine et, ce qui prouve qu'elles ne sont pas si désagréables qu'on le dit bien souvent, c'est qu'elles sont fréquentées, pour tous les petits parcours, par une foule de personnes qui préfèrent une économie au plus grand confortable.
En France, le matériel le plus répandu se compose de voitures de première, de seconde et de troisième classe, montées sur quatre roues (le nombre des voitures à six roues est très-limité), de voitures mixtes contenant des compartiments de différentes classes et qui servent spécialement au transport sur les petites (p. 165) lignes. Toutes ces voitures n'ont qu'un étage et contiennent de 24 à 50 voyageurs.
Les lignes de banlieue, établies dans le voisinage des grandes villes, qui ne servent qu'à de petits parcours, ont des voitures à impériale couverte. On accède à ces impériales au moyen d'escaliers placés aux extrémités du véhicule. La voiture contient alors 72 places. La Compagnie de l'Est avait exposé, en 1867, une voiture à deux étages, de 78 places (système Vidard et Bournique), dont l'impériale était fermée et réservée aux voyageurs de troisième classe. Au rez-de-chaussée de la voiture se trouvaient les compartiments de première, de deuxième classe et un compartiment de troisième classe pour les personnes peu valides. Ces voitures sont aujourd'hui nombreuses sur son réseau. Ainsi qu'on le voit, les recherches des ingénieurs, chargés de la carrosserie dans les Compagnies de chemins de fer, tendent toujours à diminuer le rapport du poids mort au poids utile; ces recherches aboutissent, mais ce n'est pas évidemment sans porter plus ou moins atteinte au confortable que les voyageurs de toutes classes réclament avec tant d'insistance.
Les personnes qui ont voyagé en Angleterre et en France s'accordent généralement à reconnaître la supériorité de notre matériel sur celui de nos voisins. Si les voitures de première classe se valent, celles de deuxième et de troisième classe sont assurément moins bonnes que leurs similaires françaises. Les siéges laissent à désirer, les dossiers manquent dans les secondes classes, les rideaux sont absents dans les secondes (p. 166) et dans les troisièmes classes. C'est le nécessaire, mais rien de plus.
On trouve en Allemagne des voitures à quatre, six et huit roues. Les voitures à huit roues se rapprochent, parleur construction, des voitures américaines, les autres ressemblent à nos voitures françaises. Les grandes voitures à huit roues tendent, d'ailleurs, à disparaître et le matériel à s'uniformiser. Ces longs véhicules avec portières extrêmes, couloir central, banquettes transversales ne sont plus en usage que dans le Wurtemberg, et les voitures parties du centre de l'Autriche ou de l'Allemagne peuvent arriver et arrivent chaque jour dans la gare de l'Est. Mieux que les montagnes, les barrières qui séparent les peuples s'abaissent, et les chemins de fer, en nivelant le sol, effacent ou tendent à effacer les jalousies et les vieilles rancunes, et à faire naître entre eux de bons rapports et des amitiés durables[8].
En Amérique, ce pays de la liberté, sinon de l'égalité, les voitures ne sont que d'une seule classe, mais les gens de couleur sont placés dans les wagons à bagages! Les véhicules, portés sur deux trains de quatre roues chacun, ont jusqu'à 18 mètres de longueur. Un couloir règne au centre, les banquettes, recouvertes en crin noir, sont disposées transversalement, et les voyageurs peuvent passer d'une voiture à l'autre et se promener dans toute la longueur du train. Ces wagons peuvent (p. 167) contenir jusqu'à quatre-vingts personnes. Autre pays! autres mœurs!
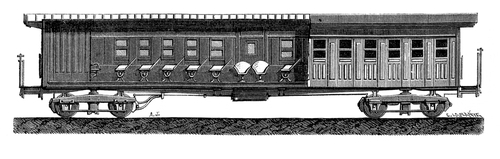
Fig. 31.—Wagon américain.
Le plus remarquable modèle que les Américains nous aient donné de leurs voitures est celui qui figurait à l'Exposition dernière et qui était destiné au chemin du Grand-Tronc. On a réuni dans cette voiture, comme dans ces superbes paquebots qui font le service des deux continents, tout ce qui est nécessaire à la vie. Le chemin qui va de New-York à San-Francisco et traverse l'Amérique septentrionale dans toute sa largeur, n'a pas moins de 5,000 kilomètres de longueur, au milieu de pays déserts et parfois habités par des peuplades sauvages; le trajet dure sept jours. Les voyageurs qui font ce long parcours ont besoin d'être logés, chauffés, (p. 168) éclairés, nourris. Ils le sont presque aussi convenablement que dans nos meilleurs hôtels.
Avec les moyens de locomotion en usage aujourd'hui, on peut faire le tour du monde en quatre-vingts jours. C'est le temps qu'autrefois un grand seigneur aurait mis à faire le voyage de Paris à Saint-Pétersbourg.
| De Paris à New-York | 11 | jours. |
| De New-York à San-Francisco (chemin de fer) | 7 | — |
| De San-Francisco à Yokohama (bateau à vapeur) | 21 | — |
| De Yokohama à Hong-Kong (bateau à vapeur) | 6 | — |
| De Hong-Kong à Calcutta (bateau à vapeur) | 12 | — |
| De Calcutta à Bombay (chemin de fer) | 3 | — |
| De Bombay au Caire (bateau à vapeur et chemin de fer) | 14 | — |
| Du Caire à Paris (bateau à vapeur et chemin de fer) | 6 | — |
| — | ||
| Total | 80 | jours. |
Sur tout cet immense parcours, il n'y a que 140 milles anglais, entre Alahabad et Bombay, que l'on soit obligé de parcourir sans se servir de vapeur; mais cette lacune sera bientôt comblée, car on travaille à l'établissement d'un chemin de fer.
Nous avons parlé de la voiture de nos grandes lignes, de la voiture Vidard à deux étages pour les chemins départementaux, de la voiture américaine pour les longs trajets dans des pays sans ressources, faisons connaître maintenant la voiture du chemin de fer de montagne. (p. 169) MM. Chevalier, Cheylus ont construit pour le chemin de fer Fell du Mont-Cenis une voiture qui présente les dispositions de nos omnibus: un couloir central de chaque côté duquel peuvent se ranger six voyageurs. Ces voitures communiquent entre elles au moyen de ponts jetés sur les tampons, d'où les voyageurs peuvent aller contempler les forêts de sapins et les âpres beautés du paysage. Ces voitures sont surtout remarquables par les freins spéciaux qui leur sont appliqués. Ce sont des espèces de mâchoires qui étreignent le rail central et viennent en aide aux freins ordinaires à sabots dont ces véhicules sont également pourvus.
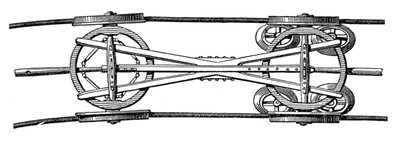
Fig. 32.—Système de wagons articulés de M. Arnoux.
Depuis de longues années, un petit chemin des environs de Paris, construit dans des conditions exceptionnelles, fait son exploitation avec un matériel d'une construction particulière. C'est le chemin de Sceaux, dont le tracé présente une série de courbes de très-petits rayons; le matériel employé a été inventé par M. Arnoux, et perfectionné par son fils, auquel il a valu le grand prix de mécanique, décerné par l'Académie. Les dispositions spéciales du wagon Arnoux consistent dans le montage des essieux sur chevilles ouvrières et dans la mobilité laissée aux roues sur ces essieux. (p. 170) L'essieu de la première voiture est assujetti à un système de quatre gros galets inclinés sur les rails, qui servent à donner à cet essieu une direction normale à la courbe et à annihiler le frottement qui se produit, en pareil cas, avec les wagons ordinaires. La même direction est donnée aux essieux des voitures suivantes au moyen de chaînes croisées dans le système de M. Arnoux père, et à l'aide de tringles rigides ou bielles dans le système perfectionné de M. Arnoux fils. C'est une très-remarquable invention, mais que sa complication rend d'un usage incommode et qui ne paraît pas devoir se répandre.
Ainsi donc, selon le pays, selon les produits à transporter, selon le tracé du chemin, le véhicule de chemin de fer varie. On se fait une idée des études qu'a exigées la construction de ce matériel dans des conditions si variées. Il faut avoir suivi les travaux des bureaux techniques de nos chemins de fer, pour savoir avec quel soin chaque menu détail est étudié, est calculé, est représenté: le moindre boulon, la plus petite ferrure sont refaits bien des fois avant d'être définitivement adoptés. Il n'y a, en effet, dans tous ces travaux, aucun détail insignifiant, tant l'application est étendue, tant le but à atteindre est élevé.
Donnons quelques chiffres.
On évalue, en France, à 25,000 francs, en moyenne, la dépense kilométrique de premier établissement afférente au matériel roulant des chemins de fer. Pour les 17,000 kilomètres exploités, c'est une dépense de 425 millions.
(p. 171) Et, si l'on prend seulement 20,000 francs comme moyenne pour tous les chemins du globe, la dépense ressort à 3 milliards 520 millions pour les 176,000 kilomètres environ, aujourd'hui exploités.
À quel nombre de véhicules correspond cette énorme dépense? Le calcul en est facile. On compte, en France, par kilomètre de chemin exploité, un nombre moyen de voitures représenté par 0,75 (soit 3 voitures pour 4 kilomètres), et un nombre moyen de fourgons et wagons représenté par 7,25 (soit 29 par 4 kilomètre); ces chiffres étant pris comme bases, on trouve pour les 176,000 kilomètres de voies ferrées du globe:
| Voitures | 152,000 | } | soit 1,408,000 véhicules, presque 1 million et demi! |
| Fourgons et wagons | 1,279,000 |
Nous arrivons à la partie la plus intéressante de l'histoire des chemins de fer, à celle où les découvertes se pressent, fécondes en résultats inattendus et merveilleux. De grands travaux ont été exécutés, des ouvrages gigantesques ont été élevés pour supporter cette voie de fer, peu différente aujourd'hui, après ses quarante ans d'existence, de ce qu'elle était à son origine, pour donner passage à ces véhicules de formes diverses.
La découverte de la machine à vapeur et son application à la locomotion ouvrent une ère nouvelle aux (p. 172) chemins de fer. L'avenir se révèle, et c'est avec un véritable respect que nous écrivons les noms de Cugnot, de Stephenson, de Séguin, les inventeurs de la locomotive.
Qu'étaient les chemins de fer avant l'invention de la locomotive? Ce qu'on les voit aujourd'hui encore sur presque tous les points où un autre mode de traction a été adopté ou conservé: des instruments imparfaits, coûteux, et par-dessus tout lents et d'un usage incommode.
Au lieu d'une locomotive aux entrailles de fer, à la respiration active et pressée, on n'a, comme moteur, qu'un coursier dont les poumons sont fragiles, et qui, malgré ses jambes aux sabots ferrés, se fatigue et s'use vite, rendant des services assurément, mais incomparablement moindres que ceux de la locomotive, s'attelant aux wagons des mines, aux wagons à voyageurs dans certains cas particuliers, mais toujours restreints.
Dans l'intérieur des villes d'Amérique, les stations sont placées le plus près possible du centre des affaires. Les wagons en partent tirés par des chevaux pour aller, dans une partie moins populeuse de la cité, former des trains qui sont alors remorqués par des locomotives.
(p. 173)
Fig. 33.—Tramway à Vienne.
(p. 175) À New-York, le chemin de Hudson-River et le New-York and Alem-Bahn ont leur station de voyageurs dans le voisinage de la Maison de Ville, tandis que le point de départ des locomotives a lieu à 4 kilomètres de là. À Philadelphie, au contraire, les locomotives pénètrent jusqu'au centre de la ville.
Les chemins américains, à rails creux, de Versailles et de Saint-Cloud, qui s'arrêtaient à la place de la Concorde, où les roues à boudin saillant étaient remplacées par des roues à jante plate pour atteindre la station centrale du Palais-Royal, ont été prolongés jusqu'au Louvre.
Tandis qu'à New-York on comptait, en 1858, 42 kilomètres de chemin à double voie, il y en avait 96 en exploitation à Philadelphie. Boston, qui n'a que 200,000 habitants, avait 40 kilomètres, et sur une portion de ces chemins de 27 kilomètres seulement, la circulation, cette même année, était de huit millions de voyageurs.
Il faut dire que le tracé des rues dans les villes, en Amérique, permet ce large développement des voies ferrées, qui serait à peu près impossible dans les villes françaises, en dépit des grandes voies rectilignes ouvertes par nos municipalités modernes. Notre esprit national, à l'encontre de celui des Américains, se prête peu à l'introduction des chemins de fer au centre des villes, et ce n'est pas sans lutter que les Compagnies obtiennent l'établissement de voies ferrées sur les quais de nos principaux ports et leur exploitation au moyen de locomotives. Là, encore, le cheval prévaut (p. 176) et le temps seul pourra dissiper les craintes des populations trop promptes à s'effrayer.
L'homme s'est efforcé de tirer parti de toutes les forces qui s'offrent naturellement à lui avant d'en chercher de nouvelles. Avant d'imaginer la locomotive, il avait inventé les plans automoteurs, ces voies inclinées le long desquelles un train de wagons pleins fait, à l'aide d'un câble et d'une poulie, et par la seule action de la pesanteur, remonter un train de wagons vides.
Le système des plans automoteurs est très en usage dans les mines, où il fournit un moyen économique d'opérer les transports. Dans certains cas, le poids de l'eau est employé comme moteur. On en remplit, au sommet du plan incliné, des chariots en tôle dont le poids fait remonter des wagons chargés de charbon et de minerai.
Robert Stephenson pensait même que ce système pourrait être appliqué au service des plans automoteurs dans les régions montagneuses de la Suisse; mais le système funiculaire ne laisse pas que de présenter toujours de graves inconvénients, et nous ne savons pas qu'il ait été appliqué dans ces conditions au transport des voyageurs.
Les chevaux, la pesanteur, agissant sur le corps transporté utilement, ou sur l'eau, tels ont été les seuls moteurs appliqués aux voies ferrées avant l'invention de la machine à vapeur. On conçoit que les inventeurs n'aient pas eu recours à l'action du vent, qui est trop irrégulière et trop variable pour pouvoir être toujours efficace.
(p. 177) C'est après l'application de la machine à vapeur à l'élévation des eaux, à l'épuisement des mines, et vers l'année 1776, aux différents usages de l'industrie, que l'on pensa à l'employer au remorquage des wagons. Les bennes remontaient dans les puits d'extraction: il ne paraissait pas plus difficile de remonter des wagons sur un plan incliné.
On a fait plusieurs applications remarquables de ce mode de traction: entre autres, les plans inclinés de Liége, dont les pentes varient de 0m,14 à 0m,30 par mètre (ils ont chacun 1,980 mètres de longueur et rachètent une même hauteur de 55 mètres), le plan incliné de Styring-Vendel, le plan incliné de la Croix-Rousse, à Lyon (pente 0,1605 sur 489m,20 de longueur). Dans les exploitations des environs de Newcastle, de Sunderland, de Manchester, etc., dans les comtés de Northumberland et de Durham et dans le Lancashire, on trouve de même de nombreuses applications du système funiculaire.
Une ou plusieurs machines à vapeur mettent en mouvement de grands tambours, ou cylindres horizontaux, sur lesquels s'enroule un câble en chanvre, en fer ou en acier, rond ou plat, dont les extrémités sont réunies ou laissées libres. À ce câble on attache le wagon de tête d'un train et les autres wagons suivent. Des freins puissants sont appliqués aux tambours et aux wagons eux-mêmes pour modérer la vitesse qu'ils tendent à prendre au moment de la descente du train, sous l'action de la pesanteur. Ces derniers sont, d'ordinaire, construits de telle sorte qu'ils peuvent (p. 178) agir automatiquement en cas de rupture du câble, étreindre, comme des mâchoires, les rails de la voie ou transformer instantanément le wagon en un traîneau en rendant immobiles les roues qui le portent.
Un autre mode de traction a été encore imaginé, pour le remorquage des véhicules avant l'invention de la locomotive. C'est le système atmosphérique. Chacun sait que l'atmosphère exerce sur les objets qui y sont plongés, une pression dont le baromètre donne la mesure; chacun sait que si l'on vient à extraire, au moyen d'une pompe, l'air contenu dans un tuyau en dessous d'un piston mobile, ce piston se déplacera sous la pression de l'air agissant sur l'autre face et entraînera avec lui une charge plus ou moins considérable, selon le diamètre plus ou moins grand du piston et le vide plus ou moins complet qui aura été fait dans le tuyau. L'existence de l'atmosphère constitue donc une force. Et, l'aurait-on soupçonné? l'idée d'utiliser cette force revient précisément à l'homme qui montra le parti qu'on pouvait tirer de la production et de la condensation de la vapeur d'eau, à Papin. Les savants de la fin du dix-septième siècle s'étaient vivement préoccupés des moyens d'utiliser la pression de l'atmosphère, les uns pour en faire un moteur mécanique d'une application générale à l'industrie; les autres uniquement pour répondre au désir du grand roi, qui voulait doter ses jardins de Versailles de nouveaux charmes, en y amenant les eaux de la Seine.
Papin essaya du vide obtenu au moyen de pompes (p. 179) pneumatiques et expérimenta sa machine, en 1687, devant la Société royale de Londres; plus tard, il se servit de la poudre à canon dans le même but (mais cependant après l'abbé d'Hautefeuille); en 1690, enfin, il publia dans les Actes de Leipsick la description de son cylindre à vapeur, où il obtenait encore le vide (vide relatif) au moyen de la production et de la condensation successives de la vapeur, découverte qui à elle seule immortalisera son nom. Les expériences de Papin sur le vide, produites à l'aide de pompes aspirantes, ne réussirent qu'imparfaitement, et l'idée resta dans l'oubli jusqu'en 1810, époque à laquelle parurent les premières locomotives.
Un ingénieur danois, Medhurst, proposa d'appliquer la pression atmosphérique au transport des marchandises, des lettres et des journaux à l'intérieur d'un tube. (Disons, en passant, que c'est au moyen de la pression de l'air, comprimé dans un tuyau, que s'opère à Londres et à Paris,—entre certaines stations,—le transport des dépêches.) L'idée de Medhurst fut reprise, en 1824, par Vallance, qui proposa de substituer les voyageurs aux marchandises et qui fit l'essai de son système sur la route de Brighton. Se confier, vivant, à une machine pénétrant dans un souterrain, où l'air manquait, où la lumière pouvait manquer, n'était pas du goût du public du temps. La tentative de Vallance demeura sans succès.
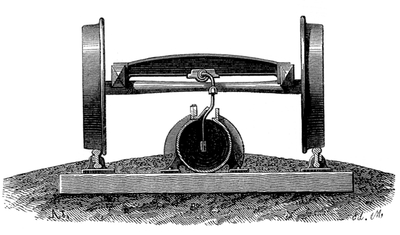
Fig. 34.—Coupe transversale du tube atmosphérique.
Trois ans après, Medhurst proposa de substituer au grand tube de Vallance un tube de plus petit diamètre, couché entre les rails; le tube contenant le piston locomoteur (p. 180) et les rails portant les wagons à voyageurs. Une fente longitudinale ménagée sur le tube devait servir au passage d'une tige reliant les wagons au piston. La difficulté était de trouver une soupape pouvant fermer hermétiquement cette fente et se soulever aisément au passage du train. Après des essais nombreux et infructueux, on expérimenta, en 1838, la soupape de MM. Clegg et Samuda, qui donna de bons résultats. En 1843, on fit une épreuve en grand sur le chemin de Kingstown à Dalkey, en Irlande. L'expérience réussit, la France s'en émut et, sur le rapport favorable de M. Mallet, inspecteur général des ponts et chaussées, il fut décidé que la traction sur le chemin de Saint-Germain, dans la partie comprise entre Nanterre et Saint-Germain, s'effectuerait suivant le système de l'ingénieur danois. On voit encore à Nanterre et à Chatou les bâtiments destinés à recevoir les pompes qui devaient faire le vide dans le tuyau (p. 181) atmosphérique. Les pompes magnifiques, les machines à vapeur et la batterie de chaudières placées en haut de la pente (0m,035 par mètre) qui mène du Pecq à Saint-Germain, ont disparu et cet énorme attirail, superbe agencement de forces impuissantes, objet de l'attention et de l'admiration de tant de visiteurs, n'a plus fourni qu'un amas de pièces inutiles, bonnes à renvoyer à la fonderie ou à la forge.
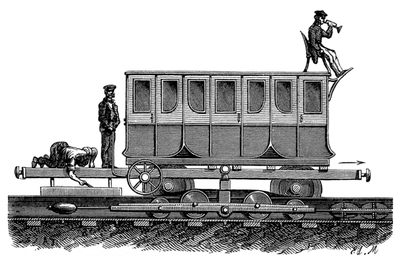
Fig. 35.—Coupe longitudinale du tube atmosphérique.
Le système atmosphérique, après quatorze années d'essai, a été abandonné entre le Pecq et Saint-Germain. Les locomotives remontent seules tous les trains, et le prix de la traction par train et par kilomètre est descendu de 3 fr. 80 ou 4 fr. à 1 fr. 32. C'est dire que le système atmosphérique est mort, et sans chances de revivre.
C'est vers l'année 1759, nous apprend le célèbre Watt, que le docteur Robinson, alors élève à l'Université de Glascow, eut l'idée d'appliquer la vapeur au mouvement des roues des véhicules. Watt lui-même, en 1784, a décrit une machine inventée par lui dans le même but; mais les idées de Robinson, aussi bien que celles de Watt, n'ont reçu aucune réalisation.
L'honneur d'avoir le premier construit une voiture se mouvant à l'aide de la vapeur, appartient au Français Cugnot. Les premiers essais de Cugnot eurent lieu en 1763. À lui revient l'idée,—au maréchal de Saxe, au général de Gribeauval, au duc de Choiseul, ministre de la guerre de Louis XV, revient l'honneur d'avoir contribué à sa réalisation.
La voiture de Cugnot était un fardier à trois roues, destiné au transport des canons. La vapeur produite dans une chaudière placée en porte-à-faux, agissait dans deux cylindres en bronze dont les pistons, alternativement soulevés et abaissés, actionnaient un petit arbre à manivelle relié au moyen d'engrenages à la roue d'avant. Cette roue était garnie d'un large cercle faisant prise sur le sol au moyen de fortes saillies et pouvait, à l'aide d'engrenages placés sous la main du conducteur, se déplacer sur elle-même de manière à faire prendre au véhicule les directions variées de la route à parcourir.
(p. 183) Mais la voiture de Cugnot ne pouvait faire que quatre kilomètres à l'heure,—c'est la vitesse d'un cheval au pas;—au bout de peu de temps, l'eau manquait et elle s'arrêtait. Elle était bien imparfaite, à la vérité, mais elle laissait deviner l'avenir. Il appartient aux hommes de génie de lever le voile qui couvre certaines découvertes et de voir dans un embryon toute une destinée. Napoléon, à son retour d'Italie, apprend l'existence de la voiture de Cugnot et exprime l'avis qu'on peut en tirer un grand parti! Le génie de la guerre a entrevu l'instrument de la paix à venir.
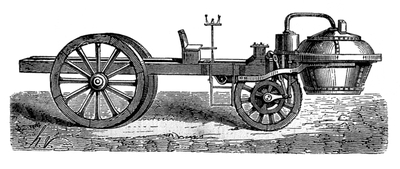
Fig. 36.—Voiture de Cugnot.
Le Conservatoire des Arts-et-Métiers et le Ministère de la guerre se disputèrent longtemps la machine de Cugnot; le premier finit par l'obtenir. C'est dans une des salles de ce musée qu'elle est encore, donnant la mesure des progrès accomplis depuis 70 ans.
Quant à Cugnot, qui avait eu, sur la proposition du général de Gribeauval, une pension de 600 livres et qui en avait été privé au moment de la Révolution, (p. 184) il serait mort de misère si une dame charitable de Bruxelles ne lui était venue en aide. Il avait soixante-quinze ans quand Bonaparte, premier consul, lui rendit sa pension et en éleva le chiffre à 1,000 livres. Il vécut encore quatre ans et mourut en 1804, pauvre, mais heureux comme on doit l'être, après une vie de labeur, en voyant grandir l'œuvre dont on a été le premier artisan. À ce moment, les locomotives commençaient à fonctionner dans les mines de Newcastle.
C'est en Amérique et en Angleterre que se poursuivent dès lors les essais d'application de la vapeur à la locomotion.
Oliver Evans, en 1800, construit une voiture à vapeur qu'il fait circuler dans les rues de Philadelphie. Trewithick et Vivian, mécaniciens de Cornouailles, prennent, en 1802, un brevet pour une voiture du même genre, et font marcher leur première locomotive, en 1804, sur les rails du chemin de Merthyr-Tydwill, dans le pays de Galles. Mais il semble que l'adhérence manque: on croit devoir recourir à l'emploi de stries sur la jante des roues.
En 1811, paraît la locomotive de M. Blenkinsop, directeur des houillères de Middleton. Cette machine avait quatre roues porteuses et s'avançait sur les rails à l'aide d'une roue dentée s'engrenant dans une crémaillère couchée entre les deux rails. Deux cylindres verticaux, placés au-dessus de la chaudière, transmettaient, au moyen de bielles, de manivelles et de pignons, le mouvement à cette roue dentée. La chaudière était un corps cylindrique traversé par un gros tube (p. 185) ayant à l'une de ses extrémités le foyer et à l'extrémité opposée la cheminée.
En 1813, un ingénieur, du nom de Brunton, remplace la roue dentée et la crémaillère par des béquilles s'appuyant sur les rails, comme la gaffe du batelier sur le fond de la rivière à la surface de laquelle chemine son bateau.
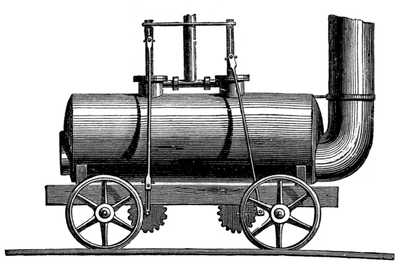
Fig. 37.—Machine de Blenkinsop (1811).
M. Blackett étudie, dans le courant de cette même année, la question de l'adhérence, qui, jusque-là, avait paralysé tout progrès. Il reconnaît que le frottement qui s'exerce entre la roue de fonte de la locomotive (car, à cette époque, les roues étaient entièrement en fonte) et les rails, est suffisant pour produire la progression de celle-ci et des wagons à remorquer.
L'année suivante, George Stephenson utilise toute l'adhérence des roues de sa machine en réunissant (p. 186) celles-ci par une chaîne sans fin, qui rend leurs mouvements solidaires. Le mode de suspension de cette machine mérite de fixer l'attention: la chaudière repose sur les roues par l'intermédiaire de tiges reliées à des pistons sur lesquels agissent l'eau et la vapeur contenues dans la chaudière. On rapporte que cette locomotive a remorqué 30 tonnes à une vitesse de 6,500 mètres à l'heure.
En 1815, G. Stephenson perfectionne sa machine. Les cylindres de suspension sont remplacés par des ressorts. À la chaîne sans fin, M. Hackworth substitue, en 1825, une bielle d'accouplement. Ce n'est pas encore notre locomotive actuelle, mais, telle qu'elle est, la machine de Stephenson rend déjà des services pour le transport des charbons.
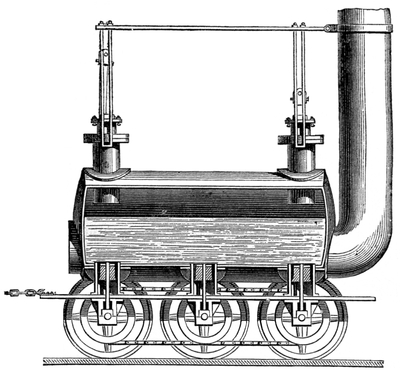
Fig. 38.—Machine de G. Stephenson (1814).
Jusqu'en 1827, il n'y a pas de progrès nouveau dans la construction des locomotives. Cependant, le chemin de Saint-Étienne à Lyon s'achève; on prévoit l'exploitation, et dans ce but on fait venir deux des locomotives inventées par Stephenson et en usage en Angleterre. Le directeur du chemin de Saint-Étienne, Marc Séguin, les examine. Il est tout d'abord frappé de leur faible production de vapeur et, pour y remédier, il leur applique le perfectionnement qu'il venait d'apporter aux chaudières servant à la navigation du Rhône: au gros tube faisant foyer de ces machines, il substitue un grand nombre de petits tubes. La chaudière tubulaire est inventée; mais cette grande division des produits de la combustion, ralentit le tirage. Pour obvier à cet inconvénient capital, Séguin a recours au (p. 187) ventilateur à force centrifuge; il arrive ainsi à produire jusqu'à 1,200 kilogrammes de vapeur par heure, avec des chaudières de 3 mètres de longueur et de 0m,80 de diamètre, renfermant 43 tuyaux de 0m,04 de diamètre. Ce moyen d'opérer artificiellement le tirage du foyer n'a pas toute la simplicité nécessaire. Stephenson, adoptant la chaudière tubulaire, se trouve en face du même problème et, pour le résoudre, il imagine de conduire dans la boîte à fumée la vapeur qui, après son action dans les cylindres, se perd dans l'air. L'idée n'est pas nouvelle, elle remonte aux temps (p. 188) les plus reculés, mais l'application est neuve et détrône le ventilateur de Séguin.
La locomotive est désormais inventée. En octobre 1829, un concours est organisé sur le chemin de Liverpool à Manchester; le prix est décerné à la Fusée (the Rocket), sortie des ateliers de Stephenson, qui remorque, avec une vitesse de six lieues à l'heure, une charge de près de 13,000 kilogrammes. Sans charge, elle fournit une course de dix lieues à l'heure.
À partir de cette époque, de nombreux perfectionnements viennent chaque jour s'ajouter à ceux dont la nouvelle machine a été dotée, mais ces perfectionnements n'ont plus qu'une importance secondaire vis-à-vis des inventions dues à Séguin et à Stephenson.
L'usage de la nouvelle machine se répand. Sa vitesse et sa puissance augmentent, ses dimensions s'accroissent. Les différentes parties du mécanisme deviennent l'objet d'études spéciales et, en même temps le travail des ateliers se perfectionne, les expériences se font, la science s'établit.
Des types sont créés pour les divers services effectués par ces nouvelles machines. Les uns servent au transport des voyageurs, les autres au transport des marchandises, d'autres, enfin, dans les gares ou sur les lignes de faible longueur.
(p. 189)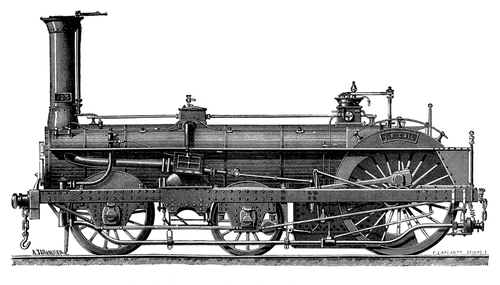
Fig. 39.—Machine Crampton.
(p. 191) Il ne faut pas s'attendre à trouver un ou deux types spéciaux pour chacun des services que nous venons d'indiquer. Il n'en est pas des choses de la science appliquée comme de celles de la science pure, et l'on est bien loin de s'entendre sur un fait de mécanique comme on s'entend sur un théorème de géométrie ou sur une question d'algèbre. Aussi, suivant les Compagnies, les types varient-ils et, à part certains caractères généraux, il serait assez difficile d'indiquer les différences qui existent entre les divers modèles adoptés. Ces différences sont, d'ailleurs, en partie légitimées par les conditions variées où se trouve placée l'exploitation de chaque chemin: tracé de la voie en plan et en profil, nature du combustible, etc., il faut avoir un moteur dont la construction,—qu'on nous permette la comparaison,—dont les entrailles, dont les jambes répondent à la nourriture qu'on lui donne, à la course qu'il doit fournir.
Les machines à voyageurs sont destinées à un service de moyenne vitesse (trains omnibus) ou à un service de grande vitesse (trains express).
Dans le premier cas, elles sont construites pour marcher à 35 ou 40 kilomètres; dans le second, à 70 kilomètres à l'heure. Ce qui distingue essentiellement ces deux types, c'est la dimension des roues motrices, qui ont, dans le second, jusqu'à 2m,60 de diamètre, et leur position en arrière du foyer, l'essieu passant sous les pieds du mécanicien. On conçoit que pour un même nombre de coups de piston ou de tours de roue, elles parcourent, grâce au grand développement (p. 192) de leur circonférence, un plus grand espace que les premières, dont les roues n'ont jamais un diamètre supérieur à 1m,80.—On peut dire de ces machines, dont l'ingénieur Crampton est l'inventeur, qu'elles courent ventre à terre. La marche rapide qu'elles doivent fournir exigeait un puissant organe respiratoire et digestif, une longue chaudière, par conséquent; elle demandait encore une grande stabilité; aussi, le centre de gravité a-t-il été placé le plus bas possible, les différentes parties du mécanisme étant groupées de chaque côté du corps cylindrique et rendues ainsi d'une surveillance plus facile.
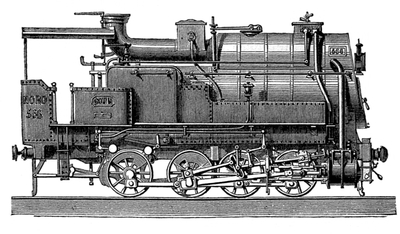
Fig. 40.—Machine Petiet (Nord).
Entre les machines à voyageurs et les machines à marchandises se placent les machines mixtes, destinées à faire un service commun sur les lignes de peu d'importance et à remorquer des trains composés de wagons à voyageurs et de wagons à marchandises. Il (p. 193) faut, pour ce service spécial, des locomotives d'une vitesse supérieure à celle des trains de marchandises ordinaires, et d'une puissance plus considérable que celle des locomotives destinées spécialement aux trains de voyageurs.
L'indépendance des roues, qui était le caractère propre des machines précédentes, n'est plus possible. Il faut, comme on dit, faire feu des quatre pieds et obtenir une adhérence plus grande. On arrive à ce résultat en rendant le mouvement d'une des deux paires de roues, précédemment laissées libres, solidaire de celui des roues motrices. On conjugue les essieux, c'est-à-dire qu'on les réunit au moyen de tiges ou de bielles d'accouplement, ce qui nécessite, comme point de départ, qu'elles aient le même diamètre. Ainsi donc: deux paires de roues d'égal diamètre, reliées entre elles, tel est le caractère essentiel de la machine mixte. Une troisième paire de roues, d'un diamètre plus petit (1m,00, tandis que les grandes ont jusqu'à 1m,74 de diamètre), accompagne celles-ci et contribue avec elles à porter le lourd véhicule. La vitesse des trains mixtes résulte du diamètre des roues motrices de la locomotive qui les remorque; leur résistance au mouvement est surmontée, grâce à l'accouplement de ces mêmes roues.
On pressent déjà les dispositions que doivent présenter les machines à marchandises. Qui ne connaît le scolopendre, ce myriapode, vulgairement appelé mille-pieds, au corps allongé, divisé en nombreux segments, aux pieds terminés par un crochet, qui, dans (p. 194) nos climats, n'a pas plus de 5 à 8 centimètres et qui, dans l'Inde, a jusqu'à 30 centimètres de longueur? Cet animal repoussant est cependant remarquable par la puissance de son appareil locomoteur: 74 paires de pattes! La machine Beugnot, l'un des types les plus puissants, l'une de celles qui en a le plus, en a dix fois moins: 7 paires de roues seulement.
Les machines à petite vitesse sont de deux espèces, celles de moyenne puissance, qui font le remorquage des trains ordinaires de marchandises sur les lignes peu accidentées et peu contournées, et celles de très-grande puissance, qui doivent circuler sur des lignes d'un tracé difficile, en traînant après elles des convois lourdement chargés.
Les machines de moyenne puissance ont d'ordinaire trois paires de roues de même diamètre accouplées. Le diamètre de ces roues est toujours faible et ne dépasse guère 1m,50. Elles sont généralement ramassées, de forme trapue, comme ces hommes qui sont capables de fournir de leurs reins et de leurs jambes de grands efforts.
Dans les machines de grande puissance, spécialement destinées à remorquer de lourdes charges sur des chemins rapides et à courbes de petit rayon, le corps cylindrique s'allonge, car il faut une grande production de vapeur; le nombre des roues augmente, car il faut user de toute l'adhérence; le mécanisme enfin se complique, car il faut donner à ce grand corps de métal la souplesse nécessaire à une marche sinueuse.
(p. 195)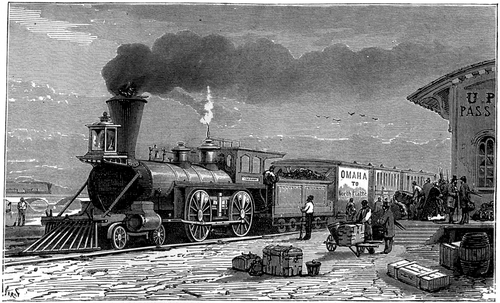
Fig. 41.—Une station, en Amérique.
(p. 197) C'est pour franchir la montagne du Sommering, avec des pentes de 25 millimètres, que l'ingénieur autrichien Engerth a construit la puissante locomotive qui porte son nom et dans laquelle il a réuni sur dix roues le tender et la machine, de manière à profiter de toute l'adhérence possible, en laissant aux deux parties du système la possibilité de se mouvoir et de s'inscrire dans des courbes de 190 mètres de rayon.
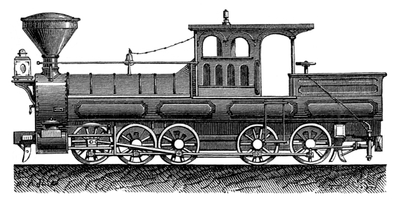
Fig. 42.—Machine Jefferson.
Le problème de la locomotion, dès qu'il s'agit de fortes pentes, en courbes de faible rayon, présente les plus grandes difficultés. Chaque jour les ingénieurs font un nouveau pas vers la solution, mais celle-ci n'est point encore atteinte et on ne peut prévoir l'époque où la machine de montagne, celle qui se rapprochera le plus de notre scolopendre, par sa force et sa souplesse, sera trouvée.
À côté de ces lourdes machines, aux formes massives (p. 198) et athlétiques, auxquelles incombent les transports les plus importants, se trouvent des machines plus légères, plus rapides à la course: les machines-tenders, qui portent avec elles leur provision d'eau et de combustible pour les courts trajets qu'elles doivent accomplir. Les machines-tenders servent à la traction sur les lignes de banlieue, et sont utilisées dans les gares pour les manœuvres de composition et de décomposition des trains, trop lentes avec des chevaux ou à bras d'hommes.
Tels sont, très en résumé, les divers types de machines nécessaires à l'exploitation des voies ferrées, et que l'on trouve dans le matériel de toutes les Compagnies de France ou de l'étranger, avec les différences naturelles que les conditions locales leur imposent.
Nous avons dit déjà plusieurs fois que l'instrument de transport sur les voies ferrées, si parfait qu'il soit déjà, n'est pas encore, dans tous les cas, tout ce que l'on peut désirer. Il ne faut pas que le chemin qui est à parcourir nous empêche de reconnaître les améliorations accomplies.
On sait que la puissance d'une machine dépend des dimensions de ses entrailles, nous voulons dire de l'étendue de sa surface de chauffe. À l'origine, les machines du chemin de Versailles mesuraient 56 mètres carrés; ce chiffre a été à peu près quadruplé: les grosses machines du chemin de fer du Nord ont jusqu'à 213mc,35 de surface de chauffe. Au lieu de 450 kilogrammes d'eau, elles digèrent ou évaporent dix fois plus, et jusqu'à 5,000 kilogrammes d'eau par (p. 199) heure. Le corps cylindrique, qui n'avait que 2m,43 de longueur dans les anciennes machines Sharp, a aujourd'hui jusqu'à 4m,89 dans les Engerth.
L'augmentation de poids est la conséquence naturelle de l'augmentation des dimensions. La Fusée pesait 4 tonnes 30 et, sans remonter si loin, les anciennes machines Buddicom pesaient 17 tonnes; aujourd'hui, les Engerth, avec leur tender, pèsent 62 tonnes 80. L'adhérence a augmenté avec le poids et, tandis que la charge remorquée par les anciennes machines n'était que de 40 tonnes, à la vitesse de 10 kilomètres à l'heure, elle est aujourd'hui: de 700 tonnes, à une vitesse de 23 kilomètres pour les Engerth, ou de 88 tonnes, à une vitesse de 80 kilomètres, pour les Crampton.
À l'encontre de ce qui arrive pour les chevaux, qui produisent en raison de la nourriture qu'on leur donne (parce que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de diminuer leurs facultés digestives et assimilatrices, sans réduire leur quantité de travail, l'œuvre de Dieu étant parfaite), la consommation des machines s'est améliorée: par de meilleures proportions données au foyer, à la chaudière et aux différentes parties du mécanisme, la quantité de combustible brûlée pour transporter une tonne à 1 kilomètre a été réduite de 0k,45 à 0k,032, c'est-à-dire dans la proportion de 14 à 1.
Le travail des ateliers s'est perfectionné, le prix des machines s'est notablement abaissé, et cela en dépit du prix de la main-d'œuvre, qui va constamment en (p. 200) croissant. L'unité-cheval a notablement baissé. Et quelle perfection plus grande dans la construction!
Or, ce cheval, pris pour unité de la mesure des locomotives et des machines à vapeur en général, et qu'on appelle cheval-vapeur, n'est pas l'équivalent du cheval ordinaire de nos voitures. Le cheval-vapeur équivaut à 75 kilogrammètres (c'est-à-dire à la force nécessaire pour élever, par seconde, un poids de 75 kilogrammes à 1 mètre de hauteur), tandis que la force du cheval ordinaire est évaluée à 45 kilogrammètres seulement. Et, comme ce dernier ne peut travailler que huit heures environ sur vingt-quatre, il en résulte qu'il faudrait 5,5 chevaux ordinaires pour faire l'équivalent d'un cheval-vapeur, ou mieux 11 chevaux ordinaires pour remplacer 2 chevaux-vapeur.
Cette définition étant donnée, nous serons compris en disant que les locomotives aujourd'hui en usage développent un travail soutenu de 200 à 300 chevaux-vapeur, ou de 1,100 à 1,650 chevaux ordinaires.
Les Compagnies françaises avaient, au 31 décembre, 11,723 locomotives, et les Compagnies anglaises 8,619.
On compte, en général, pour l'exploitation des chemins de fer, 0,34 locomotives par kilomètre (ou une machine environ pour 3 kilomètres), ce qui donne, pour les 176,000 kilomètres exploités aujourd'hui, environ 59,800 locomotives, produisant un travail de 14,950,000 chevaux-vapeur, ou de 82,225,000 chevaux ordinaires. On est effrayé de ces chiffres et l'esprit se rend difficilement compte des quantités qu'ils (p. 201) représentent. Cependant, si l'on suppose que tous ces chevaux soient attelés en flèche et n'occupent chacun qu'une longueur de 2 mètres, l'attelage aura comme longueur 191 fois la distance de Paris à Marseille, ou sera la moitié environ de la distance moyenne de la terre à la lune!
Nous ne pouvons mieux finir cette courte analyse du chemin de fer, qu'en transcrivant ici les lignes par lesquelles deux des rapporteurs de la classe 63 (matériel du chemin de fer), à l'Exposition universelle de 1867, MM. E. Flachat et de Goldschmidt, terminaient leur exposé économique.
«Quelque découverte qui puisse être faite dans l'industrie et dans les arts, il n'y en a pas qui vaille celle qui a abaissé de 4 à 1 le prix du transport de toutes choses, en augmentant la vitesse dans le rapport de 1 à 5.
«Il y a dix années au plus que ce nouvel état de choses exerce son influence sur l'industrie générale, et déjà l'Exposition universelle nous montre une égalité menaçante pour les uns, consolante pour les autres, providentielle pour tous, dans les moyens de production. C'est comme une abondance qui monte et qui doit enrichir l'humanité sur tous les points du globe. À voir l'ardeur qui nous entraîne et qui nous unit, pour améliorer demain ce qui a été fait hier, qui douterait du mieux qui va suivre et n'aurait confiance dans ce que l'avenir prépare?»
À côté des locomotives dont nous venons d'esquisser l'histoire et de faire connaître les principaux types, se placent un certain nombre de machines diverses: les unes fonctionnent encore au moyen de la vapeur, les autres au moyen de l'air ou de l'eau comprimés, d'autres enfin au moyen de l'électricité: nous allons en faire connaître les dispositions principales.
Nous parlerons d'abord de quelques locomotives remarquables par le nombre de leurs organes propulseurs.
La difficulté qu'éprouvent les constructeurs à conjuguer le mouvement de plusieurs paires de roues sur les lignes à courbes de petit rayon, les a conduits à transmettre d'une manière indépendante aux roues de la machine le mouvement de va-et-vient produit par l'action de la vapeur dans les cylindres et, par suite, à multiplier le nombre de ces derniers,—une paire de cylindres agissant, comme à l'ordinaire, sur les roues d'avant de la machine, une seconde paire agissant sur les roues d'arrière, sur celles du tender ou même sur celles des divers véhicules. Tel est le système, en principe.
Il a été appliqué pour la première fois sur le chemin (p. 203) de Saint-Étienne, par M. Verpilleux qui disposait deux cylindres sous le tender; puis, au chemin de fer du Nord, où de superbes locomotives ont été construites pour les services de petite et de grande vitesse.
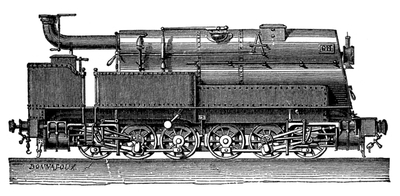
Fig. 43.—Machine Petiet (Nord), à quatre cylindres.
La machine à marchandises du Nord est montée sur douze roues, groupées et accouplées par six. Chaque groupe est commandé par deux cylindres, les uns placés en tête, les autres en queue de la machine. Une longue chaudière, surmontée d'un dessiccateur, est couchée sur les six essieux. Autour de ses flancs se trouvent l'eau et le charbon nécessaires à son alimentation, et le tout pèse 59,7 tonnes et est capable de remorquer des charges de 655 tonnes brutes, en rampe de 0m,005, avec une vitesse moyenne de 25 kilomètres à l'heure, ou de 80 tonnes, en rampe de 0,05 par mètre. Ces grandes dimensions, cette grande puissance ont fait donner parfois à cette machine le nom de machine-chameau.
(p. 204) Une machine de même système (4 cylindres), mais avec une paire de roues de moins (5 au lieu de 6), a été construite pour le service des express du Nord, qui sont très-chargés. Les deux paires de roues motrices d'avant et d'arrière ont un diamètre de 1m,60, ce qui ne pourrait suffire à un service de grande vitesse, si l'on n'avait pris soin d'augmenter le nombre des coups de piston et par suite celui des tours de roues par unité de temps.
La locomotive de M. Meyer ne diffère de la locomotive à marchandises du Nord que par l'isolement des deux groupes de six roues, montés sur deux trucks indépendants et non plus sur un même châssis. La chaudière repose sur les deux trucks, comme la caisse des wagons américains sur les trains qui la portent; des tuyaux articulés servent à la distribution de la vapeur dans les quatre cylindres et à son échappement dans la cheminée. Cette disposition donne à la machine la souplesse nécessaire à son passage dans les courbes de petit rayon, sans lui ôter la rigidité et la solidité qui sont la condition vitale de ces grands corps métalliques.
La machine Queensland, du système Fairlie en usage aux colonies anglaises, résout le même problème d'une manière différente.
M. Haswell a construit une machine, à grande vitesse, dite Dupleix, dans laquelle les quatre cylindres, au lieu d'être isolés, comme dans les machines précédentes, sont superposés deux par deux et agissent sur une manivelle à deux bras, de manière à éviter l'emploi (p. 205) des contre-poids: disposition compliquée et insuffisamment justifiée.
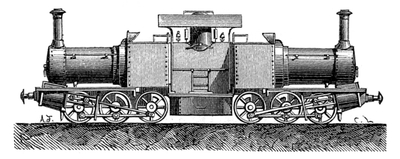
Fig. 44.—Machine Fairlie.
Enfin, M. Eugène Flachat, qui a si puissamment, et pendant de si longues années, contribué à la construction et au perfectionnement de nos voies ferrées, a proposé non plus quatre paires de cylindres, mais autant de cylindres que de trucks porteurs de véhicules. La chaudière destinée à engendrer la vapeur nécessaire à tous ces cylindres est placée en avant du train sur deux trucks, et des tuyaux articulés la répartissent dans toute la longueur du train. Le poids et, par suite, les dimensions du véhicule peuvent être augmentés. M. Flachat proposait l'emploi des voitures du système américain à long couloir intérieur.
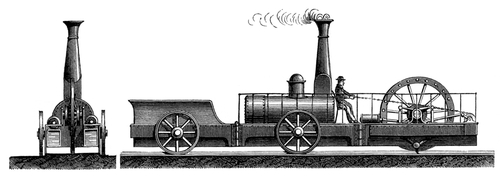
Fig. 45.—Machine Jouffroy.
La locomotive de M. de Jouffroy diffère complétement des précédentes, et c'est d'une tout autre manière que cet inventeur a cherché à résoudre le même (p. 206) problème de la locomotion en pays de montagnes. Il place la chaudière sur un châssis porté par deux grandes roues à jante plate, et le mécanisme sur un autre châssis supporté en son milieu par une roue unique en fer, garnie d'une jante en bois destinée à se mouvoir sur un rail strié, qui occupe le milieu de la voie. Cette roue est la roue motrice. Elle est comme la roue d'avant d'un tricycle, portant sur ses deux roues de derrière la chaudière et ses accessoires. Les deux parties dont se compose le châssis de ce tricycle sont réunies au moyen d'une articulation verticale, qui augmente (p. 207) encore sa souplesse propre. On voit que l'inventeur a cherché à obtenir une grande adhérence, en même temps qu'une grande légèreté et une grande flexibilité de son matériel. D'ailleurs, son système de grandes roues à jante plate, mobiles sur des rails à rebords, n'est pas exclusif à sa machine. Ses voitures sont aussi montées sur un seul essieu porté par deux grandes roues et réunies les unes aux autres au moyen d'articulations à axe vertical qui permettent un facile déplacement dans le plan de la voie. C'est là assurément une conception ingénieuse, une solution du problème, mais elle emprunte des moyens dont la pratique a révélé les défauts et n'a pu consacrer l'usage. Aussi n'est-il pas appliqué.
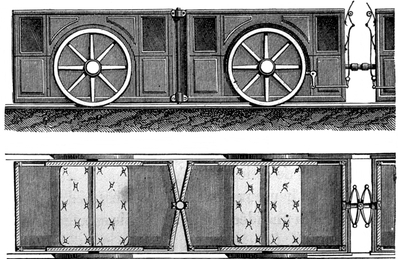
Fig. 46.—Voiture Jouffroy.
Nous retrouvons encore le rail central dans une autre (p. 208) invention, mais non plus ce rail avec ses stries et ses dentelures, qui le font ressembler à une crémaillère, mais un rail semblable à ceux de la voie ordinaire, à la hauteur près à laquelle il se trouve placé au-dessus du ballast. Il ne sert plus au passage d'une roue verticale comme celle de M. de Jouffroy, mais au passage de deux couples de roues horizontales qui le pressent entre elles, comme feraient les extrémités de tenailles dont les mâchoires tranchantes, devenues circulaires, seraient animées d'un mouvement de rotation. Tel est le système de M. le baron Séguier, que différents inventeurs, MM. Duméry, Giraud et Fedit, et enfin M. Fell, ont cherché à rendre pratique.
Nous ne nous arrêterons pas à la description des machines proposées par les premiers, mais nous dirons quelques mots de celle de M. Fell, en raison de l'avenir que des essais heureux paraissent lui réserver.
«On se fera une idée sommaire, mais exacte de cette machine, dit M. Couche dans son rapport sur les locomotives exposées en 1867, en concevant une locomotive à huit roues couplées dont quatre verticales et porteuses et quatre horizontales commandées par les mêmes pistons, au moyen de bielles motrices distinctes et pinçant entre elles un rail central. On a donc, d'une part, l'adhérence ordinaire due au poids entier de l'appareil; et, de l'autre, l'adhérence facultative, en quelque sorte illimitée, due à la pression exercée par des ressorts, et que le mécanicien règle à volonté.»
La machine de M. Fell a fait le service de la ligne de 80 kilomètres établie sur la route du Mont-Cenis, (p. 209) en attendant le percement du souterrain. Elle mettait cinq heures à opérer ce trajet, franchissant des rampes de 0m,08 par mètre, et passant dans des courbes de 40 mètres de rayon, avec un train de trois wagons attelés à sa suite. Rien de plus pittoresque que ce voyage tantôt à ciel ouvert, tantôt sous les longs souterrains en charpente destines à garantir la voie des avalanches.
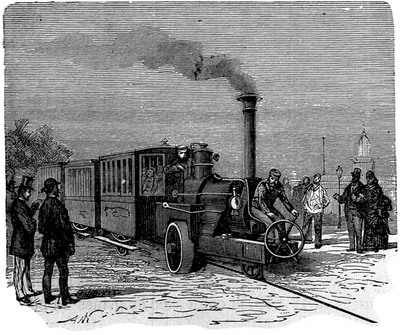
Fig. 47.—Système Larmanjat.
Deux systèmes ont été proposés pour l'établissement des chemins de fer à bon marché, au moyen d'un seul rail: l'un est le système Larmanjat, l'autre le système uno-rail de MM. Saint-Pierre et Goudal. Tous deux s'établissent sur les accotements des routes, le premier en (p. 210) terrain plat, le second en pays de montagnes plus spécialement.
Les véhicules de M. Larmanjat sont à quatre roues, deux sur l'axe: l'une à l'avant, l'autre à l'arrière et portant sur le rail; deux latérales: une à droite, une à gauche, reposant sur le sol et fonctionnant comme roues d'équilibre. Les premières portent la plus grande partie de la charge et, placées sur le rail, elles réduisent le frottement et par suite l'effort de traction.
On voit que la chaussée parcourue par les trains de M. Larmanjat doit être parfaitement de niveau pour que les voyageurs ne soient pas soumis à des oscillations qui ne manqueraient pas de devenir fatigantes et désagréables. Un essai de ce système a été fait entre le Raincy et Montfermeil, sur une longueur de 5 kilomètres, et a paru donner d'assez bons résultats.
D'après M. Larmanjat, le kilomètre de rail placé sur le côté de la route macadamisée reviendrait à 7,000 francs; placé sur l'un des bas côtés, avec macadam à droite et à gauche, à 10,000, et enfin avec longrines en bois, à 14,000 francs.
Le matériel roulant est aussi à très-bas prix: les machines coûtent de 10,000 à 20,000 francs et les wagons de 2,500 à 3,500 francs. Ces prix peuvent donc rendre possibles un grand nombre de petites lignes à trafic restreint.
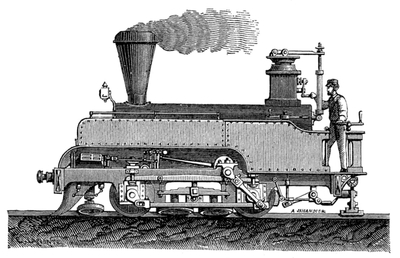
Fig. 48.—Machine Saint-Pierre et Goudal (élévation).
Les voitures et la locomotive de MM. Saint-Pierre et Goudal sont portées sur quatre roues à large jante qui se meuvent sur des bandes en asphalte comprimé; ces roues n'ont rien de particulier. En dessous des véhicules (p. 211) se trouvent deux paires de roues presque horizontales, étreignant entre elles le rail central, comme dans le système Fell. Ces roues ont même diamètre que les premières; leur pression sur le rail peut être graduée. (p. 212) Les huit roues reçoivent leur mouvement de deux cylindres placés à l'avant.
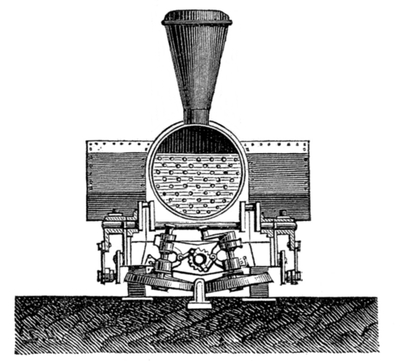
Fig. 49.—Machine Saint-Pierre et Goudal (coupe transversale).
D'après les inventeurs, cette locomotive-tender, du poids de 10 tonnes, d'une force normale de 50 chevaux, peut traîner un poids utile de 20 à 22 tonnes, en rampe de 0m,05 par mètre, à une vitesse de 6 à 8 kilomètres.
Il ne nous est pas possible de nous prononcer sur la valeur de ce système. Nous n'avons pas ouï dire qu'il ait encore reçu d'application. Quelle sera la durée des bandes asphaltées? Quelle sera la durée des machines elles-mêmes, dont le mécanisme est compliqué? Comment résisteront-elles aux secousses produites par les imperfections de la voie, si difficile à réparer. Il est impossible de répondre à toutes ces questions.
Les inventeurs et les ingénieurs ne se sont pas seulement préoccupés des améliorations à apporter au mécanisme locomoteur, ils ont cherché aussi à simplifier le mode d'action de la vapeur. C'est ainsi qu'on a essayé d'appliquer des machines rotatives à la mise en mouvement des roues des locomotives. Ces tentatives n'ont pas réussi jusqu'à présent, et on a renoncé à cette application, malgré la simplicité et l'attrait qu'elle présentait. Peut-être faut-il attendre que les machines rotatives se soient perfectionnées; la science, de ce côté, n'a pas dit son dernier mot.
Nous avons parlé déjà des plans inclinés et des machines fixes placées à leur sommet qui opèrent à l'aide d'un câble le remorquage des wagons sur ces plans. De grands inconvénients existent dans l'emploi de ce système. (p. 213) C'est par des modifications profondes que M. Agudio les a surmontés.
Chacun connaît le touage en usage sur les rivières et les canaux: une chaîne couchée dans le fond de la rivière sert d'amarre à un bateau sur le pont duquel de gros tambours sont disposés. Une machine à vapeur fait tourner ces tambours, sur lesquels la chaîne s'enroule deux ou trois fois, pour retomber ensuite dans l'eau à l'arrière du bateau. Cette chaîne, comme on le voit, présente une grande analogie avec le rail central Séguier. M. Agudio a remplacé la chaîne de touage par un câble métallique fixé à ses deux extrémités; ce câble s'enroule deux fois sur les gorges de deux tambours disposés sur le train du locomoteur. La machine à vapeur du bateau-toueur est remplacée par deux machines fixes, l'une en haut, l'autre en bas du plan incliné. Chacune de ces machines tire un des brins du second câble, dont les extrémités ont été réunies après avoir été passées sur deux nouveaux tambours du locomoteur. On comprend le jeu de l'appareil: le câble sans fin transmet, par ses deux brins, aux tambours qui le portent, le mouvement qu'il a reçu des machines. Ces tambours le transmettent à leur tour au tambour qui porte le câble toueur, immobile sur le sol et le long duquel il s'avance, entraînant à sa suite le train tout entier.
Le locomoteur est porté sur deux trucks munis de freins puissants.
Ce système, tel que nous venons de le décrire, présente déjà de sérieux avantages: flexibilité et légèreté (p. 214) de la machine, simplicité des organes de transmission, sécurité à la montée comme à la descente. Mais M. Agudio l'a encore perfectionné en remplaçant son câble toueur fixe par le rail central du système Séguier ou Fell. Les poulies du locomoteur, dans le nouvel appareil, sont disposées horizontalement et étreignent fortement le rail. Enfin, le poids du locomoteur, qui est de 12 tonnes et qui se répartit sur les roues porteuses, donne lieu à une certaine adhérence dont il a aussi tiré parti.
On étudie, en ce moment, l'application du système Agudio-Fell à la traversée du Simplon. Sur le versant nord, où se trouvent des rampes de 0m,10 par mètre, on se propose d'employer le locomoteur Agudio, et sur le versant sud, beaucoup moins abrupt, la locomotive Fell.
Jusqu'à présent, la vapeur d'eau a été le seul agent employé dans les machines fixes ou locomotives dont nous avons parlé, mais elle n'a pas été le seul agent essayé.
Nous vivons dans une atmosphère gazeuse, compressible, élastique, que nous pouvons utiliser comme moyen de propulsion. Nous pouvons profiter des chutes ou des cours d'eau improductifs pour comprimer l'air, faire provision de la masse, ainsi réduite à un faible (p. 215) volume, et la faire agir dans les cylindres de la locomotive, au lieu de la vapeur d'eau. C'est le système proposé par M. Andraud.
Deux chiffres font saisir immédiatement les difficultés qui s'opposent à l'emploi de l'air comprimé dans les locomotives: 1 mètre cube d'air et 1 mètre cube de vapeur, à même pression, produisent le même effet dans le cylindre de la machine, mais cette vapeur, à l'état d'eau, n'occupe dans le tender qu'un volume de 3 litres 50, qui est les 0,0035 de celui qu'occuperait l'air;—d'où jaillit l'impossibilité.
M. Andraud propose de comprimer l'air à 30 atmosphères, mais il faut alors un réservoir très-résistant et, par conséquent, très-lourd: nouvelle impossibilité.
L'addition d'un foyer et l'emploi de l'air chaud ne conduisent pas à de meilleurs résultats. On a constaté sur les machines fixes qu'on ne peut guère dépasser la force de quatre chevaux sans augmenter démesurément la masse.
M. Pecqueur, reprenant les idées de M. Andraud, a eu l'idée de disposer, le long de la voie, un long tube servant de réservoir où la machine en marche puiserait l'air comprimé. Mais il suffit d'énoncer un semblable projet pour faire entrevoir toutes les difficultés attachées à sa réalisation. M. Pecqueur, indépendamment de cette locomotive à air comprimé, a inventé aussi un piston locomoteur comme celui que nous avons décrit en parlant du système atmosphérique, mais qu'il fait mouvoir au moyen de l'air comprimé, au lieu de l'air raréfié.
(p. 216) M. Andraud, à qui revient l'idée de la locomotive à air comprimé, a proposé des chemins éoliques, dont le succès nous paraît encore plus problématique. Voici la disposition qu'il propose: Entre les deux files de rails se trouve un madrier et, de chaque côté de ce madrier, un tube en étoffe flexible et imperméable à l'air, une sorte de gros boyau. Ces deux boyaux sont accompagnés d'un gros tube latéral résistant, qui sert de réservoir d'air comprimé.
Que l'on suppose vides, un moment, les deux tubes placés au milieu de la voie, et qu'après les avoir saisis à l'aide de deux rouleaux opposés, faisant mâchoires, on introduise l'air, celui-ci gonflera les tubes flexibles, pressera les rouleaux et les fera avancer. On n'a plus qu'à disposer sur les tubes autant de paires de rouleaux ou de mâchoires qu'on voudra, au-dessus de ces rouleaux des wagons reliés, et le système progressera. Théoriquement, il n'y a rien à dire; mais pratiquement, c'est autre chose. Que coûtera l'ensemble? Et, sans même aborder la question de prix, que dureront ces tubes? Voyez-vous les fuites se produire et les cantonniers, transformés en couturières, chargés de mettre des pièces. Tout cela nous paraît inabordable.
Aussi préférons-nous l'obscurité du tunnel de Sydenham à l'insécurité de semblables systèmes.
Nous résumons un article du Railway News, du 3 septembre 1864, qui rend compte de l'expérience, nouvelle application de l'idée de Vallance, faite entre Londres et Sydenham.
La voie est établie dans un tunnel circulaire en briques (p. 217) de 3m,20 de diamètre, capable de recevoir les grandes voitures du Great-Western. Le véhicule ressemble à un long omnibus et porte un disque au milieu duquel il se trouve placé, comme le serait l'acrobate retenu au centre du cerceau garni de papier qu'il traverse dans les jeux du cirque. Ce disque forme la section du tunnel et fonctionne comme piston. La force qui le fait mouvoir est produite par un grand ventilateur ou éjecteur, à surface concave, de 6m,70 de diamètre, mis en mouvement par une petite machine à vapeur.
La voiture doit-elle descendre. Ses freins sont desserrés, elle s'engage dans le tunnel en passant sur une longue ouverture grillée par laquelle l'air arrive. Le ventilateur tourne. Une porte en tôle ferme l'entrée du tunnel, et la voiture descend, poussée par l'air introduit. Le ventilateur s'arrête avant l'arrivée du wagon, la vitesse acquise suffit à le conduire à la fin de sa course; les freins sont serrés, il s'arrête.—Doit-il remonter? C'est alors par aspiration que fonctionne l'appareil, et le véhicule s'avance dans le souterrain, comme l'eau s'élève aspirée dans un chalumeau.
On voit l'avantage que présente ce système sur le système atmosphérique que nous avons décrit précédemment. Au lieu d'un petit piston, dont la faible surface réclame, pour produire un effet voulu, une pression élevée en chacun de ses points, on n'a plus besoin que d'une faible pression répartie sur la grande surface du nouveau piston. Par suite, les fuites si redoutées dans le premier cas sont bien moindres et bien moins (p. 218) à craindre dans celui-ci. Enfin,—et cet avantage ne sera pas sans intérêt pour certains voyageurs délicats,—l'air circule et se renouvelle dans l'intérieur du souterrain, de manière à dissiper les craintes de ceux qui, comme le grand Arago, redouteraient encore les maladies causées par l'air humide des souterrains.
Quel sera le sort de cette nouvelle application de l'air à la locomotion? Construira-t-on des souterrains sur le versant des montagnes pour les franchir plus aisément? Fera-t-on un tunnel sous la Manche, et l'air comprimé sera-t-il le moteur adopté? On ne peut rien affirmer, mais il résulte évidemment de l'expérience que nous venons de rapporter qu'un nouveau moyen, aussi puissant que simple, a été mis à la disposition des ingénieurs, qui sauront l'utiliser dans les circonstances les plus avantageuses.
Un système, qui a fait beaucoup de bruit dans ces dernières années, est le système hydraulique de M. Girard.
Un sentiment inné porte l'ingénieur à imiter ce qu'il voit dans la nature, et à tirer parti des forces improductives qu'il ne faut que dompter pour les rendre utiles et en faire des sources de profits. C'est à un sentiment de ce genre qu'a obéi M. Girard en imaginant son chemin de fer hydraulique.

Fig. 50.—Système Girard.
Le frottement des véhicules sur les rails est déjà bien faible dans les chemins de fer: M. Girard a cherché à le réduire encore et à le rapprocher de ce qu'il est entre le bateau et l'eau qui le porte. Des chutes d'eau, d'une puissance considérable, se précipitent des montagnes (p. 219) dans les vallées sans que, le plus souvent, on en tire le moindre parti. M. Girard a voulu les utiliser. Pour cela, il dispose, le long de la voie, une conduite d'eau qui, au passage des wagons, fournit le liquide nécessaire à la mise en mouvement. Deux systèmes de turbines agissent sur les roues. Selon que l'eau frappe les turbines de l'un ou de l'autre système, la progression a lieu dans un sens ou en sens contraire. Tel est le premier système proposé par M. Girard. Plus tard, il est revenu sur cette première conception et a remplacé les roues par des patins cannelés portant sur (p. 220) un rail plat. C'est alors, entre le patin et le rail, qu'il introduit de l'eau comprimée, de manière à adoucir le frottement des deux surfaces, et à le réduire, a-t-il prétendu, au millième de la charge.
Mais pourquoi faut-il que la pratique se trouve si souvent en désaccord avec la théorie, et que les faits les plus simples en apparence rencontrent dans l'application de si grandes difficultés? Le système de M. Girard a été essayé à la Jonchère, près de Rueil; une commission a été nommée pour constater les résultats obtenus, et son rapport n'a pas été favorable à cette nouvelle invention. Aux chances de fuites que les moindres mouvements de la voie peuvent produire, et qu'une forte pression, donnée à l'eau pour obtenir de grandes vitesses, peut aggraver, s'ajoute la difficulté d'avoir toujours une grande quantité d'eau et de la conserver liquide dans les conduites en dépit des grands froids. Nous ne croyons donc pas que le système Girard soit appelé à renverser les locomotives.
Nous en dirons autant des machines électro-magnétiques qui, en l'état de la science, doivent être exclues du domaine de la pratique. Les savants sont, à cet égard, d'un avis unanime. Un cheval de force, obtenu au moyen de la vapeur, coûte environ 10 centimes par heure; obtenu par un courant électrique, il coûte 20 francs, disait M. Aristide Dumont à l'Académie des sciences, en 1851. Depuis cette époque, la construction des machines électro-motrices a fait des progrès, mais ils ne sont pas tels qu'on puisse, d'ores et déjà, prévoir leur application prochaine à l'industrie des transports.
(p. 221) Tel est, à cette heure, l'état des découvertes relatives à la locomotion sur les voies ferrées. D'immenses efforts, on le voit, ont été faits depuis l'origine, de la part de tous les hommes et de tous les peuples qui marchent à l'avant-garde de la science. Tous y ont contribué dans la mesure de leur génie et de leurs intérêts; nous ne chercherons pas à qui revient la plus large part de gloire: devant la grandeur du résultat s'efface la petitesse des amours-propres. Et nous ne touchons pas certainement au terme des progrès qui doivent s'accomplir: les grandes voies sont faites, les petites restent à faire, à chacune leur moteur; celui des premières continuera à se perfectionner, celui des secondes est presque à créer. Enfin, il faudra trouver un moteur spécial pour nos routes ordinaires, qui nous permette de tirer de celles-ci le meilleur parti possible.
Nous avons vu, au commencement du chapitre précédent, que l'honneur des premiers essais tentés pour remorquer un véhicule sur une route ordinaire à l'aide de la vapeur, revient à l'officier français Cugnot. Ces essais datent de 1763. Nous avons rapidement décrit sa machine et fait connaître ses nombreuses imperfections. Il était impossible, en effet, de construire, à cette époque, une machine ne laissant rien à désirer. En supposant que l'inventeur ait eu cette puissance créatrice supérieure, qui sait triompher des plus grands obstacles, il n'aurait pu avoir l'art de travailler les métaux, de les forger, de les tourner, de les limer, de les approprier, par des manipulations diverses, aux usages auxquels ils sont destinés, ce que la pratique seule peut donner. Cugnot ne pouvait donc construire qu'une voiture imparfaite.
(p. 223) Trente ans se passent, et c'est seulement en 1801 que Trewithick et Vivian reprennent la question de la locomotion sur les routes.
La voiture pour l'invention de laquelle ces constructeurs ont pris un brevet, était un tricycle comme celle de Cugnot. Entre les roues de derrière, de grand diamètre, se trouvait le foyer entouré d'eau de tous côtés. La vapeur agissait dans un long cylindre, dont le piston mettait en mouvement un système de bielles, de manivelles et de roues dentées, reliées à l'essieu d'arrière. Un volant, monté sur l'arbre de la première roue dentée, aidait à surmonter les obstacles du chemin; un frein, appuyé contre la jante de ce volant, servait à ralentir la marche du véhicule aux descentes rapides.
La roue d'avant était montée sur une fourche à laquelle s'attachait un levier faisant fonction de gouvernail.
La caisse, destinée à contenir les voyageurs, était placée entre les deux roues d'arrière, au-dessus du mécanisme.
Mais cette voiture n'était appelée, comme celle de Cugnot, qu'à marquer une nouvelle étape dans la voie qui devait conduire à l'invention des locomotives. On ne put en tirer parti; il fallut l'abandonner. Les constructeurs trouvèrent plus commode de triompher des difficultés du problème en les négligeant et de surmonter les aspérités des routes en plaçant leurs nouveaux véhicules sur une voie ferrée, unie et résistante.
(p. 224) On alla presque jusqu'à déclarer le problème impossible, et c'est avec un étonnement toujours nouveau que nous relisons ces lignes par lesquelles M. Perdonnet, qui a si puissamment aidé aux progrès des voies ferrées, termine son Traité des Chemins de fer:
«Il faudrait, pour qu'on pût se servir avec quelque avantage des locomotives sur les routes ordinaires: 1o que le tracé en remplît à peu près les mêmes conditions que celui des chemins de fer, ce qui en rendrait l'établissement excessivement coûteux; 2o qu'on les maintînt dans un état d'entretien tel, que la surface en restât presque aussi unie que celle d'un chemin de fer, ce qui serait aussi fort dispendieux, si ce n'était absolument impossible.
«Aussi a-t-on définitivement, en Angleterre comme en France, abandonné les essais tentés dans le but d'employer les locomotives sur les routes ordinaires.»
Il est incontestable que si les locomotives routières ne pouvaient exister qu'aux conditions posées par M. Perdonnet, on ne devrait pas prétendre les voir jamais autre chose qu'un objet de curiosité; mais rien n'implique que le problème de la locomotion routière ne puisse recevoir une autre solution que celui de la locomotive sur voie ferrée, et nous croyons qu'il faut bien se garder de poser des barrières aux conquêtes du génie industriel: ce qui est impossible aujourd'hui peut être reconnu possible demain.
Il y a des problèmes qui s'imposent naturellement et dont la solution, pour être tardive, ne demeure pas moins certaine. Le réseau des grandes voies ferrées, dites de premier ordre, est achevé en France et dans les pays avancés du centre de l'Europe; celui des chemins de second ordre est également terminé ou sur le point de l'être; enfin, on a déjà mis la main d'une manière très-active à l'exécution des lignes du troisième réseau. On sait les facilités que la loi a créées pour la construction de ces nouvelles lignes, destinées à répondre plus spécialement aux besoins intercommunaux du pays.
Il reste encore à satisfaire aux besoins locaux, aux besoins de l'agriculture et de l'industrie, aux parcours à petite distance; il reste à utiliser, de la manière la plus profitable, un réseau de voies de communication empierrées, que les voies ferrées ont remplacées sur certains points et qui sont appelées désormais à devenir leurs auxiliaires.
Tel est le problème que les locomotives routières doivent servir à résoudre.
Les transports ne s'opéreront jamais, on ne peut y prétendre, à des prix aussi bas que ceux en vigueur sur les chemins de fer, mais il est permis d'espérer des prix inférieurs à ceux du roulage, attendu que si l'on découvrait un moteur nouveau applicable aux routes et préférable aux locomotives, ce moteur serait immédiatement (p. 226) placé sur des rails et rendrait aux chemins de fer la supériorité qui leur est propre.
Au moment où l'on commençait les travaux de fondation du palais de l'Industrie, au Champ de Mars, en novembre 1865, une machine routière sortit des ateliers de M. Lotz, constructeur à Nantes, et vint à Paris.
Voici comment elle était construite:
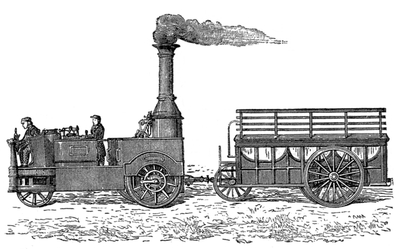
Fig. 51.—Locomotive routière Lotz remorqueuse.
La machine présentait trois parties distinctes: 1o la chaudière avec son foyer et sa cheminée; 2o le mécanisme moteur; 3o le train destiné à porter l'ensemble.
1o La chaudière était tubulaire comme celle des locomotives, le tirage était produit par le jet de vapeur dans la cheminée.
2o Le mécanisme moteur se composait essentiellement (p. 227) de deux cylindres placés à la partie supérieure de la chaudière, comme dans les locomobiles, et agissant sur un arbre transversal portant les excentriques de distribution, le volant et enfin un pignon denté qui transmettait le mouvement à la roue de droite au moyen d'une chaîne de Gall. Contrairement à ce qui a lieu dans les locomotives, les roues étaient mobiles sur les essieux, condition indispensable pour que la machine puisse tourner. Une des roues pouvait être rendue solidaire de son essieu au moyen d'un mécanisme spécial.
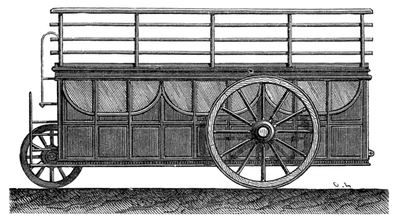
Fig. 52.—Wagon à voyageurs pour train routier.
3o À l'avant de la machine, sur la partie antérieure du train qui forme la charpente de l'édifice locomoteur, se trouvait le gouvernail. Il consistait en une paire de petites roues (0m,50 environ de diamètre), indépendantes sur un petit essieu relié au véhicule au moyen d'une cheville ouvrière. L'ensemble de ces deux roues était gouverné par un pilote à l'aide d'un (p. 228) système de pignon et de vis sans fin, et servait à diriger le véhicule.
Telle était la première machine routière de M. Lotz.
Un wagon-omnibus à impériale s'attelait à la suite et recevait les voyageurs. Nous avons assisté à un voyage d'essai de cette locomotive.
Le train, composé de la machine et de son wagon, partit du pont de l'Alma et alla bravement franchir la montée du Trocadéro, en rampe de 0m,04 environ par mètre. Il se dirigea vers la gare de Passy, s'arrêta au puits artésien de l'Arc de l'Étoile et redescendit par l'avenue des Champs-Élysées. Là, quelques chevaux, d'une nature trop nerveuse, s'effrayèrent au bruit de la machine, mais le plus grand nombre accueillirent en ami leur nouveau camarade, l'Avenir.
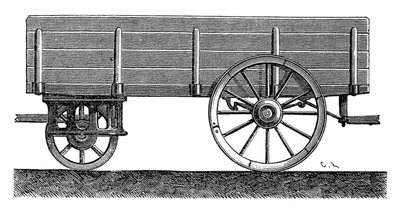
Fig. 53.—Wagon à marchandises pour train routier.
Comme on le voit, il y a loin déjà de ce véhicule au fardier de Cugnot et à la voiture de Trewithick et Vivian. Si le temps écoulé n'a pas produit d'œuvre nouvelle, (p. 229) il a du moins servi à la préparation des perfectionnements qui vont suivre.
La machine l'Avenir avait encore de nombreux défauts: elle était trop lourde, faisait trop de bruit, projetait de petits débris de charbons incandescents, tournait plus volontiers à gauche qu'à droite, etc., mais on ne pouvait plus dire que les locomotives routières étaient impossibles, et le gouvernement, convaincu des services qu'elles pouvaient rendre, prenait, le 20 avril 1866, un Arrêté concernant la circulation des locomotives sur les routes ordinaires.
Les locomotives routières eurent à peine vu le jour, qu'on reconnut la nécessité de créer des types, ainsi qu'on a fait pour les locomotives. M. Lotz a trois types de machines:
1o La locomotive routière remorqueuse;
2o La locomotive routière mixte porteuse;
3o La locomotive routière à voyageurs.
La première peut marcher à des vitesses variables de 4 à 8 kilomètres, en charge, et de 8 à 12 kilomètres, à vide.
La seconde peut prendre les mêmes vitesses. Ses dispositions ne diffèrent de celles de la précédente qu'en ce qu'elle peut recevoir directement une charge variable de 3,000 à 6,000 kilogrammes.
Enfin, la dernière est, à proprement parler, la voiture à vapeur, et porte les voyageurs en même temps que le moteur. Sa vitesse est variable, suivant les conditions, de 10 à 20 kilomètres.

Fig. 54.—Locomotive routière à voyageurs.
En trois ou quatre ans, MM. Lotz ont considérablement (p. 230) modifié leur système primitif de locomotive routière. Ils ont remplacé la chaudière horizontale par une chaudière verticale et les deux cylindres à vapeur par un seul. Ils ont ainsi reporté la plus grande partie de la charge sur les roues motrices et laissé au mécanicien une plate-forme étendue par laquelle il communique aisément avec le pilote, ce qui, dans la première machine, était presque impossible. Trois pignons, de diamètres variables, peuvent donner trois vitesses différentes; un volant régularise la marche de la machine. Ces dispositions permettent de triompher (p. 231) des inégalités du chemin et des obstacles accidentels et de gravir les parties en rampe.
Indépendamment de la pompe et de l'appareil Giffard, qui assurent l'alimentation, une pompe à eau spéciale peut être mise en mouvement par le cylindre moteur, la machine étant en repos, et servir à son approvisionnement en un point quelconque de sa route. Au départ ou à l'arrivée, la force de la machine peut, de même, être appliquée à la manœuvre de grues ou d'appareils de chargement, et, en cas de chômage des transports, à la mise en mouvement d'un atelier mécanique ou de machines agricoles.
Il est très-remarquable assurément qu'à peine la locomotive routière construite, alors qu'elle ne satisfait encore qu'incomplétement aux données du problème qu'elle est appelée à résoudre, on cherche à en faire un instrument aussi souple que le cheval, dont la force se prête à des usages si divers. Le moyen est à coup sûr excellent pour lutter contre les préjugés que rencontre toujours une machine nouvelle. Mais ne vaudrait-il pas mieux chercher tout d'abord la locomotive routière parfaite, ce qui doit être le desideratum des constructeurs, pour l'approprier ensuite aux exigences nouvelles et spéciales auxquelles il conviendra de la soumettre.
Nous ne nous arrêterons pas aux détails, et nous ne dirons rien des roues, des freins, des leviers de sûreté ou de reculement placés à l'arrière de la machine et destinés à arrêter le mouvement de recul de celle-ci, s'il venait à se produire par suite de la rupture d'un de (p. 232) ses organes ou de la négligence de ceux qui la dirigent, alors qu'elle gravit une rampe.
Nous mentionnerons seulement la substitution qui a été faite d'une roue unique directrice au système des deux roues de la première locomotive. Cette roue est plus solidement fixée au bâti de la machine, sa manœuvre est plus facile et les tournants ou les coudes sont franchis aisément.
Telles sont les dispositions principales des machines routières remorqueuses de M. Lotz.
Disons ce qu'elles coûtent:
Tandis que le prix des premières varie de 11,000 à 19,000 francs, celui des dernières n'est que de 4,000 à 5,000 francs.
La comparaison des frais de transport par locomotive routière et par chevaux s'établit aisément. Voici les chiffres fournis par MM. Lotz, en supposant un transport journalier de 50 kilomètres par locomotive routière et de 30 kilomètres par chevaux (ce qu'il est possible de faire sans relai).
MATÉRIEL DE TRACTION.
| Une locomotive routière avec tous ses accessoires | 15,000 | fr. | » | |
| Quatre voitures ou wagons, à 1200 fr. l'un | 4,800 | 4,800 | fr. | |
| Installations diverses | 500 | » | ||
| Seize chevaux, à 700 fr. l'un | » | 11,200 | ||
| Seize harnais et accessoires | » | 2,800 | ||
| ——— | ——— | |||
| Total du prix du matériel | 20,300 | fr. | 18,800 | fr. |
(p. 233) Le prix de premier établissement de la locomotion mécanique est plus élevé que celui de la locomotion animale, mais l'économie ressort de la comparaison des frais annuels: il faut nourrir les chevaux tous les jours et à peu près aussi confortablement les jours de repos que les jours de travail, tandis qu'il n'y a rien à dépenser pour la locomotive lorsqu'elle est sous la remise. Elle ne coûte donc que lorsqu'elle marche.
Voici les chiffres:
FRAIS ANNUELS.
| 25 p. 100 amortissement et entretien du matériel. | 5,075 | fr. | 4,700 | fr. |
| 6 p. 100 intérêt du capital. | 1,218 | 1,128 | ||
| Un mécanicien à l'année. | 1,800 | fr. | » | |
| Un conducteur et un chef de train serre-frein. | 2,500 | fr. | » | |
| Nourriture de 16 chevaux, à 1000 fr. l'un. | » | fr. | 16,000 | |
| Quatre charretiers à 1200 fr. l'un. | » | fr. | 4,800 | |
| ——— | ——— | |||
| Total des frais annuels. | 10,593 | fr. | 26,628 | fr. |
Pour la traction à vapeur, il faut ajouter par jour de marche:
| 500 kilogr. de charbon à 36 fr. | 18 | fr. |
| Huile, suif, coton, etc. | 5 | |
| —— | ||
| Total | 23 | fr. |
Les données qui précèdent conduisent aux chiffres suivants:
(p. 234)| NOMBRE DE JOURS DE SERVICE PENDANT L'ANNÉE. | À VAPEUR. | PAR CHEVAUX. | ||
| 20 tonnes, 50 kilomètres. | 20 tonnes, 30 kilom. | |||
| Par jour. | Par tonne et par kilom. | Par jour. | Par tonne et par kilom. | |
| 150 jours, soit 3000 t. | 70f,62 + 23f = 93f,62 | 0f,094 | 177f,52 | 0f,295 |
| 250 jours, soit 5000 t. | 42f,37 + 23f = 65f,37 | 0f,065 | 106f,51 | 0f,177 |
Il résulte de ce tableau que pour un service de 150 jours (5 mois) seulement par an, et pour un transport de 20 tonnes par jour, ce qui correspond au chargement de 2 à 3 de nos wagons de chemins de fer, le prix de revient de la traction à vapeur est plus de trois fois moindre que celui de la traction par chevaux.
Pour un travail de 250 jours, le prix est encore près de trois fois moins élevé.
Les Anglais ne se sont pas laissés devancer par nous dans la construction des locomotives routières; l'usage de ces machines est aujourd'hui beaucoup plus répandu en Angleterre qu'il ne l'est en France: le charbon, chez nos voisins, remplace les pâturages et le métal se trouve à meilleur compte que les bêtes de traction.
MM. Aveling et Porter, de Rochester (Kent), se sont spécialement occupés de la construction des machines routières et des appareils de culture à vapeur.
Leur machine diffère notablement de celle de M. Lotz, et nous devons en donner la description. Ce n'est plus un tricycle, mais une voiture à cinq roues. La chaudière n'est plus verticale, elle est horizontale et porte à la fois sur les roues motrices placées à l'arrière (p. 235) et sur l'avant-train. Un double système d'engrenages lui permet de marcher à deux vitesses différentes: 3 à 4 kilomètres à l'heure en charge et 5 à 6 kilomètres à l'heure à vide. Elle n'a qu'un seul cylindre comme celle du constructeur français, mais il est horizontal et se trouve placé à l'avant de la chaudière. Les roues motrices ont 1m,974 de diamètre et 0m,457 de largeur de jante. On a ménagé sur ces dernières des trous pour y placer au besoin des chevilles-crampons qui aident à passer sur les terrains mous. Les mouvements de rotation des deux roues motrices sont indépendants, ce qui facilite le passage des tournants très-courts. Un frein puissant se trouve sous la main du mécanicien et un pilote, placé sur l'avant-train formant tricycle, tient la tige directrice à l'aide de laquelle il oriente le disque d'avant. Celui-ci ne porte sur le sol que par son poids, et sa manœuvre est à ce point facile qu'un enfant peut en être chargé.
D'après MM. Aveling et Porter, l'économie résultant de l'emploi de leur machine est de près des deux tiers de la dépense de la traction par chevaux, tout en admettant 30 pour 100 par an, pour intérêt, amortissement et entretien du matériel.
Nous venons de faire connaître sommairement deux des principales locomotives routières, l'une française, l'autre anglaise, qui ont été l'objet des expériences les plus sérieuses de la part des ingénieurs des deux pays et qui ont fourni les meilleurs résultats. Un grand nombre d'autres constructeurs ont exposé, en 1867 et dans les concours de ces dernières années, des machines (p. 236) de leur fabrication, qui se rapprochent plus ou moins de celles que nous avons décrites. Ce sont M. Pilter, MM. Glayson, Shuttleworth et Cie, M. Ransomes, M. Underhill et MM. Albaret et Calla. Nous ne nous y arrêterons donc pas.
Mais nous ne devons pas passer sous silence la machine de M. Larmanjat, en raison des particularités qu'elle présente et qui consistent essentiellement dans un système de leviers, à l'aide duquel on peut faire porter à volonté le véhicule sur les roues du premier ou sur les roues du second essieu, de différents diamètres. Les roues qui ne sont pas en prise à un moment donné fonctionnent comme volants. Il résulte de cette ingénieuse disposition que lorsqu'on est en palier, on utilise les roues de grand diamètre et on marche à la vitesse de 16 à 18 kilomètres à l'heure. Lorsqu'au contraire on gravit une rampe ou un passage difficile, on emploie les petites roues et on marche avec une vitesse de 7 à 8 kilomètres seulement. Mais, on le conçoit, cette disposition n'est applicable qu'à une machine de faible poids, remorquant, par conséquent, de faibles charges. On ne peut donc l'utiliser que dans la construction des locomotives routières, destinées au transport des voyageurs.
Un autre constructeur, M. Victor Feugères, a imaginé une locomotive routière, dite: moteur-porteur, qui diffère essentiellement des précédentes par les principes qui ont présidé à sa conception. D'après cet inventeur, l'adhérence doit toujours être en rapport avec la charge à remorquer, eu égard aux rampes à (p. 237) franchir; la vitesse de la machine doit être en raison inverse de cette charge et le mouvement doit être donné aux roues de l'avant-train et non à celles de l'arrière-train.
M. Fougères compose un avant-train suspendu sur ressorts et porté sur deux roues motrices à action solidaire, ou indépendante à volonté, qui reçoivent le mouvement de quatre cylindres, groupés deux à deux, disposés à effet contraire et actionnant deux arbres contigus, à mouvements indépendants. Selon la vitesse à laquelle on veut marcher, la transmission est directe, ou s'opère au moyen d'une chaîne. Signalons enfin la chaudière, qui est verticale et à système inexplosible, avec retour de flamme et, comme détail intéressant, les barres à crémaillères que le conducteur tient de son siége et manie comme le cocher d'une voiture ordinaire, selon qu'il veut avancer, s'arrêter, reculer ou tourner.
Cette machine est certainement l'une des plus intéressantes de celles qui ont été produites pour résoudre l'intéressant problème de la locomotion routière. Et si elle ne triomphe pas de toutes les difficultés qu'il présente, elle met au jour des idées nouvelles, dont la pratique ne peut manquer de tirer bientôt un parti avantageux.
Nous avons fait connaître bien sommairement les principales machines routières aujourd'hui employées (p. 238) et décrit rapidement les organes dont ces machines se composent. Il nous reste à indiquer maintenant les principaux usages auxquels elles ont été jusqu'ici appliquées et ceux auxquels elles conviennent le mieux, puis à faire connaître les causes qui arrêtent, en ce moment, leur perfectionnement et s'opposent à leur prompte adoption par l'industrie.
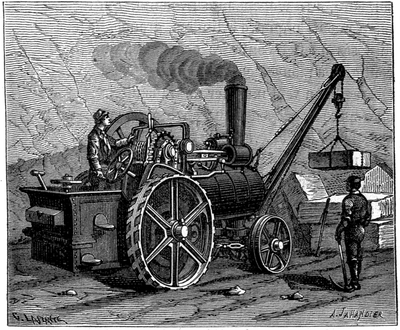
Fig. 55.—Machine routière avec grue.
En général, les lourds transports à de longues distances sont ceux qui conviennent le mieux aux locomotives routières. Aussi les a-t-on employées avec succès au remorquage des bateaux sur les canaux. Des machines (p. 239) ont circulé ainsi le long des canaux qui réunissent Saint-Omer et Caen à la mer et ont fait un excellent service.
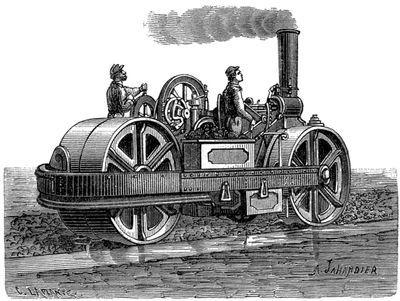
Fig. 56.—Rouleaux-compresseurs.
Les briqueteries, les sucreries, les papeteries et généralement les industries qui mettent en œuvre ou produisent une grande quantité de matières lourdes, ont intérêt à se servir de ces machines, qu'elles utilisent fréquemment, au départ ou à l'arrivée, pour le chargement ou le déchargement des matières transportées. Les mines, les houillères peuvent encore, dans certaines circonstances particulières, utiliser ces précieux engins. En Angleterre, en Irlande, les machines routières sont employées avec avantage pour les travaux d'empierrement de routes. La machine prend dans la carrière les (p. 240) matériaux qu'elle va répandre aux points voulus et dont elle règle ensuite la surface par son passage. Les roues sont alors de larges cylindres compresseurs, placés deux à l'avant, deux à l'arrière du véhicule, et suivant des frayées différentes.
Les locomotives routières ont été appliquées à l'enlèvement des vidanges. La même force, qui enlève les matières de la fosse et les fait monter dans les tonneaux, est employée à remorquer ceux-ci et à les conduire en rase campagne. La désinfection est même rendue inutile par un procédé ingénieux de combustion des gaz méphitiques. L'économie considérable et les avantages de ce système contribueront, il faut l'espérer, à le répandre.
Malheureusement, les vieilles habitudes ont de telles racines qu'on ne peut les détruire qu'avec le temps et à force de persévérance. Aussi, les transports agricoles s'exécuteront-ils pendant longtemps encore par bêtes de trait. Dans la ferme, en effet, on ne peut se refuser à en convenir, le matériel existe et on ne peut atteler une locomotive routière à une charrette, comme on fait d'un cheval, d'un âne ou d'un mulet que l'on tient à l'écurie, pour lequel on a toujours un peu de fourrage, et qui, en échange, donne un fumier précieux. Tout petit agriculteur a, au moins, l'un de ces animaux à son service, mais une locomotive routière ne peut convenir qu'à une grande exploitation, qui a de vastes champs à labourer, d'importants transports, des travaux de battage ou d'une autre nature à opérer. Aussi, croyons-nous que la locomotive routière ne viendra sérieusement (p. 241) en aide à la petite culture que le jour où, dans les campagnes, circuleront des entrepreneurs qui loueront leur matériel pour un temps ou pour un travail déterminé, comme ils louent déjà des machines à battre, des pressoirs ou des appareils de distillation portatifs durant le temps nécessaire à chacune de ces opérations.
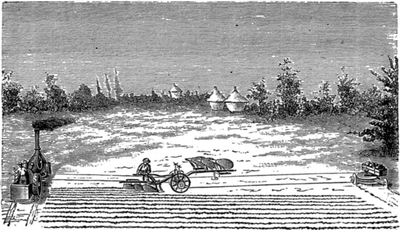
Fig. 57.—Labourage à vapeur.
Ainsi donc, en admettant la locomotive routière actuelle parfaite, nous voyons combien d'obstacles il lui faudrait vaincre pour l'emporter sur les moteurs animés, utilisés en agriculture et en industrie. Mais, combien elle est loin de la perfection et que de difficultés encore à surmonter par le constructeur! Nous en ferons connaître quelques-unes pour appeler l'attention sur certains faits pleins d'importance, évidemment trop négligés.
Les locomotives routières sont destinées à remplacer (p. 242) le cheval et les autres bêtes de trait que nous connaissons, c'est-à-dire une grande variété d'animaux, présentant chacun des races aux aptitudes diverses, capables de prendre les uns une allure rapide, en remorquant une charge légère, les autres une marche lente en traînant une grosse charge, ceux-ci ne pouvant marcher que sur une route en bon état, ceux-là habitués aux traverses et aux mauvais chemins, enfin quelques-uns ne pouvant travailler que peu d'heures par jour, d'autres capables, au contraire, de fournir un long travail. Et pour remplacer tous ces animaux, qu'offre-t-on? Le plus souvent, une seule et même machine, munie parfois d'engrenages qui permettent l'emploi de deux ou trois vitesses différentes et de roues dont la jante a une largeur constante et peut être garnie de nervures destinées à faciliter la prise avec le sol. Quelques constructeurs présentent différents types de machines. Tous compliquent le problème en cherchant à construire une machine capable de servir à d'autres usages qu'à la traction proprement dite, et mettent souvent la locomotive de leur fabrication hors d'état de répondre d'une manière satisfaisante à la principale des fonctions qu'elle doit remplir.
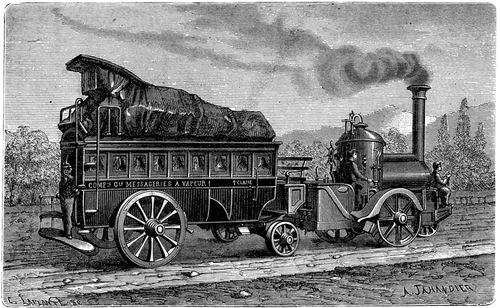
Fig. 58.—Les messageries à vapeur.
Simplifier c'est résoudre. Que l'on considère, en effet, les progrès accomplis dans la construction des machines à vapeur, ou mieux encore, dans celle des locomotives, et l'on reconnaîtra que c'est du jour où l'on a créé des types de machines pour telle ou telle nature de transport, sur une voie au profil plat ou accidenté, au tracé rectiligne ou tourmenté, qu'on a perfectionné les (p. 245) machines primitivement employées. Et combien le problème des locomotives routières est-il plus difficile à résoudre que celui des locomotives des voies ferrées, quelle complication résulte de la substitution de la route rugueuse et accidentée à la voie unie des chemins de fer! Aussi, tandis que les types de locomotives sont plus nombreux, doit-on considérer comme très-considérable le nombre des types de locomotives routières?
D'où il suit que l'on ne doit attendre de perfectionnements, dans la construction de ces nouvelles machines, que des compagnies assez puissantes pour entreprendre ces essais multipliés et coûteux qu'une persévérance soutenue fait presque toujours aboutir.
Que des compagnies, comme les Messageries à vapeur, poursuivent la création du type de locomotives routières propres au transport des voyageurs; que la compagnie des Omnibus recherche le type tout particulier de locomotive routière capable de s'accommoder à la circulation des grandes villes, que des compagnies de transport encore à créer perfectionnent le type de la locomotive routière à marchandises, et, dans quelques années, la question sera résolue; mais il n'est pas possible que des industriels risquent des ressources souvent très-limitées dans des essais dont la durée est illimitée.
Voilà, croyons-nous, de quelle manière il faut espérer voir des améliorations sérieuses se produire. Passant de cette considération générale aux questions de détail, qu'il nous soit permis d'appeler l'attention sur certaines dispositions adoptées d'ordinaire par les constructeurs (p. 246) et qui nous semblent tout au moins défavorables.
L'une des plus grandes difficultés de la construction des locomotives routières consiste dans l'établissement des deux mécanismes directeur et propulseur. Sur les locomotives des voies ferrées, ce dernier seul existe, l'action des rails sur les boudins des roues remplaçant le premier. Les moteurs animés, attelés à une voiture, en dirigent la marche en même temps qu'ils en produisent le mouvement. Il y a, de la part des moteurs, simultanéité des deux actions directrice et propulsive. Pourquoi toutes les locomotives routières, à part celle de M. Feugères, ne satisfont-elles pas à cette condition et comment prétend-on obtenir une action efficace d'un système de roues si légèrement chargées que la main du mécanicien seule suffit à le déplacer? Pourquoi ne pas chercher à commander ces deux roues du train d'avant comme un cocher commande ses chevaux, en leur imprimant à volonté des vitesses variables; et pourquoi ne pas faire des roues d'arrière, jusqu'ici motrices, de simples roues porteuses, comme celles des véhicules ordinaires? Nous posons une question, et nous ne la résolvons pas, mais nous croyons qu'avant d'abandonner un système généralement suivi, il faut voir s'il ne satisfait pas mieux que toute conception nouvelle au problème qu'on s'est posé, sauf à y renoncer définitivement si la pratique le démontre inacceptable.
Ce qui rend si difficile la solution cherchée, est un fait que peu de personnes ont remarqué, la différence (p. 247) des nombres de tours effectués par les quatre roues du véhicule, d'où résulte la nécessité d'une indépendance complète des organes transmettant le mouvement et l'accroissement du nombre de ces organes. Ces quatre roues, faisant des nombres de tours différents, marchent avec des vitesses différentes, qu'elles reçoivent d'organes animés des mêmes vitesses, concourant tous à produire comme résultat unique: la progression du véhicule suivant une ligne variable à chaque instant, en raison des obstacles rencontrés.
Que l'on ajoute à cette première difficulté toutes les autres, moins graves à la vérité, de changement de vitesse suivant le profil du chemin ou l'état de sa surface, de maintien du niveau de l'eau dans la chaudière sur une pente quelconque, d'alimentation de la machine, d'arrêt rapide de celle-ci et du train qu'elle remorque, au moment de la rupture subite d'une des pièces du mécanisme, de bruit produit par le tirage dû au jet de vapeur, d'échappement des escarbilles par la cheminée, et on se fera une idée des efforts que doivent encore faire nos constructeurs pour perfectionner la machine routière.
Et encore, quelle masse énorme à remuer pour faire avancer un train relativement peu chargé! Quelle quantité de métal, de charbon et d'eau pour produire l'effet nécessaire! L'esprit admet avec peine que la production de la puissance exige l'accumulation et l'association de si grandes quantités de matières.
Instrument raide
En fer battu,
Qui dépossède
Le char tortu;
Vélocipède,
Rail impromptu,
Fils d'Archimède,
D'où nous viens-tu?
Nous ne pouvons terminer ce petit livre sans dire quelques mots des véloces en général, qui ont été l'objet d'un si grand engouement, pour lesquels on a monté des ateliers considérables, engagé des sommes folles, comme s'il s'agissait d'un véhicule capable de modifier profondément, ou de remplacer, l'un de ceux dont nous nous servons depuis longtemps.
Un écrivain, qui s'appelle le Grand Jacques et dont la plume célèbre les prouesses du vélocipède, écrit:
«Le vélocipède est un des signes du temps.
«Après le coche, la diligence;—après la diligence, le chemin de fer;—après le chemin de fer, le vélocipède....»
(p. 249) Si cette phrase n'était qu'un simple énoncé chronologique, nous n'aurions rien à dire, mais elle vise plus haut. Elle indique plus qu'un perfectionnement dans l'art de la carrosserie, elle annonce un progrès dans la science des moyens de transport.
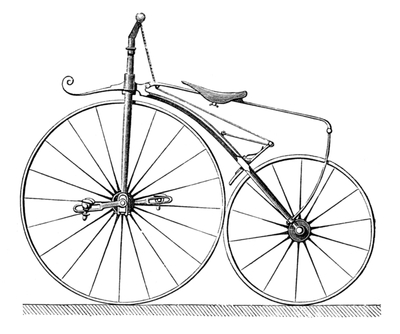
Fig. 59.—Vélocipède Michaux.
Notre avis est qu'il ne faut pas attribuer à ces légers appareils une vertu si grande. On ne pourra nous contester qu'un véhicule est d'autant plus parfait qu'il réclame pour se mouvoir une arène ou une voie moins parfaite. Or, la condition première d'emploi du vélocipède et des véloces, en général, est l'existence d'une route bitumée ou macadamisée en bon état. Le pavé, qui convient si bien aux voitures, cause une (p. 250) fatigue insupportable aux vélocemen par les cahots incessants qu'il produit. Les ornières rendent la marche impossible. Quelle est la cause de l'infériorité des locomotives? C'est qu'on n'a réussi, jusqu'à présent, à les employer avantageusement que dans les pays plats ou peu accidentés. Quelle est la cause de l'infériorité des locomotives routières? C'est, entre autres choses, qu'elles exigent une voie solide et durcie pour se mouvoir dans de bonnes conditions.
Nous avons commencé par faire le procès du vélocipède, disons maintenant ce qu'il a de bon.
Chacun sait qu'il est plus facile de rouler un fardeau que de le porter sur ses épaules. L'homme est à lui-même son propre fardeau. S'il marche, il se porte; s'il est monté sur un véloce, il se roule.
L'homme pèse, en moyenne, de 65 à 70 kilogrammes et marche avec une vitesse de 1m,50 par seconde. Il développe donc un travail de 100 kilogrammètres environ. (Nous avons dit précédemment le sens de ce mot.) Si l'homme pouvait se rouler sans aucun intermédiaire, l'effort de traction qu'il aurait à fournir sur une route ordinaire, en bon état, serait le 1/30 de son poids, ou 2kil,14 à 2kil,31, et le travail correspondant, en admettant la même vitesse de 1m,50 par seconde, varierait de 3kgm,21 à 3kgm,46.
Mais il faut tenir compte du travail absorbé par le vélocipède lui-même. Nous l'évaluerons à 2 kilogrammètres, la vitesse étant de 1m,50, ou à 8 kilogrammètres, la vitesse étant de 6 mètres par seconde, vitesse normale du vélocipède.
(p. 251) Dans cette nouvelle hypothèse, le travail que doit développer le voyageur pour son propre déplacement, la vitesse étant quadruplée, devient 12kgm,84 à 13kgm,84.
Ces chiffres ajoutés aux 8 kilogrammètres, travail du vélocipède, donnent: 20kgm,84 à 21kgm,84.
Rapprochant ces chiffres du premier que nous avons posé: 100 kilogrammètres, travail de l'homme en marche; nous voyons que le vélocipède bicycle a pour effet de réduire le travail dans le rapport de 20 à 100 ou de 1 à 5, en quadruplant l'effet produit, c'est-à-dire la vitesse obtenue.
On admet dans tout ce qui précède un terrain horizontal et en bon état. Si la route présente des montées ou des accidents, l'avantage du vélocipède disparaît promptement. Par contre, il est vrai, le véhicule devient automoteur aux descentes et le voyageur se laisse entraîner sans fatigue.
Nous bornerons à ces quelques lignes la théorie du vélocipède, ajoutant seulement que, lorsque du bicycle on passe au tricycle, on perd en force dépensée ce que l'on gagne en stabilité.
À quelle époque remonte l'invention du vélocipède?
Nous n'irons pas, comme on l'a fait, fouiller les monuments égyptiens ou passer en revue les fresques des villes enfouies sous la lave, à la recherche des génies ailés ou des amours à cheval sur un bâton monté sur des roues. Autant vaudrait parler de la Fortune, qui, plus adroite que nos vélocemen modernes, a résolu depuis longtemps le problème tant cherché du monocycle.
(p. 252) Il nous suffira de dire que le vélocipède est le perfectionnement du célérifère, construit pour la première fois en 1818. Le célérifère consiste en un bloc de bois de forme allongée, monté sur deux roues en flèche, d'assez faible diamètre pour que le cavalier puisse avoir ses pieds sur le sol. Celui-ci enfourche sa monture de bois et, poussant à droite, poussant à gauche, il s'avance à grandes enjambées ou à grands tours de roue.
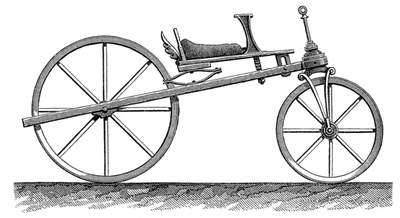
Fig. 60.—Célérifère de 1818.
Le tricycle est beaucoup plus ancien que le vélocipède. Depuis bien des années, on voit des amateurs de promenade, désireux de faire l'économie d'un cheval, parcourir les abords des grandes villes sur ces légères voitures, formées essentiellement d'un essieu doublement coudé, mis en mouvement par les pieds ou par les mains, et d'une roue dont le plan, mobile à volonté, forme l'avant-train. Ce n'est pas autre chose que la voiture dont se servent les invalides ou les paralytiques (p. 253) et qu'ils actionnent à la main au moyen de deux leviers.
On nous a raconté qu'un jour un de ces tricycles fut apporté à la maison Michaux, moins connue alors qu'elle ne l'était il y a quelques années, pour y être réparé. Le fils de la maison joue avec l'appareil. Au lieu de trois roues, il n'en met que deux, et il actionne la roue d'avant avec les pieds. Il essaye, il se lance, il tombe. Il se lance encore, sa course devient plus sûre. Chaque chute excite son courage. Le véhicule n'a plus que deux roues. L'homme court sur cet appareil, qui ne peut se tenir droit au repos, et le vélocipède est inventé. La maison Michaux se fonde, puis donne naissance à la Compagnie parisienne. Des vélocipèdes se fabriquent et s'expédient de tous côtés. Des machines sont inventées pour les fabriquer plus promptement et d'une manière plus parfaite. Aussi, ce qui existe aujourd'hui de véloces suffira-t-il à tous les besoins pour de longues années et cette industrie est-elle en ce moment dans le marasme!
La vitesse que l'homme peut atteindre, monté sur un vélocipède, est la cause de l'enthousiasme dont on s'est pris pour ce nouveau moyen de transport. Cette vitesse varie, on le comprend, avec la force du véloceman, avec la nature et l'inclinaison de la voie parcourue, et selon la plus ou moins bonne construction de l'appareil. Le club Bernois évalue à 10 kilomètres la vitesse à l'heure des vélocemen sur les routes qui entourent Berne. À Paris, sur les bonnes promenades, dit le Vélocipède illustré, la vitesse normale (p. 254) est de 15 kilomètres. Dans une grande quantité de courses et sur des pistes accidentées, les vélocipédistes exercés parcourent 1 kilomètre en 2 minutes, soit 30 kilomètres à l'heure. Et sur une piste asphaltée, d'un niveau parfait, la vitesse peut atteindre 40 kilomètres.
Ces derniers chiffres constituent, en réalité, des exceptions. Car 30 kilomètres à l'heure pour un vélocipède à roue motrice d'un mètre de diamètre représentent près de 10,000 tours de pédales: 3 tours environ par seconde! On conçoit qu'il faut un jarret doué d'une vigueur exceptionnelle pour fournir pendant un certain temps un semblable travail.
De longs voyages ont été entrepris sur des vélocipèdes. On cite, entre autres, celui de deux vélocipédistes qui ont accompli en six jours une course de 150 lieues: la distance de Paris à Bordeaux; ce qui donne une vitesse moyenne de 25 lieues, ou 100 kilomètres par jour.
On trouve encore dans les annales de la vélocipédie qu'une course de 250 kilomètres a été faite en vingt heures consécutives, y compris le temps du repos. C'est 500 mètres par minute ou 12kil,5 à l'heure.
Mais ces tours de force, si remarquables qu'ils soient d'ailleurs, au double point de vue de la vitesse obtenue et de la durée de la course, ne doivent être considérés que comme des faits exceptionnels, dus à des circonstances spéciales, et, en premier lieu, à l'excellence du véloceman.
Nous ne saurions trop le répéter: le véloce, d'une (p. 255) manière générale, ne deviendra un véhicule réellement pratique que le jour où il n'exigera plus des voies parfaites. Alors, le facteur rural s'en servira pour faire ses tournées quotidiennes; plusieurs facteurs s'en servent dès à présent d'une manière régulière; des percepteurs, des employés des contributions les ont aussi adoptés; le maraîcher, la laitière, pour porter, celui-ci ses légumes et celle-là son lait à la ville. Le véloce pourra détrôner l'âne, ce cheval du pauvre, car, si élevé que soit resté son prix d'achat, sa nourriture préoccupera moins encore que les chardons, les ronces ou l'herbe vaine qui pousse dans les fossés des chemins.
Il y a peu d'inventions aussi simples que celle du vélocipède; il y en a peu qui aient été l'objet de plus de brevets pris dans un temps plus court.
Ce que l'on a inventé de soi-disant perfectionnements qui ne sont, pour la plupart, que des complications inutiles, est inimaginable. Ces inventions ont trait les unes à la forme générale du véloce, les autres à telle ou telle de ses parties. On a cherché enfin à employer des moteurs autres que la force de l'homme: le vent, la vapeur, l'électricité. Nous dirons rapidement quelques mots des idées les plus curieuses qui se sont produites.
Mille moyens ont été proposés, chaque constructeur a le sien pour réunir les deux roues du bicycle et poser (p. 256) sur la pièce qui les assemble la selle du cavalier. La roue d'avant est généralement motrice, directrice et porteuse. Certains vélocipèdes reçoivent, au contraire, leur direction par l'arrière, tel est celui dont le dessin est donné ci-dessous. Nous ne croyons pas que cette solution soit avantageuse.

Fig. 61.—Vélocipède-raquette.
Les tricycles varient à l'infini, tantôt ils sont à une place, tantôt à deux places, mus par les pieds ou par les mains, ou par les pieds et les mains à la fois. De là des variétés innombrables.
Nous ne parlerons pas des quatricycles, nous retomberions dans la voiture ordinaire.
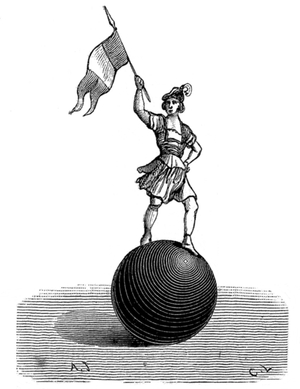
Fig. 62.—Monocycle-sphère.
Quant au monocycle, on est encore à le chercher. (p. 257) Placer le véloceman au-dessus de la roue, nous doutons que son équilibre soit bien stable. Le placer au centre, il ne nous semble pas beaucoup plus solide: la roue se trouve réduite à une jante assez facilement déformable, et la transmission de mouvement ne paraît pas devoir être simple. On dit cependant que le problème serait résolu. M. Jackson aurait fait un voyage de Paris à Versailles ou à Saint-Cloud sur un monocycle. Dans ce cas, le véloceman, placé au milieu du cercle, était porté par une circonférence concentrique à la roue, et qui frotte sur des galets. C'est en inclinant le corps, à droite ou à gauche, qu'il dirigeait l'appareil. Il n'y a là rien d'impossible, assurément, (p. 258) mais l'adresse de l'homme nous paraît merveilleuse.
Néanmoins, nous aimons la simplicité du monocycle du Vélocipède illustré: LA SPHÈRE!
Le mode d'actionnement, s'il ne donne pas toute satisfaction, est du moins tellement primitif, qu'il ne le cède à aucun autre.
Le champ reste, d'ailleurs, ouvert aux inventeurs.
Les perfectionnements des différentes parties des véloces ont été généralement plus heureux que ceux qui ont porté sur l'ensemble.
Les manivelles, ou les pédivelles (comme on devrait les nommer), ont été améliorées. Le frein, le gouvernail, la lanterne, les burettes de graissage, la selle, se font aujourd'hui avec un soin et une perfection qui seront difficilement dépassés.
La jante a été d'abord garnie d'un boudin plein, rond ou rectangulaire, en caoutchouc, servant à empêcher les chocs produits par les inégalités et les aspérités du chemin. Aujourd'hui, ce boudin est creux et contient un fil de fer dont les extrémités sont réunies au moyen d'un écrou à deux pas contraires et serrant le caoutchouc contre la jante de la roue.
Les inventeurs ont souvent cherché à simplifier le moyen de transmission du moteur à l'appareil. Ils ont proposé des pédales disposées de diverses manières, dans le but de remplacer le mouvement de rotation des pieds par un simple mouvement de va-et-vient. Aucun de ces moyens n'a réussi. Tous ont été trop compliqués et ont absorbé une telle (p. 259) fraction de la force motrice qu'il n'y avait plus avantage.
Les métaux de la meilleure fabrication et les plus légers ont été employés à la fabrication des vélocipèdes. Le fer a, de bonne heure, remplacé le bois, puis on s'est servi de l'acier. Enfin, on a employé le bronze d'aluminium. Le but que tous les constructeurs se sont proposé a été de fabriquer un appareil qui unisse la plus grande légèreté à la plus grande solidité. On a successivement diminué les dimensions des différentes parties du véhicule jusqu'au moment où elles sont devenues si faibles qu'on a dû s'arrêter, dans la crainte de ne pas les voir résister aux efforts auxquels elles peuvent être soumises.
L'un des changements les plus importants (on ne saurait dire encore si c'est un perfectionnement) consiste dans la substitution des roues métalliques à tension aux roues en bois. Chaque rais se trouve tendu par un écrou rattaché au moyeu et dont l'action se règle à volonté. Les roues, entièrement métalliques, sont garnies de caoutchouc coulé à chaud et vulcanisé sur le fer. Les roues en bois, qu'on ne peut introduire dans les chaudières à vulcaniser, sont cerclées de bandages en caoutchouc ordinaire.
Emprunter à un agent, autre que le cavalier, la force nécessaire à la mise en mouvement de l'appareil, présentait un vif intérêt. On s'est donné libre carrière et on a proposé les moyens les plus excentriques.
La vapeur tout d'abord! Et comme le véloceman aurait dû remplir ses poches de charbon, on a proposé de (p. 260) remplacer ce combustible par le pétrole, d'un transport plus facile. On a reconnu bientôt que la vapeur n'était pas plus possible que l'air comprimé, que l'air chaud. On ne peut se figurer, installé sur un de ces légers appareils, tout le lourd attirail de cylindres, de bielles, de générateurs, de pièces mécaniques qu'exige l'emploi d'un de ces agents. Autant vaudrait charger un canon sur des araignées.

Fig. 63.—Vélocipède à voile.
Nous devons dire cependant qu'un vélocipède à vapeur a fonctionné à Marseille: joujou curieux, mais nullement pratique.
(p. 261) L'électricité, que les Américains ont appliquée à la mise en mouvement des locomotives, deviendra-t-elle quelque jour le moteur des véloces? On ne peut rien affirmer, mais les résultats obtenus jusqu'à présent ne font pas entrevoir cet événement comme prochain.
Un essai a été fait dans les ateliers de la Compagnie parisienne. Le projet semblait promettre un bon résultat; mais l'appareil, construit à moitié, était déjà d'un poids inadmissible. Il a fallu y renoncer.
Le vent reste, seul moteur facilement applicable au vélocipède. Une voile légère peut être ajoutée à l'instrument, sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour le cavalier, lorsque le calme ou une direction contraire le forcent à la laisser fermée. Le Vélocipède illustré, que nous avons déjà cité plusieurs fois, rapporte qu'une vitesse de 25 kilomètres à l'heure a pu être obtenue sans fatigue, à l'aide d'une voile, sur un terrain plat; 3 kilomètres ont été parcourus sans que les pieds touchent les pédales.
C'est là, croyons-nous, un auxiliaire précieux qui pourra rendre, dans certains cas, d'utiles services.
Et l'homme désormais, suivant les hirondelles,
Pourra dire aux oiseaux: Me voici, j'ai des ailes!
Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des moyens employés par l'homme pour se mouvoir à la surface de la terre, et nous n'avons rien dit de ceux qu'il emploie pour s'élever au-dessus ou pour s'abaisser au-dessous de sa surface. Tel va être le sujet de ce chapitre, qui comprendra trois divisions.
Nous raconterons, dans un premier paragraphe, les procédés employés pour atteindre aux plus hauts points de la terre; puis, dans un second, les moyens en usage pour pénétrer dans son sein, aux plus grandes profondeurs connues et pour en rapporter les matières précieuses qui y sont cachées.
Enfin, dans une troisième division, nous décrirons le moyen de locomotion tantôt aérien, tantôt souterrain, (p. 263) tantôt sous-marin, employé dans quelques cas particuliers au transport des menus objets et, en particulier, au transport des dépêches.
Nos pères n'avaient que des moyens primitifs pour s'élever au-dessus du sol. De leur temps, il est vrai, les habitations n'avaient pas huit étages! Les maisons ressemblaient aux temples, et le grenier, qui régnait au-dessus du rez-de-chaussée, n'était pas habité. L'échelle était le seul moyen de communication. Elle est conservée dans les campagnes, où le confortable des escaliers est trop coûteux. Son invention remonte aux temps les plus reculés. Elle servait dans l'antiquité, non-seulement aux usages domestiques, mais encore à la guerre pour franchir les remparts ennemis ou pour gravir les passages difficiles. Les hommes des habitations lacustres l'employaient pour monter de leurs bateaux dans leurs demeures, comme certaines peuplades sauvages l'emploient pour atteindre leurs cases construites sur les arbres ou sur de hautes perches.
L'homme des bois a pour s'élever la liane qui pend aux branches du cocotier, le pauvre des campagnes a l'échelle; l'homme aisé, l'escalier aux marches en pente douce; le riche, l'ascenseur.
Nous ne parlons pas du plan incliné. À part quelques cas particuliers, il n'est pas employé. Nous n'en connaissons que deux exemples remarquables, celui de la Giralda de Séville, maravilla octava! et celui de la Tour de la Trinité, à Copenhague. Une rampe douce, pavée en briques, interrompue par vingt-huit paliers, conduit jusqu'à la plate-forme de la vieille tour de (p. 264) Huever, haute de 250 pieds au-dessus du Patio de los Naranjos. Deux cavaliers, marchant de front, peuvent, à cheval, arriver au sommet. Œuvre curieuse, admirable, comme toute la cathédrale qui s'étend à ses pieds, mais absolument dépourvue d'utilité.
L'église de la Trinité, à Copenhague, est flanquée de cette tour célèbre, la Tour ronde, haute de 38 mètres et demi, qui a servi d'observatoire. L'intérieur est disposé en spirale, de manière à permettre d'y monter en voiture, comme l'a fait Pierre le Grand.
Les escaliers n'ont rien de remarquable, au point de vue qui nous occupe, que leur grande hauteur. Les plus hauts monuments sont donc pour nous les plus intéressants, et au premier rang se place la cathédrale de Strasbourg. Ce monument a 142mèt.,112 de hauteur (deux mètres de moins que la plus haute pyramide d'Égypte), et l'escalier, qui se termine à la base de la flèche, compte 360 marches.
L'ascenseur vient enfin prêter son aide aux boiteux et aux paralytiques, aussi bien qu'aux gens riches. Les ascenseurs sont d'espèces variées. Tout moyen de traction mécanique appliqué à une corde ou à une chaîne, portant un plateau guidé verticalement, donnera un ascenseur. Que l'agent producteur du mouvement soit la vapeur d'eau ou l'air dilaté, qu'il soit la pression de l'eau ou toute autre force, ce sera toujours le même ascenseur.
Les premiers appareils de ce genre, établis en France, étaient mis en mouvement par des moteurs à (p. 265) gaz. On connaît ces ingénieuses petites machines, inventées par M. Lenoir, où la force est produite par la dilatation d'un mélange d'air et de gaz d'éclairage enflammé par une étincelle électrique. Le gaz circule aujourd'hui dans toutes les grandes villes; il suffit d'un branchement et d'une pile de quelques éléments pour donner la vie à cette machine. En arrivant sur le plateau de l'ascenseur, on pousse le bouton et l'on s'élève. Veut-on s'arrêter à un étage quelconque, on tire une corde, le robinet se ferme et l'on quitte l'appareil. Veut-on descendre, on s'abandonne à la pesanteur en modérant son action par l'usage d'un frein.
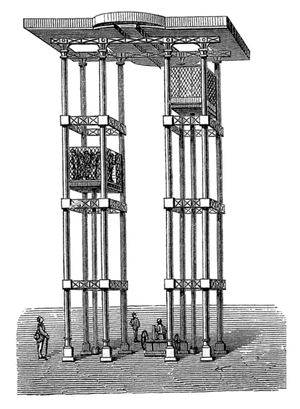
Fig. 64.—Ascenseur mécanique.
Toutes ces manœuvres ont l'inconvénient d'être (p. 266) compliquées et de ne pouvoir être faites par quiconque, sans une instruction préalable. Le concierge ou mieux un mécanicien attitré, ainsi que cela a lieu dans les hôtels importants, est chargé de la direction de l'appareil, mais on comprend qu'une semblable sujétion équivaut souvent à une impossibilité, et qu'une telle machine devient plutôt une charge et une gêne qu'un auxiliaire avantageux.
L'exposition de 1867 a fait faire un pas notable aux ascenseurs, et a vu surgir de nouveaux appareils, autrement pratiques que ceux qui les avaient précédés. M. Edoux en est l'inventeur. Qu'on se figure une longue tige cylindrique de métal, de la hauteur d'une maison, et pouvant disparaître dans un cylindre qui l'enveloppe et s'enfonce dans le sol. L'eau des conduites urbaines est introduite en dessous de cette grande tige cylindrique faisant piston, et sa pression détermine l'ascension du plateau superposé et des personnes qui y sont placées. Ce plateau, guidé dans ses mouvements, est surmonté d'une cage destinée à empêcher la chute des ascensionnistes et, au besoin, garnie de siéges. Une corde passe dans l'angle de la cage; elle s'étend du haut en bas de la tourelle parcourue par l'appareil. Il suffit de la tirer de bas en haut ou de haut en bas, selon qu'on veut monter ou descendre. Dans un cas, on ouvre le robinet d'accès de l'eau; dans l'autre, le robinet d'échappement. La fermeture des deux robinets, amenée par un état de tension convenable de la corde, détermine l'arrêt.
Comme on le voit, cet appareil est d'une manœuvre (p. 267) infiniment plus simple que celui que nous avons décrit tout d'abord, mais son emploi ne laisse pas que d'être encore assez coûteux. Paris possède aujourd'hui un grand nombre de ces appareils.
Il y a loin de ces moyens d'ascension perfectionnés à la corde à nœuds du badigeonneur, à l'échelle de corde du ravaleur, du marin ou du pompier. Chacun de ces engins suffit à la tâche qu'il sert à accomplir, et sa simplicité fait son plus grand mérite. Et puisque nous parlons du pompier, disons un mot des instruments de sauvetage qui servent à fuir le haut des habitations dont l'escalier est devenu inaccessible.
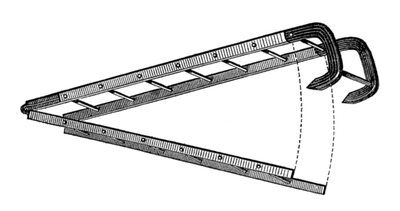
Fig. 65.—Échelles de pompier.
C'est à l'aide d'une simple petite échelle brisée en deux segments, de 2 mètres chacun, et dont les montants se terminent en forme de grands crochets, capables d'embrasser l'épaisseur d'un appui de fenêtre, que les pompiers montent d'étage en étage jusqu'au sommet des habitations. Mais souvent les murs eux-mêmes ne peuvent fournir un appui: la base brûle et il faut atteindre le quatrième, le cinquième étage ou le comble. On fait usage alors d'appareils mobiles que (p. 268) l'on dresse aussi près que possible des lieux à atteindre, et au sommet desquels on peut rapidement monter.
Ces appareils sont de différentes sortes. Nous donnerons une idée de leur construction.
On connaît ces croisillons en bois, figurant une série de losanges juxtaposés, dont les articulations sont formées par de petites chevilles sur lesquelles les enfants fixent des soldats. Selon qu'on rapproche ou qu'on éloigne deux sommets opposés de l'un des losanges, on allonge ou l'on raccourcit le petit appareil, et l'on groupe ou l'on fait marcher en avant le corps d'armée qu'il supporte.
Il en est de même de l'échelle à incendie de Jandeau. Deux systèmes de losanges, dont les plans sont disposés à angle droit pour donner à l'ensemble la rigidité voulue, sont portés sur un chariot. Les losanges, formés de pièces de charpente articulées, sont refermés sur eux-mêmes. Ils s'entr'ouvrent et leur squelette s'élève vers la maison embrasée, lorsque les extrémités des deux branches inférieures sont rapprochées l'une de l'autre. Une plate-forme et une cage, disposées à la partie supérieure, reçoivent les incendiés.

Fig. 66.—Les échelles, le boyau de toile des incendies.
Un autre appareil, qui nous semble beaucoup plus pratique, consiste en une série d'anneaux de charpente, entrés les uns dans les autres comme les anneaux d'un télescope, et dont la succession forme une haute tourelle qui peut atteindre jusqu'au sommet des habitations. Une cage, devant laquelle s'abaisse un petit pont-levis, donne accès aux incendiés, qui sont ensuite descendus à terre. Telle est l'échelle à incendie, (p. 271) inventée par Kermarec, maître de la compagnie des pompiers de la marine, au port de Brest.
Ce sont là les moyens lents de descente, mais il en est de rapides et de beaucoup plus simples dont l'emploi, quand il est possible, est assurément préférable. Un long boyau en fort treillis de toile, attaché au balcon d'une fenêtre, descend sur le sol en s'infléchissant. Les gens et les choses y sont successivement engagés et descendent à l'extrémité inférieure, convenablement soutenus pour éviter tout choc dangereux. Tous les objets précieux sont ainsi rapidement enlevés et soustraits au fléau destructeur.
Il faudrait un énorme volume pour décrire les principaux systèmes employés pour élever, non plus l'homme, dont le transport impose des conditions spéciales, mais les fardeaux de toutes sortes. Aussi n'avons-nous pas la prétention de les faire connaître tous dans les quelques pages qui vont suivre. Nous dirons seulement quelques mots des appareils les plus remarquables.
Le poids, le volume, la nature, le nombre des fardeaux qu'on peut avoir à soulever varient à l'infini. La hauteur à laquelle on doit monter ou descendre est aussi très-variable. Il en est de même de la distance horizontale à laquelle le transport doit avoir lieu et de (p. 272) la vitesse avec laquelle les mouvements doivent s'accomplir. C'est donc un problème très-complexe et infiniment varié que celui de la construction de ces appareils locomoteurs.
Les chèvres et les grues sont des assemblages de pièces de charpente, ou de métal, quelquefois de bois et de métal en même temps, tantôt fixes, tantôt mobiles, tantôt roulant, à portée constante, à portée variable, à une, à deux ou à plusieurs vitesses et mues par l'homme, par les animaux, par la vapeur ou par l'eau.
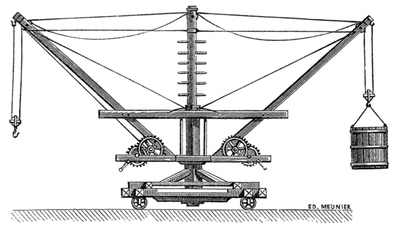
Fig. 67.—Grue roulante, à double volée.
Les grues sont les bras de l'industrie. Si ces appareils venaient à manquer, on verrait en même temps tous les chantiers, tous les ateliers s'arrêter. Les ports se fermeraient, car les bateaux pleins conserveraient leur chargement et les bateaux vides n'en pourraient recevoir de nouveau; les gares de chemins de fer ne pourraient livrer les marchandises arrivées, et n'en pourraient expédier de nouvelles; les chantiers de (p. 275) construction, les ateliers où se forgent ces énormes pièces de machines qui excitent à un si haut point l'admiration, devraient suspendre leurs travaux. Tout s'arrêterait, la force disparaissant.
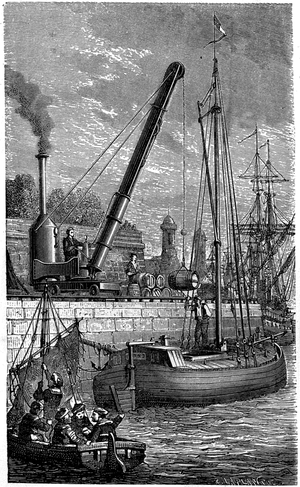
Fig. 68.—Grue à vapeur.
C'est tantôt la vapeur et tantôt l'eau qui les anime. Dans les grandes machines, des batteries de chaudières, monstres de métal allongés sur la flamme, produisent la vapeur qu'un ensemble de canaux distribue à tous les appareils, prêts à marcher à chaque instant. Dans les ports importants, dans les docks, indépendamment des grues qui portent elles-mêmes leur machine à vapeur, il existe souvent une circulation d'eau à haute pression qui alimente toutes les grues employées au chargement et au déchargement des navires. M. Armstrong est l'inventeur de cet ingénieux système.
Dans Victoria-dock, MM. William Cory et Ce, marchands de charbons à Londres, ont fait une installation de six grues au-dessus du niveau du quai. Le travail de déchargement des charbons amenés par les navires se continue jour et nuit; la cale du steamer est éclairée au moyen du gaz que des tubes flexibles en caoutchouc conduisent dans toutes les directions. En douze heures, une grue décharge 500 tonnes, c'est-à-dire le contenu de cinquante wagons, à l'aide de neuf hommes, dont six sont occupés au remplissage des bennes et trois à la manœuvre de la grue et à celle des wagons. Aussi le prix de revient, par tonne débarquée, n'est-il que de 0f,127.
Dans certaines gares de chemins de fer, à Paris, par exemple, aux deux gares de l'Ouest, et dans les (p. 276) usines métallurgiques, à côté des hauts-fourneaux, on trouve des appareils appelés monte-charges et qui sont destinés à monter les bagages à la hauteur des voies, ou les matières premières: charbon, minerai, castine, au niveau du gueulard[9] du haut-fourneau.
Le monte-charge de la gare Montparnasse a été établi par M. Baude. Les wagonnets chargés de bagages sont amenés sur un grand plateau, qui est élevé par une chaîne s'enroulant sur une poulie à gorge hélicoïdale. Tandis qu'un plateau monte les bagages au niveau du quai du départ, un autre descend à la salle des bagages un wagonnet qui doit recevoir un nouveau chargement. Chacun des plateaux est équilibré par un contre-poids en fonte relié au piston d'un cylindre dans lequel on introduit l'eau de la ville. L'arrivée du liquide, en détruisant l'équilibre, détermine le mouvement de l'appareil.
Le monte-charge de la gare Saint-Lazare, établi par M. Flachat, manœuvre d'une manière différente. Dans un cylindre se meut un piston à double tige. Selon que l'eau est introduite sur l'une ou sur l'autre des faces du piston, le mouvement a lieu dans un sens ou en sens contraire. Il en est de même des deux plateaux qui sont rattachés à chaque extrémité.
Les monte-charges hydrauliques établis pour le montage des matériaux des maisons en construction, à Paris, sont plus simples que les précédents. Les deux plateaux du monte-charge sont des caisses en (p. 277) tôle qui se font équilibre. Quand on veut élever les matériaux placés sur l'un des plateaux, on remplit l'autre de l'eau prise aux conduites de la ville. La descente de ce plateau, devenu plus lourd, détermine l'ascension de l'autre. C'est une véritable balance hydraulique.
Dans les usines métallurgiques où l'eau est abondante, on l'utilise pour faire mouvoir les monte-charges. Dans les établissements où elle est rare, on a recours à la vapeur. Voici comment on procède: on recueille, au gueulard du haut-fourneau, les gaz provenant des actions chimiques qui s'y produisent et qu'on laissait perdre autrefois, et on les dirige vers des générateurs de vapeur. Cette vapeur, à son tour, est conduite à de puissantes machines qui mettent à la fois en mouvement les souffleries et les monte-charges.
À Pont-à-Mousson, on a réuni dans un même bâtiment de 18 mètres de hauteur, l'escalier qui sert à la montée et à la descente des ouvriers, les deux tourelles pour le montage des wagonnets de houille et de minerai, et enfin un monte-charge à plateaux.
Ce dernier appareil est semblable, aux dimensions près, à celui qu'on emploie dans les briqueteries pour monter les briques et les poteries fraîches dans les séchoirs disposés au-dessus des fours. Il est semblable aussi à ces appareils qui servent, dans les raffineries, au transport des pains de sucre. Deux chaînes sans fin, disposées dans des plans parallèles, ont leurs chaînons réunis deux à deux par des tiges transversales qui font articulation et auxquelles on accroche, par des moyens (p. 278) divers, les objets à transporter ou les caisses destinées à les recevoir. Les chaînes s'enroulent sur des tambours auxquels on donne un mouvement de rotation au moyen d'une machine quelconque.
S'il s'agit d'une drague, c'est une puissante machine à vapeur; s'il s'agit simplement d'un monte-plats, c'est un contre-poids ou même une hélice en tôle placée dans la cheminée de la cuisine et que l'échappement des produits de la combustion anime d'un mouvement rapide; s'il s'agit d'une noria, c'est un cheval, un bœuf ou un âne: selon les applications, le moteur varie.
Un moyen de transport fréquemment employé dans la construction des machines et pour le transport des matières premières ou des produits entre deux étages d'une usine, est la vis d'Archimède: une hélice enfermée dans un cylindre et qui reçoit un mouvement de rotation. C'est au moyen d'appareils de ce genre qu'on opère le transport des grains dans les silos et celui du tabac dans les manufactures.
Nous avons déjà parlé des grues hydrauliques employées à l'embarquement des charbons dans les ports anglais. Ce ne sont pas les seuls appareils en usage.
Il n'était certainement pas facile de faire passer, du wagon dans le fond de la cale des bâtiments, le charbon qui, sans être une matière précieuse, perd notablement de sa valeur lorsqu'il se divise, ce qui arrive à chacune des manipulations qu'on lui fait subir.
On a imaginé des appareils appelés drops, à l'aide (p. 279) desquels le charbon est pris dans le wagon et descendu jusqu'au fond du bâtiment. Qu'on se figure une longue bigue ou flèche en bois, articulée à sa base et portant une poulie à sa partie supérieure. C'est le bras qui prend sur le wagon la caisse pleine de charbon, la soulève, l'abaisse et la descend au fond du navire. À son arrivée dans la cale, deux volets à charnières, qui forment le fond de la caisse, s'entr'ouvrent et laissent tomber son contenu. On réduit ainsi la hauteur de chute à son minimum et on évite les déchets autant qu'il est possible.
À côté des drops, s'élèvent souvent d'autres machines appelées tips, et qui servent aussi à l'embarquement des charbons. Le travail de ces machines est encore plus rapide que celui des drops. Un wagon arrive sur la plate-forme du tip, il est soulevé, puis renversé, et le charbon glisse par l'extrémité ou par le fond du wagon dans un long couloir qui s'avance au-dessus du navire. Le wagon reprend sa position horizontale, redescend et s'en va. Un autre le remplace, et toutes ces manœuvres s'opèrent avec une vitesse de 1,000 tonnes en douze heures, soit plus de 83 tonnes à l'heure et au prix surprenant de 0f,025 par tonne.
Tous ces mouvements s'exécutent au moyen de ces moteurs hydrauliques dont nous avons parlé précédemment. Pour faire avancer les wagons sur les voies de garage, on ouvre un robinet: un cabestan se met à tourner et tire la chaîne fixée au crochet d'attelage du wagon. L'eau comprimée distribue la vie à tous les appareils et toutes les manœuvres s'opèrent sans bruit, (p. 280) sans déploiement apparent, de force et comme par enchantement.
Lorsque la tarière ou le trépan sont descendus aux profondeurs où l'on trouve les métaux et la houille, après avoir creusé pendant des mois ou des années, il reste à organiser le transport des produits de la mine et tout d'abord celui des ouvriers.
Si l'exploitation est peu profonde et à flanc de coteau, c'est par des sentiers, en pentes plus ou moins rapides, ou par des échelles que vont et viennent les ouvriers. Mais dès que l'exploitation atteint une certaine profondeur, et qu'aucune galerie horizontale ou peu inclinée n'aboutit au jour, il faut avoir recours aux moyens d'ascension verticale les plus simples, les plus sûrs et les plus prompts à la fois.
Que l'on suppose, en effet, un puits de 400 mètres de profondeur, et 300 ouvriers nécessaires à l'exploitation. À la vitesse de 3 mètres par seconde, il faudra 2 minutes pour le trajet et, en comptant le temps nécessaire au départ et à l'arrivée pour monter et descendre, 2 minutes et demie, ce qui permet 20 voyages par heure. Il faudra donc une heure et demie pour descendre les 300 ouvriers au fond du puits, en admettant qu'on en descende 10 à la fois. Et si, comme le fait remarquer M. Burat, la machine d'extraction marche (p. 281) 11 heures par jour, il ne restera que 8 heures pour l'extraction des produits de la mine.
On organise donc à l'orifice des puits de puissantes machines à vapeur qui mettent en mouvement de grandes bobines sur lesquelles s'enroule la corde, la chaîne ou le câble d'extraction. On a des câbles plats, formés de câbles ronds juxtaposés, et qui pèsent de 4 à 7 kilogrammes le mètre courant. Un câble de 500 mètres pèse environ 3,500 kilogrammes, bien qu'il ne doive pas enlever de charge supérieure à 3,000 kilogrammes. Et comme le câble doit être d'autant plus résistant qu'il est plus rapproché de l'orifice, on le fait parfois de forme conique, de sorte qu'il devient plus mince et plus léger à sa partie inférieure. On peut, avec de tels câbles, atteindre des profondeurs de 700 mètres.
C'est tantôt le fil de fer, tantôt le chanvre, tantôt le fer et le chanvre associés, qui servent à leur fabrication. Enfin, on s'est servi du fer feuillard dans une mine de Belgique. On désigne sous ce nom ce fer en mince ruban, semblable à celui dont on cercle les tonneaux.
À l'extrémité du câble on attache le panier, la benne ou la caisse qui doit recevoir les mineurs, et, comme il faut prévoir le cas de la rupture de ce câble, on interpose ce qu'on appelle un parachute, ingénieux appareil dont l'action instantanée immobilise la benne dans le puits, en produisant l'enfoncement dans ses parois ou dans les guides de puissantes griffes de fer aciérées.
Que d'accidents et que de morts ont déjà été évités par ces parachutes! Nous n'en citerons qu'un, qui montre tout le soin que réclament la construction et l'emploi (p. 282) de ces appareils: «Le 20 juillet 1856, un câble se rompit au puits du Magny, près Blanzy, la cage étant un peu au-dessus de l'accrochage, en un point où les guides en bois étaient doublés de tôle; l'appareil ne put mordre sur cette tôle et la cage tomba avec une vitesse effrayante; mais, dès qu'elle arriva sur un point où le bois des guides était à nu, l'appareil agit et la cage s'arrêta après 3 mètres de cette action et malgré le poids de 260 mètres de câble tombé sur la cage. Sur cette hauteur de 3 mètres, l'épaisseur du bois des guides a été réduite de moitié, sans qu'aucune pièce du parachute se soit faussée.»
Les câbles et les bennes sont les moyens le plus communément adoptés pour le transport dans les puits de mine. Cependant, on a imaginé une machine à monter, appelée échelles mobiles ou fahrkunst, et qui sert aux mouvements du personnel des mines. Qu'on se figure deux échelles placées en regard l'une de l'autre et animées toutes deux d'un mouvement d'oscillation alternatif, de sorte que quand l'une monte, l'autre descend. Supposons qu'un homme monté sur la première, l'abandonne, alors qu'elle va descendre, pour passer sur la seconde qui va monter. Il montera avec elle. Supposons encore qu'au moment où celle-ci s'arrête, il la quitte pour repasser sur la première qui va maintenant s'élever. Il montera avec cette seconde échelle et, continuant ainsi cette manœuvre, s'élevant tantôt avec l'une et tantôt avec l'autre, il arrivera à la surface. Des ouvriers peuvent ainsi se placer sur toute la hauteur des échelles et monter d'une manière continue.
(p. 283)
Fig. 69.—Les échelles mobiles (fahrkunst).
(p. 285) Les premiers fahrkunst datent de 1833. Ils se composaient de pièces de bois équilibrées, suspendues à des balanciers et portant de petits marchepieds. Puis, on fit des échelles en fil de fer au moyen de câbles dont le diamètre allait en diminuant, à mesure qu'on s'enfonçait. On est descendu ainsi jusqu'à 500 mètres de profondeur.
M. Warocqué de Mariemont a construit un appareil qui se compose de deux longues tiges en bois, descendant dans le puits et portant des paliers à balustrade, de trois mètres en trois mètres. Des tiges métalliques terminent ces échelles à leur partie supérieure et portent chacune un piston mobile dans un cylindre dont la longueur est égale à la course des échelles. Les mouvements des deux pistons sont rendus solidaires l'un de l'autre au moyen d'un certain volume d'eau qui passe d'un cylindre dans l'autre tantôt par le haut, tantôt par le bas. Il suffit donc d'imprimer un mouvement de va-et-vient à l'un des deux pistons pour que l'autre fasse les mêmes mouvements en sens contraire. Le résultat est obtenu au moyen d'un cylindre à vapeur placé au-dessus de l'un des cylindres à eau. Les échelles font 12 à 14 oscillations par minute, et un ouvrier remonte en 6 minutes les 212 mètres qui séparent l'exploitation de l'ouverture.
Tout le monde connaît la cage où tourne l'écureuil, la roue à l'intérieur de laquelle se meut le chien de l'aiguiseur ou du cloutier, pour tourner la meule ou souffler la forge. C'est au dedans d'une roue semblable que tourne le carrier pour élever au jour les pierres employées à la construction. La roue à chevilles est très-fréquemment employée aux environs de Paris, mais elle ne peut servir que pour une exploitation peu importante et peu profonde.
Dès que l'extraction prend une certaine activité et que les produits sont tirés d'une grande profondeur, la force de l'homme devient insuffisante; il faut employer celle des chevaux, de la vapeur ou des chutes d'eau. Au lieu d'un simple treuil à axe horizontal, on a une machine à molettes avec bobines ou tambours d'enroulement.
Au-dessus du puits d'extraction, deux grandes poulies de renvoi, appelées molettes, portent les deux brins du câble: l'un montant, l'autre descendant, et les dirigent vers deux cônes tronqués rapprochés par leur grande base, mobiles sur un axe vertical et qui servent l'un à l'enroulement, l'autre au dévidage du câble. Deux chevaux donnent le mouvement à cet arbre et complètent la machine, qui a une entière ressemblance avec les manéges des maraîchers.
Les tambours dont nous venons de parler sont souvent remplacés par des bobines. Ces bobines sont des (p. 287) tambours de la largeur du câble et sur lesquels les spires se superposent, au lieu de se juxtaposer, disposition essentiellement favorable à la régularité de l'extraction.
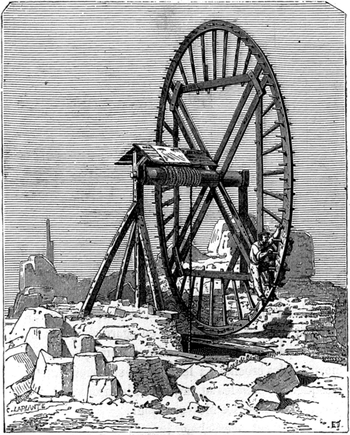
Fig. 70.—Roues à chevilles des carriers.
(p. 288) Telles sont, en abrégé, les dispositions adoptées dans les mines pour le montage des produits. Les véhicules qui servent au transport varient presque à l'infini et si, dans une même localité, on trouve parfois des chariots, des bennes, des berlines, des wagonnets ou des wagons de la même forme, il est rare que cette ressemblance ait lieu dans deux pays un peu éloignés. Un grand nombre de raisons motivent ces différences et les justifient: en premier lieu, l'allure de la couche ou du gisement, sa direction, son épaisseur, puis le mode d'exploitation adopté, la hauteur, la largeur des galeries, etc. L'ingénieur a le champ libre pour le choix des moyens les meilleurs à employer.
À Blanzy, on fait usage, pour le transport de la houille, de chariots en bois de 14 hectolitres, se vidant à l'avant par un panneau mobile sur charnière. Dans les mêmes mines, on se sert aussi de la benne roulante; c'est un tonneau avec un seul fond et monté sur roues en fonte. À Anzin, on emploie le wagon en tôle de M. Cabany, monté bas sur rails et dont la caisse évasée permet un bon chargement, eu égard au poids mort; dans le pays de Liége, des berlines moins perfectionnées portant des crochets à leur partie supérieure, à l'aide desquels on peut les superposer et les accrocher les unes aux autres pour les élever au jour.
Lorsque cet accrochage immédiat des bennes entre elles n'a pas lieu et que la machine est assez puissante pour remonter plusieurs véhicules à la fois, on réunit ceux-ci par deux ou par quatre dans une cage en bois ou en métal, ayant deux ou quatre étages. Pour empêcher (p. 289) les chocs contre les parois du puits, les bennes ou les cages sont guidées par des câbles en fil de fer ou par des longrines verticales en bois de chêne, qu'elles embrassent au moyen de coulisses en fer ou en fonte.
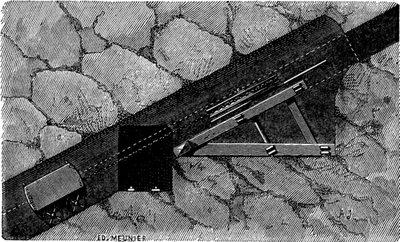
Fig. 71.—Plan automoteur dans une mine.
Outre les manéges et les machines à vapeur destinés à la mise en mouvement des appareils d'extraction, on emploie encore les moteurs hydrauliques et l'on crée, dans certains cas, des chutes d'eau d'une grande puissance. C'est ce qui a lieu dans le Hartz et dans la Saxe. Qu'on suppose un cours d'eau amené près du puits. À quelques mètres au-dessous de l'orifice, on creuse une chambre, où l'on installe une première roue; quelques mètres plus bas, on en installe une seconde; plus bas encore, une troisième, et l'eau qui est introduite passe successivement d'une roue à la suivante et sert d'abord à l'extraction des produits, puis à l'épuisement (p. 290) des eaux de la mine. Les eaux motrices s'échappent par une galerie latérale et s'écoulent ensuite dans la vallée. De la sorte, l'extraction a lieu dans les conditions économiques les plus avantageuses.
Les moyens usités pour les transports dans les galeries très-inclinées des mines sont les mêmes que ceux qu'on emploie dans les puits verticaux; mais, toutes les fois qu'on le peut, on s'arrange de manière à faire descendre les wagons chargés pour n'avoir à remonter que les wagons vides et l'on organise alors des plans automoteurs, le wagonnet roulant directement sur les rails, si l'inclinaison n'est pas trop forte, ou étant porté sur un châssis roulant ou berceau, qui le maintient horizontal et empêche le chargement de se répandre.
Certaines circonstances ont conduit parfois à l'établissement de transports au-dessus du sol suivant une ligne horizontale ou inclinée; par exemple: la mauvaise nature du sol sur lequel on aurait dû établir une voie, des accidents de terrains trop prononcés, etc. On a adopté, suivant les cas, différents systèmes; des chemins de fer à un rail, appelés chemins à la Palmer, du nom de leur inventeur et des chemins funiculaires, où le rail est remplacé par un câble en fil de fer.
Le chemin à la Palmer se compose d'un rail porté par une longrine qui repose elle-même sur des poteaux. Une roue à gorge se meut sur le rail et porte à (p. 291) droite et à gauche deux caisses entre lesquelles la charge doit se répartir également. Nous ne pouvons mieux donner une idée de la manière dont le véhicule repose sur la voie qu'en comparant ces deux caisses aux deux paniers du bât qu'on met sur le dos des bêtes de somme et qui doivent être également chargés pour qu'il y ait équilibre. Ce moyen de transport n'a été employé que dans l'intérieur d'un petit nombre d'établissements industriels (chemin du bureau des navires à Deptfort, près de Londres); transport de marchandises peu important (chemin des fours à chaux et de la briqueterie de Cheshunt au canal de Lee), service de la briqueterie de Posen; mines de houille (à Rive-de-Gier) et travaux de terrassement (fortifications de Paris au bois de Boulogne).
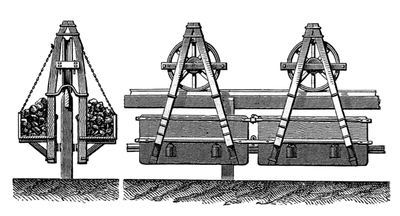
Fig 72.—Chemin à la Palmer (au jour).
Les cadres en charpente des galeries de mines ont permis de simplifier ce moyen de transport à l'intérieur des exploitations souterraines et, en soutenant (p. 292) latéralement la longrine et le rail, de placer la caisse au-dessous de la voie, ce qui rend inutile la division de la charge. Les bennes, en arrivant au jour, glissent sur leurs patins, ou sont transportées au moyen de trucks sur des voies ordinaires.
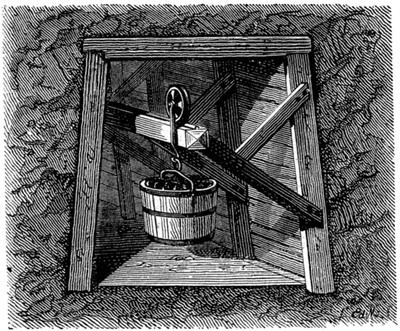
Fig. 73.—Chemin à la Palmer (dans une galerie de mine).
Dans certaines exploitations à ciel ouvert, on a parfois à transporter d'un côté à l'autre de la carrière des matières sans valeur, des terres provenant de la découverte, ou des détritus. On pourrait avec un chemin de fer opérer ces transports, mais il faudrait dresser une plate-forme, faire de grands détours, ce qui deviendrait coûteux. On tend un câble au travers de l'exploitation. Avec trois petites poulies assemblées en triangle, on fait une chape, comme celle des bacs à la traversée des rivières, et à la chape on suspend un petit bateau, chargé des matières à transporter. (p. 295) Une corde attachée à chacune des extrémités du batelet règle sa course et les transports s'opèrent rapidement et à peu de frais.

Fig. 74.—Transport par câble métallique (système Hodgson).
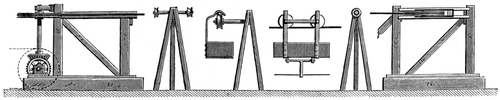
Fig. 75.—Boîtes, supports, poulies extrêmes du système Hodgson.
Cet emploi du câble métallique a été généralisé récemment par M. Hodgson, pour le transport du granit sortant des carrières de Bardon-Hill, à trois lieues de Leicester, qui s'opérait entre les carrières et le chemin de fer, sur une distance d'une lieue, au moyen de charrettes et réclamait un nombreux personnel. Une corde métallique sans fin est soutenue sur des poulies qui sont portées par de forts poteaux, éloignés ordinairement de 50 mètres les uns des autres. Cette corde passe à un bout sur une poulie mise en mouvement par une locomobile et reçoit une vitesse de 6 à 9 kilomètres à l'heure. Des caisses sont suspendues au câble par un crampon de forme particulière, qui maintient la charge en équilibre et permet le passage des points d'appui sans difficulté.
Dans le cas où on a de fortes charges, on met deux cordes pour soutiens et une corde sans fin comme moyen de transmission. On conçoit que la nature du terrain sur lequel on passe importe peu; le câble peut se poser aussi aisément que le fil du télégraphe.
Le prix d'établissement pour une ligne à une corde portant 50 tonnes par jour (l'équivalent de 5 grands wagons de chemins de fer) dans des boîtes pesant 25 kilogrammes n'est que de 3,900 francs par kilomètre.
On pressent tous les avantages que l'on pourra tirer de ce nouveau moyen de transport.
C'est vers 1560, à ce que l'on rapporte, que Gutter de Nuremberg inventa le fusil à air comprimé. Philon de Byzance parle même d'un tube construit par Ctésibius, dans lequel l'air comprimé lançait un trait et qu'il nomme aérotone. Peut-être n'est-ce tout simplement que la sarbacane qu'emploient les écoliers pour lancer des boules d'argile aux oiseaux.
Quoi qu'il en soit, l'invention dont nous voulons parler remonte, quant à son principe, aux temps les plus reculés. Les effets qu'on peut obtenir de l'air comprimé, comme propulseur, sont connus depuis longtemps; mais c'est d'une époque toute récente que date son application au transport des petits paquets.
L'Angleterre nous a précédés dans cette voie, nous avons déjà eu l'occasion de le constater. Après avoir rendu hommage à son esprit d'initiative, nous expliquerons de quelle manière s'opère à Paris le transport des dépêches télégraphiques au moyen de l'air comprimé.
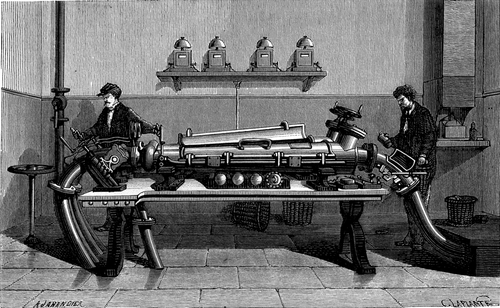
Fig. 76.—Appareil de transmission par l'air comprimé.
Un tube de six centimètres et demi de diamètre intérieur, suspendu à la voûte des égouts, réunit entre eux les six bureaux télégraphiques de la rue de Grenelle-Saint-Germain (Administration centrale), de la rue Boissy-d'Anglas, du Grand-Hôtel, de la Bourse, de l'Avenue de l'Opéra (près du Théâtre-Français) et de la rue des Saints-Pères, formant un polygone fermé de (p. 299) 6718m,80 de longueur. Chacun des côtés de ce polygone a de 900 à 1,400 mètres de longueur et se compose d'éléments droits ou courbes, horizontaux, inclinés, parfois même verticaux. Le rayon le plus petit à l'angle de deux rues est de 12 mètres et la pente la plus forte de 0m,05 par mètre, sauf aux abords des bureaux, où ce rayon atteint 3 mètres et où le tube devient vertical. Telle est la voie.
Le matériel de transport se compose d'étuis en fer garnis de cuir, ayant 0m,06 de diamètre et 0m,12 à 0m,15 de longueur. Chacun d'eux porte gravé le nom de la station à laquelle il est destiné. Ce sont les wagons.
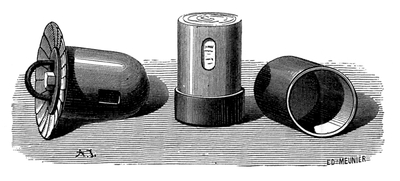
Fig. 77.—Piston et boîte à dépêches du télégraphe atmosphérique.
Le propulseur est des plus simples. Il est renfermé dans deux cylindres en tôle, mesurant chacun 4 à 5 mètres cubes et, dans lesquels on comprime de l'air. Nous avons déjà vu quelle ressource offrent les conduites de Paris, dont l'eau peut s'élever à une hauteur de 15 mètres et possède, par conséquent, une pression représentée par une colonne d'eau équivalente. Un (p. 300) troisième cylindre reçoit l'eau de la ville et chasse l'air dans les deux premiers cylindres où on le puise quand on en a besoin.
Il est inutile d'insister sur les robinets, niveaux, manomètres, qui sont le complément indispensable de ces appareils et qui servent à en suivre la marche, à en régler le fonctionnement. Disons seulement que les moyens employés pour comprimer l'air varient. Nous en avons indiqué un, c'est le plus simple. On fait usage aussi de petites turbines et on emploiera bientôt une machine à vapeur, actionnant des pompes à air. Enfin, on a imaginé un appareil d'entraînement, dont le principe, qui rappelle l'injecteur Giffard, servant à l'alimentation des locomotives, est celui de la trompe ou soufflerie des forges catalanes. C'est un jet d'eau arrivant au centre d'un tuyau en communication avec l'air extérieur et sur lequel il agit mécaniquement pour l'entraîner et le comprimer.
Nous avons décrit le réseau principal. À ce réseau se rattachent des réseaux secondaires; deux d'entre eux sont reliés à la Bourse, et forment un réseau de 18 kilomètres. Le réseau de Paris, avant peu d'années, sera porté à 50 kilomètres. Nous avons fait connaître le matériel et le propulseur. Assistons au départ d'un train du bureau central.
La station de départ prévient par le télégraphe la station voisine, qu'un train est prêt à partir. Celle-ci répond par trois coups frappés sur le timbre qu'elle l'attend. Une petite porte est ouverte sur le tuyau. Les wagons y sont engagés: un ou plusieurs pour (p. 301) chaque station, selon le nombre des dépêches et un ou plusieurs wagons omnibus pour les dépêches de station à station. À leur suite, on met le piston, qui ne diffère des wagons que par une rondelle en cuir emboutie à l'une de ses extrémités. On ferme la porte, et l'air est introduit par un robinet. Il siffle et le train part. Un ronflement a lieu, une minute se passe, puis plus rien; le train est à destination. On referme le robinet d'air et, en manœuvrant les robinets du cylindre à eau, on prépare une nouvelle provision d'air comprimé.
Au bureau central, il part et il arrive un train tous les quarts d'heure. Les dépêches à destination de la province ou de l'étranger sont remontées immédiatement à l'aide d'une corde et d'un panier dans la grande salle du départ et réparties entre les différents appareils, qui communiquent avec le réseau télégraphique.
Tout cela est bien simple, mais ce résultat si merveilleux n'a été obtenu qu'après de longs efforts et des essais multipliés. On a essayé au moins vingt wagons d'espèces différentes avant de s'arrêter à celui qui est employé! Aujourd'hui, si tous les essais ne sont pas terminés,—car on travaille toujours et on perfectionne,—ils sont, du moins, en si bonne voie que toute incertitude est levée et que le système qui fonctionne depuis plusieurs années peut être considéré comme ayant reçu du temps la sanction qui le consacre.
Le tube peut passer dans l'air, sous le sol ou dans (p. 302) l'eau; il suffit que les joints soient hermétiques pour que son fonctionnement soit parfait. C'est assurément l'un des moyens de locomotion les plus remarquables, un de ceux qui rendent déjà et pourront rendre dans l'avenir les plus grands services.
FIN
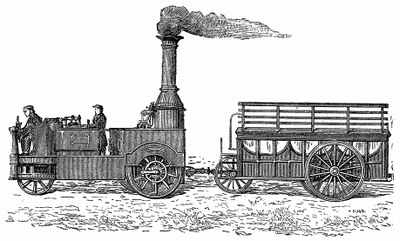
CHAPITRE PREMIER.
Introduction.
Le mouvement et l'attraction universels. — Mouvements des minéraux, des végétaux et des animaux. — Carrière offerte au mouvement de l'homme. — L'air indispensable à tous ses mouvements 1
I.—LA LOCOMOTION SUR LA TERRE.
A.—Insuffisante de l'appareil locomoteur de l'homme. — Les animaux moteurs. — Origine de la voiture. — Les traîneaux 5
B.—Frottement entre le véhicule et la voie qui le porte. — Le dé et la bille d'ivoire. — Frottement de glissement et de roulement. — Ce qu'on sait des lois du frottement. — Difficultés inhérentes aux observations. — Impressionnabilité de la matière. — Moyens de diminuer le frottement. — Lubrifaction des parties frottantes. — Accroissement du diamètre des roues 13
C.—La voie. — Chaussées empierrées, pavées, à ornières de bois et de métal. — Les anciennes voies de communication. — Les chaussées romaines, les chaussées de Brunehaut. — Les rues sous Philippe Auguste et les voies sous Colbert. — Les routes nationales, départementales; les chemins vicinaux et ruraux. — Importance de la circulation. — Le personnel des ponts et chaussées et celui des chemins de fer. — Ce que coûte un ingénieur des ponts et chaussées et des mines, d'après M. Flachat 20
II.—LA LOCOMOTION SUR L'EAU.
La feuille, la branche, le tronc d'arbre et le bateau. — Rivières, fleuves, canaux, lacs, mers, océan. — Les ondulations. — Les marées, les courants et les vents. — Les vagues, la tempête et les navires transatlantiques. — Le réseau des voies navigables en France 27
(p. 306) III.—LA LOCOMOTION DANS L'AIR.
Les vents. — La chute d'un corps dans l'air et dans le vide. — Les oiseaux et les ballons. — La direction des ballons paraît une utopie. — Invention d'un moteur à poudre 36
CHAPITRE II.
Les animaux moteurs.
I.—L'homme marcheur, coureur, patineur, échassier 42
II.—Le cheval, l'âne, le mulet, l'hémione, le bœuf, le yack, le bison, le chameau, l'éléphant, le renne, le chien, l'autruche 51
CHAPITRE III.
Les véhicules dans l'antiquité.
Biga, carpentum, cisium, pilentum, benna. Chars d'Héliogabale, char funèbre d'Alexandre. Litières et basternes 67
CHAPITRE IV.
Les véhicules depuis l'antiquité jusqu'au dix-huitième siècle.
Haquenées et palefrois. — Chariots et litières. — Coches et carrosses sous Henri IV. — Les fiacres de Nicolas Sauvage. — Les carrosses à cinq sols du duc de Roanès. — Voiture du comte de Castelmaine 75
CHAPITRE V.
Les véhicules au dix-huitième siècle et leurs progrès jusqu'à
nos jours.
Berlines. — Diligences. — Vis-à-vis. — Coupés. — Berlingots. — Désobligeantes. — Gondoles. — Landau. — Berline allemande. — Calèche. — Dormeuse. — Coches. — Diligences. — Chaises. — Les messageries. — Soufflets. — Coach-mall. — Volante havanaise. — Chaises à porteurs. — Palanquins. — Litières. — Brouettes. — Wourst. — Break. — Voitures à transformation 97
CHAPITRE VI.
Les chemins de fer.
I.—IMPORTANCE DES CHEMINS DE FER 122
II.—LA CONSTRUCTION 125
A.—Études. — Évaluation des dépenses et des produits 126
B.—Infrastructure. — Installations préliminaires. — Travaux. — Terrassements: l'homme, le cheval, la machine. — Principales tranchées. — Ouvrages d'art: souterrains, tracé, percement, accidents. (p. 307) Les principaux souterrains; le tunnel des Alpes. — Viaducs en pierre, en bois, en fer, en fonte. — Les principaux viaducs. — Le pont du Niagara 129
C.—Superstructure. — Stations et maisons de garde. — La voie: les ornières des mines de Newcastle. — Ornières creuses et saillantes. — Roues plates et à rebords. — Rails méplats, à champignon simple, à double champignon, Vignoles, Brunel, Barlow, Hartwich; rails en acier. — Traverses en bois et en fer. — Coussinets, coins, éclisses, boulons, crampons, chevillettes, etc. 147
III.—LES WAGONS.
A.—Les wagons en général. — Voitures à 2, 4, 6 et 8 roues. — Construction d'un wagon: châssis, caisse 155
B.—Wagons à marchandises, à bestiaux et divers. — Wagons pour le transport du ballast, du coke, du charbon, des marchandises, du lait, des bestiaux. — Transport des filets de bœuf, du gibier, du vin de Champagne, des fraises, des fromages. — Wagons à écurie, à bagages, des postes 157
C.—Wagons à voyageurs. — Matériel français, anglais, allemand, américain. — Voitures spéciales des chemins du Grand-Tronc, du Mont-Cenis, de Sceaux. — Valeur du matériel roulant. — Nombre de véhicules sur tous les chemins du globe 164
IV.—LA TRACTION.
Les moteurs animés et inanimés. — La vapeur 171
A.—Moteurs animés et inanimés. — Le cheval et les chemins de fer dans les villes et dans les mines. — La pesanteur et les plans automoteurs. — L'eau, la machine à vapeur fixe et les plans inclinés. — L'air et le système atmosphérique. — Papin, Medhurst, Wallance 172
B.—Invention de la locomotive. — Voitures de Cugnot, d'Oliver Evans. — Locomotive de Trewithick et Vivian, de Blenkinsop, de Brunton, de Stephenson. — Séguin invente la chaudière tubulaire et Stephenson le jet de vapeur 182
C.—La locomotive. — Différents types. — Machines à voyageurs à moyenne et à grande vitesse: Crampton. — Machines mixtes. — Machines à marchandises de moyenne et de grande puissance: Engerth, Beugnot. — Progrès accomplis dans la construction des locomotives; leur puissance 188
V.—SYSTÈMES DIVERS.
A.—Multiplication du nombre des cylindres. — Système Verpilleux. — Machines du Nord, Meyer, Dupleix, Flachat 202
B.—Systèmes divers. — Locomotive de Jouffroy. — Système Séguier. — Locomotive Fell du Mont-Cenis. — Machines rotatives. — Système Agudio, funiculaire et à rail central. — Systèmes Larmanjat, Saint-Pierre et Goudal 205
C.—L'eau et l'air comprimé. L'électricité. — Locomotives Andraud, Pecqueur. — Chemins éoliques Andraud. — L'air comprimé et raréfié: le chemin de Sydenham. Tunnel sous la Manche. — L'air chaud. — L'eau comprimée: système Girard. — Machines électro-magnétiques 214
(p. 308) CHAPITRE VII.
Les voitures à vapeur.
A.—Les voitures à vapeur avant l'époque actuelle. — Opinion des ingénieurs sur la locomotive routière 222
B.—La question reprise. — Nouvelles recherches. — Les machines Lotz, Aveling et Porter, Larmanjat, Feugères et diverses 225
C.—L'avenir de la locomotion routière à vapeur. — Usages actuels en agriculture, en industrie 237
CHAPITRE VIII.
Les vélocipèdes 249
Des variétés du véloce 255
CHAPITRE IX.
Locomotion au-dessus et au-dessous du sol et dans divers sens.
A.—LOCOMOTION AU-DESSUS DU SOL ET À FAIBLE HAUTEUR.
a.—Les cordes. — Les échelles. — Les escaliers. — Les ascenseurs. — Les échelles et les machines de sauvetage des incendies 262
b.—Les chèvres et les grues à bras, à manége, à vapeur, à eau (système Armstrong). — Les tourelles. — Les monte-charges à vapeur, hydrauliques. — La toile sans fin. — La chaîne à godets. — La vis d'Archimède. — Le tip hydraulique et à contre-poids. — Le drop 271
B.—LOCOMOTION AU-DESSOUS DU SOL ET À TOUTE PROFONDEUR.
a.—Les sentiers. — Les échelles. — La corde. — Le panier. — La benne. — La caisse. — Les Fahrkunst 280
b.—La roue à chevilles. — La machine à molettes. — Chevalets et bobines. — Chariots, bennes roulantes, berlines, wagonnets et wagons 286
C.—LOCOMOTION SUIVANT UNE LIGNE HORIZONTALE OU INCLINÉE AU-DESSUS DU SOL.
Chemins à la Palmer. — Chemins funiculaires 290
D.—LOCOMOTION EN TOUS SENS, DANS TOUTE DIRECTION ET DANS TOUT MILIEU 296
PARIS.—IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.
(p. 309) BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES
à 2 fr. 25 c. le volume in-18 jésus
La reliure percaline, tranches rouges, se paye en sus 1 fr.
PARIS.—IMP. SIMON. RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.
1: Compte rendu de la société des ingénieurs civils.—Séance du 8 janvier 1869.
2: Flachat.
3: Le kilogrammètre, ou unité de travail, est le travail dû au poids de 1 kilogramme élevé à 1 mètre de hauteur.
4: M. du Camp, Orient et Italie.
5: Voyage illustré des Deux Mondes, Mornand et Vilbort.
6: Selon d'autres, cette importation serait postérieure et daterait de 1660: elle aurait été faite par le prince de Condé, au retour de son exil à Bruxelles.
7: Un chemin de fer, d'un système analogue, permet de monter au sommet du Righi.
8: Ces lignes étaient écrites avant la guerre affreuse que nous venons de soutenir contre l'Allemagne. Rien ne faisait pressentir à ce moment les événements qui se sont accomplis.
9: C'est ainsi qu'on appelle l'orifice supérieur de ces grands appareils.