
Project Gutenberg's Les enfants des Tuileries, by Olga, Vicomtesse de Pitray This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Les enfants des Tuileries Author: Olga, Vicomtesse de Pitray Illustrator: E. Bayard Release Date: July 19, 2008 [EBook #26091] Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES ENFANTS DES TUILERIES *** Produced by Suzanne Shell, Rénald Lévesque and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
Droits de propriété et de traduction réservés
OUVRAGES DU MÊME AUTEUR
PUBLIÉS DANS LA BIBLIOTHÈQUE ROSE ILLUSTRÉE
Les débuts du gros Philéas; 2e édition, un volume avec 57 vignettes par H. Castelli.
Le château de la Pétaudière; 2e édition, un volume avec 78 gravures d'après A. Marie.
Le Fils du Maquignon; un volume avec 65 gravures par Riou.
Prix de chaque volume, broché, 2 fr. 25
A MA FILLE
JEANNE DE PITRAY
Chère enfant, voici le livre qui t'est destiné: garde toujours ta charmante simplicité, ton coeur excellent, afin de devenir une Élisabeth, une Irène, une Noémi: le bon Dieu te préservera, je l'espère, de ressembler, même de loin, à une Héloïse, à une Constance ou à une Herminie. C'est le voeu le plus cher de celle qui t'aime et te bénit de tout son coeur.
Ta mère,
Vicomtesse DE PITRAY,
Née de SÉGUR.
Livet, 14 mai 1856.
Aaaah! Dieu! que c'est ennuyeux, la campagne! toujours de la verdure, des animaux, et pas moyen de faire de la toilette! personne pour vous regarder! Aussi mes jolies robes se fanent dans l'armoire! jusqu'à ma pauvre poupée qui est condamnée comme moi... aaaah! à porter des robes de toile... oh! mes chères Tuileries, quand vous reverrai-je?
Tel était le monologue qu'Irène de Morville se débitait à demi-voix, par une belle matinée d'automne: assise auprès de la fenêtre, elle regardait d'un air renfrogné le beau paysage qui s'offrait à sa vue. Ni les pelouses vertes, ni les corbeilles remplies de fleurs, ni même le petit bateau qui se balançait au bord d'une jolie rivière anglaise, ne parvenaient à la dérider: elle finit par baisser les yeux avec humeur sur une robe de velours bleu appartenant à sa poupée, et qui était étalée sur ses genoux.
Elle recommença bientôt à bâiller de plus belle quand, au milieu d'un aaah! formidable, une porte s'ouvrant avec fracas la fit sauter sur sa chaise et pousser un cri de frayeur.
«Qui vient ici? dit Irène... ah! c'est toi, Julien? que c'est sot d'entrer ici comme un ouragan! que c'est bête!
--Ne grogne donc pas, répondit Julien en riant; je t'apporte une bonne nouvelle, devine un peu.»
Irène bondit de sa chaise.
«Ce ne sera pas long, s'écria-t-elle en battant des mains: à tes yeux brillants de joie, je vois que nous retournons à Paris, n'est-ce pas?
--Tu y es, répondit Julien. Hein! quel bonheur?
--Enfin! dit Irène avec explosion, je vais donc reprendre ma bonne, ma charmante vie de Paris! Oh! ma chère poupée, nous allons aller à l'Éclair pour moi, chez Béreux pour toi, et nous nous ferons bien belles pour faire enrager toutes nos amies!
--Et moi donc, reprit Julien, en se frottant les mains, vais-je m'en donner à la Bourse des Timbres! Jordan, Vervins et moi, nous allons faire marcher ça un peu bien, va! il y a des bêtas de petits garçons qui aiment mieux jouer aux barres. Est-ce nigaud! Vendre cher et acheter bon marché ces jolis timbres bleus, blancs, violets, rouges, voilà un meilleur passe-temps pour des garçons sérieux et intelligents comme nous.
IRÈNE.
C'est si amusant de se promener aux Tuileries, en élégante, et d'entendre dire: «Quelle gentille enfant! qu'elle est bien mise! quelle jolie tournure!
JULIEN.
.... Et d'enfoncer les autres en leur colloquant des timbres communs, qu'on leur fait payer très-cher, et puis de se promener devant tout le monde avec un stick à la main et un lorgnon à l'oeil!
IRÈNE.
Comment, un lorgnon? tu as un lorgnon, toi! Où l'as-tu pris?
JULIEN.
Et nos timbres, donc! ce sont eux qui me l'ont donné. Je le cache pour qu'on ne se moque pas de moi, ici. Nos voisins sont si bêtes! tiens, regarde, n'est-ce pas qu'il est joli? (Il le montre à sa soeur.)
IRÈNE.
Oui, il est assez bien, mais comment fais-tu pour voir à travers? Il me semble (elle regarde dedans) que ça rapetisse affreusement tous les objets.
JULIEN.
Tant mieux! c'est exprès, puisque je suis myope.
IRÈNE.
Toi? ah! ah! quelle plaisanterie! Tu as toujours eu des yeux excellents, mon cher; hier encore tu voyais sur la colline les ailes des moulins à vent de Fresnoy; et ils sont à deux lieues d'ici.
JULIEN, avec humeur.
Ce n'est pas une raison: (Irène rit toujours) finis donc, toi, tu m'impatientes avec tes ah! ah! Tiens, je vais te prouver que je suis myope!
IRÈNE, avec ironie.
Cela me fera plaisir!
JULIEN, gravement.
Vois-tu cette femme qui sarcle dans l'allée droite, là-bas?
IRÈNE.
Oui: après?
JULIEN.
Eh bien, ma chère, je crois que c'est une vache.»
Irène se remit à rire de plus belle en se moquant de son frère: Julien allait se fâcher sérieusement quand ils virent entrer les enfants du jardinier.

IRÈNE.
Bonjour, Amable, bonjour, Léonore: qu'est-ce que vous voulez?
LÉONORE.
Vous souhaiter le bonsoir, mamzelle, vous offrir ce bouquet et vous dire combien nous sommes fâchés d'apprendre que vous allez bientôt partir.
IRÈNE.
Merci. (Elle prend le bouquet et le jette en poussant un cri.) Dieu! quelle horreur! quelle infamie!
LES ENFANTS.
Qu'est-ce qu'il y a?
IRÈNE.
Une chenille.... une atroce, une monstrueuse chenille! pouah! (Elle fait des mines.) J'ai cru que j'allais me trouver mal! je frissonne à l'idée seule d'avoir pu toucher cette ignoble bête!
LÉONORE, interdite.
Je suis bien fâchée, mamzelle....
IRÈNE.
Me voilà remise. Tiens, puisque te voilà, aide-moi à faire les malles de ma poupée. Veux-tu?
LÉONORE.
Je veux bien, mamzelle. Oh! les belles choses!
IRÈNE, riant.
Ça, ce sont des horreurs, ma pauvre fille n'a plus que des vieilleries: elle a grand besoin de se remonter chez Béreux.
LÉONORE.
Qu'est-ce que c'est Béreux, mamzelle?
IRÈNE.
C'est sa couturière, ma chère amie.
LÉONORE, avec stupeur.
Mamzelle vot' poupée a une couturière?
IRÈNE.
Je crois bien! et que j'emploie sans cesse, encore! Tu ne peux pas te figurer comme c'est cher à habiller, une poupée élégante. Tiens, voilà son coffre à bijoux.
LÉONORE, saisie.
Hélas! seigneur! tout ça pour une poupée!...
Les deux petites filles continuèrent, l'une à étaler orgueilleusement les richesses de sa poupée, puis ses richesses à elle, l'autre à tout admirer; pendant ce temps, Julien causait avec Amable et lui disait d'un air de protection:
«Tu es bien heureux d'aimer la campagne, toi! moi, je ne peux pas la supporter; c'est si triste! toujours être seul.
--Et monsieur votre père? Et madame votre mère? Et mamzelle Irène? disait Amable, c'est une bonne et belle société, monsieur Julien: elle devrait vous faire bien plaisir!
--Nous autres, vois-tu, répliqua Julien avec importance, nous avons des occupations qui ne nous permettent pas de nous voir souvent. Papa est sans cesse à Paris, occupé d'affaires importantes. Maman a des visites ou fait des visites. Quand nous les voyons, ils sont très-bons et très-affectueux, mais nous les voyons très-peu. C'est donc seulement à Paris que nous menons une vie agréable.
AMABLE.
Et mam'zelle Irène! elle vous tient compagnie: ça doit vous désennuyer ici, monsieur Julien?
JULIEN.
Irène? joliment! elle passe ses récréations à s'habiller, se déshabiller, se rhabiller, s'attifer de trente-six façons différentes. Quand ce n'est pas elle, c'est sa poupée. Oui, en vérité: jolie ressource que la société d'Irène!
IRÈNE, s'approchant.
Qu'est-ce que tu dis? encore du mal de moi, évidemment! on dirait que tu es une perfection, toi qui te traînes partout d'un air ennuyé, toi qui pourrais t'occuper de pêche, de jardinage, de chasse, et qui ne sais que te pavaner! moi, au moins, je m'amuse avec ma poupée....
JULIEN.
Je te conseille de me dire cela, toi qui passes ta vie à faire la roue....»
Les enfants du jardinier s'échappèrent de la chambre pendant qu'Irène et Julien, rouges et furieux, se disaient des choses de plus en plus désagréables. Ceux-ci finirent par se séparer fort en colère; l'une continua à faire les malles de sa poupée, l'autre alla visiter sa collection de timbres, d'où il espérait bien tirer de quoi acheter une chaîne de montre; cette chaîne était l'objet de tous ses désirs.
Irène avait douze ans et Julien treize ans et demi; leur père était agent de change: leur séjour annuel à Paris développait chaque jour davantage en eux les défauts dont la vanité était le principe. Leur mère était bonne et tendre, mais malheureusement, entraînée dans le tourbillon du monde, elle était peu avec ses enfants. M. de Morville, leur père, les voyait moins encore, quoiqu'il les aimât très-sincèrement; ses nombreuses affaires le retenaient loin de sa famille, et c'est à peine s'il passait avec ses enfants et sa femme une heure chaque jour.
Le lendemain de leur dispute, le frère et la soeur se réconcilièrent d'un commun accord; la mauvaise humeur d'Irène n'avait pu tenir contre un compliment de Julien sur sa robe nouvelle, et la rancune de Julien s'était évanouie à propos d'une exclamation d'Irène sur une cravate rose.
JULIEN.
Eh bien, Irène, nous partons demain décidément, tu sais?
IRÈNE.
Oui, Dieu merci! Je crois que nous allons voyager avec Élisabeth et Armand de Kermadio.
JULIEN.
Nos petits voisins des bains de mer? Ah!...
IRÈNE.
Papa a dit l'autre jour à maman que M. de Kermadio voulait aller à Paris vers le 15 novembre. Ainsi tu vois....
JULIEN.
Ça m'est assez égal, du reste: il ne me va pas, cet Armand. Jouer, toujours jouer, c'est ennuyeux, et il ne sort pas de là; on ne peut pas causer sérieusement avec lui; d'ailleurs, il est d'une ignorance honteuse sur les timbres, et il hausse les épaules quand on parle de tailleur.
IRÈNE.
Élisabeth aussi est singulière: figure-toi qu'elle ne savait pas ce que c'était que Béreux et qu'elle n'avait jamais été à l'Éclair!...
JULIEN.
Oh!... elle est digne de son frère.
IRÈNE.
C'est dommage, vraiment! car elle est assez bonne fille!
JULIEN.
Toujours de bonne humeur.
IRÈNE.
Et très-complaisante.
JULIEN.
C'est vrai, et Armand aussi; pourtant ce sera très-ennuyeux de les voir aux Tuileries, s'ils n'ont pas bon genre comme nous!
La conversation en resta là. Le lendemain, M. et Mme de Morville quittèrent le château avec Irène et Julien. Les gens attachés à la maison les laissèrent partir sans regret, car ils voyaient à peine leurs maîtres, et les enfants avaient toujours un air dédaigneux ou ennuyé qui choquait ces braves gens.
Léonore et Amable se remirent donc gaiement au travail en se félicitant de voir partir les poupées, les lorgnons et les propriétaires de ces charmants objets, tandis qu'Irène et Julien, nonchalamment installés dans la calèche qui les emportait vers le chemin de fer, prenaient des poses gracieuses et préludaient ainsi avec bonheur aux joies qui les attendaient à Paris et en particulier aux Tuileries. Laissons-les à leurs occupations et à leurs pensées frivoles pour faire connaissance avec les petits de Kermadio.

«Chère enfant, disait Mlle Heiger à son élève, reposez-vous donc un peu: vous savez bien que je vous aiderai à faire cette robe ce soir, et vous vous fatiguez par trop, ce matin: il vaudrait bien mieux faire notre promenade accoutumée.
--Oh! chère mademoiselle, encore un quart d'heure, répondit Élisabeth, d'un ton suppliant. C'est justement parce que vous m'aiderez ce soir, que je me dépêche....
MADEMOISELLE HEIGER, souriant.
Voilà qui est curieux, par exemple!
ÉLISABETH.
Mais certainement: grâce à vous je ferai facilement la camisole qu'il m'eût fallu donner à Marthe sans être faite, et elle ne s'en serait jamais tirée, bien sûr.
MADEMOISELLE HEIGER.
Ah! comme l'ambition vient....
ÉLISABETH, riant.
En cousant! Chère mademoiselle, que vous êtes aimable de m'aider dans cette bonne oeuvre!»
Mlle Heiger se pencha vers Élisabeth et l'embrassa tendrement pour toute réponse.
ARMAND, entrant.
«Ah! ah! on s'embrasse ici?
ÉLISABETH.
Pourquoi pas, quand on s'aime.
ARMAND.
C'est très-bien, mais... il ne s'agit pas de ça.
ÉLISABETH.
Oh! mon Dieu! quel air consterné! qu'est-ce qu'il y a, Armand?
ARMAND, soupirant.
Hélas! il y a que nous partons pour Paris après-demain.»
Élisabeth échangea avec son institutrice un regard désolé.
«Déjà! dit-elle. Ah! mon Dieu, comme c'est tôt! Grand'mère ne revient à Paris que pour Noël: mes cousins de Marsy, de même. Nous serons donc seuls à Paris, jusque-là?
MADEMOISELLE HEIGER.
Que voulez-vous, chère petite! votre père a évidemment un besoin sérieux d'y retourner; nous avons, comme consolation, la perspective de visiter les nouveaux boulevards, qui sont, dit-on, magnifiques.
ARMAND.
C'est vrai, mademoiselle, mais je suis comme Élisabeth: j'aimerais mieux rester encore ici très-longtemps. C'est si amusant, la campagne! Je viens à peine de tout arranger dans mon jardin. J'espérais y récolter moi-même les salades d'hiver, et puis voilà mes autres projets dans l'eau.
ÉLISABETH.
Qu'est-ce que tu voulais faire, mon pauvre ami?
ARMAND.
Préparer avec Daniel des piéges à loups, faire une pêche de beaux coquillages pour augmenter ta collection, et enfin, organiser ma bande d'enfants bûcherons.
MADEMOISELLE HEIGER.
Comment! des enfants bûcherons? que voulez-vous dire, Armand?
ARMAND.
Il y a une masse de bois mort dans la forêt de papa, mademoiselle, et j'ai obtenu de lui que Daniel apprît à tous les enfants du village à bien faire des fagots; ça leur permettra de se chauffer tous sans dépenser un sou, et ça nettoiera les bois de papa.
ÉLISABETH, l'embrassant.
«Bon, excellent frère! c'est une charmante idée que tu as eue là.
ARMAND.
Elle est bien simple! mais je me réjouissais de les aider, et cela me fait de la peine de ne pas voir Daniel instruire son «régiment» comme il l'appelle déjà.
--Je suis bien désolée aussi, va, répliqua Élisabeth: j'espérais faire la semaine prochaine les habits d'hiver de la mère Yvonne, et j'ai à peine le temps de faire ceux de la petite Marthe.
ARMAND.
Pauvre Élisabeth! quel malheur que je ne sache pas coudre! j'aurais travaillé aujourd'hui et demain avec toi!
ÉLISABETH.
Merci, Armand, tu es bon....
MADEMOISELLE HEIGER.
Heureusement qu'Élisabeth a quelqu'un qui l'aime tendrement: ce quelqu'un a pris, sans en rien dire, les étoffes destinées à Yvonne et (elle ouvre une armoire) elle a fait les vêtements d'hiver.»
Élisabeth sauta au cou de son institutrice et l'embrassa avec effusion.
«C'est donc pour cela que vous vous en alliez de si bonne heure tous les soirs, dit-elle. Oh! bonne mademoiselle, que je vous aime, que je vous aime! C'est à étouffer de joie, cette surprise!
ARMAND.
Dis donc, Irène... je veux dire Élisabeth, sors-tu bientôt pour te promener?
ÉLISABETH.
Oui, tout de suite (riant), Julien.
--Tu m'appelles bien Irène, répliqua Élisabeth, joyeusement.
--C'est différent, dit Armand, moi je m'étais trompé; je pensais, je ne sais pourquoi, aux petits de Morville.
--Et pourquoi avez-vous l'air si contrarié de cette plaisanterie d'Élisabeth, Armand? dit alors Mlle Heiger.
--Parce que.... Julien de Morville ne me plaît pas... beaucoup, mademoiselle,» répondit Armand en hésitant.
Mlle Heiger se mit à rire.
«Voilà un petit accès d'orgueil, mon pauvre Armand, dit-elle.
--Chère mademoiselle, s'écria Élisabeth, j'ai eu tort, en effet, de plaisanter ainsi; mais franchement Julien est insupportable et je conçois qu'Armand ne veuille pas lui ressembler.--Je n'aimerais pas beaucoup de mon côté, je vous l'avoue, rassembler à Irène.
--Elle est pourtant jolie, dit Mlle Heiger gaiement, et Julien, mon cher Armand, est très-bien.
--Oui, mademoiselle, certainement, répliqua Armand avec vivacité; mais il est toujours occupé de sa personne, de sa toilette, de ses amis élégants, de son lorgnon, de ses timbres, de....
--Assez, assez, s'écria Mlle Heiger, un peu de charité, Armand!
--Moi, dit Élisabeth, je remercie le bon Dieu de ne pas être jolie comme Irène; cela dispose trop à s'occuper de ses toilettes. Celles de Marthe occupent moins....
MADEMOISELLE HEIGER, riant
Et cela vaut mieux.
--Eh bien! dit Mme de Kermadio en entrant dans la salle d'études; ne nous promenons-nous pas aujourd'hui? il faut descendre, en tout cas, mes enfants, car on sait déjà dans le village que nous partons bientôt; tous nos pauvres protégés sont venus pour vous faire leurs adieux, et vous dire combien ils regrettent de vous voir quitter sitôt la campagne.»
On descendit dans la cour et les enfants se virent entourés par une foule d'ouvriers accompagnés de leur famille. Plusieurs de ces bonnes gens avaient les larmes aux yeux.
«C'est donc déjà que vous partez? disait l'un.
--Hélas! qu'on vous a peu vus cette année! disait un autre.
--Monsieur Armand, je n'oublierai pas votre commission, s'écriait un petit garçon.... Je serai si content si je peux trouver ce qui vous fera plaisir!--Mamzelle Élisabeth, disait une bonne femme, mon casaquin va à souhait; vous êtes tout à fait habile, vous n'avez pas affaire à une ingrate, allez!--Vous reviendrez vite, n'est-ce pas? s'écriait une petite fille.
--Dépêchez-vous, disait un bûcheron; le temps nous dure joliment sans vous!
--Je crois bien, reprit-on en choeur, lorsque Kermadio est vide, le village est comme un corps sans âme....
--Merci, merci! disaient les enfants et leur mère; soyez tranquilles, mes bons amis, nous serons de retour ici le plus tôt possible.»
M. de Kermadio arriva alors; sa belle et douce figure était souriante, et il serrait cordialement les mains des rudes travailleurs qui s'empressaient au-devant de lui.
«Ne craignez rien, mes chers amis, leur dit-il, nous reviendrons dans quelques mois, car Kermadio est notre résidence favorite; nous vous aimons tous bien sincèrement et c'est une joie pour nous que d'être vos voisins et vos amis.»
Un cri général s'éleva:
«Vive notre bon Monsieur, vive la bonne madame!
--Et ses excellents enfants, ajouta une bonne femme: ils savent déjà faire le bien comme leurs parents.
--Chut! dit Mme de Kermadio, ne parlons pas de cela, mère Yvonne.
--Eh! j'en parlerai, la bonne Dame, tiens! faut-il pas que la reconnaissance m'étouffe?
--Non, non, dit Mme de Kermadio en riant: mais pour quelques petits services rendus, il ne faut pas se croire....
--QUELQUES... PETITS... services! oh! chère Dame du bon Dieu! peut-on, à ce point, oublier ses bienfaits! Était-ce un petit service que d'avoir réparé ma pauv' chaumière, hein?
--Il le fallait bien, elle tombait en ruines! dit M. de Kermadio, en souriant.
--Bon, et d'un! était-ce un petit service que d'avoir acheté ma vache malade et de m'en avoir rendu une autre, belle et bien portante; ma pauvre vieille vache a crevé chez vous quarante-huit heures après son arrivée, tandis que la vôtre me donne ses huit livres de beurre la semaine; hein! en v'là t'il un, de petit service?
--Allons, allons, mère Yvonne, au lieu de causer du passé, suivez donc Élisabeth qui vous fait signe de venir avec elle,» dit Mme de Kermadio.

Mère Yvonne obéit en grommelant: «Petits services! Bons saints du Paradis, ils ne m'empêcheront pas de dire ce que je pense, ah! mais non, da! et je le leur dirai, en face; je me gênerais peut-être pour aimer et vénérer ces bons coeurs-là....»
Le reste se perdit dans l'éloignement, et peu à peu la foule se dispersa, après avoir pris affectueusement congé des châtelains de Kermadio. On sentait de part et d'autre un vrai, un sérieux attachement, et les bons Bretons exprimaient avec effusion leurs regrets du départ, leurs espérances d'un prompt retour.
La famille fit en silence sa promenade accoutumée: chacun regrettait cette belle et paisible campagne où l'on vivait si heureux, si aimé. La mer, qui baignait la plage de Kermadio, faisait entendre son doux et incessant murmure: les grands chênes laissaient pendre leurs branches énormes jusque dans les flots et l'on respirait avec délices la brise du soir.
«Retrouverons-nous cela à Paris? dit Armand à demi-voix.
--Non, dit sa mère en l'embrassant, mais nous y verrons bientôt toute notre chère famille réunie, et ici, nous ne pouvons l'avoir, tu le sais!
--C'est cela qui me console, dit Élisabeth! Cette chère grand'mère! quelle joie de la revoir!
--Oh! oui, dit Armand, à cause de cela je suis enchanté. Jacques et Paul sont comme nous, du reste; ils aiment bien la campagne, mais ils veulent avant tout rejoindre grand'mère!
--Je crois bien! reprit Élisabeth vivement: qui est-ce qui ne l'aimerait pas cette bonne grand'mère, si bonne, si gaie, si spirituelle, si complaisante, si indulgente, si....»
Tout le monde riait en entendant Élisabeth parler avec son animation ordinaire, animation tellement augmentée par son émotion que la respiration lui manqua tout à coup.
«Il faut avouer, dit gaiement Mlle Heiger, que si votre grand'mère ne vous aimait pas, Élisabeth, elle vous ferait un vif chagrin.
--Je crois bien! dit Armand; aussi elle aime joliment Élisabeth, allez, mademoiselle!
--Et toi aussi, s'empressa de dire sa soeur.
--Oui, mais moins, répliqua Armand; et elle a raison; tu vaux mieux que moi.
--Oh! non, Armand! s'écria Élisabeth.
--Si, si! je le sais bien, va! mais je ferai des efforts pour me corriger, sois tranquille. Tiens, je fais rire papa! C'est vrai pourtant ce que je dis là, papa; je deviendrai meilleur.
--Tu prends là une excellente résolution, cher enfant,» répliqua M. de Kermadio, en serrant la main de son fils.
La promenade achevée, chacun alla faire ses préparatifs de départ. Les deux dernières soirées s'écoulèrent calmes et heureuses: Mme de Kermadio, Mlle Heiger et Élisabeth finissaient des vêtements pour les pauvres, tandis qu'on causait gaiement; une partie des veillées se passèrent à écouter une lecture amusante et instructive faite par M. de Kermadio, qui avait un rare talent de lecteur. Armand, lui, faisait des filets à poisson ou dessinait.
Enfin, le jour du départ arriva et tous, le coeur gros, quittèrent Kermadio et prirent le chemin de fer, ne pensant guère qu'ils allaient retrouver en route leurs brillants et vaniteux amis.

«Mantes, sept minutes d'arrêt....
--Cherchons un wagon vide, ou tout au moins pas trop encombré, dit Mme de Morville à son mari....
M. DE MORVILLE.
Ah! bonjour, cher monsieur de Kermadio. Vous voyagez en famille, n'est-ce pas?
M. DE KERMADIO.
Oui, nous sommes tous dans ce wagon.
M. DE MORVILLE.
C'est parfait! je vais avertir Mme de Morville: nous allons faire route ensemble, si vous le permettez.
M. DE KERMADIO.
Mais comment donc! nous en serons ravis!»
Et la famille de Morville vint s'installer avec la famille de Kermadio. Élisabeth fit une petite moue, car Mlle Heiger avait dû descendre du wagon et chercher une place ailleurs. On échangea des bonjours; puis la conversation s'engagea entre les enfants tandis que les parents causaient de leur côté.
JULIEN.
Hein, mes amis, quel bonheur pour nous de quitter enfin ces maudites campagnes?
ARMAND.
Parlez pour vous, Julien: quant à moi, je suis désolé de revenir sitôt à Paris.
JULIEN.
Sitôt, mais nous sommes au 15 novembre déjà, malheureux! Vous appelez ça, tôt?
ARMAND.
Certainement! j'avais encore mille choses à faire à la campagne, et toutes si amusantes!
JULIEN.
Lesquelles donc?
ARMAND.
Finir de soigner mon jardin, ramasser des châtaignes; faire des piéges à loups; aider les pauvres enfants à faire leur provision de bois mort pour l'hiver, aller chercher des coquilla....
JULIEN, l'interrompant.
Fi! l'horreur! mais, mon cher, vous devez user une masse de gants à faire toutes ces sales besognes?
ARMAND, riant.
Ah! ah! ah! je crois bien que j'en userais, si j'avais la bêtise d'en mettre!
JULIEN, avec dédain.
Ce sont des travaux de paysan que vous faites, alors?
ARMAND, vivement.
De paysan comme de grand seigneur. Tous les enfants de mon âge s'amusent à cela, et ils ont bien raison.
JULIEN, avec orgueil.
Pas les enfants comme il faut, mon cher.
ARMAND.
Ces enfants-là, tout comme les autres: quand Jacques et Paul sont venus à Kermadio, ils ont fait comme moi, et m'ont dit qu'à Vély ils avaient aussi leur jardin et que leurs occupations ressemblaient aux miennes.
JULIEN.
C'est possible, mais c'est bien drôle!
Pendant que les deux petits garçons causaient ainsi, Irène disait à Élisabeth: «Quelle toilette mettrez-vous cet hiver?
ÉLISABETH.
Maman ne s'en est pas encore occupée, et je n'ai pas songé à le lui demander.
IRÈNE, surprise.
En vérité! moi, je sais d'avance tout ce que je veux avoir pour moi et pour ma poupée.
ÉLISABETH.
Ce n'est pas une grande affaire que de se dire qu'on aura deux robes, l'une pour tous les jours en mérinos ou en drap, l'autre pour les dimanches, en popeline ou en alpaga.
IRÈNE.
Ciel! ma chère, croyez-vous que deux robes me suffiraient? mais j'aurais l'air d'une pauvresse!
ÉLISABETH.
Je vous assure que je n'ai que cela, et pourtant je ne me considère pas du tout comme une pauvresse!
IRÈNE, avec importance.
Moi, voici ce que j'aurai. Remarquez que c'est moi qui ai inventé les garnitures de mes toilettes.
ÉLISABETH, étonnée.
Vous avez des robes garnies? des jupes toutes simples sont bien plus commodes pour jouer.
IRÈNE.
A la campagne, à la rigueur, oui; mais à Paris, ma chère, aux Tuileries! songez donc qu'il y a un monde fou!
ÉLISABETH, riant.
Comment! il n'y a que des fous aux Tuileries? Merci pour Armand et moi qui y allons toujours.
IRÈNE.
Ne vous moquez pas, et écoutez ce que j'aurai en jolies toilettes: robe de faye....
ÉLISABETH.
Qu'est-ce que c'est que ça, de la faye?
IRÈNE, riant.
Ah! ah! ah! quelle innocente! mais c'est de la soie, ma chère, de la soie magnifique, d'un grain tout particulier.
ÉLISABETH.
Comment des grains? Ah! que ça doit être drôle!
IRÈNE.
Ah! ah! ah! quelle ignorance! cela veut dire que c'est une étoffe de choix.
ÉLISABETH, tranquillement.
Très-bien: voyez-vous, je ne me connais guère en toilettes, je laisse maman s'en occuper pour moi.
IRÈNE.
Vous avez bien tort! je reprends:
Robe de faye bleu de France avec dentelles de Cluny, blanches, sur toutes les coutures; robe de velours vert, garnie de grèbe avec casaque pareille, garnie de même.
Robe de satin gris avec brandebourgs de velours vert et épaulettes noires.
Robe de taffetas lilas avec bandes de soie gris chiné, en biais, et gilet gladiateur gris chiné, à manches.
Robe de....
ÉLISABETH.
Mais, mon Dieu, c'est tout un régiment de toilettes! et des robes simples pour les Tuileries?
IRÈNE
Mais c'est justement pour les Tuileries, ces toilettes-là.
ÉLISABETH
Vous ne pourrez jamais jouer avec ces belles choses?
IRÈNE.
Moi, par exemple! jouer sottement pour abîmer mes belles affaires; certes non, je ne jouerai pas; je me promènerai avec ma poupée qui sera aussi bien mise que moi.
ÉLISABETH, souriant.
J'ai plusieurs poupées, moi; elles marchent, parlent, rient et sont très-gentilles.
IRÈNE.
Tiens, ce doit être une mécanique qui les fait aller! qui est-ce qui vous les a données?
ÉLISABETH.
C'est le bon Dieu.
IRÈNE.
Ah! Ah! quelle plaisanterie! le bon Dieu vous donne des poupées?
ÉLISABETH.
Il me donne mieux que des poupées, puisque celles dont je vous parle et que j'appelle en riant mes poupées, sont des enfants pauvres.
IRÈNE.
Ça doit être ennuyeux, je ne ferais jamais.... Ah! mon Dieu! mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? (criant) au secours, je suis morte!
JULIEN, de même.
Miséricorde, je suis perdu...»
Le train venait de dérailler violemment et plusieurs wagons, parmi lesquels se trouvait celui contenant nos petits voyageurs, venaient de verser. Élisabeth et Armand ne criaient pas comme les petits de Morville; leur première idée avait été de rassurer leurs parents qui craignaient pour eux.
IRÈNE.
Aïe! Julien m'écrase; je suis blessée: mon sang doit couler... quel malheur! (Elle sanglote.)
JULIEN.
Ah! mon Dieu! voilà mon gilet neuf déchiré. Quel malheur!
M. DE MORVILLE.
Silence donc, mes enfants; sortez du wagon et ne dites pas de ces sottises-là!
IRÈNE, pleurnichant.
Je ne sais par où sortir! nous sommes sens dessus dessous!
MADAME DE MORVILLE.
Suis-moi, mon enfant. (Elle sort péniblement par la portière.) Tu peux bien passer par où j'ai passé moi-même, je pense.
IRÈNE, grimpant.
Ah là! là! que c'est difficile!
M. DE MORVILLE, agacé.
Ne crie pas tant: va toujours.
«Ah! mon Dieu, se mit à crier Irène, je viens de me couper la main à la glace. Que je souffre, que c'est profond! comme ça saigne! mon sang, mon pauvre sang coule! au secours!»
Et la frayeur de la petite fille était telle qu'elle tomba en pâmoison dans les bras de sa mère éperdue.
Pendant cette scène, M. de Kermadio faisait sortir du wagon sa femme et ses enfants, et hissa Julien, qui se montrait gauche et grognon.
MADAME DE KERMADIO, effrayée.
Ah! mon pauvre Armand! quelle bosse tu as au front? cela doit te faire grand mal!
ARMAND.
Un peu, maman, mais ça se passera; ne vous en tourmentez pas.
M. DE KERMADIO, inquiet.
Comme tu es pâle, Élisabeth! souffres-tu?
ÉLISABETH, sans l'écouter.
Mon Dieu! où est donc Mlle Heiger? ah! quel bonheur! la voilà qui arrive! elle n'a rien, grâce au ciel. (Elle se jette dans ses bras.)

MADEMOISELLE HEIGER.
Quelle joie de nous retrouver tous sains et sauf! (Avec terreur.) Ah!
MADAME DE KERMADIO, effrayée.
Qu'y a-t-il donc?
MADEMOISELLE HEIGER.
Mais vous êtes blessée, chère Élisabeth? oh! madame, regardez, quelle affreuse plaie au bras! comme elle saigne, mon Dieu! et les éclats de verre qui sont dans la plaie....
ÉLISABETH.
Ce n'est rien, chère mademoiselle: n'effrayez pas maman, je vous en prie: en tombant la glace s'est brisée sous mon bras.
--Comment, dit Mme de Kermadio inquiète, tu es blessée, mon enfant!
ÉLISABETH, souriant.
Un peu, mais ce bobo n'est rien auprès de ce qu'ont les autres.
Sa mère et son institutrice se regardaient avec émotion, tout en pansant avec soin le bras de cette courageuse enfant.
MADAME DE MORVILLE, tristement.
Regarde, Irène, compare ta petite coupure à la blessure d'Élisabeth, ta frayeur à son courage, et dis-moi si Mme de Kermadio ne doit pas être aussi fière de sa fille que je le suis peu de la mienne.
Les pleurs d'Irène s'étaient séchés depuis la découverte de la blessure d'Élisabeth: elle répondit à demi-voix:
«C'est vrai, maman, mais elle a six mois de plus que moi.»
Mme de Morville secoua la tête sans rien dire. Élisabeth, une fois pansée, avait pris un petit carré de taffetas d'Angleterre et l'offrit à Irène.
«Tenez, Irène, lui dit-elle en souriant, mettez cela sur votre coupure, ça empêchera l'air de l'envenimer davantage.
--Merci, ma bonne, ma chère Élisabeth, dit Irène émue, en l'embrassant: vous êtes bien aimable de songer à moi dans un pareil moment.»
On venait de relever les wagons, qui n'étaient qu'à demi renversés sur un talus; les voyageurs aidaient de très-bonne grâce les employés du chemin de fer, afin de pouvoir faire repartir le train avec une locomotive de rechange qui venait d'arriver.
Armand, sans penser à sa meurtrissure au front, aidait de tout son coeur avec son père. Quand il s'agit de relever les wagons, il donna l'idée de mouiller les cordes avec lesquelles on tirait les voitures, afin qu'elles eussent plus de solidité.
«Julien, viens donc nous aider! cria M. de Morville.
--J'ai des courbatures, répondit Julien d'une voix larmoyante; je n'en peux plus, papa! (Il se disait à part lui: Comme Armand est sale, je serais comme lui si j'aidais aussi.)
--Paresseux! dit son père, l'exemple de ton ami devrait t'encourager, au contraire! Il a le même âge que toi, et vois comme il nous aide!
--Je crois bien! s'écria le chef du train; ce petit monsieur-là a déjà un solide poignet et une rude intelligence: avec ça, serviable et gai. Son père doit être fier de lui!»
Les derniers préparatifs se terminèrent enfin, à la joie générale. On remonta dans le train, et les deux familles, arrivées à Paris, se séparèrent en se disant à revoir; Irène et Julien, très-honteux d'eux-mêmes et jaloux intérieurement de la supériorité de coeur, de courage et d'intelligence que venaient de montrer les petits de Kermadio.

«Êtes-vous prête, mademoiselle Irène?
--A l'instant, Zélie. Mon toquet? bien; attendez! mon chignon penche trop à gauche. Qu'il est désagréable, ce Leroy, de ne pas me l'avoir fait à boucles! J'en demanderai un à boucles à maman. Les coques de celui-ci sont trop sérieuses, trop lourdes pour ma figure. Mes gants, Zélie; non, pas les foncés, les gris clair tout neufs: oui, ceux-là; dépêchez-vous donc, vous êtes d'une lenteur qui me porte sur les nerfs.»
Irène mit ses gants, les boutonna avec soin, puis jeta un regard triomphant sur l'armoire à glace qui lui montrait sa petite personne tout entière.
Toque de velours vert, ornée de grèbe, robe et casaque pareille à la toque, gants gris, bottes vernies à glands d'or, manchon de grèbe, telle était la toilette d'Irène: elle avait de plus une coiffure des plus savantes, compliquée de cet énorme chignon à coques bouffantes qu'elle trouvait trop sérieux. Ainsi arrangée, Irène avait perdu la grâce et la naïveté de son âge: elle paraissait si peu naturelle et même si ridicule, que Zélie ne put s'empêcher de marmotter entre ses dents:
«Quelle pitié de laisser ainsi des enfants s'attifer en chiens fous!»
Au même instant, Julien fit son entrée dans la chambre. Il était aussi pimpant que sa soeur, et jouait négligemment avec son fameux lorgnon.
«Allons donc, lambine, s'écria-t-il, en route pour les Tuileries; j'ai des rendez-vous d'affaires, et mes acheteurs de timbres doivent s'impatienter.
--Je suis prête. Zélie, ma poupée! Partons maintenant,» dit Irène, se regardant une dernière fois avec complaisance dans la glace.
En disant ces mots, elle prit le bras que lui offrait son frère et se dirigea avec lui vers ces chères Tuileries, où leur vanité devait être satisfaite. Il y avait déjà beaucoup de monde quand ils arrivèrent: leurs riches toilettes, leurs charmantes figures, leurs tournures élégantes firent sensation. Julien, que ce succès évident gonflait d'orgueil, se mit à pérorer dans un groupe de petits garçons, tandis qu'Irène allait échanger des poignées de main et de gracieuses révérences avec quelques élégantes qui l'accueillirent avec empressement, quoique sa toilette excitât visiblement leur jalousie.
JULIEN.
Bonjour, Jordan; où est votre frère?
JORDAN.
Chut! il fait une rafle de timbre Guatemala à un petit imbécile qui n'en connaît pas la valeur. Le voyez-vous en conférence là-bas?
JULIEN.
Bravo! part à trois, n'est-ce pas?
JORDAN.
Bien entendu! Il y a de nouveaux venus aujourd'hui qui veulent faire les fendants; il s'agit de leur colloquer tous nos fonds de magasin. Chargez-vous donc de ça, Julien; vous vous y entendez comme pas un.
JULIEN.
Compris! (Il s'approche des arrivants.) Bonjour, messieurs; vous me voyez ravi: je viens de recevoir quelques timbres allemands fort rares. Voulez-vous les voir?
--Certainement, voyons donc ça! s'écrièrent les pauvres innocents.
Julien ouvrit avec précaution un portefeuille-album rempli de timbres de toute espèce.
«Voilà, dit-il.
UN PETIT GARÇON.
C'est très-joli, très-curieux! Voulez-vous m'en céder deux ou trois?
LES AUTRES.
A nous aussi, n'est-ce pas?
JULIEN, feignant d'hésiter.
C'est que... ça ne peut être acheté que par des gens très-riches, vu qu'ils sont très-chers.
UN PETIT GARÇON.
Ça nous va; nous avons de l'argent.
JULIEN.
Chaque timbre vaut quatre francs. Ce serait de la folie d'en prendre plus d'un.
LE PETIT GARÇON, avec orgueil.
J'en prends trois! (Il paye Julien.)
LES AUTRES.
Nous aussi. Donnez, voilà l'argent.
JULIEN.
Merci. A votre service, mes chers amis. J'en ai d'autres à votre disposition.»
Les petits garçons s'éloignèrent pour montrer à tout le monde leurs acquisitions.
«Eh bien, dit Julien à Jordan, ai-je mené ça lestement?
--Admirable, mon cher, répondit Jordan, vous avez le génie des affaires. Ah! voilà Jules qui arrive. Eh bien, ces Guatemalas?
--Les voilà, dit triomphalement Jules, en ouvrant son carnet.
--Sabre de bois! dit Julien, trente-deux! Quel trésor! Et combien avez-vous payé ça, Jules?
--Devinez, dit Jules en se croisant les bras.
--Seize francs? dit Jordan.
--Moins.
--Je parie, s'écria Julien, qu'il aura échangé ça contre des français!...
--Juste!» dit Jules en se frottant les mains. Jordan et Julien éclatèrent de rire.
«Il a été un peu bien enfoncé, allez! continua Jules avec orgueil. Je le voyais compter ses guatemalas quand je l'aborde tout à coup, et je lui dis: «Tiens, vous aussi, vous avez des timbres?
--Oui, dit Ernest, ils sont rares, n'est-ce pas?
--Rares, ces timbres-là? pas le moins du monde.
--Alors je ne trouverai pas à les échanger facilement?
--Je ne pense pas.
(Voilà un garçon qui a les larmes aux yeux en m'entendant.)
--Allons, lui dis-je, vous n'avez donc que cela dans votre bourse pour faire si triste mine?
--Oui, répondit-il piteusement.
--Tenez, je suis bon enfant et j'ai de l'argent, par-dessus le marché. Donnez-moi ces saletés-là, je vous offre en échange des timbres français tout neuf. Ça vaut de l'argent comptant ça.»
Il était ravi, l'imbécile! Nous avons fait l'échange et voilà.
Jordan et Julien riaient comme des fous à ce récit.
JULES.
Ah! voilà Vervins: écoutez un peu mon exploit, Vervins.
Et il se mit à lui raconter la tromperie qu'il venait de faire. Laissons-les à leur conversation et allons retrouver Irène et ses amies.
IRÈNE.
.... Vois-tu, Constance, le vert et le bleu ne vont pas ensemble: ça jure trop, ces couleurs-là; demande plutôt à Noémi qui arrive. Bonjour, ma chérie. Oh! la délicieuse toilette que tu as là.
NOÉMI.
La tienne la vaut bien, mon coeur. Ah! par exemple, ta poupée est la reine des Tuileries aujourd'hui! l'amour de costume! C'est de chez Béreux?
IRÈNE.
Je prends tout chez elle, tu sais.
NOÉMI.
Bonjour, Constance, bonjour, Herminie, vous allez bien?
Noémi, en disant cela, voulut embrasser ses amies, mais elles se reculèrent vivement.
«Prends garde à mon rouge! dit Constance.
--Prends garde à ma poudre de riz! dit Herminie.
--Tiens, c'est vrai, dit Noémi, surprise; je n'avais pas va que vous étiez peintes.
--Peinte toi-même, dit Constance avec colère pour un peu de rouge, faut-il crier des choses pareilles!
--Et pour quelques pincées de blanc, ajouta Herminie, ce n'est pas la peine de s'étonner.
--J'imite maman, d'ailleurs, reprit Constance
--Et moi aussi, dit Herminie, c'est si naturel! N'est-ce pas, Irène?
--Certainement, répondit cette dernière, et pas plus tard que demain, je ferai comme vous.
--Moi pas, dit Noémi: ça me gênerait pour me faire embrasser par maman.»
Constance et Herminie éclatèrent de rire.
«Elle t'embrasse donc souvent, ta mère! s'écrièrent-elles.
--Certainement, dit Noémi étonnée; les vôtres n'en font-elles pas autant?»
Constance secoua la tête.
«Je vois maman deux ou trois fois par semaine, dit-elle.
.... Bonjour, maman.
--Bonjour, petite.
--Va chez ta bonne, je suis pressée de sortir.... Et voilà.
--Et elle ne t'embrasse pas? dit Noémi enjoignant les mains.
CONSTANCE.
Elle n'y pense jamais.
NOÉMI.
Ça doit te faire beaucoup de peine?
CONSTANCE, avec insouciance.
Non, j'y suis habituée, ça ne me fait plus rien.
HERMINIE.
Moi, j'ai une maman qui joue très-bien du piano, et qui chante très-bien, malheureusement pour moi; car lorsqu'elle ne va pas jouer ou chanter dans le monde, elle passe tout son temps à étudier sans jamais s'occuper de moi. Je vais au cours avec ma bonne, mais dans les moments où je suis seule et où je ne travaille pas, je m'ennuie à la mort.
NOÉMI.
Et toi non plus, ta mère ne t'embrasse pas?
HERMINIE.
Si, quelquefois, elle me baise le front; mais elle a toujours l'air distrait, alors ça ne me fait pas plaisir. Ah! bah! parlons d'autre chose; voulez-vous faire faire des visites par nos poupées, ce sera amusant et cela ne nous chiffonnera pas.
LES PETITES FILES.
C'est cela! c'est une bonne idée!»
Elles organisèrent ce semblant de jeu et furent bientôt absorbées par le plaisir de faire parler et saluer leurs poupées.
Pendant qu'Irène et Julien se dirigeaient vers les Tuileries, Élisabeth et Armand se préparaient aussi à s'y rendre.
«Viens-tu, Élisabeth? dit Armand en mettant son chapeau.
--A l'instant, répondit sa soeur, je prends ma poupée et je suis à toi.
--Elle n'est pas très-neuve, dit Armand en examinant la figure fanée et les vêtements modestes de la poupée.
ÉLISABETH.
Bah! elle m'amuse tout autant qu'une belle. Anna, voulez-vous venir, je vous en prie, nous sommes prêts. Adieu, chère maman, adieu, bonne mademoiselle, je suis bien fâchée que votre mal de tête vous empêche de venir avec nous aujourd'hui.»
Et les enfants, après avoir embrassé leur mère, se dirigèrent gaiement, suivis de leur bonne, vers les Tuileries.
«Ah! quel bonheur, voilà Irène, s'écria Élisabeth en arrivant. Je vais pouvoir jouer avec elle, au revoir, Armand.
Au revoir, Élisabeth, moi je vais rejoindre Julien que j'aperçois là-bas. Anna, asseyez-vous là, je vous en prie; je vous promets de ne pas jouer hors de l'allée de Diane.
ANNA.
Bien, monsieur Armand; j'y compte.»
Élisabeth avait couru vers Irène et lui avait tendu la main.
«Bonjour, chère amie, dit-elle, avec son bon sourire, me voilà guérie et prête à jouer. Voulez-vous de moi et de ma poupée?
IRÈNE, embarrassée.
Bonjour, Élisa... bonjour, mademoiselle, je vais demander à ces demoiselles si elles veulent bien vous laisser jouer avec elles.
CONSTANCE, à demi-voix.
Non, certainement. Voyez quelle toilette a cette petite! Quelle misérable robe de drap bleu, sans garnitures, et des brodequins pas vernis! Je ne veux pas d'elle, Irène.
HERMINIE, de même.
Ni moi non plus, Constance a raison; et puis, voyez, ma chère, comment pourriez-vous jouer convenablement avec elle! Sa poupée est si mal mise! renvoyez-la.
NOÉMI, de même.
Pourquoi? Elle-a l'air très-bon, gai et intelligent. Essayez de jouer avec elle, croyez-moi.

--Non, non, reprirent aigrement Constance et Herminie, nous n'en voulons pas.»
Élisabeth, à quelques pas seulement du petit groupe, avait presque tout entendu: elle devint rouge, jeta à Irène toute confuse un regard de reproche et s'éloigna rapidement.
NOÉMI, étonnée.
Eh bien, elle s'en va comme cela? Est-elle drôle, cette petite fille!
CONSTANCE.
Oh! laissez-la tranquille: c'est inouï d'oser vouloir jouer avec nous quand on a une toilette pareille!
HERMINIE.
Vous la connaissez donc, Irène? Elle paraissait très-familière avec vous: ce n'est pas une brillante connaissance que vous avez là, ma chère! Tâchez donc de vous en débarrasser.
CONSTANCE.
C'est bien dit. Vous avez eu joliment raison de l'appeler Mademoiselle: ça lui apprendra à vous respecter.
NOÉMI.
Je ne suis pas de votre avis; mais bah! elle est partie; n'y pensons plus et jouons. Eh bien! Irène, quel air pensif?
IRÈNE, tressaillant.
Ce n'est rien, oui, jouons; cela me distraira et me fera oublier cette ennuyeuse voisine.
Une scène semblable se passait entre Julien et Armand. Celui-ci, arrivé près de Julien, s'était vu repoussé avec le plus froid dédain. Indigné, il dit nettement à Julien sa façon de penser sur sa conduite, puis il alla rejoindre la pauvre Élisabeth, qu'il trouva pleurant amèrement près d'Anna. Ils se racontèrent mutuellement ce qui leur était arrivé et se promirent bien de ne plus s'approcher des deux orgueilleux qui avaient été si impertinents à leur égard: Anna leur fit acheter des plaisirs, cela les consola un peu, et, leur goûter fini, ils reprirent le chemin de la maison, pressés qu'ils étaient de raconter à leur mère leurs tristes aventures.

A leur grande joie, les enfants trouvèrent Mme de Kermadio seule dans le salon.
«Eh bien! mes enfants, quel air consterné, leur dit-elle, vous est-il arrivé quelque accident?
ÉLISABETH.
Non, maman: pas d'accident; mais nous avons eu du chagrin....»
Et en achevant ces mots, le coeur de la pauvre Élisabeth lui manquant, elle fondit en larmes.
«Qu'y a-t-il donc, chère enfant? reprit la mère, en attirant sa fille à ses côtés. Voyons, Armand, toi qui es plus calme, explique-moi ce qui est arrivé, car cela m'inquiète! Élisabeth ne pleure jamais sans motif grave, et toi, mon pauvre enfant, je vois que tu as les larmes aux yeux. Assieds-toi là, et parle.»
Armand ne se le fit pas dire deux fois: il raconta tout d'une haleine ce qui s'était passé aux Tuileries; la froideur d'Irène, l'impertinence de ses amis, la grossièreté de Julien, tout fut dépeint en traits de feu. Élisabeth, qui s'était calmée, compléta le récit.
«Hein, maman, que pensez-vous de ces gens-là?» dit Armand en finissant.
Et il se croisa les bras en regardant sa mère d'un air si formidable, que celle-ci ne put s'empêcher de sourire.
MADAME DE KERMADIO.
Je vais probablement te choquer, Armand, si je dis franchement ce que je pense de ces gens-là?
ARMAND.
Me choquer, vous maman? oh non, jamais, vous le savez bien!
MADAME DE KERMADIO.
Eh bien, Armand, pour te dire toute ma pensée, je les plains, oh! mais de toute mon âme.
Armand resta interdit.
«Je vous comprends, chère maman, s'écria Élisabeth, et je veux faire comme vous.
--Dame! moi aussi, dit Armand en se grattant l'oreille, quoique ce soit très-difficile; car je leur en veux terriblement, savez-vous, maman!
MADAME DE KERMADIO.
Non, mon ami.
ARMAND, surpris.
Comment, non, maman! vous avez mal entendu mes derniers mots; j'ai dit que....
--J'ai très-bien entendu, très-bien compris, dit Mme de Kermadio en souriant, mais je te connais trop bien, mon cher Armand, pour ne pas savoir que tu leur pardonnes du fond du coeur, quoi que tu dises. Voyons, si Julien souffrait et t'appelait à son secours maintenant, irais-tu?
ARMAND, avec élan.
Oh oui! maman, sans hésiter.
MADAME DE KERMADIO.
Tu vois bien, cher petit, que ton coeur pardonne déjà sans se douter de sa générosité. Ne pense plus à cela, crois-moi, et accepte cette petite humiliation comme un bon coeur chrétien doit le faire. Élisabeth a déjà pris son parti là-dessus. Regarde-la plutôt.»
Élisabeth s'était peu à peu consolée pendant que sa mère parlait; elle n'avait pu remarquer sans sourire, l'attitude rageuse, puis repentante de son brave petit frère. Les sourcils d'Armand étaient encore froncés, mais il avait la tête basse et semblait si drôle à voir, partagé entre la colère, la bonté et le regret, que sa soeur n'y put tenir et cacha sa figure dans son mouchoir pour rire tout bas à son aise.
En la regardant, Armand éclata de rire, ce qui permit à Élisabeth d'en faire autant, sans se gêner.
Leur conversation finit gaiement. Le frère et la soeur consolés, organisèrent immédiatement des promenades instructives et amusantes, destinées à leur faire bien connaître Paris. Ils visitèrent les nouvelles magnificences qu'ils n'avaient pas vues, les nouveaux boulevards, le parc Monceaux, le bois de Vincennes, Notre-Dame restaurée, la Sainte-Chapelle: toutes ces intéressantes excursions les menèrent jusqu'au moment où leurs cousins de Marsy arrivèrent à Paris, et un beau matin, ils virent, à leur grande joie, Jacques, Paul, Jeanne et Françoise de Marsy se précipiter dans leurs bras. Cousins et cousines étaient enchantés de se revoir: ils organisèrent des promenades en commun et projetèrent des parties admirables aux Tuileries.
Dès le lendemain, en effet, tous se rendirent à l'allée de Diane, et là on se mit à jouer à cache-cache. C'était d'autant plus amusant qu'il y avait peu de monde ce jour-là: aussi les enfants couraient-ils de tout leur coeur et de toutes leurs forces. Dans une de ses courses, Élisabeth heurta une petite fille qui était assise toute seule à l'écart.
ÉLISABETH.
Pardon, mad... Oh! Irène....

IRÈNE, embarrassée.
Ce n'est rien, Élisabeth, vous ne m'avez pas fait mal.
Élisabeth sembla hésiter, rougit un peu, puis se rapprochant d'Irène, elle reprit:
«Pourquoi ne jouez-vous pas, Irène?
--Parce que je suis toute seule! répondit tristement l'élégante.
--Cela vous amuserait-il de jouer avec nous? dit Élisabeth, d'un ton affectueux.
--Oh oui! dit Irène, en baissant la tête, mais je ne sais pas... ce ne serait pas agréable pour....
--Pour qui? dit Élisabeth en souriant.
--Pour vous, dit Irène à voix basse. J'ai été si froide, si impolie pour vous, pauvre Élisabeth, il y a trois semaines; vous devez certainement m'en vouloir.
--Irène, dit Élisabeth, d'un ton sérieux, il y a dans le Pater: «pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés;» je vous en voulais d'abord, mais maintenant je vous pardonne, et de toute mon âme.
--Ah! merci, Élisabeth, s'écria Irène, les larmes aux yeux, c'est bien, c'est beau ce que vous faites et ce que vous dites là: accordez-moi votre amitié, je vous en prie; j'ai tant besoin, je le vois maintenant, de bons conseils et de bons exemples!
--De tout mon coeur, chère Irène, dit Élisabeth en l'embrassant.
--Alors, au lieu de jouer, causons encore un peu, je vous en prie, dit Irène en se rasseyant.
ÉLISABETH, s'asseyant.
Très-volontiers. Voyons, de quoi voulez-vous causer?
IRÈNE.
Racontez moi votre vie; elle doit être plus intéressante que la mienne: vous êtes toujours contente, gaie, en train, tandis que je m'ennuie sans cesse: à quoi cela tient-il?
ÉLISABETH.
J'aime, je suis aimée, et je m'occupe toujours: voilà le secret.
IRÈNE.
Expliquez-moi cela, je vous en prie, chère Élisabeth?
ÉLISABETH.
Je travaille avec mon institutrice, puis je m'occupe avec maman.
IRÈNE, pensive.
C'est une vie très-austère, mais que vous savez rendre agréable.
ÉLISABETH.
Je ne la rends pas agréable, vu qu'elle l'est par elle-même!
IRÈNE.
C'est pourtant bien plus amusant de s'occuper de toilettes et de promenades, de ne travailler que lorsque cela fait plaisir.
ÉLISABETH.
Et cependant vous vous ennuyez sans cesse, tandis que ma vie austère, comme vous l'appelez, m'empêche de jamais m'ennuyer: laquelle vaut mieux?
IRÈNE.
Ah! la vôtre, je le vois, mais il faut du courage pour changer toutes ses habitudes, et... je n'en ai guère.
ÉLISABETH, riant.
On ne peut pas changer tout d'un coup: essayez tout doucement de devenir laborieuse et vous verrez comme vous serez contente; pour commencer, je vais vous donner deux conseils. Oh! je suis terrible quand j'aime quelqu'un, je vous en préviens, et je veux vous changer.
IRÈNE, l'embrassant.
Voyons les conseils?
ÉLISABETH.
A votre place, je penserais souvent à Dieu, et je tâcherais d'être bonne et aimable pour mes parents, pour mon frère et pour ceux qui m'entourent; voulez-vous suivre ce conseil?
IRÈNE.
Il est très-bon: j'essayerai, je vous le promets.
ÉLISABETH.
Très-bien. Et puis, à votre place, moi, je m'occuperais.
IRÈNE.
Ah! voilà le terrible; tout m'ennuie!
ÉLISABETH.
Même le piano, sur lequel vous êtes déjà si forte?
IRÈNE.
Cela moins que le reste.
ÉLISABETH.
C'est un commencement: cultivez votre talent, déjà si beau! perfectionnez-le, étudiez à des heures régulières, chose très-importante: vous verrez que peu à peu, vous vous intéresserez à autre chose et que vous finirez par....
ARMAND, accourant.
Élisabeth, Élisa..., oh! mademoiselle Irène.... (Il salue.)
IRÈNE.
Dites Irène tout court, s'écria la petite fille en lui tendant la main: j'ai demandé pardon à Élisabeth de ma grossièreté, et elle veut bien m'aimer encore.
ARMAND.
J'en suis enchanté, Irène: vous êtes une bonne enfant de convenir de vos torts; cela me raccommode tout à fait avec vous.--Où est Julien?
IRÈNE.
Là-bas, sous les quinconces: il s'ennuie, car il est tout seul et ne sait que faire.
A peine Armand eut-il entendu ces mots qu'il partit comme un trait et alla trouver Julien qui se promenait en bâillant. Le petit de Morville fut agréablement surpris des avances d'Armand et s'y montra très-sensible. Quand les enfants se quittèrent, tous étaient dans le meilleur accord du monde, et lorsque les petits de Kermadio, les yeux brillants de joie, racontèrent à leur mère ce qui s'était passé aux Tuileries, le tendre et long baiser qu'ils reçurent les récompensa amplement de leur généreuse conduite.

Irène, de retour à la maison, essaya courageusement de suivre les bons conseils d'Élisabeth. Elle se mit donc au piano, décidée à y consacrer une heure avant le dîner. Malheureusement pour ses bonnes résolutions, elle était à peine depuis un quart d'heure à étudier lorsque Noémi entra conduite par Julien.
NOÉMI.
Quelle ardeur de travail, chérie, c'est superbe! peut-on vous interrompre?
IRÈNE.
Vous êtes toujours la bienvenue, ma bonne Noémi.
JULIEN.
Surtout comme messagère de bonnes nouvelles.
IRÈNE.
Ah! qu'y a-t-il de nouveau, Noémi?
NOÉMI.
D'abord un bal chez maman pour mardi, chère amie, ainsi préparez vos toilettes et celles de votre poupée.
IRÈNE, avec joie.
C'est charmant. Quel bonheur! je vais me faire éblouissante pour vous faire honneur!
JULIEN.
Ce n'est pas tout! devine ce qu'il y aura dans quinze jours chez Mlle Noémi?
IRÈNE, intriguée.
Un bal costumé?
NOÉMI.
Bien mieux que ça!
IRÈNE.
Un bal en dominos?
NOÉMI.
Vous n'y êtes pas!
IRÈNE.
Un déjeuner de cérémonie?
JULIEN.
Elle ne devinera jamais, mademoiselle. Faites lui grâce!
NOÉMI, riant.
Vous avez raison. Nous jouerons la comédie chère mignonne, et je compte sur vous, comme sur monsieur Julien, pour jouer avec moi une opérette.
IRÈNE.
Ah! quelle joie! (Elle embrasse Noémi.) Que vous êtes donc bonne et gentille!
NOÉMI.
Acceptez-vous?
IRÈNE.
Comment pouvez-vous me faire une pareille question! Avec transport, avec enthousiasme! Que jouerons-nous?
NOÉMI, sans l'écouter.
Nous serons en bergères: costumes Watteau, poudre, mouches, guirlandes de fleurs, houlette et des flots de rubans. Ce sera délicieux!
JULIEN.
Et moi, comment serai-je?
NOÉMI.
En Prince Charmant.
JULIEN, radieux.
Comme c'est aimable à vous, mademoiselle, de m'avoir choisi ce rôle; je suis sûr qu'il me conviendra très-bien!
NOÉMI.
A présent, je me sauve. Tenez, voici vos rôles et les gravures pour vos costumes. Apprenez les rôles, commandez vos toilettes, et venez répéter tous les jours chez moi à deux heures. A demain!
Restés seuls, le frère et la soeur se félicitèrent de la brillante perspective qui s'ouvrait devant eux; leur vanité se réjouissait à l'idée de paraître au bal et surtout de jouer la comédie. Les bonnes résolutions qu'Irène avait rapportées de sa conversation avec Élisabeth s'évanouirent rapidement, et elle fut bientôt aussi absorbée que son frère par les répétitions, les costumes et les mille soucis qu'entraîne ce genre de plaisir.
Irène avait pourtant gardé la volonté de faire ce que lui avait conseillé son amie, et elle trouva moyen d'étudier presque chaque jour son piano. Souvent aussi, elle réprima des mouvements d'humeur; elle se retint dans son impatience en songeant à Élisabeth, et quoiqu'elle allât peu aux Tuileries, préoccupée qu'elle était par son rôle et ses toilettes, elle se montra empressée et affectueuse avec la petite de Kermadio pendant le peu d'instants que lui laissaient ses répétitions. Élisabeth, jugeant inutile de lui donner d'autres avis dans l'état de fièvre où elle la voyait, se contenta d'être très-amicale.
Le jour du bal, Irène, le coeur palpitant, vit arriver Leroy qui devait la coiffer à midi, car il était demandé partout et n'avait pu accorder que cette heure matinale. Irène, malgré les observations de sa mère, avait voulu Leroy quand même, et se condamna au supplice d'être mal à l'aise toute la journée pour ne pas déranger sa coiffure.
Leroy se surpassa: la jolie figure d'Irène rayonnait d'orgueil quand le célèbre coiffeur se recula en disant:
«C'est fini et c'est charmant. Je puis faire aussi bien, mais mieux, c'est impossible!»
Irène avait, en effet, une délicieuse coiffure. Ses beaux cheveux blonds étaient ondulés et relevés en bandeaux capricieusement disposés. Des flots de boucles s'échappaient de son peigne orné de turquoises; des guirlandes de myosotis étaient disposées sur sa tête et, lui entourant le cou, formaient un délicieux collier de fleurs tenant à la coiffure. Irène, radieuse, remercia Leroy de tout son coeur, et, l'avouerons-nous, elle s'installa devant sa psyché pour jouir toute la journée du spectacle de sa belle coiffure: elle passa ainsi son après-midi, faisant des grâces, s'admirant sans cesse, et ne pensant plus guère à Élisabeth et aux bonnes résolutions que celle-ci lui avait fait prendre. Le soir venu, Irène mit avec bonheur une robe de tarlatane bleue, relevée par des bouquets de myosotis; la berthe du corsage était couverte des mêmes fleurs, et ses petits souliers de satin bleu avaient pour bouffettes une touffe de myosotis. Julien n'était pas moins beau que sa soeur: il avait un habit à la française, un gilet blanc, une culotte courte, des bas de soie blanche et des souliers à boucles. Lui et ses amis s'étaient donné le mot pour imiter le costume de cour.
M. et Mme de Morville étaient fiers de leurs charmants enfants. Leurs louanges imprudentes achevèrent d'exalter la vanité d'Irène et de Julien. Si l'on avait pu voir leurs âmes, on aurait été effrayé des défauts qui s'y épanouissaient rapidement; mais on ne pensait qu'à leurs corps, et les idées sérieuses étaient malheureusement écartées par tous, comme des pensées importunes.
L'entrée dans le bal fut triomphante: Constance, Herminie et d'autres élégantes des Tuileries se retrouvaient là; elles jetèrent sur Irène des regards d'envie, de jalousie, de colère, qui charmèrent la vaniteuse enfant comme le plus flatteur des hommages. Ce fut elle qui dansa le plus gracieusement: elle eut la joie d'entendre Mme de Valmier, la mère de Noémi, la prier de danser une mazourka avec Julien, et là encore leur triomphe fut éclatant et complet. De tous côtés, les épithètes de «charmants, adorables, délicieux,» venaient frapper leurs oreilles ravies; Julien partageait les succès d'Irène et sa joie orgueilleuse; jamais leurs sourires n'avaient été si doux, leurs regards si brillants, leurs démarches si gracieuses: ils se sentaient admirés, ils étaient heureux! Un dernier succès vint enivrer Irène: Constance dut jouer une valse pour obéir à un caprice de Noémi; elle s'embrouilla bientôt et s'arrêta rouge, confuse et prête à pleurer.

«Tu ne te rappelles pas bien ta valse, dit alors Irène d'un air moqueur; laisse-moi jouer à ta place, Constance: j'en sais une plus jolie.»
Constance, dépitée, lui céda sa place, et Irène, surexcitée par la vanité, se mit à exécuter une des plus belles, mais des plus difficiles valses de Schulhoff. Elle la joua avec une telle perfection que les bravos éclatèrent quand elle eut fini et que l'attention se détourna de Noémi pour se reporter sur la jolie pianiste.
De nouveau, mille compliments vinrent pleuvoir sur Irène, devenue la reine du bal, et ce fut dans l'enivrement de l'orgueil et de la vanité, que la petite fille et son frère se retirèrent avec leurs parents à la fin de la soirée.
Ces triomphes dangereux eurent le triste résultat de replonger le coeur et l'esprit d'Irène dans des idées de frivolité et de toilette. Elle négligea Élisabeth, car elle sentait au fond du coeur que son amie devait la blâmer, et elle se jeta à corps perdu dans les mille distractions que lui offraient ses costumes à essayer et ses répétitions.
Un jour, pourtant, Élisabeth l'arrêta au moment où elle passait dans les Tuileries d'un pas rapide pour se rendre chez Noémi.
ÉLISABETH.
Je ne vous vois presque plus, ma chère Irène. Que devenez-vous donc?
IRÈNE, embarrassée.
Ma bonne Élisabeth, vous êtes bien gentille de vous être aperçue de cela! Je suis un peu absorbée par Noémi, c'est vrai!
ÉLISABETH, souriant.
Un peu, et même beaucoup! Est-elle malade?
IRÈNE, rougissant.
Non, Dieu merci; mais nous allons jouer la comédie et je vais répéter chez elle.
--Ah! dit Élisabeth.
Ce ah! était si triste qu'Irène se sentit tout à fait mal à son aise. Il y eut un moment de silence.
«Il faut que je me sauve, je suis en retard, reprit Irène, d'un air contraint; à revoir, Élisabeth.
ÉLISABETH, soupirant.
Au revoir, ma chère Irène.»
Ce soupir fut désagréable à Irène: elle quitta brusquement Élisabeth et se dirigea, suivie de sa bonne, vers la maison de Noémi. Cette répétition était la dernière. Irène dut faire quelques efforts pour ne pas être distraite et bien jouer. Malgré elle, les quelques paroles d'Élisabeth revenaient à sa mémoire: elle en chassa le souvenir, non sans peine; mais le soir venu, au moment de s'endormir, elle y repensa encore et se mit à pleurer. Elle ne savait trop pourquoi, elle se sentait la conscience mal à l'aise: elle se tranquillisa un peu on se disant qu'au bout du compte, elle n'était pas forcée de préférer Élisabeth à Noémi. Là-dessus, elle finit par s'endormir. Le lendemain, son joli costume la consola très-vite de son chagrin et ce fut en sautant de joie qu'elle s'habilla pour la comédie.
Julien n'était pas moins joyeux que sa soeur. Il courut chez elle, à peine habillé, sous prétexte de la voir, mais en réalité pour recevoir des compliments.
Ils partirent avec leurs parents, et ce soir-là, comme le jour du bal, ils eurent une série de triomphes des plus flatteurs pour leur amour-propre.

Le lendemain de cette brillante soirée, Irène et Julien étaient très-fatigués et plus tristes encore que fatigués. L'étourdissement de la fête passé, leur conscience leur reprochait vaguement quelque chose: c'est trop souvent en flattant des défauts de toute espèce que l'on se procure un amusement imparfait et passager.
C'était cela qui troublait les petits de Morville; aussi étaient-ils fort maussades et virent-ils arriver avec plaisir le moment d'aller se promener aux Tuileries.
Ils espéraient y rencontrer Noémi et leurs autres amis, afin de parler de leur soirée de la veille, mais aucun d'eux n'y était. En revanche ils y trouvèrent Élisabeth et Armand sans leurs cousins. Rien ne pouvait leur être plus désagréable que la vue de leurs amis de Kermadio, ce jour-là: ils se sentaient sérieusement blâmés par eux, leur conscience leur disait qu'ils étaient blâmés avec raison, et cela leur causait une grande gêne.
Ils furent donc agréablement surpris quand Élisabeth les aborda en leur disant:
«Bonjour, mes amis; je n'ai qu'une demi-heure à rester aux Tuileries, aujourd'hui: j'en suis désolée, car je ne vous vois presque plus.
ARMAND.
Moi aussi. Eh bien! prince Charmant, il paraît que vous avez joué à merveille hier au soir?
--Comment savez-vous?... dit Julien flatté et surpris.
ARMAND.
Par la voix de la renommée; autrement dit par mon cousin Jacques, qui était hier au soir chez Mme de Valmier.
JULIEN.
Ah! j'en suis bien aise! il s'est amusé alors?
ARMAND, tranquillement.
Non; pas trop!
JULIEN, vexé.
Et pourquoi donc ça? les costumes étaient charmants, la pièce aussi!
ARMAND.
Non, cela manquait de gaieté, à ce qu'il dit. Franchement, Julien, ce n'est pas un amusement d'enfant qu'une comédie comme celle là.
ÉLISABETH.
Je trouve qu'Armand a raison. Se costumer pour de bon et imiter les vrais acteurs, c'est ennuyeux et surtout mauvais.
IRÈNE, se récriant.
Par exemple, et comment ça?
ÉLISABETH.
Maman dit que cela excite l'orgueil, la vanité, la coquetterie, que cela détourne du travail, de la vie calme, de la bonne vie de famille, (avec intention) des vrais amis. (Irène rougit.) Voyons, Irène, chère amie, avouez que tous ces jours-ci, vous n'avez pensé qu'à des choses frivoles et que vous avez négligé tous vos devoirs sérieux.
IRÈNE, à demi-voix.
C'est vrai, Élisabeth.
ÉLISABETH.
Que résulte-t-il de tous ces mauvais plaisirs? Qu'on se sent mal à son aise et qu'on s'en veut d'être frivole sans avoir le courage de cesser de l'être!
IRÈNE, soupirant.
C'est très-vrai, je l'avoue! J'ai pensé tout cela, surtout ce matin!
ARMAND.
Voyez-vous, Julien, tout cela ne vaut pas nos simples charades; voilà qui est amusant et qui est un vrai passe-temps d'enfants!
JULIEN.
De quelles charades parlez-vous, Armand?
ARMAND.
De celles que nous allons jouer bientôt chez grand'mère, comme nous le faisons tous les ans.
JULIEN.
Et qui joue avec vous?
ÉLISABETH.
Nos cousins et cousines de Marsy.
IRÈNE.
Et vos costumes, qui les fait?
ARMAND.
Nous-mêmes, avec des affaires que grand'mère nous prête. L'année dernière, j'étais en Turc avec un turban gros comme une citrouille sur la tête. Paul était en Tarentule, et puis, il a joué ensuite un oignon d'Egypte. Dieu, avons-nous ri!
JULIEN, souriant.
Le fait est que ça devait être bien drôle!
IRÈNE, avec curiosité.
Je voudrais bien vous voir jouer vos charades, Élisabeth!
ÉLISABETH.
C'est facile: je demanderai à grand'mère de vouloir bien inviter M. et Mme de Morville et vous deux: elle sait que je vous aime bien: quoique vous ne soyez pas de la famille, elle le fera volontiers, j'en suis sûre.

IRÈNE.
Vous n'avez donc personne d'invité, à cette fête?
ARMAND.
Ce n'est pas une fête, Irène: c'est une réunion de famille. Il n'y a que nos parents, mon oncle Gaston et mon oncle Woldemar.
ÉLISABETH.
D'ailleurs, grand'mère dit que c'est très-mauvais d'exciter la vanité des enfants en les donnant en spectacle; tandis que les charades sont pour faire rire, et je vous assure qu'on n'y manque pas!
--Élisabeth, dit Mlle Heiger, en s'approchant, l'heure de notre visite à Mme de Gursé est venue. Dites adieu, ainsi qu'Armand, à vos amis et partons vite.
--Déjà? dit Élisabeth.
--Ah! quel dommage! s'écrièrent les petits de Morville.
--Au revoir, Irène, à revoir, Julien, dirent Élisabeth et Armand. A bientôt, n'est-ce pas?»
Et l'on se sépara en s'embrassant affectueusement.
Restés seuls, les petits de Morville se regardèrent un instant en silence.
«Quelle bonne enfant que cette Élisabeth! dit enfin Irène, avec conviction.
--J'en dis autant d'Armand. Il me plaît beaucoup, maintenant, répondit Julien.
--Ils ont raison! reprit Irène d'un air pensif. Nos fêtes sont mauvaises.
--Quelle idée, dit Julien avec humeur. Pourquoi dis-tu une chose pareille?
IRÈNE.
Si ce n'était pas mauvais, Julien, je n'aurais pas la conscience inquiète comme je l'ai.
JULIEN.
En quoi, inquiète? Tu n'as rien fait de mal, après tout!
IRÈNE.
Si, c'était mal de se mirer pendant des heures entières, et je l'ai fait quand j'ai été coiffée. C'était mal de prendre la place de Constance au piano, au lieu de l'encourager, et je l'ai fait! C'était mal d'être orgueilleuse pour avoir bien dansé la mazurka, et j'avais le coeur gonflé d'orgueil, et plein de dédain pour les autres.
JULIEN, hésitant.
C'est possible, ce que tu dis là: j'ai bien quelque chose de semblable à me reprocher aussi; mais... notre comédie, notre pauvre comédie, qu'y avait-il de mal là dedans?
IRÈNE, avec émotion.
Là plus qu'au bal, j'ai été coupable, je le reconnais maintenant. Quand Herminie s'est trompée, qu'elle a balbutié, j'aurais pu, j'aurais dû lui souffler la phrase qu'elle avait oubliée et que je savais. Au lieu de cela, j'ai ri; cela a fini de la troubler, de la désoler, la pauvre petite: elle n'a continué qu'avec peine, et après le spectacle, sa mère l'a durement grondée..., et ma constante préoccupation de ma toilette, mon désir de briller, même aux dépens de Noémi qui est si bonne; tout cela, vois-tu, est mal; vraiment mal!»
Irène s'était animée en parlant: sa vivacité, sa voix émue touchèrent Julien.
«Allons, petite soeur, calme-toi, lui dit-il; tu as raison, là, et je me sens aussi coupable que toi.»
En finissant ces mots, il embrassa tendrement sa soeur. Irène était si peu habituée aux démonstrations affectueuses de Julien, qu'elle resta d'abord interdite, puis elle fondit en larmes en se jetant au cou de son frère.
«Oh! mon cher Julien, murmura-t-elle à travers ses larmes! Que c'est bon d'être aimée de son frère! Que je te remercie!
--Irène, chère soeur, dit Julien, les larmes aux yeux, je te remercie à mon tour. Oui, aimons-nous sincèrement; je sens à présent combien il est triste de vivre comme nous le faisions, indifférents l'un à l'autre. Grâce à Dieu, je sens aujourd'hui tout le prix de ta tendresse: je veux être ton ami et ton frère, entends-tu, chère soeur? Non pas seulement de nom, mais en réalité.»
Irène s'essuya les yeux à la hâte, car Zélie s'approchait d'un air inquiet. Les enfants, suivis de leur bonne, revinrent à la maison en causant affectueusement, heureux pour la première fois de sentir leur égoïsme se fondre et se changer en tendresse vraie, en amitié dévouée l'un pour l'autre.

«Ah çà! ma chère, disait la semaine suivante Constance à Irène, on ne vous voit presque plus, que devenez-vous?
--J'ai été un peu souffrante, répondit Irène; c'est pour cela que je ne suis pas venue tous ces jours-ci.
CONSTANCE.
Alors, vous ne savez pas la grande nouvelle?
IRÈNE.
Non, vraiment. Laquelle donc?
CONSTANCE.
Herminie et moi, avec M. Jordan, fondons ici le club du Beau monde. Vous êtes inscrite, bien entendu, ainsi que monsieur Julien. On ne reçoit que les petites filles en robe de soie et les petits garçons en paletots élégants.
IRÈNE, faiblement.
Mais je ne sais pas si je peux....
CONSTANCE.
Ah! ma chère, il est impossible que vous n'en soyez pas! Vous seriez montrée au doigt si vous refusiez! Venez, voilà ces demoiselles qui nous cherchent. Allons vite vous faire recevoir.»
Irène se laissa entraîner à demi flattée, à demi mécontente: elle vit bientôt avec déplaisir que l'on avait fait cela pour humilier les enfants simplement mis, que les élégants voulaient chasser des Tuileries.
IRÈNE.
Mes chers amis, vraiment je ne vois pas trop la nécessité de fonder ce club. A quoi bon imiter nos papas quand les Tuileries ne nous ont réunis jusqu'ici que pour jouer?
HERMINIE, avec autorité.
Ma toute belle, c'est justement pour empêcher ces jeux de chevaux échappés que nous fondons «le Beau monde:» il vient ici un tas d'enfants qui déconsidèrent les Tuileries. Cela est choquant; cela ne peut durer.
CONSTANCE.
Parfaitement raisonné. Il est révoltant de coudoyer à chaque instant des enfants vêtus d'une façon misérable. Il ne doit venir ici que des personnes riches. Que les autres s'en aillent!
Dans ce moment, Jordan et son frère arrivèrent, entraînant Julien, qui semblait se laisser faire de très-mauvaise grâce; mais de même qu'Irène le respect humain, la fausse honte, l'empêchaient de dire sa pensée et de rompre avec les faux amis qui formaient le nouveau Club.
JORDAN.
Là, à présent, nous voici au complet.--Je vais lire notre règlement. Mesdemoiselles et Messieurs, voulez-vous?
TOUS LES ENFANTS.
Oui, oui, lisez!
Jordan tire un cahier de sa poche et lit ce qui suit:
«Règlement du Club des Tuileries: Le Beau Monde.
ART. 1er.
Les membres du Club ne devront jamais porter que des vêtements élégants.
ART. 2.
Les demoiselles doivent jurer de ne jamais s'affubler de drap, mérinos et autres étoffes grossières, indignes du Beau Monde.--Les messieurs devront être, dans leur genre, aussi élégants que les demoiselles.
ART. 3.
Les membres du Club ne devront, sous aucun prétexte, jouer avec les enfants grossièrement habillés.
ART. 4.
Les membres du Club ne joueront jamais que d'une façon comme il faut; leurs jeux devant être en rapport avec leurs toilettes et leurs devoirs de société élégante.--Sont abolis cache-cache, colin-maillard, les barres et tous jeux semblables,--La corde est tolérée, lorsqu'il y a du monde pouvant faire cercle et regarder....»
Un grand éclat de rire interrompit le lecteur; tous les enfants tournèrent la tête et virent Armand, Élisabeth, leurs cousins et quelques autres enfants qui avaient écouté Jordan et riaient de tout leur coeur.
CONSTANCE, indignée.
Voilà les gens mal mis! qu'est-ce qu'ils viennent faire ici?
JORDAN.
Comme c'est ridicule de venir déranger nos occupations!
HERMINIE, avec majesté.
Petits et petites, allez-vous-en: nous ne vous connaissons pas, nous ne voulons pas vous connaître, et c'est très-indiscret de venir écouter ce que nous disons.
ARMAND, tranquillement.
Petits et petites, les Tuileries sont à tout le monde, vous lisez à haute voix, ce n'est donc pas un secret, et comme vous lisez des bêtises, nous rions, voilà tout.
JORDAN, indigné.
Des bêtises?...
JACQUES DE MARSY.
Et des énormes, encore; ah! il faut à ces demoiselles et à ces messieurs de beaux vêtements?
CONSTANCE, aigrement.
Mêlez-vous de ce qui vous regarde, polisson.
ÉLISABETH, à ses compagnons.
Laissons-les, mes amis: maman m'a dit plus d'une fois que les enfants devraient se réunir pour faire du bien. Fondons aussi un club, nous, un club bon, utile, intéressant, que nous appellerons le Club de la Charité: tous ceux qui voudront en être seront les bienvenus.
VERVINS.
Ah! Ah! ah! vous demandez la charité, alors?
ARMAND, vivement.
Dites donc, vous, tâchez de fermer votre grande bouche et de cacher vos vilaines dents jaunes (on rit); respectez ma soeur, entendez-vous, gandin?
ÉLISABETH.
Tais-toi, Armand, ne dis pas de choses désagréables à Vervins. Non, monsieur, nous ne demandons pas la charité, nous la ferons, au contraire, puisque papa et nos oncles veulent bien nous donner de l'argent plus qu'il ne nous en faut pour nos menus plaisirs. Vous trouvez mauvais que nous ne soyons pas aussi bien mis que vous: c'est que notre maman le veut ainsi; et elle a bien raison: au moins nous sommes libres de jouer à notre aise, et comme cela, il nous reste quelque chose dans notre bourse quand il y a quelque misère à soulager.
JEANNE DE MARSY.
Tu as bien parlé, Élisabeth; viens, retournons près de Mlle Heiger pour organiser notre club, ça va être très-intéressant.
LES AUTRES ENFANTS.
C'est cela.
ARMAND.
Bonsoir, le beau monde, continuez de débiter vos sornettes, nous ne vous dérangerons pas dans vos amusements. Ah! ah! Ah! que c'est donc bête de s'amuser à s'ennuyer!
Et il partit en courant, suivi de sa soeur et de leurs cousins et amis.
Restés seuls, les élégants se regardèrent.
NOÉMI.
Elle a bien parlé, cette petite fille, n'est-ce pas, Ir.... Eh bien! où est donc Irène?
JORDAN.
Et Julien?
HERMINIE.
Ils sont partis tout doucement pendant que vous lisiez, monsieur; je les ai vus aller rejoindre leur bonne et quitter les Tuileries.
NOÉMI.
C'est singulier: ce n'est pas leur heure de départ!
CONSTANCE, aigrement.
Elle est si bizarre, cette Irène; elle ne veut rien faire comme les autres: elle tâche toujours de se singulariser pour qu'on la remarque: je ne peux pas souffrir ces manières-là!
HERMINIE.
Vous avez bien raison, c'est crispant de voir comme elle est affectée; ses maîtres, qui me donnent aussi des leçons, me disent sans cesse qu'elle et Julien passent le temps de leurs études à faire des mines et à se regarder dans la glace.
NOÉMI.
N'en dites pas de mal, voyons, et songeons plutôt à nous amuser.
VERVINS.
Voulez-vous regarder mes albums de timbres?
JULES.
C'est ça; les messieurs vont faire des affaires et les demoiselles les conseilleront.
Les élégants acceptèrent la proposition et bientôt on n'entendit plus que:
«J'ai des mexicains: qui en veut?
--Moi, j'en prends cinq.
--Il n'y a pas de confédérés, aujourd'hui?
--Marchandise précieuse, mon cher! Si vous en avez, gardez-la; ils ne pourront qu'augmenter.
--Jules, cédez-moi vos russes!
--A combien?
--Dix francs, les cinq.
--Merci! on vous en donnera des russes à ce prix-là!
--Dites votre chiffre, alors?
--Quinze francs.
--Oh là! là!
--Dame, c'est à prendre ou à laisser; dépêchez-vous; on me les demande....
--Donnez, allons, quoique ce soit un prix salé!
--Eh! Vervins, avez-vous vendu mes italiens?
--Oui, mais mal!
--Combien, voyons?
--Neuf francs cinquante centimes, et encore j'ai eu de la peine.
--Miséricorde, en voilà une débâcle! ils ont donc baissé?
--Vous le voyez bien.»
Entre petites filles on entendait des conversations dans le genre de celles-ci:
«Allez-vous patiner au Bois, cet hiver?

--Je crois bien! on vient de me faire un costume pour cela; un amour, ma chère!
--Qu'est-ce que c'est?
--Jupe de velours noir garnie de cygne, casaque pareille, toque avec plume de lophophore, c'est adorable; et des bottes! ah! ma chère, Meyer s'est surpassé!»
Plus loin, on entendait Constance dire à Herminie:
«En règle générale, ma toute belle, le lait virginal est toujours mal fait chez les petits parfumeurs. Il n'y a que Rimmel ou Claye pour bien arranger cela.
--J'irai chez eux alors, bien certainement! ont-ils de quoi brunir les sourcils?
--Oui. Je vous recommande aussi leur rouge, il est parfait. A propos de cela, comment vous mettez-vous du blanc?
--C'est un secret, mais pour vous je n'ai rien de caché. Je mets du cold cream sur le visage; je le laisse dix minutes, je l'essuie légèrement et je me poudre; cela fait un effet admirable.»
Pendant que les élégants s'amusaient ainsi, Mlle Heiger aidait Élisabeth à rédiger son règlement pour le Club de la Charité. Quand ce fut fait, Élisabeth réclama l'attention générale.
Élisabeth lut ce qui suit:
«Article 1er.--Chaque enfant devra se charger d'un petit pauvre, fourni par mon oncle Gaston: en sa qualité de président de la société des pauvres apprentis, cela lui sera facile de nous en indiquer.
ARMAND.
Si je prenais Jordan? (On rit.)
ÉLISABETH, continuant.
Article 2.--Tous les samedis, chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait dans la semaine.
Article 3.--On sera aimable, bienveillant pour tous les enfants connus et inconnus, et l'on tâchera non-seulement de leur donner de bons conseils, mais encore de leur rendre le bien pour le mal et de leur inspirer de bons sentiments.
ARMAND.
Je proteste!... (on rit) et de toutes mes forces encore! on nous demande tout simplement d'être parfaits. Je déclare que je ne le suis pas et qu'il se passera très, très-longtemps avant que je le sois. Mon honnêteté m'ordonne de vous dire cela à tous, pour ne pas vous prendre en traître, vu que je suis vif comme la poudre et que je ne réponds pas de moi.
ÉLISABETH, riant.
Voyons, Armand, tu n'es pas si diable que tu en as l'air. Tu t'y feras, va!
ARMAND.
Nous verrons ça; en tout cas, je ferai tous mes efforts pour être meilleur, je t'assure.»
On se sépara sur cette bonne parole et chacun s'en retourna chez soi, le coeur content, convaincu que la bonne et charmante idée d'Élisabeth ferait grand bien aux protecteurs comme à leurs petits protégés.

«Enfin, voilà Élisabeth! s'écria Irène avec joie, on courant vers son amie.
--Et le bon Armand, dit Julien en allant serrer la main du petit Breton.
ÉLISABETH.
Bonjour, mes amis, il y a quinze jours que je ne vous ai vus ici, pourquoi ne venez-vous plus aux Tuileries?»
Irène et Julien donnèrent, en balbutiant, quelques mauvaises raisons. Au fond, ils étaient embarrassés de choisir entre les petits de Kermadio, qu'ils aimaient, et leurs connaissances du club Le Beau Monde, qu'ils n'aimaient pas, mais qui flattaient leur vanité. Ce jour-là, pourtant, ils s'étaient décidés à venir aux Tuileries, les élégants ayant été tous goûter chez Noémi; les petits de Morville, honteux de leur lâcheté, avaient voulu profiter de cette circonstance pour revoir leurs amis.
JULIEN.
Mais qu'avez-vous donc, Armand? Vous avez l'air tout affairé aujourd'hui.
IRÈNE.
Et vous aussi, Élisabeth; est-ce que nous vous gênons?
ÉLISABETH.
Non, si vous voulez bien venir avec nous et assister à notre compte rendu du Club de la Charité; vous en avez peut-être entendu parler?
IRÈNE.
Oui, Noémi m'en a dit quelques mots.
ÉLISABETH.
Eh bien, nous allons aujourd'hui raconter ce que nous avons fait. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous accompagner.
JULIEN.
Et moi, Élisabeth, puis-je venir aussi?
ÉLISABETH.
Certainement. Allons vite à la grande allée: on nous y attend.
Les petits de Marsy et quelques autres enfants étaient déjà rassemblés, en effet: ils accueillirent les arrivants avec une joie affectueuse qui toucha visiblement Irène et Julien.
JACQUES.
Allons, Élisabeth; à toi de commencer: tu es notre présidente et tu as la parole.
ÉLISABETH, souriant.
Ici les premiers doivent être les derniers, comme dans l'Évangile: je demande à Jeanne de commencer.
On s'assit et Jeanne prit la parole.
«Mon oncle Gaston m'a donné, dit-elle, une pauvre petite aveugle à secourir. Elle s'appelle Louise et a treize ans; elle est très-bonne et très-gentille, mais elle est désolée de son infirmité; elle n'a perdu la vue que depuis un an; il me faut non-seulement la secourir, mais aussi la consoler. J'y vais tous les jours, avant le déjeuner; je l'aide à faire sa toilette, je lui apprends à s'occuper, à faire le ménage à tâtons; je lui lis des histoires, je lui chante des cantiques, et elle ne pleure plus maintenant. Dieu merci! sa mère est bien contente: moi aussi.»
Un murmure d'approbation s'éleva quand Jeanne se tut. Irène et Julien se regardèrent avec un mélange de surprise et d'attendrissement.
ÉLISABETH.
Merci, Jeanne. Jacques, à ton tour.
JACQUES.
Mon oncle m'a donné un petit blessé. C'est un pauvre enfant qui a eu la jambe écrasée par une poutre: on la lui a coupée et il est dans son lit très-malade, et exaspéré d'être mutilé ainsi. J'ai eu bien du mal avec lui! Les premiers jours il gardait un silence obstiné, ou bien il ne parlait que pour dire les vilaines choses sur le sort, sur la Providence, enfin, beaucoup de paroles tristes à entendre. Hier, il m'a dit brusquement:
«Pourquoi venez-vous me voir, puisque je vous suis étranger?
--Vous n'êtes pas un étranger pour moi, lui ai-je dit; ne sommes-nous pas frères devant le bon Dieu?»
Il me regarda avec des yeux singuliers.
«Le bon Dieu! a-t-il dit, il n'est guère bon pour moi!
--Ne dites pas cela, me suis-je écrié; il vous aime, mon pauvre Adolphe! et moi aussi, je vous aime, je souffre de vous voir souffrir et surtout....
--Eh bien? dit-il, achevez.
--Eh bien! je me désole de voir votre coeur si triste.
--Pourquoi dites-vous que vous m'aimez, a-t-il repris; vous vous moquez de moi sans doute....»
J'ai eu les larmes aux yeux et j'ai détourné la tête sans répondre.
«Je vous fais de la peine, a continué le blessé d'une voix émue; est-ce pour cela que vous avez des larmes dans les yeux?
--Vous doutez de mon affection, Adolphe, cela m'afflige, mon ami!»
Adolphe me saisit les mains.
«Vous avez dit....
--J'ai dit: mon ami; ne voulez-vous pas me laisser vous appeler ainsi, Adolphe?»
Il s'est caché la tête dans ses mains en fondant en larmes: j'ai voulu le consoler.
«Laissez, a-t-il dit, ces larmes me font tant de bien! Oh! que c'est bon d'aimer, de se repentir!...»
A partir de ce moment, il a changé complètement; il est devenu affectueux, résigné, patient, et son pauvre coeur n'est plus révolté, mais soumis.
On remercia Jacques avec effusion de son compte rendu. Irène et Julien, pour la première fois de leur vie, comprenaient les nobles émotions, les saintes joies de la charité.
Les autres enfants racontèrent le résultat de leur mission; il ne restait plus qu'Élisabeth et Armand.
ÉLISABETH.
A ton tour, Armand, dis nous l'histoire de ton protégé.
ARMAND.
Moi, je n'ai pas d'enfant, il n'y en avait plus de disponible (on rit); j'ai un vieil ivrogne (on rit plus fort), c'est le concierge de mon oncle Ernest, un brave homme, mais il boit; oh! mais il boit tellement d'eau-de-vie que c'est une pitié! Alors j'ai été le voir avec mon oncle, je l'ai fait convenir qu'il devait se corriger, et je lui ai proposé de le guérir. J'avais entendu parler du docteur Tribault, de sa méthode pour rendre les ivrognes très-sobres: mon oncle et moi, nous avons conduit le nôtre chez le docteur (on rit). Savez-vous ce qu'il a fait pour le guérir de son amour pour l'eau-de-vie? il l'a gardé chez lui trois jours entiers, ne lui faisant manger et boire que des choses imprégnées d'eau-de-vie; c'était exécrable, je le sais parce que j'en ai goûté un peu: mon malheureux ivrogne trouvait ça dégoûtant, ça lui donnait des haut-le-coeur, et il a demandé grâce le second jour, mais le docteur a tenu ferme, il n'a pas lâché mon pauvre ivrogne avant la fin des trois jours: alors, il lui a donné une bouteille d'eau-de-vie en disant:
«Tenez, mon ami, vous êtes libre, buvez à discrétion maintenant, je vous le permets.
--Moi, boire, pouah! certes non, je ne boirai pas de cette saleté: ça me fait bondir le coeur rien que de la voir; ça me rappelle mon horreur de nourriture et de boisson de ces jours-ci!
--Voyons, essayez....
--Jamais... j'aime mieux de l'huile de ricin! (On rit.)»

Mon ivrogne était parfaitement guéri; le docteur est ravi, et c'est la femme de mon ivrogne qui est heureuse! elle pleurait en me remerciant de ma bonne idée, et elle me disait: «Grâce à vous, monsieur Armand, mon mari ne nous laissera plus dans la misère, les enfants et moi, pour aller boire à son maudit cabaret.»
--Bravo! s'écrièrent les enfants: tu as fait là une chose excellente, Armand!
ARMAND.
A toi, Élisabeth, tu nous dois ton histoire.
ÉLISABETH.
Très-volontiers; la voici:
«J'ai eu pour partage de soigner une vieille femme paralysée des jambes; comme pour Armand, il n'y avait plus d'enfants pauvres ou affligés à me confier. J'ai donc été voir ma paralytique. Je trouve une femme furieuse d'être dans cet état, et très-aigrie par la souffrance: elle me tourne le dos en déclarant qu'elle ne me dirait pas un mot, qu'elle me défend de la toucher et même de l'approcher. Je lui parle, je veux lui faire entendre raison, peine perdue: je fais son ménage le mieux que je peux, et chaque jour, je reviens (j'étais avec Mlle Heiger, bien entendu!) la soigner de mon mieux; elle continuait à ne pas vouloir dire une parole, lorsqu'avant-hier, j'ai le malheur d'oublier sa défense, je veux l'aider à se soulever et je reçois un soufflet, oh mais! un soufflet en règle, Mlle Heiger a poussé un cri, mais je me suis hâtée de lui dire, en joignant les mains: «Pardonnez-lui, car elle doit être bien malheureuse pour maltraiter celle qui l'aime et l'aimera malgré elle.»
Alors la paralytique m'a tendu les bras sans rien dire, je me suis approchée avec joie de la pauvre femme repentante, et elle a embrassé ma joue toute rouge, ç'a été le signal de la paix: nous nous entendons très-bien maintenant!»
Ce touchant récit finit la réunion du Club de la Charité: l'on se sépara ensuite: Irène et Julien étaient sérieusement touchés de ce qu'ils avaient entendu et prenaient de bonnes résolutions pour l'avenir.

L'enfer est, dit-on, pavé de bonnes intentions. Cela signifie que les actions doivent accompagner les bons desseins, sans quoi les sages résolutions restent stériles et l'on a des remords de plus, en songeant qu'on a voulu bien faire et qu'on n'a pas eu la force d'agir comme on se le promettait.
C'est ce qui arrivait pour Irène et Julien: leurs habitudes futiles et dissipées, leurs amis faux et vains, les entraînaient à reprendre un train de vie qui ne suffisait plus à leurs coeurs, ni à leurs esprits: ils s'amusaient parfois à satisfaire leur besoin de briller, mais le plus souvent, ils n'approuvaient qu'en apparence ce que leur conscience blâmait en secret.
Pourtant comme ils étaient gais, élégants, et surtout comme ils étaient fort riches, Irène et Julien se voyaient recherchés plus que jamais par leurs amis du club le Beau Monde. C'est là que nous les retrouvons, quelques jours après leur réunion avec Élisabeth et ses amis.
La vente des timbres était des plus animées, ce jour-là; jamais Vervins, Jordan et Jules n'avaient déployé autant d'activité, de génie des affaires. Julien lui-même s'était laissé entraîner par leur exemple et faisait comme eux, des spéculations, aussi bonnes pour lui que mauvaises pour ses acheteurs de timbres. Chacun criait, allait, venait, discutait, lorsqu'une voix grave domina tout à coup le tumulte.
«Mes petits messieurs, il n'est pas permis de faire du commerce ici.»
Tous les spéculateurs restèrent pétrifiés devant un surveillant qui se tenait au milieu d'eux, les bras croisés, et fronçant les sourcils.
«Fi! continua-t-il, des enfants honnêtes passent leur temps à trafiquer, au lieu de jouer et de courir, comme cela devrait être! Voilà donc pourquoi vous vous cachiez sous les quinconces depuis quelque temps? Mais je soupçonnais cela.... J'ai guetté et je surprends vos vilaines manoeuvres!
VERVINS, troublé.
Mais monsieur, il est bien permis d'échanger des timbres, c'est un amusement comme un autre!
LE SURVEILLANT, avec force.
Ne mentez pas, monsieur: vous trafiquiez, et vous vous trompiez les uns les autres; je le sais, car j'ai entendu tout à l'heure votre conversation avec votre camarade. (Il désigne Jordan.)
JORDAN, aigrement.
Ah! par exemple! nous n'avons rien dit que de très-simple, de très-honnête!
LE SURVEILLANT, avec ironie.
Ah! c'est donc honnête de dire: «Je viens de gagner sept francs vingt-cinq centimes sur Anastase!
«Et moi cinq francs cinquante centimes sur Étienne! Ils sont refaits en plein, ces imbéciles; les affaires vont joliment, aujourd'hui!»
(Exclamations parmi les enfants.)
ANASTASE, en colère.
C'est très-mal, je ne veux plus être votre ami, je ne veux plus être du club du Beau Monde: je ne jouerai plus avec vous. Je vais rejoindre Armand et Élisabeth. (Il s'en va en courant.)
ÉTIENNE, indigné.
Moi aussi; j'aime mieux jouer et être simple que de me voir prendre mon argent comme ça! (Il suit Anastase.)
LE SURVEILLANT.
Si ça ne fait pas pitié de voir des enfants s'exciter à la vanité avec leur Beau Monde, et les voir mépriser des enfants raisonnables! Bien le bonsoir, messieurs; j'ai l'oeil sur vous. Plus d'affaires, ou gare à vous!»
Le surveillant s'éloigna alors en grommelant, laissant les enfants à moitié en colère, à moitié terrifiés.
CONSTANCE, avec aigreur.
Vilain bonhomme! c'est un tyran, de ne pas nous laisser faire ce qui nous plaît!
HERMINIE, tapant du pied.
Et d'oser nous faire des reproches!
NOÉMI.
Ah! mes amis, franchement il a raison: en y réfléchissant, il vaut bien mieux jouer que de se pavaner comme nous le faisons! Et puis, c'est bien plus gentil de jouer tous ensemble: nous repoussons les enfants simplement mis, je ne sais pas pourquoi!
CONSTANCE, avec dignité.
Je ne m'abaisserai jamais à fréquenter des gens portant de pareilles toilettes.
HERMINIE.
Que va devenir notre club...? Eh bien, Irène, vous vous en allez?
IRÈNE.
Oui, je ne veux plus avoir la honte d'être blâmée par le gardien. Viens-tu, Julien?
JULIEN.
Oh! oui! je ne recommencerai pas, je t'assure, à me mettre dans une position pareille!
JORDAN.
Comment, vous vous en allez! Et notre club?
JULIEN.
Je m'en moque, j'en ai assez; j'en ai même trop...
CONSTANCE.
Irène, restez donc, n'abandonnez pas le club, vous, au moins!
IRÈNE.
Si vraiment; je veux bien jouer, mais je ne veux plus de ce bête de club qui ne sert à rien qu'à nous rendre vaniteux. A demain, mes amis; aujourd'hui, je vais embrasser Élisabeth, Armand, leurs amis, et leur dire que je serai très-contente de jouer avec eux.
CONSTANCE.
Mais... allons bon, voilà qu'il pleut! Ah! ma robe, ma jolie robe! mon satin lilas sera perdu....
HERMINIE.
Mes plumes de paon seront défrisées, si ça continue! Aïe!... il me tombe de l'eau dans le cou....
NOÉMI.
Sauvons-nous sous les arcades de la rue de Rivoli avec nos bonnes!
Ces mots furent le signal d'une débandade générale; le Beau Monde courut à toutes jambes vers la grille, au milieu d'une pluie devenue torrentielle; les élégants se bousculaient tellement en montant l'escalier qui conduit à la porte d'entrée, que plusieurs d'entre eux tombèrent: ils se relevèrent furieux, pleins de boue et de sable, et se disant des choses désagréables les uns aux autres.
Les malheureux finirent par arriver sous les arcades, mais dans l'état le plus déplorable qu'on puisse imaginer: leurs belles toilettes étaient toutes perdues; leurs visages exprimaient le dépit et la colère.
La déroute du Beau Monde attira l'attention de plusieurs gamins: ils accoururent en se bousculant et firent cercle autour des élégants consternés.
UN GAMIN.
Ohé Titi, en v'là des boules et des balles! sac à papier, qué joli spectacle!
DEUXIÈME GAMIN.
Tiens, Dodolphe, v'là une merveilleuse qui perd son rouge, il rigole sur son menton...
TROISIÈME GAMIN.
Prends garde de l'perdre; ah! en v'là une qu'a du blanc et du noir pêle-mêle. C'est comme pour les pies!

PREMIER GAMIN.
C'est, ma foi, vrai. C'est gentil de voir tout ça gratis!
JORDAN.
Allez-vous en, polissons! Donnez-nous la paix.
PREMIER GAMIN.
M'sieur a ses nerfs?
JULES.
Mauvais garnement, respecte-nous ou gare à toi!
DEUXIÈME GAMIN.
Oh la la! maman, j'ai t'y peur! (Chantant).
En avant, marchons,
Contre ces garçons....
(Il s'avance vers Jules.)
JULES, reculant.
Eh bien! eh bien! ma bonne, au secours!
TROISIÈME GAMIN.
Bébé crie; vite, la nourrice, du lolo pour consoler Fanfan!
LA BONNE.
Allez-vous-en, gamins, laissez ces enfants tranquilles.
PREMIER GAMIN.
La rue est à tout le monde, d'abord....
DEUXIÈME GAMIN
Et puis, c'est pas des enfants, ça!
HERMINIE, indignée.
Par exemple!
DEUXIÈME GAMIN.
Non, c'est des chiens fous; ainsi, on peut regarder ça.
CONSTANCE, furieuse.
Ça! l'insolent!
UN SERGENT DE VILLE, arrivant.
Arrière, les gamins! (les gamins se sauvent en criant: «v'là les chiens fous, hou, hou....») Et vous, mesdemoiselles et messieurs, veuillez circuler; voilà la pluie finie, du reste; vous pouvez aller et venir.
Les élégants, trempés, sales, grognons, et quelques-uns d'entre eux barbouillés par leur maquillage à moitié enlevé, s'en allèrent piteusement avec leurs bonnes; ils eurent la douleur de rencontrer, au détour d'une rue, les implacables gamins qui les escortèrent pendant quelques minutes en se moquant d'eux et en les huant, tandis que les passants riaient à gorge déployée, et des lazzis des gamins et des mines ridicules du beau monde.

Le lendemain de cette scène, Irène reçut d'Élisabeth le billet suivant:
«Chère amie,
Grand'mère me charge de demander à M. et à Mme de Morville de vouloir bien t'amener chez elle, ainsi que Julien, jeudi soir, à huit heures; mes cousins et cousines de Marsy, Armand et moi, devrons jouer deux charades. A jeudi, j'espère: en attendant, je t'embrasse comme je t'aime, ma bonne Irène, de toute mon âme.
Ton amie dévouée,
ÉLISABETH DE KERMADIO.»
Irène, enchantée, courut chercher Julien: tous deux se hâtèrent de porter à leur mère la gentille lettre d'Élisabeth, et lui demander de vouloir bien, ainsi que leur père, les mener le soir chez Mme de Gursé, la grand'mère des petits de Kermadio et de Marsy.
Mme de Morville y consentit volontiers, et Irène, après avoir remercié sa mère, écrivit à Élisabeth pour lui dire qu'elle pouvait compter sur eux.
Le jeudi matin, les six cousins et cousines, fort affairés, se rendirent ensemble chez Mme de Gursé, pour préparer leurs fameuses charades; ils se retirèrent dans le petit salon, afin d'y chercher les mots pour le soir.
JEANNE.
Messieurs, mesdames, dépêchez-vous de trouver une bonne charade, car je vous déclare que je me sens bête comme un pot: je n'en trouve pas la queue d'une, pour ma part!
PAUL.
Il n'y a pas besoin de nous décourager. Nous le sommes déjà bien assez sans ça! (Il réfléchit.)
ÉLISABETH.
Le difficile est de trouver des charades dont les mots soient simples, aisés à jouer et amusants pour tout le monde. (Elle réfléchit.)
JACQUES.
Je crois que... non, ce serait mauvais!
ARMAND.
Ah! j'ai trouvé... impossible! le tout serait trop long à jouer....
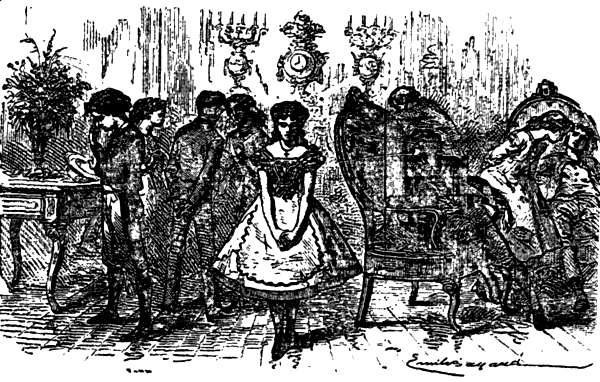
JEANNE.
Tiens! si nous prenions... bah! que je suis étourdie; cela n'irait jamais!
ÉLISABETH, riant.
Eh bien! le commencement promet. Nos spectateurs seront contents, ce soir, si nous allons de ce train-là.
JEANNE.
C'est inquiétant, tu as raison! arranger nos mots, notre théâtre, nos costumes!...
FRANÇOISE.
Heureusement que maman et ma tante de Kermadio vont venir bientôt nous aider!
JACQUES.
Et Mlle Heiger aussi. Elle finit une lettre et arrive tout de suite après, à ce que dit Armand.
FRANÇOISE.
J'en sais un! j'en sais un superbe....
TOUS.
Qu'est-ce que c'est? dis vite!
FRANÇOISE, triomphante.
Mésange! C'est ça, un joli mot?
JEANNE, réfléchissant.
Il n'est pas facile.
ÉLISABETH.
Il est même impossible!
FRANÇOISE, vivement.
Pourquoi ça, mademoiselle la difficile?
ÉLISABETH.
Parce que ange serait très-bien, mésange, aussi; mais le premier mot més, comment nous en tirer?
FRANÇOISE.
La belle affaire! Ce sera quelqu'un qui dira toujours maiz, maiz, parce qu'il sera embarrassé.
(Les enfants rient.)
François commençait à devenir très-rouge quand les mamans et Mlle Heiger entrèrent. Les pauvres acteurs leur demandèrent du secours.
MADAME DE MARSY.
Voyons! courage. Cherchez un mot simple et qui ne demande qu'un jeu facile: talent, tailleur, que sais-je, moi!
MADAME DE KERMADIO.
Balai, piqueur....
JACQUES.
Non, piqûre, ce sera mieux! Merci, ma tante, merci, maman.
TOUS.
C'est ça! piqûre, ce sera très-bien.
JACQUES, affairé.
Pique-hure. Voilà comment nous devons jouer cela.
Il y aura une brouille entre deux vieilles portières, pour le premier mot; pour le second, on servira, à un déjeuner de gourmands, une hure de sanglier en carton, comme plat du milieu: vous jugez du désappointement général.
Au dernier, ce sera M. de Rosbourg, piqué par un serpent et sauvé par Paul d'Aubert 1.
Note 1: (retour) Épisode tiré du livre de la comtesse de Ségur, les Vacances.
TOUS.
Bravo! Jacques; c'est charmant, très-bien inventé!
MADAME DE MARSY.
Très gentil et ingénieux: la piqûre surtout sera charmante à jouer.
PAUL.
Et la seconde charade? cherchons-la, puisque voilà la première trouvée.
JEANNE.
Charité serait très-bien et très-joli à jouer.
MADAME DE KERMADIO.
Ah! voilà une idée excellente, chère enfant!
MADAME DE MARSY.
En effet, c'est simple et facile à jouer.
PAUL.
Oui, oui; c'est ça! chat, l'aventure de ma vieille cousine avec le charretier; riz, un dîner de poltrons effrayés du choléra, et thé, un thé comme celui de Mme Gibou, que maman nous lisait l'autre jour.
LES ENFANTS.
Bravo! c'est parfait.
MADEMOISELLE HEIGER.
Maintenant il faut s'occuper de distribuer les rôles à chacun, d'arranger les costumes et les décors.
Les enfants, enchantés d'avoir enfin trouvé leurs mots, se mirent à tout organiser. Lorsque les rôles durent être distribués, Jeanne déclara malignement qu'elle donnait à Paul le soin de représenter la hure de sanglier.
PAUL, vivement.
Tu veux me vexer, taquine? mais je vais t'attraper en acceptant; je jouerai si bien mon rôle que je donnerai des fous rires à tout le monde.
JEANNE, riant.
Je demande aussi qu'on t'offre le rôle du chat; il sera si intéressant!
PAUL, se rebiffant.
Ah! tu m'ennuies à la fin, de me fourrer toujours dans les bêtes comme ça! l'année dernière, c'était la même histoire....
JEANNE, gaiement.
Mais ça t'amuserait tant, d'égratigner et de faire le gros dos!
PAUL, décidé.
J'accepte, et je te ferai des phout... phout... si terribles, que tu ne seras pas contente de m'avoir offert le rôle!
Tout le monde riait en les écoutant et l'on finit de tout organiser, à la satisfaction générale.
Le soir venu, la famille de Morville arriva et fut reçue à merveille par l'excellente grand'mère d'Élisabeth, Mme de Gursé. Irène et Julien étaient fort impatients de savoir comment les petits acteurs se tireraient de leurs rôles.
Lorsqu'on fut installé dans le salon, converti en salle de spectacle, on leva le rideau et la première charade commença.

PIQUE.
|
PERSONNAGES. Mme Petit-Colin, portière 2 Mme Gros-Colin, portière 3 M. Conciliant, voisin 4 Mimi, fils de Mme Petit-Colin 5 Titi, fils de Mme Gros-Colin 6 Marinette, fille de M. Conciliant 7 |
ACTEURS. Mlle Jeanne. Mlle Élisabeth. M. Jacques. M. Paul. M. Armand. Mlle Françoise. |
Le théâtre représente une loge de concierge.
Note 2: (retour) Bonnet à rubans rouges, robe verte à queue, châle de toutes couleurs, collier d'énormes boules.
Note 3: (retour) Bonnet à rubans roses et bleus, robe rouge à queue, châle vert, doigts couverts de bagues.
Note 4: (retour) Redingote noire, pantalon gris, gilet blanc, cravate très-empesée, lunettes bleues, grand chapeau gris.
Note 5: (retour) Blouse grise, pantalon blanc, toque ridiculement ornée et beaucoup trop empanachée.
Note 6: (retour) Veste bleue, pantalon blanc, toque d'un autre genre que celle de Mimi, aussi ridiculement ornée.
Note 7: (retour) Simple et gentil costume de fantaisie.
SCÈNE I.
MADAME PETIT-COLIN, MIMI.
MADAME PETIT-COLIN.
Je suis contente que nous soyons habillés, Mimi, car je ne serais pas étonnée de recevoir des visites, aujourd'hui!
MIMI, bâillant.
Ah! bah, maman, et qui donc qui viendrait?
MADAME PETIT-COLIN.
Quand ça ne serait que la vieille Gros-Colin qui aime tant à jouer de la langue; elle ne peut pas se tenir de parler, et faut qu'elle aille de porte en porte cancaner et assommer tous les voisins. (Voyant entrer Mme Colin.) Ah! bonjour, ma chère madame Gros-Colin; que vous êtes donc aimable de venir comme ça voir les amis!
SCÈNE II.
MADAME GROS-COLIN, entrant.
Je ne pouvais pas passer devant votre porte sans entrer, madame Petit-Colin! Titi, dis bonjour à ton cher Mimi.
TITI, grognant.
Bonjour, toi!
MIMI, rechigné.
Bonjour, toi!
MADAME PETIT-COLIN.
Allez jouer, mes petits amours.
(Les enfants vont dans un coin et restent immobiles, causant à peine et se tirant la langue de temps en temps.)
MADAME GROS-COLIN.
Une chose qui m'a toujours étonnée et que je venais vous demander aujourd'hui, ma voisine, c'est pourquoi que vous vous appelez Colin comme moi?
MADAME PETIT-COLIN.
La même chose m'étonnait aussi!
MADAME GROS-COLIN.
Pourquoi ça, s'il vous plaît?
MADAME PETIT-COLIN, avec fierté.
Parce que nous sommes les seuls qui devons porter le nom de Colin.
MADAME GROS-COLIN, vivement.
Je dis la même chose: c'est à nous seuls que revient cet honorable nom....
MADAME PETIT-COLIN, aigrement.
Vous devez vous tromper, Mame, nous sommes les seuls vrais Colin!
MADAME GROS-COLIN, très-vivement.
Vous vous trompez vous même, Mame; il n'y a que nous.
MADAME PETIT-COLIN.
Ceci est fort. Lisez ces papiers.
(Elle lui donne une liasse de cahiers.)
MADAME GROS-COLIN.
Et lisez ceci, il n'y a rien à répondre.
(Elle tire de sa poche un rouleau de papiers. Les deux femmes lisent tout bas, en gesticulant.)
MIMI.
Je te dis moi, que je tire la langue plus vite que toi!
TITI.
Pas vrai, c'est moi!
MIMI, tirant la langue.
Tiens! tiens! tiens! vois-tu comme je fais bien ça?
TITI, de même.
Et tiens! et tiens! et tiens! je le fais mieux....
MIMI.
Comptons combien de fois nous la tirerons chacun dans une minute, veux-tu?
TITI.
Veux bien.
(Ils vont devant la glace et tirent la langue le plus vite qu'ils peuvent en se faisant d'atroces grimaces.)
MADAME GROS-COLIN, jetant les papiers.
C'est un tissu de mensonges! les seuls Colin, c'est nous!
MADAME PETIT-COLIN, de même.
Fausseté! horreur! Il n'y a que nous de vérédiques!
MADAME GROS-COLIN, en colère.
Ne répétez pas ça, portière; il n'y a plus qu'une branche de Colin, c'est nous....
MADAME PETIT-COLIN, furieuse.
Une branche, une souche morte, vous voulez dire!
MADAME GROS-COLIN, exaspérée.
Madame!...
MADAME PETIT-COLIN, de même.
Madame!...
SCÈNE III.
MONSIEUR CONCILIANT, entrant.
Bonjour, Ma.... Ah! mon Dieu! qu'y a-t-il donc, mes chères dames?
MARINETTE, avec reproche.
Oh! Mimi; oh! Titi, pourquoi vous tirez-vous la langue comme ça?
MADAME GROS-COLIN, embarrassée.
Nous nous disputons un peu, monsieur Conciliant, à cause de nos noms.
MADAME PETIT-COLIN.
Oui, parce que chacune de nous soutenait que son nom n'appartenait qu'à elle seule, et que les autres étaient de faux Colin.
MONSIEUR CONCILIANT.
Et ce n'était que cela qui vous troublait tant?
LES DEUX PORTIÈRES, indignées.
Comment, que cela?
MONSIEUR CONCILIANT.
Certainement, car je puis vous mettre d'accord; connaissant vos deux familles depuis longtemps, je suis au courant de toutes vos affaires.
LES DEUX FEMMES.
Eh bien! qui est la vraie Colin?
MONSIEUR CONCILIANT.
Vous êtes toutes deux de vraies Colin; seulement l'une est de la branche des Colin-Maillard, et l'autre, de la branche des Colin-Tampon!
MADAME PETIT-COLIN, rassurée.
Vous êtes sûr?
MONSIEUR CONCILIANT, gravement.
Très-sûr!
MADAME GROS-COLIN.
Mais alors, nous sommes parentes?
MONSIEUR CONCILIANT.
Certainement!
MADAME PETIT-COLIN.
Et moi qui l'ignorais....
MADAME GROS-COLIN.
Je vous rendais bien la pareille! Embrassons-nous, ma cousine, et vivons en paix.
(Elles se jettent dans les bras l'une de l'autre. Monsieur Conciliant se frotte les mains en riant.)
MARINETTE.
Voyez, mes amis, le bon exemple que vous donnent vos mamans. Soyez gentils et embrassez-vous aussi!
MIMI.
Elle a raison. Veux-tu, Titi?
TITI.
Veux bien! C'est vilain de tirer la langue; ça nous rendrait bien laids!
MARINETTE.
Et surtout, cela offense le bon Dieu et la sainte Vierge!
(Les enfants s'embrassent. La toile tombe.)
HURE.
|
PERSONNAGES. Mme Harpagon 8 Jocrisset, domestique et cuisinier 9 M. Gourmet 10 Mme Gourmet 11 Mlle Gourmet 12 Une hure de sanglier en carton 13 |
ACTEURS. Mlle Jeanne. M. Jacques. M. Armand. Mlle Élisabeth. Mlle Françoise. M. Paul. |
Le théâtre représente une salle à manger.
Note 8: (retour) Vêtements râpés, sales et n'allant pas ensemble. Robe de satin jaune fanée, bonnet fripé en tulle orné de rubans roses tachés; un soulier et une pantoufle; un mouchoir brodé taché d'encre.
Note 9: (retour) Habit brun couvert de reprises, veste jaune trop courte, pantalon vert avec des morceaux noirs aux genoux; casquette sans visière.
Note 10: (retour) Toilette élégante, mais tachée de graisse.
Note 11: (retour) Toilette semblable à celle de son mari, aussi chargée de taches de graisse.
Note 12: (retour) Comme ses parents, élégante et couverte de taches.
Note 13: (retour) Le petit acteur est accroupi sur un plat: il est recouvert d'une peau de chevreuil. Sur sa figure, une gaze couverte de plumes, ne laissant voir que les yeux et d'énormes défenses (des morceaux de mie de pain taillés en pointe, attachés à la gaze, simulent les défenses); oreilles postiches en queue de lapin: le sanglier doit faire des yeux terribles, pour compléter l'effet.
SCÈNE I.
MADAME HARPAGON, JOCRISSET.
MADAME HARPAGON.
Que c'est ennuyeux de donner à dîner! et à ces assommants Gourmet, encore! Ils vont dévorer, j'en suis sûre.... Jocrisset!
JOCRISSET, s'avançant.
Madame me réclame?
MADAME HARPAGON.
Tu n'as pas oublié ce que je t'ai recommandé?
JOCRISSET.
Quoi donc, madame?
MADAME HARPAGON, impatientée.
Enfin, tu te rappelles ce que j'ai dit! Sers vite et peu. Emporte les plats et n'offre que le moins possible.
JOCRISSET.
Oui, madame, j'emporterai vite et peu. J'offrirai les plats que je servirai. C'est-à-dire non... je servirai les plats que j'offrirai....
MADAME HARPAGON.
Mais non! mais non! c'est le contraire!
JOCRISSET.
C'est égal, madame, j'ai compris, et madame peut être sûre que....
SCÈNE II.
LES MÊMES, MADAME, M. ET MADEMOISELLE GOURMET
MADAME GOURMET.
Bonjour, chère madame, nous sommes exacts j'espère!
M. GOURMET.
Et mourant de faim....
MADAME HARPAGON, à part.
Aïe! (Haut.) Soyez les bienvenus! Vous voyez que je vous attendais, quasi à table. Asseyons-nous vite et réparons le temps perdu. (On s'assied: Jocrisset sert.)
JOCRISSET, très-vite.
Madame ne veut pas de côtelettes? (Il passe sans attendre la réponse; il fait la même chose pour chaque convive: personne ne mange. Mme Harpagon est radieuse, les Gourmet, consternés.)
MADAME HARPAGON, enchantée.
Quel triste appétit nous avons! Jocrisset, sers le poulet.
JOCRISSET.
La couveuse morte? Oui, madame, tout de suite.
M. GOURMET, bas.
Horreur! Anastasie, as-tu entendu?
MADAME GOURMET, de même.
Que trop, hélas!
MADEMOISELLE GOURMET, de même.
J'en mangerai tout de même, moi; tant pis, j'ai trop faim!
M. GOURMET.
Ma fille, je te le défends! N'en mange pas, Clélie, si tu aimes ton père.
MADAME HARPAGON, bas.
Jocrisset, ne sers que la carcasse! (Jocrisset se trompe et offre les bons morceaux. La petite Gourmet prend tout. Mme Harpagon s'agita avec douleur.)
JOCRISSET.
Madame, faut-il découvrir le plat du milieu?
MADAME HARPAGON.
Sans doute; tu as eu tort de l'oublier.
MADAME GOURMET, bas.
Oh! bonheur, nous allons manger....
M. GOURMET, bas.
Servons-nous sans dire gare, ou sans cela nous sommes perdus! (Jocrisset découvre la hure qui est sur la table.)
M. GOURMET, haut.
Ah! voilà un plat qui me réjouit. Cela m'amusera de le découper. J'ai un talent tout particulier pour cela. (Il attire le plat vers lui.)
MADAME HARPAGON, très-agitée.
Non, cher monsieur, non! Jocrisset va emporter le plat et vous évitera cette peine.
MADAME GOURMET, aigrement.
Doutez-vous de l'adresse de mon mari, madame?
MADAME HARPAGON, embarrassée.
Non certes; mais il vaudrait mieux... ce serait préférable....
M. GOURMET.
Dieu! que c'est dur! mon couteau ne peut pas... eh bien! eh bien! Oh! grand Dieu! c'est du carton!
MADEMOISELLE GOURMET.
Ah ben! on ne peut donc pas manger, ici? N'y avait que la couveuse!
MADAME HARPAGON, balbutiant.
Mon Dieu, vous savez... ces plats du milieu... sont pour la montre souvent... pour orner....
M. GOURMET, se levant.
En voilà assez! nous vous saluons, madame, et nous allons chercher ailleurs de quoi manger.
MADAME GOURMET, de même.
Et nous avons chez nous un cuissot de chevreuil (pas en carton!) que nous allons manger à nous seuls, sans inviter personne!
MADAME HARPAGON, désolée.
Ciel! si j'avais su! Restez donc; on va rapporter les côtelettes, et il y a encore des pommes de terre, n'est-ce pas, Jocrisset?
JOCRISSET.
Les pommes de terre germées? Certainement, madame.
MADEMOISELLE GOURMET.
Ça doit être bon!
M. GOURMET.
Plus un mot! Partons, ma femme et ma fille.
(Ils sortent.)
MADAME HARPAGON, désolée.
Coquin de sanglier! Il est cause de tout! (Elle montre le poing à la hure qui lui fait des yeux terribles. La toile tombe.)
PIQURE.
|
Personnages. Comte de Rosbourg 14 Paul d'Aubert 15 Première sauvage 16 Deuxième sauvage Troisième sauvage Quatrième sauvage |
Acteurs. M. Jacques. M. Paul. Mlle Élisabeth. Mlle Jeanne. Mlle Françoise. M. Armand. |
Le théâtre représente une plaine. A droite, un arbre figuré par
une grosse planche de sapin.
Note 14: (retour) Habits très-usés et déchirés, mais aussi propres que possible. Grande barbe, longs cheveux.
Note 15: (retour) Habits comme ceux de M. de Rosbourg.
Note 16: (retour) Corsages blancs, jupons en coton brodé et en peaux de bêtes, guirlandes de fleurs sur la poitrine et le dos. Carquois, flèches, couronnes de plumes; cheveux à la chinoise.
M. DE ROSBOURG, seul, se promenant.
Que je suis malheureux! Ma vie se passera-t-elle dans cette île, loin de ma chère femme, de ma chère fille, cette enfant bien aimée? Ah! mon Dieu! Donnez-moi le courage qui me manque.... (Il s'assied, accablé, sur une pierre.) Ah!... (Il se lève.) je viens d'être piqué! Ciel! un serpent à sonnettes, et je suis seul, loin du village.... (Il essaye vainement de marcher.) Je suis perdu! ma femme, ma chère fille, adieu.... Seigneur, prenez pitié de moi! (Il retombe assis sur un rocher et prie.)
PAUL, accourant.
Mon père, mon père, qu'avez-vous? Dieu! que vous êtes pâle!
M. DE ROSBOURG, d'une voix faible.
Ne t'afflige pas, Paul... un serpent... m'a piqué.... Je me sens mal.... (Il s'évanouit.)
PAUL, avec désespoir.
O mon pauvre père! Comment le sauver? Personne ici pour le secourir. A moi! à moi! il va mourir; mon Dieu, inspirez-moi!... Ah! quelle idée! (Il cherche la blessure, la découvre, puis suce la plaie.)
M. DE ROSBOURG, ouvrant les yeux.
Quel mieux je ressens! Quel miracle!... Ciel! Paul, que fais-tu? (Il veut l'empêcher de continuer.)
PAUL, se débattant.
Laissez, mon père! Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'agir. Je veux que vous viviez, je veux vous sauver, moi, moi qui vous dois la vie!
M. DE ROSBOURG.
Paul, mon enfant... je ne veux pas.... Ah! mes forces s'épuisent! (Il retombé évanoui. Paul profite de cette faiblesse pour achever de sucer la plaie.)
UNE PREMIÈRE SAUVAGE, accourant.
Quoi arriver ici? On criait!
PAUL, se relevant.
Mon père a été piqué par un serpent à sonnettes il y a plus d'une heure.
DEUXIÈME SAUVAGE.
Trop tard pour sauver lui! Lui, perdu!
PAUL.
Ne craignez rien. J'ai sucé la plaie. Il est hors de danger.
M. DE ROSBOURG, revenant à lui.
Paul, où es-tu? Tu souris, tu m'embrasses.... Tu m'as sauvé! (Il se lève.) Je le sens, tout le venin de ma blessure est parti. Mon Dieu! il a peut-être passé dans tes veines, cher et excellent enfant!
PAUL, d'une voix éteinte.
Non, mon père, ne craignez rien pour moi; mais ces émotions m'ont brisé... je ne puis.... (Il tombe dans les bras de M. de Rosbourg.)
M. DE. ROSBOURG, pleurant.
Mon fils, mon enfant! reviens à toi!

PREMIÈRE SAUVAGE.
Attends, Gligala venir là-bas et apporter bons remèdes.
TROISIÈME SAUVAGE, accourant.
Paul évanoui? Crains rien; voilà pour faire revenir lui. (Elle lui fait respirer un jus d'herbe.)
PAUL, ouvrant les yeux.
Mon père, je suis mieux. Merci, mes amies, merci de vos bons soins.
M. DE ROSBOURG.
Oh! mon Paul, que je suis heureux! Et moi qui me désolais de notre infortune! Je vois qu'aimé par un coeur comme le tien, je ne puis être vraiment malheureux!
QUATRIÈME SAUVAGE, arrivant.
Ami, ami, dans le lointain, voir venir un vaisseau comme le tien. Il vient vite vers terre.
M. DE ROSBOURG.
Paul, ton dévouement est béni de Dieu! Un vaisseau.... C'est la France! c'est la famille....
PAUL.
Cher père, vous allez être heureux?
M. DE ROSBOURG, avec tendresse.
Oui, mais jamais sans toi! (La toile tombe.)

CHAT.
|
Personnages. Mme Dur-à-Cuir 17 Sacripant, charretier 18 Diablotin, gamin 19 Mme Cancanier, portière 20 M. Cancanier, portier, son mari 21 Un Chat 22 |
Acteurs. Mlle Jeanne. M. Jacques. Mlle Françoise. Mlle Élisabeth. M. Armand. M. Paul. |
La scène représente une rue.
Note 17: (retour) Chapeau à fleurs fanées, mis de travers; cheveux gris ébouriffés; robe et manteau de couleur sombre; un énorme parapluie à la main.
Note 18: (retour) Blouse, pantalon en toile; large casquette sur l'oreille.
Note 19: (retour) Blouse, pantalon en toile; bonnet de police en papier.
Note 20: (retour) Costume de Mme Petit-Colin, plus un tablier et un balai.
Note 21: (retour) Costume de M. Conciliant, plus un tablier et un balai.
Note 22: (retour) L'acteur est enveloppé d'une fourrure; oreilles postiches, queue démesurément longue.
SCÈNE I.
(On entend miauler lamentablement dans la coulisse.)
MADAME DUR-A-CUIR, entrant.
J'entends miauler par ici! Il doit y avoir quelque misérable qui tourmente une pauvre bête sans défense... (Elle agite son parapluie.) Que vois-je! (Elle regarde dans la coulisse.) Un charretier fouette un angora.... L'infâme! et la victime, grimpée à moitié sur une voiture, ne peut ni descendre ni monter! Horrible spectacle!... Je vole au secours du malheur! (Elle s'élance dans la coulisse, son parapluie levé. On entend de grands cris.)
SCÈNE II.
MADAME DUR-A-CUIR, SACRIPANT, DIABLOTIN, le CHAT, entrent en désordre.
SACRIPANT.
Ah çà! allez-vous me laisser tranquille, à la fin, ma bonne femme! On ne peut donc pas s'amuser un brin sans être maltraité?
MADAME DUR-A-CUIR.
Gredin! tu appelles s'amuser, tourmenter, torturer un malheureux animal! (Elle lui montre le poing.) Touches-y, maintenant que je l'ai pris sous ma protection....
LE CHAT.
Miaou, miaou.
DIABLOTIN, déclamant.
Qu'ils sont touchants, les cris de l'innocence!
SACRIPANT.
Ne me défiez pas, la mère, car je vous lui en ferais voir de toutes les couleurs, à vot' protégé!
MADAME DUR-A-CUIR, le parapluie levé.
Approche, si tu l'oses!
SCÈNE III.
MADAME CANCANIER, entrant.
Bravo! ma bonne femme, tu as mon estime. Je vole à ton secours! (Elle se place près de Mme Dur-à-Cuir, la balai en l'air.)
M. CANCANIER, accourant.
De quoi te mêles-tu, toi? Toujours fourrée dans les bagarres! Attends un peu que je me mette dans le parti ennemi pour te donner une leçon. (Il se range à côté de Sacripant qui a son fouet en l'air.)
DIABLOTIN, riant.
Allez, la musique! En avant, Minet, déploie ton organe et anime la partie! (Le chat s'élance en miaulant et griffe énergiquement les figures de Sacripant et de Cancanier.)
LE CHAT, jurant.
Phout.... Phout.... (vite et griffant) phout, phout-phout....
SACRIPANT.
Aïe! Je suis éborgné.... Horreur de bête! va! Hé! le pharmacien, viens me panser, j'ai le nez en compote! (Il jette son fouet et se sauve en courant.)
CANCANIER.
Oh! là! là! j'ai la joue en marmelade; vilain animal.... Dieu! que ça me cuit! Vite, un médecin pour mes blessures! Brrrou! que j'ai mal! (Il s'en va en se tenant la tête.)
DIABLOTIN, chantant.
La victoire est à nous!
MADAME CANCANIER.
Et v'là le champ de bataille qui nous reste....
MADAME DUR-A-CUIR.
Avec armes et bagages!
LE CHAT.
Miaou....
MADAME CANCANIER.
Qu'allons-nous faire de ce pauvre animal?
MADAME DUR-A-CUIR.
Je l'emmène. Il me servira de compagnon et je raconterai son trait de bravoure à qui voudra l'entendre.
MADAME CANCANIER.
Je vous ferai écho, les oreilles de M. Cancanier seront rebattues de notre gloire! (Le chat se précipite dans les bras de Mme Dur-à-Cuir.)
DIABLOTIN.
Tableau touchant! Je suis ému! Je suis ému!...
(La toile tombe.)
RIZ.
|
Personnages. M. Tremblotant 23 Mme Tremblotant Le docteur Tukanmaime M. Huileux, apothicaire Mme Gémissons, cousine de Tremblotant Mlle Azelma Tremblotant |
Acteurs. M. Jacques. Mlle Jeanne. M. Armand. M. Paul. Mlle Élisabeth. Mlle Françoise. |
La scène représente une salle à manger.
Note 23: (retour) Costumes de fantaisie.
SCÈNE I.
MONSIEUR, MADAME, MADEMOISELLE TREMBLOTANT, MADAME GÉMISSONS, à table.
M. TREMBLOTANT.
Qu'avons-nous encore à manger, ma femme?
MADAME TREMBLOTANT.
Toujours la même chose, mon ami. Au temps de choléra où nous sommes, on ne saurait trop manger de cet aliment précieux. (Elle montre une terrine.)
MADAME GÉMISSONS.
Vous avez bien raison, ma cousine; un malheur est si vite arrivé! (Elle mange.)
M. TREMBLOTANT.
Ça bourre joliment de ne manger que de ce... légume-là! (Il se frotte l'estomac.)
MADAME GÉMISSONS.
Le fait est que ça ne veut plus passer. (Elle se renverse sur sa chaise.)
MADEMOISELLE TREMBLOTANT.
Ah! mon Dieu, maman, v'là ma cousine qu'a le choléra, elle devient toute verte!
MADAME TREMBLOTANT, bondissant.
Ciel de Dieu! c'est vrai! Vite, Azelma, un médecin.... Cours chercher un médecin. Tâche d'amener le docteur Tukanmaime. (Azelma sort en courant.)
M. TREMBLOTANT, terrifié.
Ah! Seigneur! je suis pris aussi, pour sûr. Je me sens tout drôle.... (Il tombe évanoui sur sa chaise.)
MADAME GÉMISSONS, pleurant.
Nous allons mourir! A la fleur de l'âge, hélas! (Elle se tord les mains.)
MADAME TREMBLOTANT.
Ne craignez rien, ma cousine, je prierai pour le repos de votre âme!
SCÈNE II.
Les mêmes, LE DOCTEUR, AZELMA.
LE DOCTEUR.
Qu'y a-t-il donc? Oh! oh! deux malades, bonne aubaine! (Il leur tâte le pouls.)
Fièvre violente.--Bien. Face rouge et gonflée. Très-bien.--Agitation convulsive! Parfait. (Les deux malades poussent des cris plaintifs.)
MADAME TREMBLOTANT, épouvantée.
Grand Dieu! docteur, que vous êtes sinistre dans vos paroles!
LE DOCTEUR, gaiement.
Et qu'ont-ils mangé, ces chers malades, ma bonne dame?
MADAME TREMBLOTANT.
Mais simplement de ceci, docteur; c'est ce qu'il y a de plus sain en temps de choléra. (Elle montre une énorme terrine presque vide.)
LE DOCTEUR.
Quelle quantité chaque malade en a-t-il mangé?
M. TREMBLOTANT, d'une voix faible.
Je n'en ai mangé que quatre à cinq livres pour ma part.
MADAME GÉMISSONS, de même.
Et moi, pas davantage.
LE DOCTEUR, tranquillement.
Ceci me rassure. Ce n'est pas précisément le choléra, alors, mais une violentissime indigestion cholérique dont nous allons débarrasser les patients.
Monsieur Tremblotant, vous allez.... (Il lui parle bas à l'oreille) dans votre chambre.
M. TREMBLOTANT, joignant les mains.
Cinq, docteur! Cinq de suite? cela va bien m'éprouver!
LE DOCTEUR, avec force.
Il le faut! un par livre, c'est la règle! Vous, Madame, vous.... (Il lui parle bas) dans la chambre de votre cousine.
MADAME GÉMISSONS.
Ah! docteur! cinq tout entiers? Ça me bouleversera!
LE DOCTEUR, avec autorité.
Madame, ne discutez pas la médecine! (Les malades sortent en gémissant chacun de son côté.)
SCÈNE III.
Les mêmes hors les malades, M. HUILEUX, arrivant.
M. HUILEUX, avec un gros rouleau enveloppé sous le bras. (On voit le bout de son instrument dépasser le papier.)
Je vous ai vu entrer ici, docteur, et je pense qu'on doit avoir, grâce à vous, besoin de mon ministère?
LE DOCTEUR.
Oui, mon cher Huileux, il faut.... (Il lui parle bas.) Cinq à Mme Gémissons, cinq à M. Tremblotant, et bien en conscience.
M. HUILEUX, avec fierté.
Ne craignez rien, docteur; j'aimerais mieux mourir que de faire grâce d'une goutte! (Il entre chez Mme Gémissons. Grand silence.)
M. HUILEUX, avec solennité (dans la coulisse).
Un..., deux..., trois....
MADAME GÉMISSONS, dans la coulisse.
Assez, assez! Je n'en peux plus!
M. HUILEUX, de même.
On en peut toujours, madame. Courage!
MADAME TREMBLOTANT.
La malheureuse! Ses plaintes sont déchirantes à entendre.
M. HUILEUX.
Quatre..., cinq! (Il sort de chez Mme Gémissons et va chez M. Tremblotant. Grand silence.)
M. HUILEUX, dans la coulisse.
Un..., deux....
M. TREMBLOTANT, de même.
Pas plus! pas plus!
M. HUILEUX, de même.
Monsieur, soyez homme! Mme Gémissons ne se plaignait qu'au troisième, et pourtant elle en a eu cinq!
M. TREMBLOTANT, de même.
Vous trouvez que ce n'est rien?
M. HUILEUX, de même.
Peu de chose, mon cher monsieur.... Allons, recommençons! Trois... quatre!...
M. TREMBLOTANT, de même.
Grâce.... Miséricorde!
M. HUILEUX, de même.
Cinq....
M. TREMBLOTANT, de même.
Ah! je suis mort!
M. HUILEUX, sortant.
Quand vous le serez pour de bon, vous ne le direz pas.
LE DOCTEUR.
C'est fini? Bravo! Allons, mon cher Huileux, courons chez nos autres malades, et sauvons l'humanité souffrante. (Ils sortent.)
MADAME GÉMISSONS paraît, courbée en deux, à la porte de sa chambre.
Oh! la, la!
M. TREMBLOTANT, paraissant de même.
Ah! grand Dieu!
Mme Tremblotant et Azelma se désolent
La toile tombe.

THÉ.
|
Personnages. Mme Ouistiti M. Ouistiti Mme Cornichon, voisine M. Gobe-Mouche, voisin Grinchu, cuisinier Follette, fille de Ouistiti |
Acteurs. Mlle Élisabeth. M. Armand. Mlle Jeanne. M. Jacques. M. Paul. Mlle Françoise. |
(Les acteurs sont en costume de ville, Grinchu en cuisinier; M. Gobe-Mouche devra avoir un énorme chapeau, très en arrière; Mme Cornichon, un grand chapeau, très en avant: tous les deux devront tourner leurs pouces sans cesse.)
La scène représente un salon.
SCÈNE I.
MADAME OUISTITI, cherchant dans un tiroir.
Impossible de retrouver ma recette pour faire le thym. Tu es sûr de ne pas l'avoir, Anastase?
M. OUISTITI.
Moi? non, je....
MADAME OUISTITI.
C'est bon! ne bavarde pas tant; je n'en veux pas davantage! Ah! Seigneur, qu'allons-nous faire? déjà huit heures, et je ne sais comment faire ce maudit thym!
FOLLETTE, sautant.
Et les voisins vont arriver, hé! hé! hé! et tu seras bien vexée, maman! han! han!
MADAME OUISTITI.
Tais-toi, petit monstre! Tu retournes le poignard dans la plaie!
SCÈNE II.
GRINCHU, entrant.
Madame, je crois avoir trouvé votre recette, quoiqu'elle ne vaille pas grand'chose, à mon avis!
MADAME OUISTITI.
O bonheur! Anastase, nous sommes sauvés!
M. OUISTITI.
Oui, nous sommes....
MADAME OUISTITI.
C'est bon; je ne t'en demande pas davantage. Vite. Grinchu, donnez-moi cette recette.
GRINCHU.
Je me méfierais à la place de madame, elle a été écrite par M. Ricanant, qui aime à plaisanter, et il riait en la donnant! Enfin la v'là. Elle était collée, sauf respect, sur le ventre de la poupée de Mlle Follette en guise de cataplasme, avec du jus de réglisse.
MADAME OUISTITI.
Ciel! que c'est barbouillé! (Tâchant de lire.) Prenez... prenez... du... thym... in... in... (S'arrêtant). Pas possible de lire ce mot-là!
GRINCHU, regardant.
Il y a: infectez.
M. OUISTITI, de même.
Oui, je crois que....
MADAME OUISTITI.
C'est bon. Je ne t'en demande pas davantage. (Lisant.) Infectez le thym... dans... dans....
GRINCHU.
Madame se trompe; il y a avec.
MADAME OUISTITI.
Tenez, lisez, Grinchu; vous y verrez mieux que moi.
GRINCHU, lisant.
Infectez avec... hum... avec du vin de Bordeaux. Salez... salez... les tasses et servez avec du plâtre dedans.
MADAME OUISTITI, effrayée.
Comment, du plâtre? Ah! ça, mais! nos estomacs vont être recrépis, de cette façon-là; il n'y manquera plus que des pierres et de la peinture!
M. OUISTITI.
C'est vrai! nous allons....
MADAME OUISTITI, affairée.
C'est bon! Je ne t'en demande pas davantage. Vous êtes sûr, Grinchu, que vous avez bien lu....
GRINCHU, aigrement.
Madame me moleste bien à tort! Je suis remarquable par mon habileté à lire l'imprimé!
MADAME OUISTITI.
Eh bien, alors, arrangez-vous vite ce thym; car j'entends nos voisins qui arrivent.
(Grinchu sort.)
SCÈNE III.
MADAME CORNICHON, entrant.
Ma chère voisine, bonjour!
M. GOBE-MOUCHE, entrant.
Bonjour, madame Ouistiti! (Il rit.) Bonjour, monsieur Ouistiti. (Il rit.) Bonjour, mademoiselle Ouis....
FOLLETTE, éclatant de rire.
.... titi. Allez, monsieur, je sais mon nom sans que vous me le rappeliez.
M. GOBE-MOUCHE, déconcerté.
Je n'ai pas voulu vous vexer, mais seulement vous faire une politesse, mademoiselle Ouis....
FOLLETTE, saluant.
.... titi.
(Gobe-mouche reste la bouche ouverte.)
MADAME CORNICHON.
Que c'est aimable à vous, voisine, de nous faire goûter ce fameux tout dont on parle tant!
MADAME OUISTITI.
Vous voulez dire du thym, ma voisine.
MADAME CORNICHON.
Pardon, du tout. C'est ainsi qu'on appelle cette délicieuse tisane anglaise.
M. GOBE-MOUCHE.
Permettez! J'ai entendu dire que cela se nommait du tré, et je pense que c'est son vrai nom.
LES DEUX DAMES.
Tiens! pourquoi?
M. GOBE-MOUCHE, gravement.
Parce qu'il y a quatre substances qui composent ce breuvage.
SCÈNE IV.
GRINCHU, entrant.
Madame, v'là la soupe.
MADAME OUISTITI.
Dites donc le thym, Grinchu!
MADAME CORNICHON.
Non, le tout.
M. GOBE-MOUCHE.
Non, le tré.
GRINCHU, impatienté.
Enfin, v'là la machine, quoi!
M. OUISTITI.
Eh bien! il faudrait man....
MADAME OUISTITI.
C'est bon, on ne t'en demande pas davantage.
(Tout le monde s'assied, on sert.)
MADAME CORNICHON, buvant.
Chère voisine, il manque quelque chose à ce tout.
MADAME OUISTITI, agacée.
A ce thym, chère amie?
MADAME CORNICHON, insistant.
Oui, à ce tout. Il y faut mettre un peu de liqueur; on dit que ça le bonifie extraordinairement.
GRINCHU, à part.
Attends, toi, je vais t'apprendre à faire la difficile. (Haut.) Madame a raison. V'là de l'esprit-de-vin; n'y a rien de meilleur pour aromatiser ça! (Il en verse quelques gouttes à tout le monde et la valeur d'un grand verre à Mme Cornichon et à M. Gobe-Mouche.)
M. GOBE-MOUCHE, faisant des grimaces après en avoir goûté.
Chers voisins, c'est délicieux; si délicieux que je n'ose prendre toute ma tasse, ne voulant pas vous en priver...
MADAME OUISTITI, à part.
Ce thym est exécrable, je vais le faire boire à ce brave homme. (Haut.) Cher Monsieur, n'y mettez pas de discrétion. Ajoutez ma tasse à la vôtre, je m'en prive en votre faveur!
M. OUISTITI, à part.
Bien! je vais faire boire cet affreux breuvage à Madame Cornichon. (Haut.) Ma voisine, je fais comme ma...
MADAME OUISTITI.
C'est bon! On ne t'en demande pas davantage.
MADAME CORNICHON, ahurie.
Oh! je vais boire... tout ça? (Elle regarde ses tasses avec angoisse.)
M. GOBE-MOUCHE, de même.
Je suis très-reconnaissant, enchanté!... (Il lève les yeux au ciel.)
Les deux invités boivent en faisant des contorsions. Les Ouistiti sont ravis.
MADAME CORNICHON, se levant.
Je ne me sens pas bien, permettez que je me retire, la tête me tourne!
MADAME OUISTITI, l'accompagnant.
Chère voisine, je veux vous reconduire. (Dans la coulisse.) Ah! ciel! quelle catastrophe!
FOLLETTE, regardant.
Ah! pauvre madame Cornichon! Elle n'a pas gardé longtemps son tout.
M. GOBE-MOUCHE, chancelant.
Je me retire aussi. Cher voisin, adieu!
M. OUISTITI, effrayé.
Je ne vous accompagne pas, car je crains des accidents.
M. GOBE-MOUCHE, s'accrochant à lui.
Ne me quittez pas, je suis très-faible! (Ils sortent.)
M. OUISTITI, dans la coulisse.
Ouf! Grinchu, à mon secours!
MADAME OUISTITI, dans la coulisse.
Follette, à moi!
M. OUISTITI, de même.
Grinchu!
La toile tombe.
CHARITÉ.
|
Personnages. Un pauvre aveugle Un pauvre honteux Mme Étourneau Mme Réfléchie Juliette, fille de Mme Réfléchie 24 |
Acteurs. M. Armand.> M. Jacques. Mlle Jeanne. Mlle Élisabeth. Mlle Françoise. |
La scène se passe aux Champs-Élysées.--Mme Étourneau, Mme Réfléchie et Juliette se promènent.
Note 24: (retour) Costumes de fantaisie.
MADAME ÉTOURNEAU.
Chère amie, nous voici arrivées au but de notre promenade; vous me permettrez bien de donner à Juliette de quoi s'amuser et lui acheter ce dont elle aura envie.
MADAME RÉFLÉCHIE.
Volontiers, Azurine; mais ne faites pas de folies pour cette enfant.
MADAME ÉTOURNEAU.
Soyez tranquille, ma chère. (Elle tire vingt francs de sa bourse.) Tiens, Juliette, voilà vingt francs. Si tu n'en as pas assez, tu me le diras.
MADAME RÉFLÉCHIE.
Chère amie, je ne veux pas que vous donniez tout cela à Juliette, c'est beaucoup trop!
MADAME ÉTOURNEAU.
Mais pourtant....
MADAME RÉFLÉCHIE.
Du tout, donnez-lui cinq francs: cela lui suffira très-grandement.
MADAME ÉTOURNEAU.
Allons, je vous obéis. Tiens, Juliette.
JULIETTE.
Merci, madame; je vais acheter un ballon, si maman le permet.
MADAME RÉFLÉCHIE.
Je le veux bien.
(Elles vont vers une boutique.)
MADAME ÉTOURNEAU.
Ah! voilà un aveugle: tant mieux, j'adore les aveugles, moi. Tenez, mon brave.
L'AVEUGLE.
Merci de tout coeur, ma chère dame; oh! laissez-moi serrer votre main bienfaisante! (Il lui saisit le bras.)
MADAME ÉTOURNEAU.
C'est bien, mon brave, d'être reconnaissant. Tenez, voilà encore pour vous. (Elle lui donne.)
L'AVEUGLE, sans la lâcher.
Votre générosité est inépuisable! Comment vous dire ce que je ressens?
MADAME ÉTOURNEAU.
C'est inutile, lâchez-moi, je le devine bien.
L'AVEUGLE, de même.
Il faut que mon coeur parle, sans quoi la reconnaissance m'étoufferait. Je vais vous raconter ma lamentable histoire. (Il tousse, crache et se mouche.) Vous saurez donc, chère bienfaitrice....
MADAME ÉTOURNEAU, à part.
Ah çà mais! il m'ennuie, cet homme; il a une poigne de fer et il est bavard comme une pie.
L'AVEUGLE, d'une voix criarde.
Je suis né de parents pauvres.... (Il tousse, crache et se mouche.) J'ai quarante-six ans, trois mois et deux jours.
MADAME ÉTOURNEAU, à part.
Je voudrais bien m'en aller!
L'AVEUGLE, de même.
Je ne pesais que deux livres et demie à un mois. (Il tousse, crache et se mouche.) J'avais des digestions pénibles, je les ai encore, je souffre....
MADAME ÉTOURNEAU, impatientée.
Et moi aussi, lâchez-moi, insupportable bavard!
L'AVEUGLE, la laissant et s'en allant.
Bavard, moi?... jamais je n'ouvre la bouche, jamais je ne me plains; si vous croyez que je suis reconnaissant de vos aumônes, à présent! faut-il recevoir des reproches semblables et penser que....
(Sa voix se perd dans l'éloignement.)
MADAME ÉTOURNEAU.
Pouf! m'en voilà débarrassée. (Elle va vers ses amies.) Eh bien, avez-vous acheté des joujoux?
JULIETTE.
Je crois que je vais prendre ce beau ballon.
LE PAUVRE HONTEUX, approchant.
Vous avez perdu quelque chose, madame. (Il remet à Mme Étourneau son porte-monnaie.)
MADAME ÉTOURNEAU.
Mille remercîments, mon ami: pourrais-je vous offrir ceci comme récompense de ce service? (Elle veut lui donner de l'argent.)
LE PAUVRE HONTEUX, refusant.
Madame, je n'ai fait que mon devoir.
JULIETTE, bas.
Comme il est pâle, maman, ce pauvre homme!
MADAME RÉFLÉCHIE, bas.
Chère Azurine, ce brave garçon paraît souffrir. Il doit être très-pauvre et très-fier.
MADAME ÉTOURNEAU, de même.
Puisqu'il ne veut pas d'argent, c'est qu'il n'en a pas besoin.... Tiens! il chancelle et s'assoit sur un banc.
MADAME RÉFLÉCHIE, allant au pauvre.
Vous souffrez, mon ami, dites-le-moi sans crainte: un honnête homme doit être fier de supporter noblement la pauvreté.
LE PAUVRE HONTEUX, d'une voix faible.
C'est vrai, madame; je puis donc vous avouer que la faim me dévore....
JULIETTE.
Vite, mon ami, prenez mon goûter! Quel bonheur que je n'y aie pas encore touché!
MADAME ÉTOURNEAU, agitée.
Ça ne lui suffira pas, à ce malheureux! et moi qui le croyais à son aise! Je cours chercher un rosbif.
MADAME RÉFLÉCHIE, riant.
Cru?
MADAME ÉTOURNEAU, agitée.
Non, cuit; sera-ce bien?
MADAME RÉFLÉCHIE.
Il vaut mieux l'emmener chez moi et lui servir un bon bouillon; puis nous aviserons au moyen de le placer honorablement pour le tirer de sa misère.
LE PAUVRE HONTEUX.
Ah! madame, que de reconnaissance!
MADAME ÉTOURNEAU.
Voilà, chère amie, une bonne leçon pour moi. Donner de l'argent n'est rien: la vraie, la grande charité est de tirer les pauvres de leur misère. Je m'en souviendrai, je vous le promets!

Des applaudissements accueillirent ces dernières paroles: les petits acteurs furent tendrement embrassés par leurs parents, surtout par Irène et Julien, attendris et charmés.
ÉLISABETH, gaiement.
Eh bien, Irène, avoue que tout cela est préférable à tes brillantes réunions. Ces plaisirs simples sont innocents et nous laissent de paisibles et doux souvenirs.
IRÈNE.
Tu as raison, ma bonne Élisabeth; je me souviendrai de cette soirée avec une joie sans mélange.
MADAME DE GURSÉ.
Mes enfante, le thé et le chocolat sont servis dans la salle à manger! Allez-y avec vos amis et faites-leurs les honneurs de mon petit chez moi.
ÉLISABETH.
Oui, grand'mère chérie, nous obéissons.
On finit gaiement cette douce soirée de famille et les petits de Morville se retirèrent, s'avouant à eux-mêmes qu'ils s'étaient extrêmement amusés chez Mme de Gursé.
Le lendemain était le jour de réception de Mme de Morville: Irène devait y assister pour faire les honneurs du salon à ses élégantes amies qui accompagnaient déjà leurs mères en visite. Elle en était contrariée, les bonnes impressions que lui avait faites sa soirée de la veille étant encore toutes fraîches. Elle faisait donc assez triste mine quand sa mère lui remit une toilette du matin très-élégante pour sa chère poupée. Ce présent lui fit un plaisir extrême, mais il la replongea dans des pensées de frivolité et de toilette, et elle s'habilla avec soin après avoir paré sa fille.
Les visites commencèrent bientôt et furent nombreuses; Noémi, Constance, Herminie et quelques autres amies élégantes arrivèrent: il y eut bientôt dans le boudoir, devenu le salon de réception d'Irène, un cercle imposant de petites filles, plus richement habillées les unes que les autres. Irène s'étourdissait à plaisir dans ce milieu frivole et vain.
NOÉMI.
Êtes-vous sortie hier au soir, Irène?
IRÈNE, rougissant.
Oui, je suis allée avec maman chez la grand'mère d'Élisabeth.
CONSTANCE, avec dédain.
De cette petite si mal mise? Comment, ma chère, vous fréquentez encore cette enfant? Quel tort vous vous ferez!
IRÈNE.
Et quel tort voulez-vous que cela me fasse?
HERMINIE, sèchement.
Le tort de descendre au-dessous de votre position: les habitudes de cette Élisabeth ne cadrent pas avec les nôtres; elle n'a pas le moindre chic.
NOÉMI, étonnée.
Qu'est-ce que vous dites donc, Herminie?
IRÈNE, de même.
C'est vrai, quel drôle de mot! je ne le connaissais pas.
HERMINIE.
Chic veut dire bon genre. On dit beaucoup ce mot-là chez maman; chez la princesse de Tréville on en dit encore bien d'autres!
NOÉMI, résolûment.
Tant pis; c'est vilain de parler comme ça.
IRÈNE.
Ah! voilà Justement la petite princesse qui arrive: bonjour, Lionnette, vous voilà avec votre nouvelle fille? elle est délicieusement jolie!
LIONNETTE.
Permettez que je vous la présente officiellement, mesdemoiselles. Chère Irène, chère Noémi, mademoiselle Constance, chère Herminie, mesdemoiselles, j'ai l'honneur de vous présenter ma fille Cocodette. Elle réclame votre amitié.
«Elle est charmante, Cocodette!» dirent en choeur les petites en embrassant la poupée.
Irène et Lionnette présentèrent ensuite leurs filles l'une à l'autre: celle d'Irène qui portait le nom (trouvé trop simple) de Mathilde, fut rebaptisée de celui de Gladiatrice, en l'honneur du célèbre cheval de course du comte de Lagrange. Il fut convenu que les fêtes du baptême auraient lieu le lendemain aux Tuileries: Julien devait être le parrain, et Noémi, la marraine.
Le jour suivant, Julien et Irène arrivèrent solennellement aux Tuileries, suivis d'un garçon confiseur qui portait un grand panier. Tous les enfants accueillirent avec enthousiasme les petits de Morville, et leur joie fut extrême quand Julien découvrit aux yeux de l'assemblée une multitude de jolies petites boîtes de dragées et de fruits confits, vraies miniatures de boîtes de baptême. Il pria galamment Noémi de vouloir bien, en sa qualité de marraine, offrir elle-même ces boîtes, et la distribution se fit au milieu d'une joie générale.
LE GARÇON.
Voici la note, monsieur: je désire régler le compte tout de suite, si vous voulez bien.
JULIEN, à voix basse avec embarras.
Mon Dieu! mon ami, je crois que j'ai oublié ma bourse: apportez-moi, je vous en prie, la note chez moi, rue....
LE GARÇON.
C'est impossible, monsieur, on m'a recommandé au magasin de ne pas livrer sans être payé sur-le-champ: je vais rentrer et il me faut mon argent.
JULIEN, troublé.
C'est que je comptais payer seulement en rentrant. Je suis désolé....
IRÈNE, s'approchant.
Qu'y a-t-il, Julien?
JULIEN.
Hélas! il y a que le garçon veut être payé tout de suite, et je n'ai pas d'argent! en as-tu, toi?
IRÈNE.
Non, pas ici; à la maison, j'ai six francs.
JULIEN, désolé.
Tu n'as que cela? Ah! mon Dieu! moi qui comptais sur toi pour acquitter cette maudite note. Je n'ai que deux francs cinquante centimes et elle est de vingt-six francs. Papa va me gronder, maman aussi! Quelle affaire!
IRÈNE, vivement.
Attends, j'ai une idée, mon pauvre ami; je vais emprunter à Noémi. Elle a toujours beaucoup d'argent dans sa bourse. Elle va nous tirer d'affaire. (Elle s'éloigne en courant.)
LE GARÇON, froidement.
Eh bien, monsieur, et la note?
JULIEN.
Tout à l'heure.
JORDAN.
Paye donc, Julien.
JULES.
Une pareille bagatelle!
VERVINS.
Tu as l'air mal à l'aise; voilà qui serait curieux de te voir si à court!
JULIEN.
Attendez... je vais....
(Il frappe du pied; ses camarades ricanent.)
IRÈNE, revenant.
Je suis au désespoir, Julien! Noémi a perdu sa bourse en venant. Herminie dit qu'elle ne prête jamais rien, et Constance m'a répondu en ricanant que charité bien ordonnée commence par soi-même. Que faire?

ARMAND, arrivant.
Bonjour, monsieur le parrain, Mlle Noémi vient de me remettre de votre part deux jolies boîtes: je vous remercie d'avoir songé à moi.
LE GARÇON, impatienté.
Monsieur, finissons-en, je suis pressé.
ARMAND, surpris.
Qu'y a-t-il, Julien? Vous et Irène paraissez contrariés, chagrins même! Élisabeth, arrive donc, j'ai besoin de toi.
ÉLISABETH, s'approchant.
Bonjour, chers amis, merci de....
ARMAND, précipitamment.
Chut! Il ne s'agit pas de ça; je soupçonne que nos amis sont dans l'embarras!
LE GARÇON.
Cela pourrait bien être; je ne puis pourtant revenir chez mon patron sans les vingt-six francs qui me sont dus.
ARMAND.
Attendez un instant. (Il parle bas avec Élisabeth.)
ÉLISABETH, au garçon.
Où est votre note?
LE GARÇON.
La voici, mademoiselle.
ARMAND.
Elle est acquittée? très-bien. Tenez, voilà votre argent, (Élisabeth et Armand paient le garçon.)
LE GARÇON.
Merci, monsieur.
Pendant ce temps, Irène et Julien, d'abord stupéfaits, s'étaient jetés dans les bras de leurs vrais, de leurs excellents amis. Il les remerciaient avec attendrissement du service qu'ils venaient de leur rendre avec tant de délicatesse et de générosité.
ARMAND.
Ah bah! ne parlons plus de ça. Venez jouer, maintenant. Tenez, voilà les élégants qui organisent... eh! mais, Dieu me pardonne, ils daignent organiser une partie de cache-cache! enfoncés, les règlements du club le Beau Monde!
Les quatre enfants allèrent prendre leur part du jeu et les élégants s'étaient humanisés au point de bien accueillir les petits de Kermadio.
La journée finit gaiement, grâce à l'entrain irrésistible d'Armand et d'Élisabeth.
Le soir même, les petits de Kermadio reçurent l'argent qu'ils avaient prêté à leurs amis, avec deux charmants porte-monnaie en ivoire sculpté. Un petit billet de Julien accompagnait cet envoi.
«Cher Armand, écrivait-il, j'ai tout raconté à papa; il m'a pardonné. Irène et moi, nous vous embrassons, toi et Élisabeth, en vous disant encore et toujours merci!
Ton ami reconnaissant,
Julien de Morville.»

«Mais qu'as-tu donc, Élisabeth? disait Mme de Kermadio à sa fille, au moment où celle-ci s'apprêtait à se rendre aux Tuileries avec son frère: tu es pâle, tu as mauvaise mine.
--Je ne me sens pas bien, en effet, maman, répondit Élisabeth, j'ai un malaise général, et je ne serais pas étonnée d'avoir un petit accès de fièvre; c'est probablement un peu de rhume.»
Mme de Kermadio, inquiète, examina attentivement le visage de sa fille, lui tâta le pouls et reconnut qu'elle avait, non pas un peu de fièvre, mais une très-forte fièvre. Justement alarmée, elle envoya chercher à la hâte le docteur Trébaut, l'excellent médecin de la famille. Elle voulait faire faire à Armand sa promenade accoutumée, mais le petit garçon était aussi tourmenté que sa mère de la santé d'Élisabeth et obtint de Mme de Kermadio qu'il resterait près de sa soeur.
Le docteur arriva; son coup d'oeil exercé vit tout de suite chez la petite fille les germes d'une grave maladie, et son visage s'assombrit.
«C'est la scarlatine qui commence, madame, dit-il. Monsieur Armand ne doit pas s'approcher de sa soeur, ni même rester dans la même chambre qu'elle. Consacrez-vous à la malade, tandis que votre fils demeurera près de son père.
ARMAND, pleurant.
Oh! mon Dieu! quel malheur, ma pauvre Élisabeth! ne plus te voir, justement quand tu es malade et que tu vas être toute seule!
MADAME DE KERMADIO.
Voyons, mon cher enfant, du courage! au lieu d'attrister ta soeur, donne-lui l'exemple de la fermeté: prions bien le bon Dieu qu'il la guérisse vite, cela vaudra mieux que de se désoler.
ÉLISABETH.
Armand, console grand'mère; je te confie aussi la mère Préval, ma paralytique: dis-lui pourquoi je ne vais pas la voir; soigne-la à ma place, je t'en prie.
ARMAND.
Oui, ma chère Élisabeth, sois tranquille, je la dorloterai bien, va! tu la retrouveras en bon état!
Élisabeth, sa mère et le docteur ne purent s'empêcher de rire du ton lamentable avec lequel le pauvre garçon disait cela. Mme de Kermadio fit sortir Armand de la chambre d'Élisabeth; il alla tristement chez son père, qui venait de rentrer et lui annonça la maladie qui frappait la petite fille. M. de Kermadio se hâta d'aller chez sa fille, mais le docteur l'empêcha résolûment d'entrer.
«Vous ne pouvez voir Mlle Élisabeth, cher monsieur, lui dit-il, sans courir un danger sérieux et en faire courir un aussi sérieux à M. Armand, car aucun de vous n'a encore été atteint de la scarlatine; Mme de Kermadio, l'ayant eue, peut au contraire soigner impunément sa fille; on n'a, Dieu merci, qu'une fois cette terrible maladie.»
La tristesse régnait donc dans cette maison, la veille encore si gaie: on suivait scrupuleusement les prescriptions du docteur, et le silence était religieusement gardé, pour ne pas fatiguer la tête de la pauvre malade. Cela était d'autant plus facile, qu'Élisabeth était l'âme de la maison, et l'animation, la gaieté bruyante d'Armand avaient disparu depuis qu'il savait sa soeur sérieusement malade. Le pauvre enfant refusait de sortir et se contentait de jouer dans le petit jardin de l'hôtel, afin, disait-il, d'avoir à chaque instant des nouvelles de sa chère Élisabeth: en outre, il lui préparait des surprises et jardinait avec ardeur pour qu'elle pût trouver à sa convalescence une corbeille des fleurs hâtives qu'elle aimait le plus.
Il eut tout le temps de préparer ses surprises, car la maladie d'Élisabeth fut longue et dangereuse: mais cette charmante nature était digne de la croix que Dieu lui envoyait: elle supporta ses souffrances avec un courage de vraie chrétienne. Sa patience, sa douceur attendrissaient profondément Mme de Kermadio, sa bonne et Mlle Heiger: cette dernière ayant eu la même maladie, pouvait soigner et soignait avec bonheur son élève bien aimée. Pendant cette douloureuse maladie, jamais Élisabeth ne se montra égoïste: elle s'oubliait, au contraire, pour ne songer qu'aux autres et leur témoigner de la façon la plus tendre, la plus charmante, sa reconnaissance pour l'affection et les bons soins dont elle était entourée.
Chaque jour, Armand se donnait la consolation de lui dire un petit bonjour par le trou de la serrure, et bien souvent il lui criait:
«Grand'mère va bien, je la fais rire souvent.
«Ta paralytique est en bon état. Elle engraisse un peu.--Mon ivrogne se conduit toujours très-bien.--Guéris-toi vite, ma petite Élisabeth, pour que nous puissions aller les voir ensemble!»

Enfin arriva cet heureux jour où Élisabeth, convalescente, put voir et embrasser son père, son cher Armand et toute sa famille, surtout son excellente grand'mère. Ce fut une vraie fête dans la maison, redevenue aussi joyeuse, aussi bruyante qu'elle était grave et triste pendant la maladie de la bonne et charmante petite fille.
Les premiers instants d'effusion passés, les enfants se mirent à jouer dans la chambre d'étude, convertie en salle de jeu pour ce jour de fête.
Élisabeth étant encore un peu faible, les amusements fatigants cessèrent vite, et l'on s'assit pour causer.
ARMAND.
Une chose m'étonne beaucoup, mes amis, c'est que pendant toute la maladie de ma chère Élisabeth, pas une fois Irène et Julien ne sont venus s'informer de ses nouvelles; ils n'en ont pas même fait demander. C'est mal et ingrat!
ÉLISABETH.
Ne les accuse pas étourdiment, Armand; ils ne savent probablement pas que j'ai été malade.
ARMAND.
Ils ont dû le savoir bien vite par nos cousins aux Tuileries; d'ailleurs, pourquoi ne pas venir nous voir?
JACQUES.
Doucement donc, Armand, tu parles comme une corneille qui abat des noix: si Irène et Julien ne sont pas venus ici, ils n'ont pas non plus mis les pieds aux Tuileries depuis le jour des charades. Tu vois qu'ils ne peuvent savoir ce qu'a eu Élisabeth; j'ajoute que l'on dit aux Tuileries M. et Mme de Morville dans une très-triste position; ils ont, paraît-il, vendu Morville, leur hôtel et même tout leur mobilier; enfin, on ne sait ce qu'ils sont devenus.
ÉLISABETH, désolée.
Mon Dieu! quel malheur... quel coup terrible! Depuis quand sais-tu cela, Jacques?
JACQUES.
Depuis près de quinze jours.
ARMAND, vivement.
Et tu ne me l'as pas dit! et tu me les laisses accuser sans souffler mot?
JACQUES.
Avec cela que tu es discret comme un boulet de canon, toi: tu n'aurais jamais pu t'empêcher de crier cela à Élisabeth, qui était encore très-malade! cela l'aurait agitée, désolée; cela aurait fait une belle affaire!
ARMAND.
Tu as raison. Pauvre Irène! pauvre Julien! qu'ils doivent être malheureux!... Ruinés tout d'un coup! quelle terrible chose!
PAUL.
Et ils tiennent tant au luxe! ce malheur les frappera d'autant plus!
JEANNE.
C'est vrai! quel changement de vie ce doit être pour eux!...
FRANÇOISE.
Où demeurent-ils, puisqu'ils ne sont plus dans leur hôtel?
JACQUES.
Je n'en sais rien.
ÉLISABETH.
Peut-être papa le saura-t-il; il voyait assez souvent M. de Morville. Je vais le lui demander.
Les enfants suivirent Élisabeth, qui courut au salon. M. et Mme de Kermadio, Mme de Gursé et même M. et Mme de Marsy avaient entendu parler de la ruine subite et complète de M. de Morville, mais ils ignoraient où il s'était installé depuis qu'il avait quitté son hôtel.
M. DE KERMADIO.
Ce sont des spéculations qui l'ont ruiné, chère enfant, voilà la cause de ce malheur subit.
ARMAND.
Qu'est-ce que c'est que des spéculations, papa?
M. DE KERMADIO.
C'est quand on risque imprudemment de l'argent, mon ami; on court la chance de beaucoup gagner, comme on risque de beaucoup perdre. C'est cette dernière chose qui est arrivée à M. de Morville.
ARMAND.
C'est vilain, les spéculations; je n'en ferai jamais. Il vaut bien mieux gagner beaucoup moins et à coup sûr, n'est-ce pas, grand'mère?
MADAME DE GURSÉ.
Je suis de cet avis, cher petit; M. de Morville, non content de sa grande fortune, a voulu l'augmenter encore; il en a été, tu le vois, cruellement puni.
JACQUES.
Julien faisait en petit pour les timbres ce que son papa faisait en grand pour les affaires; te rappelles-tu, Armand? il nous a dit un jour: «Moi, je fais aux Tuileries comme papa à la Bourse; j'ag... j'agia....
M. DE MARSY, en riant.
J'agiote....
JACQUES.
C'est cela, papa. Quel drôle de mot!
M. DE MARSY.
J'agiote ou je spécule veulent dire, je fais des affaires hasardeuses. Je prie Dieu, mes enfants, de ne jamais vous entendre dire ces tristes mots-là.
ÉLISABETH.
Que je voudrais voir et consoler la pauvre Irène! Chère maman, voulez-vous que nous tâchions de découvrir sa nouvelle demeure?
MADAME DE KERMADIO.
Oui, mon enfant, dès que tu seras complètement rétablie.
ÉLISABETH, soupirant.
Attendre huit ou dix jours encore, peut-être: Dieu! que c'est long!...
ARMAND.
Maman, j'ai une idée: voulez-vous me permettre d'aller avec Mlle Heiger, à la recherche d'Irène et de Julien? comme cela, Élisabeth aura leur adresse sans se fatiguer, et pourra y aller avec moi, dès qu'elle sortira!
ÉLISABETH, l'embrassant.
Oh! Armand! que tu es bon!
Tout le monde approuva le petit garçon, et Armand, triomphant de son idée, alla dès le lendemain aux Tuileries, afin de savoir par les élégants, où demeuraient ceux avec lesquels ils étaient si intimes au temps de leur prospérité.

Arrivée aux Tuileries, Mlle Heiger voulut bien laisser à Armand la gloire de rechercher tout seul l'adresse tant désirée par Élisabeth, et le petit de Kermadio alla tout droit à Vervins, à Jules et à Jordan, qui discutaient gravement sur le plus ou moins de grâce que pouvait avoir le noeud d'une cravate.
ARMAND.
Bonjour, monsieur Jules, pouvez-vous avoir l'obligeance de me donner la nouvelle adresse de Julien?
JULES, maussade.
Est-ce que je sais, moi! informez-vous auprès de ces messieurs.
VERVINS, froidement.
Je ne fréquente que les gens qui sont dans ma position, je ne puis donc vous renseigner en rien.
JORDAN.
Moi non plus; je les ai tout à fait perdus de vue.
JULES, ricanant.
Je crois bien! Voir des gens ruinés!
ARMAND, saluant.
Merci, mille fois, messieurs; il est impossible de rendre service avec meilleure grâce et plus de politesse, j'en suis charmé.
Et il s'en alla en riant, laissant les trois amis grommeler contre lui, sans oser engager une dispute, la mine résolue et l'air vigoureux du petit Breton leur laissant voir qu'il ne ferait pas bon l'attaquer.
Armand, sans se décourager, se dirigea vers le groupe des élégantes, fort occupées ce jour-là à donner des avis sur une partie de plaisir projetée au bois de Boulogne; aussi le pauvre garçon fut-il encore plus mal accueilli par les amies d'Irène que par les amis de Julien.
CONSTANCE, indignée.
C'est inouï! on ne peut pas jouer tranquillement ici! il faut toujours que ce petit garçon nous dérange ou nous taquine!
HERMINIE, légèrement.
Laissez-nous tranquilles avec votre Irène: je ne la vois plus et j'en suis enchantée; c'était une orgueilleuse!
ARMAND.
Voyons, mademoiselle Noémi, vous au moins, vous serez bonne et aimable, vous me donnerez peut-être un renseignement sur mes pauvres amis!
NOÉMI, avec impatience.
Que voulez-vous que je sache? ils ont disparu sans me faire rien dire, ce qui est peu gracieux, vu que j'ai toujours été charmante pour eux, n'est-ce pas, Lionnette?
LIONNETTE.
Trop charmante, ma mignonne, ils ne le méritaient certainement pas.
ARMAND, insistant.
Vous ne savez rien, rien du tout à leur sujet, dites, mademoiselle?
NOÉMI, habillant sa poupée.
Attendez donc! je crois avoir entendu dire à papa, hier au soir: «Et dire que ces malheureux Morville en sont réduits à loger avenue de Breteuil! dans un épouvantable quartier perdu!»
ARMAND, avec joie.
De notre côté! quel bonheur!...
NOÉMI, avec horreur.
Vous logez par là?
ARMAND, riant.
Non, non, rassurez-vous. Nous demeurons rue de Grenelle, 91.
NOÉMI.
A l'hôtel Saint-Marcel, il est très-beau, je le connais: nous allons y voir quelquefois Mme de Nogent à laquelle il appartient.
ARMAND.
C'est ma grand'tante.
CONSTANCE, radoucie.
C'est magnifique, cela. Allez donc chercher mademoiselle votre soeur, monsieur, et dites-lui que je serai charmée de jouer avec elle.
HERMINIE.
Moi aussi, je lui donnerai des bons conseils pour sa toilette. Quand on a une si belle position, on doit tenir son rang.
LIONNETTE.
C'est évident; je la protégerai, moi, cette petite. Allez nous la chercher, monsieur.
ARMAND.
Cela m'est malheureusement impossible, mesdemoiselles; elle est convalescente et ne sort pas encore. Mais je lui dirai avec quelle amabilité vous l'accueillerez... à cause du bel hôtel de notre tante!...
Armand salua ironiquement les élégantes, honteuses du juste mépris du petit Breton pour leurs vils sentiments: elles venaient de les démasquer en flattant bassement la richesse.
Victoire, chère mademoiselle, s'écria-t-il, en rejoignant Mlle Heiger; Noémi a fini par m'apprendre l'adresse! ah! j'ai eu de la peine: sont-ils insolents et désagréables, ces élégants-là! enfin, je l'ai; tout le reste m'est égal!
MADEMOISELLE HEIGER.
A merveille, Armand: où demeurent vos pauvres amis?
ARMAND.
Avenue de Breteuil.
MADEMOISELLE HEIGER.
Mais ce n'est pas loin de nous, c'est dans le même quartier. Élisabeth va être enchantée! et le numéro?
ARMAND, stupéfait.
Le numéro?
MADEMOISELLE HEIGER.
Eh bien, oui, le numéro; il faut le savoir pour y aller.
ARMAND, consterné.
Le numéro... mon Dieu, mon Dieu, j'ai oublié de le leur demander!
MADEMOISELLE HEIGER.
Allez vous en informer près de Noémi.
ARMAND, piteusement.
Ça m'ennuie, car je leur ai dit des choses désagréables avant de m'en aller, et je suis sûr qu'elles vont m'accueillir comme un chien dans un jeu de quilles.
MADEMOISELLE HEIGER.
Vous avez eu tort, Armand. A quoi sert de dire des choses blessantes? rappelez-vous le proverbe: mieux vaut douceur que violence.
ARMAND.
Vous avez raison, mademoiselle, je me résigne à y aller. (Il se dispose à partir.)
MADEMOISELLE HEIGER.
Non, mon enfant, restez ici et goûtez tranquillement tandis que j'irai, moi, savoir ce numéro.
ARMAND.
Merci, mademoiselle; vrai, vous me rendrez un fameux service.
Armand, enchanté, goûta joyeusement pendant que la bonne et aimable institutrice demandait à Noémi le renseignement qui lui manquait: elle revint bientôt, mais elle paraissait contrariée.
«Qu'y a-t-il, mademoiselle, s'écria Armand, remarquant sa figure chagrine; est-ce que ces petites péronnelles auraient été impertinentes pour vous?
--Ce n'est pas cela, Armand, répondit en souriant à demi Mlle Heiger, mais Noémi ne sait pas le numéro et dit que son père ne le sait pas non plus.

ARMAND, désolé.
Que faire alors?
MADEMOISELLE HEIGER.
S'armer de patience et venir demain avec moi parcourir l'avenue de Breteuil pour demander de porte en porte Mme de Morville. L'avenue n'est pas excessivement longue, heureusement; nous finirons bien par trouver ce que nous cherchons.
ARMAND, radieux.
C'est cela, mademoiselle; en voilà, un bonheur; c'est Élisabeth qui va être contente!»
Élisabeth fut enchantée, en effet, des patientes recherches d'Armand et de son succès: le jour suivant, Mlle Heiger et le petit garçon se rendirent avenue de Breteuil. Armand, toujours impétueux, eut à subir une série de mésaventures tragi-comiques. Il se lança étourdiment dans une allée sombre et roula pêle-mêle avec un charbonnier et un sac de charbon; il marcha sur la queue d'un chat qui, pour se venger, le griffa à la main, et il finit par écraser l'orteil d'un vieux portier goutteux qui poussa des cris horribles et assura qu'Armand périrait sur l'échafaud.
Mais tous ces malheurs n'affaiblirent en rien l'ardeur d'Armand à la recherche de ses amis, et son courage fut enfin récompensé par cette bonne parole d'un concierge: «C'est ici.»
MADEMOISELLE HEIGER.
Entrez-vous, Armand?
ARMAND.
J'en serais bien content, mademoiselle; mais je ne veux pas y aller seul sans Élisabeth. Cela lui ferait de la peine.
MADEMOISELLE HEIGER.
Bien, mon cher Armand, je reconnais là votre coeur et votre tendresse pour votre soeur. Elle le mérite! allons, venez; il faut lui raconter votre plein succès.
ARMAND, riant.
Et mes maladresses!
Élisabeth accueillit avec bonheur les nouvelles rapportées par les promeneurs: elle rit de tout son coeur au récit des aventures de son frère, et après quelques jours de soin, elle put enfin sortir. A son grand regret, l'avenue de Breteuil était trop loin pour elle et elle ne put se rendre chez les petits de Morville que le surlendemain.

Élisabeth et Armand, accompagnés de leur bonne Anna, se rendirent avenue de Breteuil et demandèrent avec émotion les petits de Morville. Ils y étaient, heureusement: le frère et la soeur, le coeur ému, les larmes aux yeux, montèrent un misérable petit escalier tournant et frappèrent à une porte disjointe.
On leur dit d'entrer; ils ouvrirent et s'avancèrent timidement vers Mme de Morville qui, tout en larmes, était assise dans un mauvais fauteuil, seule dans une petite pièce misérablement meublée.
Elle leva la tête et reconnut les amis de ses enfants.
«Vous voici, chers petits? s'écria-t-elle avec surprise et émotion: votre amitié dévouée a donc su trouver notre triste demeure? Je le disais bien à mes pauvres enfants ces jours-ci: qu'ils vont être heureux de vous voir!
ÉLISABETH.
Pouvons-nous aller les embrasser, madame?
--Vous n'irez pas loin pour les trouver, répondit Mme de Morville, en souriant tristement; ils sont là à côté; entrez-y, mes chers enfants.»
Anna était restée discrètement sur le palier: les enfants lui dirent tout bas de s'asseoir sur une petite banquette de bois qui se trouvait là et de les attendre, puis ils coururent chez leurs amis.
On entendit deux cris: Armand! Élisabeth!... puis, plus rien que des sanglots et des baisers; les pauvres enfants s'étaient jetés dans les bras des petits de Kermadio et pleuraient à chaudes larmes en les embrassant. Élisabeth et Armand leur rendaient leurs caresses avec effusion: ils pleuraient aussi.
Quand ils furent un peu calmés, Irène fit asseoir son amie sur l'unique chaise de paille qui se trouvait dans la petite chambre, et Julien offrit à Armand un vieux tabouret. Deux petits lits de fer séparés par un paravent, une table de bois avec une cuvette, un pot à eau et un verre complétaient leur triste ameublement.

IRÈNE.
Vous voilà, ma bonne, ma chère amie! vous avez réussi à nous découvrir! vous avez donc eu la bonté de nous chercher?
ÉLISABETH.
Ma pauvre chère Irène!... tiens, permets que nous nous tutoyions fraternellement! tu me connais bien peu si tu as pu douter de mon amitié un seul instant: je te suis aussi attachée que par le passé.
ARMAND, avec reproche.
Pourquoi ne pas m'avoir écrit, Julien! je serais accouru tout de suite pour te voir, te consoler, te dire que je t'aime toujours!
JULIEN, pleurant.
Je n'osais pas, Armand. Si tu savais comme j'ai été reçu par mes anciens amis des Tuileries lorsque j'ai été les voir, après notre ruine! Alors j'ai pensé que peut-être tu en ferais autant, et cette idée-là m'a fait tant de peine....
ARMAND.
Tais-toi, méchant. Bats-moi, dis-moi des sottises, mais ne doute pas de mon attachement, entends-tu?
JULIEN, l'embrassant.
Pardonne-moi, mon cher ami; j'ai été si malheureux, si maltraité que je n'avais plus la tête à moi!
IRÈNE, s'essuyant les yeux.
Voilà le premier instant de joie que nous avons depuis notre ruine: c'est à toi que je le dois, chère Élisabeth! je ne l'oublierai pas.
ÉLISABETH.
Je serais venue bien plus tôt, va, si je n'avais été si malade!
Et elle raconta à ses amis ce qui lui était arrivé. Puis Armand leur dit à son tour les recherches qu'il avait faites à leur sujet. Les petits de Morville étaient vivement émus de se voir l'objet d'une amitié si pleine de sollicitude.
ÉLISABETH.
A présent, chère Irène, parlons raison. Quelles sont tes ressources? Que comptes-tu faire?
IRÈNE.
Jusqu'ici je n'ai fait que pleurer... je suis si malheureuse, si abattue par la douleur!
ÉLISABETH, avec tendresse.
Du courage, Irène: ne te laisse plus abattre ainsi. Crois-moi, cela ne remédie à rien de se désoler; non-seulement on est inutile, mais on attriste et on décourage les autres.
IRÈNE.
Je vais tâcher, va, d'être calme et raisonnable. Ta visite, ton amitié me remontent tellement!
ÉLISABETH.
Tant mieux! Quelles seront tes occupations?
IRÈNE.
Maman a pu garder mon piano, je vais l'étudier très-sérieusement. Peut-être voudra-t-on, dans quelques maisons où me conduisait maman, me laisser donner des leçons de piano. J'ai très-bien enseigné la musique l'année dernière, tu te le rappelles, aux petites de Kerden, aux bains de mer. C'était pour m'amuser que je le faisais; maintenant, hélas, ce sera pour vivre!
ÉLISABETH.
Chut! pas d'hélas! le courage est toujours gai, et il est convenu que tu vas être courageuse. Maman avait bien prévu que tu songerais à t'occuper ainsi: elle me charge donc, 1° de mettre à ta disposition toute ma musique, cahiers et sonates (Irène veut remercier). Chut! Puis elle te demande, et je te supplie de nous accorder cela, de me donner des leçons de piano deux fois par semaine. Tes jours et tes heures seront les nôtres, tu me permettras de venir les prendre ici, afin de ne pas déranger ta mère. Pour le prix, il sera fixé, si tu le veux bien, à 5 francs par leçon.
IRÈNE, d'une voix entrecoupée.
Mon amie.... Élisabeth... cette bonté... cette délicatesse.... (Elle pleure.)
ÉLISABETH, riant et pleurant.
Chut donc, ma chérie, je ne veux plus qu'on pleure ici, moi! (Elles s'embrassent.)
ARMAND, gaiement.
A nous deux, Julien! que feras-tu, toi, quand tu auras fini de pleurer?
JULIEN, souriant à demi.
J'ai, Dieu merci, un certain talent de dessin et d'aquarelle: je cultivais, par vanité, ces heureuses dispositions; ce sera par nécessité, maintenant.
ARMAND.
Très-bien, voilà mon affaire, tu seras mon maître.
JULIEN.
Je crains de ne pas savoir suffisamment....
ARMAND.
Ta, ta, ta, ta! ne fais pas le modeste: papa dit que tu dessines remarquablement: il m'a déclaré qu'il serait charmé de te voir me donner des leçons. Pendant qu'Élisabeth pianotera, moi, je barbouillerai. Les prix de leçons seront les mêmes que pour Élisabeth. Tu veux bien?
Un sanglot fit tourner la tête aux enfants. M. et Mme de Morville se tenaient à la porte, les yeux baignés de larmes.
MADAME DE MORVILLE.
Oui, ils acceptent, chers enfants, ces bienfaits de votre admirable tendresse; et je les accepte avec eux. Pour la première fois depuis ma ruine, je me sens heureuse. Je suis fière de voir mes enfants se mettre courageusement à l'oeuvre pour gagner leur vie: je suis heureuse de les voir aimés de vous, qui êtes si noblement dévoués au malheur!
M. DE MORVILLE.
Je pense comme vous, chère Suzanne: le courage me revient en admirant le dévouement et l'affection de ces excellents coeurs: merci à vous, de me rendre la force qui me faisait défaut!
Les enfants embrassèrent tendrement M. et Mme de Morville et après d'affectueuses paroles échangées, il fut convenu, avant de se quitter, que les petits de Kermadio viendraient le lendemain, prendre leurs premières leçons: après, ils emmèneraient leurs amis aux Tuileries, afin d'éviter à Mme de Morville la peine de les y conduire; les quatre enfants s'applaudissaient, d'ailleurs, de cette occasion de se voir plus longtemps et tout à leur aise.

Les premières leçons se passèrent à merveille. Les petits maîtres mettaient à enseigner une patience admirable; les petits écoliers, de leur côté, étaient d'une docilité exemplaire et, leur intelligence vive et prompte aidant, chaque leçon fut excellente. La joie était revenue chez les pauvres Morville avec le courage et l'amour du travail. Mme de Morville s'occupait entièrement de son petit ménage et employait le temps resté sans emploi à des ouvrages de couture, de broderie, de tapisserie. Après la première leçon, les enfants se dirigèrent gaiement, suivis d'Anna, vers les Tuileries: Irène et Julien étaient pourtant un peu mal à l'aise en regardant, l'une sa robe de laine brune, son talma de drap noir et son modeste chapeau de feutre noir, sans ornements, et l'autre son vêtement de gros drap gris et sa casquette de cuir verni. Leurs parents avaient dû se défaire de tous leurs vêtements élégants et les remplacer par d'autres, appropriés à leur très-modeste position.
Il faisait un temps magnifique, aussi les Tuileries étaient-elles en fête: les allées regorgeaient d'enfants, plus coquettement habillés que jamais. Les quatre amis se trouvèrent tout à coup face à face avec leurs anciens camarades.
IRÈNE, saisie.
Ah! voilà toutes mes amies!
«Bonjour; Constance, bonjour Noémi, bonjour Herminie, bonjour Lionnette, Jenny, Diane et Clara, vous allez bien? voulez-vous jouer?»
Les élégantes levèrent la tête avec une surprise qui se changea en indignation quand elles eurent reconnu Irène et contemplé ses vêtements.
LIONNETTE, majestueusement.
Bonjour, mademoiselle. (Elle se détourne.)
CONSTANCE, à demi-voix.
A-t-on jamais vu! oser vouloir jouer avec nous dans une toilette semblable!
HERMINIE, de même.
Ah! l'horreur! elle est encore pis que son inséparable. C'est hideux à voir! on ne devrait pas permettre de laisser entrer aux Tuileries des fagots comme ça!

LES AUTRES PETITES FILLES, de même.
Qu'elle s'en aille. Nous ne voulons pas d'elle!
IRÈNE, pleurant.
Ah! que vous êtes méchantes de me traiter ainsi! Est-ce parce que je ne suis plus riche? Noémi, vous qui avez toujours été si affectueuse pour moi....
NOÉMI, embarrassée et froide.
Ma chère, vous comprenez.... Il y a longtemps que nous ne nous sommes vues. Nous n'avons guère l'occasion de nous rencontrer maintenant.
IRÈNE, douloureusement.
Assez, oh, assez, Noémi, je vous quitte, je vous délivre de ma présence, en remerciant le bon Dieu, toutefois, qui m'a permis de voir combien je dois peu vous regretter: je sais maintenant à quoi m'en tenir sur votre amitié à mon égard. Toutes vos prévenances d'autrefois s'adressaient à mes toilettes, à ma fortune, et moi, folle, je prenais cela pour moi!... Dieu merci, vous venez de me faire voir ce que vous êtes.
ÉLISABETH.
Chère amie, c'est une triste expérience: je m'attendais à ce résultat! tu as raison de te réjouir: tu vois clair à présent, et désormais tu sauras juger les autres non selon ce qu'ils ont, mais selon ce qu'ils valent.--Plaignons ces pauvres petites, et ne leur adressons plus la parole.
HERMINIE, ricanant.
Ah! ah! ah! Vous voudriez bien être à notre place, mademoiselle la dédaigneuse!
ARMAND, s'avançant.
Ce n'est pas vrai, petite insolente! Élisabeth serait bien désolée d'être aussi ridicule que vous avec votre énorme cage à serins, vos panaches de chevaux de corbillard et votre teint de souris noyée: ah! mais... tiens, elles se sont toutes sauvées.... (Chantant):
La victoire est à nous!...
IRÈNE, souriant.
Je crois bien! tu avais l'air de vouloir les dévorer!
ARMAND.
Pourquoi attaquent-elles Élisabeth, aussi!
ÉLISABETH, avec reproche.
Tu n'aurais pas dû leur dire des sottises.
ARMAND, se récriant.
D'abord, je n'en ai dit qu'à Herminie.
ÉLISABETH, souriant.
Elle est bonne, ta raison!
ARMAND, avec sang-froid.
Et puis, ce n'étaient que des vérités.
JULIEN, riant.
Elles étaient joliment crues, tes vérités!
ÉLISABETH.
Voyons, ne restons pas là sans jouer et allons rejoindre mes cousins et cousines que je vois là-bas.
IRÈNE, avec effroi.
Oh! non, Élisabeth, non, je t'en prie!
ÉLISABETH, surprise.
Et pourquoi donc pas, ma bonne Irène?
IRÈNE, les larmes aux yeux.
Ils vont nous dire des choses humiliantes et désagréables, comme ces demoiselles et les amis de Julien nous en ont déjà dit!
ARMAND, se récriant.
Oh! oh! par exemple, Irène, on voit bien que tu ne les connais pas. Il est impossible d'être plus gentil et plus aimable qu'eux. Ils te portent, ainsi qu'à Julien, le plus grand intérêt et ils seront enchantés de vous voir tous deux, je te le promets!
JULIEN, hésitant.
Mais... ils vont se moquer de nos vêtements!
ÉLISABETH.
N'aie donc pas peur, Julien; tu vas voir s'ils y font la moindre attention. Ils sont trop polis pour cela, d'abord.
ARMAND.
Et puis, ils font comme nous; ils n'attachent d'importance qu'aux bons coeurs et à la vraie amitié.
Sur ces entrefaites, les petits de Marsy, qui avaient aperçu les enfants, arrivèrent en courant.
Venez donc, chers amis, s'écrièrent-ils de loin; aux Tuileries, on ne doit pas causer, on joue.
JEANNE.
Bonjour, chère Irène (elle l'embrasse), je sais qu'Élisabeth et Armand te tutoient et je te demande la permission d'en faire autant!
JACQUES.
Elle a raison, Jeanne. Je vais l'imiter; ce bon Julien, que je suis content de le revoir! (Il lui serre la main.)
PAUL.
L'autre main à moi. Là! il n'y a pas de jaloux, comme ça.
FRANÇOISE.
Irène, Julien, embrassez-moi aussi, n'est-ce pas?
Les petits de Morville, les larmes aux yeux, répondaient avec effusion aux affectueuses démonstrations des petits de Marsy, tandis qu'Élisabeth et Armand les contemplaient en souriant avec bonheur. Irène et Julien comparaient dans leur coeur cet accueil si chaleureux fait par des enfants qu'ils connaissaient à peine, et pour lesquels ils s'étaient montrés souvent hautains, dédaigneux presque grossiers, avec la réception que leur avaient fait subir leurs prétendus amis: ils voyaient clairement de quel côté étaient la bonté, la noblesse de sentiments, et ils sentirent que dans leur malheur le bon Dieu leur avait envoyé de vraies amitiés; ils apprirent alors qu'il faut juger les gens par la bonté de leurs coeurs et non par leurs dehors brillants.
Grâce aux petits de Kermadio et de Marsy, la journée s'acheva gaiement pour tous les enfants. Irène et Julien revinrent chez eux, ramenés par Anna, et se mirent avec courage et gaieté à leurs sérieuses études.

Quand M. de Morville rentra, il vit dans son pauvre logis un spectacle si charmant qu'il s'arrêta, doucement ému, pour le contempler à loisir.
Irène, assise devant son piano, étudiait avec ardeur. Sa jolie figure, intelligente et attentive, était délicieuse d'expression. Julien, penché sur une aquarelle, souriait à demi de la difficulté vaincue, et Mme de Morville, assise près de ses deux enfants, avait interrompu sa couture pour les regarder avec un orgueil maternel.
Dans ce moment, Irène termina sa sonate par un trait brillant.
«Bravo, petite soeur! s'écria Julien enthousiasmé, tu es un pianiste de premier ordre, n'est-ce pas, chère maman?
--Oui vraiment, dit Mme de Morville, les progrès d'Irène me causent autant de surprise que de joie!
--On est si heureux de travailler pour ceux que l'on aime,» répondit la petite fille avec tendresse.
M. de Morville s'avança.
«Chers amis, dit-il, je commence à comprendre mon bonheur, moi aussi.
--Bonjour, cher papa, s'écrièrent les enfants; vous voilà revenu: quel bonheur!
--Vous devez être bien fatigué, mon pauvre Adolphe! dit Mme de Morville.
--Je l'étais tout à l'heure, répondit son mari, mais ce que je viens de voir m'a reposé.
--Qu'avez-vous donc vu, papa? dit Irène en le faisant asseoir près de leur petite cheminée et en s'agenouillant près de lui pour allumer un peu de feu.
--J'ai vu, répliqua son père qui tendit la main à Mme de Morville, une courageuse femme qui ne rougit pas de se consacrer à d'humbles travaux, et de courageux enfants qui imitent leur excellente mère; j'ai compris alors la grâce que Dieu m'a faite, en vous donnant à moi, puis....»
Là, M. de Morville s'arrêta.
«Puis, dit sa femme qui souriait, achève.
--Puis, en me ruinant,» dit M. de Morville, qui répondit par un sourire au sourire de sa femme.
Mme de Morville poussa une exclamation, et les enfants, aussi surpris que leur mère, regardèrent M. de Morville avec de grands yeux interrogateurs.
«Oui, continua-t-il gravement, j'apprécie maintenant cette grâce. Sans ma ruine, aurais-je jamais joui de voire dévouement, de vos sacrifices, de votre tendresse? Quand nous étions riches, nous étions chacun les forçats de la richesse et du plaisir: j'étais plongé dans le tourbillon des affaires, toi, Suzanne, dans le tourbillon du monde, vous, pauvres chers petits, dans celui de la vanité. Au milieu de tout cela, nous étions séparés les uns des autres, nous n'avions pas le temps de nous aimer ni de nous le prouver.
MADAME DE MORVILLE, pensive.
C'est vrai ce que tu dis là, cher Adolphe; cette vie futile et vide m'avait accaparée; comme toi je bénis le ciel de nous avoir rappelés à nos devoirs; quoi qu'il arrive désormais, je mènerai une vie sérieuse et utile, me consacrant à ton bonheur, à nos enfants et au soulagement de ceux qui souffrent.
IRÈNE.
Oh! papa, comme vous avez raison! que c'est vrai, ce que vous venez de dire! je comprends maintenant que cette épreuve est une vraie grâce, elle nous a été envoyée pour notre plus grand bien!...
JULIEN.
Et pour notre bonheur, Irène! je n'ai jamais aimé notre bel hôtel comme j'aime maintenant notre petit logis, pourtant si pauvre. C'est qu'ici l'on comprend et l'on remplit son devoir, c'est une joie pure qui m'était inconnue autrefois.»
M. et Mme de Morville écoutaient leurs enfants avec émotion; ils se regardaient avec un sourire sur les lèvres, et des larmes dans les yeux.
IRÈNE.
Ne faisons pas pleurer papa et maman, Julien; regarde, ils sont très-émus! vite, papa, souriez-moi (elle l'embrasse); à votre tour, chère maman: là, c'est très-bien.
JULIEN.
Qu'est-ce que ce gros rouleau de cahiers que vous avez sous le bras, papa?
M. DE MORVILLE.
Des projets de chemins de fer: je dois faire un rapport là-dessus et divers travaux de ce genre pour M. de Valmier.
IRÈNE, étonnée.
Le père de Noémi? vous le voyez donc encore, papa?
M. DE MORVILLE.
Non, mon enfant, c'est un de ses employés de banque qui m'a donné ce travail. M. de Valmier ignore même que ce travail m'est confié.
MADAME DE MORVILLE.
Chère Minette, assez causé pour l'instant, ton pauvre père doit être non-seulement fatigué, mais affamé; servons bien vite le dîner.
IRÈNE.
C'est cela, maman; vous allez voir, papa, nous vous avons préparé un bon petit plat!
JULIEN.
Attendez, maman, je vais aider Irène, ne vous inquiétez de rien.
La mère et les enfants se disputaient gaiement le modeste service de la table, tandis que M. de Morville les écoutait et les regardait faire avec un profond sentiment de bonheur.
IRÈNE.
Là, voilà les couverts mis.
JULIEN.
Et les chaises que tu oubliais, petite ménagère; nous assoirons-nous comme des Turcs, pour manger?
MADAME DE MORVILLE.
Voilà le potage et le rôti. Viens, cher Adolphe, tu dois avoir grand'faim, j'ai hâte de te voir à table.
On s'installa et l'on dîna avec autant d'appétit que de gaieté.
IRÈNE.
Quel excellent potage! ce bon père Michel est un portier précieux, maman; non-seulement il fait le ménage, mais il surveille notre petite cuisine d'une façon étonnante.
JULIEN.
C'est vrai; et il est aussi amusant à entendre qu'à voir. Il a des manières à lui de se poser, armé de son balai, pour raconter ses aventures!...
MADAME DE MORVILLE.
C'est un bien brave homme: traitez-le avec amitié, mes enfants; vous savez qu'il n'est dans cette modeste position que par suite de désastres éprouvés par sa famille, pendant la grande révolution.
JULIEN.
N'ayez pas peur, maman, vous avez déjà dû voir.... (on frappe). Ne bougez pas, papa, je vous en prie, je vais ouvrir.
IRÈNE.
Non, ce sera moi; tu n'as pas fini de manger (elle va ouvrir). C'est le père Michel. Bonjour, bon père Michel, qu'y a-t-il?
LE PÈRE MICHEL.
Je venais, d'amitié, desservir votre table, messieurs et mesdames. (Il salue.)
MADAME DE MORVILLE.
Merci, père Michel, ne prenez pas cette peine, c'est bien assez de faire le ménage et de préparer nos repas. Nous nous servirons nous-mêmes.
LE PÈRE MICHEL.
C'est ce que je ne permettrai pas, ma chère dame: justement parce que je connais le malheur, j'y sais compatir.
(La famille de Morville sort de table, le père Michel dessert en continuant:)
«Car ma famille est illustre, je me plais à le dire: je suis, tel que vous me voyez, seul et unique descendant des comtes de Barninville, noble race s'il en fut, alliée aux plus grandes familles de France. (Il essuie une assiette.) Nos ancêtres ont été aux croisades, tel que vous me voyez. Ils ont brillé à la cour du grand roi!.. Vanités des vanités et tout est vanité.... (S'interrompant.) Où est la moutarde, que je la serre, monsieur Julien?
JULIEN.
Je vais la ranger, père Michel.
LE PÈRE MICHEL.
Quand je vous dis que je veux vous épargner cette peine, je vous l'épargnerai. Ah! je suis têtu, moi. Là, voilà tout rangé. Messieurs, mesdames, j'ai l'honneur de vous saluer, tel que vous me voyez.
M. DE MORVILLE, lui serrant la main.
Bonsoir, père Michel; merci de votre obligeance, de votre empressement à nous être utile et agréable.
MADAME DE MORVILLE.
Je joins mes remercîments à ceux de mon mari, père Michel, nous sommes heureux d'être si bien servis.
LE PÈRE MICHEL, se rengorgeant.
Entre gens de noblesse, c'est tout simple: bonne nuit, mademoiselle Irène, et à vous aussi, monsieur Julien.
LES ENFANTS.
Merci, bon père Michel, bonsoir.»
Le brave portier parti, la famille s'installa pour la soirée. La petite lampe éclairait bien; le feu brillait joyeusement, et chacun s'arrangea pour en profiter, tout en reprenant son travail. M. de Morville, lui, écrivait avec ardeur, et la veillée se prolongea jusqu'à dix heures, tous travaillant, causant et riant. Le lendemain, Élisabeth et Armand vinrent prendre leurs leçons; ils avaient, en entrant, un air mystérieux, moitié inquiet moitié heureux; Irène et Julien en furent intrigués.
«Où est Mme de Morville? dit Armand qui ne tenait pas en place.

--Sortie pour quelques instants, dit Julien de plus en plus étonné. Veux-tu lui parler?
--Je crois bien, s'écria Armand, j'ai hâte de vous faire venir....
--Armand, affreux bavard, dit Élisabeth avec précipitation, ne sauras-tu jamais tenir ta langue?
ARMAND.
Il me démange, mon secret, ma petite Élisabeth. Oh! si tu savais comme il me démange, tu aurais pitié de moi!
ÉLISABETH.
Tiens, sois heureux, voilà Mme de Morville qui rentre: dis-lui tout; nos amis ont l'air très-intrigués.»
Les petits de Morville étaient en effet fort désireux de connaître la raison des allures, des paroles singulières d'Élisabeth et d'Armand. Après les bonjours échangés, Armand s'écria: «Madame, vous voyez en moi un ambassadeur.
MADAME DE MORVILLE, s'installant au travail.
De bonnes nouvelles, j'espère, cher enfant?
--Je le crois, madame, il dépend de vous de les changer en mauvaises pour nous.
ÉLISABETH, riant.
Voyons, Armand, ne parle pas par énigmes; va droit au fait.
ARMAND.
Eh bien, m'y voilà. Madame, mon oncle et ma
tante de Marsy désirent: d'abord, que vous ayez la bonté de laisser Irène et Julien donner à Jeanne et à Jacques des leçons de piano et de dessin, deux fois par semaine; ils viendront ici à l'heure que vous jugerez la plus commode; leurs prix seraient les nôtres.
MADAME DE MORVILLE, émue.
Cher enfant....
ARMAND, précipitamment.
Je n'ai pas fini! mon oncle et ma tante donnent une petite soirée jeudi prochain: ils désirent que M. de Morville et vous, madame, vous ameniez Irène et Julien, parce qu'Irène jouerait du piano, et cela lui procurera quelques élèves, car il y aura deux ou trois amies de maman et de ma tante, qui sont décidées à envoyer leurs filles à Irène, dès qu'elles l'auront entendue. Et puis, Julien, lui, aura la bonté d'apporter sa collection d'aquarelles, parce qu'il y aura jeudi quelques amateurs qui lui en prendront avec grand plaisir, à de très-bonnes conditions. Voilà.»
Et Armand, rouge de joie, se frotta les mains avec violence, ce qui indiquait toujours chez lui un ravissement complet.
Mme de Morville avait posé son ouvrage: quand Armand cessa de parler, elle l'attira vers elle, ainsi qu'Élisabeth, et les embrassa en silence tandis que quelques grosses larmes tombaient de ses yeux sur leurs joues roses. Irène et Julien n'étaient pas moins émus que leur mère! Ce dévouement délicat, cette façon charmante de rendre service leur allait droit au coeur: eux aussi embrassèrent leurs excellents amis avec une tendresse pleine de reconnaissance.
Quand elle fut un peu remise, Mme de Morville essaya de parler.
ARMAND.
Oh! chère madame, dites seulement oui, je vous en prie! nous sommes si heureux déjà, que si vous nous dites quelque chose, cela nous fera éclater.
Tout le monde se mit à rire. Mme de Morville et ses enfants ne purent toutefois s'empêcher de dire combien ils étaient joyeux et reconnaissants; puis les leçons commencèrent.
Elles se passèrent, bien entendu, à merveille: aussitôt finies, Élisabeth et Armand emmenèrent triomphalement leurs amis pour faire leur promenade accoutumée.
Arrivés aux Tuileries, ils retrouvèrent les petits de Marsy et leur firent part du consentement de Mme de Morville: Irène et Julien les remercièrent avec effusion de ce qu'ils faisaient pour eux.
Après avoir joué longtemps, les petits de Marsy allèrent dire à Noémi de Valmier, et à Lionnette dont les parents étaient connus de Mme de Marsy, que leur mère recevrait le jeudi suivant et serait charmée de les voir venir: Armand s'amusa à piquer leur curiosité en leur déclarant que deux grands artistes honoreraient la soirée de leur présence: chacun se sépara en riant et en se donnant rendez-vous pour le jeudi.

M. de Morville fut aussi charmé que sa femme de la perspective d'une soirée chez Mme de Marsy; une seule chose l'inquiétait: lui et sa femme avaient des vêtements simples mais convenables pour la soirée, tandis que les enfants n'avaient que leurs habits du matin, Mme de Morville s'étant défait des vêtements d'Irène et de Julien, qui ne convenaient plus à leur modeste position. M. et Mme de Morville étaient donc fort tourmentés à ce sujet sans oser se l'avouer, lorsque la bonne des petits de Kermadio arriva, portant un grand carton qu'elle remit à Irène; puis, elle partit à la hâte.
Irène porta le paquet à sa mère qui l'ouvrit, et poussa un cri en voyant une toilette simple et charmante pour Irène, avec un costume aussi simple et aussi charmant pour Julien. Un petit billet attaché à la robe contenait ces quelques mots:
Prière instante à des amis d'accepter ce souvenir d'amitié.»
IRÈNE, attendrie.
Maman, c'est encore, c'est toujours Élisabeth: quel coeur, quel coeur!
JULIEN.
Voici un billet sur mon habit. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit?
«Un écolier à son professeur. Juste témoignage de reconnaissance; aussi, pas de remercîment, chut!...»
Cher, excellent Armand!
MADAME DE MORVILLE.
Oh! mes enfants! comme nous devons remercier le bon Dieu d'avoir de tels amis!...
M. DE MORVILLE.
Tu le vois, Suzanne, j'avais bien raison d'être heureux de cette chère pauvreté. Aurions-nous la joie de voir des dévouements pareils, si nous avions encore nos richesses?
MADAME DE MORVILLE.
Va! j'en remercie Dieu autant que toi. Écrivez vite à vos amis, chers enfants, et dites-leur que je les aime et les bénis!
Il n'y avait plus que la matinée qui séparât nos héros de la réception de M. et de Mme de Marsy: les enfants écrivirent à Élisabeth et à Julien, puis Irène étudia de nouveau avec ardeur ses morceaux les plus difficiles, tandis que Julien achevait avec soin ses dernières aquarelles. Il était tard quand les enfants cessèrent leurs travaux et se hâtèrent de rejoindre leurs parents, qui, eux aussi, avaient travaillé toute la journée; après un modeste repas, tous s'habillèrent promptement et se rendirent chez Mme de Marsy.
Il était encore de bonne heure, aussi eurent-ils la satisfaction de ne trouver que la famille réunie, et d'arriver les premiers parmi les invités. Irène et Julien murmurèrent à l'oreille de leurs amis de chaleureux remercîments, interrompus par un baiser d'Élisabeth, et un terrible «chut» d'Armand.
Le salon ne tarda pas à se remplir de monde: Lionnette et Noémi arrivèrent bientôt avec leurs parents.
LIONNETTE.
Eh! bonjour, chères belles; bonjour, messieurs; nos grands artistes sont-ils arrivés?
ARMAND.
Oui, mademoiselle, ils sont là.
NOÉMI.
Ah! quel bonheur! je craignais qu'ils ne manquassent de parole!... Tiens! Irène Ici... et Julien!
Noémi leur adressa la parole avec embarras; les petits de Morville répondirent timidement à son bonjour contraint. Lionnette avait pris un air de dédain et de protection.
«Vous ici, dit-elle, quelle merveille! je croyais que....»
Elle s'arrêta, troublée par le regard flamboyant d'Armand de Kermadio.
ARMAND, d'un air formidable.
Mais continuez donc, mademoiselle, nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt (ses yeux lancent des éclairs), infiniment d'intérêt!...
LIONETTE, balbutiant.
J'aimerais mieux parler d'autre chose.
ARMAND, de même.
Et pourquoi, et pourquoi?
LIONETTE, naïvement.
Je viens de vous vexer, évidemment, et si je continuais, vous me diriez, comme cela vous arrive toujours dans ce cas-là, des choses piquantes, d'une façon très-drôle qui égaye les autres à mes dépens; c'est ennuyeux, ça.
Ces paroles de Lionnette firent rire les enfants, et même le terrible petit Breton.
MADAME DE MARSY, s'approchant.
Ma chère Irène, nous voilà tous réunis; vous savez ce que vous nous avez promis; je compte sur vous, et le piano vous attend.

IRÈNE, tremblante.
Me voici, madame, je vous suis. (Elle se lève.)
NOÉMI, bas à Élisabeth.
Ah! mon Dieu! un des grands artistes, c'est Irène?
Un accord brillant répondit pour Élisabeth, et le morceau commença; Irène, d'abord très-émue, s'était tout à coup rassurée en jetant les yeux sur ses parents et sur Julien, aussi tremblants qu'elle; la pauvre enfant sentit que son avenir dépendait de son talent, de son courage, et subitement inspirée, priant tout bas le bon Dieu, elle joua l'admirable sonate en do dièze mineur, de Beethoven. Au lieu de lui nuire, son émotion la servit. Oh! que ses sentiments étaient différents alors des misérables pensées qui remplissaient son esprit le jour du bal de Noémi. Elle jouait aujourd'hui pour sa chère famille, et cette noble préoccupation rendait son jeu délicieusement doux et touchant! Irène se surpassa; toutes les profondeurs de cette admirable musique, toutes les délicatesses de ce grand style, furent mises en relief par ses doigts inspirés; à peine eut-elle terminé, qu'un tonnerre d'applaudissements retentit, et des exclamations s'élevèrent de toutes parts!
On complimenta chaleureusement M. et Mme de Morville sur le talent hors ligne de leur fille, tandis que les petits de Kermadio et de Marsy se montraient aussi fiers d'Irène que ses parents l'étaient à juste titre.
Noémi et Lionnette aimaient beaucoup la musique; émerveillées de l'admirable talent d'Irène, elles mirent de côté toute morgue et l'accablèrent de félicitations.
NOÉMI, enthousiasmée.
Vous aviez bien raison, monsieur Armand, de dire que c'est une grande artiste; je l'avais entendue jouer quelquefois, mais seulement des bluettes, et je ne lui soupçonnais pas ce beau talent.
LIONETTE, de même.
C'est écrasant, j'en suis épatée; dites donc, monsieur Armand, je vous accorde que voilà une grande artiste. Mais l'autre, le second, où est-il?
ARMAND.
Tenez, mademoiselle, ma réponse est sur cette table.
NOÉMI, regardant.
Oh! que c'est joli! que c'est charmant! Papa, vous qui aimez tant ces choses-là, venez voir ces aquarelles, elles sont merveilleuses!
Les exclamations de Noémi avaient attiré M. de Valmier.
«Mais c'est ravissant! dit-il, outre que ces vues sont admirables, elles sont faites par un véritable artiste; qui est-ce qui fait ces belles choses?
ARMAND.
Allons, Julien, ne fais pas le modeste; pourquoi n'as-tu pas signé tes aquarelles?
M. DE VALMIER, à Julien.
Bravo! mon ami, je vous félicite; vous avez un talent remarquable! J'aimerais beaucoup à posséder cette belle collection! Me la cédez-vous?
JULIEN, rougissant.
Elle est à mon père, monsieur: je pense qu'il consentirait à s'en défaire.»
M. de Valmier alla vers M. de Morville, le salua et se mit à causer à voix basse avec lui, tandis que d'autres personnes venaient voir et admirer les aquarelles.
LIONNETTE.
Ah! ah! voilà donc votre second grand artiste, monsieur Armand?
ARMAND.
Oui, mademoiselle, qu'en dites-vous?
LIONNETTE.
Je suis plus épatée que jamais.
ARMAND, avec sang-froid.
N'est-ce pas, mademoiselle, que c'est escarbouillant?
LIONNETTE, étonnée.
Hein? vous dites?
ARMAND.
Je dis que c'est escarbouillant, ces aquarelles!
LIONNETTE, stupéfaite.
Qu'est-ce que c'est que ça, bon Dieu! escar... escar...
ARMAND, tranquillement.
Dame! mademoiselle, c'est du patois; vous venez bien de dire un mot aussi étonnant que le mien, en vous déclarant épatée; alors, moi, pour être à votre hauteur, je me dis escarbouillé. (Les enfants rient.)
LIONNETTE, très-rouge.
Là! je le savais bien! avec ce M. Armand, on est toujours sûre d'avoir des affaires. C'est assommant que vous ayez de l'esprit, vous!
ARMAND.
Mais, mademoiselle, si vous....
ÉLISABETH.
Chut! Armand, ne plaisante pas trop longtemps; tu vois bien que cela finit par être désagréable. J'espère que Mlle Lionnette t'a déjà excusé; offre-lui ton bras et allons prendre du thé, car je vois que tout le monde se dirige vers la salle à manger.
Après le thé, on demanda à Irène de se faire entendre de nouveau, et elle fut aussi justement applaudie que la première fois.
On finit gaiement cette charmante soirée, et M. et Mme de Morville se retirèrent, heureux et fiers de leurs enfants; avant leur départ, M. de Valmier avait pris rendez-vous avec M. de Morville, au sujet des aquarelles, et Mmes de Nardray, Darsal et Drangard s'étaient concertées avec Mme de Morville, pour que leurs filles pussent aller chez Irène prendre des leçons de piano. Ce fut donc en bénissant mille fois leurs amis, qu'Irène et Julien les quittèrent, joyeux et pleins d'espoir.

En revenant chez elle, Noémi avait un air pensif, triste même; sa mère s'en aperçut et lui en demanda la cause; Noémi s'excusa sur la fatigue de la soirée.
«Elle était pourtant si intéressante que cela aurait dû te faire oublier ta fatigue! s'écria Mme de Valmier.
-Oui, dit son mari, c'était charmant à voir, ces deux enfants si bien doués, si modestes et si heureux de secourir leurs parents!»
A ce moment, la voiture s'arrêta, Noémi et ses parents descendirent, et la conversation en resta là.
Rentrée chez elle, la petite fille se déshabilla, fit sa prière avec distraction et se coucha; mais ce ne fut pas pour dormir, ce fut pour réfléchir sérieusement.
«Comme Irène et Julien sont gentils maintenant, se dit-elle; plus leurs talents font de progrès, plus ils deviennent modestes. Comme c'est beau et courageux de leur part de travailler pour vivre! Jeanne raconte d'eux des choses bien touchantes. J'ai eu tort, grand tort de m'être montrée si froide et si orgueilleuse! C'est vilain, le respect humain; et pourtant la crainte de voir mes amis se moquer de moi m'a rendue lâche et m'a fait agir comme si je manquais de coeur!
«Mes amis! sont-ce mes amis? Quelle différence entre le semblant d'amitié que nous nous portons les uns aux autres et la tendresse dévouée que se témoignent les petits de Morville, de Kermadio et de Marsy. Avec mes amis, il n'est question que de vanités, de frivolités! Ils ne seraient pas capables de dévouement, et me traiteraient, si j'étais pauvre, comme ils ont traité Irène et Julien l'autre jour. Ils ont bien mal agi: moi aussi, hélas! Oh! je m'en repens beaucoup maintenant; je veux changer de manière d'être avec eux, avoir le courage d'aimer, malgré les élégants, ces enfants si gentils et si bons.»
Cette bonne résolution calma la conscience troublée de Noémi; elle ne tarda pas à s'endormir, en répétant:
«Je serai l'amie... des bons enfants... du Club de la Charité.»
Le lendemain, à l'heure habituelle de sa promenade, Noémi se rendit aux Tuileries; elle hâtait le pas, et son coeur battait, car elle allait faire acte de courage. Arrivée dans l'allée de Diane, plusieurs élégants s'empressèrent autour d'elle, mais elle se contenta de leur dire bonjour, les écarta doucement, et elle alla droit à un groupe composé d'Irène, de Julien et de tous leurs amis. Les élégants, fort surpris, l'avaient accompagnée machinalement.
«Irène, Julien et vous tous, chers amis, dit Noémi d'une voix émue, en rougissant, voulez-vous me permettre, non-seulement de jouer avec vous, mais encore d'être votre amie? Je me sens attirée vers vous, et maman dit que je ne puis que gagner en étant avec vous le plus possible. Excusez-moi si je vous ai repoussés l'autre jour: je vous en demande pardon!»
A peine ces dernières paroles étaient-elles prononcées par Noémi que tous les enfants, attendris, avaient entouré la gentille petite fille et l'embrassaient à l'envi, l'assurant de leur amitié, de leur joie de l'admettre parmi eux, et la complimentant de sa touchante démarche. Les élégants, stupéfaits de cette scène, faisaient des figures si embarrassées, si comiques, qu'à la fin Armand les remarqua et partit d'un grand éclat de rire.
CONSTANCE, aigrement.
De quoi riez-vous donc, vous?
ARMAND.
Vous devriez plutôt dire de qui, mademoiselle.
HERMINIE.
Est-ce de nous, par hasard?
ARMAND.
Ma foi, oui, ah! ah! ah! Vous paraissez tout interloqués, ah! ah! ah! Vervins a la bouche toute grande ouverte, ah! ah! ah! Jordan écarquille les yeux, ah! ah! ah! et Mlle Constance a l'air de vouloir nous dévorer tous d'une seule bouchée, ah! ah! ah!
La gaieté d'Armand gagna Élisabeth et ses amis. Tous se mirent à rire aux éclats.
CONSTANCE, ricanant.
Ainsi, de l'avis de monsieur, nous sommes ridicules?
ARMAND.
Certes, et joliment, encore!
Il y eut un hourra d'indignation parmi les élégants, qui arrivaient en foule.
HERMINIE, avec ironie.
Ainsi, ma belle robe de soie gris perle, ma casaque de velours gros bleu, ma toque de velours écossais gris et bleu, mes bottes grises à talons bleus, vous trouvez cela ridicule, monsieur?
ARMAND.
Parfaitement, mademoiselle; un enfant doit être mis de façon à pouvoir jouer à son aise et ne pas ressembler à une poupée vivante.
Il y eut un mélange de rires et de cris.
CONSTANCE, en colère.
Mais puisque nous sommes riches, nous devons donner le ton.
ARMAND.
Oh! oh! des enfants donner le ton!... Tenez, mademoiselle, voulez-vous faire une chose? Supposons que nous sommes deux avocats? Mlle Lionnette jugera ma cause; ma soeur jugera la vôtre; vous plaiderez pour le beau monde, moi contre, c'est-à-dire que vous serez l'avocat du diable.... (Rires et exclamations.)
CONSTANCE, furieuse.
Je ne serai pas l'avocat du diable!...
ARMAND.
La paix, la paix! vous serez l'avocat du luxe, là, êtes-vous contente? (Entre ses dents.) C'est la même chose.
CONSTANCE, calmée.
Je veux bien; vous allez être battu à plate couture.
JULES.
Bon, ça va être amusant.
LIONNETTE.
C'est très-gentil, ce jeu-là.
JACQUES.
Des chaises pour nos juges!
PAUL.
Avocats, retournez les vôtres, on doit plaider debout.
HERMINIE.
Ah! mais je m'amuse, moi; il est drôle, cet Armand, il commence à m'aller très-bien.
JORDAN.
A moi aussi; en place, mesdemoiselles et messieurs.
Tous les enfants s'assirent pêle-mêle et la séance commença.
L'AVOCAT CONSTANCE.
Je viens, mesdemoiselles et messieurs, défendre devant vous une belle cause, injustement attaquée. On a osé dire du mal du luxe, du grand luxe, première de toutes les nécessités; on veut nous interdire la soie, le velours, le satin, peut-être même, hélas, la popeline;--on croit que cela nous empêche de jouer; mais nos jeux, qui sont calmes....
L'AVOCAT ARMAND.
Oh! très-calmes!
LE JUGE ÉLISABETH.
Avocat Armand, n'interrompez pas.
LE JUGE LIONNETTE.
Je remercie mon collègue de ce sage avertissement.
L'AVOCAT CONSTANCE.
Et moi aussi. Nos jeux calmes, dis-je, conviennent à notre position, à notre rang. Et puis, nous faisons aller le commerce: que deviendraient sans nous, sans nos toilettes, les magasins de nouveautés, de modes, de chaussures, de coiffures, de passementerie, de bijouterie....
L'AVOCAT ARMAND.
L'épicerie est hors de cause. (Rire général.)
L'AVOCAT CONSTANCE, avec dignité.
Je méprise vos plaisanteries, avocat Armand! Et nos élégantes poupées, ne sont-elles pas la fortune de leurs fournisseurs? allez! le luxe est utile, il est nécessaire, indispensable aux autres comme à nous-mêmes.
Les élégants applaudirent avec frénésie à cet habile plaidoyer. On félicita très-chaleureusement l'avocat Constance, puis l'avocat Armand demanda la parole, l'obtint et dit avec emphase:
«Messieurs les juges, et vous, chers auditeurs, l'éloquence perfide de mon spirituel adversaire ne m'empêche pas d'avoir raison. Autant le luxe modéré est utile, je le reconnais, autant le luxe exagéré que j'attaque, que j'attaquerai toujours, est mauvais et même dangereux! En effet, nous, enfants, avons-nous besoin, dites-moi, d'être couverts de soie, de velours, de dentelles et de garnitures de toute sorte? Nos jeux s'accommodent-ils de ces beaux habits qui nous empêchent de remuer, de peur de les déchirer ou de les salir? A quoi servent vos bottes magnifiques? Ne vaudrait-il pas mieux des bottines simples et solides, avec lesquelles on peut courir à son aise, les jours où il y a de la boue comme les jours où il fait sec? N'est-il pas plus amusant de sauter à la corde, de jouer aux barres, ou cerceau, à cache-cache, que de rester immobiles sur des chaises comme des grandes personnes? Eh bien, vos belles étoffes vous privent de tous ces jeux-là. Quant à faire aller le commerce, c'est l'affaire de nos mamans et de nos papas; ce n'est pas la nôtre. Pour vos poupées, mesdemoiselles, faites-les redevenir simples; et si la marchande de vêtements y perd, faites gagner celle qui habille les pauvres!»
Armand s'était animé en parlant: sa jolie figure était pleine d'ardeur et d'intelligence; son âme était dans ses yeux: les enfants écoutaient tous avec une attention profonde: peu à peu, les rires avaient cessé, une sérieuse conviction pénétrait dans les coeurs.
Il y eut un instant de silence, puis les amis d'Armand l'entourèrent en le félicitant: les élégants, après quelque hésitation, s'approchèrent aussi.

HERMINIE.
Je suis contente de vous avoir entendu, monsieur Armand.
LIONNETTE.
Moi aussi; il y a du vrai dans tout cela! pour aider à faire une réforme utile, je déclare que le Club du Beau monde est une bêtise et que je n'en suis plus.
JORDAN.
Moi non plus, alors: cet Armand, il m'a remué, ma foi! C'est un orateur, vraiment!
LIONNETTE.
Dites donc, mes amis, nous oublions de juger la cause: faut-il le faire?
LES ENFANTS.
Certainement, il le faut.
LIONNETTE.
Eh bien, alors, je déclare que l'avocat Armand a dit d'excellentes choses, sa cause est loin d'être mauvaise et je suis presque convertie. (Applaudissements.)
HERMINIE.
Déjà!... Il faut voir, essayer d'abord: on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain!
LIONNETTE.
C'est trop juste; accordé.
CONSTANCE, gaiement.
Vous, Élisabeth, vous allez me condamner, je prévois que j'ai perdu ma cause près de vous.
ÉLISABETH, affectueusement.
C'est vrai, ma chère Constance: permettez-moi cependant de le faire en ajoutant quelques mots. Le bon saint Jean disait à ses disciples: «Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres;» disons-nous cela, afin d'être affectueux les uns pour les autres: il y a eu souvent des paroles peu aimables échangées entre nous depuis quelque temps; promettons-nous de n'en plus dire de semblables. Ne regardons plus aux dehors, mais aux côtés sérieux de ceux que nous voyons; n'attachons de l'importance qu'aux qualités du coeur, et non aux vêtements. Enfin, je me permets de vous supplier de renoncer à ce trafic de timbres; autant il est naturel d'en faire collection avec plaisir, autant il est fâcheux de spéculer là-dessus. Vous avez entendu ce que le surveillant a dit l'autre jour à ce propos (je l'ai appris depuis), que cette leçon nous profite.
VERVINS.
Mademoiselle Élisabeth, vous parlez aussi sagement qu'Armand; nous allons être très-raisonnables, vous verrez.
CONSTANCE.
Il faudra encore jouer à ce jeu-là, il est très-drôle.
ARMAND, gaiement.
A présent, vive la joie! je propose, pour finir la séance, une partie monstre; les juges vont choisir le jeu.
On applaudit à cette proposition d'Armand et les Tuileries retentirent bientôt d'éclats de rire et de cris joyeux. Ce fut ainsi que finit le Club du Beau monde. Nous verrons plus tard ce que devint le Club de la Charité.

En revenant de la séance des Tuileries, Noémi, enthousiasmée, raconta à sa mère tout ce qui s'était passé; celle-ci en fut vivement émue; c'était une personne excellente au fond; une grande fortune, le manque de bons conseils et d'amie sérieuse l'avaient entraînée dans une vie mondaine et dissipée: mais son coeur était resté bon et elle consentit avec joie à la demande de Noémi, qui désirait prendre des leçons de piano chez Irène.
La mère et la fille allèrent donc chez Mme de Morville, qui les reçut avec une politesse, une dignité parfaites. Mme de Valmier fut frappée de voir cette pauvreté noblement supportée. Elle causa longuement avec Mme de Morville et admira sa patience, sa piété, sa résignation si vraie et si touchante: elle ne pouvait revenir de son étonnement en entendant cette jeune femme, jadis frivole et étourdie, parler d'une façon élevée et simple à la fois. Mme de Morville s'en aperçut et sourit.
«Vous me trouvez bien changée, n'est-ce pas, madame? dit-elle.
--C'est vrai, dit franchement Mme de Valmier, et je ne puis que vous en féliciter.
MADAME DE MORVILLE.
Ah! c'est un heureux malheur que le nôtre, madame; je le reconnais chaque jour davantage.»
Pendant que leurs mères parlaient ainsi, les petites filles et Julien causaient avec non moins de franchise et d'abandon. Noémi se sentait de plus en plus attirée vers Irène et Julien, et désirait extrêmement devenir l'amie d'Élisabeth. Ce fut donc avec joie qu'elle prit jour pour ses leçons de piano, puis elle se retira avec sa mère.
Restés seuls, Mme de Morville et ses enfants se félicitèrent de ce surcroît de leçons. Ils causaient encore de la visite si aimable de Mme de Valmier et de sa fille, lorsque M. de Morville entra: il était rayonnant.
JULIEN.
Dieu! papa, quelle figure heureuse!
IRÈNE.
Eh bien, papa, les aquarelles de Julien sont-elles vendues?
M. DE MORVILLE.
Oui, chère petite, très-bien vendues, très-généreusement achetées.
MADAME DE MORVILLE.
Quel bonheur! Combien, mon ami?
M. DE MORVILLE.
Devine! devinez, enfants.
JULIEN.
Il y en a dix. A vingt francs pièce, ce serait magnifique.
M. DE MORVILLE.
Tu n'y es pas.
IRÈNE.
Quarante francs chacune, alors, papa?
M. DE MORVILLE.
Va toujours.
MADAME DE MORVILLE, étonnée.
Cinquante francs pièce, mon ami?
M. DE MORVILLE.
Cent francs, chère Suzanne.
La mère et les enfants s'exclamèrent; Julien était rouge de joie.
«Papa, dit-il, en hésitant, je ne sais si nous pouvons accepter tant d'argent; ces aquarelles ne valent pas cela.
M. DE MORVILLE.
Je comprends et j'admire ton scrupule, cher enfant: je l'ai eu pour toi et avant toi, crois-le bien, car j'ai d'abord nettement refusé à M. de Valmier de faire cette vente à des conditions pareilles.
«Vous trouvez que ce n'est pas assez? a-t-il dit, en fronçant le sourcil.
--Je trouve que c'est trop, au contraire, monsieur, ai-je répondu. La délicatesse de mon fils et la mienne refusent un prix aussi élevé!»
Il a souri et sa figure s'est éclairée.
«Je prie pourtant M. Julien et son excellent père de me faire l'honneur d'accepter ce prix-là, a-t-il dit. Le travail d'un fils secourant sa famille est inestimable à mes yeux. Si je voulais le payer ce qu'il vaut, ma fortune entière ne suffirait pas!... Je vous prie, je vous supplie d'y consentir.»
«Il m'avait tendu la main, je la serrai en silence, je pris le billet qu'il m'offrait et... tiens, Julien, le voici.... Ne pleure pas, mon enfant, embrasse-moi; je suis fier de toi, de cet argent gagné par ton talent, par tes veilles assidues. Sois béni, mon fils, des joies que tu me donnes.»
Le père et le fils s'embrassèrent avec tendresse: Mme de Morville et Irène aussi émues qu'eux, se joignirent à ces témoignages d'affection.
Bientôt après, Élisabeth et Armand arrivèrent. Ils furent enchantés de la bonne nouvelle que leur donnèrent leurs amis. Après les leçons, tous les quatre se dirigèrent, comme d'habitude, vers les Tuileries.
Grâce à l'aventure de la veille, qui avait amusé tous les enfants, ils furent reçus à merveille par les élégants: la glace était rompue, et à partir de ce jour, les enfants raisonnables furent, quoique aussi simplement mis que par le passé, traités avec politesse, souvent avec amitié par le Beau monde, revenu à de meilleurs sentiments.
Tous jouaient ensemble, et les exagérations de langage, de toilette s'effaçaient peu à peu chaque jour, grâce aux conseils d'Élisabeth, à l'esprit gai et malin du bon gros Armand.
Les petits de Kermadio, à leur insu, faisaient subir aux autres l'influence de leurs charmantes qualités: la bonté d'Élisabeth attirait; la gaieté, l'entrain d'Armand amusaient, et ils étaient devenus l'âme des Tuileries.
Noémi, surtout, était frappée de voir ces excellentes natures faire le bien sans relâche et donner l'exemple de toutes les qualités: le petit cercle d'Irène était aussi pour elle un centre d'attraction; les leçons de piano étaient pour la petite fille de vraies joies. Elle y retrouvait souvent Élisabeth, dont la conversation était toujours aussi intéressante que profitable.
Un jour, Noémi achevait de prendre sa leçon, lorsque Irène reçut un billet d'Élisabeth qui parut la contrarier.
«Qu'y a-t-il, Irène? demanda Julien en interrompant son dessin.
--Élisabeth envoie Anna pour nous mener promener, dit Irène en soupirant; mais il faut qu'elle et Armand accompagnent Mme de Kermadio pour une course pressée.
JULIEN.
Ah! que c'est dommage! ils nous auraient aidés chez....
IRÈNE.
Chut! nous tâcherons de nous tirer d'affaire tout seuls.
NOÉMI.
Puis-je vous être utile, Irène? je serais charmée de vous rendre service, vous savez!
IRÈNE, hésitant.
Je craindrais d'abuser, ma bonne Noémi....
NOÉMI.
Pas du tout, je vous assure!
JULIEN, à voix basse.
Ne parlons pas de cela maintenant.
NOÉMI, surprise.
C'est donc un se....
IRÈNE, précipitamment.
Chère maman, la leçon est finie, nous allons aux Tuileries: Élisabeth nous a envoyé la bonne Anna; voulez-vous nous permettre de partir?
MADAME DE MORVILLE.
Certainement, mes enfants. Remerciez Anna de ma part et soyez gentils avec elle.»
Noémi, Irène et Julien dirent adieu à Mme de Morville: puis les trois amis, suivis d'Anna et de la bonne de Noémi, sortirent pour se rendre aux Tuileries.
A peine hors de la maison, Irène s'écria.... «A présent, chez Mme Blesseau, rue du Bac; n'est-ce pas, Julien?
JULIEN.
Oui, voilà notre secret, mademoiselle Noémi.»
Et il expliqua à Noémi, surprise et touchée, que le surlendemain étant la fête de leur mère, ils allaient chez Mme Blesseau, bijoutière, pour vendre deux joyaux, restes de leur splendeur passée. Leur mère leur ayant permis d'en disposer comme bon leur semblerait pour leurs petites dépenses, ils les portaient à Mme Blesseau, voulant offrir des souvenirs à Mme de Morville, puis à Élisabeth et Armand, les bons anges de la famille, invités à dîner pour ce jour-là.
Tout en parlant ainsi, les enfants étaient arrivés chez Mme Blesseau.
IRÈNE, entrant.
Bonjour, madame; voudriez-vous nous faire le plaisir d'estimer les bijoux dont nous vous avons parlé l'autre jour. Maman vous a dit qu'elle nous avait donné la permission de les vendre.
MADAME BLESSEAU.
Parfaitement, mademoiselle. Voyons-les.
IRÈNE.
Voilà ma bague.
JULIEN.
Voici mes boutons de chemise.
MADAME BLESSEAU.
Ils sont très-jolis. Ils seront faciles à placer.
IRÈNE.
Mais c'est que nous voudrions l'argent tout de suite.
MADAME BLESSEAU.
Je vais vous les estimer immédiatement, mademoiselle. (Elle pèse chaque bijou.)
IRÈNE.
Dieu! que je voudrais que ma bague pesât 10 francs.
MADAME BLESSEAU.
Elle ne pèse pas cela, mademoiselle.
IRÈNE, avec chagrin.
Ah! mon Dieu, quel malheur!
MADAME BLESSEAU, souriant.
Rassurez-vous, mademoiselle; je veux dire qu'elle vaut davantage.
IRÈNE.
Quel bonheur! combien s'il vous plaît?
MADAME BLESSEAU.
Quinze francs cinquante centimes, mademoiselle.
IRÈNE.
C'est énorme; merci, madame Blesseau.
MADAME BLESSEAU.
Vous oubliez la rubis, mademoiselle; il est joli et très-bien taillé. Je vous en donnerai certainement.... (elle l'examine) trente....
IRÈNE.
Mais quel bonheur!
MADAME BLESSEAU, riant.
Oh! que vous faites une mauvaise vendeuse, mademoiselle, vous ne me laissez seulement pas achever! trente-cinq francs, voilà la valeur bien exacte de votre pierre.
IRÈNE.
Que je suis contente! à toi, Julien.
MADAME BLESSEAU.
Pour vos boutons de chemise, monsieur Julien, il y a un jeune homme qui m'a prié de lui avoir cela d'occasion: il m'a fixé un pris de quarante à quarante-cinq francs. Les vôtres valent dix-neuf francs d'or et... vingt-deux à vingt-trois francs de turquoises; cela fait quarante-deux francs. C'est leur valeur, qui, du reste, est le prix que ce jeune homme désire y mettre; si vous voulez, ils sont vendus.
JULIEN.
Je crois bien; je n'espérais pas tant que cela!... je vous remercie mille fois, madame Blesseau.
NOÉMI.
Par exemple, madame, vous n'êtes pas comme notre joaillier: j'ai eu quelquefois la fantaisie de changer des bijoux, il m'en donnait quatre fois moins qu'ils ne valaient. Tenez, voici un petit bracelet gourmette dont il m'a offert seulement vingt-cinq francs; vous pensez bien que je l'ai gardé.
MADAME BLESSEAU.
C'est qu'il a voulu trop gagner, mademoiselle.
NOÉMI.
Combien l'estimez-vous, alors?
MADAME BLESSEAU, le pesant.
Trente-neuf francs, mademoiselle.
NOÉMI.
Dieu! quelle différence! pourquoi ne voulez-vous pas gagner autant que lui? ça vous serait si facile, pourtant!
MADAME BLESSEAU.
Parce que, mademoiselle, j'ai pris pour règle la maxime: «Faites-vous acheteur en vendant, vendeur en achetant.»
NOÉMI.
Je me souviendrai de vous, madame, car je n'ai pas souvent vu faire le commerce aussi honnêtement.

MADAME BLESSEAU, avec simplicité.
Je ne fais que mon devoir, mademoiselle. Mademoiselle Irène, Monsieur Julien, voici votre argent.
Les petits de Morville dirent adieu à l'honnête femme qui avait si justement excité l'admiration de Noémi par sa sévère probité, et les enfants sortirent du magasin. A peine dans la rue, Noémi, qui semblait préoccupée, dit qu'elle avait oublié son ombrelle chez Mme Blesseau; elle ne voulut pas permettre à ses amies de rentrer pour la prendre et y courut seule. Elle fut quelques minutes absente et revint toute essoufflée au moment où Irène et Julien s'étonnaient de sa longue absence. Noémi prétendit qu'elle avait dû longtemps chercher l'ombrelle et l'on se dirigea vers les Tuileries.
NOÉMI.
Qui est-ce qui vous avait donné vos bijoux, mes amis?
IRÈNE, tristement.
Ce sont des souvenirs de première communion. (Julien soupire.)
NOÉMI.
Vous deviez y tenir beaucoup, alors?
IRÈNE, avec effort.
Ne parlons pas de cela. Julien, nous allons pouvoir acheter pour maman un beau bénitier et une statue de la sainte Vierge.
JULIEN.
C'est cela; elle priera chaque jour devant une image qui lui rappellera notre affection.
IRÈNE.
C'est une très-bonne pensée, n'est-ce pas?
NOÉMI.
Est-ce que vous n'avez plus de boutons de chemise, monsieur Julien?
JULIEN, souriant avec effort.
En voilà d'excellents à vingt-cinq centimes, mademoiselle. Ce n'est pas la valeur qui me fait quelque chose, allez, c'est le souvenir.
IRÈNE, lui serrant la main.
Tiens, Julien, je vois Jacques qui te cherche; nous allons bien jouer, il faudrait confier notre argent à Anna pour ne pas le perdre. Nous achèterons nos jolis souvenirs en revenant, veux-tu?
JULIEN, souriant.
C'est cela.
Les enfants furent entourés par leurs compagnons de jeux: l'absence des petits de Kermadio fut remarquée de tout le monde. Puis l'on se mit à jouer. Noémi se montra tout particulièrement affectueuse pour les petits de Morville, et l'heure de se séparer étant arrivée, l'on se quitta en se donnant rendez-vous pour le lendemain. Tous les enfants recommandèrent à Irène et à Julien de dire aux petits de Kermadio de ne plus manquer leur promenade, parce qu'on les avait beaucoup regrettés.

Élisabeth et Armand arrivèrent très-exactement pour l'heure du dîner, le jour de la fête de Mme de Morville. Irène et Julien les reçurent avec amitié et les emmenèrent dans leur petite chambre pour leur faire voir leurs surprises.
Le père Michel, toujours serviable et empressé, avait déclaré qu'il servirait le dîner, et l'on se mit à table; Mme de Morville seule ignorait pourquoi une certaine expression de joie et de mystère était répandue sur tous les visages.
Au dessert, les enfants se levèrent tout à coup.
MADAME DE MORVILLE.
Nous n'avons pas fini, mes enfants; il y a encore une tarte à la crème en l'honneur de vos amis.
M. DE MORVILLE.
Laisse-les faire, Suzanne. (Il se lève.)
MADAME DE MORVILLE.
Mais où vas-tu donc, Adolphe? tout est sur la table.
M. DE MORVILLE, riant.
Non, pas tout. (Il disparaît comme les enfants.)
MADAME DE MORVILLE, étonnée.
Il ne manque rien...; mon bon Armand, chère Élisabeth, vous aussi, vous vous sauvez?
ARMAND, s'enfuyant.
Pour un instant, chère madame. (Il sort sur le palier.)
ÉLISABETH, de même.
Une petite minute seulement et nous revenons.
Mme de Morville se retourna du côté du père Michel pour lui demander quelque chose; lui aussi s'était éclipsé!... La jeune femme restait toute seule, très-surprise de ces disparitions successives, lorsque toutes les portes s'ouvrirent à la fois et l'on vit les déserteurs reparaître.
M. de Morville portait une jolie pendule de marbre blanc, Irène et Julien un charmant bénitier et une belle statue de la sainte Vierge; sur le palier était Armand, tenant une jolie étagère de palissandre. Élisabeth traînait un beau prie-Dieu en palissandre et tapisserie, et le père Michel fermait la marche avec un énorme bouquet.
MADAME DE MORVILLE, stupéfaite.
Pour qui toutes ces magnifiques choses, bon Dieu?

A peine avait-elle achevé ces mots qu'elle se vit entourée, embrassée, félicitée.
IRÈNE.
Votre fête, chère, chère maman.
JULIEN.
Que nous vous souhaitons de tout notre coeur.
M. DE MORVILLE.
Pouvions-nous l'oublier, Suzanne!
ARMAND.
Voilà pour poser la statue de la sainte Vierge.
ÉLISABETH.
Voilà pour s'agenouiller devant.
MICHEL.
Et voilà un bouquet pour orner l'autel. Hélas! que ne puis-je dire aussi: et l'hôtel!
Ce mélancolique calembour du bon vieux concierge fit éclater de rire tout le monde. Ce fut au tour de M. de Morville et de ses enfants d'offrir leurs présents, et ce furent de nouvelles exclamations, de nouvelles tendresses, de nouvelles embrassades. On remerciait, on serrait la main des petits de Kermadio et du père Michel, dont les aimables attentions avaient vivement touché la famille de Morville.
M. DE MORVILLE.
Petits sournois, vous ne m'aviez pas dit ce que vous méditiez!
IRÈNE.
Et Élisabeth, elle s'est bien gardée de me parler du joli prie-Dieu.
JULIEN.
Armand ne m'avait rien dit non plus de la belle étagère.
ÉLISABETH, riant.
C'est bien étonnant, car sa discrétion a manqué l'étouffer: pour se consoler de ne rien dire, il s'est promené hier pendant une heure dans le jardin, en chantonnant: «Je suis discret, je n'ai dit à personne que je donnais l'étagère à Mme de Morville, personne ne l'a su, ne le sait, et ne le saura: personne, personne!»
(Tout le monde rit.)
ARMAND, consterné.
Tu m'as entendu?
ÉLISABETH.
Moi et toute la maison. On riait joliment, va; tu n'as donc pas compris pourquoi mon oncle Gaston avait un fou rire, quand il t'a donné de beaux roseaux pour planter dans ton jardinet?
ARMAND, frappé.
Ah! mon Dieu, c'est en souvenir du roi Midas?
ÉLISABETH, riant.
Justement.
Armand, après avoir fait une figure tragi-comique, s'écria tout à coup: «Je suis vengé... je confondrai mon oncle par mon admirable discrétion.
ÉLISABETH.
Comment ça?
ARMAND, avec majesté.
J'ai un secret depuis cinq jours, et je ne l'ai dit à personne, pas même à toi!
ÉLISABETH, intriguée.
Depuis le jour où Noémi est venue en mon absence et où tu l'as reçue à ma place?
ARMAND, triomphant.
Justement.
M. DE MORVILLE.
A propos de secret, Suzanne, tu vas apprendre le sacrifice que se sont imposé nos excellents enfants pour toi.
MADAME DE MORVILLE, inquiète.
Oh! mon Dieu, lequel?
IRÈNE ET JULIEN, suppliant.
Papa, ne dites pas....
M. DE MORVILLE.
Laissez, mes bien-aimés, laissez à votre mère la joie de vous apprécier pleinement: Suzanne, ils ont profité de ta permission; ils ont vendu leurs bijoux de première communion pour t'offrir ces cadeaux de fête.
MADAME DE MORVILLE, très-émue.
Oh! mes pauvres chers enfants! quel sacrifice! Combien je regrette votre dévouement! (Elle les embrasse.)
IRÈNE.
Chère maman, ce n'étaient que des bijoux, et votre joie est le vrai trésor de notre coeur.
JULIEN.
Nous en ferions bien d'autres pour vous faire plaisir, ne fût-ce qu'un instant!
MADAME DE MORVILLE.
Pauvres petits! Non, je ne puis être consolée de vos privations; vous y teniez tant, surtout depuis notre ruine, à ces précieux souvenirs!
M. DE MORVILLE.
Ils n'en ont eu que plus de mérite à te les sacrifier. Va, Suzanne, je suis fier de leur dévouement.
ARMAND, avec explosion.
Là! le moment indiqué par Noémi est arrivé; quel bonheur, Seigneur, quelle joie! (Il gambade.)
ÉLISABETH.
Armand, es-tu fou?
ARMAND.
De joie, petite soeur; oui, complètement. Tiens, je te laisse le plaisir de lire toi-même cette lettre à nos amis. (Il lui donne une lettre.)
ÉLISABETH.
Voyons. (Elle lit haut.)
«Chère Irène et cher Julien,
«C'était aussi ma fête aujourd'hui. Maman m'a demandé l'autre jour ce qui me ferait plaisir: «Les bijoux de mes amis, ai-je répondu;» et je lui ai raconté notre visite chez Mme Blesseau. Maman a pleuré en m'écoutant, nous sommes vite montées en voiture, nous avons pris vos bijoux chez la bonne Mme Blesseau, qui était déjà prévenue: elle était aussi contente que nous, car elle devinait à qui ils étaient destinés...; les voici.... Vous me permettez de vous les offrir, n'est-ce pas, mes bons amis? J'ai tant de plaisir à le faire! Ce sera la fête de papa bientôt, et je m'y préparerai avec votre secours, mes chers amis: ce service sera bien supérieur au plaisir que je vous fais en ce moment: j'ai le seul mérite de vous offrir ces bijoux comme je vous aime: de tout mon coeur.
«Votre amie dévouée,
«Noémi de Valmier.»
Les petits de Morville s'étaient jetés dans les bras de leurs parents, aussi émus qu'eux de cette lettre touchante.
ARMAND, sautant de joie.
Et voici les bijoux.... (il tire les écrins de sa poche), le secret de Mlle Noémi; il me semble l'avoir bien gardé. Ah! ah! Élisabeth, qu'est-ce qu'il dira des roseaux, mon oncle Gaston?
ÉLISABETH.
Ce ne seront plus les roseaux du roi Midas, Armand, ce seront les roseaux d'Armand le discret!
(Armand se rengorge.)
JULIEN, avec émotion.
Dès demain, je me mets au travail, et je prépare à cette charmante Noémi une surprise comme elle le mérite.
IRÈNE, de même.
Et moi aussi; j'ai certain ouvrage que je vais me dépêcher de finir.
LE PÈRE MICHEL, desservant.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi touchant depuis la grande révolution.
ARMAND, gaiement.
Quel âge aviez-vous en 93, père Michel?
LE PÈRE MICHEL.
Aucun, monsieur Armand (on rit), car je ne naquis qu'en 98.
ARMAND.
Alors vous avez cinquante-sept ans, puisque nous sommes en 1855.
LE PÈRE MICHEL.
Et je les porte bien, n'est-ce pas? Ah! c'est que j'ai eu tant de malheurs! forcé par la nécessité, j'ai dû être intendant. J'ai été dix ans chez un bien bon maître, M. le duc de Narvonne; depuis sa mort, je n'ai pas eu le courage d'en servir un autre et j'ai pris cette loge comme retraite, mais maintenant, si j'avais une bonne place en vue, j'aimerais bien à la prendre.
M. DE MORVILLE.
Si je puis vous recommander, père Michel, je le ferai, soyez-en sûr.
LE PÈRE MICHEL.
Merci, monsieur. Je montrerai avec orgueil mes certificats; ils ne peuvent que me faire honneur.
La soirée s'avançait. Anna était venue chercher Élisabeth et Armand; après des bonsoirs affectueux on se sépara gaiement.

Lorsque Noémi arriva le jour suivant pour prendre sa leçon, Mme de Morville et ses enfants la reçurent avec les témoignages de la reconnaissance la plus tendre; Mme de Valmier accompagnait sa fille et se mit à causer avec la mère d'Irène.
Dans cette conversation, Mme de Valmier dit à Mme de Morville combien elle était lasse de mener une vie aussi frivole, aussi vide, et lui demanda en toute simplicité des conseils pour devenir sérieuse et utile aux autres. Mme de Morville, touchée de cette confiance amicale, se montra des plus affectueuses; à partir de ce moment, les deux jeunes femmes se lièrent étroitement. Mme de Valmier vit aussi intimement Mmes de Kermadio et de Marsy. On va voir quels changements furent amenés par ces liaisons.
La fête de M. de Valmier arriva peu de temps après; au moment de se mettre à table, il fut agréablement surpris de voir sa femme et sa fille lui offrir de magnifiques bouquets.
«En l'honneur de quel saint me fleurissez-vous ainsi? dit il gaiement.
--En l'honneur de saint André, votre patron, mon ami, dit sa femme en l'embrassant.
--Vous ne vous en doutiez pas, cher papa? dit Noémi l'embrassant aussi.
--Ma foi non, répondit M. de Valmier en souriant; mais il y a si longtemps qu'on n'a fêté cet anniversaire! mon oubli est pardonnable.
--Vous n'aurez plus ce reproche à nous faire, André, dit affectueusement Mme de Valmier; nos coeurs ne vous oublieront point, soyez-en sûr.
--Ma chère Juliette, répondit son mari, ces bonnes paroles me font grand plaisir... mais n'avons-nous pas du monde à dîner, ce soir? Vous êtes bien simplement mises pour nos invités.
MADAME DE VALMIER.
J'ai remis à plus tard, cher André, ce dîner de cérémonie; j'ai préféré que nous fussions seuls pour vous fêter tout à notre aise.
NOÉMI, gaiement.
Et puis, papa, ma petite robe d'alpaga est bien plus commode pour m'installer sur vos genoux et vous embrasser à mon aise, sans craindre de chiffonner d'ennuyeuses garnitures.»
L'air surpris et joyeux de M. de Valmier fit rire sa femme.
«Ah ça! dit-il enfin, tu es joliment changée, Noémi! toi qui étais folle de la toilette et... vous aussi, Juliette, permettez-moi de le remarquer: vous qui recherchiez le luxe, le monde, les réunions brillantes, vous paraissez aimer le calme et la simplicité, maintenant?
MADAME DE VALMIER.
En êtes-vous fâché, André?
M. DE VALMIER, vivement.
Pouvez-vous le penser, Juliette! j'en suis enchanté, au contraire... non, je veux dire heureux, profondément heureux! Un intérieur calme doit être si doux!»
On finissait alors de dîner, M. de Valmier se leva, passa dans le salon avec sa femme et sa fille, puis s'assit en silence près du feu.
«Oui, dit-il alors seulement, je dis «doit être,» car notre existence brillante nous empêche de jouir de ce bonheur. Quoi de plus charmant que l'intimité de la famille pour se reposer des fatigues, du tracas des affaires, pour se retremper le coeur et l'esprit!... Hélas, cela ne nous est pas donné, et pourtant nous en aurions grand besoin!»
M. de Valmier avait dit cela avec un sentiment de profonde tristesse, de regret poignant, la voix émue, les yeux baissés.
Un baiser le fit tressaillir: il regarda alors Noémi qui, les larmes aux yeux, était à genoux devant lui, tandis que sa femme, assise près de lui, lui tendait la main et lui dit tout bas:
«Tout cela est tristement vrai, André; mais cette vie calme qui nous fait défaut et que vous désirez, je la réclame aussi: grâce aux excellents conseils d'amis vrais, j'ai compris que notre vie était plus qu'inutile, qu'elle était mauvaise. Désormais, cher André, ajouta Mme de Valmier à voix haute, vous trouverez soir et matin le vrai foyer de famille; jusqu'ici, il était vide ou envahi par le monde, maintenant votre femme et votre fille vont y être sans cesse, simples, aimantes et dévouées. N'est-ce pas, ma Noémi?
NOÉMI.
Oh oui, maman, je serai bien heureuse de donner à papa le bonheur qu'il désire!»
M. de Valmier avait écouté avec ravissement ces tendres paroles, échos de nobles sentiments; il voulut parler, mais l'émotion l'en empêcha et il tendit ses bras à sa femme et à sa fille; elles s'y jetèrent en pleurant.
Après ces étreintes si tendres de la part de la mère et de la fille, si affectueusement reconnaissantes de la part de M. de Valmier, Noémi, riant et pleurant, s'écria:
«Il faut égayer papa! le faire pleurer le jour de sa fête, c'est triste!
M. DE VALMIER.
Ce sont de douces larmes, mon enfant; bénies soient celles qui les font couler.
NOÉMI.
Papa, ne nous flattez pas. Est-il temps de faire ma surprise, maman?
MADAME DE VALMIER.
Oui, mon enfant; elle ne peut être que bien reçue.
M. DE VALMIER.
Comment, Noémi, tu n'es pas contente de m'avoir donné un magnifique bouquet?
NOÉMI.
Non, papa, mon cher et excellent papa: le bouquet ne m'a donné aucune peine, et je veux vous prouver que l'idée de vous faire plaisir m'a aidée à vaincre quelques difficultés.»
En disant ces mots, Noémi se mit au piano, et joua à son père un morceau de Chopin avec une délicatesse et une sûreté de jeu vraiment remarquables.
M. DE VALMIER
Bravo, mon enfant, ma chère Noémi; bravo et merci. (Il l'embrasse.) Moi qui suis passionné pour la musique, cela me promet de bonnes et charmantes soirées. Quels progrès Irène t'a fait faire!
MADAME DE VALMIER.
A mon tour de faire ma surprise. André, vous me reprochiez avec raison de négliger ma voix; depuis quelque temps je prends (riant) en cachette des leçons de Braga, et je suis à même de vous chanter votre morceau favori du Barbier de Séville.
Et, accompagnée par Noémi, Mme de Valmier chanta, avec un vrai talent, l'air tant aimé par M. de Valmier.
Quand elle eut fini, M. de Valmier lui serra les mains en silence, mais ses yeux remerciaient plus éloquemment que des paroles n'auraient pu le faire.
NOÉMI.
Ah! voilà le thé, ne vous dérangez pas, maman, je vais le servir moi-même, comme a fait l'autre jour ma bonne Irène.
M. DE VALMIER, frappé.
Eh! mais, parliez-vous tout à l'heure de la famille de Morville, Juliette, lorsque vous disiez que votre changement, béni et mille fois béni par moi, était dû à leurs bons conseils?
NOÉMI, avec feu.
Oui, papa! vous ne pouvez savoir combien ils sont excellents, eux et leurs amis de Kermadio et de Marsy.

MADAME DE VALMIER.
Laissez-moi vous raconter l'histoire de notre changement, mon bon André: elle vous intéressera et vous fera aimer les coeurs à qui nous sommes redevables de nos idées sérieuses.
Juliette fit alors part à son mari de la résolution de Noémi de prendre des leçons de piano d'Irène; elle lui parla des conversations qu'elle avait eues avec Mme de Morville, avec Mmes de Kermadio et de Marsy; de l'affaire des bijoux chez Mme Blesseau; de la charmante conduite de Noémi; enfin de leur résolution, à elle et à sa fille, de vivre comme leurs amis, en famille et pour la famille.
M. de Valmier avait écouté sa femme avec un intérêt profond; il était vivement ému. Lorsque sa femme eut fini, il se leva et s'écria avec élan:
«Moi aussi, j'aurai une surprise à vous faire, mes chères amies, et elle sera digne de vos coeurs, je le jure.
MADAME DE VALMIER.
Nous sommes richement récompensées par la joie de vous rendre heureux, André. Nous ne voulons rien de plus!
NOÉMI.
Certainement non. Ah! maman, savez-vous qu'Élisabeth est enchantée: sa famille vient de s'augmenter d'une charmante petite soeur: on va l'appeler Henriette! Quel joli nom et qu'ils sont heureux! ils sont trois déjà, et moi, je suis toute seule! J'aimerais tant avoir des petits frères et des petites soeurs à aimer, à caresser....
M. DE VALMIER.
Le bon Dieu t'en enverra peut-être.
MADAME DE VALMIER.
Je l'espère aussi; c'est si charmant, une nombreuse famille!
M. DE VALMIER.
C'est vrai, on n'a jamais trop d'enfants à aimer.»
Un domestique entra en ce moment:
«Monsieur, dit-il, il y a un vieux bonhomme qui demande instamment à remettre à monsieur en personne deux paquets.
M. DE VALMIER.
Est-ce encore une surprise, ma bonne Juliette?
MADAME DE VALMIER.
Pas de moi, mon ami, mais de Noémi peut-être.
NOÉMI, étonnée.
Non, maman, je ne sais ce que cela veut dire.
M. DE VALMIER.
Bah! faites entrer cet homme, Baptiste, nous allons avoir par lui la clef de ce mystère.
LE DOMESTIQUE.
Tout de suite, monsieur.»
La porte s'ouvrit et l'on vit entrer... le père Michel, haletant, essoufflé, pliant sous le poids d'un lourd paquet, mais toujours majestueux dans ses gestes, et plus bavard que jamais.
NOÉMI, intriguée.
C'est vous, père Michel? que nous apportez-vous là?
MADAME DE VALMIER.
Déposez cela bien vite, mon ami; pauvre homme, comme il est chargé!
LE PÈRE MICHEL.
Mlle Irène et M. Julien ne voulaient pas me laisser porter cela, mais je suis têtu, moi, tel que vous me voyez, surtout quand il s'agit de faire plaisir à de charmants enfants comme vos amis, mademoiselle Noémi. Or, comme il n'y avait plus de commissionnaires disponibles et que je voyais deux gentilles figures désolées de ne pas envoyer leurs surprises à monsieur et à mademoiselle, j'ai pris les paquets, et me voici, moi et mes cinquante-sept ans, plus mes deux paquets.
NOÉMI, surprise.
Irène m'envoie cela?
LE PÈRE MICHEL.
Rectifions les faits, mademoiselle, rectifions-les! Ce paquet vous est destiné. Celui-là est envoyé à monsieur votre père...; seulement (il hésite) je prierai monsieur de vouloir bien....
M. DE VALMIER.
Quoi, mon ami, que voulez-vous?
LE PÈRE MICHEL.
C'est que... j'aimerais bien avoir... un petit reçu! (étonnement général) mais oui, un petit reçu, comme quoi je vous ai fidèlement remis ces deux paquets intacts. Voyez-vous, monsieur, il y a des gens si canailles au jour d'aujourd'hui, que je suis toujours content quand je peux donner un témoignage écrit de ma délicatesse; alors, monsieur comprend..., portant des choses précieuses, sans doute....
M. DE VALMIER, riant.
Oui, mon ami, c'est très-bien: tenez (il écrit un reçu), voilà; pouvons-nous prendre les paquets, maintenant?
LE PÈRE MICHEL.
Ah! grand Dieu, monsieur peut-il me faire une pareille question? J'espère n'avoir pas offensé monsieur par cette demande. Monsieur doit bien penser qu'un pauvre noble aime à s'entourer de témoignages honorables, qu'il....
NOÉMI.
Ah! ma bonne Irène! Quelle charmante chose elle m'envoie! Regardez, maman, le délicieux mouchoir!
MADAME DE VALMIER.
La jolie broderie! Tiens, Noémi, vois, mon enfant, quelle pensée délicate l'a inspirée. Ton chiffre est brodé dans un anneau; à gauche et à droite, un semis de petits boutons! Charmante enfant... quelle amie excellente tu as là, Noémi!
NOÉMI.
Voici son petit billet, chère maman. (Elle lit.)
«Ma bonne Noémi,
«La fête de ceux que nous aimons étant aussi une fête pour nous, je me permets de t'envoyer un souvenir: dis-toi bien que chaque point a été accompagné d'une prière pour toi, d'un élan du coeur pour celle qui m'a prouvé d'une façon si charmante son dévouement et son affection.
«Ton ami reconnaissante,
«Irène.»
M. DE VALMIER.
Noémi, aide-moi donc à défaire mon paquet; je ne puis en venir à bout, et je prévois une surprise aussi charmante que la tienne.
Noémi se hâta de venir au secours de son père et l'on vit apparaître une magnifique aquarelle, richement encadrée. Elle représentait le château de M. de Valmier; l'on voyait écrit au bas: Souvenir de la Saint-André, offert par une famille reconnaissante.
MADAME DE VALMIER.
André, mon ami, voilà une belle et touchante preuve de gratitude; j'en suis aussi heureuse que fière pour mes amis.
NOÉMI.
Ah! le sournois de Julien. C'est donc pour cela qu'il m'avait demandé le petit croquis de Valmier!
M. DE VALMIER.
Je le punirai de sa cachotterie, ce cher enfant. Le beau, le touchant souvenir! il aura la place d'honneur dans mon cabinet de travail!
LE PÈRE MICHEL.
Madame, monsieur et mademoiselle, j'ai bien l'honneur de vous saluer; je vous demande pardon d'être resté pour être témoin de votre joie, mais je tenais à la raconter à Mlle Irène et à M. Julien; ils ont tant travaillé à leur surprise, ces pauvres chers petits! ils se levaient tous ces jours-ci à cinq heures du matin, prenant sur leur sommeil afin que leurs leçons et leurs études, qui sont leur gagne-pain, n'en souffrissent pas.
NOÉMI, émue.
L'entendez-vous, maman?
MADAME DE VALMIER.
Oui, ma fille, ils t'aiment comme tu les aimes! conserve bien ces affections, mon enfant; ce sont les seuls vrais bonheurs de la vie, après l'amour de Dieu!
M. DE VALMIER.
Tu as raison, Juliette, mille fois raison, mon amie. Tenez, père Michel, permettez-moi de vous offrir ceci comme récompense de toute votre peine. (Il veut lui donner un louis.)
LE PÈRE MICHEL, refusant.
Ne gâtez pas ma satisfaction, monsieur! je suis largement payé par le service rendu à Mlle Irène et à M. Julien, et par la vue de votre joie.
M. DE VALMIER.
Je n'insiste pas; laissez-moi alors vous serrer la main, afin de vous remercier de votre obligeance.
Le bon vieux concierge, après cette cordiale poignée de main, s'essuya les yeux et disparut sans dire un mot, signe infaillible chez lui d'une profonde émotion.
Restée seule, la famille s'aperçut avec étonnement qu'il était onze heures passées.
M. DE VALMIER.
Le temps passe si vite en famille! Ah! la bonne, la belle soirée! merci à vous, chères amies, qui l'avez rendue si attrayante.
On se sépara sur ces bonnes paroles.

L'intérieur de M. de Valmier avait subi, depuis le jour de sa fête, la plus heureuse transformation; une seule chose inquiétait Mme de Valmier et Noémi, et troublait le calme de leur existence: c'étaient les allures mystérieuses de M. de Valmier. Après avoir accompagné sa femme et sa fille chez les Morville, et les avoir remerciés chaleureusement de leurs charmants souvenirs, il ne reparlait plus d'eux et s'absentait presque chaque jour. Mme de Valmier craignait quelquefois qu'il ne retournât au cercle, mais elle se rassurait en voyant l'air joyeux de son mari, et elle se disait que c'était probablement la surprise annoncée qui le préoccupait ainsi.
«Papa, dit un jour Noémi en dînant, le père Michel est donc venu vous voir aujourd'hui?
--Comment sais-tu cela? demanda M. de Valmier, en se troublant.
--Parce que je l'ai rencontré dans l'escalier en allant avec maman chez Irène. Il nous a dit vite bonjour, en ajoutant: Je suis pressé, tel que vous me voyez.
MADAME DE VALMIER, finement.
André, vous ressemblez à un coupable; vous me rappelez M. de Morville.
M. DE VALMIER, riant.
Comment cela?
MADAME DE VALMIER.
Il était aussi embarrassé que vous ce matin, quand Suzanne lui a demandé le pourquoi de ses allures aussi mystérieuses que les vôtres.
M. DE VALMIER, interdit.
Moi, mystérieux? par exemple, je vous assure....
NOÉMI.
Papa, pour vous ôter l'embarras de répondre à la terrible maman, dites-nous donc si vous avez loué le pavillon, ces jours-ci?
M. DE VALMIER.
Oui! qui te l'a appris?
NOÉMI.
Des ouvriers allant et venant me l'ont fait supposer, avec raison, vous le voyez! Dieu! quel gentil mobilier ils apportent!
MADAME DE VALMIER, avec reproche.
Comment, André! tu as loué le pavillon sans me consulter! il est si rapproché de nous que je désirais y voir là, tu le sais, des parents ou des amis intimes.
M. DE VALMIER.
Ma bonne Juliette, excuse-moi; ce sont des étrangers... charmants...; tu les aimeras beaucoup.
MADAME DE VALMIER, riant.
S'ils sont assez charmants pour t'avoir séduit à première vue, j'espère qu'ils me plairont également; comment s'appellent-ils?
M. DE VALMIER.
Hum!... M. et Mme Villemor.
NOÉMI.
Ont-ils des enfants, papa?
M. DE VALMIER.
Oui, un fils et une fille.
NOÉMI.
Comme chez les Morville. S'ils sont aussi gentils qu'Irène et Julien, cela me fera un charmant voisinage.
MADAME DE VALMIER.
Je souhaite pour ma part une jeune voisine ressemblant un peu à ma chère Suzanne.
M. DE VALMIER.
Mme Villemor est, il me semble, aussi aimable, aussi distinguée que Mme de Morville.
MADAME DE VALMIER.
C'est impossible, mon ami; va, il est rare de rencontrer deux femmes aussi charmantes.
M. DE VALMIER, avec tendresse.
J'en connais une qui la vaut bien.
MADAME DE VALMIER.
Tais-toi, flatteur, ne me donne pas d'orgueil.»
Noémi, se mettant au piano, interrompit la conversation.
Quand Noémi alla aux Tuileries le lendemain, les enfants étaient comme une ruche d'abeilles en révolution. Ce remue-ménage était causé par l'arrivée d'un petit garçon et d'une petite fille, mais quel petit garçon! quelle petite fille!
On n'avait jamais vu un luxe de toilette aussi extravagant, et des manières aussi ridiculement affectées.
Il va sans dire que les élégants admiraient ces nouveaux venus. Lionnette était indécise. Noémi se joignait aux enfants raisonnables pour rire tout bas de ces costumes et de ces façons grotesques.
CONSTANCE, gracieusement.
Mademoiselle, monsieur, voulez-vous jouer avec nous?
LA PETITE FILLE, zézayant.
N'approssez pas trop; vous allez me siffoner. Qui êtes-vous, mademoiselle?

CONSTANCE.
Je m'appelle Constance de Blainval.
LA PETITE FILLE.
Votre mère est-elle marquise?
CONSTANCE.
Non, elle est comtesse.
LA PETITE FILLE.
La mienne est marquise. Moi ze suis la petite marquise Héloïse de Ramor, et voici mon cousin Héliogabale, le fils du comte de Tourtefransse. Vicomte, la comtesse Constance de Blainval: voulez-vous zouer avec la comtesse?
LE VICOMTE HÉLIOGABALE.
Mais comment donc, ma cousine, j'en serai aux anges! On va causer chevaux et équipages, je suppose. C'est le plus charmant passe-temps possible.
CONSTANCE, avec orgueil.
Voilà M. de Jordan, fils du marquis de ce nom, qui va vous parler de ce qui vous intéresse, monsieur le vicomte.
LE VICOMTE HÉLIOGABALE, avec importance.
Combien avez-vous de chevaux dans vos écuries, monsieur?
JORDAN, orgueilleusement.
Trois, monsieur, deux pour la voiture, un pour la selle.
LE VICOMTE HÉLIOGABALE.
Nous autres, nous en avons huit. Quatre chevaux (deux bais et deux noirs) pour attelage, deux chevaux anglais pour le comte mon père et son groom, et deux poneys de Shetland pour moi et mon groom. Combien avez-vous de voitures?
JORDAN, un peu humilié.
Deux, une calèche et un coupé.
LE VICOMTE HÉLIOGABALE.
Nous autres, nous en avons huit, savoir: landeau, calèche, coupé, phaéton, break, poney-chaise, poney-duc et cabriolet. D'où viennent vos voitures?
JORDAN, de plus en plus humilié.
De chez Lelorieux.
LE VICOMTE HÉLIOGABALE.
Nous autres, nous ne nous fournissons que chez Ehrler. Il n'y a que lui, mon cher, il n'y a que lui à Paris.--(A voix basse.) Fumez-vous? (Il lui offre mystérieusement un cigare.) J'ai des havanes parfaits que j'ai chipés.
JORDAN.
On me le défend, mais je fume aussi en cachette. Où prenez-vous vos cigares?
LE VICOMTE HÉLIOGABALE.
Dans le fumoir de papa, donc.
Pendant que les deux petits garçons causaient ainsi, la petite Héloïse disait à Constance.
«Votre mère a-t-elle beaucoup de diamants?
CONSTANCE.
Je crois bien! elle a un collier de 12,000 francs et une broche de 8,000 francs, c'est superbe à voir.
HÉLOISE, avec dédain.
Comment, elle n'a que cela? que ze la plains! Ma mère, à moi, a 20,000 écus de diamants, 5,000 écus d'émeraudes, et 10,000 écus de perles. Elle a toute une garniture de vieux point d'Alençon (30 mètres à 60 francs le mètre!) et tout une garniture de vieux point d'Angleterre, d'un prix incalculable; et puis elle vient d'asseter une garniture de vieux point de Venise de 4,000 écus.
CONSTANCE, humiliée.
Maman a beaucoup de belles dentelles, aussi.
HÉLOISE, dédaigneusement.
Des dentelles modernes, probablement: c'est bien commun! Laissez-moi vous donner un bon conseil, sère, ne dites pas maman, dites ma mère: il n'y a que ce mot-là de bien porté.
CONSTANCE.
Merci, mademoiselle, vous avez raison.
HÉLOISE.
Z'espère avoir toutes les belles sozes de ma mère, à mon mariaze: elle est touzours souffrante et ne les porte presque zamais. D'ailleurs, ça m'ira mieux qu'à elle.
CONSTANCE.
Avez-vous des frères et soeurs?
HÉLOISE, indignée.
Fi, donc! ze suis fille unique, Dieu merci! partazer avec d'autres, ce serait horrible; ze n'ai pas trop de tout l'arzent de mon père et de ma mère, pour moi seule: tout doit être à moi, tout!...
ARMAND, bas.
Ah! la vilaine petite fille! le vilain petit garçon!
JACQUES, bas.
Nous allons voir s'ils vont daigner s'amuser! (Haut.) Eh bien, mes amis, à quoi jouons-nous à présent?
CONSTANCE, avec humeur.
Laissez-nous causer; moi, je ne joue pas.
HÉLOISE.
Moi, zouer, zuste ciel! zamais! cela siffonnerait ma zolie toilette.
LE VICOMTE HÉLIOGABALE, avec hauteur.
Veuillez, monsieur, nous traiter avec respect. Nous ne sommes pas les amis des premiers venus, je vous en préviens.
ARMAND, avec ironie.
Oh! oh! cher vicomte, vous le prenez de bien haut!
LE VICOMTE HÉLIOGABALE.
Ne vous familiarisez pas avec moi, monsieur, je vous prie.
ARMAND, haussant les épaules.
Tenez, mes amis, laissons tranquilles ces petites caricatures et allons jouer sans elles.»

Au moment où Héloïse et Héliogabale, rouges de dépit, ouvraient la bouche pour répondre aux paroles d'Armand, un petit garçon et une petite fille, proprement mais très-simplement vêtus, passèrent avec précipitation en heurtant involontairement les deux merveilleux. Héliogabale, enchanté d'avoir un prétexte pour se mettre en colère, arrêta brusquement ces enfants.
«Je vous trouve bien insolents de nous bousculer, moi et ma cousine, s'écria-t-il grossièrement. Vos vilains vêtements ont touché les nôtres!
HÉLOISE.
Ils ont manqué me siffonner! sassez-les, mon cousin, ces sales petits.
LE PETIT GARÇON, rougissant.
Nos vêtements sont simples, mais propres, monsieur et mademoiselle! vous ne devez pas craindre de les toucher.
HÉLOISE, minaudant.
Quelle horreur! tousser cette laine affreuse? zamais! (Elle se sauve derrière Héliogabale.)
HÉLIOGABALE, avec majesté.
Allez-vous-en, ce n'est pas votre place. Les Tuileries ne sont pas faites pour des gens communs comme vous.
ARMAND, indigné.
Héliogabale, vous êtes aussi impertinent que ridicule: c'est lâche à vous d'insulter des enfants qui ne vous ont rien fait.
HÉLIOGABALE.
Comment, rien fait? ils ont osé effleurer mes vêtements! Je leur ai donné la leçon qu'ils méritaient.
LA PETITE FILLE, irritée.
C'est vous qui mériteriez d'en recevoir une, monsieur, et elle vous sera peut-être donnée....
HÉLIOGABALE, ricanant.
Ah! Ah! je voudrais bien voir cela.
LE PETIT GARÇON, avec colère.
Oui, vous verrez cela, car vous êtes un vilain petit....
LA PETITE FILLE.
Tais-toi, mon ami, viens: laissons ces deux méchants enfants: ils n'ont pas de coeur! (A Armand.) Merci, Monsieur, d'avoir pris notre défense.»
Les petits inconnus s'éloignèrent rapidement. Armand et ses amis, choqués du ton et des manières des nouveaux venus, les laissèrent avec Constance, Herminie, Jordan, Jules et Vervins. Lionnette, retenue par les élégants, était restée près d'Héloïse.
Débarrassés de cette vilaine petite société, les enfants jouèrent de bon coeur: ils se séparèrent enfin, en se disant à revoir pour les jours suivants.
On était alors au printemps: le soleil brillait dans tout son éclat; aussi la réunion était-elle complète chaque jour aux Tuileries; mais, au grand regret des enfants raisonnables, la présence d'Héliogabale, celle d'Héloïse, avaient détruit chez les élégants les bons effets produits par les sages conseils et le bon exemple des enfants raisonnables; les toilettes étaient redevenues extravagantes; à la bourse de timbres se joignaient des paris de toute sorte: Héloïse et son cousin triomphaient orgueilleusement de leur mauvaise influence qui s'accroissait chaque jour de plus en plus.
Un dimanche, les élégants étaient réunis comme d'habitude, se pavanant, paradant les uns devant les autres, lorsque arrivèrent deux enfants, une petite fille et un petit garçon, habillés si richement qu'Héloïse et Héliogabale eux-mêmes poussèrent un cri de surprise et d'admiration: ce n'était que soie rose, dentelles, broderies, or et bijoux.
HÉLOÏSE, gracieusement.
Voulez-vous venir zouer avec nous, mademoiselle et monsieur?
LA PETITE FILLE, avec hauteur.
Je veux savoir avant qui vous êtes.
HÉLOÏSE, bas.
Quelle dignité! c'est une personne très-distinguée! (Haut.) C'est trop zuste! Ze suis la fille de la marquise de Ramor.
LA PETITE FILLE, riant.
Ah! ah! Ramor! quel drôle de nom! pourquoi pas souris morte?
Armand et ses amis, qui s'étaient approchés avec curiosité, éclatèrent de rire à cette réflexion.
HÉLOÏSE, très-rouge.
Vous êtes bien moqueuse, mademoiselle!
LA PETITE FILLE, majestueusement.
Mon père est le duc de Fontarabie, mademoiselle: il a trente-cinq serviteurs.
ARMAND, riant.
Pourquoi pas trente-six? c'est un nombre consacré.
LE PETIT GARÇON, à Héliogabale.
Mon père est maréchal: j'ai quarante-cinq chevaux à ma disposition, je ne comprends pas la vie sans chevaux: en avez-vous autant que moi?
HÉLIOGABALE, honteux.
Hélas! je n'en ai que huit!
JORDAN, bas.
Je ne suis pas fâché qu'il soit humilié par le petit maréchal, le vicomte; il nous a assez assommés avec ses écuries!
La conversation continua: les élégants étaient de plus en plus subjugués par les discours et les manières des nouveaux venus. Le moment de se séparer étant venu, le fils du maréchal dit à tous les enfants: «Messieurs et mesdemoiselles, nous allons ce soir au Cirque; il y débute deux merveilles, les petits centaures. Je vous engage à y aller aussi, ce sera très-intéressant.»
Cette proposition séduisit les enfants, et il fut convenu qu'on obtiendrait des parents la permission d'aller au Cirque:
Leur curiosité était vivement excitée, aussi furent-ils très-éloquents; chacun obtint ce qu'il désirait, et le soir venu, tout ce petit monde se retrouva au spectacle.
Les élégants, groupés entre eux, s'étonnaient de ne voir pas arriver leurs amis du matin, lorsque l'arène s'ouvrit et l'on vit paraître les petits centaures, montés sur des chevaux arabes, lancés au grand galop. Des applaudissements les accueillirent; les enfants des Tuileries avaient poussé un cri de surprise, les élégants étaient furieux, les enfants raisonnables riaient aux éclats en reconnaissant les merveilleux qui étaient venus aux Tuileries le matin.
Les petits centaures firent des prodiges d'adresse et d'intrépidité: on les applaudissait à tout rompre. Leurs exercices terminés, ils sautèrent à bas de leurs chevaux: et se dirigèrent vers les élégants, qui étaient devenus rouges et embarrassés.
LE PETIT GARÇON.
Monsieur Héliogabale, mon père est maréchal... ferrant! (rires) et: j'ai à ma disposition les quarante-cinq chevaux de ce manège!
LA PETITE FILLE.
Mademoiselle Héloïse, mon père s'appelle Leduc, et il est de Fontarabie; il a trente-cinq valets d'écurie sous ses ordres.
LE PETIT GARÇON.
Merci de l'accueil flatteur que vous nous avez fait ce matin: il est vrai que nous étions richement habillés.
LA PETITE FILLE.
Tandis que l'autre jour, quand nous étions mis simplement, vous nous avez insultés.

LE PETIT GARÇON.
C'est papa qui a voulu que nous vous donnions une leçon.
ARMAND.
C'est donc ça! je me rappelais bien les avoir vus quelque part, ces petits enfants!
Après avoir salué ironiquement, les petits centaures se retirèrent. Les élégants, pleurant de dépit, se sauvèrent au milieu des rires moqueurs de leurs voisins qui avaient assisté à cette scène.
Cet incident fit grand bruit dans la petite société des Tuileries: quelques élégants incorrigibles, parmi lesquels se trouvaient Héloïse, Héliogabale, Constance, Herminie, Jordan, son frère et Vervins, abandonnèrent les Tuileries, et se donnèrent rendez-vous aux Champs-Élysées pour y étaler leurs grâces tout à leur aise: une dizaine d'autres enfants revinrent franchement à la raison, à la simplicité, et grossirent le nombre des enfants raisonnables.

«Maman, dit Noémi, en entrant un matin au salon, quelques jours après les dernières scènes, Irène m'écrit qu'elle ne peut me donner ma leçon aujourd'hui; elle me dit aussi qu'ils sont tous très-occupés, et il leur est impossible de nous recevoir ce matin.
MADAME DE VALMIER, étonnée.
C'est singulier, Suzanne y est toujours pour moi; je ne la gêne jamais! cela me contrarie, j'aime tant voir ces chers amis!
NOÉMI.
Et moi donc, j'aime de tout mon coeur mes leçons et ma petite maîtresse de piano. Me voilà désorientée pour toute la journée.
M. DE VALMIER.
Allez voir vos amis de Kermadio, cela vous consolera, mes amies.
NOÉMI.
On dirait que vous êtes enchanté de notre désappointement, méchant papa. (Elle l'embrasse.) Irons-nous chez Mme de Kermadio, maman?
MADAME DE VALMIER.
Je ne sais si cela leur....
BAPTISTE, entrant.
Une lettre pour Madame, une lettre pour Monsieur.
MADAME DE VALMIER, lisant.
C'est de Mme de Kermadio, Noémi, elle nous prie de venir passer la matinée chez elle; ses enfants ont leurs cousins de Marsy à goûter; ils désirent tous que nous y allions.
NOÉMI, étonnée.
Ils choisissent pour se réunir un jour où Irène, Julien et leurs parents sont occupés! quelle singulière chose!
MADAME DE VALMIER.
Je vais écrire que nous irons.»
La mère et la fille se rendirent, en effet, chez Mme de Kermadio. M. de Valmier, visiblement agité après la lecture de la lettre qu'il avait reçue, ne tenait pas en place et n'eut de repos que lorsque la voiture eut emmené Mme de Valmier et Noémi; elles s'en étaient aperçues et en voiture, Noémi dit a sa mère:
«Maman, papa prépare notre surprise.
MADAME DE VALMIER.
Je le crois aussi.
NOÉMI, pensive.
Peut-être s'est-il entendu avec Mme de Kermadio pour nous tenir éloignées de la maison aujourd'hui.
MADAME DE VALMIER, riant.
Tu le sauras facilement en me demandant à trois heures de retourner à l'hôtel. Leur manière de nous retenir nous prouvera qu'ils sont d'accord avec ton père.
NOÉMI.
C'est cela! ça va être amusant.»
Elles arrivèrent chez Mme de Kermadio, où elles furent reçues avec la tendresse accoutumée. Armand faisait mille folies; il éclatait de rire sans sujet, se parlait à lui-même, se frottait les mains à les écorcher et paraissait hors de lui.
Noémi et sa mère remarquèrent cela et se regardèrent du coin de l'oeil en souriant. Après le goûter, Noémi dit à Mme de Valmier, avec intention:
«Ne serait-il pas temps de retourner à la maison, maman?»
Armand poussa un cri qui fit bondir tout le monde.
ÉLISABETH.
Mon Dieu! Armand, ne nous fais donc pas des peurs pareilles.
ARMAND, très-agité.
Mais tu n'as donc pas entendu que Noémi veut partir?
NOÉMI, avec malice.
Il me semble qu'il en est bien temps.
ARMAND, de plus en plus agité.
Oh non, non! Il est bien trop tôt! c'est impossible! tout serait manqué!
NOÉMI.
Qu'est-ce qui serait manqué?
ÉLISABETH, précipitamment.
Notre matinée, chère Noémi; nous comptons te garder jusqu'à l'heure du dîner.
JEANNE, riant.
Armand deviendrait fou furieux si tu par... aïe!...
LES ENFANTS.
Qu'est-ce que c'est?
JEANNE.
Dis donc, Armand, tu pinces bien quand tu t'y mets! je t'en fais mon compliment! (Elle se frotte le bras.)
ARMAND, honteux.
Pardon, ma pauvre Jeanne, je craignais que... que....
NOÉMI.
Que quoi?
ARMAND.
Heu.... Jeanne me comprend, ça me suffit.
ÉLISABETH, riant.
Armand, mon ami, tu ne tiendras jamais jusqu'à la fin!
ARMAND.
Si, si! (Héroïquement.) Je sais me dompter, tu vas voir. Tenez, mes amis, jouons à la lanterne magique, je serai le montreur.
JACQUES.
Qu'est-ce que c'est que ça, le montreur?
ARMAND.
Eh bien, l'homme qui montre, quoi! C'est bien simple.
ÉLISABETH.
Plus simple qu'élégant.
ARMAND.
C'est bon, moqueuse. Installez-vous, je prépare mes verres.
La fin de la matinée s'écoula rapidement. Armand était très-drôle en débitant ses histoires et faisait rire tout le monde. Six heures sonnaient quand Mme de Valmier s'écria:
«Qu'il est tard! Nous nous sommes oubliées: vite, Noémi, partons.
NOÉMI.
Tout de suite, maman. (Elle s'apprête.) Adieu, mes amis; nous sommes horriblement en retard pour le dîner!
ARMAND.
Tant mieux!
NOÉMI.
Merci, Armand, vous êtes charitable! Le pauvre papa qui nous attend doit mourir de faim!
ARMAND.
Il n'y songe pas, au... aïe!...
LES ENFANTS.
Qu'est-ce que tu as!
ARMAND.
C'est Jeanne qui m'a rendu mon pinçon (il se frotte le bras) avec les intérêts! (On rit.)
JEANNE, gaiement.
Il n'y avait plus moyen de t'arrêter autrement... tu allais, tu allais....
ARMAND.
Tu m'as rudement arrêté! C'est égal, je te remercie.»
Mme de Valmier et sa fille prirent congé de leurs amis; elles étaient plus intriguées que jamais.
NOÉMI.
Mais qu'est-ce que cela peut être, mon Dieu, que cette surprise?
MADAME DE VALMIER.
Je ne m'en doute pas du tout! Patience!
En arrivant à l'hôtel, la calèche s'arrêta un instant pour laisser entrer un commissionnaire portant une étagère et un prie-dieu.
NOÉMI.
Voilà nos locataires qui emménagent, maman. C'est drôle: ces meubles ressemblent à ceux de Mme de Morville.
MADAME DE VALMIER.
Il y en a des centaines de pareils, mon enfant.
En descendant de voiture, Noémi leva machinalement la tête: le jour baissait, elle vit pourtant à une des fenêtres du pavillon la figure d'une petite fille qui disparut dès qu'elle se vit regardée.
Noémi poussa une exclamation.
«Comme cette enfant ressemble à Irène! dit-elle.
MADAME DE VALMIER.
Mais tu rêves, ma fillette. Tu n'as dans la tête que nos amis, leur mobilier, leur ressemblance... Bonjour, André, c'est bien aimable à toi de nous attendre, au lieu de te mettre à table... nous sommes si en retard!
M. DE VALMIER.
Tant mieux!
NOÉMI.
Là! voilà papa qui dit comme Armand.
M. DE VALMIER.
Mais certainement: cela prouve que vous vous êtes amusées (entre ses dents) et que Mme de Kermadio m'a tenu parole.
MADAME DE VALMIER.
A table, Noémi: j'ai honte de retenir ainsi ton pauvre père.»
A peine à table, M. de Valmier regarda sa femme et sa fille, sourit en se voyant observé par elles avec une curiosité affectueuse et leur dit:
«Nos locataires se sont installés ce matin dans le pavillon.
MADAME DE VALMIER.
Bien, mon ami; j'irai les voir dès demain matin, cela me semble poli.
M. DE VALMIER.
Je te prie de m'excuser, Juliette, mais je leur ai déjà annoncé que nous irions tous leur faire une visite ce soir.
MADAME DE VALMIER, étonnée.
N'est-ce pas trop d'empressement, mon ami? ils doivent être à peine installés: notre visite les gênera, je crois.
M. DE VALMIER.
Nous y resterons cinq minutes seulement, si tu le veux. Noémi sera contente de voir ses petits voisins.
NOÉMI.
Certainement, papa, d'autant plus que j'ai entrevu la petite fille et elle m'a paru ressembler à ma chère Irène.»

On sortit de table, et Noémi se mit au piano sur la demande de son père, mais elle était visiblement distraite.
A huit heures, M. de Valmier se leva en disant: «Veux-tu venir chez nos voisins, Juliette?
MADAME DE VALMIER.
Volontiers; viens, Noémi.»
On alla vers le pavillon des nouveaux locataires. M. de Valmier sonna et... le père Michel vint ouvrir.
NOÉMI, surprise.
Vous ici, père Michel, par quel hasard?
M. DE VALMIER, souriant.
Il est à mon service maintenant, et il a aidé au déménagement de nos voisins. Entre au salon, Juliette.
MADAME DE VALMIER, entrant.
Je suis charmée, Ma.... Suzanne, chère Suzanne, vous ici? (Elle l'embrasse.)
NOÉMI, enchantée.
Irène, Julien, mes bons amis! quel bonheur!... Et M. de Morville! Voilà donc votre surprise, papa?
MADAME DE VALMIER, émue.
Oh! merci, merci, mon bon André: elle est digne de ton coeur, et de ta tendresse pour nous.
MADAME DE MORVILLE.
Oui, Juliette, nous voilà devenus vos voisins. Et vous ne savez pas tout!
M. DE MORVILLE.
Laisse-moi la joie de le dire, ma bonne Suzanne. Notre généreux ami, madame, m'associe à sa maison de banque: grâce à son affection, ma chère famille n'est plus dans la gêne.
IRÈNE.
Et c'est par sa bonté que nous voilà installés ici. Ces jolis meubles, nous les devons à sa générosité.
JULIEN.
Comment jamais reconnaître tant de bienfaits?
En disant cela tout le monde s'embrassait, riant, pleurant, s'embrassant encore. Quand on fut un peu calmé, M. de Valmier prit la parole:
«Oui, dit-il avec émotion, voilà nos amis près de nous: M. de Morville, grâce à sa grande intelligence, à sa grande habitude des affaires, et à sa prudence, si chèrement acquise, m'aidera à diriger ma maison de banque, trop considérable pour moi seul. Mais cette conduite m'a été inspirée par les bienfaits que nous avons reçus de nos amis. Grâce à eux, j'ai retrouvé l'intérieur, les affections qui me manquaient. N'était-il pas juste de témoigner ma reconnaissance à ceux qui l'ont si noblement méritée?»
De nouvelles exclamations, des effusions nouvelles répondirent à ces paroles; puis Noémi et sa mère visitèrent avec bonheur le charmant appartement de leurs amis.
NOÉMI.
Que c'est joli! que c'est bien arrangé!... Ah! voilà l'étagère et le prie-dieu! Maman, avais-je raison de trouver qu'ils ressemblaient à ceux de Mme de Morville?
MADAME DE VALMIER.
Parfaitement raison, ma Noémi, et la ressemblance de la voisine avec Irène était très-naturelle.
IRÈNE.
Je me suis bien aperçue que j'avais attiré l'attention de Noémi quand elle a regardé le pavillon. J'avais tort de me montrer; mais je ne pouvais résister à l'envie de voir un instant cette chère amie.... (Elles s'embrassent.)
M. DE VALMIER.
Je propose d'aller prendre le thé chez Juliette; nos amis sont à peine installés et rien n'est prêt. Le bon Michel va nous servir; il est averti.
NOÉMI.
Je suis enchantée que vous ayez pris Michel, papa, je l'aime beaucoup.
MADAME DE VALMIER.
Oui, il me paraît très-honnête: il remplacera avantageusement Marius le maître d'hôtel.
On alla chez Mme de Valmier, et l'on termina paisiblement la soirée dans la plus douce, la plus affectueuse intimité.

Le jour suivant, il y avait réception chez M. et Mme de Valmier; mais ce n'était pas une brillante soirée comme il y en avait autrefois: si les toilettes étaient simples, si les invités étaient en petit nombre, les coeurs étaient franchement joyeux. Il y avait là les familles de Morville, de Kermadio et de Marsy: le bonheur était complet et les amis vrais venaient se réjouir avec ceux qu'ils avaient aimés et consolés dans leurs malheurs.
Sur l'expressive et sympathique figure d'Élisabeth se peignait une joie profonde; pour Armand il était changé en mouvement perpétuel, riant, chantant, gambadant et ne cessant pas une minute de se frotter les mains avec plus d'ardeur que jamais.
Après le dîner, il y eut un petit concert, puis une loterie: les artistes étaient Mme de Valmier, Noémi, Irène et Élisabeth. Chacun avait gagné un magnifique lot. Élisabeth et Armand seuls n'avaient pas encore tiré leurs billets.
ARMAND.
Que vais-je gagner, moi? un nigaud, peut-être, j'ai toujours de la chance à rebours. (On rit; il tire son billet.) Qu'est-ce que je disais! un papier plié! C'est une attrape, évidem.... Ah! ah! mes amis, je vais m'évanouir.... (il saute de joie). Non, j'aime mieux embrasser M. de Valmier! (Il lui saute au cou.)
ÉLISABETH, intriguée.
Mais qu'est-ce que c'est donc, mon Dieu?
ARMAND.
Tiens, regarde! Le remplacement du fils de ma nourrice, de ce pauvre Yvon que je savais si malheureux d'être à l'armée. Tu sais comme cela me faisait de la peine, à moi aussi? Ah! mon Dieu, que je suis heureux!... Marie-Anne va être si contente de ravoir son pauvre fils. J'en pleure, tenez! (Il s'essuie les yeux.)
MADAME DE KERMADIO, émue.
Quelle charmante pensée, monsieur de Valmier! Vous venez de faire là bien des heureux!
M. DE KERMADIO, de même.
Nous en sommes vivement reconnaissants!
ÉLISABETH, poussant un cri.
Ah! c'est trop, trop généreux! Voyez, maman, ce que je viens de gagner....
MADAME DE KERMADIO, avec étonnement.
Une lettre de notre architecte pour toi! (Elle lit.)
«Mademoiselle,
«J'ai reçu l'argent destiné à l'école des soeurs. Le terrain est acheté et les travaux commencent aujourd'hui. L'école sera prête pour le premier jour du mois de mai, comme vous le désirez, me dit-on.
«Daignez agréer, etc.
«LEPEC, architecte.»
M. DE KERMADIO.
Une école à Kermadio.... L'objet de tous les voeux d'Élisabeth! Cher monsieur de Valmier, vous la comblez. Je ne sais vraiment si nous pourrons lui laisser accepter....
M. DE VALMIER.
Ah! laissez-nous témoigner notre reconnaissance à vos charmants enfants, monsieur; c'est grâce à eux que tous ces enfants font la joie de leurs parents. Qu'ils en soient récompensés!
MADAME DE VALMIER.
André a raison: vous vous plaisez, chers petits, à faire le bien: nous sommes heureux de vous y aider.
Élisabeth embrassa Mme de Valmier en pleurant.
«Ne me donnez pas d'éloges, madame, s'écria-t-elle: je fais mon devoir, voilà tout! C'est le bon Dieu qu'il faut remercier: lui seul a permis que notre amitié fit quelque bien.
ARMAND.
Rendons-nous justice: Élisabeth a été excellente; moi, je n'ai presque rien fait de bon.
JULIEN.
Par exemple! Et tes leçons de dessin? et tes recherches pour nous trouver?»
Après quelques protestations modestes d'Armand, l'on se dit adieu et l'on se sépara en se donnant rendez-vous aux Tuileries pour le lendemain.
Elles étaient bien changées, les Tuileries! les débris du club le Beau monde ayant disparu, les enfants étaient redevenus peu à peu simples et gentils; le club de la Charité grossissait de plus en plus et améliorait ceux qui en faisaient partie. Il n'y a rien de tel que de faire l'aumône et de s'occuper activement des pauvres pour améliorer son coeur et son esprit. Aussi les parents s'applaudissaient-ils chaque jour davantage de l'excellente influence exercée sur leurs enfants par Élisabeth, Armand et leurs amis.
On venait de terminer les comptes rendus des bonnes oeuvres faites dans la semaine, quand un ouragan de rires et de quolibets fit lever tous les enfants: ils virent accourir Héloïse de Ramor tout en larmes, rouge, en nage, les vêtements en désordre. Lionnette et sa bonne l'accompagnaient; Héloïse était poursuivie par quelques gamins, acharnés comme de vrais roquets. On n'entendait que des cris confus entremêlés de ces phrases:
«Sac à papier! papa, maman, que crâne toilette!
--C'est la reine de Charenton, pour sûr!
--Et ça insulte le monde, ces péronnelles-là?
-Si ça ne fait pas suer! une cervelle à l'envers qui va faire la Marie j'ordonne!
--Ah! mais non! ça ne prend pas....
--Un gamin est t'hardi, mais pas assez pour porter une pelure comme celle-là!
--J'crois ben! un chaudron emplumassé de queues d'arlequins, des habits idem, et tout ça rouge comme du sang de boeuf gras!
--Une ronde autour de la déesse du Boeuf-Gras!
--Ça y est!»
Et les impitoyables gamins, malgré les cris des petites filles furieuses et de la bonne effrayée, se mirent à tourbillonner autour d'elles, en chantant avec frénésie, sur l'air de: Nous allons planter des choux:
V'là la Déesse du Boeuf-Gras,
A la mode, à la mode,
V'là la Déesse du Boeuf-Gras,
A la mode de chez nous.
Elle a la tête à l'envers,
d'cervelle, pas d'cervelle,
Elle a la tête à l'envers,
A la mode de chez nous.
ARMAND, s'élançant.
Voyons, mes amis, laissez ces enfants. C'est lâche à de grands garçons comme vous de tourmenter de pauvres petites filles, parce que leurs parents jugent à propos de les habiller d'une façon ridicule.
UN GAMIN.
Si ça nous plaît, à nous? Ça n'est pas votre affaire!
UN AUTRE GAMIN.
Tais-toi, Micou, ce petit garçon a raison, je le connais, et je ne veux pas qu'on le contrarie, entends-tu?
PREMIER GAMIN.
A cause? C'est l'arche sainte, peut-être?
DEUXIÈME GAMIN.
Tu m'demandais l'aut' jour qui avait donné à maman l'argent de not' loyer pour apaiser l'propriétaire. J't'ai dit: un bon coeur.... Eh ben! le v'là.

PREMIER GAMIN, ému.
C'est bien, ça! fichtre, c'est bien! vot' main, m'sieu, s'vous plaît (il serre la main d'Armand); on aime à s'amuser et à gouailler, mais on n'est pas mauvais pour ça; pas vrai, les autres?
TOUS LES GAMINS.
Non, non, vive l'bienfaiteur à Todore!
DEUXIÈME GAMIN.
Et filons roide, à présent: à l'atelier, les camarades!
ARMAND, affectueusement.
Merci, mes amis, merci, Théodore.
THÉODORE.
Faudrait que je soye un fier ingrat pour pas vous faire plaisir, m'sieu Armand, l'gamin de Paris est reconnaissant pour toujours, entendez-vous? en route, mauvaise troupe.
La bande de gamins disparut comme une nuée d'oiseaux, en chantant à tue-tête.

Restés seuls, les enfants consolèrent Lionnette et Héloïse; ils aidaient la bonne à réparer le désordre de leurs vêtements, lorsque de grands cris se firent entendre de nouveau: Héliogabale parut à son tour, suivi de loin par deux soldats. Le petit garçon se sauvait à toutes jambes en pleurnichant lorsqu'il aperçut sa bonne, poussa un cri de joie et s'élança vers elle.
LA BONNE.
Enfin, vous voilà, monsieur le vicomte. Comment ne m'avez-vous pas suivie pour protéger aussi votre cousine?
HÉLIOGABALE, pleurnichant.
Les méchants gamins se seraient moqués de moi, comme d'Héloïse! j'aimais mieux rester aux Champs Élysées.
PREMIER SOLDAT, arrivant.
Mille tonnerres de pipe culottée! nous vous attrapons enfin, l'insulteur du militairrrre frrrrançais.
DEUXIÈME SOLDAT.
Oui, nous vous....
PREMIER SOLDAT, avec solennité.
Que l'on doit se taire devant son sargent, fusilier Rodet; laissez-moi m'expliquer avec ce civil impoli. C'est donc comme ça, jeune blanc-bec, que vous nous remerciez pour avoir eu l'obligeante complaisance de vous faire traverser la place Concorde?
DEUXIÈME SOLDAT.
Il est t'honteux de ses bienfaiteurs, pas vrai, sargent?
LE SERGENT.
Que je vous adjoins à nouveau de clore votre bec, fusilier Rodet; votre intempérie de langage me choque.
LA BONNE, étonnée.
Monsieur le vicomte, qu'avez-vous donc fait à ces braves soldats?
HÉLIOGABALE, grognant.
Rien du tout; ils sont méchants et assommants de venir me faire une scène devant tout ce monde: ils m'ont aidé à venir ici parce que j'avais peur des voitures, c'est vrai, mais après ils ont exigé des remercîments: de quoi se plaignent-ils, puisque j'ai voulu leur donner de l'argent?

ARMAND, vivement.
C'est très-mal, Héliogabale, d'avoir été ingrat envers ces braves gens. Comment avez-vous osé les humilier en leur offrant de l'argent?
JULIEN.
A des soldats français! c'est honteux....
JACQUES.
Pauvre sergent, il a l'air tout peiné! (Il lui serre la main.) Allez, sergent, tout le monde ne se ressemble pas; les enfants des Tuileries vous remercient de ce que vous venez de faire pour un de leurs camarades.
PAUL.
Bien dit, Jacques. Tenez, sergent, voilà un rouleau de sucre au punch, voulez-vous me faire le plaisir de l'accepter? Ce n'est pas de l'argent, ça, mais le souvenir d'un petit garçon qui espère devenir brave comme vous.
LE SERGENT, souriant.
A la bonne heure! voilà parler! Merci de vos bonnes paroles et de votre gentil cadeau.
DEUXIÈME SOLDAT.
Et moi aussi, je vous remercie, messieurs, je....
LE SERGENT, avec autorité.
Assez causé, fusilier Rodet; par file à droite, en avant marche, mon ami. Au revoir, mes enfants. Adieu, gredinet de vicomte.
Les deux soldats s'éloignèrent, tandis que la bonne faisait des remontrances à Héliogabale, qui grognait de plus belle.
Les élégants et les élégantes des Champs-Élysées étaient arrivés peu à peu à la recherche de leurs amis.
HÉLOÏSE, aigrement.
C'est la faute de cette sotte de Lionnette, si tout cela m'est arrivé; elle disait sans cesse à haute voix: «Tout ce rouze est ravissant! il n'y a qu'Héloïse pour s'habiller si bien! Alors, les gamins l'ont entendue et se sont mis à me poursuivre. Ze me suis sauvée zusqu'ici, et voilà.
LIONNETTE, vivement.
Ah! par exemple, vous n'êtes guère reconnaissante, ma chère; j'ai essayé de vous défendre tout le temps.
HÉLOÏSE, avec colère.
Ce n'est pas vrai! et Herminie m'a abandonnée lâssement, elle, c'est dégoûtant!
HERMINIE, ricanant.
Tiens! comme ç'aurait été agréable de recevoir des injures à cause de vous....
HÉLOÏSE, de même.
Et Constance riait des inzures des gamins. C'est ignoble!
CONSTANCE, tranquillement.
C'était drôle à entendre. D'ailleurs, vous n'êtes guère aimable, ce n'est donc pas étonnant que je ne me soucie pas de vous.
HÉLIOGABALE.
Jordan, Jules et Vervins n'ont jamais voulu quitter guignol, pour me mener ici. C'est pas des bons amis, ça!
JORDAN.
Merci, allez donc vous déranger pour un garçon qui m'a filouté pour 18 francs de timbres confédérés....
JULES.
Et qui n'a jamais voulu me payer mes timbres russes....
VERVINS.
Et qui ne veut jamais jouer qu'aux jokeys pour nous écraser de son luxe, de ses havanes chipés et fumés en cachette, et de ses écuries.
HÉLIOGABALE.
Vous êtes des vilains!
HÉLOÏSE, à ses amies.
Vous êtes des messantes!
Les bonnes ramenèrent aux Champs-Élysées les malheureux élégants, qui se disputaient avec acharnement. Lionnette seule ne les suivit pas.
LA BONNE.
Venez-vous, mademoiselle Lionnette? voilà toutes vos amies qui s'en vont.
LIONNETTE, résolûment.
Non, ce ne sont plus mes amies; je veux rester ici avec Élisabeth, Noémi, Irène, Jeanne et Françoise, que j'ai sottement dédaignées. Héloïse n'est qu'une ingrate et une égoïste. (Aux petites filles qui l'entourent.) Chères amies, voulez-vous de moi? je serais si heureuse de redevenir votre amie, d'être simple et gentille comme vous toutes!
ARMAND, battant des mains.
Vivat! voilà Mlle Lionnette gagnée à la bonne cause!
ÉLISABETH, l'embrassant.
Soyez la bienvenue, chère Lionnette! nous vous regrettions véritablement. Votre retour parmi nous est une grande joie.
LA BONNE.
Vous faites joliment bien, mademoiselle; allez, les bons coeurs valent mieux que les beaux habits.
Tous les enfants entourèrent Lionnette, émue et reconnaissante, et lui firent les plus tendres caresses.
Armand déclara alors solennellement qu'on allait jouer à «la condamnation du luxe des enfants.» Lionnette devait déposer comme témoin à charge. On accueillit avec joie cette proposition et l'interrogatoire commença.
LE JUGE ÉLISABETH.
Procureur Armand, qu'avez-vous à dire?
P. ARMAND.
Illustre juge, j'accuse le maudit Luxe d'avoir pris une de nos amies, de l'avoir maquillée, de l'avoir habillée comme une poupée, et, pour preuve, je demande qu'on interroge la susdite amie.
J. ÉLISABETH.
C'est trop juste! Témoin Lionnette, dites ce que vous savez.
T. LIONNETTE.
Je déclare en toute franchise que je trouve fâcheux et ridicule de se barbouiller de blanc, de rouge et de noir. Moi-même j'avoue que....
P. ARMAND, l'interrompant.
Vous n'êtes pas accusée, vous n'êtes que témoin.
LIONNETTE.
Je déclare également qu'il est fâcheux de voir les enfants affublés de tant d'étoffes et de garnitures coûteuses: cela les empêche de jouer....
ARMAND.
Écoutez, écoutez bien!... (On rit.)
LIONNETTE.
Cela excite leur vanité, détruit les bons sentiments de leurs coeurs, les rend passionnés pour le monde, et pour ces motifs je blâme absolument ces modes dangereuses. (On applaudit.)
ARMAND.
Bravo, témoin! à mon tour.... (Il grince des dents.) Brrr! (On rit.) Mesdemoiselles et messieurs, nous venons de voir quel fâcheux exemple nous donnent ceux qui ne vivent que pour le luxe, l'élégance, la vanité et l'argent. Ils sont ridicules à plaisir, ingrats, grossiers, sans coeur, faux amis. Nous, sachons rester simples, naturels, sincères: nous y gagnerons sous tous les rapports.
Des applaudissements accueillirent le discours d'Armand, et le juge Élisabeth prononça, au milieu d'acclamations enthousiastes, la condamnation suivante:
«D'après la déposition du témoin Lionnette et le réquisitoire du procureur Armand, nous, juge, déclarons que le luxe est à jamais aboli par les enfants des Tuileries.»
Et satisfaits de cette sérieuse résolution, qui ne pouvait que leur faire grand bien, les enfants se séparèrent gaiement, pour annoncer à leurs familles l'heureuse transformation des enfants des Tuileries.

Depuis ce temps tout fut paix et bonheur chez nos amis. Irène, Julien, Noémi, Lionnette, les petits de Kermadio, les petits de Marsy, tous achevèrent brillamment leur instruction. Les jeunes gens terminèrent leur éducation dans un excellent collège. Les jeunes filles, dirigées par leurs mères et assidues à des cours de toute espèce, acquirent ainsi une solide instruction. Michel, «tel que vous le voyez,» est le meilleur des maîtres d'hôtel: il mène admirablement la maison de M. de Valmier Les parents sont profondément, complètement heureux. Noémi a vu, à sa grande joie, sa famille s'accroître de deux petites soeurs et d'un petit frère. La famille de Morville a racheté sa terre. Irène et Julien s'y plaisent beaucoup, y font beaucoup de bien et sont adorés par tous les gens du voisinage, pauvres et riches.
Julien, en sortant du collège, est devenu l'associé de M. de Valmier et de son père: on parle de son prochain mariage avec Notoni. Armand dirige l'exploitation de Kermadio et vient de demander la main d'Irène. On pensa qu'elle ne le refusera pas.
Constance a épousé un sportman qui se ruina en jokeys et en chevaux. Herminie est défigurée par la petite vérole et impossible à marier, grâce à son detestable caractère.
Héloïse est morte étouffée dans son corset.
Jordan et Jules se détestent et plaident l'un contre l'autre, à propos d'héritages.
Vervins est en prison pour dettes; le vicomte Héliogabale est devenu idiot à force de fumer.
Et Élisabeth! notre chère, notre charmante et sympathique Élisabeth? vous n'en parlez pas! me disent d'impatients petits lecteurs, indignés de mon oubli... Je la réservais pour la fin.
Élisabeth est une de ces natures d'élite qui ont soif de sacrifices, de dévouement. Si vous voulez la voir, allez à l'hospice de ***; celle que les malades attendris appellent «la bonne soeur,» celle dont la cornette de soeur de Charité voile le doux et gracieux visage, c'est Élisabeth, l'Ange de la famille devenu l'Ange de la Charité.
V. Rendez le bien pour le bien
VII. Comme quoi l'on s'amuse mal quelquefois
IX. Une séance du Club «la Charité»
X. Une séance du Club «le Beau monde»
XI. Chez la grand'mère d'Élisabeth
XIV. Les amis faux et les amis vrais
XVIII. Manières différentes de recevoir des amis pauvres
XXII. Les sacrifices d'Irène et de Julien
XXIII. La fille de Mme de Marville
XXIV. La fête de M. de Valmier
XXV. On entrevoit une grande surprise
XXVI. Les élégants sont attrapés!
XXVII. La surprise de M. de Valmier
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
End of the Project Gutenberg EBook of Les enfants des Tuileries, by
Olga, Vicomtesse de Pitray
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES ENFANTS DES TUILERIES ***
***** This file should be named 26091-h.htm or 26091-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
https://www.gutenberg.org/2/6/0/9/26091/
Produced by Suzanne Shell, Rénald Lévesque and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
https://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.