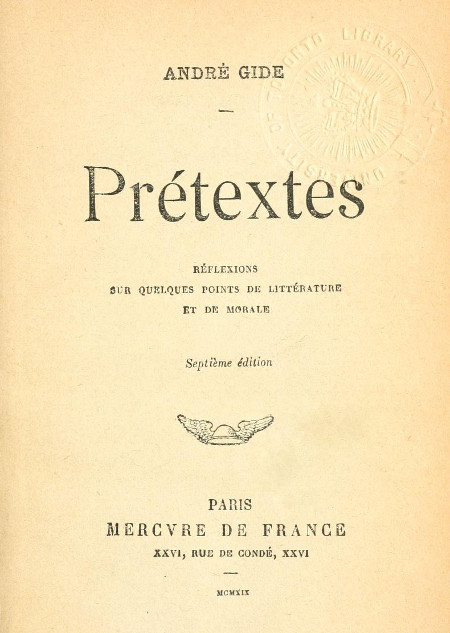
Title: Prétextes: Réflexions sur quelques points de littérature et de morale
Author: André Gide
Release date: March 20, 2017 [eBook #54393]
Most recently updated: October 23, 2024
Language: French
Credits: Produced by Winston Smith. Images made available by The
Internet Archive.
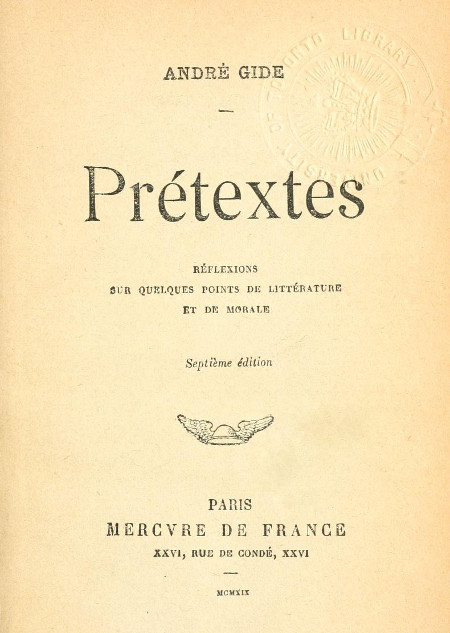
PRÉTEXTES
DU MÊME AUTEUR
| ANDRÉ WALTER (Les cahiers; Les Poésies) | épuisé |
| LE VOYAGE D'URIEN | épuisé |
| PALUDES | épuisé |
| Au Mercure de France | |
| PRÉTEXTES | 1 vol. |
| NOUVEAUX PRÉTEXTES | 1 vol. |
| L'IMMORALISTE, récit | 1 vol. |
| LA PORTE ÉTROITE, récit | 1 vol. |
| OSCAR WILDE | 1 vol. |
| A la Nouvelle Revue Française | |
| LES NOURRITURES TERRESTRES | 1 vol. |
| ISABELLE, récit | 1 vol. |
| LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGUE | 1 vol. |
| LE ROI DE CANDAULE, suivi de SAUL | 1 vol. |
| LE PROMÉTHÉE MAL ENCHAÎNÉ | 1 vol. |
| LES CAVES DU VATICAN | 1 vol. |
Réflexions
sur quelques points de littérature
et de morale
Septième édition
PARIS
MERCVRE DE FRANCE
XXVI, RUE DE CONDÉ, XXVI
MCMXIX
JUSTIFICATION DU TIRAGE
Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays
| Deux conférences. | ||
| De l'influence en Littérature | 7 | |
| Les Limites de L'Art | 35 | |
| Autour de M. Barrès. | ||
| A propos des Déracinés | 51 | |
| La querelle du peuplier (Réponse à M. Maurras) | 61 | |
| La Normandie et le Bas-Languedoc | 71 | |
| Lettres à Angèle. | ||
| I.— | Mirbeau; Curel; Hauptmann | 81 |
| II.— | Signoret; Jammes | 88 |
| III.— | Les Naturistes | 99 |
| IV.— | Barrès; Maeterlinck | 102 |
| V.— | Verhaeren, Pierre Louys | 107 |
| VI.— | Stevenson et du nationalisme en littérature | 113 |
| VII.— | De quelques récentes idolâtries | 124 |
| VIII.— | Sada Yacco | 135 |
| IX.— | De quelques jeunes gens du Midi | 142 |
| X.— | Les Mille Nuits et une Nuit du Dr Mardrus | 151 |
| XI.— | Max Stirner et l'individualisme | 160 |
| XII.— | Nietzsche | 166 |
| Quelques livres. | ||
| Villiers de l'Isle-Adam | 185 | |
| Maurice Léon | 192 | |
| Camille Mauclair | 197 | |
| Henri de Régnier | 203 | |
| Dr J. C. Mardrus (Les Mille Nuits et une Nuit) | 211 | |
| Saint-Georges de Bouhélier | 225 | |
| Lettre à M. Saint-Georges de Bouhélier | 235 | |
| Supplément. | ||
| Francis Jammes | 241 | |
| Saint-Georges de Bouhélier | 242 | |
| Henri de Régnier | 244 | |
| Octave Mirbeau | 246 | |
| In Memoriam. | ||
| Stéphane Mallarmé | 251 | |
| Emmanuel Signoret | 260 | |
| Oscar Wilde | 265 |
Conférence faite à la Libre Esthétique de Bruxelles le 29 Mars 1900.
A Théo Van Rysselberghe.
Mesdames, Messieurs,
Je viens ici faire l'apologie de l'influence.
On convient généralement qu'il y a de bonnes et de mauvaises influences. Je ne me charge pas de les distinguer. J'ai la prétention de faire l'apologie de toutes les influences.
J'estime qu'il y a de très bonnes influences qui ne paraissent pas telles aux yeux de tous.
J'estime qu'une influence n'est pas bonne ou mauvaise [Pg 8]d'une manière absolue, mais simplement par rapport à qui la subit.
J'estime surtout qu'il y a de mauvaises natures pour qui tout est guignon, et à qui tout fait tort. D'autres au contraire pour qui tout est heureuse nourriture, qui changent les cailloux en pain: «Je dévorais, dit Gœthe, tout ce que Herder voulait bien m'enseigner.»
L'apologie de l'influencé d'abord; l'apologie de l'influenceur ensuite; ce seront là les deux points de notre causerie.
Gœthe, dans ses Mémoires, parle avec émotion de cette période de jeunesse où, s'abandonnant au monde extérieur, il laissait indistinctement chaque créature agir sur lui, chacune à sa manière. «Une merveilleuse parenté avec chaque objet en résultait, écrit-il,—une si parfaite harmonie avec toute la nature, que tout changement de lieu, d'heure, de saison, m'affectait intimement.» Avec délices il subissait la plus fugitive influence.
Les influences sont de maintes sortes—et si je vous ai rappelé ce passage de Gœthe, c'est parce que je voudrais pouvoir parler de toutes les influences, chacune [Pg 9]ayant son importance,—commençant par les plus vagues, les plus naturelles, gardant pour les dernières les influences des hommes et celles des œuvres des hommes; les gardant pour les dernières parce que ce sont celles dont il est le plus difficile de parler—et contre lesquelles on tente le plus, ou l'on prétend tenter le plus, de regimber.—Comme ma prétention est de faire l'apologie de celles-ci aussi, je voudrais préparer cette apologie de mon mieux,—c'est-à-dire lentement.
Il n'est pas possible à l'homme de se soustraire aux influences; l'homme le plus préservé, le plus muré en sent encore. Les influences risquent même d'être d'autant plus fortes qu'elles sont moins nombreuses. Si nous n'avions rien pour nous distraire du mauvais temps, la moindre averse nous ferait inconsolables.
Il est tellement impossible d'imaginer un homme complètement échappé de toutes les influences naturelles et humaines, que, lorsqu'il s'est présenté des héros qui paraissaient ne rien devoir à l'extérieur, dont on ne pouvait expliquer la marche, dont les actions, subites, et incompréhensibles aux profanes, étaient telles qu'aucun mobile humain ne les semblait déterminer—on préférait, après leur réussite, croire à l'influence [Pg 10]des astres, tant il est impossible d'imaginer quelque chose d'humain qui soit complètement, profondément, foncièrement spontané.
En général on peut dire, je crois, que ceux qui avaient la glorieuse réputation de n'obéir qu'à leur étoile étaient ceux sur qui les influences personnelles, les influences d'élection agissaient plus puissamment que les influences générales—je veux dire celles qui agissent sur tout un peuple, du moins sur tous les habitants d'une même ville, à la fois.
Donc deux classes d'influences, les influences communes, les influences particulières; celles que toute une famille, un groupement d'hommes, un pays subit à la fois; celles que dans sa famille, dans sa ville, dans son pays, l'on est seul à subir (volontairement ou non, consciemment ou inconsciemment, qu'on les ait choisies ou qu'elles vous aient choisi). Les premières tendent à réduire l'individu au type commun; les secondes à opposer l'individu à la communauté.—Taine s'est occupé presque exclusivement des premières; elle flattaient son déterminisme mieux que les autres...
Mais comme on ne peut inventer rien de neuf pour soi tout seul, ces influences que je dis personnelles [Pg 11]parce qu'elles sépareront en quelque sorte la personne qui les subit, l'individu, de sa famille, de sa société, seront aussi bien celles qui le rapprocheront de tel inconnu qui les subit ou les a subies comme lui,—qui forme ainsi des groupements nouveaux—et crée comme une nouvelle famille, aux membres parfois très épars, tisse des liens, fonde des parentés—qui peut pousser à la même pensée tel homme de Moscou et moi-même, et qui, à travers le temps, apparente Jammes à Virgile—et à ce poète chinois dont il vous lisait jeudi dernier le charmant, modeste et ridicule poème.
Les influences communes sont forcément les plus grossières—ce n'est pas par hasard que le mot grossier est devenu synonyme de commun.—J'aurais presque honte à parler de l'influence de la nourriture si Nietzsche par exemple, paradoxalement je veux le croire, ne prétendait que la boisson a une influence considérable sur les mœurs et sur la pensée d'un peuple en général: que les Allemands par exemple, en buvant de la bière, s'interdisent à jamais de prétendre à cette légèreté, cette acuité d'esprit que Nietzsche prête aux Français buveurs de vin. Passons.
Mais, je le répète: moins une influence est grossière, [Pg 12]plus elle agit d'une manière particulière. Et déjà l'influence du temps, celle des saisons, bien qu'agissant sur de grandes foules à la fois, agit sur elles de manière plus délicate et plus nerveuse, et provoque des réactions très diverses.—Tel est exténué, tel autre est exalté par la chaleur. Keats ne pouvait travailler bien qu'en été, Shelley qu'en automne. Et Diderot disait: «J'ai l'esprit fou dans les grands vents.» On pourrait citer encore, citer beaucoup... Passons.
L'influence d'un climat cesse d'être générale, et par là devient sensible, à celui qui la subit en étranger.—Ici nous arrivons aux influences particulières;—à vrai dire, les seules qui aient droit de nous occuper ici.
Lorsque Gœthe, arrivant à Rome, s'écrie: «Nun bin ich endlich geboren!» Enfin je suis né!... Lorsqu'il nous dit dans sa correspondance qu'entrant en Italie il lui sembla pour la première fois prendre conscience de lui-même et exister ... voilà certes de quoi nous faire juger l'influence d'un pays étranger comme des plus importantes.—C'est, de plus, une influence d'élection: je veux dire qu'à part de malheureuses exceptions, voyages forcés ou exils, on choisit d'ordinaire la terre où l'on veut voyager; la choisir est preuve que déjà l'on est un peu influencé par elle.—Enfin [Pg 13]l'on choisit tel pays précisément parce que l'on sait que l'on va être influencé par lui, parce qu'on espère, que l'on souhaite cette influence. On choisit précisément les lieux que l'on croit capables de vous influencer le plus.—Quand Delacroix partait pour le Maroc, ce n'était pas pour devenir orientaliste, mais bien, par la compréhension qu'il devait avoir d'harmonies plus vives, plus délicates et plus subtiles, pour «prendre conscience» plus parfaite de lui-même, du coloriste qu'il était.
J'ai presque honte à citer ici le mot de Lessing, repris par Gœthe dans les Affinités Electives, mot si connu qu'il fait sourire: «Es wandelt niemand unbestraft unter Palmen», et que l'on ne peut traduire en français qu'assez banalement par: «Nul ne se promène impunément sous les palmes.» Qu'entendre par là? sinon qu'on a beau sortir de leur ombre, on ne se retrouve plus tel qu'avant.
J'ai lu tel livre; et après l'avoir lu je l'ai fermé; je l'ai remis sur ce rayon de ma bibliothèque,—mais dans ce livre il y avait telle parole que je ne peux pas oublier. Elle est descendue en moi si avant, que je ne la distingue plus de moi-même. Désormais je ne suis plus comme si je ne l'avais pas connue.—Que j'oublie [Pg 14]le livre où j'ai lu cette parole: que j'oublie même que je l'ai lue; que je ne me souvienne d'elle que d'une manière imparfaite ... n'importe! Je ne peux plus redevenir celui que j'étais avant de l'avoir lue.—Comment expliquer sa puissance?
Sa puissance vient de ceci qu'elle n'a fait que me révéler quelque partie de moi encore inconnue à moi-même; elle n'a été pour moi qu'une explication—oui, qu'une explication de moi-même. On l'a dit déjà: les influences agissent par ressemblance. On les a comparées à des sortes de miroirs qui nous montreraient, non point ce que nous sommes déjà effectivement, mais ce que nous sommes d'une façon latente.
Ce frère intérieur que tu n'es pas encore,
disait Henri de Regnier,—Je les comparerai plus précisément à ce prince d'une pièce de Mæterlinck, qui vient réveiller des princesses. Combien de sommeillantes princesses nous portons en nous, ignorées, attendant qu'un contact, qu'un accord, qu'un mot les réveille!
Que m'importe, auprès de cela, tout ce que j'apprends par la tête, ce qu'à grand renfort de mémoire j'arrive [Pg 15]à retenir?—Par instruction, ainsi, je peux accumuler en moi de lourds trésors, toute une encombrante richesse, une fortune, précieuse certes comme instrument, mais qui restera différente de moi jusqu'à la consommation des siècles.—L'avare met ses pièces d'or dans un coffre; mais, sitôt le coffre fermé, c'est comme si le coffre était vide.
Rien de pareil avec cette intime connaissance, qui n'est plutôt qu'une reconnaissance mêlée d'amour—de reconnaissance, vraiment; qui est comme le sentiment d'une parenté retrouvée.
A Rome, près de la solitaire petite tombe de Keats, quand je lus ses vers admirables, combien naïvement je laissai sa douce influence entrer en moi, tendrement me toucher, me reconnaître, s'apparenter à mes plus douteuses, à mes plus incertaines pensées.—A ce point que lorsque, malade, il s'écrie dans l'Ode au Rossignol:
Oh! qui me donnera une gorgée d'un vin—longtemps refroidi dans la terre profonde,—d'un vin qui sente Flora et la campagne verte, la danse et les chansons provençales, et la joie que brûle le soleil?
—Oh! qui me donnera une coupe pleine de chaud Midi?
[Pg 16]Il me semblait, que, de mes propres lèvres, j'entendisse jaillir cette plainte admirable.
S'éduquer, s'épanouir dans le monde, il semble vraiment que ce soit se retrouver des parents.
Je sens bien qu'ici nous sommes arrivés au point sensible, dangereux, et qu'il va devenir plus difficile et délicat de parler. Il ne s'agit plus à présent des influences—dirai-je: naturelles—mais bien des influences humaines.—Comment expliquer, tandis que l'influence nous apparaissait jusqu'ici comme un heureux moyen d'enrichissement personnel—ou du moins semblable à cette baguette de coudre des sorciers qui permettrait de découvrir en soi des richesses,—comment expliquer que brusquement ici l'on entre en garde, que l'on ait peur (surtout de nos jours, disons-le bien), que l'on se défie. L'influence, ici, est considérée comme une chose néfaste, une sorte d'attentat envers soi-même, de crime de lèse-personnalité.
C'est que précisément aujourd'hui, même sans faire profession d'individualisme, nous prétendons avoir chacun notre personnalité, et que, sitôt que cette personnalité n'est plus très robuste, sitôt qu'elle paraît, [Pg 17]à nous-mêmes ou aux autres, un peu indécise, chancelante ou débile, la peur de la perdre nous poursuit et risque de gâter nos plus réelles joies.
La peur de perdre sa personnalité!
Nous avons pu, dans notre bienheureux monde des lettres, connaître et rencontrer bien des peurs: la peur du neuf, la peur du vieux—ces derniers temps la peur des langues étrangères, etc. ... mais de toutes, la plus vilaine, la plus sotte, la plus ridicule, c'est bien la peur de perdre sa personnalité.
«Je ne veux pas lire Gœthe, me disait un jeune littérateur (ne craignez rien, je ne nomme que quand je loue),—je ne veux pas lire Gœthe parce que cela pourrait m'impressionner.»
Il faut, n'est-ce pas, être arrivé à un point de perfection rare, pour croire que l'on ne peut changer qu'en mal.
La personnalité d'un écrivain, cette personnalité délicate, choyée, celle qu'on a peur de perdre, non tant parce qu'on la sait précieuse, que parce qu'on la croit sans cesse sur le point d'être perdue—consiste trop souvent à n'avoir jamais fait telle ou telle chose. C'est ce qu'on pourrait appeler une personnalité privative. La perdre, c'est avoir envie de faire, ce [Pg 18]qu'on s'était promis de ne pas faire.—Il a paru, il y a quelque dix ans, un volume de nouvelles que l'auteur avait intitulé: Contes sans qui ni que. L'auteur s'était fait une manière d'originalité, un style spécial, une personnalité, à n'employer jamais un pronom conjonctif. (Comme si les qui et les que ne continuaient pas quand même d'exister!)—Combien d'auteurs, d'artistes, n'ont d'autre personnalité que celle-là, qui, le jour où ils consentiraient à employer les qui et les que, comme tout le monde, se confondraient tout simplement dans la masse banale et infiniment nuancée de l'humanité.
Et pourtant, il faut bien avouer que la personnalité des plus grands hommes est faite aussi de leurs incompréhensions. L'accentuation même de leurs traits exige une limitation violente. Aucun grand homme ne nous laisse de lui une image vague, mais précise et très définie. On peut même dire que ses incompréhensions font la définition du grand homme.
Que Voltaire n'ait compris Homère ni la Bible; qu'il éclate de rire devant Pindare; est-ce que cela ne dessine pas la figure de Voltaire? comme le peintre qui, traçant le contour d'un visage, dirait à ce visage: Tu n'iras pas plus loin.
[Pg 19]Que Gœthe, le plus intelligent des êtres, n'ait pas compris Beethoven—Beethoven, qui, après avoir joué devant lui la sonate en ut dièze mineur (celle qu'on a coutume de nommer la Sonate au clair de lune), comme Gœthe demeurait froidement silencieux, poussait vers lui ce cri de détresse: «Mais, Maître, si vous, vous ne me dites rien—qui donc alors me comprendra?» est-ce que cela ne définit pas d'un coup Gœthe—et Beethoven?
Ces incompréhensions s'expliquent, voici comment: elles ne sont certes point sottise; elles sont éblouissement.—Ainsi tout grand amour est exclusif, et l'admiration d'un amant pour sa maîtresse le rend insensible à toute beauté différente.—C'est l'amour qu'il avait pour l'esprit, qui rendait Voltaire insensible au lyrisme. C'est l'adoration de Gœthe pour la Grèce, pour la pure et souriante tendresse de Mozart, qui lui faisait craindre le déchaînement passionné de Beethoven—et dire à Mendelssohn qui lui jouait le début de la symphonie en ut mineur: «Je ne ressens que de l'étonnement.»
Peut-être peut-on dire que tout grand producteur, tout créateur, a coutume de projeter sur le point qu'il veut opérer une telle abondance de lumière spirituelle, [Pg 20]un tel faisceau de rayons—que tout le reste autour en paraît sombre. Le contraire de cela, n'est-ce pas le dilettante? qui comprend tout, précisément parce qu'il n'aime rien passionnément, c'est-à-dire exclusivement.
Mais combien celui qui, sans avoir une personnalité fatale, toute d'ombre et d'éblouissement, tâche de se créer une personnalité restreinte et combinée, en se privant de certaines influences, en se mettant l'esprit au régime, comme un malade dont l'estomac débile ne saurait supporter qu'un choix de nourritures peu variées (mais qu'alors il digère si bien!)—combien celui-là me fait aimer le dilettante, qui, ne pouvant être producteur et parler, prend le charmant parti d'être attentif et se fait une carrière vraiment de savoir admirablement écouter. (On manque d'écouteurs aujourd'hui, de même que l'on manque d'écoles—c'est un des résultats de ce besoin d'originalité à tout prix.)
La peur de ressembler à tous fait dès lors chercher à celui-ci quels traits bizarres, uniques (incompréhensibles souvent par la même), il peut bien montrer—qui lui apparaissent aussitôt d'une principale importance, qu'il croit devoir exagérer, fût-ce aux dépens [Pg 21]de tout le reste. J'en sais un qui ne veut pas lire Ibsen parce que, dit-il, «il a peur de le trop bien comprendre». Un autre s'est promis de ne jamais lire les poètes étrangers, de crainte de perdre «le sens pur de sa langue»...
Ceux qui craignent les influences et s'y dérobent font le tacite aveu de la pauvreté de leur âme. Rien de bien neuf en eux à découvrir, puisqu'ils ne veulent prêter la main à rien de ce qui peut guider leur découverte. Et s'ils sont si peu soucieux de se retrouver des parents, c'est, je pense, qu'il se pressentent fort mal apparentés.
Un grand homme n'a qu'un souci: devenir le plus humain possible,—-disons mieux: devenir banal. Devenir banal, Shakespeare, banal Gœthe, Molière, Balzac, Tolstoï... Et, chose admirable, c'est ainsi qu'il devient le plus personnel. Tandis que celui qui fuit l'humanité pour lui-même, n'arrive qu'à devenir particulier, bizarre, défectueux... Dois-je citer le mot de l'Evangile? Oui, car je ne pense pas le détourner de son sens: «Celui qui veut sauver sa vie (sa vie personnelle) la perdra; mais qui veut la donner la sauvera (ou pour traduire plus exactement le texte grec: «la rendra vraiment vivante»),
[Pg 22]Voilà pourquoi nous voyons les grands esprits ne jamais craindre les influences, mais au contraire les rechercher avec une sorte d'avidité qui est comme l'avidité d'être.
Quelles richesses ne devait pas sentir en lui un Gœthe, pour ne s'être refusé,—ou, selon le mot de Nietzsche, «n'avoir dit non»—à rien! Il semble que la biographie de Gœthe soit l'histoire de ses influences—(nationales avec Gœtz; moyenâgeuses avec Faust; grecques avec les Iphigénies; italiennes avec le Tasse, etc.; enfin vers la fin de sa vie encore, l'influence orientale, à travers le divan de Hafiz, que venait de traduire Hammer—influence si puissante que, à plus de 70 ans, il apprend le persan et écrit lui aussi un Divan).
La même frénésie désireuse qui poussait Gœthe vers l'Italie, poussait le Dante vers la France. C'est parce qu'il ne trouvait plus en Italie d'influences suffisantes, qu'il accourait jusqu'à Paris se soumettre à celle de notre Université.
Il faudrait pourtant se convaincre que la peur dont je parle est une peur toute moderne, dernier effet de l'anarchie des lettres et des arts; avant, on ne connaissait pas cette crainte-là. Dans toute grande époque on se [Pg 23]contentait d'être personnel, sans chercher à l'être, de sorte qu'un admirable fonds commun semble unir les artistes des grandes époques, et, par la réunion de leurs figures involontairement diverses, créer une sorte de société, admirable presque autant par elle-même, que l'est chaque figure isolée. Un Racine se préoccupait-il de ne ressembler à nul autre? Sa Phèdre est-elle diminuée parce qu'elle naquit, prétend-on, d'une influence janséniste? Le xviie siècle français est-il moins grand pour avoir été dominé par Descartes? Shakespeare a-t-il rougi de mettre en scène les héros de Plutarque; de reprendre les pièces de ses prédécesseurs ou de ses contemporains?
Je conseillais un jour à un jeune littérateur un sujet qui me paraissait à ce point fait pour lui, que je m'étonnais presque qu'il n'eût pas déjà songé à le prendre. Huit jours après, je le revis, navré. Qu'avait-il? Je m'inquiétai... «Eh! me dit-il amèrement, je ne veux vous faire aucun reproche, parce que je pense que le motif qui vous faisait me conseiller était bon,—mais pour l'amour de Dieu, cher ami, ne me donnez plus de conseils! Voici qu'à présent je viens de moi-même au sujet dont vous m'avez parlé l'autre jour. Que diable voulez-vous que j'en fasse à présent? C'est [Pg 24]vous qui me l'avez conseillé; je ne pourrai jamais plus croire que je l'ai trouvé tout seul.»—Ah! je n'invente pas!—j'avoue que je fus quelque temps sans comprendre:—le malheureux craignait de ne pas être personnel.
On raconte que Pouchkine un jour dit à Gogol: «Mon jeune ami, il m'est venu en tête, l'autre jour, un sujet—une idée que je crois admirable—mais dont je sens bien que moi, je ne pourrai rien tirer. Vous devriez la prendre; il me semble, tel que je vous connais, que vous en feriez quelque chose.»—Quelque chose!—en effet—Gogol n'en fit rien moins que les Ames mortes, à quoi il dut sa gloire, de ce petit sujet, de ce germe que Pouchkine un jour posait dans son esprit.
Il faut aller plus loin et dire: les grandes époques de création artistique, les époques fécondes, ont été les époques les plus profondément influencées.—Telle la période d'Auguste, par les lettres grecques; la renaissance anglaise, italienne, française par l'invasion de l'antiquité, etc.
La contemplation de ces grandes époques où, par suite de conjonctures heureuses, grandit, s'épanouit, [Pg 25]éclate, tout ce qui, depuis longtemps semé, germinait et restait dans l'attente—peut nous emplir aujourd'hui de regrets et de tristesse. A notre époque, que j'admire et que j'aime, il est bon, je crois, de chercher d'où vient cette régnante anarchie, qui peut nous exalter un instant en nous faisant prendre la fièvre qu'elle nous donne pour une surabondance de vie;—il est utile de comprendre que ce qui fait, dans sa plantureuse diversité, l'unité malgré tout d'une grande époque, c'est que tous les esprits qui la composent se viennent abreuver aux mêmes eaux...
Aujourd'hui nous ne savons plus à quelle source boire—nous croyons trop d'eaux salutaires, et tel va boire ici, tel va là.
C'est aussi qu'aucune grande source unique, ne jaillit, mais que les eaux, surgies de toutes parts, sans élan, sourdent à peine, puis restent sur le sol, stagnantes—et que l'aspect du sol littéraire, aujourd'hui, est assez proprement celui d'un marécage.
Plus de puissant courant, plus de canal, plus de grande influence générale qui groupe et unisse les esprits en les soumettant à quelque grande croyance commune, à quelque grande idée dominatrice—plus d'école, en un mot—mais, par crainte de se ressembler, [Pg 26]par horreur d'avoir à se soumettre, par incertitude aussi, par scepticisme, complexité, une multitude de petites croyances particulières, pour le triomphe des bizarres petits particuliers.
Si donc les grands esprits cherchent avidement les influences, c'est que, sûrs de leurs propres richesses, pleins du sentiment intuitif, ingénu de l'abondance immanente de leur être, ils vivent dans une attente joyeuse de leurs nouvelles éclosions.—Ceux, au contraire, qui n'ont pas en eux grande ressource, semblent garder toujours la crainte de voir se vérifier pour eux le mot tragique de l'Evangile: «Il sera donné à celui qui a; mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.» Ici encore la vie est sans pitié pour les faibles.—Est-ce une raison pour fuir les influences?—Non.—Mais les faibles y perdront le peu d'originalité à laquelle ils peuvent prétendre... Messieurs: tant mieux! C'est là ce qui permet une Ecole.
Une Ecole est composée toujours de quelques rares grands esprits directeurs—et de toute une série d'autres subordonnés, qui forment comme le terrain neutre sur lequel ces quelques grands esprits peuvent s'élever. [Pg 27]Nous y reconnaissons d'abord une subordination, une sorte de soumission tacite, inconsciente, à quelques grandes idées que quelques grands esprits proposent, que les esprits moins grands prennent pour Vérités.—Et, s'ils suivent ces grands esprits, peu m'importe! car ces grands esprits les mèneront plus loin qu'ils n'eussent su aller par eux-mêmes. Nous ne pouvons savoir ce qu'eût été Jordaens sans Rubens. Grâce à Rubens, Jordaens s'est élevé parfois si haut, qu'il semble que mon exemple soit mal choisi et qu'il faille placer Jordaens au contraire parmi les grands esprits directeurs.—Et que serait ce si je parlais de Van Dyck, qui, à son tour, crée et domine l'école anglaise?
Autre chose: souvent une grande idée n'a pas assez d'un seul grand homme pour l'exprimer, pour l'exagérer tout entière; un grand homme n'y suffit pas; il faut que plusieurs s'y emploient, reprennent cette idée première, la redisent, la réfractent en fassent valoir une dernière beauté.—La grandeur, qui paraissait démesurée, de Shakespeare, a longtemps empêché de voir, mais ne nous empêche plus aujourd'hui d'admirer, l'admirable pléiade de dramaturges qui l'entourent.—L'idée qu'exalte l'école hollandaise [Pg 28]s'est-elle satisfaite d'un Terburg, d'un Metsu, d'un Pieter de Hooch? Non, non, il fallait chacun de ceux-là, et combien d'autres!
Enfin, disons que si toute une suite de grands esprits se dévouent pour exalter une grande idée, il en faut d'autres, qui se dévouent aussi, pour l'exténuer, la compromettre et la détruire.—Je ne parle pas de ceux qui s'acharnent contre—non—ceux-là d'ordinaire servent l'idée qu'ils combattent, la fortifient de leur inimitié.—Mais je parle de ceux qui croient la servir, de cette malheureuse descendance en qui s'épuise enfin l'idée.—Et, comme l'humanité fait et doit faire une consommation effroyable d'idées, il faut être reconnaissant à ceux-ci qui, en épuisant enfin ce qu'une idée avait encore de généreux en elle, en la faisant redevenir Idée, de vérité qu'elle semblait, la vident enfin de tout suc, et forcent ceux qui viennent à chercher une idée nouvelle,—idée qui, à son tour, paraisse pour un temps Vérité.
Bénis soient les Miéris et les Philippe Van Dyck pour achever de ruiner la moribonde école hollandaise, pour venir à bout de ses dernières dominations.
En littérature, croyez bien que ce sont pas les [Pg 29]«verslibristes», pas même les plus grands, les Vielé-Griffin, les Verhaeren, qui viendraient à bout du Parnasse; c'est le Parnasse lui-même qui se supprime, se compromet en ses derniers lamentables représentants.
Disons encore ceci: ceux qui craignent les influences et s'y refusent en sont punis de cette manière admirable: dès qu'on signale un pasticheur, c'est parmi eux qu'il faut chercher.—Ils ne se tiennent pas bien devant les œuvres d'art d'autrui. La crainte qu'ils ont les fait s'arrêter à la surface de l'œuvre; ils y goûtent du bout des lèvres.—Ce qu'ils y cherchent, c'est le secret tout extérieur (croient-ils) de la matière, du métier—ce qui précisément n'existe qu'en relation intime et profonde avec la personnalité même de l'artiste, ce qui demeure le plus inaliénable de ses biens.—Ils ont, pour la raison d'être de l'œuvre d'art, une incompréhension totale. Ils semblent croire qu'on peut prendre la peau des statues, puis qu'en soufflant dedans, cela redonnera quelque chose.
L'artiste véritable, avide des influences profondes, se penchera sur l'œuvre d'art, tâchant de l'oublier et de pénétrer plus arrière. Il considérera l'œuvre d'art [Pg 30]accomplie, comme un point d'arrêt, de frontière; pour aller plus loin ou ailleurs, il nous faut changer de manteau.—L'artiste véritable cherchera, derrière l'œuvre, l'homme, et c'est de lui qu'il apprendra.
La franche imitation n'a rien à faire avec le pastiche qui toujours reste besogne sournoise et cachée. Par quelle aberration aujourd'hui n'osons-nous plus imiter, c'est ce qu'il serait trop long de dire—d'ailleurs tout cela se tient et si l'on m'a suivi jusqu'ici l'on me comprendra sans peine.—Les grands artistes n'ont jamais craint d'imiter.
Michel-Ange imita d'abord si résolument les antiques que, certaines de ses statues—entre autres un Cupidon endormi—il s'amusa de les faire passer pour des statues retrouvées dans des fouilles.—Une autre statue de l'amour fut, raconte-t-on, enterrée par lui, puis exhumée comme marbre grec.
Montaigne, dans sa fréquentation des anciens, se compare aux abeilles qui «pillottent de çà de là les fleurs», mais qui en font après le miel, «qui est tout leur»—ce n'est plus, dit-il, «thym ne marjoleine».
—Non: c'est du Montaigne, et tant mieux.
[Pg 31]Mesdames et Messieurs,
Je m'étais promis de faire, après l'apologie de l'influencé, celle de l'influenceur. A présent elle ne m'apparaît plus bien utile. L'apologie de l'influenceur—ne serait-ce pas celle du «grand homme»? Tout grand homme est un influenceur.—Artiste, ses écrits, ses tableaux, ne sont qu'une part de son œuvre; son influence l'explique, la continue. Descartes n'est pas seulement l'auteur du Discours de la Méthode, de la Dioptrique et des Méditations; il est l'auteur aussi du Cartésianisme.—Parfois même l'influence de l'homme est plus importante que son œuvre; parfois elle s'en détache et ne semble la suivre que de très loin;—telle est, à travers des siècles d'inaction, celle de la Poétique d'Aristote sur le xviie siècle français. Parfois enfin, l'influence est l'œuvre unique, comme il advint pour ces deux uniques figures, que j'ose à peine citer, de Socrate et du Christ.
On a souvent parlé de la responsabilité des grands hommes.—On n'a point tant reproché au Christ tous les martyrs que le Christianisme avait faits (car l'idée de salut s'y mêlait)—qu'on ne reproche encore à tel [Pg 32]écrivain le retentissement parfois tragique de ses idées.—Après Werther, on dit qu'il y eut une épidémie de suicides. De même en Russie, après un poème de Lermontof. «Après ce livre, disait Mme de Sévigné en parlant des Maximes de La Rochefoucauld,—il n'y a plus qu'à se tuer ou qu'à se faire chrétien.» (Elle disait cela croyant sûrement qu'il ne se trouverait personne qui ne préférât une conversion à la mort).—Ceux que la littérature a tués, je pense qu'ils portaient déjà la mort en eux; ceux qui se sont faits chrétiens étaient admirablement prêts pour l'être; l'influence, disais-je, ne crée rien: elle éveille.
Mais je me garderai, d'ailleurs, de chercher à diminuer la responsabilité des grands hommes; pour leur plus grande gloire, il faut la croire même la plus lourde, la plus effrayante possible. Je ne sache pas qu'elle ait fait reculer aucun d'eux. Au contraire, ils cherchent de l'assumer toujours plus grande. Ils font, tout autour d'eux, que l'on s'en doute ou non, une consommation de vie formidable.
Mais ce n'est pas toujours un besoin de domination qui les mène: Chez l'artiste, souvent, la soumission d'autrui qu'il obtient a des causes très différentes. Un mot pourrait, je crois, les résumer: il ne se suffit pas à [Pg 33]lui-même. La conscience qu'il a de l'importance de l'idée qu'il porte le tourmente. Il en est responsable, il le sent. Cette responsabilité lui paraît la plus importante; l'autre ne passera qu'après. Que peut-il? Seul!—Il est débordé. Il n'a pas assez de ses cinq sens pour palper le monde; de ses vingt-quatre heures par jour, pour vivre, penser, s'exprimer. Il n'y suffit pas, il le sent. Il a besoin d'adjoints, de substituts, de secrétaires.—«Un grand homme, dit Nietzsche, n'a pas seulement son esprit, mais aussi celui de tous ses amis.»—Chaque ami lui prêtera ses sens; bien plus: vivra pour lui. Lui se fait centre (oh! malgré lui), il regarde et profite de tout. Il influence: d'autres vivront et joueront pour lui ses idées; risqueront le danger de les expérimenter à sa place.
Il est difficile parfois de faire l'apologie des grands hommes. Je ne veux donc point dire ici que j'approuve cela; je dis seulement que sans cela le grand homme n'est guère possible.—S'il voulait œuvrer sans influencer, il serait d'abord mal renseigné, n'ayant pu voir opérer ses idées; puis il ne serait pas intéressant; car cela seul qui nous influence nous importe.—Voilà pourquoi j'ai eu soin de faire d'abord l'apologie des influencés,—pour pouvoir à [Pg 34]présent oser dire qu'ils sont indispensables aux grands hommes.
Mesdames et Messieurs,
Je vous ai dit à présent à peu près ce que je désirais vous dire. Peut-être les quelques idées que j'ai tenté d'exposer ici vous paraîtront-elles soit paradoxales, soit fausses.—Je me tiendrai pourtant pour satisfait si, fût-ce par protestation contre elles, j'ai pu faire naître en vous—je veux dire: éveiller—quelques idées que vous jugerez justes et belles.—C'est ce que nous pourrons appeler de l'influence par réaction.
Bruxelles, le 29 mars 1900.
Conférence.
A Maurice Denis,
Mesdames et Messieurs[1]
Si je viens vous parler ici des limites de l'art, ce n'est point, soyez-en d'avance convaincus, que j'aie quelque prétention à les reculer ou à les rapprocher, fût-ce durant le temps de cette causerie; et si le titre que j'y ai laissé donner paraît un peu bien général, ma hardiesse, je vous l'affirme, n'est pourtant point d'avoir choisi ce titre: elle est de parler à des peintres.
[Pg 36]Nous ne sommes plus au temps où quelques échappés de l'atelier Rouault pouvaient redire avec Gautier le: ut pictura poesis d'Horace; mais si les littérateurs d'aujourd'hui ont compris le danger, le non-sens tout au moins, de prétendre se servir de la plume comme d'un pinceau, les peintres n'ont pas moins compris de leur côté que le ut poesis pictura serait pour eux théorie plus funeste encore. Littérature et peinture se sont heureusement désalliées, et je ne viens pas ici pour m'en plaindre; au contraire. Il est d'avance bien reconnu que je n'entends rien à votre métier et que vous n'entendez rien au mien. Vous cultivez votre jardin, nous le nôtre; nous voisinons un peu parfois; c'est tout.
Pourtant, si vous m'avez amicalement convié à venir aujourd'hui vous parler, et si je le fais avec joie, ce n'est pas pour de simples raisons de voisinage; nous sommes quelques-uns à penser qu'il n'est pas bon que les artistes d'un même pays, absorbés chacun dans leur art, méconnaissent qu'au-dessus des questions particulières à la littérature et à la peinture, il y a telles questions d'esthétique plus générale,—de celles qui, résolues, firent Poussin frère de Racine, par exemple,—et devant lesquelles nous pouvons [Pg 37]ensemble oublier un instant, vous, Messieurs, que vous êtes peintres, moi que je suis littérateur, pour nous souvenir mieux que nous sommes, et malgré toutes les différences de métier, les uns et l'autre des artistes.
Voilà pourquoi, si j'aborde aujourd'hui devant vous de telles généralités, je dis que ce n'est point hardiesse, mais modeste crainte, au contraire, de n'avoir pas, pour tout sujet plus spécial, la compétence nécessaire.
Il y a quelques jours, plutôt feuilletant que lisant un des épais volumes du «Cours de philosophie positive», je fus frappé par un curieux passage. Il s'y agit de louer la science; Auguste Comte s'entend à cela et loue bien—peu le passé, plus le présent, presque infiniment l'avenir,—je dis «presque», car tout aussitôt, par saine horreur de l'hyperbole et souci de précision, Comte, après avoir vaguement esquissé ce que, de la science, l'avenir paraît pouvoir espérer et prétendre, ajoute que prétentions et espérances ne sauraient être infinies. Il est, écrit-il (à peu près, car je cite de mémoire), presque aisé d'en prévoir dès à présent les limites et d'indiquer quelles [Pg 38]terres lui resteront toujours fermées; on sait par exemple que la science n'atteindra jamais... Savez-vous l'exemple qu'il cite?—la composition chimique des astres. Une génération s'écoulait, puis simplement, sans bruit, l'analyse spectrale s'emparait de ces mêmes astres, et la science franchissait les bornes assignées.
De cette page du positiviste, où je trouve malgré tout plus à admirer qu'à sourire, est née, avec le titre et l'idée de cette causerie, une défiance de moi plus grande encore, comme l'étrange avertissement que prétendre fixer d'avance des limites au pouvoir de l'intelligence humaine était folie—folie aussi présomptueuse en son genre que prétendre prévoir et dessiner d'avance les futures manifestations de ce pouvoir, et que de les croire infinies.
Sans cesse des moyens nouveaux permettent au savant des investigations et des précisions nouvelles, chaque nouvelle découverte servant de moyen à son tour; mais précisément pour cela, et parce qu'ainsi chaque effort nouveau s'additionne, chaque effort ancien s'y confond et s'anonymise, de sorte que l'on n'y considère jamais en chaque partie que la plus récente victoire;—l'on peut donc dire (et c'est presque une tautologie) que les limites de la science se reculent [Pg 39]toujours dans le sens même de son progrès. La question est: jusqu'où ira-t-elle?
En art, la question se pose d'une manière très différente. Le mot «progrès» y perd tout sens, et, comme l'écrivait naguère Ingres: on ne peut entendre dire de sang-froid et lire que «la génération présente jouit, en les voyant, des immenses progrès que la peinture a faits depuis la Renaissance jusqu'à nos jours». La question ne sera donc plus: jusqu'où la peinture, la musique, la littérature iront-elles? mais, plus vaguement encore: où iront-elles? et l'on y peut encore moins oser donner une réponse.
Il ne s'agit plus, pour l'artiste de valeur, de prendre appui sur l'art d'hier pour tâcher d'aller au delà, et de reculer des limites, mais de changer le sens même de l'art et d'inventer à son effort une nouvelle direction. Et si, par contre, l'œuvre des artistes passés conserve sa parfaite valeur, à ce point que chacun semble à neuf chaque fois avoir presque inventé et comme défini son art, chaque génie nouveau semble d'abord errer, tant il tourne résolument le dos aux autres; chaque génie nouveau semble remettre le problème de l'art même en question. Après un Jean-Sébastien Bach, on pense: telle est la musique; survient [Pg 40]un Mozart, un Beethoven, après lesquels on peut encore dire: Voilà donc la musique—à moins que, déjà prévenu, l'on ne pense: Qu'est-ce que la musique? et que l'on ne comprenne enfin que la musique n'est ni Bach, ni Mozart, ni Beethoven; que chacun d'eux ne saurait limiter que lui-même et que la musique, pour continuer d'être, doit être sans cesse autre chose que ce qu'elle n'était que par eux.
Cependant, méconnaissant qu'il n'y a plus rien à tenter de son côté et que l'artiste de génie n'indique la direction que de lui-même, semble guider mais ne guide qu'à lui, et se dresse devant l'élan de qui le suit comme une toile de fond devant la marche de l'acteur, certains pensent découvrir d'après lui quelque secret du beau, quelque recette, ou plutôt pensent que la réussite du maître va les dispenser d'un effort et que, puisque le maître trouve, il n'importe plus de chercher; ce n'est pas précisément qu'ils l'imitent, ils s'en défendent bien du moins, mais ils suivent sa direction; c'est un remous puissant qui les entraîne en son sillage; et bien mieux, le maître s'étant tu avant eux, ils espèrent le dépasser, aller plus loin que lui, prenant pour de l'audace leur folie, et le grand empêchement où ils restent d'essayer d'un autre côté. C'est [Pg 41]par eux que la forme d'un maître devient formule, aucune intérieure nécessité ne la motivant plus. C'est par eux, c'est sur eux que la nuit se fait sans qu'ils s'en doutent, car leurs yeux, éblouis par le soleil couché, voient encore l'astre au lieu du couchant obscurci—quand déjà derrière eux, à l'autre pôle de l'art, un soleil rajeuni, radieux, se relève.
La vérité (c'est-à-dire la ressource) se trouve toujours en deçà, jamais au delà du génie.
Ce territoire qu'en allant toucher ses frontières, le génie laisse derrière lui, cette contrée, d'où chacun doit partir, quelle est-elle? quel est le lieu commun des chefs-d'œuvre? là chose toujours disponible?
Dois-je m'excuser ici, Messieurs, de ne m'apprêter à vous dire rien que de banal et de simple? Comment choses si délibérément générales ne seraient-elles pas très simples et connues? Et, si j'ose pourtant les redire, c'est que, en art, il est bon, je crois, que chaque génération nouvelle se pose à nouveau le problème; qu'elle n'accepte jamais toute trouvée la solution que ceux d'avant-hier et d'hier lui en apportent, et qu'elle n'oublie point que tous ceux du passé, qu'elle admire, sont précisément ceux qui l'ont eux-mêmes d'abord et péniblement recherchée. Le [Pg 42]Laocoon de Lessing est œuvre qu'il est bon tous les trente ans de redire ou de contredire. Une grande clairvoyance fut toujours aux grandes époques; elle semble encore souvent nous manquer; trop amoureux souvent de ce que nous possédons déjà, nous perdons l'aigu sentiment de ce qui nous manque, de nos défauts; et je vois hélas! aujourd'hui plus d'artistes que d'œuvres d'art, car le goût de celles-ci s'est perdu, et l'artiste trop souvent croit avoir fait suffisamment quand, dans sa peinture ou ses vers, il a montré qu'il est artiste, considérant la part de la raison, de l'intelligence et de la volonté, la composition en un mot, comme négligeable et banalisante—car l'abominable discrédit où la médiocrité des grands faiseurs a jeté ce que l'on appelait, ce que l'on n'ose plus appeler sans sourire, «les grands genres», est cause que les peintres n'osent plus faire de tableaux, que les littérateurs ne savent plus porter un sujet un peu plus d'un an dans leur tête, que triomphe en littérature, en peinture, en musique, l'impressionnisme, la poésie d'occasion.
Ce terrain neutre vers lequel, faisant volte-face, il nous faut toujours à nouveau retourner, vous savez bien, Messieurs, que c'est simplement la Nature... [Pg 43]Vais-je donc vous parler, moi aussi, de ce fameux retour à la nature? dont il semble, à entendre certains, que ce soit l'unique secret de tout art, et que l'on ait tout dit, disant cela!
Retour à la nature!... mais qu'est-ce dite? À quoi d'autre peut-on retourner? Que trouver hors de soi, sinon sans cesse et partout la nature? Mais que trouver en soi, sinon la nature aussi bien?
Le vrai retour à la nature, c'est le définitif retour aux éléments: la mort. Mais, tant qu'il reste à l'homme encore un peu de volonté de vie, un peu d'être, n'est-ce donc pas pour lutter contre? et n'est-ce pas, artiste, pour s'opposer à la nature et s'affirmer?
Comment, pourquoi, ne pas comprendre que ces deux «naturels»—extérieur et intime—s'opposent? et que c'est selon celui-ci que celui-là se façonne et s'informe? Ce naturel intime a-t-il donc moins de valeur que l'autre et va-t-on lui refuser ce droit, ou lui dénier ce pouvoir sans lequel l'œuvre d'art n'est plus?—ou prétend-on que tout l'art ne soit donc plus que réalisme?
Cette opinion, formulée en tout son excès, n'a personne pour la défendre, je l'espère; mais n'est-ce pas là qu'on en vient en disant que l'artiste doit être absent [Pg 44]de son œuvre, que l'objectivation est une des conditions de l'art; de sorte que s'il était possible d'atteindre le but proposé, toute personnalité s'effaçant devant la chose représentée, une œuvre ne différerait plus d'une autre que par le sujet relaté, et l'artiste se serait enfin satisfait pour avoir assuré la durée à quelque vaine contingence—à moins que, trop peu désireux d'éterniser n'importe quoi, il choisisse ... mais de quel droit même choisir? Et qu'appelle-t-on «interprétation», sinon ensuite un choix encore, plus subtil et plus détaillé, qui, comme le choix du «sujet», vient toujours indiquer, sinon ma volonté, du moins ma préférence?...
Et ne pensez-vous pas précisément, qu'il convient de faire de ce choix même, de cette instinctive puis volontaire préférence, l'affirmation même de l'art,—de l'art qui n'est point dans la nature, de l'art qui n'est point naturel, l'art que l'artiste seul impose à la nature, impose difficilement?
Mais ici précisons encore:
Car il ne suffit pas dès lors de dire, comme vous savez qu'on a fait: l'œuvre d'art, c'est un morceau de nature vu à travers un tempérament. Dans cette spécieuse formule, ni l'intelligence, ni la volonté de l'artiste [Pg 45]n'entre en jeu. Cette formule ne saurait donc me satisfaire.
L'œuvre d'art est œuvre volontaire. L'œuvre d'art est œuvre de raison. Car elle doit trouver en soi sa suffisance, sa fin et sa raison parfaite; formant un tout, elle doit pouvoir s'isoler et reposer, comme hors de l'espace et du temps, dans une satisfaite et satisfaisante harmonie. Que si, peinture, elle s'arrête au cadre, ce n'est point parce que cadre il y a, mais, tout au contraire, il y a cadre parce qu'ici elle s'arrête. Et le cadre n'est là, soulignant cet arrêt, que pour faire cette isolation plus marquée.
Dans la nature, rien ne peut s'isoler ni s'arrêter; tout continue. L'homme y peut essayer, proposer la beauté; la nature aussitôt s'en rend maîtresse et en dispose. Et voici bien l'opposition que je disais: Ici, l'homme est soumis à la nature; dans l'œuvre d'art au contraire, il soumet la nature à lui.—«L'homme propose et Dieu dispose», nous a-t-on dit; ceci est vrai dans la nature;—mais je vais résumer l'opposition que j'indique en disant que, dans l'œuvre d'art, au contraire, Dieu propose et l'homme dispose; et tout prétendu producteur d'œuvres d'art qui n'est pas conscient de ceci est tout ce que l'on veut; pas un artiste.
[Pg 46]Coupez la phrase en deux, ne prenez pour credo qu'un des deux membres de la formule, et vous aurez les deux grandes hérésies artistiques qui toujours à neuf s'entrecombattent pour ne vouloir comprendre que c'est de leur union même et de leur compromission seulement que l'art peut naître.
Dieu propose: c'est le naturalisme, l'objectivisme, appelez-le comme il vous plaît.
L'homme dispose: c'est l'à-priorisme, l'idéalisme...
Dieu propose et l'homme dispose: c'est l'œuvre d'art.
Pourquoi faut-il qu'à chaque nouvelle fausse «école» l'intransigeance absurde des partis vienne voir le salut dans l'adoration exclusive d'une des deux parties de la formule? Hier: l'homme dispose; aujourd'hui; Dieu propose... Et tantôt l'on semble ignorer que l'artiste a tous droits pour disposer; tantôt qu'il ne doit disposer que de ce que la nature lui propose.
Car, si je parlais tout à l'heure de l'artiste comme faisant opposition à la nature, et semblais voir en l'œuvre d'art tout d'abord une affirmation,—serait-ce pour prôner à présent l'individualisme, et ne nous serons-nous arrachés d'un excès que pour nous précipiter vers un autre? qu'est-ce qu'un artiste individualiste? Qu'est-ce qu'un artiste anti-individualiste? Qu'il laisse [Pg 47]à d'autres les «convictions». Elles lui coûtent trop cher à lui et elles le déforment trop. L'artiste n'est ni d'un camp ni de l'autre; il est à tout point de conflit.
L'art est une chose tempérée. Et certes je ne veux non plus dire par là que l'œuvre d'art la plus accomplie serait celle qui se tiendrait à la plus égale distance de l'idéalisme et du réalisme; non certes! et l'artiste peut bien se rapprocher autant qu'il osera d'un des deux pôles, mais à condition qu'il ne quittera pas du talon le second; un sursaut de plus, il perd pied.
«On ne montre pas sa grandeur, disait Pascal, pour être à une extrémité, mais en touchant les deux à la fois et en remplissant l'entre-deux.»
Et les limites de l'art que nous renoncions vite à chercher tant que nous les demandions extérieures, ses limites, Messieurs, qui ne sont point obstacles ni défi, nous les découvrons tout intimes: ce sont limites d'extension.
Il est un point d'extrême tension, passé lequel l'œuvre brusquement cède et se décompose,—on n'a jamais été composée.—Les limites ne sont qu'en l'artiste; heureux celui qui les élargit en lui, les recule et qui, [Pg 48]comme devrait vouloir chacun d'eux, soumet le plus possible à lui, le plus possible de nature.
Mesdames et Messieurs,
Si, malgré que vous sachiez déjà tout cela, je me suis permis de le redire, c'est que, vous qui pensez cela, vous restez en très petit nombre, c'est que le nombre des faux artistes et des hérétiques est grand.
Été 1901.
[1] La conférence annoncée sous ce titre fut préparée pour l'exposition des artistes indépendants de 1901; un contretemps subit m'empêcha, à mon grand regret, de la prononcer. J'en donne ici simplement l'esquisse.
Né à Paris, d'un père Uzétien et d'une mère Normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m'enracine?
J'ai donc pris le parti de voyager.
En ayant éprouvé beaucoup d'agrément (pour employer une de vos exquises expressions de jadis) et surtout, j'ose le croire, beaucoup de profit, je me suis permis de conseiller aux autres le voyage; j'ai même fait plus: j'ai poussé, j'ai contraint d'autres au voyage; il en est qui n'avaient jamais navigué et qui m'ont rejoint sur des terres assez lointaines; il en est que j'ai mis en wagon; il en est que j'ai accompagnés. J'ai fait plus encore; j'ai écrit tout un livre, d'une folie très méditée, pour exalter la beauté du voyage, m'efforçant, peut-être par manie de prosélytisme, d'enseigner la joie qu'il y aurait à ne plus se sentir [Pg 52]d'attaches, de racines si vous préférez (vous aviez bien écrit l'Homme libre,—mais libre un peu différemment).—Et c'est en voyage que j'ai lu votre livre.—Rien d'étonnant donc si, à ma grande admiration, je ne peux m'empêcher de mêler la critique: excusez ce préambule; il n'est là que pour montrer combien je suis désigné pour la faire, ceux pour vous louer étant légion.
Pourtant je voudrais commencer par dire combien j'admire votre livre; certes vos œuvres précédentes nous permettaient d'attendre de vous les plus exquises délicatesses, et bien des pages datées d'Espagne ou d'Italie ne le cédaient pas de beaucoup au merveilleux récit de Mme Aravian; nous connaissions la netteté de votre vue, la clarté de vos jugements, votre vaillance, votre prudence, l'excellence de vos conseils; et malgré tout cela les Déracinés ont surpris même vos plus chauds admirateurs; il y a là (non assez concentré peut-être), maintenu sans inquiétude, un si sérieux travail, une si autoritaire affirmation, que le respect de vous s'impose et que même vos plus entêtés ennemis sont forcés à présent de vous considérer. Sous des noms affreux comme ceux de l'Education Sentimentale, vous avez créé des types, pénibles, mais que [Pg 53]l'on ne peut plus oublier; vous avez fait plus: vous les avez groupés, hiérarchisés, ou plutôt et mieux: vous avez montré la fatalité de cette hiérarchie, comme un professeur de physique montre le «Vase des quatre éléments». La fondation du journal, son âpre vie, la façon dont Sturel s'en tire, tout cela, pesant, est d'une remarquable tenue, d'une absence de fantaisie parfaite.—Pourquoi, ce dessin si bon, avoir cru devoir le boursoufler inartistiquement d'une thèse électorale, intéressante certes en elle-même (sans souci même qu'elle soit juste ou non), mais dont presque toutes les pages s'empèsent et qui en épaissit les moindres mouvements?—Si vous venez, à chacun de ceux-ci, ergoter et, à renfort de raisonnements, le rattacher à votre thèse générale, c'est donc que ces événements n'étaient pas assez éloquents par eux-mêmes? c'est donc que vous craigniez que l'on n'en pensât pas tout ce que vous en pensez? c'est donc que, peut-être, si vous aviez laissé l'esprit du lecteur libre, il en aurait conclu différemment?—Et le résultat de votre habileté oratoire c'est que les événements que vous dites, après que vous en avez parlé, semblent, pris hors du livre, moins éloquents que vous-même, ou ne pas persuader toujours comme vous voudriez [Pg 54]qu'ils persuadent. Car enfin Suret-Lefort, Renaudin, Sturel, Rœmerspacher réussissent; s'il avait plus d'argent, on peut croire que Racadot réussirait. D'ailleurs je consens que, si Racadot n'eût jamais quitté la Lorraine, il n'eût jamais assassiné; mais alors il ne m'intéresserait plus du tout; tandis que, grâce aux circonstances étranges qui l'acculent, c'est lui, vous le savez, sur qui se concentre l'intérêt dramatique du livre; de sorte que, soucieux aussi de vérité psychologique, votre livre, comme malgré vous, semble ne prouver rien tant que ceci: «dans une situation où il se trouve souvent et qui pour beaucoup est la même, l'organisme agit d'une façon banale; dans une situation qui s'offre à lui pour la première fois, il fera preuve d'originalité, s'il ne peut y échapper»[1]. Le déracinement contraignant Racadot à l'originalité: on peut dire, en souriant, que c'est là le sujet de votre livre.
Car votre affirmation trop constante nous fait désirer contredire; désirer affirmer ceci: le déracinement peut être une école de vertu.—C'est seulement lors d'un sensible apport de nouveauté extérieure qu'un organisme, pour en moins souffrir, est amené à inventer [Pg 55]une modification propre permettant une appropriation plus sûre[2]. Faute d'être appelées par de l'étrange, les plus rares vertus pourront rester latentes; irrévélées pour l'être même qui les possède, n'être pour lui que cause de vague inquiétude, germe d'anarchie.
Par contre, plus l'être est faible, plus il répugne à l'étrange, au changement; car la plus légère idée nouvelle, la plus petite modification de régime nécessite de lui une vertu, un effort d'adaptation qu'il ne va peut-être pas pouvoir fournir. Mais qu'est-ce à dire? sinon qu'il est trop faible; allons! tant pis! qu'il s'enracine et que ce soit tant mieux pour lui.
Mais ne cherchez pas non plus à l'instruire. Toute instruction est un déracinement par la tête. Plus l'être est faible, moins il peut supporter d'instruction. N'est-ce pas là ce qui vous fait dire: «Beaucoup de femmes et d'enfants ne sont que d'un seul paysage»? Traduisez: l'instruction n'est bonne que pour les [Pg 56]forts. Soignez le faible; protégez-le; mais par pitié pour nous, n'établissez pas sur lui notre règle.
L'instruction, apport d'éléments étrangers, ne peut être bonne qu'en tant que l'être à qui elle s'adresse trouvera en lui de quoi y faire face; ce qu'il ne surmonte pas risque de l'accabler. L'instruction accable le faible.
Oui, mais le fort en est fortifié.
S'il ne faut donc avoir en vue que le bien-être du plus grand nombre, j'admets que c'est en ne bougeant pas de chez soi qu'on l'obtient avec le moindre effort, n'y ayant là qu'à poursuivre d'ordinaire un élan hérité...—Mais ne peut-il nous plaire de voir un homme exiger de soi la plus grande valeur possible?—Dans le bien-être s'étiole toute vertu; les routes neuves, ardues, la nécessitent. J'aime (pardonnez-moi) tout ce qui met l'homme en demeure, ou de périr, ou d'être grand. Les événements historiques qui nous ont le plus dépaysés sont certes ceux qui ont fait le plus de victimes, mais aussi ceux qui ont échauffé, éclairé le plus grand nombre de héros; c'est un tri; dans le calme du coutumier, toutes les ailes inétendues, sans besoin d'être grandes, oublient de l'être; plus le vent du dehors s'élève et plus se nécessite une forte envergure.
[Pg 57]Oui, mais les faibles y périront.
Faut-il s'en consoler, disant: c'étaient des faibles?—Disons plutôt: aux forts seuls la véritable instruction. Aux faibles l'enracinement, l'encroûtement dans les habitudes héréditaires qui les empêcheront d'avoir froid.—Mais à ceux qui, non plus faibles, ne cherchent pas, avant tout, leur confort, à ceux-ci, le déracinement, proportionné autant qu'il se peut à leur force, à leur vertu—la recherche du dépaysement qui exigera d'eux la plus grande vertu possible. Et peut-être pourrait-on mesurer la valeur d'un homme au degré de dépaysement (physique ou intellectuel) qu'il est capable de maîtriser.—Oui, dépaysement; ce qui exige de l'homme une gymnastique d'adaptation, un rétablissement sur du neuf: voilà l'éducation que réclame l'homme fort,—dangereuse il est vrai, éprouvante; c'est une lutte contre l'étranger; mais il n'y a éducation que dès que l'instruction modifie.—Quant aux faibles: enracinez! enracinez!
Instruction, dépaysement, déracinement[3],—il [Pg 58]faudrait pouvoir en user selon les forces de chacun; on y trouve danger sitôt que ce n'est plus profit; et que les faibles y agonisent, c'est là ce que montrent [Pg 59]les Déracinés; mais pour préserver du danger le faible, nous aveuglerons-nous sur le profit du fort? et que les forts s'y fortifient, c'est là ce que ne montrent pas les Déracinés—ou du moins ce qu'ils ne montrent que malgré vous.
Car se posait alors devant vous ce dilemme: ou, pour favoriser votre thèse et montrer le danger du déracinement, peindre des êtres si faibles et médiocres, qu'on eût crié: tant pis pour eux;—ou, pour favoriser votre roman, peindre des êtres assez forts pour [Pg 60]qu'ils ne souffrent plus du dépaysement, assez importants pour invalider votre thèse.
Il est beaucoup de ces points, je le sais bien, où l'on pourrait infiniment contredire; aussi n'aurais-je point tant affirmé si vous n'aviez si fort affirmé le contraire.
Ce qui reste pourtant certain, c'est que, si les sept Lorrains dont vous donnez l'histoire n'étaient pas venus à Paris, vous n'eussiez pas écrit les Déracinés; que vous n'eussiez pas écrit ce livre si vous-même n'étiez pas venu à Paris;—et cela eût été extrêmement regrettable, car, à cause de ses préoccupations mêmes, ce pesant livre d'une excédente mais admirable tension, remet à leur médiocre place tant de romans négligeables dont, faute de mieux, nous risquions de nous occuper.
Décembre 1897.
[1] La formule est de Nordau.
[2] Le bien-être n'engendre que l'inertie; la gêne est le principe du mouvement.
Renan (Dialogues).
ou encore:
«On acquiert rarement les qualités dont on peut se passer.»
Laclos (Les liaisons dangereuses).
[3] Ici une note de M. Charles Maurras:
«M. Doumic, dans la Revue des Deux-Mondes, admet la thèse des Déracinés, mais sous la réserve suivante: Le propre de l'éducation est d'arracher l'homme à son milieu formateur. Il faut qu'elle le déracine. C'est le sens étymologique du mot «élever»... En quoi ce professeur se moque de nous. M. Barrès n'aurait qu'à lui demander à quel moment un peuplier, si haut qu'il s'élève, peut être contraint au déracinement...»
—Non, M. Maurras; j'en suis bien désolé, mais celui qui se moque de nous ici, ce n'est pas M. Doumic, c'est vous; et pour peu que M. Doumic ne soit pas aussi ignorant en arboriculture que vous paraissez l'être, il vous aura répondu, je suppose, que le peuplier dont vous parlez, pour être beau et bien fait, n'était sans doute pas né sur le sol qu'il ombrageait à présent, mais venait tout vraisemblablement d'une pépinière,—comme celle sur le catalogue de laquelle je copie pour votre édification cette phrase:
Nos arbres ont été transplantés (le mot est en gros caractères dans le texte) 2, 3, 4 fois et plus, suivant leur force (ce qui veut dire ici: suivant leur âge), opération qui favorise la reprise; ils sont distancés convenablement, afin d'obtenir des têtes bien faites (ici c'est moi qui souligne, car voici un des côtés de la question dont vous ne parlez pas, et qui importe).
Catalogue des pépinières Croux (63e année, p. 72).
Ignorez-vous aussi l'opération qu'en culture on appelle repiquage? Permettez que pour vous, je copie encore ces quelques phrases instructives:
Dès que les plants ont quelques feuilles, on doit, selon les espèces et les soins particuliers qu'elles exigent, ou les éclaircir ou les repiquer.
Le repiquage est de la plus haute importance pour la plus grande majorité des plantes.—Et, en note: Toutes les plantes pourraient à la rigueur être repiquées.
Vilmorin-Andrieux, Les fleurs de pleine terre, p. 3.
Ou repiquer, ou éclaircir. Voici l'affreux dilemme que vous proposent vos savants co-partisans MM. Croux et Vilmorin-Andrieux. Renoncez à chercher vos exemples dans leur domaine. Et si cela ne suffit pas à invalider la thèse de M. Barrès, vous m'accorderez tout au moins que cela ne la renforce pas non plus...
(Le passage de M. Maurras que je cite est cité par M. Barrès dans les Scènes et doctrine du Nationalisme.)
(réponse a m. maurras)
Lorsque, en 1897, parut dans l'Ermitage mon article sur les Déracinés, l'on n'y fit pas grande attention. L'an dernier, ayant à réunir en volume quelques pages de critique, je relus cet article oublié; ne le trouvant pas trop mauvais, je le joignis aux autres, tel quel—avec l'addition pourtant d'une note, et voici pourquoi:
Entre 1897 et 1902, un article de M. Doumic avait paru, auquel avait aussitôt répondu M. Maurras. De l'article et de la réponse, j'eus connaissance par une note des «Scènes et Doctrines» de M. Barrès. Cette note a depuis été tant de fois citée, que j'ai honte à la citer encore; on la saura par cœur; tant pis:
[Pg 62]«M. Doumic, dans la Revue des Deux-Mondes, admet la thèse des Déracinés, mais sous la réserve suivante: «Le propre de l'éducation est d'arracher l'homme à son milieu formateur. Il faut qu'elle le déracine: c'est le sens étymologique du mot «élever...» En quoi ce professeur se moque de nous. M. Barrès n'aurait qu'à lui demander à quel moment un peuplier, si haut qu'il s'élève, peut être contraint au déracinement...»
Il coulait à ce moment, à propos de déracinement, des flots d'encre; j'ai trouvé que celle de M. Maurras n'avait pas bien belle couleur. Je me permis de lui faire observer l'imprudence de sa question; il était en effet plus qu'aisé de répondre que ces peupliers exemplaires sortaient d'une pépinière, tout vraisemblablement—comme celle, ajoutai-je, sur le catalogue de laquelle je copie cette phrase:
«Nos arbres ont été transplantés (le mot est en gros caractères dans le texte), 2, 3, 4 fois et plus, suivant leur force, opération qui favorise la reprise; ils sont distancés convenablement, afin d'obtenir des têtes bien faites (ici c'est moi qui soulignais).»
M. Maurras, ayant écrit naguère: «Je proteste publiquement que M. Gide n'est pas justifiable de la critique», [Pg 63]s'apprêtait à ne rien répondre. «Son esprit, son talent, son tour d'imagination, affirme-t-il encore, sont d'une coquette achevée; ils perdent donc à être connus de toutes parts. Ils ne peuvent être soufferts qu'à la faveur d'une pénombre officieuse et d'un propice clair obscur.» Donc, par égard pour moi, il fallait me laisser dans l'ombre.
C'est ce que MM. Faguet, Blum et Remy de Gourmont n'eurent pas la délicatesse de comprendre. A l'impertinence de me lire, ils ajoutèrent celle de parler de mon livre et d'en parler excellemment; bien plus, ils citèrent ma note.
M. Maurras alors n'y tint plus et me supprima durant dix-huit colonnes de la Gazette.
Mes articles sur M. Barrès, que j'écoute toujours, que j'admire souvent, et pour qui je garderais l'affection la plus vive s'il ne m'en empêchait pas quelquefois—-mes articles sont des plus modérés contre une thèse dont je ne blâme que l'outrance et à qui j'en yeux de gâter bien des pages d'un de nos meilleurs écrivains.
Cette doctrine de l'enracinement qu'il préconise, je la crois bonne en effet pour les faibles, la masse; j'accorde que c'est d'eux qu'il se faut occuper, car [Pg 64]les individus qui s'en échappent s'occupent très suffisamment d'eux-mêmes, et l'on ne peut tabler sur eux. Mais je prétends que ceux-ci trouvent profit au déracinement, et que l'enracinement, tout au contraire, les empêche. Eux aussi sont nécessaires au pays. «Instruction, dépaysement, déracinement, dis-je à la fin de mon premier article—il faudrait pouvoir en user selon les forces de chacun; on y trouve danger sitôt que ce n'est plus profit; et que les faibles y agonisent, c'est là ce que montrent les Déracinés; mais pour préserver du danger le faible, nous aveuglerons-nous sur le profit du fort?[2]. Et que les forts s'y fortifient, c'est là ce que ne montrent pas les Déracinés—ou du moins ce qu'ils ne montrent que malgré M. Barrès.»
«De ce que les sept Lorrains du roman de M. Barrès ont eu tort de venir à Paris, puisqu'ils s'y sont tous plus ou moins noyés, il ne s'en suit pas qu'un [Pg 65]huitième Lorrain aura tort de suivre leur exemple; car ce huitième Lorrain, ce sera peut-être un Barrès», écrit M. de Gourmont, résumant ma conclusion. «Ainsi finit par un compliment cette dispute», conclut-il à son tour.
M. Maurras ne l'entend pas ainsi. Il a les conciliations en horreur. L'huile qu'on apportait pour les blessures, c'est sur le feu qu'il la renverse. Je doute qu'il ait lu nos articles. Du moins n'est-ce pas à eux qu'il répond, mais tout simplement à la note où son nom s'est trouvé cité. Et la querelle qu'il ravive, n'est pas sur le fond même du sujet; lui-même la baptise: c'est «la querelle du peuplier». Il ne faut pas qu'il ait eu tort de prendre le peuplier comme exemple. Ce n'est pas facile à prouver. Il va parler fort et longtemps. Dix-huit colonnes contre vingt lignes. Je suis vaincu.
«Cette leçon d'arboriculture a fait mon bonheur, lit-on dans la Gazette de France du 14 septembre 1903 après citation de ma note. M. André Gide a découvert le repiquage dans le traité de M. Vilmorin-Andrieux, et la transplantation dans le catalogue des pépinières Croux.»
Je passe là-dessus. M. Maurras n'est nullement tenu [Pg 66]de savoir, et ses lecteurs encore moins, que je vis neuf mois sur douze à la campagne, où je regarde plus mon jardin que mes livres—ni même que la Société des Agriculteurs de Normandie accordait à ma pépinière une première médaille, il y a quelques années—il faut vraiment une occasion comme celle-ci pour l'avouer...
«L'étonnement naïf que fait paraître M. Gide—continue M. Maurras—en nous révélant repiquage et transplantation est sans aucun doute absolument étranger à ceux d'entre nous qui ..., etc ...; mais si cette émotion merveilleuse leur manque, ils sont aussi gardés d'introduire dans le langage d'aussi honnêtes gens que MM. Emile Faguet et Remy de Gourmont ... une confusion ridicule entre transplantation et déracinement. A la place de M. André Gide, écrivain délicat, critique difficile, on ne se consolerait pas de la mésaventure.»—Merci des compliments—mais décidément, M. Maurras, vous êtes par trop sûr que vos lecteurs ne seront pas les nôtres: Voici le début de l'article de M. Gourmont:
«Au mot imaginé par M. Barrès «les Déracinés», il faudrait, je pense, en opposer un autre, qui exprimerait la même idée matérielle, et une idée psychologique [Pg 67]toute différente: les transplantés. On emploierait l'un ou l'autre selon que l'on parlerait d'un homme à qui le changement de milieu a été mauvais, ou d'un homme qui a trouvé une nouvelle vigueur par le fait même de sa transplantation en un terrain nouveau.
«Cette insinuation m'est suggérée par la lecture de quelques pages du nouveau livre de M. Gide... Esprit très logique, il a été choqué de la thèse de M. Barrès en tant que thèse absolue. Il reconnaît que le déracinement est défavorable aux natures faibles, qu'il est bon que la plupart des hommes vivent et meurent là où ils sont nés; mais il croit que la transplantation est heureuse pour les forts et qu'elle les fortifie encore.» Là-dessus, exemples à l'appui de cette thèse;—je ne puis citer tout l'article[3]; il est parfait.
Mais revenons au peuplier. M. Maurras, n'ayant pas sous la main son «vieux jardinier Marius», appelle à la rescousse «quelqu'un de ces grands amateurs de jardinage qui allient les plaisirs de leur art à la haute culture intellectuelle». Tenons-nous!
[Pg 68]«... Quand ces boutures (de peuplier) ont des feuilles et paraissent pourvues de racines...» dit le grand amateur.
—On les déracine? interrompt M. Maurras.
—Mais non! On éclaircit le plan, c'est-à-dire qu'on enlève à volonté les plus forts pour en faire des arbres de choix (c'est moi qui souligne), ou les plus nombreux et les plus délicats pour les repiquer en rayons moins serrés, afin de permettre aux racines de se bien développer.
—Et si l'on expédie?
—On enveloppe les racines avec beaucoup de soin pour qu'elles ne se sèchent pas en route.»
Eh! parbleu, prétendis-je rien d'autre?
Mais, plus loin, ceci nous éclaire:
«En somme, continue M. Maurras, relever, dépiquer, repiquer, replanter, même arracher sont des opérations qui n'ont rien de commun avec le déracinement. On ne déracine que des arbres morts ou ceux qu'on sacrifie.» Et plus loin:
«J'expliquai alors à mon jardinier ce qu'on appelle maintenant, selon la forte et juste expression de Barrès, un déraciné... Je dis comment la mauvaise éducation avait chez ces jeunes gens tranché les racines (ici c'est [Pg 69]M. Maurras qui souligue) qui les attachaient à leur Lorraine..., etc., etc.»
Nous y voilà! «Déracinés» signifie pour M. Maurras «dont on a tranché les racines». Que ne le disait-il plus tôt? J'aurais laissé son peuplier tranquille.[4]
On comprenait sans peine la métaphore de M. Barrès, et ses écrits l'éclairaient d'un bon jour; mais quelque éloquente que cette métaphore demeure, il est très fâcheux qu'en arboriculture, le seul domaine où ce mot déraciné ait un sens précis, ce sens soit différent de celui qu'est appelé à lui donner M. Barrès, sous peine de voir presque tous les exemples qu'il y chercherait, contredire en plein sa théorie. Le grand tort de M. Maurras aujourd'hui, par cette absurde querelle de mots, est de rendre sensible une faute [Pg 70]qu'on n'avait pas bien remarquée,—en prétendant faire passer ce nouveau sens du mot déraciné: dont les racines ont été tranchées, en arboriculture où le mot déraciné n'a jamais voulu dire et ne voudra jamais dire que: dont les racines ont été arrachées de terre. C'est le seul sens que donne et qu'ait à donner Littré.
—Mais qu'importe le mot, dira-t-on, si la chose...
—Le mot n'importe point, peut-être; mais derrière la faute de mot, accourt et s'abrite la faute de pensée. Et si M. Maurras ne la sentait ici très grave, il n'emploierait pas tant d'âpres soins, ni ne trouverait tant de difficultés, à la défendre.
[1] Cet article a paru dans l'Ermitage, n° de novembre 1903.
[2] «L'instruction, disais-je plus haut, apport d'éléments étrangers, ne peut être bonne qu'en tant que l'être à qui elle s'adresse trouvera en lui de quoi y faire face; ce qu'il ne surmonte pas risque de l'accabler» ... etc... Je ne peux pourtant pas citer tout mon article! Si M. Maurras ne l'a pas lu, je n'y peux rien. Mais alors pourquoi en parle-t-il?
[3] Weekly Critical Review, 30 juillet.
[4] N'en déplaise à M. Maurras il arrive même souvent que ces racines, au moment de la replantation, d'un coup de serpe, on les coupe, afin d'assurer mieux la reprise; car il s'en forme aussitôt de nouvelles et l'arbre reprend d'autant mieux, que les vieilles racines ont été coupées. Les catalogues des pépiniéristes et les traités d'arboriculture nous enseignent que c'est surtout la racine centrale, pivotante (celle même de «la terre et les morts») qu'il importe de trancher.
Il est d'autres terres plus belles et que je crois que j'eusse préférées. Mais de celles-ci je suis né. Si j'avais pu, je me serais fait naître en Bretagne à Locmariaquer la dévote, ou, près de Brest, à Camaret ou à Morgat, mais on ne choisit pas ses parents; et même ce désir je l'héritai, je pense, avec le sang catholique et normand de la famille de ma mère, le sang languedocien protestant de mon père. Entre la Normandie et le Midi je ne voudrais ni ne pourrais choisir, et me sens d'autant plus Français que je ne le suis pas d'un seul morceau de France, que je ne peux penser et sentir spécialement en Normand ou en Méridional, en catholique ou en protestant, mais en Français, et que, né [Pg 72]à Paris, je comprends à la fois l'Oc et l'Oïl, l'épais jargon normand, le parler chantant du midi, que je garde à la fois le goût du vin, le goût du cidre, l'amour des bois profonds, celui de la garrigue, du pommier blanc et du blanc amandier,
Je ne choisis non plus ici: taire un des deux pays serait ingratitude, et, puisque vous me pressez de parler, souffrez que je parle des deux.
Du bord des bois normands j'évoque une roche brûlante—un air tout embaumé, tournoyant de soleil, et roulant à la fois confondus les parfums des thyms, des lavandes et le chant strident des cigales. J'évoque à mes pieds, car la roche est abrupte, dans l'étroite vallée qui fuit, un moulin, des laveuses, une eau plus fraîche encore d'avoir été plus désirée. J'évoque un peu plus loin la roche de nouveau, mais moins abrupte, plus clémente, des enclos, des jardins, puis des toits, une petite ville riante: Uzès. C'est là qu'est né mon père et que je suis venu tout enfant.
On y venait de Nîmes en voiture; on traversait au [Pg 73]pont Saint-Nicolas le Gardon. Ses bords au mois de mai se couvrent d'asphodèles comme les bords de l'Anapo. Là vivent des dieux de la Grèce. Le pont du Gard est tout auprès...
Plus tard je connus Arles, Avignon, Vaucluse... Terre presque latine, de rire grave, de poésie lucide et de belle sévérité. Nulle mollesse ici. La ville naît du roc et garde ses tons chauds. Dans la dureté de ce roc l'âme antique reste fixée; inscrite en la chair vive et dure de la race, elle fait la beauté des femmes, l'éclat de leur rire, la gravité de leur démarche, la sévérité de leurs yeux; elle fait la fierté des hommes, cette assurance un peu facile de ceux qui, s'étant déjà dits dans le passé, n'ont plus qu'à se redire sans effort et ne trouvent plus rien de bien neuf à chercher;—j'entends cette âme encore dans le cri micacé des cigales, je la respire avec les aromates, je la vois dans le feuillage aigu des chênes verts, dans les rameaux grêles des oliviers...
Du bord de la garrigue enflammée, j'évoque une herbe épaisse et sans cesse mouillée, des rameaux flexueux, des chemins creux ombrés; j'évoque un bois où ils s'enfoncent... Mais d'autres ont chanté déjà la verdoyante [Pg 74]terre du Calvados. Là nul chant de cigales; tout est mollesse et luxe; sous la plante, le roc franc n'apparaît jamais. Là vivent d'autres dieux, d'autres hommes; les dieux sont beaux, je crois; les hommes laids. La race, alourdie de bien-être et ne songeant pourtant qu'à l'augmenter, s'est déformée. Incapable de chant, de musique, elle n'occupe plus qu'à boire, ses plus belles heures oisives. Ici l'amour du gain vient seul à bout de la paresse; l'homme indolent laisse fuir de ses mains les biens les plus précieux, les plus rares...
Mais, peut-être les qualités de la race normande, moins apparentes que celles des méridionaux, prennent-elles chez ceux qui en restent dépositaires une force d'autant plus grande qu'une chair plus lourde les contraint plus, et gagnent-elles en gravité, en profondeur ce qu'elles perdent d'éclat et de superficie.
Dès le pays de Caux tout change; les grands champs remplacent les prés; l'homme plus travailleur est plus sobre; les femmes sont moins déformées. Et ce quinze juillet, où j'écris ceci, près d'Etretat, tantôt assis, tantôt marchant sous le plein soleil de midi, jamais cette campagne ne m'a paru plus belle. Quelques lins sont encore en fleur. On coupe les colzas; [Pg 75]les seigles sont fauchés. Les blés en quelques jours ont blondi. La moisson s'annonce admirable. De ci de là, par places, partout, de grands coquelicots posent une rougeur sur la terre.
Les quelques lieux dont je parle ne sont pas plus toute la Normandie et tout le Midi, que le Midi et la Normandie toute la France.
Je songe avec tristesse que si quelque hasard les rapprochait, le paysan normand que je connais et l'homme du midi que je connais, non seulement ne s'aimeraient pas, mais ne pourraient même pas se comprendre. Pourtant ils sont Français tous deux.
Aux yeux d'un Allemand, d'un Italien, d'un Russe, qu'est-ce qui représente «une ville française»?—Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de recul pour le comprendre. Je vois une Bretagne, une Normandie, un pays basque, une Lorraine, et de leur addition je fais ma France. En Savoie je sais que je suis en France; et je sais qu'un peu plus loin je n'y suis plus. Je le sais [Pg 76]et je veux le sentir. Mais est-ce une simple annexion qui va faire une terre française? Non; pas plus qu'un triste traité ne suffirait à faire de l'Alsace-Lorraine une terre allemande; l'Allemagne l'a bien compris. Pour que se forme et s'affermisse le sentiment d'unité d'un pays, il faut que les divers éléments qui le composent se mêlent, se croisent et fusionnent. La doctrine de l'enracinement, trop rigoureusement appliquée, risquerait, en protégeant et en accentuant l'hétérogénéité des divers éléments français, de les faire à jamais se mésentendre, de former des bretons, des normands, des lorrains, des basques, plus bretons, normands, lorrains et basques ... que français. Rien de plus particulier que l'esprit de province; de moins particulier que le génie français. Il est bon qu'il naisse des Français comme Hugo
qui, portant en eux tout à la fois les richesses les plus extrêmes de la France, les organisent et les contraignent à l'unité.
Disons encore: Il y a des landes plus âpres que celles de Bretagne; des pacages plus verts que ceux de [Pg 77]Normandie; des rocs plus chauds que ceux de la campagne d'Arles; des plages plus glauques que nos plages de la Manche, plus azurées que celles de notre midi—mais la France a cela tout à la fois. Et le génie français n'est, pour cela même, ni tout landes, ni tout cultures, ni tout forêts, ni tout ombre, ni tout lumière—mais organise et tient en harmonieux équilibre ces divers éléments proposés. C'est ce qui fait de la terre française la plus classique des terres; de même que les éléments si divers: ionien, dorien, béotien, attique, firent la classique terre grecque.
Juillet (1902)
[1] L'Occident ayant cru intéressant de demander à plusieurs de raconter les aspects de la terre Occidentale, cet article fut le premier d'une série consacrée à nos provinces.
1898–1900
Nous ne faisons que nous entregloser. Tout formille de commentaires; d'aucteurs il en est grand'cherté.
MONTAIGNE, III, 13.
[Pg 80]Ces chroniques ont paru irrégulièrement dans l'Ermitage, au cours des années 1898, 1899 et 1900.
Non, chère Angèle; j'y suis bien décidé; je ne recommanderai pas votre livre au Mercure; d'abord parce que ma voix n'y a pas l'importance que vous croyez, et puis parce que, si elle y avait plus d'importance, j'en userais d'abord pour d'autres que pour vous.—Quelle drôle d'idée vous avez eue d'écrire! Ne pouviez-vous vraiment vous empêcher? Ce n'est pas certes que votre livre ne soit plein des qualités exquises de votre âme, et de celles de beaucoup d'autres;—mais qui ne les connaît, Angèle?—Vous m'écrivez que je dois les aimer, puisque déjà je les aimais en d'autres;—mais c'est précisément pour cela, chère amie.—Vous manifestez pour me plaire un anormal amour de la Nature, comme si là gisait le salut assuré;—mais le salut n'est pas dans la Nature, il est dans l'amour, chère amie... Et puis, vous n'aimez pas tant que ça [Pg 82]la Nature; je me souviens de notre course à Suresnes: vous crachiez les peaux des raisins...
Ah! si vous récrivez, n'ayez donc pas souci de me plaire; et c'est ainsi que vous plairez vraiment; c'est ainsi que vous intéresserez. Ah! quand donc, chère amie, saurez-vous, oserez-vous me déplaire un peu puissamment!—Je suis sûr que vous n'avez jamais songé aux permissions que donne la blancheur des pages. Mais, avant de prendre la plume, la page s'assombrit déjà de quels compliqués esclavages!—Chaque sympathie, chaque théorie, chaque réprobation vous enchaîne; et combien le champ blanc se rétrécit! Vous ne vous affirmez jamais. Vous vous laissez tracer votre figure. Vous n'occupez (en souriant toujours!) que la place que l'on vous laisse. Tout vous dicte, et vous ne protestez pas!—Des amis vous ont dit qu'il fallait à tout prix de la joie: c'est fâcheux; vous étiez née pour être heureuse; mais vous voilà contrainte, et votre sourire est forcé. On blâme autour de vous les intrigues; on rêve des récits sans événements: c'est fâcheux; vous vous entendiez aux intrigues; dans votre livre il n'y en a plus l'ombre; on y marche comme en plein champ. Chaque page en soi est charmante; je sais, je sais;—mais en soi le livre [Pg 83]n'existe pas; de sorte qu'il faudrait alors chaque page encore plus charmante, ou bien un tempérament stupéfiant, ou bien un style ... et ne me poussez pas, chère Angèle, sinon je finirais par vous dire que rien ne m'intéresse dans un livre, que la révélation d'une attitude nouvelle devant la vie.
J'exagère...
Mais je sais que je voudrais pouvoir considérer l'œuvre d'un artiste comme un microcosme complet, étrange tout entier, où pourtant toute la complexité de la vie se retrouve. Je voudrais y sentir une philosophie spéciale, une morale spéciale, une langue spéciale, une plaisanterie spéciale... Cieux! à propos de votre livre délicat, où m'égarai-je?...
Et n'est-ce pas une calamité de notre époque, au contraire, cette peur de paraître banal, ce désir de génie, ce dédain du talent.—Voyez M. Mirbeau... Vous qui le connaissez et qui avez quelque influence sur lui, vous devriez bien tâcher de lui lire un peu ses articles. Ils sont stupides. Certainement c'est parce qu'il a du génie; mais c'est fâcheux qu'il n'ait pas plus de talent. Il faut terriblement de talent, chère amie, pour rendre un peu de génie supportable.
Dans son dernier article, un Monsieur compte les [Pg 84]étamines d'une fleur; il compte: «une, deux, quatre, huit, dix, vingt...» Il est lancé quoi!—C'est tout Mirbeau.—Dites-lui donc que ce n'est pas vrai; que tout cela c'est de la rhétorique; que compter sérieusement, c'est compter difficilement.—Mais voilà: s'il était plus vrai, M. Mirbeau serait moins brutal, et s'il était moins brutal, il ne serait plus rien du tout. Non, chère Angèle, s'il avait seulement un peu de talent, je crois qu'il n'oserait plus écrire.—Ah! souhaitons-lui du talent, chère Angèle[1]!
Parlons plutôt de M. de Curel. Car M. de Curel manque surtout de génie. Ses pièces sont, comme il sied alors, d'une grande hardiesse de pensée et d'une grande timidité de présentation. Après M. Mirbeau cette timidité paraît presque une politesse, exquise vraiment; M. de Curel vous laisse la parole sans cesse, par chacun de ses personnages—de sorte que, de quelque côté qu'on se tourne, on est contraint d'être de son avis. L'effet dramatique de ses pièces reste donc à peu près complètement subordonné à l'exposition des idées:—il faut dire qu'elle est excellente;—mais l'erreur dramatique est que l'idée devienne plus importante en [Pg 85]elle-même que le personnage qui l'exprime; les idées ne devraient être exprimées que par l'action—ou, autrement dit, il ne devrait pas y avoir d'idées; ou, autrement dit encore, une idée, au théâtre, ce devrait être un caractère, une situation, les pseudo-idées que l'on prête à la bouche des personnages ne sont jamais que des opinions et doivent être subordonnées aux personnages; ce n'est pas par elles surtout qu'ils s'expriment; elles ne doivent être que le contenu conscient de leurs actes. Le soutien inconscient plus intéressant, plus important, plus fort, c'est le caractère lui-même.
D'ailleurs, l'on peut dire que, dans l'œuvre de M. de Curel, les caractères sont fort bien observés; on sent surtout qu'il y a très soigneusement pris garde et que ses pièces sont consciencieusement travaillées. Tout bas je vous avoue que je préfère Ubu; mais au Repas du Lion, à la Nouvelle Idole j'applaudis de toutes mes forces; j'y retourne plusieurs fois: j'y entraîne les autres; car telles qu'elles sont, ces pièces restent beaucoup au-dessus des stupidités auxquelles les théâtres nous accoutument; et j'applaudis pour ne pas donner gain de cause aux imbéciles, car certainement le rôle des intelligents est ici d'applaudir—quitte à dire ensuite tout ce qu'ils veulent, en fait de restrictions.
[Pg 86]Je ne crois pas pourtant que de telles pièces puissent durer; il n'y a pas de beauté en elles; leur aristocratie intellectuelle nous flatte (vous du moins, chère Angèle—moi je préfère la grossièreté); elle fait dire aux délicats: «que cela est bien écrit!» précisément là où le style cesse complètement d'être un style de rampe, sans fournir pour cela de phrases vraiment belles. Il y a (comme il me souvient qu'il y avait dans l'Invitée) des comparaisons prolongées qui sont pénibles... Malgré toutes ces réserves, j'aime en M. de Curel une très grande, une parfaite honnêteté artistique, une bonne foi qui, souvent, m'émouvait plus que le drame...
J'eusse voulu vous parler aussi des Tisserands: c'est une forte pièce que j'admire et qui m'exaspère; je ne décolère pas de toute la représentation. Je voudrais protester, crier que je m'en f..., car enfin ces gens-là ne m'intéressent que parce qu'ils ont faim; s'ils cessaient de crever de faim, ils ne m'intéresseraient plus du tout;—aussi soyez bien sûre qu'il ne mangeront pas durant cinq actes; et nous voilà contraints d'être émus.—Oserais-je écrire que, de toutes les façons de mourir au théâtre, celle «de faim» est la moins intéressante,—car enfin, quand nous regardons cela, c'est toujours au sortir de table... etc.
[Pg 87]Et certes, la signification des situations est ce qu'au théâtre devient l'éloquence; mais la lumière qu'elle apporte ici n'y est, volontairement, pas propagée; elle est subite et s'arrête, à la scène même; elle n'éclaire rien à l'entour; elle n'éclaire pas; elle aveugle ... et si ceux qui assistent, si les spectateurs n'avaient pas suffisamment dîné, s'ils avaient faim, s'ils étaient pauvres, les voici chauds pour tous les crimes, grisés et ne voyant plus que cela: l'auteur leur a bandé les yeux avec du feu.—C'est un miroir qu'ils brisent (admirable, le bruit du verre cassé sur la scène!) mais c'est que ça serait tout aussi bien une œuvre d'art ... oh! qu'elles sont loin de cette pièce, les œuvres d'art! oh! combien Hauptmann les a prudemment écartées!
Qu'elle est habile, cette grossière et fruste pièce!—Tenez, chère Angèle, un seul trait:—pour garder l'anonymat de la foule malgré la précision des misères particulières, remarquez qu'à chaque acte ce sont des représentants différents qui paraissent—et qu'on ne s'en aperçoit presque pas, tant leur passion est la même ... tant ils sont peu intéressants. «L'important, dit quelqu'un près de moi—l'important, c'est que ça fasse peur au bourgeois.»—Evidemment, ça y arrive.
Parler des autres est bien malaisé, chère Angèle.
On reproche à M. Maurras de ne dire du bien que de ses amis; cela est désagréable à penser; et puis on peut répondre qu'ils ne sont ses amis que parce qu'il en pensait du bien. Ce n'est pas mal répondre, mais les amitiés ne se choisissent pas tant que ça; certaines, au contraire, s'imposent fâcheusement. Pour moi, qui les choisis pourtant le plus possible, j'ai la pudeur contraire exagérée: l'amitié que je voue à certains et celle qu'ils veulent bien m'offrir relient l'expression de mon éloge; il peut m'en retourner quelque chose et, pour un peu, les louant, je me paraîtrais immodeste. C'est ainsi que l'amitié de Jammes m'a souvent empêché de crier combien je l'admire; et peut-être ne l'eussè-je pas encore fait, sans la petite plaquette rare qu'il m'apporte, où vous lirez quatorze de ses plus [Pg 89]belles Prières qui paraîtront bientôt en volume[1].
Ce sont d'autres raisons qui rendent la louange de Signoret difficile; d'abord parce que le parti qu'il en tire l'exagère et risque de la dénaturer; ensuite parce que l'admiration qu'il proclame pompeusement pour mes écrits risque de donner à mes éloges l'allure fâcheuse d'une réciproque; enfin parce que tous les éloges qu'on y pourrait faire ne vaudront jamais ceux qu'il se converse à lui-même. Ils frémissent immodestement en chaque page; son œuvre en est remplie, encombrée; souvent l'œuvre est comme mangée et remplacée par sa propre louange; celle-ci devient alors parfaite, sonore à souhait, et complètement désintéressée—forcément.
J'allais pourtant oser parler de Signoret lorsque voici que me parvient le dernier numéro du Saint-Graal. J'y vois que M. Signoret trouve plus simple de publier directement des fragments, choisis élogieux, de ce qu'on lui écrivait en des lettres particulières; autant alors vous y renvoyer simplement n'ayant d'ailleurs rien d'autre à vous dire sur lui que ce que je lui disais à lui-même. Mais pour permettre dans [Pg 90]le prochain Saint-Graal plus de place à l'œuvre propre de Signoret, mieux vaut que je publie aussitôt ici la lettre que je lui adressais hier pour le remercier de l'envoi du premier livre de ses Sonnets[2]. Parcourez-la si [Pg 91]cela vous amuse, puis redisons ensemble son Chant d'amour dont j'appris comme malgré moi ces beaux vers:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .[Pg 92]Eurydice, Eurydice, Eurydice, regarde:
Lyrisme orgueilleux et rapide; absorption des sens dans l'exaltation de la pensée:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quand ma nef passera près des plages obscures,
Il faut, après ces vers dignes d'être cités auprès des plus splendides, rouvrir le livre à peine fermé de Jammes pour comprendre aussitôt et comme instinctivement les positions réciproques de ces deux poètes; ils se limitent l'un par l'autre. Tout le faste d'Emmanuel Signoret fait mieux sentir encore la fraîche [Pg 93]nouveauté de ce dernier; car il y a là quelque chose d'autre, quelque chose de neuf, quelque chose de jamais encore entendu. Là, plus de sonorité, ni d'éclat; une voix souvent presque fausse, mais à la façon de celles que troublent les larmes—et je comprends que M. Signoret n'aime pas Francis Jammes, car devant une voix si orgueilleusement simple, toute la rumeur rhétorique et la belle sonorité ne paraît plus, comme dit l'Evangile, «qu'un airain qui résonne, qu'une cymbale qui retentit».—Même il n'est pas intéressant de marquer les différences de ces deux esprits; ils ne vivent pas dans le même monde et regardent opposément. L'impersonnalité du premier est si grande que ce que l'on admire ici, il semble que ce soit la langue française elle-même; M. Signoret n'est personnel que parce qu'il parle de lui. La personnalité de Francis Jammes déconcerte; mais ce n'est qu'au premier abord; jamais une plus complète absence de recherche extérieure n'avait permis encore recherche d'union plus intime des mots avec l'émotion, des sensations entre elles-mêmes. On n'imagine pas beauté plus fièrement déparée de tout fard. Sa seule coquetterie, si c'en est une, est la montre presque involontaire de sensations plus subtiles et plus subtilement associées qu'on ne le pouvait supposer jusqu'alors. [Pg 94]Elles se touchent, se continuent, s'appellent et se marient, à ce point que parfois elles font à l'émotion qu'elles entourent un vêtement sans couture.
Francis Jammes est un grand poète; il a l'audace la plus noble: celle de la simplicité. Il existe assez réellement lui-même pour pouvoir se passer d'adjuvants, des communes ressources littéraires; de sorte qu'on s'étonne d'abord, tant sa littérature emprunte peu à celle des autres.
L'amour de la simplicité est tel, chez lui, qu'il va parfois jusqu'à certaine affectation de dénuement;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faites qu'en me levant, ce matin, de ma table,
Patient dénuement de pensée pour permettre un accueil plus vaste et plus surpris à tout émoi vibrant, à toute sensation éparse autour de lui. Chaque soupir errant trouve en lui son écho disponible. Sa poésie [Pg 95]fluide et pure est comme le ruisseau sous les bois, où chaque oiseau vient boire, où tremble chaque feuille mirée, où l'eau se plaint à chaque roche. Aucune abondance inutile; cette eau vaut par sa pureté; savez-vous ce qui la fait si grande? C'est que pas une eau étrangère n'en est venue grossir, en le troublant, le cours; c'est qu'il se résigne à lui-même, pour aliment n'espérant que du ciel les abondantes eaux des averses.
Et parfois la pureté de cette eau devient telle qu'elle n'est plus que murmure, transparence, et reflet, et fraîcheur.
Ces prières sont belles et, presque toutes, parmi les plus belles pièces de Jammes. Elles marqueront pour cet involontaire esprit non un repos, mais au contraire une période d'inquiétude. Il semble parler beaucoup de Dieu pour tâcher de se prouver qu'il y croit. Peut-être en parlait-il mieux en ne le nommant pas, mais simplement, comme avant, délicieusement chaque chose. Prendre Dieu à partie sans cesse, comme ici, donnerait à entendre qu'on en attend encore en vain une réponse. Je sens en ces Prières une âme excessivement affectueuse et désolée. La prière n'est souvent que le besoin, quand on se sent seul, de parler à la seconde personne.—Ces prières sont l'œuvre d'une crise, inquiète et passionnée. J'attends avec confiance que ce sensuel si peu mystique, ressentant à nouveau chaque émotion en soi suffisante, se plaisant à l'aspect et le disant dès lors divin tant qu'il lui plaît, laisse de nouveau Dieu tranquille et le fasse seulement entrevoir sous la terre très habitée. Nul [Pg 97]doute alors que le grand mouvement de ses prières, plus plein et soulevé qu'il ne l'avait encore jamais été chez Jammes, gonfle admirablement de longues pièces d'une allure assez différente—comme voici qu'il fait cette délicieuse élégie que vous lirez dans le prochain numéro du Mercure[3].
C'est près des bois épais qu'elle fut composée, dans cette Normandie ruisselante et penchée où je m'attarde encore, où nous vîmes approcher l'automne, ensemble avec Henri Ghéon dont il faut aussi que je vous parle; j'aime à placer ce nom près de celui de Jammes; leurs livres sont voisins dans ma bibliothèque; ils vivent dans une même atmosphère, cela leur fait, par sympathie, une espèce de ressemblance; mais c'est par où devraient se ressembler tous les poètes: l'entente à demi-mot de la nature. Ceci dit, il est difficile d'imaginer deux esprits de nature plus différente. Celui-là, tout le trouble; son émoi, c'est la contagion d'une tristesse; pour motiver mieux sa pitié, il imagine une souffrance en chaque chose; il explique ainsi sa tendresse.—En Ghéon, aucune tristesse; c'est une âme de cristal et d'or, pleine de sonorités merveilleuses. [Pg 98]Tout ce qui la touche y retentit; rien ne la laisse indifférente; pourtant, à travers tout, elle reste la même. Tout l'émeut et rien ne la trouble; le monde se revoit en elle dans une charmante, vibrante et souriante harmonie[4].
Je suis heureux que vous ayez pu parler à M. Mirbeau; je remarquais bien en effet que ses derniers articles devenaient meilleurs...
La Roque, 15 octobre 1898.
[1] V. Le Deuil des Primevères (Mercure de France).
[2] Cher Signoret,
Vos sonnets paraissent plus beaux à la seconde lecture qu'à la première. L'égalité de leur éclat trompe d'abord; on doute d'une clarté sans étincelles; on ne comprend que peu à peu qu'elles sont toutes dévorées. Voilà pourquoi je crus d'abord vos belles élégies préférables: leur morbidesse est moins cachée et mon esprit s'étonne encore d'une beauté sans renoncement ni faiblesse, comme si sa perfection n'était due qu'aux dépens de son humanité. C'est aussi que nous sommes en un temps où il semble que la trop pure beauté ait besoin de faire pardonner sa présence; on ne l'accepte, semble-t-il, que venue de loin et passée; on prend aisément son parti que la Renaissance italienne et la Pléïade qu'était Ronsard, en la démontrant de manière si glorieuse, l'aient comme monopolisée.
Je pense que le souvenir de cette Renaissance admirée vous hante; vous y cherchez non seulement le secret de votre forme, mais encore un modèle de vie, franche jusqu'à l'orgueil, superbement extérieure, aventurée. J'ai peu lu, je l'avoue, les lettres de ce temps, qui m'hallucine moins que vous, et ne sais si les Donatello et les Brunelleschi que vous citez oseraient porter leur orgueil aussi sonorement devant eux. N'importe; je m'amuse trop de cela pour m'en plaindre et n'en souffre que lorsque cet orgueil vient pour boucher les vides de l'esprit, que lorsque l'affirmation de votre génie tend à remplacer sa manifestation effective. Au reste, je conviens que le public est si bête que c'est surtout en lui affirmant que vous avez du génie que vous le forcerez de le croire ... mais vous n'écrivez pas pour ce public, et les gens intelligents que vous prétendez que nous sommes savent comprendre la beauté de vos vers sans que vous l'affirmiez à l'avance.
J'admire aussi votre riante audace de publier les lettres qu'on vous écrit: si je vous estimais assez peu pour vous croire capable d'une habileté, je dirais qu'elle est excellente; mais non: j'y veux voir seulement l'exigence d'une franchise et m'y plaire; tel qui louerait secrètement par flatterie va se croire contraint de rester fidèle à lui-même et continuer à vous louer; vous innovez une coutume, et certes rien n'est moins facile, car certes sans vous on ne l'eût pas choisie. Les lettres des littérateurs sont trop aisément ténébreuses; il est bon d'illuminer cela. Créons des précédents. J'y veux aider aussi, et laissez-moi trouver plus simple de publier déjà moi-même cette lettre à vous adressée.
Au revoir, etc.
A. G.
[4] Les Chansons d'Aube et La Solitude de l'Eté (Mercure de France).
—Quand donc pourrons-nous parler librement, tranquillement, du Naturisme? A chaque fois quelque nouvel éclat nous empêche.—Naguère quelques critiques mal renseignés (ou du moins renseignés trop exclusivement par M. de Bouhélier lui-même) voulurent bien, dans l'ignorance des dates, me croire adepte d'une école qui simplement avait le goût naissant de m'approuver. Affamé de plus bruyante gloire, M. de Bouhélier entraînait mon nom à sa suite jusque dans les colonnes du Figaro; l'admiration que je manifestais pour son jeune talent trouvait ainsi sa récompense. Mon admiration n'en fut pas précisément modifiée, mais du coup je la manifestai moins.—Ce n'est non plus une mauvaise pièce de théâtre qu'un médiocre volume de vers qui peuvent faire oublier l'extraordinaire don de prosateur que montraient ses premiers écrits; [Pg 100]nulle composition; une redondance souvent vaine, aidant une plus grande sonorité; un lyrisme souvent imité, mais sincère (je vous assure que cela se peut): tout cela, la pensée même, ou l'apparence de pensée, complètement subordonné au rythme sûr, plein, riche, harmonieux de la phrase; et souvent on n'y sentait rien d'autre—comme on ne sent souvent rien d'autre chez Hugo que le vers.—Et je comprends que l'orgueil de M. de Bouhélier puisse déplaire; mais c'est tant qu'il n'est pas plus grandement justifié. Quelqu'un qui sent en lui des œuvres grandes (comme je pense que fait M. de Bouhélier) peut prendre des allures modestes, mais c'est en attendant et par hypocrisie. Chez M. de Bouhélier, l'orgueil de l'œuvre précède l'œuvre; mais j'espère que l'œuvre suivra[1].
Le talent de M. Monfort semble plus personnel et plus particulier; c'est peut-être parce qu'il est plus restreint. Il est bien difficile de jauger sa future valeur d'après ses deux premiers écrits. L'émotion, qu'aucun [Pg 101]souci de composition non plus ne contrefait, trouve souvent pour se chanter les exclamations les plus justes; il semble parfois qu'il y ait là comme le bruissement même de la vie, le battement léger des artères sans même un doigt posé dessus pour le sentir et pour y imposer un unique lien. D'où quelque chose d'éperdu, qui charme mais qui déconcerte; une fuite dans le temps, mais une telle absence d'espace que les émotions se succèdent sans parvenir à voisiner. Que deviendra tant de fluidité? Que donnera ce don d'expression si immédiate, mais si exclusivement passionnée?
Les articles de M. Mirbeau deviennent bons.
Chère amie,
Monsieur Mirbeau fait comme tant d'autres devraient faire: il change. Dans un article de l'Aurore du 15 novembre, intitulé «Palinodies», il écrit: «Aujourd'hui, j'aime des personnes, des choses, des idées qu'autrefois je détestais, et je déteste des idées, des choses et des personnes que j'ai aimées jadis...» Que M. Mirbeau nous permette donc de faire comme lui; de l'aimer aujourd'hui d'autant plus que nous l'aimions moins naguère et qu'il en est plus revenu.—Parlant du suicide de Gérard de Nerval, Baudelaire ou Gautier, je ne sais plus lequel, revendique deux libertés que l'on refuse volontiers aux hommes: celle de se tuer, celle de se contredire. Aux yeux de certains, c'est presque la même chose. C'est presque [Pg 103]le contraire, aux yeux de certains autres, et seuls, pensent-ils, ceux qui sont morts, ou presque, ne se contredisent jamais. C'est l'avis de M. Mirbeau qui tient à vivre, et c'est le mien.
Se contredire! Si seulement M. Barrès l'osait ... quelle belle carrière!—Au lieu de cela il tâche de faire se contredire M. France et ne réussit à rien, sinon montrer que M. France a été sincère deux fois. La politique est désastreuse pour cela; le parti que l'on sert emprisonne; on ne s'en dégage pas sans apparence de désertion; la franchise y perd, il est vrai, mais c'est pour que le parti y gagne... J'ai la terreur des partis pris. Songez donc: c'est de vingt à trente ans qu'une carrière se décide; est-ce de quinze à vingt que l'on aura pu réfléchir! Qu'y faire? car c'est une fatalité. L'action seule vous éduque; on ne l'apprend qu'en agissant; un premier acte vous engage; il éduque, mais compromet; dût-on l'avoir trouvé mauvais, c'est le même qu'on va refaire. Les co-partisans vous déplaisent? on ne se sent que mal avec eux? n'importe, il faut continuer: d'autres comptent déjà sur vous; changer ce serait les trahir. A trente-cinq ans vous n'avez fait que des écoles; mais vous apportez un passé qui dictera votre avenir.
[Pg 104]La vie d'un «homme libre» est décidément difficile et terriblement motivée.
—Au moins, vous dites-vous, chère Angèle, en art, tout cela n'existe pas!—Oh! sous une autre forme, si pourtant. De toutes les fidélités, celle à soi-même est la plus sotte—dès qu'elle n'est plus spontanée.—Fidélité à quoi, grand Apollon?—à ses principes; on se fait de cela sa personnalité.
Par une affirmation prématurée, que de sincérités compromises? Mais on veut se manifester précocement.—Passe encore, lorsqu'on écrit roman ou drame, ou que l'on se raconte, simplement; parler de soi n'est pas un mal; on s'y aide à changer; que raconter de soi, sinon des changements? «Le Moi est haïssable», dit Pascal; le Moi d'hier, par celui d'aujourd'hui.
—Non, le danger, c'est d'exprimer précocement des opinions, des idées. M. Mæterlinck le sait bien. M. Mæterlinck a changé, mais reste esclave d'un premier livre. Je ne parle pas, vous le pensez, de ses drames—mais bien du «Trésor des Humbles».—Là tentait de se fixer sa pensée; c'était un livre de morale.
Chère Angèle, vous savez si je les aime, moi, les livres de morale; si je ne me retenais, chère Angèle, j'en écrirais [Pg 105]un tous les mois; mais un tous les trois ans, ah! non!—ou seulement passé cinquantaine; on ne sait pas, avant, ce qui peut arriver... Maurice Mæterlinck est encore jeune; il peut créer, mais il raisonne: il écrit Sagesse et Destinée au lieu d'écrire d'autres Maleine, des Intérieur, des Mélisande. Combien peu de temps pense-t-il vivre encore? N'attend-il donc plus rien de la vie? Un livre comme ce dernier[1] me fait l'effet d'un testament. J'aime, comme Pascal, attendre d'être mort pour livrer mes pensées. Qu'elles vivent, après! Ça les regarde; mais c'est parce que soi l'on est mort.—M. Mæterlinck, lui, n'est pas mort; et je vous dis qu'il a changé. Depuis le Trésor des Humbles, qu'a-t-il donc rencontré sur sa route?—La vie et Nietzsche;—quoi de plus pour bouleverser?—Mais le Trésor des Humbles étant écrit, il a voulu rester fidèle à ce qu'il y disait si bien, relier au nouveau moi l'ancien. Etrange mariage de l'individualisme et de l'humilité; un peu de mysticisme rend tout possible.
M. Mæterlinck est un fort, et sa pensée continuera; déjà bien des phrases de ce livre n'eussent pu être [Pg 106]écrites dans le Trésor des Humbles. Espérons que nous connaîtrons plus tard de lui bien des phrases qui n'eussent pu être écrites dans celui-ci. Plus un tel livre engage la pensée, plus une âme aussi sincère que la sienne se sent le devoir de redonner un nouveau livre, sitôt que celui-ci n'en est plus le portrait fidèle. «Nées douces, les pensées, elles vieillissent féroces»,—dit votre ami Vielé-Griffin dans la très belle lettre qu'il nous adresse[2]; «belles d'hier, les voici ridées, flétries, hideuses à faire pleurer qui les mit au monde...»—«O mes pensées d'hier! O mes belles pensées! s'écriait Nietzsche, qu'ai-je donc fait de vous? qu'est-ce que vous voilà devenues?»
Que M. Vielé-Griffin se rassure: même avec des précautions, je n'ose encore guider personne.—Qui veut se promener, qu'il me suive! Mais vers quoi guiderais-je les autres? moi qui ne sais pas où je vais.—Allons-y—mais doucement, ma chère Angèle. Léo est in via, dit Salomon. Et errare humanum est ... mais il y a quelque charme à cela.
Paris, 15 novembre 1898.
Chère Angèle,
Pardonnez-moi, je ne suis pas parti, je ne pars pas. Je ne sais plus partir.—Le petit appartement que nous prîmes à frais communs, si petit qu'on n'y peut tenir ensemble, et que vous n'y venez que lorsque je cède la place, je ne le quitterai qu'au printemps. Paris me retient, me possède; j'y vis, j'y revis, j'y voyage; j'y regarde inlassablement. A force de le fuir naguère, j'ai trouvé le secret d'y vivre comme en une ville étrangère, c'est-à-dire d'y admirer tout. Non! Rome et le grave Palatin, les quais argentés de Venise, Naples et ses tièdes aurores n'ont pas eu pour moi plus de charmes. Quand je regrette (car je me plais à regretter parfois), c'est plus lointainement encore, Kairouan, Tunis, Touggourt, le mirage infini du désert, l'oasis [Pg 108]pleine de colombes... Que n'y allez vous à présent, tandis que je m'attarde ici? Vous m'écririez: Il fait un temps affreux; depuis trois jours nous suffoquons sous une tempête de sable. Je répondrais: Il fait un temps charmant, gris et tiède, et de sourire entre les larmes; l'alternance de brefs soleils et de passagères ondées fait un étonnement pour chaque heure, et les travaux des quais renouvellent les paysages.—Paris est merveilleux, chère amie, et défoncé de toutes parts: vous savez que ce n'est pas seulement à l'Exposition qu'on travaille; on perce tous les boulevards; on sape, on creuse, on lance et fait rôder sous terre des projets ténébreux d'égouts et de chemins de fer. Le travail souterrain crève par places la surface; on se penche au-dessus; on suppose des cavités inexplorables où tout un peuple harassé travaille le jour et la nuit.—Car la nuit, le travail continue; sur les quais, dès la tombée du soir, de fantastiques fanaux éclatent. Passé minuit, dans le silence d'alentour, les abords de l'ex-Cour des Comptes sont lyriques. Il y a, près du pont Royal, d'énormes arbres; leurs branches s'allongent et baignent dans cette lumière factice, et, derrière eux, les murs semblent incendiés. Plus loin des palais naissent, comme poussés par en bas.
Ces vers sont de Verhaeren; je vous envoie son dernier volume[1]. Citerai-je encore?
Et ceci me permet d'ajouter que je ne suis pas de ceux qui regrettent la Cour des Comptes. Par principe, je veux avoir toutes les ruines en horreur. Certes, si c'est pour construire un aussi terrible monument que le nouvel Opéra-Comique qu'on les enlève, je préférerai toujours ce qui pouvait se trouver à la place.—Mais quel terrible aveu d'impuissance que cette crainte du neuf, que ce respect du vieux. Les époques créatrices n'avaient pas tant de scrupules et se plaisaient à démolir—pour avoir plus à reconstruire après—soucieuses [Pg 110]surtout d'imposer au dehors des formes à leur ressemblance. La première condition pour cela, c'est de ne pas ressembler au passé. L'admiration de l'antiquité qu'avait la grande Renaissance ne me contredit point; c'était pour elle une ferveur de plus, une émulation, une excitation à produire.—Mais l'archéologie, le contemplatif regret du passé ne créent pas les œuvres nouvelles.
M. Louys nous le prouve surabondamment et plus délicieusement que jamais dans le conte qu'il donne au Mercure, où il s'excuse de ne parvenir plus à rien inventer de bien neuf[2].—Il m'est difficile, je l'avoue, de suivre une discussion où l'on veut faire le mot «histoire» synonyme du mot «progrès», surtout lorsqu'on entend par progrès simplement augmentation de confort, perfectionnement des voluptés. Il m'est difficile et désagréable de considérer l'histoire de l'humanité comme une marche, de sensualités en sensualités plus charmantes, et rien dans ce monde ne me convainc que ce soit de volupté que le monde doive mourir.
Constater que l'antiquité tissait déjà la soie ne [Pg 111]déprécie pas la soie à mes yeux. La ramie ne me semble pas d'une textilité plus parfaite, la pomme de terre d'un goût plus délicat pour avoir été découvertes hier. Si l'on n'a pas inventé, comme il est déploré dans ce conte, de nouvelles pierres précieuses, c'est peut-être qu'on n'en avait pas grand besoin et que celles d'avant contentaient.—Que M. Louys trouve la vie antique parfaite, j'y consens; mais alors il ne devrait pas regretter que l'homme ne l'ait point perfectionnée—s'extasier sur la beauté d'antiques marbres et déplorer tout à la fois que l'homme n'ait pas trouvé depuis «une pierre naturelle, un alliage chimique plus digne de reproduire la figure humaine»,—c'est peut-être une inconséquence. L'idée de perfection exclut celle de progrès; on parle de la perfection de l'art et des progrès de l'industrie; cela M. Louys le sait bien,—mais je vous le dis à vous, chère Angèle, pour que vous compreniez qu'il est dangereux de refaire l'œuvre d'autrui, fût-ce en vue de la perfectionner, et surtout lorsqu'elle est déjà parfaite; on risquerait sinon, par bienveillance envers soi-même, de préférer le Guide à Raphaël, le plafond du palais Farnèse à celui de la Sixtine, et Une volupté nouvelle au Dialogue avec une momie d'Edgar Poe.
[Pg 112]Certes, nos temps sont laids; le temple de Pœstum reste plus immuablement beau que tout ce qu'on fit dans la suite,—mais l'admirable aujourd'hui, chère Angèle, c'est, malgré la vieillesse des temps, de sentir sa propre jeunesse, d'imposer, malgré tout, celle-ci; c'est là ce qui fait ce qu'on appelle les «renaissances».
15 février 1899.
Chère amie,
Je relève de voyage. Excusez mon trop long silence. Je vous écris sitôt rentré, et, si ma lettre d'aujourd'hui marque encore un peu de fatigue, n'en accusez que le voyage: c'est une grave maladie qui laisse les facultés éblouies, et dont je fais maintenant à Paris une heureuse convalescence.
J'ai vu des villes et des villes encore; croyez un voyageur: Paris est merveilleux. Si parfois je pouvais souhaiter être étranger, ce serait pour le découvrir.—Mais vous l'aimez autant que moi, je le sais, et m'en parliez dans vos dernières lettres de façon à me faire déplorer encore plus mon absence; aussi maintenant c'est fini, je ne voyage plus, chère amie.—Les voyages, d'ailleurs, n'ont qu'un temps; non qu'on se lasse de courir [Pg 114]les routes, mais parce qu'on les sent plus longues que la vie; et parce qu'on se dit que la vie n'est point faite uniquement pour voir, mais aussi pour se souvenir d'avoir vu. Il est un temps pour jeter des pierres, dit l'Ecclésiaste, et un temps pour les ramasser...
Pourtant, si vous partez, prévenez-moi—et surtout n'allez pas en Algérie sans moi! j'en serais malade.
Pourquoi me reprocher encore de ne pas vous écrire des lettres de là-bas? Je vous l'ai dit vingt fois: en voyage, je ne peux pas écrire; cela m'empêche de regarder; et puis je ne veux pas brusquer mes souvenirs, ni les empailler tout vivants. Pourquoi vous obstiner à vous en plaindre? Me faut-il vous citer votre cher Stevenson?
«Ecrire m'est impossible en voyage, dit-il (la lettre est datée d'Avignon). C'est un défaut, mais qu'y faire? Il me faut, pour pouvoir écrire, me sentir un peu chez moi, et ma tête doit avoir le loisir de se mettre en ordre. Les images nouvelles m'oppressent et puis j'ai une fièvre de mouvement...» Et plus loin; «J'aimerais à rester plus longtemps ici; je ne peux pas. Je suis poussé devant moi par une inquiétude invincible...» Ces lignes, ainsi détachées, se fanent comme une fleur coupée; je me doute, en les transcrivant, qu'elles ne [Pg 115]vous diront pas grand'chose; mais songez à cette délicate figure de malade sans cesse exilé, et ces mots «me sentir un peu chez moi» prendront pour vous une saveur singulière.
Je ne professe point pour Stevenson une de ces admirations sans mesure; mais c'est un excellent auteur. Je n'aime pas beaucoup son Prince Othon, que des maladroits veulent faire passer pour son chef-d'œuvre, mais dans ses Nouvelles Mille et une nuits il y a des inventions merveilleuses. Bien des gens ignorent que le Dynamiteur est traduit,—ou bien qu'attendent-ils donc pour le lire? Et l'Ile au Trésor ou même le Club du suicide?—L'absence de pensée est là volontaire et charmante; à l'excellence du récit, l'intelligence fine et vive de Stevenson est uniquement employée; et quel choix de détails! quel tact! quelle aristocratie de moyens! Cela est fin, spécieux, délicat, extrêmement civilisé. Lui reste correct et discret; toujours conteur, acteur jamais; la vie le grise, mais comme un très léger champagne; rien de dionysiaque en cette ivresse, rien de divin; son ivresse est toujours lucide et n'excite que son cerveau; ivresse de salon, de causeur;—vous savez que ce n'est pas la mienne; et je souffre souvent, le lisant, de sentir [Pg 116]que toujours il est resté devant les choses, un peu distant, voyeur amusé, non viveur; je lui voudrais de moins bons yeux et qu'il eût dû s'approcher pour bien voir; il ne se compromet jamais dans quoi que ce soit qu'il raconte; actions hâtives, forcenées, trépidantes, mais sans chaleur; c'est un pirate de cabinet, Kipling, depuis, nous a montré de la sauvagerie plus réelle.
Louons les patients traducteurs! A quelle reconnaissance notre native ignorance des langues étrangères ne nous oblige-t-elle pas envers eux! Peu de jours passent sans que je rende grâces à quelqu'un d'eux;—et principalement à votre excellent ami Davray, qui comble mes vœux en ouvrant une bibliothèque d'auteurs étrangers, au Mercure. Combien de livres sont restés sans lecteurs parce que les lecteurs ne savaient où trouver ces livres! L'ignorance, faute de renseignements, est déplorable; il serait si facile d'y remédier, sinon par une centralisation des livres de même famille, du moins par une bibliographie bien faite.
—Je sais que la question de nationalité littéraire a passionné quelque temps «toute la presse». J'ai peu suivi, je vous l'avoue, cette querelle qui ne m'intéressait [Pg 117]pas grandement. Certains nationalistes, m'a-t-on dit, contestaient jusqu'au droit de traduire ou de lire les étrangers, sous prétexte que ce qui s'y trouvait de non français, d'exotique, était fait pour intoxiquer la France; que la France ne se pouvait assimiler rien qui ne fût déjà français par avance, et que ce qui, dans ces fâcheux auteurs, se pouvait absorber sans péril, c'était toutes qualités que nous n'avions pas su reconnaître en nous-mêmes; que les voisins nous servaient tout bonnement notre bien propre et que si l'on recherchait mieux on trouverait, à tout ce que nous admirons chez eux, toujours une origine française.—La détestable infatuation d'une pareille thèse ne peut pourtant me faire la rejeter trop vite en entier. Je crois en effet que notre littérature est très imparfaitement connue de nous-mêmes, et que les étrangers la connaissent beaucoup mieux que nous ne connaissons la leur. Gœthe, Heine, Schopenhauer, Nietzsche, Ibsen, Dostoïevsky, Tolstoï, tous les grands esprits étrangers ont tenu leurs regards sans cesse tournés vers la France, et beaucoup ont trouvé dans les recoins de notre bibliothèque les germes de pensées qui, développées, exagérées par eux, vont revenir à nous comme de vieux parents reviennent d'Amérique, [Pg 118]partis pauvres, jadis, depuis presque oubliés, maintenant étonnamment riches, mais ne parlant plus notre langue. Il est entendu que c'est un caractère de notre race, de courir trop vite et de laisser tomber en courant toutes les pommes d'or d'Hippomène, dont les nations voisines aussitôt vont s'emparer, comme Atalante... Longtemps avant Jules Lemaître, Viollet-le-Duc disait cela, et je ne pense pas que nul l'ait mieux dit dans la suite:—«Nous cherchons, nous entrevoyons, nous poursuivons le bien, mais nous ne tenons pas à le fixer ... et ainsi courant, haletant, notre jouissance est sans cesse ajournée... Cette disposition, chez nous, amène dans l'étude des arts les plus étranges bévues. Nous émettons un principe qui en fait naître un autre, et ainsi de suite; nous ne poursuivons pas l'application et les développements du premier, nous allons en avant, laissant inachevée l'œuvre commencée; pendant ce temps, un peuple plus calme, ou plus attaché aux intérêts du moment, s'empare du premier principe abandonné par nous, il le développe, l'étudie, en perfectionne les conséquences: or il arrive un jour que ces développements perfectionnés par d'autres se rencontrent sur notre route; nous voilà ravis d'admiration, et [Pg 119]nous mettons autant d'ardeur à imiter les conséquences souvent mal déduites, des principes abandonnés jadis par nous, que nous avions mis d'empressement à en poursuivre de nouveaux. On conçoit combien ces retours étranges amènent de confusion dans les idées, combien il devient difficile de démêler le vrai du faux, l'inspiration de l'imitation au milieu de ces éléments divers. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui tant de peine à savoir ce que nous voulons et ce qui nous convient en fait d'art[1].»
Il y a des gens pour s'étonner sans cesse que l'art et la pensée soient de domaine public. Tous les protectionnismes du monde ne pourront empêcher les paroles, les formes et les sons, de voler par-dessus les frontières comme les oiseaux par-dessus les murs. Toutes les considérations les plus admirablement patriotiques ne me retiendront pas d'être à l'affût de tout ce qui peut paraître d'étrange. J'attends toujours je ne sais quoi d'inconnu, nouvelles formes d'art et nouvelles pensées et quand elles devraient venir de la planète Mars, nul Lemaître ne me persuadera qu'elles doivent m'être nuisibles ou me demeurer inconnues. [Pg 120]Nous sommes loin du temps où La Bruyère disait que tout est déjà dit; nos littératures modernes diffèrent extraordinairement des antiques ... imaginez un Balzac chez les Grecs! un Whitman! un Dostoïevsky!—Qu'est-ce qui va venir après?—ô richesses insoupçonnées! Je vous propose, chère amie, une belle définition du génie: Le génie, c'est le sentiment de la ressource.
Celle de notre race est loin d'être épuisée.
Je vous envoie, avec cette lettre, tout un bouquet de beaux poèmes: lisez-les; une jeunesse active, amoureuse et fervente y respire. Si ce n'est pas là une renaissance, alors, qu'appelle t-on ainsi?—Cela m'emplit de confiance; on lit en eux comme une certitude d'avenir. Et vous verrez que le vieil alexandrin n'est pas mort, quoi que vous en disiez.—Vous me demandez mon opinion sur le vers libre.—En ai-je seulement? On vit si bien sans opinions. A cause des autres, j'ai dû m'en faire quelques-unes; mais c'est à peine si j'y crois; elles me gênent; quand je suis seul, je les renie.
André Beaunier faisait habilement remarquer, dans une conférence récente, comment la poésie, passant [Pg 121]de la littérature grecque à la latine, avait pris soin de remplacer par l'observation stricte des règles, le sentiment poétique qui lui manquait. Peut-être y a-t-il lieu de dire aussi que la rigidité même de notre vers classique et de nos lois prosodiques est la conséquence et le signe du caractère si médiocrement poétique de notre peuple et de notre langue. Il n'y avait poésie qu'à conditions strictes, et de là vint dès lors que ce qu'on appelait «génie poétique» n'était souvent qu'un génie tout verbal, et métaphorique, et rhéteur. En une période comme la nôtre, où le sentiment poétique semble surabonder, et surabonde, c'est parce que les règles prosodiques ne sont plus nécessaires pour soutenir la poésie que certains poètes, suffisamment poètes pour s'en passer, s'en passent.—Le danger vient de ce que peut-être notre langue ne le supportera pas; on ne peut le savoir encore. Peut-être des poètes aussi clairs que Vielé-Griffin, aussi robustes que Verhaeren, nous donnent-ils inconsciemment le change; peut-être n'admirons-nous en leurs nouvelles formes qu'eux-mêmes; peut-être donnent-ils sans le vouloir le coup de grâce à la poésie vraiment française et leur génie, pour un dernier éclat, la détériore-t-il à jamais; peut-être, ne [Pg 122]laissant après eux plus aucune forme banale, aucune forme métrique fixe, arbitraire, disponible, indépendante de l'émotion qui l'emplit, contraindront-ils les faux et médiocres poètes à ne plus oser écrire en vers; et peut-être les vrais poètes eux-mêmes n'écriront-ils plus nécessairement en vers, et le mot poésie ne sera-t-il plus nécessairement synonyme de vers, quand déjà celui de vers est si rarement, en France, synonyme de poésie.—Et peut-être cela sera-t-il très heureux, si la prose d'autant y gagne, si les poètes à venir, héritiers d'aucune forme, mais de la très riche ferveur, de l'intense et diverse émotion de la pléiade d'aujourd'hui, trouvent, plastique à souhait, une langue, prose tant qu'on voudra, mais si belle, si souple, et nombreuse et rythmique enfin, si hardie, sensuelle et soucieuse d'émotion, que le plus poétique génie pourra s'y dire, tandis que les mauvais poètes seuls demanderont encore aux formes surannées la protection, le support et le déguisement de leur débilité lyrique...
Je dis «peut-être» pour ne froisser personne; car l'alexandrin n'est pas mort; mais «la France est le pays de la prose», dit Michelet—et puis je vous ai dit que je n'avais pas d'opinion.
... Mais, je vous en prie, chère amie, ne confondez [Pg 123]pas Art et Vie; certes cela n'est pas le contraire, comme on nous l'a fait croire trop longtemps au Parnasse; mais ça n'est pas non plus la même chose... J'y reviendrai dans ma prochaine lettre. Au revoir.
Paris, 10 mai 1899.
[1] Septième entretien sur l'architecture.
Non, chère amie, je ne discuterai pas avec vous. Il fait trop chaud. Je m'irriterais, et je ne vous persuaderais point.—Vous me demandez, sur le téméraire engagement que je prenais en vous quittant le mois dernier, de différencier Art et Vie. Vous me le demandez parce que vous savez très bien que je n'y arriverai pas.
Par instants on peut croire que l'on se fait des idées nettes sur ces choses, c'est d'ordinaire au sortir de médiocres lectures; on sent alors fort bien de quelles funestes théories le médiocre auteur est victime; par charité, pour excuser l'auteur, on accuse les théories; on feint d'oublier un instant que certains auteurs naissent victimes, et que ceux que précisément n'importe quelle théorie écrase, écrasera, doit écraser, sont aussi ceux-là mêmes qui s'en chargent le plus volontiers, [Pg 125]par une sorte d'instinctif talent de portefaix,—comme si de s'en décharger leur faisait trop froid aux épaules ou comme s'il leur fallait un faix pour marcher droit.
Par instants l'on n'y comprend plus rien du tout.—Ces instants sont les bons.—Si ces questions supportaient une solution définitive, la littérature en mourrait; elle vit d'une confusion momentanée, volontaire ou charmante de ces choses. On se donne beaucoup de mal pour tâcher de fixer et de délimiter ses idées, par une manie toute latine. Les idées nettes sont les plus dangereuses, parce qu'alors on n'ose plus en changer; et c'est une anticipation de la mort.
Il y a eu l'idolâtrie de la mort. S'il nous faut une idolâtrie, préférons celle de la vie.—Mais pourquoi des idolâtries? Notre ferveur est-elle donc si languissante qu'elle ait besoin de se construire des autels? Pourquoi des autels à la Vie? Que signifie la Vie, par elle-même? Pourquoi lui subordonner l'art? comme si l'art était, en face de la vie, un dangereux ennemi à soumettre, qui sinon réduirait la vie. Un rancunier souvenir du Parnasse nous fait-il oublier la médiocre utopie des Goncourt? L'art des Goncourt, autant que celui du Parnasse, est signe d'une diminution [Pg 126]de vie. Ce n'est que lorsque la vie d'un peuple baisse comme une eau se retire, que l'art de ce peuple s'isole, ou qu'il prétend doubler et redire la vie.—Opposer l'art à la vie est absurde, parce que l'on ne peut faire de l'art qu'avec la vie. Mais ce n'est que là où la vie surabonde que l'art a chance de commencer. L'art naît par surcroît, par pression de surabondance; il commence là où vivre ne suffit plus à exprimer la vie. L'œuvre d'art est une œuvre de distillation; l'artiste est un bouilleur de cru. Pour une goutte de ce fin alcool, il faut une somme énorme de vie, qui s'y concentre.
Il y a eu l'idolâtrie de la tristesse. S'il nous faut une idolâtrie, préférons celle de la joie. On disait, il y a cinquante ans:
Beaucoup alors n'osèrent pas être joyeux, ce qui est triste. Le mot d'ordre aujourd'hui vaut mieux, bien que ce soit un mot d'ordre. Les vrais tristes n'en seront pas plus joyeux, mais les joyeux sauront mieux le paraître; et un grand nombre de douteux n'oseront pas paraître tristes,—ce qui leur apprendra le bonheur.
[Pg 127]Je vous ai déjà dit ce que je pensais de l'idolâtrie de la Nature. Ceux qui l'idolâtrent croient trop qu'on sort de la nature sitôt qu'on sort des champs de blé. Laissons cela... Une idolâtrie bien plus grave, que certains enseignent aujourd'hui, c'est celle du peuple, de la foule. Certains voudraient nous persuader qu'il y a profit à se laisser mener par elle, et qu'elle est belle. Marc Lafargue compromet son nom délicieux à louanger le populaire. C'est un poète fort et délicat; sans doute sa naturelle générosité le leurre; je ne puis m'expliquer autrement son erreur. La terre riche et riante où il a le bonheur de vivre nourrit sans doute un peuple confiant et joyeux. Pour moi qui passe depuis mon enfance de longs morceaux d'année dans une pluvieuse province, où le presque unique souci des hommes qui l'habitent est de changer l'abondante eau du ciel en alcool, je ne peux penser comme lui.—Vous parlez d'éduquer la foule; essayez-le; si vous sentez que c'est votre métier, je vais vous trouver admirable, car c'est extrêmement peu le mien. Vous parlez de récitations populaires; certes, l'entreprise est curieuse et vaut la peine qu'on la loue: gloire à MM. Mendès et Kahn, gloire à Sarah Bernhardt, de la tenter! Et je ne m'étonne pas trop que, [Pg 128]dans une société aussi prétentieuse que celle de Paris, on puisse hebdomadairement trouver de quoi remplir une vaste salle de spectacle, avec des gens qui viennent voir réciter, par nos plus illustres acteurs, des vers qu'ils n'ont jamais l'idée de lire; ils trouvent que paraître goûter l'Œuvre d'Art vaut bien quelques heures d'ennui.
O Marc Lafargue! vous dont j'aimais les vers, défiez-vous des foules! Pour aimer bien chacun, séparez-le de tous. Réunis, les hommes perdent ce qu'ils ont de précieusement personnel; ils n'additionnent et ne renforcent que ce qu'ils ont «de même nature»; il n'y a bientôt plus qu'un total monstrueux.—Vous parlez d'émotions propagées et de contagions admirables... Les maladies seules sont contagieuses, et rien d'exquis ne se propage par contact. La communion ne s'obtient ici que sur les points les plus communs, les plus grossiers et les plus vils. Sympathiser avec la foule c'est déchoir.
Je comprends que vous admiriez en la foule le trouble réservoir des énergies futures, mais vous, dont tout l'effort a été de sortir de cette foule et de vous différencier d'elle assez pour pouvoir vous opposer à elle et pour la voir,—que vous veniez vous incliner devant [Pg 129]elle, lui apporter votre œuvre d'art comme un présent, comme un hommage, la lui soumettre ... ô malheureux!
Je hais la foule; elle ne respecte rien; toute tendresse, toute délicatesse, toute justesse, toute beauté s'y faussent, s'y brisent, s'y mortifient; houle mobile, inconsciente, sans cesse à la merci du souffle d'un tribun qui la mène, quand elle est belle, c'est comme une mer en démence; quand je l'admire, c'est du balcon—e terra.
Je hais la foule;—ne voyez pas d'orgueil dans mes paroles: quand je suis dans la foule, j'en fais partie, et c'est parce que je sais ce que j'y deviens que je hais la foule.
Et c'est ce qui rend la question théâtrale si passionnante; c'est que l'œuvre dramatique est, comme nous nous plaisons tous à dire: «faite pour être jouée», pour être livrée à la foule; c'est-à-dire que, dans le livre, elle demeure comme une symphonie sur le papier, virtuelle, lisible seulement pour quelques initiés. C'est, avec toutes les prétentions qu'on voudra, une œuvre qui ne trouve pas sa fin en elle-même, qui vit entre les acteurs et le public et qui n'existe qu'à l'aide de lui... Et pourtant je ne peux considérer le drame [Pg 130]comme soumis au public; non jamais; je le considère comme une lutte au contraire, ou mieux comme un duel contre lui—duel où le mépris du public est un des principaux éléments du triomphe. La grande erreur de nos dramaturges modernes est de ne pas mépriser suffisamment leur public. Il ne faut pas chercher à l'acquérir, mais à le vaincre. Un duel, vous dis-je, et d'où le public sorte et battu, et content.
Je ne vais pas souvent au théâtre; l'ennui que j'y goûte est souvent infini. Rarement, surtout quand je n'ai près de moi personne avec qui causer, rarement je peux prendre sur moi d'attendre jusqu'à la fin du spectacle, où je ne sais ce qui me gêne le plus: de l'admiration benête de mes voisins, du jeu factice et sans art des acteurs, ou des informes pièces qu'on nous sert aujourd'hui.—Pourtant, grâce à vos conseils toujours bons, j'ai voulu voir Hamlet ... je n'ai vu que Sarah Bernhardt.
Des artistes dont je respecte la science sûre et le goût fin m'avaient tant dit et répété que Sarah était excellente, etc.,—que pendant quelques jours, plutôt que de n'être pas de leur avis, j'ai préféré croire que j'étais, par un malchanceux hasard, tombé sur une de ces représentations extraordinaires où les acteurs jouent [Pg 131]comme si vous n'étiez pas là... Mais non; tout était volontaire et appris. Causant depuis avec les uns et les autres, j'ai dû comprendre que la grande Sarah n'était pas différente pour exalter les uns et pour m'exaspérer.
Je sais qu'il se produit dans une salle de spectacle des zones torrides et des îlots de froideur. Peut-être, auprès de moi, eussiez-vous donc trouvé Sarah moins bonne; peut-être auprès de vous l'eussè-je donc trouvée moins détestable. Combien de fois la crainte d'être appelé à donner mon avis en sortant m'a-t-elle fait fuir théâtres ou concerts.
—Comment trouvez-vous que *** ait dirigé la 9e?
—Ne préfériez-vous pas X ou Z?
Ces questions tuent. Mon cerveau a ceci de cruel qu'il ne fonctionne jamais si peu que devant une pure œuvre d'art. L'enthousiasme ou la contemplation ont pour premier effet chez moi l'inhibition délicieuse et vraisemblablement divine de mes facultés critiques... Je dois vous avouer que devant Sarah Bernhardt il n'y a pas eu d'inhibition du tout. Au contraire, mes facultés critiques ont seules profité de la pièce, et, vous l'avouerai-je, mon amie, malgré la remarquable traduction de Schwob, Hamlet m'a ennuyé à périr, et je [Pg 132]n'y ai quasiment plus rien compris. Il me paraît même possible que je n'y eusse plus vu qu'un médiocre mélodrame, si, Dieu merci, je n'avais pas connu la pièce par avance.—Telle que la joue Sarah, la pièce, dès le troisième acte, change de sujet... Eh quoi? n'aimez-vous pas Hamlet? Ou quelle étrange idée vous faites-vous de ce rôle pour avoir pu vous satisfaire d'une telle interprétation?—Je vous en parlerai longuement, mais le temps aujourd'hui me manque; j'y reviendrai.
Au revoir, je vous laisse Paris. S'il en paraît de bons, envoyez-moi des livres.
Paris, 15 Juin 1899.
En post-scriptum à cette lettre, et simplement pour opposer une interprétation, que je crois juste, à beaucoup d'interprétations récentes, que je crois fausses, et tout particulièrement à celle de la grande Sarah, qui prétend ne voir dans Hamlet que le type de «l'homme résolu»—je transcris ici quelques notes prises au lendemain de la représentation:
—«Un caractère résolu» prétend-elle trouver dans Hamlet ... «résolu», oui; mais réfléchi. Et tandis qu'Othello agit avant de penser, celui-ci pense avant d'agir. Il pense au lieu d'agir; il est distrait de l'action par la pensée.
Au début du drame que voyons-nous?—Un homme inscrire sur les tablettes de son carnet et au plus profond de son [Pg 133]cerveau qu'il a quelque chose à faire: venger son père. «Oui, pauvre ombre, je veux du registre de ma mémoire effacer tous les souvenirs vulgaires et frivoles, toutes les maximes des livres, toutes les formes, toutes les impressions ... et ton ordre vivant remplira seul les feuillets du livre de mon cerveau, fermé à ces vils sujets.»
Va-t-il agir?—Non. Il réfléchira:
Doit-il se fier au récit d'un fantôme? Il s'agit de contrôler d'abord.—Et dès lors l'action (j'entends: la vengeance) passe au second plan, se recule. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'action, c'est une raison d'agir. Il invente l'épreuve du spectacle. Il expérimente; il essaie: et le voilà qui, peu à peu, se distrait de l'action par les moyens mêmes qu'il employait pour se pousser à agir. A ce point que, dans le quatrième acte, à peine est-il question de père à venger, mais bien d'Ophélie, de Laërte, et de généralités vagues où toute décision se perd. C'est là ce qui vous faisait dire qu'Hamlet avait «changé de sujet».—Non; car le sujet c'est: la distraction de Hamlet.
Et il faudrait alors que, par une habile gradation, qui est dans la pièce, l'acteur force le spectateur de penser: Mais le malheureux! il oublie ce qu'il devait faire! il oublie!—Oui: et l'action sinon le sujet bifurque, et l'intérêt semble changer. Les moyens d'action ont pris la place de l'action même, à ce point qu'il ne faut rien moins que l'angoisse d'une mort imminente pour rappeler à Hamlet son devoir. Alors, soudain, de nouveau, tout disparaît. «J'avais une chose à faire; je ne l'ai pas faite,—et je meurs!...» Monnet, qui certes ne nous satisfaisait pas toujours durant le cours de la pièce, devenait alors, et brusquement, superbe. Chez cet homme qui, durant quatre actes, balançait et ne pouvait se décider à tuer il y avait une soudaine rage atroce, une ruée, comme une fringale d'action après ces quatre actes de jeûne; il agissait: il agissait soudain beaucoup trop: il tuait [Pg 134]le roi trois fois, oui, trois fois de suite, en forcené qui ne tuera jamais assez. Il le crevait de coups d'épée: il lui enfonçait dans la bouche le bord de son hanap empoisonné; il l'écrasait à coups de bottes.—Réfléchir quatre actes durant, pour en arriver là!... C'était une action stupide, irraisonnée, frénétique, et maladroite encore, autant que celle qui tuait Polonius, affolait Ophélie, torturait inutilement la reine et démoralisait Laërte. Oh non! pas l'action d'un «homme résolu», mais celle de quelqu'un qui n'était pas né pour agir, et à qui Horatio saura dire: «Vous auriez pu naître poète.»
Chère Angèle,
J'aurais plus de plaisir à vous parler de l'Exposition si déjà M. Verhaeren n'en avait si excellemment parlé dans le Mercure. J'aime son optimisme flagrant; il a parbleu le goût tout aussi fin qu'un autre, que M. de Gourmont par exemple, et sait être choqué par les hideurs; mais tandis que celui-ci s'y attarde et leur donne précisément l'importance de ses sarcasmes, celui-là passe (ce qui est la plus simple façon de mépriser) et réserve sa vie pour admirer ce qui pourtant reste admirable. Affaire de tempéraments.
De tout ce que j'ai vu dans cette foire, un souvenir domine. Près de lui pâlissent les autres, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour, le ravivant par ma parole, le mieux défendre contre mon propre oubli;—aussi [Pg 136]pour que vous regrettiez un peu de n'avoir pas parfois épousé ma folie, surtout lorsqu'elle me menait, comme elle fit souvent, au théâtre de la Loïe Fuller, pour y voir jouer la troupe japonaise. De ne l'avoir pas vue, je comprendrais que vous fussiez inconsolable, si elle ne nous avait déjà donné l'espoir de reparaître à Paris dans deux ans.
Elle n'a guère joué que deux pièces: «la Geisha et le Chevalier», puis «Kesa». Il s'ajoutait à l'excellence de l'interprétation cet intérêt bizarre: l'actrice unique de la troupe, Sada Yacco, était, prétendait-on, la première femme qui jamais au Japon eût monté sur les planches. Bien mieux: certains très renseignés affirmaient que jamais encore elle n'avait paru au Japon même, mais que dès son retour là-bas on la présenterait à l'empereur. Sa carrière se serait décidée d'une façon subite: durant une tournée que la troupe faisait, en Amérique je crois, un soir, tout brusquement, le jeune acteur chargé du rôle de la Geisha tomba malade. Allait-il falloir désappointer la salle? la femme de l'acteur principal, Kawa Kamy, se proposa; elle savait le rôle, disait-elle, elle le jouerait sans erreurs, et le public non averti ne s'apercevrait même pas du scandale; sur la scène, une femme tenir un rôle de femme!...
[Pg 137]Qu'elle eût été d'abord admirable, c'est ce qu'on ne saurait affirmer, tant son jeu semble appris, modéré, retenu. Il offre, avec le jeu des coacteurs, une adaptation si parfaite, que le geste de l'un semble mourir toujours où commence le geste de l'autre, de sorte que, dans le dialogue, aucun aléa n'est laissé et que l'expansion de chacun se tempère selon celle de tous les autres et la limite à son tour strictement. Une perpétuelle vision de l'ensemble ne permet à chacun que son temps, que sa place, de même que dans un concert, tout le lyrisme du soliste se soumet au besoin précis de la mesure.
Aussi ne puis-je dire que c'est Sada Yacco que je trouve uniquement admirable, mais bien toute la troupe, vraiment.
Le rideau s'ouvre. On est je ne sais où, dans le Japon. Une toile de fond montre le faîte des maisons d'une rue dont les arbres fleuris font un square. On est dans un quartier de plaisir que les courtisanes habitent.
Un seigneur se paie le spectacle d'un mime; il s'évente distraitement, tandis que le mime s'évertue devant lui. Le mime est excellent, le seigneur excellent; nous verrons plus pathétique ensuite, nous ne verrons rien de meilleur.
[Pg 138]Quand la danse du mime est finie, la Geisha passe; elle est vêtue à la façon des courtisanes, richement, mais avec un goût délicat. Sa démarche est gênée et sa taille grandie par de hauts souliers de bois, que d'ailleurs elle n'aura plus à son apparition prochaine. Le désœuvré seigneur s'empresse, offre son bras, veut le faire accepter de force. La courtisane le repousse, et passe, et se retourne en souriant.
—Je suis retourné six fois voir cette pièce, à des intervalles assez grands: ce sourire est un des rares gestes dont la fine et presque imperceptible détérioration progressive montre, à qui sait bien voir, le mal que fait à l'œuvre d'art un sot public, ses incompréhensions et surtout ses louanges.
La Geisha revient bientôt au bras de son amant de cœur. Il tient une branche d'amandier fleuri; il paraît heureux autant qu'elle.—Le seigneur repoussé les voit, les arrête, les sépare; il insulte, provoque l'amant. Une courte lutte s'engage; les sabres sont au clair;—le rideau tombe.
Il se relève sur l'antichambre d'un temple. L'amant du premier acte est, paraît-il, fiancé; la Geisha le poursuit; c'est pour éviter sa colère amoureuse qu'il a fui dans le pays jusqu'à ce temple; il arrive avec sa [Pg 139]fiancée; elle et lui vont y prendre refuge.—La scène, après qu'ils sont entrés dans l'intérieur du temple, reste occupée par cinq bonzes bizarres, types, je pense, traditionnels comme les apothicaires au temps de Molière. Ils sont oisifs, niais, couards et fantoches assez pour ne pouvoir, à cinq, garder la porte du temple lorsque la Geisha tout à l'heure va venir pour y pénétrer. Car elle a découvert la retraite de l'amant et de la rivale. Et d'abord elle s'y prend par la douceur; et repoussée d'abord, demande aux bonzes la faveur de danser devant eux pour le dieu.—Cette danse commence lente et grave; puis s'anime; la Geisha tout entière y paraît, avec ses docilités langoureuses, ses souplesses de courtisane, avec aussi les sursauts brusques, les élans de l'amante passionnée. Cependant les gardiens, séduits au début, se reprennent, et devant sa croissante insistance, la repoussent enfin assez brutalement. Elle revient; sa passion fait sa force; elle envoie, en quelques coups de reins culbuter les gardiens du temple, et pénètre tragiquement.
Dans cette scène, où, dépouillant de minces robes superposées, trois fois elle se métamorphose, Sada Yacco est merveilleuse. Elle l'est plus encore lorsqu'au bout d'un instant, parmi le désarroi que vient [Pg 140]de causer sa violence, elle reparaît, pâle, les vêtements défaits, les cheveux tombants, les yeux fous. La pauvre fiancée cependant a pu réoccuper la scène; les bonzes la protègent, l'entourent, et, dans son égarement, la Geisha ne la voit pas d'abord. Mais, dès qu'elle l'a vue, sa fureur, l'acharnement contre cette victime misérable, que défendent en vain les gardiens, sa lutte enfin contre le prêtre survenu, ses efforts insensés où sa passion et sa vie s'exténuent ... je n'irai pas chercher comparaison bien loin, chère Angèle: ce fut beau comme de l'Eschyle.
Oui, Sada Yacco nous donna, dans son emportement rythmique et mesuré, l'émotion sacrée des grands drames antiques, celles que nous cherchons et ne trouvons plus sur nos scènes. Car aucune inharmonie dans ses gestes que scande et rythme un lyrisme constant; aucune nuance inutile, aucun détail; ce fut d'un paroxysme très sobre, comme celui des hautes œuvres d'art, que domine et que se soumet une supérieure idée de beauté, Sada Yacco ne cesse jamais d'être belle; elle l'est d'une manière continue et continuellement accrue; elle ne l'est jamais plus que dans sa mort, toute droite et toute raidie, dans les bras de l'amant qu'un si farouche amour a reconquis, et qui la touche et qui la presse, [Pg 141]mais qu'elle ne reconnaît pas d'abord, tant la tendresse et la douceur ont déjà déserté son âme; mais quand elle comprend à la fin que c'est lui qui la tient dans ses bras, tandis que déjà la mort les sépare, elle pousse un grand cri d'étonnement d'amour, puis retombe épuisée, ayant fini de haïr et d'aimer.—C'est à vrai dire le seul cri qu'elle pousse dans toute la pièce; et même ce suprême cri d'amour est tempéré; il arrive admirablement et simplement satisfait une attente, une attente très préparée. (Les acteurs, même dans les instants de plus grande fureur tragique, parlent à voix très maintenue; ils ne donnent jamais toute leur voix; jamais ils ne «donnent de la voix».)—Et je me réjouissais qu'il soit encore ici bien prouvé que: l'œuvre d'art ne s'obtient que par contrainte, et par la soumission du réalisme à l'idée de beauté préconçue.
C'est pour vous redire cela que je vous écris cette lettre; mais je vous connais bien; vous lirez peut-être ma lettre, mais sauterez par là-dessus. Tant pis.
Chère Angèle,
Excusez mon silence de deux mois; je voudrais le prolonger encore, en prolongeant l'été qui le causa. Et je m'attarde où il s'attarde, dans un petit repli des Cévennes; après le temps affreux de Normandie, la chaleur y paraît plus belle, et je ne croirais pas à l'hiver sans la chute des feuilles lassées, sans l'abandon des champs et sans mon désir de la ville.
J'ai pu revoir, avant de m'exiler ici, les grands champs plats de la Seine-Inférieure, qui, fauchés, nous rappelèrent le désert, à cause aussi des oasis qu'y forment au loin les hêtraies.
Est-ce à ces vastes horizons, à des conditions économiques différentes, que l'on doit le repos de voir à quelque cent kilomètres à peine du Calvados d'où je [Pg 143]revenais attristé, des paysans, de même race je suppose, mais non plus perdus de richesse et de paresse et d'alcool, mais laborieux, graves, décents et prolifiques, Sous le ciel léger du Midi, la différence est bien plus grande encore; je comprends volontiers ceux de Toulouse ou d'Aix, qui, n'ayant point quitté leur soleil radieux, parlent du peuple comme j'en parlerais, je pense, si je vivais toujours au milieu d'eux.—Oui certes, je crois le théâtre du peuple possible; mais cela dépend des contrées. Le malheur est que là où il pourrait faire le plus de bien, c'est là que son établissement est le plus difficile.—Riante terre du Midi, donne-nous de nouveaux exemples! De loin on peut traiter cela de chimères: on se rapproche et l'on y croit.
Dans la campagne des environs de Nîmes, je retrouve un simple jardinier qui baptise sa chienne Corinne par enthousiasme pour le livre de Madame de Staël.—En Normandie, on ne se réjouit de rien d'humain sans être dupe. Votre ami Raymond Bonheur vint m'y voir:
—Quelle excellente idée vous eûtes, me dit-il, de nommer votre poulain Chopin. Comme cela convient à sa grâce!
[Pg 144]—Oh! lui dis-je, ne m'attristez pas. Je ne fus pour rien au baptême, et ne peux rien à rien, ici. S'il s'appelle Chopin, c'est que sa mère s'appelait Chopine; voilà tout.
—A Magny, dit Bonheur, je m'émus d'un petit garçon, parce qu'il s'appelait Virgile. Qui t'a nommé ainsi, lui demandai-je?—C'est ma marraine.—Et pourquoi?—Parce qu'elle s'appelle Virginie.—Ne vous plaignez donc pas; vous voyez que c'est partout la même chose.
—Eh bien, non! cher Bonheur: dans le Midi, ce n'est pas la même chose; c'est pourquoi j'aime le Midi.—Vous pensez bien qu'il m'est assez indifférent que cette chienne ou cette jument près de moi s'appelle ou Corinne ou Chopine; mais un pays où l'homme ne songe pas uniquement à s'enrichir et s'alcooliser me paraîtra toujours un beau pays, et que j'envie.—Que des fêtes comme celles de Béziers y aient été possibles, voilà qui dit un pays admirable. Verrons-nous donc revivre enfin, ailleurs qu'en des musées, l'art pour qui nous vivons, mais de qui nous portions le deuil? De peur de trop me désoler après, je doute encore, et retiens encore ma joie. Le seul récit des belles fêtes de la Grèce nous a laissé de si mortels regrets!...
[Pg 145]Je reçois le Pays de France, l'Effort, et je m'attriste; il y a là un malentendu. M. Nadi s'indigne de ce que j'écrive: «Sympathiser avec la foule, c'est déchoir.»—Où j'écrivais foule il a cru lire peuple, je pense; pourtant, entre foule de peuple et foule de bourgeois, ma sympathie irait plutôt vers la première; vous le savez, vous du moins, chère amie, et cela me console.—C'est en elle (la foule), dit M. Nadi[1], que nous chercherons le démenti le plus éclatant à de telles paroles; ... notre œuvre, nous avons la certitude qu'elle la comprend, l'aime et l'attend.—Je suis tout au contraire heureux de faire partie de cette foule qui attend l'œuvre de M. Nadi.
Mais ce n'est pas ce malentendu que je veux dire. L'autre est plus grave, car il n'est pas à mon sujet. Et [Pg 146]ce n'est pas non plus de M. Nadi seul qu'il s'agit; si je parle de lui plus que d'un autre, c'est qu'aussi bien son article est meilleur, et que lui-même semble riche de promesses; il le dit un peu fort,—mais comment ne pas croire pleins de promesses des jeunes gens qui écrivent si exactement comme nous eussions pu écrire à vingt ans?
Tant que M. Nadi parlera, passe encore; il parle bien; mais quand ce sera quelqu'un d'autre... Ecoutez d'abord M. Nadi:
Elle (la Race) connaîtra le frisson de notre foi. Elle appellera avec nous les délices d'un jour nouveau. Nous l'entraînerons dans cette adoration consciente de l'Univers, depuis l'atome jusqu'à l'Humanité.—Cela va bien, oui; mais cela va bientôt se gâter.—Je continue?...
Oh! devant Elle (la Race), nous éprouverons avec puissance l'ivresse de posséder la Vérité.—Cela va se gâter, vous dis-je.—Nous célébrerons l'Essence, la Forme éternelle et universelle, etc., etc... Tout cela c'est de M. Nadi.
Ah! l'on s'étonnera peut-être de la puissance de notre lyrisme!...—Non, M. Nadi, non; au contraire, j'ai peur qu'il n'ait pas de puissance, votre lyrisme. Il faut [Pg 147]tant de lyrisme pour faire une œuvre d'art,—et tant d'autres choses avec! J'ai peur que, loin de faire œuvre d'art, votre lyrisme n'enfante ceci, par exemple, que je m'en vais vous lire, dans l'Effort de Toulouse:
La Raison n'est qu'une forme, mais par elle l'homme devient Dieu, ou plutôt s'achemine vers Dieu, car il le sera un jour, il faut le croire, alors que son cerveau omniscient embrassera le monde entier et que, d'un geste, il guidera les phénomènes de Vie et de Mort. Et sur ce point je vous renvoie à Ernest Renan et à Joachim Gasquet(?). Prisonnières de notre substance nerveuse, les sensations acceptent l'ordre que leur imprime Dieu. Avec un arsenal de méthodes, l'homme s'empare de l'Univers. Il faut relire Descartes (Le délicieux Descartes, disait Bouhélier). Il faut relire Taine et Claude Bernard (Plus loin l'auteur l'appellera Bernard tout court). Je lisais récemment la Synthèse chimique de Berthelot et le livre de Duclaux sur Pasteur... Quel merveilleux monument que celui des sciences chimiques! Analyse, décomposition des éléments et des principes immédiats, isométrie, analyse par décomposition graduelle, synthèse.—Et l'auteur ajoute: Les autres méthodes de Dieu sont plus connues. Vous me permettrez donc d'en sauter. Je reprends plus [Pg 148]loin: Depuis longtemps Aristote a dit que la beauté est l'ordre. Dès lors l'art est frère de la science et ne se sépare plus d'elle...—Plus loin cette note effarante: Il y a beaucoup à dire là-dessus; j'y reviendrai dans mon prochain article.—Et plus loin: En tout et pour tout il s'agit de méthode. Ainsi de la politique. Le citoyen, la République, autant de mots très beaux qui viennent confirmer notre thèse. Imprimez donc un rythme à la Société. Ne négligez aucune puissance.—Et plus loin encore: Permettez-moi de rêver un peu.—Mais je vous en prie, faites donc.
S'imaginer qu'au bout de tout cela va poindre une œuvre d'art, voilà le malentendu, chère amie. Certes j'applaudis de toutes mes forces à l'entreprise d'un théâtre populaire (quand ce ne serait que pour nous tirer de la médiocrité des autres),—mais gare aux pièces que l'on va nous écrire pour lui! Les théories humanitaires nous préparent, je le crains, une littérature déplorable.—Pourquoi?—Parce que «méfiez-vous, dit Diderot, de celui qui veut mettre de l'ordre. Ordonner, c'est toujours se rendre le maître des autres en les gênant.» C'est son œuvre que l'artiste doit ordonner, et non le monde qui l'entoure; car l'ordre extérieur rend celui de l'œuvre dramatique impossible.
[Pg 149]Mais que sert de parler? Ils n'écouteront pas.—Et c'est moi qui les écouterai m'appeler, moi et d'autres, esprits craintifs, âmes pondérées, n'ayant eu jusque-là aucun contact avec nous,—et cela au nom de la Vie, de la Joie dont ils se disent déjà dispensateurs. Les poèmes de Griffin, les Nourritures Terrestres, les poèmes de Henri Ghéon, etc., ont pourtant précédé, non suivi leurs dires; s'ils le savaient un peu plus, peut-être écouteraient-ils un peu plus nos paroles et comprendraient-ils mieux que, si nous leur crions: fausse-route! c'est au nom même des dieux qu'ils nomment et dont aussi la religion délaissée nous réunit à quelques-uns dans l'Ermitage. Et c'est au nom de l'œuvre d'art qu'ils veulent faire—et qu'il faudra réinventer complètement, car notre littérature a désappris le goût du beau et en a perdu le souci.
Pour la musique et la peinture, nous sommes certes moins à plaindre—et pourtant combien le ciel s'assombrit de la seule mort d'un Puvis!—Le ciel de notre littérature est resté sombre assez longtemps. Du côté de l'occident, plus rien n'y luit beaucoup; mais l'orient [Pg 150]s'emplit de lueurs. Un extraordinaire silence semble creuser l'espace entre le siècle mort et celui qui commence, comme il se fit entre le xviie siècle et le suivant. Malgré son œuvre déjà grande, Verhaeren pas plus que Moréas ni que Griffin n'est de la génération passée, sans quoi je n'eusse pas dit que notre ciel était si sombre. Régnier, plus différent de nous peut-être, maintient le goût d'une langue si pure, que c'est à lui que je voudrais aller comme à un maître, s'il était plus âgé, ou si j'étais plus jeune.—Chère Angèle, dites aux jeunes gens du Pays de France et de l'Effort que nous, tout autant qu'eux, c'est l'œuvre d'art que nous voulons: que c'est vers elle que nous marchons, et qu'ils se trompent en croyant notre but opposé ou nos routes divergentes. Répétez-leur ce vers du Dante:
Adieu.
[1] Comme je le montre plus loin, ce n'est pas procès de personnes, mais de tendances que je veux faire. M. Nadi nous a écrit, sitôt après cet article, la plus aimable des lettres; si notre modestie se refuse à la citer en ce lieu, je veux au moins que nul ne mette en doute l'impersonnalité de mes accusations.
Chère Angèle,
Aujourd'hui, je ne vous enverrai qu'un livre; et ce livre en vaudra beaucoup: Voici les Mille et une Nuits, que le Dr Mardrus vient de traduire, et de rebaptiser avec une pointe d'arabisme: Les Mille Nuits et une Nuit.
Vous savez mon admiration pour ce livre. Mon père qui l'admirait aussi le mit entre mes mains de si bonne heure que c'est, je crois, avec la Bible le premier livre que j'ai lu.—Mais je pense que, si, seule, la traduction de Mardrus eût alors existé, mon père eût choisi, pour m'y apprendre à lire, un autre livre. A peine osai-je vous le donner. Il faut bien, pour m'y décider, la tranquille assurance de la préface, dans laquelle le traducteur se fait garant de la naïveté et de l'ingénuité du conteur.
On m'avait mis en garde contre Galland, dit et redit [Pg 152]qu'il prenait dans sa traduction toutes les libertés qu'il enlevait aux contes; à défaut de Burton, dont j'ai l'ennui de ne comprendre pas la langue, j'avais pu lire la version allemande de Weil et me rendre compte que celle de Galland respectait bien plus Louis XIV que le grand sultan Schahriar; que Galland omettait systématiquement (entre autres choses) les citations poétiques qui surabondent dans le récit, en sont une des particularités merveilleuses, et pourraient, réunies, former une très importante anthologie.
Les critiques contre la traduction de Galland sont faciles. Elles sont inutiles aussi. Il s'agissait à cette époque de réduire au bon goût français les ouvrages qu'on prétendait traduire. Près de cinquante ans plus tard, l'abbé Prévost écrivait en préface de sa traduction de Grandison: «J'ai supprimé ou réduit aux usages communs de l'Europe ce que ceux de l'Angleterre peuvent avoir de choquant pour les autres nations.» Et le biographe de Prévost ajoute: «Son goût était trop sûr pour se borner à traduire son original.» Galland avait aussi «le goût trop sûr».—Ces phrases font sourire aujourd'hui; mais on oublie trop que, sous Louis XIV, les Français avaient plus de droit que nous n'avons d'être infatués de la France.
[Pg 153]La langue de Galland est plaisante, douce à lire, classique encore et souvent non sans grâce. Son orientalisme affaibli garde un charme. Enfin peut être sa traduction n'était-elle pas inutile à titre d'initiation préparatoire. Celle de Mardrus[1] d'abord eût pu surprendre et rebuter. Galland fut comme l'étuve tiède qui précède, dans un Hammam, la salle torride. Et, tandis que Galland, à la manière de son siècle, recherchait dans ses contes avant tout l'émotion générale et la part qu'il croyait être commune à tous parce qu'il la sentait être semblable à lui, Mardrus, lui, se plaît au contraire (et nous nous plaisons avec lui), à l'étrange, à la différence; ou mieux, il ne se plaît à rien qu'à une traduction très fidèle, et, si la vie de ces contes va différer de notre vie, c'est par toute l'ardeur et la saveur orientale qu'il leur laisse. Ah! l'habile Mardrus! Ah! vive Mardrus! Ah! merci! Ici l'on exulte; on éclate; on s'enivre par tous les sens.
Que la sensualité de Galland paraît pâle! Le bol «plein de grains de grenade apprêtés au sucre, aux amandes décortiquées, et parfumés délicieusement et juste à point» que le faux pâtissier Hassan prépare [Pg 154]pour le petit Agib, et auquel il ajoute encore, lorsqu'on lui redemande de ce plat, «un peu de musc et d'eau de roses»; ce plat exquis par lequel Hassan se laisse inespérément reconnaître, devient chez Galland «une tarte à la crème», bonnement. Et dire que déjà les «confitures sèches» qu'on y goûte me faisaient rêver! qu'eût-ce été si j'avais ouï parler de la «boisson délicieuse et parfumée aux fleurs»? si j'avais lu: «Elle m'offrit à boire du sirop au musc»?—Car ce qui ressort avant tout de cette traduction si nouvelle, ce n'est pas l'invention prodigieuse de ces contes, pour laquelle je garde une inlassable curiosité mais que, plus ou moins, nous connaissions déjà,—c'est la sensualité splendide, persistante, indécente, et mêlée de rires. Permettez-vous que je cite? «. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Non; décidément, je n'ose pas citer.—Mais il y a d'autres passages; par exemple ces vers si moqueurs et charmants «sur l'excellence des pâtisseries arabes», ces vers que le troisième calender (il s'appelle ici: saalouk), métamorphosé en singe, écrit pour révéler qu'il est un homme,—et l'on ne saura ce dont on doit s'étonner le plus: ou de son lyrisme subit, ou de la subtilité de sa gourmandise:
[Pg 155]«O pâtisseries, douces, fines et sublimes; pâtisseries enroulées par les doigts! Vous êtes la thériaque, antidote de tout poison! En dehors de vous, pâtisseries, je ne saurais aimer jamais rien; et vous êtes mon seul espoir, toute ma passion!
O frémissements de mon cœur à la vue d'une nappe tendue ou, en son milieu, s'aromatise une Kenafa (ici une note nous apprend que la Kenafa est «une sorte de pâtisserie faite avec des filets très fins de vermicelle») nageant au milieu du beurre et du miel, dans le grand plateau!
O Kenafa! Kenafa amincie en une chevelure appétissante, réjouissante! mon désir, le cri de mon désir vers toi, ô Kenafa, est extrême! Et je ne pourrais, au risque de mourir, passer un jour de ma vie sans toi sur ma nappe, ô Kenafa, ya Kenafa!
Et ton sirop! ton adorable, délicieux sirop! Haï! en mangerais-je, en boirais-je jour et nuit, que j'en reprendrais dans la vie future!»
—Je ne sais pas, chère amie, ce que ces strophes valent dans le texte; dans la traduction de Mardrus, je les trouve parfaitement merveilleuses.
Cette traduction abonde d'ailleurs en passages exquis. Écoutez cette courte phrase: «Par Allah! notre nuit va être une nuit bénie, une nuit de blancheur!»—Mais [Pg 156]c'est de sensualité que je voulais vous parler. Le mot «sensualité» est devenu chez nous de signification si vilaine que vous n'osez plus l'employer; c'est un tort; il faudra réformer cela. Sachez que Coleridge, à propos de Millon, fait de la sensualité une des trois vertus du poète. La sensualité, chère amie, consiste simplement à considérer comme une fin et non comme un moyen l'objet présent et la minute présente. C'est là ce que j'admire aussi dans la poésie persane; c'est là ce que j'y admire surtout.—Car la littérature persane presque entière m'apparaît pareille à ce palais doré, dont il est raconté, dans le récit d'un des trois saalouks, que les quarante portes ouvrent, la première sur un verger plein de fruits, la seconde sur un jardin de fleurs, la troisième sur une volière, la quatrième sur des joyaux entassés ... mais dont la quarantième défendue, ferme une salle très obscure dont l'atmosphère saturée d'une sorte de parfum très subtil vous soûle et vous fait défaillir; une salle où l'on entre pourtant, où l'on trouve un cheval très noir, qui n'a l'air qu'étrange et que beau, mais qui, dès qu'on l'enfourche, déploie des ailes, des ailes «qu'on n'avait pas d'abord remarquées»,—qui bondit avec vous, vous enlève au plus haut d'un ciel inconnu; puis brusquement [Pg 157]s'abat, vous désarçonne, et puis vous crève un œil avec la pointe de son aile, comme pour marquer mieux l'éblouissement que laisse ce rapide voyage en plein ciel.—C'est ce cheval noir que les commentateurs d'Omar et de Hafiz appellent «le sens mystique des poètes persans». Car on affirme qu'il y est. Pour moi qui n'apprécie que peu cette équitation aérienne, ni surtout la demi-cécité qui la suit, plus sage que le troisième saalouk, je n'ouvre pas la porte défendue et préfère m'attarder encore dans les vergers, et les jardins et les volières. Je trouve là quelques voluptés si intenses qu'elles suffisent pour désaltérer mes désirs et pour endormir ma pensée.
Ne lisez pas Omar Kheyam dans la traduction française de Nicolas: elle est littérale, il le dit; mais la traduction anglaise de Fitz-Gérald est bien autre chose et bien plus: elle est belle. Dans son texte excessivement resserré, chaque quatrain prend un sens et un poids admirable. Aussi déçu que l'Ecclésiaste, lyrique à la façon du Cantique de Salomon, et pondéré comme ses Proverbes, Omar Kheyam, à travers Fitz-Gérald, paraît un poète admirable[2].
[Pg 158]Pour Hafiz, si vous ne pouvez vous procurer la très rare de Rosenzweig, lisez-le dans la traduction de Hammer; c'est celle qui, en 1812, révélait l'Orient au grand Gœthe. Voyez dans ses Annales avec quelle admiration il en parle.—Plutôt que de vous en parler à mon tour, laissez-moi vous transcrire un de ces courts ghazels: le voici tout entier:
Il est assurément très ridicule de traduire une traduction: mais que ne savez-vous l'allemand?—ou que ne sais-je le persan?
Vous pouvez lire en français le Gulistan de Sadi et Firdousy tout entier;—je ne vous cache pas que je préfère Omar et Hafiz.
Pardonnez-moi d'oser parler ainsi d'une littérature que, malgré tout mon amour pour elle, je connais peu. Je la connais peu, mais je l'aime beaucoup; que cela me serve d'excuse. Et puis j'écris pour qui la connaît encore moins.
[1] Le livre des Mille Nuits et une Nuit. Traduction complète par le D. J. C. Mardrus.—Fasquelle.
[2] Une remarquable traduction d'Omar a paru l'an passé chez Carrington. Elle est de M. Ch. Grolleau.
[3] Hammer, II, p. 426.
Chère Angèle,
Que votre palais délicat excuse un tel pâté d'arêtes: Voici le livre de Stirner l'Unique et sa propriété[1], que M. Lasvignes vient de traduire,—avec quelle patience, vous en jugerez par celle qu'il faut pour le lire.
Du temps de Jean-Paul Richter, ce qu'on appelait l'Unique, c'était lui—lui Jean-Paul, et c'était assez.—Vous souvient-il qu'en le lisant, nous nous disions: quelle chance qu'il soit Unique! S'il devait y en avoir beaucoup comme lui, le monde des lettres ne serait plus tenable... Hélas! ô mon unique Angèle! l'Unique de M. Max Stirner est légion!—Unique, il ne l'est [Pg 161]plus d'ailleurs que pour lui-même: c'est sa seule «propriété»; l'Unique, c'est moi, vous, Tityre; l'Unique, c'est chacun pour soi.
Voilà ce que M. Stirner expose en un livre de près de 500 pages; et il ne faut pas dire: l'Egoïsme, nous le connaissions déjà; ce serait mal entendre le jeu du philosophe: nomenclateur, sa mission n'est pas d'inventer; n'en déplaise au grand Nietzsche, le philosophe ne crée ni ne déplace les valeurs: simplement il légitime et enrôle ce que des tempéraments neufs et robustes lui proposaient. L'homme propose; le philosophe dispose. L'Unique et sa propriété, c'est l'égoïsme bien disposé.
Au cours des 500 pages, pas un accroc, pas un trouble, pas une rencontre; le livre est laid, ressasseur, comble et vide. C'est un livre de ruminant.
Et je ne vous en parlerais même pas, chère Angèle, si, par un procédé digne des lois scélérates, certains ne voulaient à présent lier le sort de Nietzsche à celui de Stirner, juger l'un avec l'autre pour les englober mieux tous deux dans une admiration ou une réprobation plus facile. Il serait trop long aujourd'hui de chercher avec vous en quoi l'un de l'autre diffère, diffère jusqu'à s'opposer; la question demeurera si grave que [Pg 162]plus d'une fois nous y reviendrons, je suppose. En attendant, indignez-vous tout simplement en entendant dire: «Stirner et Nietzsche» comme Nietzsche lui-même s'indignait en entendant dire: «Gœthe et Schiller».
C'est à propos de Stirner, non de Nietzsche qu'il me plaît de vous parler un peu des «dangers de l'individualisme». Je crains, Angèle, je crains les ratés de l'individualisme, autant que tous les autres ratés. Ratés et médiocres, laissons-les donc aux religions établies; ils s'en trouveront mieux; nous aussi. Ne poussons donc pas vers l'individualisme ce qui n'a rien d'individuel; le résultat serait piteux. Ou mieux:
Pourquoi formuler l'individualisme? Il n'y a pas d'individualisme qui tienne; les grands individus n'ont nul besoin des théories qui les protègent: ils sont vainqueurs. Laissons donc aux médiocres et aux faibles la joie de les pouvoir condamner, et vaincus, écrasés par eux, de prendre une innocente revanche en les vainquant en effigie[2].
[Pg 163]Il me plaît, à Moi, l'unique, que le «grand homme» continue à me paraître un grand coupable. Et puisque Max Stirner ose encore employer le mot de lâcheté, je dirai que je trouve lâche, Moi, de l'innocenter. Eh quoi! pour disculper sa grandeur, rétablirez-vous donc la notion du bien et du mal? Aurez-vous peur du crime encore, Monsieur Stirner? Vous n'êtes qu'un théoricien, non un vrai criminel. Sous votre apparence logique, vous souhaitez encore mon estime. Eh bien! vous ne l'aurez pas! précisément, vous ne l'aurez pas. Je ne m'accorde la mienne que lorsque je ne pense plus comme vous.
O Stirner! allez-vous à nouveau nous rendre le «Moi, haïssable»? Nous espérions n'y plus penser!...
Mais c'est qu'il faudrait mieux s'entendre et ne pas illustrer un tel livre avec l'image d'un Gœthe, d'un Beethoven, d'un Balzac, d'un Nietzsche ou d'un Napoléon (ces grandes et altières figures furent admirablement dévouées à quelque grande idée projetée devant eux, au-dessus d'eux); car il faut encore dire ceci d'admirable, c'est que plus les individus sont grands, [Pg 164]moins il y en a. En sorte qu'une théorie qui chercherait à produire le plus grand nombre possible d'individus diminuerait chacun pour tous, et tendrait à se rapprocher du socialisme. Tous individus: plus d'individu. Ah! pour l'amour de Moi! pas d'individualisme!!!
Retenez-les! Angèle! Retenez-les! Ne favorisons pas ces éclosions malheureuses; continuons à honnir, à bannir, à lapider l'individu. Ceux que ne retiendra ni le respect d'autrui, ni la crainte, ni la pitié, ni la pudeur, ni le mépris ou la haine d'autrui, ceux-là ce sont les vrais; nous pouvons espérer qu'ils vaudront quelque chose. Et ils s'inquiètent peu qu'un Stirner les approuve, ou que les désapprouve un Tolstoï. S'ils sont grands, c'est qu'ils sont en petit nombre; ils sont triés. Et rien n'a pu contre eux, pas même mon épouvante: voilà pourquoi je les admire, je les aime, je les trouve grands. Il faut, pour en obtenir quelques-uns, forcer à la médiocrité beaucoup d'autres et tâcher d'y contraindre même celui-là.
Pourquoi le disculper?—Il faut que tout s'acharne contre le grand homme, car le grand homme est l'ennemi de beaucoup[3].
[Pg 165]Pourquoi le plaindre?—C'est un grand homme. Et, s'il est authentique, il saura toujours bien s'en tirer.
Pourquoi le protéger?—Ses épreuves mêmes et son isolement feront sa force—ou du moins celui-là seul qui les supporte et qui en sort était puissant.
Par pitié, pas d'individualisme! par pitié pour les individus. N'encouragez jamais les grands hommes; et pour les autres: découragez! découragez!...
10 décembre 1899.
[1] 1 vol. in-8° carré (Editions de la Revue blanche).
[2] C'est aussi ce que M. Lasvignes exprime excellemment à la fin de son intéressante préface: «Les masses humaines, dit-il, ne seront jamais plus conscientes de la puissance formidable qu'elles représentent en face de la poignée d'hommes qui les tient asservies, que les forces naturelles ne le sont de l'infinie faiblesse de l'homme qui les gouverne.» (Page xxix.)
[3] ... «Nous sommes accablés par les esprits sublimes. Pour qu'un homme soit au-dessus de l'humanité, il en coûte trop cher à tous les autres.»
Montesquieu.
Chère Angèle,
Vous recevrez par le même courrier deux gros livres de Nietzsche. Vous ne les lirez probablement pas; mais je veux que vous les ayez quand même. C'est mon petit cadeau de janvier.
Et je préférerais, il est vrai, du fond de l'Algérie, vous envoyer des dattes, ainsi que je faisais si joliment, les ans passés. Hélas! Paris me tient encore et, si j'y pensais trop, l'approche ici d'un nouvel an me rendrait triste.—Que ne puis-je parler des sables et des palmes! je m'y connais, et mieux qu'à la philosophie... Mais j'en suis loin, et voici Nietzsche, chère amie; si je suis grave, excusez-moi.
Grâces soient rendues à M. Henri Albert qui nous donne enfin notre Nietzsche, et dans une fort bonne [Pg 167]traduction. Depuis si longtemps nous l'attendions! L'impatience nous le faisait épeler déjà dans le texte—mais nous lisons si mal les étrangers!
Et peut-être valait-il mieux que cette traduction ait mis tant de temps à paraître: grâce à cette cruelle lenteur, l'influence de Nietzsche a précédé chez nous l'apparition de son œuvre; celle-ci tombe en terrain préparé; elle eût risqué sinon de ne pas prendre; à présent elle ne surprend plus, elle confirme; ce qu'elle apprend surtout, c'est sa splendide et enthousiasmante vigueur;—mais elle n'était presque plus indispensable; car l'on peut presque dire que l'influence de Nietzsche importe plus que son œuvre, ou même que son œuvre est d'influence seulement.
Encore et malgré tout l'œuvre importe, car son influence, on commençait de la fausser.—Il faut, pour bien comprendre Nietzsche, s'en éprendre, et seuls le peuvent comme il faut les cerveaux préparés à lui depuis longtemps par une sorte de protestantisme ou de jansénisme natif; des cerveaux qui n'ont rien tant en horreur que le scepticisme, ou chez qui le scepticisme, nouvelle forme de croyance qui mue amour en haine, garde toute la chaleur d'une foi.—Voilà pourquoi tels esprits ingénieux et souples comme [Pg 168]celui de M. de Wyzewa s'y trompèrent: peu d'études sur Nietzsche (je ne parle que des plus remarquables) trahissent autant Nietzsche que la sienne[1]. Il voulut voir en lui un pessimiste: Nietzsche est avant tout un croyant. Il ne sut voir en son œuvre que démolitions et que ruines: elles y sont, mais loués soient ceux-là qui nous permettent de construire! Seuls ceux-là ruinent qui découragent et diminuent notre croyance en la vie...:
Je veux l'homme le plus orgueilleux, le plus vivant, le plus affirmatif; je veux le monde, et le veux tel quel, et le veux encore, le veux éternellement, et je crie insatiablement: Bis! et non seulement pour moi seul, mais pour toute la pièce, et pour tout le spectacle; et non pour tout le spectacle seul, mais au fond pour moi, parce que le spectacle m'est nécessaire—parce qu'il me rend nécessaire—parce que je lui suis nécessaire—et parce que je le rends nécessaire.
Oui, Nietzsche démolit; il sape, mais ce n'est point en découragé, c'est en féroce; c'est noblement, glorieusement, surhumainement, comme un conquérant neuf violente des choses vieillies. La ferveur qu'il [Pg 169]y met, il la redonne à d'autres pour construire. L'horreur du repos, du confort, de tout ce qui propose à la vie une diminution, un engourdissement, un sommeil, c'est là ce qui lui fait crever murailles et voûtes: On ne produit qu'à condition d'être riche en antagonismes, dit-il; on ne reste jeune qu'à condition que l'âme ne se détende pas, n'aspire pas au repos. Il sape les œuvres fatiguées et n'en forme pas de nouvelles, lui—mais il fait plus: il forme des ouvriers. Il démolit pour exiger plus d'eux; les accule.
L'admirable, c'est qu'il les gonfle en même temps de vie joyeuse, c'est qu'avec eux il rit au milieu des décombres, c'est qu'il y sème à tour de bras. Il n'est jamais plus rouge de vie que quand c'est pour ruiner les choses mortelles ou tristes. Chaque page est alors saturée d'une énergie créatrice; d'indistinctes nouveautés s'y agitent; il prévoit, il pressent, il appelle—et il rit.—Œuvre admirable? non—mais préface d'œuvres admirables. Démolir, Nietzsche? Allons donc! Il construit,—il construit, vous dis-je! il construit à bras raccourcis.
Je voudrais pouvoir louer plus le petit livre de Lichtenberger sur Nietzsche. A défaut de Nietzsche même, c'est là, chère Angèle, ce que je vous conseillerais [Pg 170]de lire. Je le ferais plus volontiers si certaine timidité d'esprit n'avait fait l'auteur traiter son sujet avec presque trop de conscience. Oui, pour bien parler de Nietzsche, il faut plus de passion et moins d'école; plus de passion surtout, et partant moins de crainte. Le dernier chapitre, en guise de conclusion, étudiant Nietzsche dans son ensemble, cherche en quoi il est bon, en quoi mauvais—etc.; il pondère, limite, sauvegarde. Nietzsche entraîne tant d'effrayantes choses après lui! Si donc la peur domine, je préfère entendre bannir Nietzsche en entier plutôt que d'en voir approuver seulement les parties rassurantes. Ce sont parties d'un tout. La modération le supprime. Et je comprends que Nietzsche fasse peur; mais les idées qui ne heurtent rien d'abord ne sont en rien réformatrices.
Tout cela ne suffirait pas à me faire critiquer ce petit livre, je lui en veux un peu pour de plus particulières raisons: certaines de vos amies, chrétiennes il est vrai, ont pu à travers lui se représenter Nietzsche comme «quelqu'un d'excessivement triste». Et c'est vraiment contrariant, vous l'avouerez, cherchant la joie jusque dans la folie et la glorifiant à travers toutes les souffrances, martyr vraiment dans le sens plein du [Pg 171]mot, d'arriver aux yeux de certains à représenter «Quelqu'un d'excessivement triste»!—Mais la joie chrétienne admet malaisément d'autre forme de joie que la sienne: ne pouvant réduire celle-là, elle la nie.
«Œuvre profondément triste», dit aussi M. de Wyzewa, et diront encore long temps d'autres. Décidément il était temps que cette traduction parût!
Ces deux livres[2] font connaître Nietzsche autant que le pourra faire l'œuvre entière—d'une admirable monotonie. Douze volumes; de l'un à l'autre aucune nouveauté; le ton seul change, devient plus lyrique et plus âpre, plus forcené.
Dès le premier ouvrage (la Naissance de la Tragédie), l'un des plus beaux, Nietzsche s'affirme et se montre tel qu'il sera: tous ses futurs écrits sont là en germe. Dès lors une ferveur l'habite qui va toucher à tout en lui, réduire en cendres ou vitrifier tout ce qui ne supporte pas tant de chaleur.
L'œuvre des philosophes est fatalement monotone; nulle surprise en eux; une appliquée conséquence à soi-même; aucune contradiction qui ne soit dès lors [Pg 172]une erreur.—«L'esprit fait sa maison, dit Emerson, puis la maison enferme l'esprit.»—Système clos; la solidité des murs d'enceinte en fait la force; on ne les perd jamais de vue ... ou sinon ce sont des transes: on croit être sorti du système, s'être trompé.—Se tromper!—Comment me tromperais-je? «Qui trompe-t-on ici?»—Un philosophe ne trompe jamais que les autres... On ne trompe jamais que les autres.
Et Nietzsche lui-même s'emprisonne; ce passionné, ce créateur, se débat dans son système qui se replie de toutes parts sur lui comme un rets; il le sait et rugit de le savoir, mais n'en sort pas; c'est un lion dans une cage d'écureuil. Quoi de plus dramatique que cela: cet antirationnel veut prouver. Ses moyens sont autres, mais qu'importe? Artiste, il ne crée pas; il prouve; il prouve passionnément. Il nie la raison et raisonne. Il nie avec une ferveur de martyr.—De part en part son œuvre n'est qu'une polémique: douze volumes de cela; on ouvre au hasard; on lit n'importe quoi; d'une page à l'autre, c'est tout de même; la ferveur seule se renouvelle et la maladie l'alimente; aucun calme; il y souffle sans cesse une colère, une passion enflammée. Etait-ce donc là que devait aboutir le protestantisme?—Je [Pg 173]le crois—et voilà pourquoi je l'admire;—à la plus grande libération.
Je suis trop protestant moi-même, et pour cela j'admire trop Nietzsche pour oser parler en mon nom propre. J'aime mieux laisser parler M. Fouillée. En 1895, il écrivait dans la Revue des Deux Mondes[3]:
«Le protestantisme, après avoir été plus réactionnaire que le catholicisme lui-même, s'avisa d'opposer à l'immobilité catholique l'idée du libre examen. Quand ils eurent trouvé cela, les protestants eurent cause gagnée—et aussi perdue. Ils avaient trouvé l'arrêt de mort de leurs adversaires; car en face d'une religion enchaînée par elle-même et engagée dans son passé comme un terme dans une gaine, ils dressaient une religion libre, progressive, capable de tout ce que la libre recherche scientifique lui apporterait. Le leur: car, n'y ayant pas de limite au libre examen, ils créaient une religion illimitée, donc indéfinie, donc indéfinissable, qui ne saurait pas, le jour où le libre examen lui apporterait l'athéisme, si l'athéisme fait partie d'elle-même ou non; une religion destinée à s'évanouir dans le cercle indéfini du philosophisme [Pg 174]qu'elle a ouvert. Toute la libre pensée, tout le philosophisme, toute l'anarchie intellectuelle étaient contenus, dans le protestantisme dès qu'il cesserait d'être un catholicisme radical.»
Certes, cela n'apporte pas de repos, et rien n'y est plus opposé. Rien n'est plus opposé à ces phrases (magistrales certes) de Bossuet, dans ses lettres pastorales:
Nous n'avons jamais condamné nos prédécesseurs et nous laissons la foi des Eglises telle que nous l'avons trouvée... Dieu a voulu que la vérité vînt à nous de pasteur en pasteur et de main en main sans que jamais on n'aperçût d'innovation. C'est par là qu'on reconnaît ce qui a toujours été cru et par conséquent ce que l'on doit toujours croire. C'est pour ainsi dire dans ce toujours que paraît la force de la vérité et de la promesse, et on le perd tout entier dès qu'on trouve de l'interruption en un seul endroit[4].»
Mais Nietzsche ne cherchait pas le repos, lui qui disait encore:
[Pg 175]Rien ne nous est devenu plus étranger que ce desideratum du passé, la paix de l'âme, desideratum chrétien. Rien ne nous fait moins envie que la Morale de ruminant et l'épais bonheur d'une bonne conscience. Et ailleurs: La plus belle vie, pour le héros, est de mûrir pour la mort, dans le combat.
J'espère par ces quelques citations vous éclairer un peu le débat, vous faire comprendre pourquoi Nietzsche paraît et continuera de paraître à certains «quelqu'un d'excessivement malheureux».—Je vous satisferais trop maladroitement en disant que ce n'est pas le «bonheur» qu'il recherche, car précisément c'est «ce que l'on recherche» que l'on appelle «bonheur»;—mais il est difficile toujours de continuer à appeler «bonheur» ce dont on ne voudrait pas pour soi-même. Tant pis! J'en tiens pour le bonheur de Nietzsche, chère amie.
Que de choses sur lui j'aurais donc à vous dire! Mais le temps presse; j'écris presque au hasard, hâtivement. Excusez-moi. J'y reviendrai.—Comment ne pas y revenir? Je suis entré dans Nietzsche malgré moi, je l'attendais avant de le connaître—de le connaître fût-ce de nom. Une sorte de fatalité charmante me conduisait aux lieux qu'il avait traversés, en Suisse, [Pg 176]en Italie,—me faisait choisir pour y vivre un hiver précisément ce Sils-Maria de la Haute Engadine, où j'appris ensuite qu'il avait agonisé plus doucement. Et pas à pas ensuite, le lisant, il me semblait qu'il excitait mes pensées.
Nous devons tous à Nietzsche une reconnaissance mûrie: sans lui, des générations peut-être se seraient employées à insinuer timidement ce qu'il affirme avec hardiesse, avec maîtrise, avec folie. Nous-mêmes, plus personnellement, nous risquions de laisser s'encombrer toute notre œuvre par d'informes mouvements de pensées—de pensées qui maintenant sont dites. C'est à partir de là qu'il faut créer, et que l'œuvre d'art est possible.—Voilà ce qui me faisait considérer plus haut l'œuvre entière de Nietzsche comme une préface, on pourrait dire: Préface à toute dramaturgie future.—Nietzsche le sait, le montre sans cesse. Il semble, anachroniquement, que toute son œuvre soit sous-entendue en celle d'un Shakespeare, d'un Beethoven, d'un Michel-Ange. Nietzsche est infus dans tout cela. Il est même plus simple de dire que tout grand créateur, tout grand affirmateur de Vie est forcément un Nietzschéen.
«Voyez enfin quelle naïveté il y a à dire: l'homme devrait [Pg 177]être tel ou tel. La réalité nous montre une richesse enivrante de types, une multiplicité de formes, d'une exubérance et d'une profusion inouïes»...
Nietzsche, tout comme un créateur de types, est enivré par la contemplation de la ressource humaine; mais, tandis que les autres créateurs échappent à la folie de leur génie par la continuelle purgation qu'est pour eux la création artistique, la fiction de leurs passions Nietzsche, prisonnier dans sa cage de philosophe, dans son hérédité protestante, y devient fou.
J'ai dit que nous attendions Nietzsche bien avant de le connaître: c'est que le Nietzschéisme a commencé bien avant Nietzsche; le Nietzschéisme est à la fois une manifestation de vie surabondante qui s'était exprimée déjà dans l'œuvre des plus grands artistes, et une tendance aussi qui, suivant les époques, s'est baptisée «jansénisme», ou «protestantisme», et qu'on nommera maintenant Nietzschéisme, parce que Nietzsche a osé formuler jusqu'au bout tout ce qui murmurait de latent encore en elle.
Si j'eusse eu plus de temps, je me fusse amusé à vous montrer le Nietzschéisme d'avant Nietzsche. Par des citations habilement choisies j'eusse pu circonvenir presque de toutes parts sa figure; mais ce serait [Pg 178]trop long pour aujourd'hui; puis ce qu'il eût fallu citer surtout, ce sont des phrases des dernières œuvres de Beethoven. J'y reviendrai. Laissez-moi seulement en passant vous montrer ce passage de Dostoievsky. Nul plus que Dostoievsky n'a aidé Nietzsche.—Je cite, puis passe; et si vous ne comprenez pas, dites-le-moi; je vous expliquerai cela dans la suite,—Cela se lit presque à la fin des Possédés:
Celui qui parle (Kiriloff) est à moitié fou. Il doit se suicider dans un quart d'heure. Celui qui l'écoute compte profiter du suicide; il s'agit de faire endosser à Kiriloff un crime que lui, l'écouteur, a commis. Kiriloff, avant de se tuer, doit signer un papier où il se déclare coupable. A l'instant précis où nous sommes, la conversation entre eux a dévié; Kiriloff hésite, n'est plus capable de rien, pas même d'un suicide; il risque de redevenir raisonnable; tout est perdu pour Pierre, l'écouteur, s'il ne remet pas Kiriloff en état de se tuer. (Tant il est vrai que tout état pathologique inconscient peut proposer à l'individu des actes neufs, que sa raison s'ingéniera aussitôt à admettre, à soutenir, à systématiser). Il faut que toute une philosophie, toute une morale subitement improvisée, paraisse motiver cet acte qui, réciproquement, motive cette [Pg 179]philosophie. Voici ce que, poussé par Pierre, Kiriloff arrive à dire, superuomo d'un instant,—un instant seulement, s'il vous plaît,—simplement le temps de se tuer:
... «Enfin tu m'as compris! s'écria Kiriloff enthousiasmé.—-Tu comprends maintenant que le salut pour l'humanité consiste à lui prouver cette pensée[5]. Qui la prouvera?—Moi. Je ne comprends pas comment jusqu'à présent l'athée a pu savoir qu'il n'y a pas de Dieu et ne pas se tuer tout de suite! Sentir que Dieu n'existe pas, et ne pas sentir du même coup qu'on est soi-même devenu Dieu, c'est une absurdité..... Si tu sens cela, toi, tu es un tzar, et, loin de te tuer, tu vivras au comble de ta gloire
»Mais celui-là seul, qui est le premier, doit absolument se tuer; sans cela, qui donc commencera et prouvera? C'est moi qui me tuerai absolument, pour commencer, et pour prouver. Je ne suis encore Dieu que par force, et je suis malheureux, car je suis obligé d'affirmer ma liberté. Tous sont malheureux parce que tous ont peur d'affirmer leur liberté. Si l'homme jusqu'à [Pg 180]présent a été si malheureux et si pauvre, c'est parce qu'il n'osait pas se montrer libre dans la plus haute acception du mot et qu'il se contentait d'une insubordination d'écolier... La crainte est la malédiction de l'homme... Mais je manifesterai mon indépendance, je finirai et j'ouvrirai la porte. Et je sauverai. Cela seul sauvera tous les hommes et transformera physiquement la génération suivante; car autant que j'en puis juger, sous sa forme physique actuelle il est impossible à l'homme de se passer de l'ancien Dieu. J'ai cherché pendant trois ans l'attribut de ma divinité, c'est l'indépendance! C'est tout ce par quoi je puis montrer au plus haut degré mon insubordination, ma nouvelle et terrible liberté. Car elle est terrible. Je me tuerai pour affirmer mon insubordination, ma nouvelle et terrible liberté!»
Kiriloff se tue, Pierre «devient tzar».—Nietzsche sombre dans la folie, vive à présent son superuomo!
Je sais bien que Dostoievsky met ces paroles dans la bouche d'un fou; mais peut-être une certaine folie est-elle nécessaire pour faire dire une première fois certaines choses;—peut-être Nietzsche l'a-t-il senti. L'important, c'est que ces choses-là soient dites; car maintenant il n'est plus besoin d'être fou pour les penser.
[Pg 181]Mais lorsque des raisonnables viennent dire: c'est un malade; des orthodoxes: sa folie finale condamne son système—je proteste et dis que ce sont les mêmes qui criaient au Christ sur la croix: «Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même.» Il y a là une grave incompréhension. Je ne veux plus savoir ici ce qui est cause et ce qui est effet; et je préfère dire que Nietzsche s'est fait fou. Et pour écrire de telles pages, peut-être fallait-il consentir d'être malade[6]: c'est une forme de dévouement. Les livres de Lombroso ne gênent que les sots.—La raison de Nietzsche au début de la vie s'y propose une tragique partie dont sa raison même est l'enjeu. Il joue contre lui-même, perd la raison,—mais gagne la partie; il a gagné, puisqu'il est fou.
Nietzsche a voulu savoir, et jusqu'à la folie; sa clairvoyance fut de plus en plus aiguë, cruelle, délibérée. A mesure qu'il voyait plus clair, il prônait davantage l'inconscience. Nietzsche voulait la joie à tout prix. De toute la force de sa raison il se poussait à la folie, comme vers un refuge. Que son génie surmené [Pg 182]s'y repose!—L'an passé, j'ai lu, dans les Débats je crois, un court article où l'on parlait de Nietzsche. On le montrait près de sa sœur, distrait, insouciant, point triste.—«Il cause avec moi, disait sa sœur, et s'intéresse à tout autour de lui, tout comme s'il n'était pas fou—seulement il ne sait plus qu'il est Nietzsche. Parfois, le regardant, je ne peux retenir mes larmes; il dit alors: Pourquoi pleures-tu? Est-ce que nous ne sommes pas heureux?»
Au revoir, chère amie!—Dieu vous mesure le bonheur!
Paris, 10 décembre 1893.
[1] Wyzewa.—Revue bleue du 7 novembre 1891. Wyzewa.—Ecrivains Etrangers (Perrin), février 1896.
[2] Par delà le bien et le mal; Ainsi parlait Zarathustra (Mercure de France).
[3] Etude sur Auguste Comte, 1er août 1895.
[4] Lettre pastorale aux nouveaux catholiques de son diocèse, II.
[5] «Si Dieu existe, tout dépend de lui, et je ne peux rien en dehors de sa volonté. S'il n'existe pas, tout dépend de moi, et je suis tenu d'affirmer mon indépendance.»
[6] Guéri! je ne veux pas l'être! Mon esprit est puissant! Je serais alors abject comme les autres.»
(Faust, Apostrophe à Chiron.)
[Pg 184]Ces articles ont paru dans la Revue Blanche, au cours de l'an 1901.
Pour la plus grande joie d'un petit nombre, M. Deman en libraire amateur riche de loisirs et en artiste de haut goût, parachève parfois une impression nouvelle qu'orne précieusement un Redon, un Van Rysselberghe, un Renoir. Les livres qu'il nous offre alors avec lenteur sont beaux, comme furent presque tous ceux de Verhaeren, ou la récente réédition des poésies de Stéphane Mallarmé; mais jamais la réussite de M. Deman ne fut plus heureuse que pour cette anthologie de Villiers.—Sur le papier de moire vert foncé qui la couvre, au-dessus d'un grand ornement noir, on lit, en caractères d'or: Histoires Souveraines. Ce sont là, prédit l'éditeur, «les vingt meilleurs contes» de l'inimitable conteur.
[Pg 186]Je n'ai pu apprendre précisément comment se décida le choix de ces contes; on parle d'une enquête: ceux des littérateurs qui furent jugés dignes de s'y connaître auraient envoyé des listes selon leur goût; ce choix représenterait donc à peu près celui du meilleur public;—on parle aussi de Mallarmé tout seul... Quoi qu'il en soit, le choix est bon. Je regrette, il est vrai, pour ma part, l'absence du délicieux Sentimentalisme, de Sombre récit, conteur plus sombre, la présence de la Voix du Passé, du Meilleur Amour, de Impatience de la Foule—mais j'indique un goût personnel; je préfère le taire ici, prendre ce livre tel que si ce choix était celui du temps lui-même et que ce fussent là les opera quæ supersunt de tout Villiers. Aussi bien, ces vingt contes suffisent-ils pour le connaître; il est là très entier, tour à tour mystique et passionné, grandiloquent, courtois, lyrique, oriental, ironique surtout, «cruel», avec toutes les nuances de la haine, du dédain,—un et divers, satisfaisant enfin et ne nous déconcertant plus.
Le recul s'est fait vite, ces dernières années; les influences violentes se succèdent fièvreusement, nous créant ad hoc une espèce de petit passé provisoire, comme pour donner plus d'élan et plus d'apparente [Pg 187]jeunesse à la nouvelle croyance de l'instant; Villiers qui, tant que vivait Mallarmé, pouvait inquiéter encore, semble à présent déjà si loin de nous que je crois en pouvoir parler sans injustice et, comme l'on dit alors: historiquement. Et peu m'importe alors qu'il n'apparaisse plus, peut-être, comme une étoile de première grandeur: il a tiré vers lui d'étroites marées d'enthousiasme; il eut ses fervents, ses disciples, tout ce qu'il faut pour qu'on le considère comme un maître; intéressant peut-être d'autant plus qu'il n'y eut pas chez lui grande invention personnelle, qu'il est lui-même un résultat, mais qu'en lui convergent en faisceau, s'unissent des influences assez diverses (faux hégélianisme, wagnérisme, morale hindoue, etc.) et que des idées flottantes, et pour cela gênantes, se sont trouvées par lui artificiées, poussées à bout et portées à leur point de perfection littéraire, sinon de maturité réelle.
Oui vraiment: perfection littéraire. Je sais, dans notre langue, peu de choses aussi belles que le début d'Amour Suprême,—et pourquoi ne pas dire: que le conte tout entier?—Quel juste et délicat mélange de frivolité, de politesse et d'esprit dans le Tsar et les grands-ducs! la proportion de chaque élément est parfaite—et [Pg 188]dans d'autres contes quelle sûreté de diction!—Parfois une insistance inutile et charmante; car les plus belles phrases de Villiers sont d'ordinaire des phrases de pure insistance, savamment préparées, annoncées, et dont la surprise n'est plus que presque exclusivement verbale. Souvent deux ou trois pages s'y emploient, nuançant, graduant l'émotion d'une même idée; la dernière phrase vient, sans heurt, comme la résolution d'une suite d'accords. L'art littéraire ne peut être poussé plus loin.—Nulle violence, nulle perturbation de l'instinct, nulle indiscrétion de la chair; le sang qui rougit aisément la pâleur de ses très chastes héroïnes coule paisiblement; chaque passion assagie n'est peinte, chaque mot, chaque cri n'est amené qu'en vue de l'effet artistique. Le mot factice ici devient éloge, mais c'est lui qu'il faut qu'on emploie.
Car la phrase ne paraît pas chez lui profondément nécessitée; née plutôt d'un besoin de parure et de luxe où s'affirme à la fois tout son amour et tout son mépris de l'aspect, elle ne s'identifie jamais avec l'idée, mais reste comme sa projection sensible, et semble parfois, postiche, n'être que son prestigieux et chatoyant faire-valoir; factice—autant, pas plus [Pg 189]que ne l'était pour lui toute apparence, tout le rideau diapré de notre monde phénoménal. «Sic indutus et ornatus», citera-t-il.—Parfois, souvent, le mot limite l'évocation de l'objet qu'il désigne, à sa seule signification décorative. Non seulement il n'y croit pas, à l'objet, mais encore veut nous faire sentir qu'il n'y croit pas. Le réel, pour nous, dira-t-il, est seulement ce qui touche soit nos sens, soit notre esprit. «Les objets se transfigurent selon le magnétisme des personnes qui les approchent, toutes choses n'ayant d'autre signification, pour chacun, que celle que chacun peut leur prêter.—Pour nous ces candélabres étaient, nécessairement, d'un or vierge, etc...» Et encore: «Nul ne peut posséder d'une chose que ce qu'il en éprouve.» Et plus subtilement: «Le seul contrôle que nous ayons de la réalité, c'est l'idée.» Voilà, plus ou moins déguisé, le sujet même de la plupart de ces contes, et d'Axel, de l'Eve future, et de Tribulat Bonhomet.
Est-ce son subjectivisme quasi religieux qui impose à Villiers sa méconnaissance, quasi religieuse aussi, de la vie? ou au contraire cette méconnaissance précède-t-elle, lui dicte-t-elle le subjectivisme, comme pour se justifier? Je ne sais.—La même question [Pg 190]peut d'ailleurs se poser, et vainement, pour tous les «écrivains catholiques». Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Hello, Bloy, Huysmans, c'est là leur trait commun: méconnaissance de la vie, et même haine de la vie,—mépris, honte, peur, dédain, il y a toutes les nuances,—une sorte de religieuse rancune contre la vie. L'ironie de Villiers s'y ramène.
Villiers parle de «ceux qui portent, dans l'âme, un exil»; «tant que traîna le simulacre de sa vie», dit Mallarmé, parlant précisément de Villiers;—car la vie devient alors aisément une sorte de parade, ironique et déclamatoire, parfois cabotine; et le rôle de l'artiste est, n'y croyant pas, de jeter sur son néant un prestige,—ou mieux, d'opposer à ce néant, avoué, une autre vie, un autre monde, monde créé par lui, factice, qu'il prétendra révélateur de l'idée pure que bientôt il appellera le vrai monde—l'œuvre d'art[1].
Dans un de ses plus beaux contes, dans Vera (quelle intention déjà dans ce titre!), Villiers nous dit l'histoire d'un jeune homme surhumainement amoureux de sa femme. Celle-ci meurt. Il n'admet pas que la [Pg 191]mort la lui enlève; il rejette par-dessus la grille du caveau la clef du caveau où repose Vera. Rentré dans la demeure en deuil, il s'occupe de son amour; il commence à jouer pour lui-même une amoureuse et persuadante comédie, feint un dialogue, suppose sans cesse la présence de la morte; bientôt rien ne manquera plus, qu'elle-même; il parvient, à force d'amour, à imaginer—bien plus: à forcer, à nécessiter sa présence. «Le comte avait creusé dans l'air la forme de son amour, et il fallait bien que ce vide fut comblé par le seul être qui lui était homogène, autrement l'Univers aurait croulé.» «Et comme il ne manquait plus que Vera elle-même, tangible, extérieure, il fallut bien qu'elle s'y trouvât.»
Magnificence de l'artiste! L'art suprême supplante l'inexistante réalité. L'imaginaire Vera devient plus vraie que la vraie Vera morte.—Ce conte, le premier des Histoires Souveraines, est l'histoire même de l'artiste Villiers.—S'il est vrai que Vera soit morte et que ce monde est imposteur: vive Villiers!—Mais on peut estimer que le monde extérieur existe et que Vera ne meurt que parce que c'est Villiers qui la tue: son art n'apparaît plus alors qu'une admirable et éblouissante imposture.
[1] «L'auteur a dû modifier un peu le personnage même du Duc de Portland—puisqu'il écrit cette histoire telle qu'elle aurait dû se passer», dit Villiers en note du Duke of Portland.
Inconnu d'hier, le très jeune Maurice Léon arrivera-t-il à la célébrité par ce livre?—Il a pris, sinon la meilleure, du moins la route la plus courte; il s'est tué.
Autant dire qu'il est mort de ce livre; car nulle cause extérieure à son suicide, nulle maladie, nulle intrigue, nulle complicité d'amour: il reste responsable seul, avec ceux qui l'ont fait ainsi, et c'est dans sa seule pensée, qu'ici minutieusement il expose, qu'il sied de découvrir la cause de sa mort lente et compliquée, qu'un coup de pistolet achève. Triste autopsie! qui peut-être n'intéressera que les spécialistes, psychologues et psychothérapeutes, mais qui intéressera ceux-là passionnément. A chaque page de ce livre on réfléchit, on pense: qu'y a-t-il donc de mortel là-dedans?—Et [Pg 193]cela seul suffit à dramatiser tout le livre.
Une robuste préface de Paul Adam nous avertit (nul, je pense, ne pouvait être plus désigné pour antidoter un tel livre) et par des phrases habilement choisies au cours du livre, nous prépare; puis commencent sans ordre apparent, et continuent sans gradation sensible, ces 300 pages où Maurice Léon ne parlera strictement que de lui: «Me commenter, m'expliquer moi-même, me critiquer si profondément que l'on n'ait plus rien à dire de moi» ... et si, les 300 pages écrites, le «petit Gendelettre» s'est tu, c'est qu'il n'aura trouvé sur lui plus rien à dire.
De ces pages, excellentes souvent, il est peu dont je n'eusse voulu souligner quelques lignes; il en est d'assez remarquables pour mériter de n'ennuyer que les esprits superficiels et que les sots: il en est qui se juxtaposent, se répètent et font, semble-t-il, double emploi; mais cette obsédante rétrospection est précisément un des plus étonnants caractères du livre; il en est dont la forme sèche, non abstraite pourtant, sans hypocrite attrait, étonne lorsqu'on les songe écrites avant vingt ans, et leur aiguë pénétration inquiète; l'intelligence de Léon fut un instrument délicat, un instrument de précision.
[Pg 194]«Mon autobiographie, dira-t-il, je la veux froide, méticuleuse; elle sera douloureuse au fond, douloureuse par l'effort—jamais sûre de son résultat, doutant de sa sincérité même—vers la vérité nue.»—Une biographie cela!—Pas un fait, pas une émotion—j'allais dire: pas une pensée, tant l'étude ou la critique de la pensée tient lieu de la pensée nouvelle. C'est là l'effort d'Orphée pour apercevoir Eurydice, et son étonnement déçu de n'en saisir jamais que le cadavre. «La pensée que j'étudie ne vit pas dans la même atmosphère que ma pensée»; autant dire: ma pensée, dès que je l'étudie, est morte.
Qu'Orphée n'avançait-il simplement et sans regarder en arrière? Eurydice suivait si bien!—Que Léon n'écrivait-il simplement, sans souci de se voir écrire?—Ecrire!—mais écrire quoi? Maurice Léon n'avait rien à dire. Son active pensée fonctionne à vide. Il eut tôt fait de le comprendre, et dès lors c'est ceci même que de page en page il dira. Il s'observera, tentera d'observer sa pensée, son fonctionnement délicat, pour raconter après, non point la première pensée (encore une fois il n'en a pas), mais l'observation de cette pensée et tout son travail désœuvré. «Je veux faire le livre où l'on se fige, où l'on se momifie pour ne pas [Pg 195]mourir tout... Je ne pourrai pas être sincère; ce n'est pas moi que je momifierai pour l'éternité.»
Et dès lors ce souci concomitant l'habite: être sincère. Il importe de constater que ce souci n'habite et ne peut habiter que ceux précisément qui n'ont rien à dire; comprenne qui voudra pourquoi... Ces quelques phrases de Léon éclairent un peu ce que j'avance: «Je ne sais si je mens ou si je dis vrai; j'écris, voilà tout...» voici comment parle l'artiste qui a quelque chose à dire—mais Léon ajoute: «Suis-je sincère? Eh oui! je suis sincère comme lorsque j'ai peur de la mort: peur verbale, qui ne peut pas se traduire par le plus léger battement de cœur.»—Peur verbale, émotions verbales ... tout ce que je dirais ici ne pourrait qu'affaiblir ses paroles; aussi bien cette jeune voix qui s'est tue, je voudrais qu'elle parlât encore: «Le mot, dit Maurice Léon, ne dérive jamais chez moi de mon émotion, de ma vision; il paraît par une spontanéité acquise en venir parfois; en réalité, c'est la nécessité d'écrire, l'habitude qui l'appellent... Pour l'âme artiste, le mot ne fait que rendre imparfaitement l'impression ressentie; pour moi il la crée presque; je dis plus que je n'éprouve.»—Et ailleurs: «Réfléchissez sur votre bonheur, sur votre jeunesse, et vous [Pg 196]n'en jouirez plus qu'en paroles.»—Enfin je veux encore citer cette si clairvoyante phrase, qui désormais prend un accent d'adieu: «Un caractère n'existe pas; il n'y a que des sensations et des réactions; les plus fréquentes ne sont même pas les plus essentielles.—Que reste-t-il? Les balbutiements de l'auteur, et la bonne volonté du lecteur.»
Comprendre tout, ne rien sentir... De nouveau la question se pose: qu'y a-t-il de mortel là-dedans?—Oh! rien, peut-être—car enfin, des générations l'ont prouvé: on peut bien vivre ainsi sans en mourir, sans en trop souffrir même, surtout sans s'en douter. La conscience d'un mal, plus que le mal lui-même, fait le suicide, et l'on prend sans vertu son parti des souffrances très partagées. Mais le monde en tournant change un peu; une souffrance, commune hier, devient plus rare et solitaire, s'exagère par comparaison. Pour beaucoup l'intelligence a suffi; si Léon est mort, c'est donc qu'elle commence à ne plus suffire. Le suicide de Léon est important; il y a peu de temps encore on ne se serait pas tué pour cela... Hélas! Léon n'avait pas moins à dire que plusieurs autres d'aujourd'hui et qui vivent.—Léon fut plus consciencieux.
Certes M. Mauclair est bien de la famille intelligente des Léon; mais une sorte de ferveur l'anime. Sa pensée, pour n'être pas toujours très autochtone, est véhémente: tout ce qu'il prend s'émeut en lui et se réchauffe; il fusionne passionnément. Bellement soucieux de tout ce qu'il découvre, il consent de s'instruire encore et se complète incessamment; mais son cerveau modeleur achève vite; Mauclair ne se critique pas, mais passe; à la fois penseur et lyrique il semble procéder par bonds.
Parfois quelque excellent article de revue nous fait douter dans quels parages ne poussera-t-il point sa pensée;—réunis prochainement, je l'espère, en volume ces essais paraîtront peut-être la partie la [Pg 198]meilleure de l'œuvre de M. Mauclair, et me seront occasion de louer son esprit généralisateur.
J'avoue que M. Mauclair me plaît moins lorsqu'il généralise ses propres sentiments, comme il fait dans la préface de l'Ennemie des Rêves.—Ses sentiments, il les prête à une génération tout entière. Par horreur de l'égoïsme, croit-il, il ne dit jamais Je, mais Nous. L'expérience, peut-être maladroite, qu'il fit de la vie, il aime à la croire celle de tous; c'est comme telle qu'il la condamne. D'autres peut-être se seront pu reconnaître dans le portrait qu'il fait de «Nous»; moi pas; et qui j'y reconnais surtout, c'est M. Mauclair.
Habile aux avatars, il condamne ce qu'il était au nom de ce qu'il est aujourd'hui; sa nature généreuse et crédule l'y pousse. Depuis la première Eleusis, quel chemin parcouru! Ses regards sur son moi d'hier sont hostiles; mais ses erreurs d'hier, il les généralise et s'en échappe; il les met au présent d'autrui. Il écrit: «Il leur faudrait apprendre d'abord à ne plus tant s'analyser eux-mêmes...» etc.; ou bien: «Le vice essentiel de l'éducation actuelle est d'avoir trop habitué les jeunes hommes à s'occuper constamment d'eux-mêmes, de ce qu'ils sentent.» Ne [Pg 199]pouvant reconnaître moi ni les miens dans ce portrait, je préférerais lire: «Le vice essentiel de mon éducation était de m'avoir trop habitué à m'occuper constamment de moi-même.»—M. Mauclair continue: «Ils ne sortent de cette étude que pour rêver à ce qu'ils devraient ou pourraient éprouver encore...» Je préférerais lire: «Je ne suis sorti d'Eleusis, causerie sur la cité intérieure, que pour écrire Couronne de Clarté.»
Au demeurant, peut-être l'extraordinaire malléabilité de M. Camille Mauclair, en nuisant à l'affirmation de sa propre personnalité indécise, lui a-t-elle permis mieux de comprendre, d'adopter et de représenter une génération anonyme. Ce que je lui reproche donc, ce n'est pas de changer, non certes: c'est, prenant chaque changement pour un état définitif, de renier son état de la veille, sans songer que le présent sort du passé, et qu'il dut, à ce qu'il était, d'être ce qu'il est aujourd'hui. Il peut paraître beau de voir un fervent converti renier et brûler l'idole de la veille, mais M. Mauclair est trop intelligent pour avoir fini de changer; il demeure catéchumène, et si cette ferveur crédule lui fait prendre pour vérité chaque idée qu'il traverse, chaque route qu'il suit pour chemin de Damas, son demain risque [Pg 200]fort de renier son aujourd'hui,—comme son aujourd'hui, son hier.
Aujourd'hui, vive le féminisme! L'«Ennemie des rêves», c'est la femme; et M. Mauclair louera Marthe d'avoir délivré Maxime Hersent de ses rêves; aussi bien les rêves du pauvre garçon tournaient-ils au cauchemar. Mais comme il n'a guère rien en lui que ses «rêves», il y tient.—Maxime Hersent préférera-t-il ses rêves à sa femme, sa femme à ses rêves? incertitude, drame et option, c'est ce que le livre raconte. La femme en veut aux rêves; les rêves en veulent à la femme. Maxime Hersent, qui craint d'être dépossédé, commence par haïr la femme. «Marthe l'irritait par une constante pesée de son regard amoureux. Il s'en devinait suivi et s'en croyait harcelé... Il était appris par cœur.» Plus loin, cette excellente remarque: «Et comme il ne savait au juste ce qu'il désirait, ne se donnant ni raison ni tort, il piétinait entre deux regrets. En réalité il était heureux.»
La figure de Marthe est assez belle et délicatement tracée: «Elle n'avait pas eu de printemps et ne s'en était pas aperçue.»—Mais pourquoi, dès qu'elle parle, dit-elle: «Que faites-vous donc tous? Qu'est-il, votre art? Un fétichisme de subtilité, un nœud [Pg 201]gordien fait de toutes les contorsions nerveuses d'une époque hystérisée.»—Pourquoi dit-il: «J'obéis à la tradition éternelle des artistes, qui est de craindre la femme... Oh! oui, vous êtes dangereuses, ... mais malgré tout nous avons notre domaine, nous fermons la porte derrière nous, nous sommes seuls, quand il nous plaît, face à face, avec notre torture et notre ivresse, humant dans la solitude le poison divin, la plante d'oubli pour la chair vilement vautrée dans le désir de l'éternelle Circé, etc.»—Cela n'est pas naturel.
Les rêves de ce pauvre Hersent paraissent, à travers ces déclamations, si médiocres, qu'on lui pardonne mal d'y tenir. L'ennui c'est qu'aussi l'on pardonne mal à la femme de tenir à Maxime Hersent... Et pourtant le problème existe et si M. Mauclair eût accepté de n'y donner qu'une solution particulière, il nous aurait plus vivement intéressés. Les problèmes psychologiques ne comportent peut-être pas de solutions générales, et la préoccupation de leur en donner une, nuit à la peinture des caractères.—Si l'homme est supérieur, la femme aura tort; si l'homme est médiocre, elle aura raison (le plus simple alors serait de le plaquer). Si tous les deux sont «supérieurs», ils auront [Pg 202]tous les deux raison; avec beaucoup d'amour c'est le paradis; avec un peu moins d'amour c'est l'enfer; question de dosage. S'ils sont médiocres tous les deux,—alors ce sont des discussions infinies, c'est le roman de M. Mauclair.—Ne pas craindre de peindre un héros médiocre, et le peindre sans ironie; preuve d'un grand courage littéraire.
M. Henri de Régnier est aujourd'hui l'un des seuls qui écrivent; il a l'amour et le souci de notre langue; français très exclusivement, il le prouve jusqu'en ses défauts mêmes, si bien que, même de ceux-là, on peut trouver à le louer. Et, certes, le dernier livre de M. de Régnier ne m'empêchera pas de dire le grand cas que je fais de son incontestable talent, l'admiration même que parfois je lui porte,—mais, ayant à parler pour la première fois ici de M. de Régnier, je regrette que ce soit au sujet de la Double Maîtresse.
Non point que la Double Maîtresse ne soit, en son genre et somme toute, réussi,—et peut-être ce livre montre-t-il d'aussi nombreuses qualités que nous pouvions croire et attendre,—mais ces qualités extrinsèques [Pg 204]ne semblent cultivées et poussées qu'en vue d'un effet plus connu; nous regrettons alors des défauts plus charmants; nous cherchons tristement en vain ce que tant nous aimions dans Hertulie et les délicates merveilles du Trèfle blanc, ce souci, cette grâce morose, cette tenue un peu guindée mais digne et donnant plus d'attrait encore au lieu des sensations ingénues.
Mais il importe de situer le livre dans l'œuvre, de comprendre la personnalité de M. de Régnier tout entière et d'admettre que l'auteur de Tel qu'en songe soit aussi l'auteur de la Double Maîtresse. Aussi bien saurais-je montrer que M. de Régnier seul pouvait l'écrire, et que ce livre était en lui tout préparé.—«Je ne sais trop, pour dire vrai, confesse-t-il dans sa préface, d'où j'ai été conduit à écrire ce singulier roman, ni par où il m'est venu à l'esprit. Ce qui est certain, c'est qu'il y trouva presque à mon insu de quoi m'imposer son autorité et me contraindre à faire droit à ses exigences.»—On peut donc aimer ou n'aimer point ce livre, le critiquer ou le louer, l'admirer ou le déplorer au contraire, mais pour s'en étonner, il faut avoir mal compris tous les autres. Voilà pourquoi, bien qu'ayant lu la Double Maîtresse avec plus de [Pg 205]curiosité que d'intérêt,—d'abord parce que les anecdotes piquantes dont la suite immotivée fait le livre sont plus curieuses qu'intéressantes, puis surtout parce que j'estime qu'il était plus curieux qu'intéressant que M. de Régnier l'écrivit—je n'en fus pas autrement étonné.
Qui connaissait M. de Régnier n'ignorait pas qu'il réservait en lui, avec particulière intelligence, un don, sinon de psychologue, au sens plutôt russe du mot, du moins d'observateur à la manière française, et qu'il collectionnait misanthropiquement, comme La Bruyère ses Caractères, tout ce que la mouvante nature humaine pouvait lui présenter de bizarre, de fantasque, de maniaque ou de disconvenu. L'effet lui importait, plus que la cause; chercher d'y remonter, n'était-ce pas risquer de réduire une diversité qui par elle-même amusait; plus peintre que musicien, son esprit se refusait toute synthèse; par raison d'art sa connaissance restait extérieure et pour cela très variée.—C'est ce don qui dans la Double Maîtresse s'exagère avec minutie, mais c'est à lui déjà que nous dûmes ce chef-d'œuvre qu'est l'historiette des Petits Messieurs de Nèvres et certaines pages de Monsieur d'Amercœur, la moins bonne des œuvres de M. de Régnier, mais une des [Pg 206]plus significatives. La grâce d'une mythologie de quinconces et la poudre du siècle dernier s'y mêlaient; les petits dieux et les déesses luttaient encore, marbre ou chair, et cette lutte, qu'ils livraient bien un peu je pense en l'esprit même de l'auteur, faisait presque le sujet du livre; et parfois le contact était exquis, du marbre ou de la chair faunesque avec une costumerie, qui pourrait bien être historique, mais qui paraît seulement surannée. Ici les culottes courtes et les tabatières à vignette ont complètement chassé ce qui restait encore de divin; une licence polissonne remplace cette sorte de demi-chasteté qui peut-être devait sa décence à ce qu'elle gardait d'irréel.
Le libertinage obstiné des romans du xviiie siècle avait pour excuse, pour prétexte ou pour raison d'être les mœurs du temps qu'ils représentent (si tant est qu'il n'ait pas contribué à les faire); je ne vois pas ce qu'il «représente» ici. Ce livre est un amusement d'auteur admirablement doué pour décrire. Le récit est trop objectif, trop parfait pour qu'on soupçonne un seul instant une satire; le charme, ou le brillant du moins, en est si vif qu'il ferait presque naître des regrets pour ces mœurs un peu disparues—regrets fâcheux je pense, car il y eut à cette époque et dans tous ces petits [Pg 207]romans pour la peindre, et dans ce livre enfin, habile à la ressusciter, plus de goût que d'intelligence, plus d'esprit que d'émotion, plus de débauche que de sensualité profonde, de gourmandise que d'appétit réel.—Cette époque, de grands et graves esprits la sauvèrent. Que resterait-il d'elle, sans eux? On les accuse d'avoir fait la Révolution; mais c'était empêcher une dissolution. Dans ce roman galant, rien ne l'empêche; que dis-je? tout y porte et tout la favorise; le cynique Lamparelli, cardinal romain, l'épicurien Hubertet, abbé de France, vilainement ou délicatement y travaillent; elle emplit le livre, l'émeut, en fait le principal délice, elle y est peinte avec beaucoup d'attrait.
Que Nicolas de Galandot, à Pont-aux-Belles d'abord, avec sa cousine Julie, puis à Rome, avec la belle et très facile Olympia, se soit appris piteusement qu'il était peu fait pour l'amour, c'est ce qui donne son titre au livre, comme l'explique vers la fin cette phrase: «Qui eût pensé que le pauvre gentilhomme servait, en une double maîtresse, le fantôme d'un amour unique et deux fois vain?»—Mais l'histoire de Galandot ne tient que la moitié du volume; celle de M. de Portebize s'y mêle de la façon la plus inattendue,—ou [Pg 208]plutôt ne s'y mêle pas, mais la coupe; et les deux histoires, qui se passent à quelque cinquante ans de distance, alternent; les chapitres II et IV sont consacrés à Nicolas de Galandot; les chapitres I, III et V à François de Portebize, son neveu et son héritier. Le neveu n'a pas connu l'oncle, et c'est pourquoi l'on nous raconte son histoire; mais comme il n'apprend l'existence de son oncle qu'en apprenant aussi sa mort, aucun rapprochement n'est possible; les deux histoires ne se rejoignent pas. Un seul des personnages passe de l'une à l'autre; c'est l'abbé Hubertet qui, vers 1730, s'occupait de l'éducation du petit Nicolas, tout en mangeant les savoureuses poires de madame de Galandot; François de Portebize plus tard le retrouve à Paris, où il élève, pour les ballets de l'Opéra et pour les plaisirs de François, la jeune et charmante Fanchon. Et sinon, d'une histoire à l'autre, à peine un rappel, un écho, comme une très lointaine résonnance; et gêne et plaisir à la fois naissent de cette juxtaposition si spécieusement délicate.—J'oubliais l'urne de bronze vert que Galandot d'abord envoie de Rome à son vieux maître; Hubertet mort, Portebize l'hérite; dans sa fraîche Folie de Feuilly, les colombes de Fanchon s'y posent; «On entendait sur le métal le grincement [Pg 209]des pattes écailleuses ou le frottement du bec de corne. Puis l'oiseau s'envolait, et le vase seul restait debout.»
Je ne raconte point ce livre; ce serait tâche trop ardue. Les petits événements qui s'y suivent sont presque d'égale importance; le récit en est si bien fait qu'on n'en pourrait rien supprimer. L'amusement que j'y pris fut vif, mais successif; chaque perle de ce collier me plut parce qu'elle fut charmante déformé ou brillante, mais je n'en pus saisir fortement le lien; c'était plutôt de l'une à l'autre la fine attache d'une convenance esthétique, qu'une intime nécessitation; de sorte que, le livre lu, je n'en aurais pu rien retenir qu'un miroitement de parure, si chaque figure d'acteur et chaque événement du récit n'était décrit de manière si vive, qu'il imposât sa vision précise à l'esprit. C'est le pauvre M. de Galandot, qui promène au soleil de Rome son impuissance résignée; c'est Julie de Mausseuil que corrompt le vieux Portebize; c'est le ménage du Fresnay, c'est ... le roman ne se raconte pas, il s'énumère... C'est le vieux Galandot, le père, qu'on ne fait qu'entrevoir mais dont il nous est dit qu'«il n'avait guère de goût que pour le jeu, [Pg 210]moins ceux de cartes que tels autres, non les échecs par exemple dont la difficulté le fatiguait vite, mais les jonchets qui le divertissaient infiniment. De sa belle main sortant des dentelles de la manchette, il débrouillait l'enchevêtrement capricieux des petites figures taillées dans l'os ou l'ivoire et mettait à cette tactique une patience et une dextérité remarquables.» Et si je cite cette phrase charmante c'est que l'intrigue même du livre aux délicates figures m'apparaît, patiemment et dextrement débrouillée, comme le jeu de jonchets de l'auteur.
Voilà donc ce singulier livre, à la fois déplorable et plaisant. Que si celui qui vient de lire ces lignes hésite et doute si je l'aime ou non, c'est bien que je doute moi-même.—Sur un de ses tout premiers livres, M. de Régnier a mis en épigraphe cette parole des Goncourt: «On n'écrit pas les livres qu'on veut.» Quand je me souviens bien de ce mot, j'ose aimer la Double Maîtresse[1].
On peut aimer ou ne comprendre point la Bible, aimer ou ne comprendre point les Mille Nuits et une Nuit, mais, s'il vous plaît, je partagerai la foule des pensants en deux classes, à cause de deux formes inconciliables d'esprit: ceux qui devant ces deux livres s'émeuvent; ceux devant qui ces livres restent et resteront fermés. Faut-il les plaindre? non; sans doute qu'ils ont d'autres joies. Mais avec eux je ne saurais bien m'entendre; ce qui les intéresse surtout, ne m'intéresse pas beaucoup, et, réciproquement, quand ils m'écoutent c'est qu'ils se trompent; je commence un malentendu.
Par la grâce de quelles conjonctures heureuses, le [Pg 212]Dr Mardrus, à la fois oriental et roumi, arabisant d'enfance et sûr lettré français, se trouve-t-il, avec les droits d'unique héritier légitime, naître pour nous montrer cette littérature admirable; moi naître juste à temps pour l'écouter et pour le lire ... c'est ce dont je ne me lasserai point de nous féliciter tous deux.
Dans les Mille Nuits et une Nuit, comme dans la Bible, un monde, un peuple entier s'expose et se révèle; le récit n'a plus rien de personnellement littéraire, et seules les parties lyriques sont pour nous dire qu'un homme était là, qui chantait. Le récit est de la voix même du peuple; c'est son livre, et c'est tous ses livres, sa littérature, sa Somme; il n'a produit rien d'autre que cela.—Que m'importe dès lors que le conte ici parfois traîne, qu'une souplesse manque à ce contour, que parfois tel sanglot soit trop bref; que tel rire paraisse un peu rauque; il ne s'agit plus de la Grèce et de sa souriante eurythmie, de Rome et de sévérité latine; c'est une autre race qui parle; il faut la prendre telle, ou ne pas l'écouter du tout; on lit ce livre comme on voyage; partons-nous, que ce soit sans bagages; il faut n'emporter rien, oublier tout; ici comme à Baghdad l'habit européen fait tache; si [Pg 213]l'on ne peut d'abord s'y vêtir à l'arabe, alors il faut y entrer nu.
J'eus la chance d'entrer nu dans ce livre: je veux dire que c'est, je crois, avec la Bible, le premier livre que j'ai lu. Contes charmants! Je racontais ailleurs l'enchantement de ma première enfance... Pourtant qu'en connaissais-je! que ce qu'une première traduction, apprêtée à l'excès, réformée, voulait bien m'en laisser connaître. Heureusement! car cette traduction de Galland devait laisser à celle de Mardrus sa fleur, toute son authentique saveur et comme sa virginité. Je retrouve à la lire aujourd'hui une surprise aussi parfaite et tout mon enfantin plaisir.
D'abord j'entrai nu dans ce livre; à présent je m'y vêts à l'arabe. J'oublie passé, futur, lois, religion, morale et littérature, et contrainte; j'emplis de moi la minute présente, et, comme je fais en voyage, j'ai soin surtout de ne pas me faire remarquer,—pour ne plus trop me remarquer moi-même. Au bout de peu de temps je m'aperçois que c'est sans peine; je n'ai pour ressembler à tout, ici, qu'à me laisser aller à moi-même, jusqu'à redevenir naturel. Non point que je me découvre des goûts très particulièrement arabes, mais bien parce que les us de chacun sont ici très [Pg 214]généralement et naturellement humains. Ici,—non plus comme en la Bible,—aucune menace divine n'y contrefait l'homme à plaisir. Ici l'instinct seul, charmant ou vil, propose ce qu'Allah favorise ou non.
—Un seul récit, dans ces quatre volumes, un court récit de quatre pages, qui semble de tradition différente et comme une importation, donne un exemple d'abstinence: Un berger très pieux, dans une Thébaïde, est tenté. Allah, pour l'éprouver, permet que le visite une riante adolescente «qui pouvait bien passer aussi pour un adolescent». La grotte en est du coup parfumée, et le berger sent «sa vieille chair frissonner», mais résiste; l'adolescente insiste; Le berger résiste toujours, puis enfin se retourne «entièrement du coté du mur», c'est-à-dire, je pense, du côté de Dieu,—de sorte que l'adolescente presque à bout de charmes s'écrie: «O saint berger! bois le lait de tes brebis; et habille-toi de leur laine, et prie ton Soigneur dans la solitude et dans la paix de ton cœur!»—puis disparaît. Et le vieux Sultan Schahriar, que cette morale imprévue déconcerte, s'écrie, un instant alarmé: «En vérité, Schahrazade, l'exemple du berger me donne à réfléchir! Et je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux pour moi me retirer aussi dans [Pg 215]une grotte...» Heureusement que bien vite il ajoute: «Mais je veux d'abord entendre la suite de l'Histoire des Animaux et des Oiseaux!»—de sorte que le cours un instant troublé du récit continue et que Schahriar, à la nuit suivante, peut dire: «O Schahrazade, les paroles ne font que me confirmer dans le retour vers des pensers moins farouches.»—Schahriar, sultan luxurieux, que vous avez raison d'écouter plus longtemps les histoires! quel mauvais saint vous eussiez fait!
Aussi bien les «paroles des animaux et des oiseaux» sont charmantes.
—«Mais que peuvent bien dire les animaux et les oiseaux? questionnait d'abord Schahriar; dans quelle langue parlent-ils?—En prose et en vers, dans le pur arabe», répond Schahrazade aussitôt. Et quand les animaux ont parlé:
«Que leurs propos sont admirables! ne peut se retenir de crier Schahriar,—et que ces animaux sont bien doués!»—Pourtant le paon et la paonne, l'oie, le chameau, le cheval, l'âne ont parlé si naturellement que l'on ne peut imaginer pour eux d'autres paroles, et que ces seyantes paroles on ne peut les prêter qu'à eux.
[Pg 216]Entre tous leurs propos, ceux de l'âne sont remarquables. Il conte ce qu'a fait de lui l'homme; il se plaint:
«Sache, en effet, dit-il au jeune lion,—sache que je lui sers de monture!» puis il décrit au lion chaque pièce de son pauvre harnachement. «Et c'est alors, ajoute-t-il, que lui me monte, et que, pour me faire aller plus vite que je ne peux, il me pique le cou et le derrière avec un aiguillon. Et si, fourbu, je fais mine d'aller moins vite, il me lance d'effroyables malédictions et des jurons qui me font frissonner, tout âne que je suis, car devant tout le monde il m'appelle: «E...! f... de p...! f... d'e...! le c... de t. s...! coureur de femmes!!»—M. Mardrus écrit les mots en toutes lettres. On le lui reprocha. C'est absurde.—On lui dit (ce fut spécieux) que ces mots, si gros dans notre langue polie, n'ont plus là-bas même valeur; qu'ils sont d'usage si courant que personne ne s'en étonne (et le peu que je sais d'arabe me permit de les reconnaître, en effet, sur les lèvres de petits et purs enfants); qu'il s'agit pour le traducteur de trouver des équivalents; qu'il fallait traduire par exemple: f... de p... par: «bouffi!» et: le c... de t. s... par: «chameau!» C'est absurde! Car l'âne alors se serait-il [Pg 217]scandalisé? Tant pis pour eux si les critiques sont des ânes.
D'après eux il aurait fallu, sous prétexte qu'un vocable «courait», enlever à la langue arabe toute sa spéciale saveur. Il est certain que chaque langue est farcie de métaphores si «courantes» qu'on n'en peut rattraper le premier sens; l'image sous le mot se recule, s'éteint enfin complètement; le costume élégant et rare devient habit de chaque jour. C'est pourquoi bien des phrases ici, qui nous paraissent de goût puissant ou de grâce plaisante, ne sont plus que banales formules là-bas.—Si Mardrus, comme on s'en est plaint, redonne à chaque locution sa complète valeur, son relief, faut-il l'en blâmer? Certes pas! S'il traduisait l'œuvre d'un homme, il pourrait avoir tort parfois, et prêter à l'auteur, ce faisant, trop d'intentions et de sens;—mais ici l'œuvre est anonyme; encore un coup c'est un peuple qui parle; sa langue il l'a lui seul formée: en redonnant à chaque mot sa valeur complète et native, le Dr Mardrus à la fois nous permet d'entrer mieux dans la pensée même du peuple, dans sa pensée en formation,—et fait œuvre de bon écrivain.
«A un monde faire connaître un autre monde», [Pg 218]telle est sa légitime prétention. C'est là ce qu'il promet et que nous désirons. Par des équivalents, fussent-ils très exacts, qu'eût-il montré de tout cela? Tout au plus eussions-nous pu juger, lisant ces contes en une telle adaptation, de leur «vraie valeur littéraire»; précisément ils n'en ont point; ou du moins ce n'est pas par là qu'ils importent.
Et voilà comment et pourquoi le Dr Mardrus, d'un texte arabe parfois de langue très banale et lâchée, nous donne une version sans cesse prestigieuse.
J'aurais à dire, de ce dernier volume et des trois autres, des choses en grand nombre encore,—mais douze volumes doivent suivre et je voudrais me réserver, craignant d'avoir à louer plus que je ne saurai de louanges.
Le livre des Mille Nuits et Une Nuit, tome VI. Traduction littérale et complète du texte arabe, par le Dr J-C. Mardrus.
Cinq volumes ont déjà paru. Aujourd'hui voici le sixième et nous gardons, comme nous garderons encore pour les dix autres, un étonnement non lassé.
Ici, pour la première fois, nous voyons apparaître [Pg 219]enfin la figure d'Abou-Nowas, de cet extraordinaire poète, ivrogne, pédéraste, libertin, demi-fou de Haroun Al-Rachid, aussi connu par ses bons mots, ses facéties, que par ses vers—dont, aux échoppes des libraires, pour deux sous, les petits enfants de Tunis achètent la scabreuse et populaire histoire, comme les petits enfants sages, ici, celle de Duguesclin ou Bayard. C'est Abou-Nowas qui disait, comme Haroun Al-Rachid lui demandait, à lui qui la pratiquait si bien, de parler un peu de l'ivresse:
—«Sire, comment le ferais-je: mon ivresse, je ne la peux point voir; et quant à celle des autres comment la connaîtrais-je?—Sur la natte de la taverne, je suis toujours le premier ivre et le dernier.» Mais l'aventure qu'aujourd'hui rapporte de lui la sultane ne satisfait pas Schahriar: c'est, je crois, la première nuit qu'il se fâche, et, tandis que la petite Doniazade enfonce son visage dans le tapis pour tâcher d'y étouffer son rire, le roi s'écrie: «Je n'aime pas du tout cet Abou-Nowas-là! Si tu tiens absolument à avoir la tête coupée sur l'heure, tu n'as qu'à continuer le récit de ses aventures. Sinon, et pour achever de nous faire passer cette nuit, hâte-toi de me raconter une histoire de voyages; car depuis le jour où, avec mon frère [Pg 220]Schahzamân, roi de Samarkand Al-Ajam, j'ai entrepris une excursion aux pays lointains, à la suite de l'aventure avec ma femme maudite, dont j'ai fait couper la tête, j'ai pris goût à tout ce qui a rapport aux voyages instructifs.» Suit le célèbre récit de Sindbad le Marin.
D'autres discuteront, diront si ce conte est d'une tradition différente. Dans une brève et mordante réponse à quelques impertinents chamailleurs, le docteur Mardrus nous annonce qu'il «se réserve, une fois tout son ouvrage publié, de faire paraître une vue d'ensemble sur les Mille Nuits et Une Nuit, en un volume pesant, documenté et suffisamment indigeste pour faire le bonheur des vénérables savants». C'est nous engager sagement à prendre d'ici là un plaisir purement artistique. Faisons ainsi. Nous ergoterons après.
Aussi bien, de toutes celles des Nuits, la figure vieillie de Sindbad est-elle une des plus admirables. Nulle obscénité dans ce récit; cela change. C'est donc celui qui nous surprend le moins dans sa traduction nouvelle; mais c'est aussi celui, je crois, dont cette nouvelle traduction fait le plus négliger toutes les traduction précédentes. Je veux dire que, dans quelques [Pg 221]récits d'intrigue plus amoureuse et plaintive, certaine grâce atténuée que, facticement, laissait traîner Galland, pouvait y plaire. Ici plus rien de doux, de languissant n'était possible: le récit de Mardrus se superpose point par point au récit de Galland, le remplace absolument, le supprime.
Je ne peux raconter à neuf ces aventures que chacun connaissait déjà, que les lecteurs de cette revue[1] ont eu le plaisir de goûter avec toute leur saveur nouvelle, ici même. Cette saveur persiste dans l'esprit, l'embrume et l'engourdit comme fait la vapeur subtile et capiteuse de certains aromates d'Orient. Que nous sommes loin de la Grèce! ici même où, par l'Odyssée, nous en pourrions le plus approcher. Mais Sindbad, πολυτλας comme Ulysse, n'a pour l'attendre aucune Ithaque, aucune femme, aucun fils, aucun chien. Ce ne sont pas non plus les sentiments qui le gênent. Nul être plus libre, plus détaché de tout, plus flottant. Même il n'a, semble-il, d'autre «figure» que celle que ces aventures vont lui faire; il paraîtrait sans caractère aucun, n'était cette passion unique qui précisément le précipite à l'aventure: une inlassable curiosité.—Cette [Pg 222]passion tient, non seulement dans l'histoire de Sindbad, mais dans tous ces récits arabes, tant déplacé qu'il semble, par comparaison, qu'elle n'en tienne aucune dans notre littérature, dans nos mythes, ou dans nos récits populaires. La curiosité de Pandore, celle d'Eve, celle de Psyché est de nature si différente! Combien elle est ... occidentale—il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Orientale serait celle de l'épouse de Barbe-Bleue, celle de la Marienkind des contes populaires allemands, mais combien pâle elle apparaît, et tremblante, et doutant de soi, auprès de celle de Sindbad, des trois saâlik, de Kamaralzamân. Remarquons d'ailleurs que, dans la tradition de l'occident, la curiosité est réservée aux femmes, et que les hommes n'y ont pas droit. C'est qu'ici la curiosité est faiblesse. Elle est toute audace là-bas. C'est une sorte d'avidité de l'esprit et des sens qui détériore le goût du présent au profit de la plus chanceuse aventure; c'est un désir de risque qui devient d'autant plus aigu que le confort où l'on vit est plus grand. Sindbad possède de nombreux biens; il les dissipe plus vite encore qu'il ne s'en lasse; il semble ne goûter dans le luxe et dans l'abondance qu'un sentiment de satiété, d'ennui, qui précisément le dispose à partir. Ses aventures, [Pg 223]sept fois, sont cruelles; sept fois il se repent d'être parti; chaque fois que s'offre à lui une façon de mourir nouvelle, celle qu'il venait d'éviter lui paraît aussitôt maintes fois préférable; n'importe! rien ne peut le lasser, quand il possède, de risquer, quand il n'a rien, de conquérir. Rien du guerrier d'ailleurs; il reste commerçant dans l'âme; pas plutôt échappé à la mort, il trafique; son courage est tout négatif; c'est une résistance simplement; il se défend très bien et s'obstine à ne pas mourir avec grande ingéniosité. «Mon premier mouvement, dira-t-il après une nouvelle épreuve, fut d'aller me jeter à la mer pour en finir avec une vie misérable et pleine d'alarmes plus terribles les unes que les autres; mais je m'arrêtai en route, car mon âme n'y consentit pas, étant donné que l'âme est une chose précieuse; et même elle me suggéra une idée à laquelle je dus mon salut.»
De sorte que sans cesse les deux états se succèdent; de sorte qu'il dira tantôt: «Dans la délicieuse vie que je menais depuis mon retour de voyage, au milieu des richesses et de l'épanouissement, je finis par perdre complètement le souvenir des maux éprouvés et des danger courus, et par m'ennuyer de l'oisiveté monotone de mon existence à Baghdad.—Et tantôt, au [Pg 224]milieu des tribulations: «Tu mérites bien ton sort, Sindbad à l'âme insatiable!... Qu'avais-tu donc besoin, misérable, de voyager encore, alors qu'à Baghdad tu vivais dans les délices?... Que manquait-il à ton bonheur...» Il y manquait précisément d'être risqué...
J'eusse voulu parler aussi de l'autre Sindbad, du «terrien», qui dans Galland s'appelle Hindbad, du portefaix, de l'écouteur des récits merveilleux que le marin Sindbad lui fait, pour lui montrer (avec quelle prudence amusée!) qu'il n'a pas à lui envier ses richesses, car elles sont le fruit d'extraordinaires labeurs; mais ces labeurs sont si surprenants, inouïs, ils sont contés si joliment, qu'on se prend à les envier plus encore que les richesses.—J'eusse voulu rapprocher la figure du pauvre Sindbad de celle du porteur des premiers contes, de celle du dormeur éveillé et de celles de plusieurs autres—pour parler du sentiment des classes sociales particulier à tous ces contes, de la pénétrabilité (si j'ose ainsi parler) de ces classes, de l'amour de ce que Nietzsche appellera: les mauvaises fréquentations»... Mais j'attends que de nouveaux volumes aient paru.
[1] Le conte de Sindbad avait paru, ainsi que cet article, dans la Revue Blanche.
L'orgueil des grands m'offusque moins que ne m'irrite la sottise de celui qui le leur reproche. On voudrait, semble-t-il, qu'ils s'ignorent, ou qu'ils feignent de s'ignorer. L'étonnement que cause leur génie, on ne veut pas qu'ils le partagent; on leur sait gré pourtant d'admettre que le génie procède du Divin, etc. Leur attitude est difficile.—A ceux à qui leur orgueil ne plaît point, j'aime redire le mot de Gœthe: «Il n'y a que les gueux pour être modestes.»—Hélas! pourquoi n'y a-t-il pas que les gens de génie pour être orgueilleux?
Lorsque M. de Bouhélier naissant voulut bien annoncer à la France qu'il allait faire une renaissance [Pg 226]littéraire, je me suis immodérément réjoui. Ses premiers écrits étaient beaux, sonores, pleins de sublime vague et de précis orgueil. L'abondante négligence de presque tous les écrivains d'aujourd'hui me fit apprécier d'autant plus, chez un si jeune, une phrase toujours formée, souvent plus mûre que la pensée, mais véhémente, de charme grave et de nombreuse eurythmie.—M. de Bouhélier s'avança comme un dieu. Tous ceux qui l'approchaient devenaient aussitôt ses disciples. Il parlait peu, mais semblait écrire à voix haute; on n'attendait de lui rien que de déclamé. Le vent qu'il respirait s'enflait autour de lui de promesses. Romans, drames, poèmes ... on attendait. Il annonçait toujours.—On attendait.
Et la Route Noire a paru... Je voudrais parler doucement de ce livre.—J'eusse eu réel plaisir à le louer, et déjà ma louange était prête ... mais, hélas! je voulus d'abord lire le livre, et, vite, dus me rendre à cette pénible évidence: M. de Bouhélier ne sait plus le français.
Je dis: plus—car, chose bizarre, en ses premiers écrits, rien de bien alarmant encore. On imputait plutôt l'imprécision des épithètes, qui surtout pouvait étonner, au vague de la vision, à l'imprécision des [Pg 227]idées. Procédé, me disais-je souvent; au moins croyais-je cela conscient et volontaire. La phrase n'était pas châtiée, mais elle paraissait solide. Et peut-être un disciple instruit avait-il pris le soin de revoir d'abord les épreuves ... toujours est-il que les quelques fautes, noyées, pouvaient passer inaperçues. Là où désormais l'on s'écrie: quelle ignorance! on pouvait dire encore: quelle hardiesse!—et tant qu'il n'avait pas écrit: «des épices secs» (p. 72), on pouvait prendre les «branches rubicondes» (p. 270) pour une audace, les «plumages coloriés» (p. 273) pour une négligence.
Mais tout cela s'additionne, s'aggrave, encourage notre blâme naissant. La faute d'orthographe promet la faute de syntaxe, qui promet à son tour bien pis. Fautes de relation, de coordination, de rapport... M. de Bouhélier tient ses promesses, et l'illogisme de cet esprit devient flagrant.
Il écrit: «J'en ai vues» (p. 50), «J'en ai eues» (p. 167), «Ne te récries pas» (p. 176), «Ne vas pas croire» (p. [180), et, par contre, «suppose-tu que...» (p. 187).
J'avais passé légèrement sur «Si j'eus nié les talents de ce poète» dans l'Hiver en méditation, et sur «ces [Pg 228]méditations ne seront pas sans quelque prix si de jeunes auteurs lui en trouvent assez» (p. 272); mais dans la Route Noire je retrouve: «Quand je débouchai près du quai, leur couleur, leur tohu-bohu me saisirent fort» (p. 265). Il n'y a pas là simple erreur, inadvertence ou négligence; il y a illogisme, vague, incoordination des sensations, des sentiments et des pensées. Celui qui fait dire à une femme: «Il n'en est pas un seul qui m'ait compris» (p. 106) est aussi bien celui qui écrira: «Aucun des quolibets ne parvint jusqu'à lui. Les écailles de poisson pourri, les fruits en décomposition, les bouts de paille et de fumier que lui jetaient les boutiquières, rien ne réussit à l'atteindre» (p. 158).—Le même indiscernement, le même illogisme lui feront dire: «Quel mal faisait ce perroquet? En revanche, il mettait partout la gaîté» (p. 229). Et, quand sa maîtresse l'abandonne: «J'aurais pu la croire en promenade. Je n'en eus pas même l'idée. Je ne sais quel pressentiment m'avertissait du contraire» (p. 257). Faut-il citer encore? «Rien ne m'avait ému hors de moi-même» (p. 180). «Le scorbut, la fièvre, les luttes ne les avaient pas épargnés les uns les autres» (p. 216). O notre belle langue! école de pensée... M. de Bouhélier ne sait pas le français.
[Pg 229]L'ignorance des mots reflète l'inconnaissance des objets. «Il y a ainsi bien des mots, avoue-t-il, dont la forme, le volume, le taux, la densité ne nous sont aucunement connus, quoique nous les utilisions à tout propos «(p. 200). Tel le mot «conjoncture» qu'il emploie à trois reprises dans le sens «d'événement»; le mot «dilection» (pour «délectation», je suppose): «Te presser sur mon cœur n'en est pas moins une profonde dilection» (p. 180). «Je goûtais moins de dilection à voir Lénore, que...» (p. 85). Déjà dans l'Hiver en Méditation il écrivait: «L'insufflation des dieux l'inspire», et nous n'y prêtions pas grande attention,—«des précipices, par interstices, découpent d'épaisses grottes grondantes de glaciers», et nous passions,—mais à présent, de plus belle, il écrit: «Puis il se produisit soudain une circonstance» (p. 231); sur les quais de Paris il entend «des tonnes bombées qui sonnaient en heurtant la pierre des estacades» (p. 266). «Elle entrait dans une sombre extase quand je lui disais que nulle femme n'était plus belle, que son souvenir resterait intact... que je lui garderais son contour» (p. 225).
—«Si j'insiste sur ces choses (dit-il, et dis-je avec lui), c'est qu'elles ont une grande importance à mon [Pg 230]avis.—. Nous ne nous comprenons si peu les uns les autres que parce que nous utilisons une infinité d'adjectifs, de verbes, de conjonctions, de noms propres et communs, dont nous n'avons pu établir la vraie valeur» (p. 200). Aussi écrira-t-il sans gêne: «Je gardais mon air restreint»; «l'air était strict et mat; «son teint était rouge et compact»; «ces lieux autrefois si placides étaient pétulants et commerciaux» (p. 265); «ma course a été frénétique et mouvementée» (p. ibid.).—Une femme reste-t-elle assise pendant qu'on lui raconte un voyage, elle dira: «De cette manière je m'intruisis en restant stable» (p. 216). On lui parlera de «sites polaires ou antarctiques» (p. 226). «Au Midi ou dans les régions de l'Antarctique, elle avance» (p. 226); etc., etc.
—Vous cherchez les puces du lion.
—Non, monsieur! je cherche un lion sous des puces.
Assez longtemps je crus au lion;—j'ai besoin de croire aux grands hommes. Je me réjouissais d'abord de voir M. de Bouhélier tomber le naturalisme,—écrire: «Comme l'on était au printemps les arbres pliaient sous le poids des poires[1].» Nous n'avions [Pg 231]pas de répugnance foncière à voir Edmond, son héros, sortant dans les premiers jours de printemps, être ému par «l'incarnat d'une pomme ou d'un coquelicot» (p. 45). Nous nous plaisions à imaginer, avec l'auteur, des marchandes ambulantes promenant au mois de juillet «des pommes d'api» (p. 131) et des «bananes» (p. 195); je ne m'irritais pas non plus de voir sur les quais du «port» de Paris «les steamers charger du charbon» ou décharger «les toiles précieuses des colonies, le minerai et les houilles brillantes, les graines rapportées des tropiques, les pâtes curatives et utiles, etc., etc. (p. 226),—j'ai bien écrit le Voyage d'Urien;—enfin je suis trop convaincu de la fausseté des théories naturalistes pour ne pas lire avec joie telle description à la manière épique: «Des voitures chargées de bananes, de tomates, de noix de coco encombraient la voie populaire et rocailleuse. (Nous sommes à Paris au mois de juillet.) Autour bavardaient des commères au teint de pourpre ... de figure encarminée et écaillée. En piétinant elles écrasaient des céréales. Elles broyaient des fraises sous leurs pas sur le trottoir... Des melons tombaient dans des sacs. Des bonds de noix et d'abricots produisaient un sonore grondement sur le pavé. On entendait rouler des poires noires et [Pg 232]opaques» (p. 196).—Mais quand j'entends parler d'un «chardonneret vert», appeler un perroquet «l'oiseau au bec rouge» (p. 10), je proteste et ne sens plus qu'une chose: l'auteur n'a jamais rien su voir, rien regardé que son génie.
Cependant M. de Bouhélier ose écrire, dans la Revue naturiste de décembre dernier:
Apprendre la chimie, la physique, l'astronomie, l'algébre, Hydraulique, la médecine et la géologie, afin d'en appliquer les lois à l'esthétique, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ne jamais cesser de s'instruire dans toutes les matières possibles, étudier la dialectique ... faire des voyages, voir des contrées, accomplir le périple du monde, aller sans cesse d'un pôle à l'autre, observer les mœurs des contrées les plus lointaines, comparer les flores, les parfums, les lumières et les aromates du sud au nord, voilà quelques-uns des devoirs qui nous incombent (J'en ai sauté).
Si nombreux qu'ils soient, ils ne sont pas tout...
En effet, monsieur de Bouhélier, il reste encore celui d'apprendre le français.
Peut-être, après, sentant vous-même le vide affreux de votre pompeux pathétique, rougirez-vous d'écrire des dialogues comme celui-ci:
[Pg 233]«Mes récits t'ennuient?—Pas du tout.—Tu parais fâché!—Je n'ai rien.—Allons donc, Edmond.—Je t'assure.—T'ai-je fait du chagrin?—Toi! aucun.—De quel ton furieux tu me dis cela!—Ce n'est pas ma faute.—Tu es las peut-être? [Ils ont passé la nuit ensemble.]—Qu'ai-je donc fait pour l'être?—Oh! oh! tu veux rire...»—«Pourquoi te montres-tu si cruel? Et toi, pourquoi es-tu si fausse?—Tu me mets au désespoir!—Moi j'y suis depuis longtemps.—Ne te souviens-tu plus de rien?—Souhaite plutôt que j'oublie tout.—En quoi t'ai-je déplu?—En voulant me plaire.—Comme tu es changé! Tu me hais.—Que veux tu? Tout casse et tout lasse.—Tu dois bien souffrir pour dire de pareilles choses!—Mais non, je t'assure.—Que tu es méchant!—Je pourrais l'être bien davantage.—Oh! Edmond, quel mal tu me fais! etc.» (p. 79)[2].
Peut-être rirez-vous vous-même de ces phrases saugrenues contre lesquelles on butte à chaque pas, dans ce volume: «Juliette est douce, disait Lénore. De la voir entre une branche de rose et une feuille [Pg 234]cuite(!), je me sens toute réconfortée au-dedans de moi» (p. 247).
—Mais que me font, direz-vous, ces erreurs si le livre lui-même est bon?—Mais, monsieur, comment voulez-vous que cela soit? L'auteur n'a pas changé, pour penser ce livre et pour écrire ces phrases. Le livre, l'auteur et cela, c'est tout un.—J'y mets de l'acharnement, direz-vous.—Oui certes! le plus possible; et je défends mon bien. Notre admirable langue française, des gâcheurs sont en train de la dénaturer et de la perdre: parfois, malgré mon espérance, m'envahit une grande tristesse ... je pense alors que nous n'avons pas trop d'un Pierre Louys, d'un Francis Jammes, d'un Régnier, d'un Marcel Schwob[3], pour assurer à chaque mot français «sa forme, son volume, son taux, sa densité», comme dit sans rougir notre auteur.
Mal rugi! jeune lion Bouhélier, mal rugi!—Reprenez; reprenez.
Peu de temps après cet article, M. de Bouhélier, avec une grande courtoisie, voulut bien écrire sur ma conférence: de l'influence en Littérature qui venait de [Pg 235]paraître, quelques phrases de grand éloge que, disait-il, l'injuste violence de mon article ne savait lui faire modifier. A cette occasion, me reprochant de n'avoir point voulu reconnaître la beauté de son livre, il établissait que la beauté de ce livre était telle que seuls quelques griefs personnels pouvaient m'empêcher de la voir. Par la même occasion M. de Bouhélier me reprochait mon «sourire», indice d'un «esprit léger». Je redonne ici la lettre que je lui répondis, telle qu'elle parut dans l'Ermitage d'Août 1900.
Je conviens, Monsieur, que vous avez pris le beau rôle, et que je vous l'avais laissé. Plus que l'accent de la critique, l'accent de la louange est délectable; que si mon modeste opuscule vous donne occasion de le prendre, j'en suis heureux. Vous forcez mon remercîment; je vous l'adresse sans gêne aucune.—La véhémence de mon article sur vous ne saurait, dites-vous, influencer votre jugement sur mes œuvres, ni vous faire trouver ma conférence moins excellente. Je [Pg 236]vous estime assez pour le croire. La gentillesse de votre éloge, de même, ne saurait, hélas, me faire trouver La Route Noire moins mauvaise.—Vous me forcez d'y revenir; sachez bien que j'en suis désolé.
Vous posez que, pour n'aimer point un tel livre il faut être ou aveugle, ou de mauvaise foi, et (car vous m'octroyez de la finesse) vous parlez donc de griefs personnels. Je vous affirme qu'il n'en est point. Tout me portait vers vous, au contraire; et bien des sentiments m'y porteraient encore; mais deux choses m'écartent, que je ne puis aimer, que je ne peux souffrir—ou du moins souffrir réunies:—La suffisance—qui, à peine passé vingt ans, vous fait écrire: «J'ai longtemps cru que la douleur devait être exclue de l'étude de l'art»[4] et l'ignorance.
Vous prétendez donner cet exemple impossible d'un grand artiste qui ne sache pas son métier.
Vous abîmez notre langue, Monsieur; voilà mon «grief personnel». Vous citez (dans une extraordinaire phrase[5], que je relis encore avec un étonnement [Pg 237]grandissant)—les hardiesses de Saint-Simon, Hugo «chez qui fourmillent tant d'erreurs». Je ne reconnais pas les erreurs de Hugo—et, quand vous écrivez, comme dans votre dernière revue[6]: «Le grand perfectionnement que Rodin a apporté à la statuaire a été de substituer à l'étude de la dynamique l'étude de la statique», je prétends que ce n'est pas par «hardiesse» que vous dites strictement le contraire de ce que vous voulez dire—comme le montre la fin de votre phrase: «Je veux dire par là, à la science de l'équilibre stable, celle de l'équilibre mobile.»
Parce que je souriais souvent (c'est le plus gros de vos reproches) vous m'avez cru sans passion. Vous vous trompez. Le rire n'empêche pas la haine, et ni le sourire l'amour.—Mais je veux, ici, puisque mon rire vous déplaît, cesser de rire et parler franc:—C'est parce que j'aime mon art que je hais le journalisme qui le détruit. Par le mot journalisme, j'entends [Pg 238]beaucoup, j'entends trop; j'entends aussi le mal écrire, quand il devient le fait d'un écrivain-né, tel que vous.—Au revoir, Monsieur; j'attends les livres que vous annoncez avec faste; croyez bien que, s'ils sont meilleurs, nul ne sera plus heureux de le reconnaître que
Votre cordial serviteur
A. G.
10 août 1900.
[1] Je m'excuse de citer de mémoire et peut-être imparfaitement cette phrase.
[2] Que le lecteur me pardonne une si longue citation; je ne l'eusse point faite si je ne lisais à l'instant dans la Revue de M. de Bouhélier que nous ne saurions trouver dans «Werther, Adolphe ou les Confessions d'un enfant du siècle ... une page d'un goût plus âcre et plus pénétrant.» Plus loin le même disciple comparera cela à du Dostoïevsky.
[3] Ecrit en 1901.
[4] Revue Naturiste de juillet (Etude sur Rodin)
[5] Textuellement: «Tous les arguments possibles tirés de l'éthnographie, de la botanique et de la grammaire, ne feront jamais que Hugo, chez qui fourmillent tant d'erreurs, que Saint-Simon, si hardi dans la construction expressive de toutes ses phrases, sans que toutes sortes d'autres hommes ne soient des poètes parfaits et des génies véritables.» Revue Naturiste de juillet, p. 38.
[6] Ibid., p. 5.
[Pg 240]Des quelques notices bibliographiques parues en revue de fin d'année dans l'Ermitage de décembre 1901, je ne redonne ici que celles concernant des auteurs dont il a été question dans ce livre. Trop peu importantes par elles-mêmes, elles ne valent que supplémentairement.
On ne lit pas le Francis Jammes; on le respire; on le hume; il pénètre en vous par les sens. Il rappelle ces balsamines d'Espagne, de qui, non seulement la fleur est parfumée, mais aussi la feuille et la tige; émotion, volonté, pensée, tout, en M. Jammes, n'est que poésie et parfum. Clara d'Ellébeuse sentait le buis et la pervenche; Almaïde est plus sauvagement et plus voluptueusement embaumée. De ces deux petits livres, je ne sais lequel je préfère et ne pourrais choisir entre eux; et l'on ne peut avec eux restreindre sa louange ou limiter son blâme; autant ne les aimer pas du tout, que de ne les aimer qu'à demi. Sitôt que l'on veut critiquer, on hésite: défauts ou qualités se fondent; il n'y a plus défaut ni qualité. Sitôt que l'on veut louer, il faut louer tout Francis Jammes. Dès qu'on se laisse aller à lui, il semble que lui seul soit poète.
J'estime M. de Bouhélier; c'est pourquoi je voudrais qu'il me fut permis de ne parler point de sa nouvelle tragédie; évidemment elle le trahit. Mais les fervents dont il s'entoure, et lui-même il faut l'avouer, ne nous permettent pas le silence; car loin d'en savoir gré, ils l'appellent «conspiration».
Que l'œuvre d'art soit chose ardue, et qu'il ne suffise pas pour la faire de s'en croire infiniment capable, c'est ce que M. de Bouhélier semble désirer n'apprendre qu'à ses dépens. Je ne veux point douter encore qu'avec ses remarquables dons, il ne soit à la fin capable de tenir ce qu'il nous promet. J'avoue pourtant, hélas! qu'à chaque œuvre nouvelle, ma confiance diminue. En effet, loin de reconnaître que jusqu'à présent ses promesses restent ce qu'il nous a [Pg 243]donné de plus fameux, M. de Bouhélier et la majeure partie de ses naturistes semblent se refuser à comprendre que n'ait pas cessé notre attente, s'étonner que la Route Noire, la Victoire, et le Nouveau Christ, ne nous aient pas rassasiés.
Vraiment M. de Bouhélier n'exige-t-il pas plus de lui? Ne s'estime-t-il donc pas autant qu'il nous avait appris à faire?—Que ne reconnaît-il simplement que son roman ne valait pas grand'chose, que ses deux drames ne valent rien. Je pourrais penser aussitôt: Bah! qu'importe! Flaubert n'a-t-il pas déchiré cinq livres avant d'avoir écrit la Bovary?
Que la «Double Maîtresse» de M. de Régnier m'ait au premier abord assez fâcheusement surpris, peut-être ma prédilection pour la grave Hertulie des premiers contes l'expliquait-elle; mais le temps passe; la belle figure du poète plus minutieusement et plus complètement se dessine; certains traits indistincts d'abord, ou inexpliqués, s'accentuent, et l'on comprend enfin qu'on ne pourrait supprimer, ou même souhaiter différente, aucune ligne de son œuvre sans fausser aussitôt toute l'expression du visage,—dont un des plus mystérieux attraits est de sembler toujours morose et grave lorsqu'il parle au présent, toujours souriant et bizarre lorsqu'il s'occupe du passé—comme s'il indiquait par là qu'il ne restera rien des [Pg 245]plus hautains soucis, qu'une plus ou moins belle apparence, que les peines les plus profondes, ne se manifestant jamais qu'à la surface, pourront sembler plus tard peu sérieuses, et que tout aboutit enfin à un assez plaisant mirage.
«Cette fièvre appelée vivre», comme disait Edgar Poe, et tant d'angoisse passionnée, se vêt de drame puis se retire, n'abandonnant au souvenir qu'une dépouille diaprée, comme le flot abandonne à la plage les belles coquilles vidées. Des drames les plus surprenants nous ne touchons que l'apparence; le reste est supposition. Balthazar Aldramin, la Femme de Marbre, le Rival, les trois contes qui composent ce dernier livre, sont des coquilles merveilleuses d'éclat, de ligne, de coloration; chacune concrétise un drame, en devient la forme parfaite, et en garde une tache de sang. Pourquoi souhaiterait-on que l'angoisse et la fièvre les viennent habiter de nouveau?
Je ne me plaindrai pas que, d'un bout à l'autre de l'œuvre de M. Mirbeau, il n'y ait pas un honnête homme; je m'en passe très volontiers. Si M. Mirbeau n'en peint point, c'est apparemment qu'il saurait mal les peindre; c'est aussi qu'il ne s'y intéresse pas.—M. Mirbeau est fait de la curieuse étoile de ces satiristes, qui semblent n'exister qu'en raison de ce qu'ils attaquent. Les monstres leur sont absolument indispensables. Que feraient-ils sans eux?—Ils en inventeraient à plaisir.—C'est ce que fait M. Mirbeau. Il s'arc-boute contre sa lance; ce dont il a besoin, c'est de motiver sa posture: peu lui chaut que l'ennemi soit vrai. Il a bien plus beau jeu avec ceux qu'il invente. Ah! comme il les ridiculise! Comme il s'irrite [Pg 247]bien des bosses qu'il leur met! Il semble s'y piper lui-même. Son têtu procédé d'outrance lui fournit des guignols qui ne manquent pas de laideur. Quand il leur prête un nom connu, les baptise Sarcey, Emile Ollivier, Leygues, et nous les veut bailler pour portraits, il irrite: il ne sait pas voir ressemblant. Dès qu'il ne les nomme plus que Fistule, que Chomassus, Tarte ou Portpierre, il devient vraiment amusant: peu nous importe alors qu'il imagine, ou s'imagine copier. Les dialogues sont nets, inégaux, mais parfois très bons; les récits parfois vigoureux. Si tout le chapitre de Fistule est stupide péniblement, tout le chapitre de Portpierre, l'épisode du hérisson, certains des récits chez Triceps, d'autres encore sont bien menés, curieux et pressants.[1]
[1] La nouvelle pièce de M. Mirbeau: Les Affaires sont les affaires, paraît, comme achève de s'imprimer ce volume. J'eusse voulu exprimer mieux que dans une note tout le bien que je pense de cette belle œuvre, excellente en plus d'un endroit.
Octobre 1898.
Stéphane Mallarmé est mort.—Notre cœur est empli de tristesse. Comment parlerais-je aujourd'hui de rien d'autre? La figure si belle qui disparaît vit presque encore; nous sentons encore plus à présent combien elle était unique; c'est d'elle, avant qu'elle soit plus écartée, que je voudrais parler surtout, et de son exemple admirable. On a tout le temps désormais pour parler de son œuvre; ceux qui viendront après nous pourront mieux en parler encore; elle couvre ce nom très aimé d'une gloire sans rumeur, mais pure; tout y est d'une beauté sans tristesse et presque sans humain émoi; d'une tranquillité déjà et d'une sérénité immortelle;—la plus belle des gloires,—la plus belle et la plus amère des gloires.
[Pg 252]Car même devant la mort, les moqueries et les mauvais vouloirs n'ont pas désarmé; et il est à penser que longtemps encore la sottise, la légèreté d'esprit, la suffisance ne pardonneront pas à ce qui par son éclat seul, et simplement en paraissant, les humilie[1].
Par une sorte de fierté cruelle, mais plutôt encore naturellement et par la seule pureté de sa belle pensée, Stéphane Mallarmé avait préservé son œuvre de la vie; celle-ci coulait autour de lui comme s'écoule un fleuve, aux côtés d'un navire à l'ancre; il n'était jamais entraîné. L'inopportunité même de son œuvre fera qu'elle ne sera pas passagère. Déjà d'avance hors du [Pg 253]présent, elle apparaissait bien comme une œuvre lointaine, éprouvée déjà par le temps, sur quoi le temps n'a plus de prise. Et je crois fermement que l'œuvre de Mallarmé durera presque tout entière.—Quel éloge plus rare faire à ce rare esprit, isolé dans une société de gens de lettres qui spéculent, confondent gloire et succès, n'acquièrent l'un qu'au mépris de l'autre et ne doivent qu'à l'apparente actualité de l'œuvre, la bruyance des applaudissements immédiats, la vulgarité de leur public sans choix, puis l'immortel mépris ou l'immortel oubli qui va suivre. Le public croit choisir ses auteurs; mais non: c'est l'artiste qui choisit son public; l'un est toujours digne de l'autre. Certains, peu désireux des faveurs triviales, trouvent dans une foule énorme et affairée bien peu de lecteurs dignes d'eux; il leur faut plus de choix, dans une foule plus vaste encore et plus lointainement répartie. Mépriser le public vulgaire, c'est estimer d'autant plus quelques-uns. Où les trouver? Ce n'est que dans la longue suite des temps qu'ils peuvent se choisir eux-mêmes; un ici, l'autre là, chacun d'eux solitaire; et que se forme lentement, à travers les générations survenues, un public qui soit lui de même admirable[2].
[Pg 254]La fuite du temps entraîne tout ce qui s'attachait à lui; c'est hors du temps que pose l'ancre; assuré contre les dérives, depuis longtemps Mallarmé s'était immobilisé hors du monde; voilà pourquoi, ne recevant plus aucun aliment du dehors, son œuvre tout abstraite, jaillissante de soi et ne se servant plus du monde que comme d'un moyen représentatif, peut paraître vaine tout entière à qui cherche ses rapports avec «son temps»—mais s'illumine tout entière à qui veut bien la pénétrer intimement, lentement, pas à pas, comme on entre dans le système clos d'un Spinoza, d'un Laplace, ou dans une géométrie[3].
[Pg 255]Il importe que nous puissions avoir bientôt une édition complète des œuvres de Stéphane Mallarmé. A part quelques poèmes admirables isolément (presque tous d'une ancienne époque), l'œuvre de Mallarmé demande, pour être comprise, une très lente et progressive initiation. Les derniers écrits déconcertent ceux qui n'y sont pas parvenus par l'étude des précédents. Les mots n'y révèlent qu'à l'étude très attentive l'effrayante densité que leur laisse la méditation intérieure, et comme ils ne valent plus ni par pittoresque ni par pathétique direct, mais seulement par cela, tout échappe à l'impatient qui veut que l'écrit parle vite; il ne tient plus rien devant lui,—rien qu'un peu de noir sur du blanc: «Words! words! words!»
Mais l'attention qu'on refuse aux vivants, on l'accorde plus volontiers aux morts.
Nous ne nous flattons pas, certes, d'avoir «compris» tout Mallarmé. Bien des passages restent à l'étude. Puis notre esprit souvent se rebute, refuse de [Pg 256]pourchasser plus longtemps une pensée si différente de la sienne;—(car il semble souvent que le secret ici ne se livre que comme récompense d'une poursuite très assidue). Mais je sais que jamais la poursuite ne fut vaine, et que, plus elle fut patiente, plus le repos, après, dans la contemplation de cette imagination pure et belle, fut profond, joyeux, fécond, plein de délices.
J'avoue par contre l'irritation que me causent certains pseudo-admirateurs du poète, qui vraiment «comprennent» avec une facilité qui fait croire plus à la légèreté de leur esprit qu'à sa force. Ceux-là, d'ordinaire écrivains eux-mêmes, non contents de comprendre, imitent. Un Mallarmé subit revit en eux.—Pour l'un d'eux Mallarmé eut une ironie très douce et à peine attristée, si discrète que celui qui me la rapportait, l'auteur même à qui furent dites ces paroles, les répétait comme un éloge: «Ce que j'admire surtout ici, disait le Maître, c'est que, ce que j'ai mis trente ans à chercher, vous, avec vos vingt ans, en un an l'ayez découvert.»
Imiter Mallarmé, c'est folie!—Tout au plus pourrait-on, pour d'autres résultats, employer sa patiente méthode, mais imiter le résultat de cette méthode [Pg 257]dans la bizarrerie extérieure qu'elle lui doit parfois, c'est aussi sot que de se promener en scaphandre dans les rues, ou d'écrire à l'envers sous prétexte qu'on admire les manuscrits du Vinci. Mallarmé, sous ce rapport, fit beaucoup de bien et beaucoup de mal, comme fait toujours tout puissant esprit. Beaucoup de bien, parce qu'il désigna certains sots plagiaires à une risée méritée; beaucoup de mal parce que l'autorité de ce magique esprit, son despotisme involontaire, d'autant plus redoutable qu'il était plus voilé de douceur, put incliner quelques esprits non négligeables, mais trop flexibles, ou trop jeunes, pas assez formés, les plier en des postures peu sincères, leur faire adopter une syntaxe, une manière d'écrire qui supposait et que nécessitait une méthode, mais qui sans elle n'était plus que manière et que pure affectation.
Comment en eût-il été autrement? Ceux qui viendront, ceux qui sont venus depuis trois ans ne peuvent assez se rendre compte de la déconvenue qui attendait un jeune esprit avide d'art et des émotions de l'esprit à son entrée dans la «Société littéraire» d'alors. Renan, Leconte de Lisle et Banville étaient morts; Rimbaud perdu; Verlaine hagard, impossible à saisir; [Pg 258]la conversation de Heredia, toute de verve, nourrissait peu: Sully-Prudhomme se méprenait; certaine méprisante infatuation empêchait de reconnaître en Moréas ses qualités de vrai poète; Régnier, Griffin naissaient à peine... Auprès de qui aller? Qui admirer, grands dieux?
—On entrait chez Mallarmé; c'était le soir; on trouvait là d'abord enfin un grand silence; à la porte, tous les bruits de la rue mouraient; Mallarmé commençait à parler d'une voix douce, musicale, inoubliable,—hélas! à jamais étouffée. Chose étrange: il pensait avant de parler!
Et pour la première fois, près de lui, on sentait, on touchait la réalité de la pensée: ce que nous cherchions, ce que nous voulions, ce que nous adorions dans la vie, existait; un homme, ici, avait tout sacrifié à cela.
Pour Mallarmé, la littérature était le but, oui la fin même de la vie; on la sentait ici, authentique et réelle. Pour y sacrifier tout comme il fit, il fallait bien y croire uniquement. Je ne pense pas qu'il y ait, dans notre histoire littéraire, exemple de plus intransigeante conviction.
Ne pouvant écouter nul autre, on ne sut point voir en lui le représentant dernier et le plus parfait du [Pg 259]Parnasse, son sommet, son accomplissement et sa consommation; on y vit un initiateur. Voilà pourquoi peut-être la réaction, ces dernières années, fut si vive, si follement passionnée. On eût cru la revendication d'une liberté compromise, tant cet esprit calme et retrait avait soumis à lui de pensées, avait contraint les autres à l'admirer. On regimba; on fit semblant de le haïr; et jamais sa domination ne fut plus affirmée que par ceux qui s'en délivrèrent; ils ne le purent faire qu'à grand éclat; ils réclamèrent le droit de vivre; comme si Mallarmé leur défendait d'exister dans quelque autre monde que le sien—par la seule manifestation tranquille d'une beauté morale hors du monde, éblouissante comme celle du solitaire dont il parle, qui nie le monde extérieur par la puissance de sa foi.
Et je consens que la violence et la passion des réactions récentes vint aussi de la violence et de la passion de certains admirateurs, dont nous fûmes.
En un âge où nous avions besoin d'admirer, Mallarmé seul motivait une admiration légitime: comment n'eût-elle pas été violente et passionnée?
Été 1898.
[1] Citons, en regard de l'indécent article du Temps, le respectueux et sérieux hommage de M. Lalo dans les Débats; peut-être pour racheter le sot et vil article que ce même journal osait faire paraître naguère, qui s'appelait «le Coup du père Verlaine»; c'était signé Georges Clément. Il faut se souvenir de ces choses.
Quant à l'Aurore, on ne peut lui demander de comprendre une figure aussi inactuelle; elle eût mieux fait de n'en pas parler du tout. Rien ne paraît plus vain qu'une occupation dont on ne pénètre pas les motifs; sans l'invention du pratique feu grégeois, le mépris des Syracusains pour Archimède eût été sans bornes; surtout quand il se laissa tuer. Le mépris tend ici à devenir même de la haine; le savant n'indiquait-il pas par là que ce qui l'occupait et que ne pouvaient apercevoir les autres, était plus important que Syracuse, plus important même que sa vie?
[2] Je sais que l'on peut citer bien des noms et parmi les plus grands, pour qui la faveur populaire n'empêcha pas les faveurs plus choisies, dont le succès ne tua pas la gloire, et dont la gloire pour être populaire d'abord, ne fut ni moins belle ni moins parfaitement prolongée;—mais c'est que l'œuvre de ces admirables génies sans murs d'enceinte pour ainsi dire, se prolongeait au loin sur le terrain public; de sorte que, ce que la foule admire en eux n'est pas le centre même de l'œuvre, le dieu dans le secret du temple, mais bien les dépendances d'accès facile et le terrain banal où l'on peut aisément se retrouver.—D'ailleurs pas de règle à cela; et quand mille exemples audacieux protesteraient, ce que je dis plus haut peut se redire.
[3] Littérature d'à prioriste, par conséquent française entre toutes, cartésienne,—mais de forme plus concise que ne le supporte d'ordinaire l'esprit un peu coureur des Français et d'apparence plutôt latine, pour sa concision, sa syntaxe,—à ce point que certains passages de l'Après-Midi d'un Faune ont pu nous redonner une émotion poétique très semblable à celle que nous cherchons dans les Eglogues de Virgile.
Ces vers, que publiait la Revue Blanche du 1er janvier dernier, sont à peu près les derniers d'Emmanuel Signoret. Le 20 décembre 1900, à Cannes, où, longtemps, des soins vigilants et une sorte d'inspiration latente la prolongèrent encore, s'acheva enfin sa triste lutte contre la nuit et la misère. La mort vint, non comme une étrangère, et non comme une amie, mais comme une fatale attendue qui ne devait trouver en lui plus rien à prendre, qu'une souffrante dépouille épuisée—tant l'effort du poète avait été de poser, en [Pg 261]des vers qu'elle ne put toucher, la part exquise de lui-même—de sorte que, reculé et comme disparu derrière son œuvre, son absence n'importât plus.
Oui, tout l'effort de Signoret, sachant de loin la mort venir, fut l'effort propre de l'artiste: la nier. Fixer sa propre gloire et sa pensée en des lignes si belles, si pures, que le temps n'y pût rien enlever.—Qu'eût été l'œuvre d'art sans la mort, contre laquelle elle proteste?
L'imperfection de certains poètes rassure. Il semble, tant leur effort satisfait peu, qu'ils aient encore beaucoup à dire, parce que jusqu'alors ils ont mal dit. Un long temps de vie leur est dû pour mener à mieux leur pauvre œuvre.—Par sa beauté, parfaite trop vite, accomplie, l'œuvre de Signoret inquiétait: elle empiétait sur sa vie. La satisfaction de ses vers ne lui laissait, nous semblait-il, plus rien à dire. Hélas! C'étaient—beauté, vie, œuvres—choses disons-nous: accomplies. La mort ne changera rien à ses vers. La vie n'y eût rien ajouté.
Il était, pour les choses terrestres, sinon aveugle comme Homère, du moins d'une si extraordinaire myopie, que jamais la laideur ou l'infirmité du réel ne vint heurter, comme elle fait si douloureusement [Pg 262]chez Baudelaire, la poétique vision dans laquelle il avançait en rêve. Autant sa marche dans les rues était gauche, tâtonnante et gênée, autant son essor était là robuste, tranquille, assuré. Ce que d'autres appellent inspiration, visitation de la Muse, dont tels poètes sortent las et boiteux comme Jacob d'une lutte avec l'ange, c'était pour lui l'état constant, normal—à ce point qu'au contraire ce qui l'en distrayait, les soins matériels et urgents de la vie devenaient pour lui causes de maladie, de ruine.
La misère, parfois, arracha d'un Léopardi, d'un Verlaine des chants si inespérément beaux qu'on doute s'il sied bien d'accuser de sa cruauté pour eux la Nature. Ici point: la douleur, la misère n'arrachèrent d'Emmanuel Signoret pas un chant, pas un cri personnel. Les cordes métalliques de sa lyre ne se détendirent jamais. Il n'y eut là, ni pose, ni affectation d'impassibilité, mais isolation naturelle et complète de sa faculté poétique. De sorte que cette grande misère où vécut, dont mourut Signoret n'a servi de rien pour son art et reste simplement lamentable.
Un jour je le vis, à Cannes; je me plaignis à lui de ce qu'il ne produisait pas davantage.—«Moi, je suis toujours prêt, répondit-il; j'attends que l'on me commande [Pg 263]quelque chose.»—A la façon de Malherbe, de Pindare, Signoret se sentait poète officiel; tout comme eux, sur commande, à propos de n'importe quoi, il eût fait des vers admirables; il eût su couronner d'un laurier neuf chaque victoire... Et comme aucune commande officielle ne lui venait, Signoret, n'ayant rien de particulier à dire, satisfaisait son lyrisme en se chantant. Il se chantait lui-même sans repos et sans lassitude; il chantait Puget-Théniers, Lançon, villages immortels de ce qu'il les avait habités; il chantait la plage de Cannes comme Ronsart avait chanté les bords du Loir. Comme Ronsart chantait:
il chantait, en non moins beaux vers:
Et puisque aucune gloire extérieure et matérielle ne descendait, il posait sur son propre front, le tressant lui-même en couronne, le laurier que lui-même et solitaire [Pg 264]avait cueilli. Et dans l'orgueil, dans l'infatuation même du geste, rien de bassement égoïste ni d'intéressé ne restait. Rien d'impersonnel, de général, d'officiel dirai-je, comme la figure qu'il évoque de lui-même en ses vers. Il parle de lui-même comme d'une autre divinité.
Une poésie si déshumanisée étonne aujourd'hui, déconcerte. Les âmes trop sceptiques et trop peu dévouées méconnaissent la divine et païenne ferveur qui peut, sur l'autel d'Apollon, consumer sans laisser de cendres. Le profane n'estime la passion qu'à ce qu'elle a laissé de déchets. La pureté du sacrifice est telle, ici, qu'il se méprend. Qu'importe! si, sur la pierre lisse où, par le feu, tout ce qui restait de charnel fut dévoré, la flamme intense et sans vacillement de cette glorieuse consomption se reflète.
Il y a un an, à même époque[1], c'est à Biskra que j'appris par les journaux la lamentable fin d'Oscar Wilde. L'éloignement ne me permit pas, hélas! de me joindre au maigre cortège qui suivit sa dépouille jusqu'au cimetière de ***; en vain me désolai-je que mon absence semblât diminuer encore le nombre si petit des amis demeurés fidèles;—du moins les pages que voici, je voulus aussitôt les écrire; mais durant un assez long temps, de nouveau, le nom de Wilde sembla devenir la propriété des journaux... A présent que toute indiscrète rumeur autour de ce nom si tristement fameux s'est calmée, que la foule enfin s'est lassée, après avoir loué, de s'étonner, puis de maudire, peut-être un ami pourra-t-il exprimer une [Pg 266]tristesse qui dure, apporter, comme une couronne sur une tombe délaissée, ces pages d'affection, d'admiration et de respectueuse pitié.
Lorsque le scandaleux procès, qui passionna l'opinion anglaise, menaça de briser sa vie, quelques littérateurs et quelques artistes tentèrent une sorte de sauvetage au nom de la littérature et de l'art. On espéra qu'en louant l'écrivain on allait faire excuser l'homme. Hélas! un malentendu s'établit; car, il faut bien le reconnaître: Wilde n'est pas un grand écrivain. La bouée de plomb qu'on lui jeta ne fit donc qu'achever de le perdre; ses œuvres, loin de le soutenir, semblèrent foncer avec lui. En vain quelques mains se tendirent. Le flot du monde se referma; tout fut fini.
On ne pouvait alors songer à tout différemment le défendre. Au lieu de chercher à cacher l'homme derrière son œuvre, il fallait montrer l'homme d'abord admirable, comme je vais essayer de faire aujourd'hui—puis l'œuvre même en devenant illuminée.—«J'ai mis tout mon génie dans ma vie; je n'ai mis que mon talent dans mes œuvres», disait Wilde.—Grand écrivain non pas, mais grand viveur, si l'on permet au mot de prendre son plein sens. Pareil aux philosophes de la Grèce, Wilde n'écrivait pas mais [Pg 267]causait et vivait sa sagesse, la confiant imprudemment à la mémoire fluide des hommes, et comme l'inscrivant sur de l'eau. Que ceux qui l'ont plus longuement connu racontent sa biographie; un de ceux qui l'auront le plus avidement écouté rapporte simplement ici quelques souvenirs personnels:
Ceux qui n'ont approché Wilde que dans les derniers temps de sa vie, imaginent mal, d'après l'être affaibli, défait, que nous avait rendu la prison, l'être prodigieux qu'il fut d'abord.
C'est en 1891 que je le rencontrai pour la première fois. Wilde avait alors ce que Thackeray appelle «le principal don des grands hommes»: le succès. Son geste, son regard triomphaient. Son succès était si certain qu'il semblait qu'il précédât Wilde et que lui n'eût qu'à s'avancer. Ses livres étonnaient, charmaient. Ses pièces allaient faire courir Londres. Il était riche; il était grand; il était beau; gorgé de bonheurs et d'honneurs. Certains le comparaient à un Bacchus asiatique; d'autres à quelque empereur romain; d'autres à Apollon lui-même—et le fait est qu'il rayonnait.
A Paris, sitôt qu'il y vint, son nom courut de [Pg 269]bouche en bouche; on rapportait sur lui quelques absurdes anecdotes: Wilde n'était encore que celui qui fumait des cigarettes à bout d'or et qui se promenait dans les rues une fleur de tournesol à la main. Car, habile à piper ceux qui font la mondaine gloire, Wilde avait su créer, par devant son vrai personnage, un amusant fantôme dont il jouait avec esprit.
J'entendis parler de lui chez Mallarmé: on le peignit brillant causeur, et je souhaitai le connaître, tout en n'espérant pas d'y arriver. Un hasard heureux, ou plutôt un ami, me servit, à qui j'avais dit mon désir. On invita Wilde à dîner. Ce fut au restaurant. Nous étions quatre, mais Wilde fut le seul qui parla.
Wilde ne causait pas: il contait. Durant presque tout le repas, il n'arrêta pas de conter. Il contait doucement, lentement; sa voix même était merveilleuse. Il savait admirablement le français, mais feignait de chercher un peu les mots qu'il voulait faire attendre. Il n'avait presque pas d'accent, ou du moins que ce qu'il lui plaisait d'en garder, et qui pouvait donner aux mots un aspect parfois neuf et étrange. Il prononçait volontiers, pour scepticisme: skepticisme... Les contes qu'il nous dit interminablement ce soir-là étaient confus et pas de ses meilleurs; Wilde, incertain [Pg 270]de nous, nous essayait. De sa sagesse ou bien de sa folie, il ne livrait jamais que ce qu'il croyait qu'en pourrait goûter l'auditeur; il servait à chacun, selon son appétit, sa pâture; ceux qui n'attendaient rien de lui n'avaient rien, ou qu'un peu de mousse légère; et comme il s'occupait d'abord d'amuser, beaucoup de ceux qui crurent le connaître n'auront connu de lui que l'amuseur.
Le repas fini, nous sortîmes. Mes deux amis marchant ensemble, Wilde me prit à part:
—«Vous écoutez avec les yeux, me dit-il assez brusquement. Voilà pourquoi je vous raconterai cette histoire:
»Quand Narcisse fut mort, les fleurs des champs se désolèrent et demandèrent à la rivière des gouttes d'eau pour le pleurer.—Oh! leur répondit la rivière, quand toutes mes gouttes d'eau seraient des larmes, je n'en aurais pas assez pour pleurer moi-même Narcisse: je l'aimais.—Oh! reprirent les fleurs des champs, comment n'aurais-tu pas aimé Narcisse? Il était beau.—Etait-il beau? dit la rivière.—Et qui mieux que toi le saurait? Chaque jour penché sur ta rive, il mirait dans tes eaux sa beauté...»
Wilde s'arrêtait un instant...
[Pg 271]—«Si je l'aimais, répondit la rivière, c'est que, lorsqu'il se penchait sur mes eaux, je voyais le reflet de mes eaux dans ses yeux.»
Puis Wilde, se rengorgeant avec un bizarre éclat de rire, ajoutait:
—«Cela s'appelle: Le Disciple.»
Nous étions arrivés devant sa porte et le quittâmes. Il m'invita à le revoir. Cette année et l'année suivante je le vis souvent et partout.
Devant les autres, je l'ai dit, Wilde montrait un masque de parade, fait pour étonner, amuser ou pour exaspérer parfois. Il n'écoutait jamais et prenait peu souci de la pensée dès que ce n'était plus la sienne. Dès qu'il ne brillait plus tout seul, il s'effaçait. On ne le retrouvait alors qu'en se retrouvant seul avec lui.
Mais, sitôt seuls, il commençait:
—«Qu'avez-vous fait depuis hier?»
Et comme alors ma vie coulait sans heurts, le récit que j'en pouvais faire ne présentait nul intérêt. Je redisais docilement de menus faits, observant, tandis que je parlais, le front de Wilde se rembrunir.
—«C'est vraiment là ce que vous avez fait?
—Oui, répondais-je.
[Pg 272]—Et ce que vous dites est vrai!
—Oui, bien vrai.
—Mais alors pourquoi le redire? Vous voyez bien: cela n'est pas du tout intéressant.—Comprenez qu'il y a deux mondes: celui qui est sans qu'on en parle; on l'appelle le monde réel, parce qu'il n'est nul besoin d'en parler pour le voir. Et l'autre, c'est le monde de l'art; c'est celui dont il faut parler, parce qu'il n'existerait pas sans cela.
»Il y avait un jour un homme que dans son village on aimait parce qu'il racontait des histoires. Tous les matins il sortait du village, et quand le soir il y rentrait, tous les travailleurs du village, après avoir peiné tout le jour, s'assemblaient tout autour de lui et disaient: Allons! Raconte: Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui?—Il racontait: J'ai vu dans la forêt un faune qui jouait de la flûte, et qui faisait danser une ronde de petits sylvains.—Raconte encore: qu'as-tu vu? disaient les hommes.—Quand je suis arrivé sur le bord de la mer, j'ai vu trois sirènes, au bord des vagues, et qui peignaient avec un peigne d'or leurs cheveux verts.—Et les hommes l'aimaient parce qu'il leur racontait des histoires.
»Un matin il quitta comme tous les matins son [Pg 273]village—mais quand il arriva sur le bord de la mer, voici qu'il aperçut trois sirènes, trois sirènes au bord des vagues, et qui peignaient avec un peigne d'or leurs cheveux verts. Et comme il continuait sa promenade, il vit, arrivant près du bois, un faune qui jouait de la flûte à une ronde de sylvains... Ce soir-là, quand il rentra dans son village et qu'on lui demanda comme les autres soirs: Allons! raconte: Qu'as-tu vu? Il répondit:—Je n'ai rien vu.»
Wilde s'arrêtait un peu, laissait descendre en moi l'effet du conte: puis reprenait:
«Je n'aime pas vos lèvres; elles sont droites comme celles de quelqu'un qui n'a jamais menti. Je veux vous apprendre à mentir, pour que vos lèvres deviennent belles et tordues comme celles d'un masque antique.
»Savez-vous ce qui fait l'œuvre d'art et ce qui fait l'œuvre de la nature? Savez-vous ce qui fait leur différence? Car enfin la fleur du narcisse est aussi belle qu'une œuvre d'art—et ce qui les distingue ce ne peut être la beauté. Savez-vous ce qui les distingue?—L'œuvre d'art est toujours unique. La nature, qui ne fait rien de durable, se répète toujours, afin que rien de ce qu'elle fait ne soit perdu. Il y a beaucoup de [Pg 274]fleurs de narcisse; voilà pourquoi chacune peut ne vivre qu'un jour. Et chaque fois que la nature invente une forme nouvelle elle la répète aussitôt. Un monstre marin dans une mer sait qu'il est dans une autre mer un monstre marin, son semblable. Quand Dieu crée un Néron, un Borgia ou un Napoléon dans l'histoire, il en met un autre à côté; on ne le connaît pas, peu importe; l'important c'est qu'un réussisse; car Dieu invente l'homme, et l'homme invente l'œuvre d'art.
»Oui, je sais ... un jour il se fit sur la terre un grand malaise, comme si enfin la nature allait créer quelque chose d'unique, quelque chose d'unique vraiment—et le Christ naquit sur la terre. Oui, je sais bien ... mais écoutez:
«Quand Joseph d'Arimathie, au soir, descendit du mont du Calvaire où venait de mourir Jésus, il vit sur une pierre blanche un jeune homme assis, qui pleurait. Et Joseph s'approcha de lui et lui dit:—Je comprends que ta douleur soit grande, car certainement cet homme-là était un juste.—Mais le jeune homme lui répondit:—Oh! ce n'est pas pour cela que je pleure! Je pleure parce que moi aussi j'ai fait des miracles! Moi aussi j'ai rendu la vue aux aveugles, j'ai guéri des paralytiques et j'ai ressuscité des morts. Moi aussi j'ai [Pg 275]séché le figuier stérile et j'ai changé de l'eau en vin... Et les hommes ne m'ont pas crucifié.»
Et qu'Oscar Wilde fût convaincu de sa mission représentative, c'est ce qui m'apparut plus d'un jour.
L'Évangile inquiétait et tourmentait le païen Wilde. Il ne lui pardonnait pas ses miracles. Le miracle païen, c'est l'œuvre d'art: le Christianisme empiétait. Tout irréalisme artistique robuste, exige un réalisme convaincu dans la vie.
Ses apologues les plus ingénieux, ses plus inquiétantes ironies étaient pour confronter les deux morales, je veux dire le naturalisme païen et l'idéalisme chrétien, et décontenancer celui-ci de tout sens.
—«Quand Jésus voulut rentrer dans Nazareth, racontait-il, Nazareth était si changée, qu'il ne reconnut plus sa ville. La Nazareth où il avait vécu était pleine de lamentations et de larmes; cette ville nouvelle, pleine d'éclats de rire et de chants. Et le Christ, entrant dans la ville, vit des esclaves chargés de fleurs, qui s'empressaient vers l'escalier de marbre d'une maison de marbre blanc. Le Christ entra dans la maison, et au fond d'une salle de jaspe, couché sur une couche de pourpre, il vit un homme dont les cheveux [Pg 276]défaits étaient mêlés aux roses rouges et dont les lèvres étaient rouges de vin. Le Christ s'approcha de lui, lui toucha l'épaule et lui dit:—Pourquoi mènes-tu cette vie?—L'homme se retourna, le reconnut et répondit:—J'étais lépreux; tu m'as guéri. Pourquoi mènerais-je une autre vie?
»Le Christ sortit de cette maison. Et voici que dans la rue, il vit une femme dont le visage et les vêtements étaient peints, et dont les pieds étaient chaussés de perles; et derrière elle, marchait un homme dont l'habit était de deux couleurs et dont les yeux se chargeaient de désirs. Et le Christ s'approcha de l'homme, lui toucha l'épaule et lui dit:—Pourquoi donc suis-tu cette femme et la regardes-tu ainsi?—L'homme se retournant le reconnut et répondit:—J'étais aveugle; tu m'as guéri. Que ferais-je d'autre de ma vue?
»Et le Christ s'approcha de la femme:—Cette route que tu suis, lui dit-il, est celle du péché; pourquoi la suivre?—La femme le reconnut et lui dit en riant:—La route que je suis est agréable et tu m'as pardonné tous mes péchés.
»Alors le Christ sentit son cœur plein de tristesse et voulut quitter cette ville. Mais comme il en sortait, [Pg 277]il vit enfin, au bord des fossés de la ville, un jeune homme assis qui pleurait. Le Christ s'approcha de lui, et touchant les boucles de ses cheveux, il lui dit:—Mon ami, pourquoi pleures-tu?
»Et Lazare leva les yeux, le reconnut et répondit:
—J'étais mort et tu m'as ressuscité; que ferais-je d'autre de ma vie?»
—«Voulez-vous que je vous dise un secret? commençait Wilde, un autre jour;—c'était chez Heredia; il m'avait pris à part au milieu du salon plein de monde—un secret ... mais promettez-moi de ne le redire à personne.... Savez-vous pourquoi le Christ n'aimait pas sa mère?—Cela était dit à l'oreille, à voix basse et comme honteusement. Il faisait une courte pause, saisissait mon bras, se reculait, puis, éclatant de rire, brusquement:
—C'est parce qu'elle était vierge!!...»
Qu'on me laisse encore citer ce conte, un des plus étranges où se puisse achopper l'esprit—et comprenne qui peut la contradiction que semble à peine inventer Wilde:
«... Puis il se fit un grand silence dans la Chambre de la Justice de Dieu.—Et l'âme du pécheur s'avança toute nue devant Dieu.
[Pg 278]Et Dieu ouvrit le livre de la vie du pécheur:
—Certainement ta vie a été très mauvaise: Tu as... (suivait une prodigieuse, merveilleuse énumération de péchés)[2].—Puisque tu as fait tout cela, certainement je vais t'envoyer en Enfer.
—Tu ne peux pas m'envoyer en Enfer.
—Et pourquoi est-ce que je ne puis pas t'envoyer en Enfer?
—Parce que j'y ai vécu toute ma vie.
Alors il se fit un grand silence dans la Chambre de la Justice de Dieu.
—Eh bien! puisque je ne puis pas t'envoyer en Enfer, je m'en vais t'envoyer au Ciel.
—Tu ne peux pas m'envoyer au Ciel.
—Et pourquoi est-ce que je ne puis pas t'envoyer au Ciel?
—Parce que je n'ai jamais pu l'imaginer.
Et il se fit un grand silence dans la Chambre de la Justice de Dieu[3].»
[Pg 279]Un matin, Wilde me tendit à lire un article où un critique assez épais le félicitait de «savoir inventer de jolis contes pour habiller mieux sa pensée».
—«Ils croient, commença Wilde, que toutes les pensées naissent nues... Ils ne comprennent pas que je ne peux pas penser autrement qu'en contes. Le sculpteur ne cherche pas à traduire en marbre sa pensée; il pense en marbre, directement.
»Il y avait un homme qui ne pouvait penser qu'en bronze. Et cet homme, un jour, eut une idée, l'idée de la joie, de la joie qui habite l'instant. Et il sentit qu'il lui fallait la dire. Mais dans le monde tout entier il ne restait plus un seul morceau de bronze; car les hommes avaient tout employé. Et cet homme sentit qu'il deviendrait fou, s'il ne disait pas son idée.
»Et il songeait à un morceau de bronze, sur la tombe de sa femme, à une statue qu'il avait faite pour orner la tombe de sa femme, de la seule femme qu'il eût aimée; c'était la statue de la tristesse, de la tristesse qui habite la vie. Et l'homme sentit qu'il devenait fou s'il ne disait pas son idée.
«Alors il prit cette statue de la tristesse, de la tristesse qui habite la vie; il la brisa; il la fondit, et il en [Pg 280]fit la statue de la joie, de la joie qui n'habite que dans l'instant.»
Wilde croyait à quelque fatalité de l'artiste, et que l'idée est plus forte que l'homme.
—«Il y a, disait-il, deux espèces d'artistes: les uns apportent des réponses, et les autres, des questions. Il faut savoir si l'on est de ceux qui répondent ou bien de ceux qui interrogent; car celui qui interroge n'est jamais celui qui répond. Il y a des œuvres qui attendent, et qu'on ne comprend pas pendant longtemps; c'est qu'elles apportaient des réponses à des questions qu'on n'avait pas encore posées; car la question arrive souvent terriblement longtemps après la réponse.»
Et il disait encore:
—«L'âme naît vieille dans le corps; c'est pour la rajeunir que celui-ci vieillit. Platon, c'est la jeunesse de Socrate...»
Puis je restai trois ans sans le revoir.
Ici commencent les souvenirs tragiques.
Une persistante rumeur, grandissant avec celle de ses succès (à Londres on le jouait à la fois sur trois théâtres), prêtait à Wilde d'étranges mœurs, dont certains voulaient bien encore ne s'indigner qu'avec sourire, et d'autres ne s'indigner point; on prétendait d'ailleurs que ces mœurs, il les cachait peu, souvent les affichait au contraire, certains disaient: avec courage; d'autres: avec cynisme; d'autres: avec affectation. J'écoutais, plein d'étonnement, cette rumeur. Rien, depuis que je fréquentais Wilde, ne m'avait jamais pu rien faire soupçonner.—Mais déjà, par prudence, nombre d'anciens amis le désertaient. On ne le reniait pas nettement encore, mais on ne tenait plus à l'avoir rencontré.
Un extraordinaire hasard croisa de nouveau nos [Pg 282]deux routes. C'est en janvier 1895. Je voyageais; une humeur chagrine m'y poussait, et plus en quête de solitude que de la nouveauté des lieux. Le temps était affreux; j'avais fui d'Alger vers Blidah; j'allais laisser Blidah pour Biskra. Au moment de quitter l'hôtel, par curiosité désœuvrée, je regardai le tableau noir où les noms des voyageurs sont inscrits. Qu'y vis-je?—A côté de mon nom, le touchant, celui de Wilde... J'ai dit que j'avais soif de solitude: je pris l'éponge et j'effaçai mon nom.
Avant d'avoir atteint la gare, je n'étais plus bien sûr qu'un peu de lâcheté ne se fut pas cachée dans cet acte; aussitôt, revenant sur mes pas, je fis remonter ma valise, et récrivis mon nom sur le tableau.
Depuis trois ans que je ne l'avais vu (car je ne puis compter pour un revoir, l'an d'avant, une courte rencontre à Florence), Wilde était certainement changé. On sentait dans son regard moins de mollesse, quelque chose de rauque en son rire et de forcené dans sa joie, Il semblait à la fois plus sûr de plaire et moins ambitieux d'y réussir; il était enhardi, affermi, grandi. Chose étrange, il ne parlait plus par apologues; durant les quelques jours que je m'attardai près de lui, je ne pus arracher de lui le moindre conte.
[Pg 283]Je m'étonnai d'abord de le trouver en Algérie.—«Oh! me dit-il, c'est que maintenant je fuis l'œuvre d'art. Je ne veux plus adorer que le soleil... Avez-vous remarqué que le soleil déteste la pensée; il la fait reculer toujours, et se réfugier dans l'ombre. Elle habitait d'abord l'Égypte; le soleil a conquis l'Égypte. Elle a vécu longtemps en Grèce, le soleil a conquis la Grèce; puis l'Italie et puis la France. A présent toute la pensée se trouve repoussée jusqu'en Norvège et en Russie, là où ne vient jamais le soleil. Le soleil est jaloux de l'œuvre d'art.»
Adorer le soleil, ah! c'était adorer la vie. L'adoration lyrique de Wilde devenait farouche et terrible. Une fatalité le menait; il ne pouvait pas et ne voulait pas s'y soustraire. Il semblait mettre tout son soin, sa vertu, à s'exagérer son destin et à s'exaspérer lui-même. Il allait au plaisir comme on marche au devoir.—«Mon devoir à moi, disait-il, c'est de terriblement m'amuser.»—Nietzsche m'étonna moins plus tard, parce que j'avais entendu Wilde dire;
—«Pas le bonheur! Surtout pas le bonheur. Le plaisir! Il faut vouloir toujours le plus tragique...»
Il marchait dans les rues d'Alger précédé, escorté, suivi d'une extraordinaire bande de maraudeurs; il [Pg 284]conversait avec chacun; il les regardait tous avec joie et leur jetait son argent au hasard.
—«J'espère, me disait-il, avoir bien démoralisé cette ville.»
Je songeais au mot de Flaubert, qui lorsqu'on lui demandait quelle sorte de gloire il ambitionnait le plus, répondait:
—«Celle de démoralisateur.»
Je restais devant tout cela plein d'étonnement, d'admiration et de crainte. Je savais sa situation ébranlée, les hostilités, les attaques et quelle sombre inquiétude il cachait sous sa joie hardie[4]. Il parlait de rentrer [Pg 285]à Londres; le marquis de Q... l'insultait, l'appelait, l'accusait de fuir.
—«Mais si vous retournez là-bas, qu'adviendra-t-il? lui demandai-je. Savez-vous ce que vous risquez?
—Il ne faut jamais le savoir... Ils sont extraordinaires, mes amis; ils me conseillent la prudence. La prudence! Mais est-ce que je peux en avoir? Ce serait [Pg 286]revenir en arrière. Il faut que j'aille aussi loin que possible... Je ne peux pas aller plus loin... Il faut qu'il arrive quelque chose, quelque chose d'autre...»
Wilde s'embarqua le lendemain.
Le reste de l'histoire, on le sait. Ce «quelque chose d'autre» ce fut le hard labour[5].
Dès qu'il fut sorti de prison, Oscar Wilde revint en France. A Berneval, discret petit village aux environs de Dieppe, un nommé Sébastien Melmoth s'établit; c'était lui. De ses amis français, comme j'avais été le dernier à le voir, à le revoir je voulus être le premier. Dès que je pus connaître son adresse, j'accourus.
J'arrivai vers le milieu du jour. J'arrivais sans m'être annoncé. Melmoth que la bonne cordialité de T*** appelait assez souvent à Dieppe, ne devait rentrer que le soir. Il ne rentra qu'au milieu de la nuit.
C'était presque encore l'hiver. Il faisait froid; il faisait laid. Tout le jour je rôdai sur la plage déserte, découragé et plein d'ennui. Comment Wilde avait-il pu choisir Berneval pour y vivre? C'était lugubre.
La nuit vint. Je rentrai retenir une chambre à l'hôtel, celui même où vivait Melmoth, et d'ailleurs le [Pg 288]seul de l'endroit. L'hôtel, propre, agréablement situé, n'hébergeait que quelques êtres de second plan, d'inoffensifs comparses auprès de qui je dus dîner. Triste société pour Melmoth!
Heureusement j'avais un livre. Lugubre soir! onze heures... J'allais renoncer à attendre, quand j'entends le roulement d'une voiture... M. Melmoth est arrivé.
M. Melmoth est tout transi. Il a perdu en route son pardessus. Une plume de paon que, la veille, lui apporta son domestique (affreux présage) lui avait bien annoncé un malheur; il est heureux que ce ne soit que cela. Mais il grelotte et tout l'hôtel s'agite pour lui faire chauffer un grog. A peine s'il m'a dit bonjour. Devant les autres tout au moins, il ne veut pas paraître ému. Et mon émotion presque aussitôt retombe, à trouver Sébastien Melmoth si simplement pareil à l'Oscar Wilde qu'il était: non plus le lyrique forcené d'Algérie, mais le doux Wilde d'avant la crise; et je me trouvais reporté non pas de deux ans, mais de quatre ou cinq ans en arrière; même regard rompu, même rire amusé, même voix...
Il occupe deux chambres, les deux meilleures de l'hôtel, et se les est fait aménager avec goût. Beaucoup [Pg 289]de livres sur sa table, et parmi lesquels il me montre mes Nourritures Terrestres qui avaient paru depuis peu. Une jolie vierge gothique, sur un grand piédestal, dans l'ombre...
A présent nous sommes assis près de la lampe et Wilde boit son grog à petits coups. Je remarque, à présent qu'il est mieux éclairé, que la peau du visage est devenue rouge et commune; celle des mains encore plus, qui pourtant ont repris les mêmes bagues; une à laquelle il tient beaucoup porte en chaton mobile un scarabée d'Égypte en lapis-lazuli. Ses dents sont atrocement abîmées.
Nous causons. Je lui reparle de notre dernière rencontre à Alger. Je lui demande s'il se souvient qu'alors je lui prédisais presque la catastrophe.
—«N'est-ce pas, dis-je, que vous saviez à peu près ce qui vous attendait en Angleterre; vous aviez prévu le danger et vous y êtes précipité?...
(Ici je ne crois pas pouvoir mieux faire que recopier les feuilles où je transcrivis peu après tout ce que je pus me rappeler de ses paroles).
—«Oh! naturellement! naturellement, je savais qu'il y aurait une catastrophe—celle-là, ou une autre, je l'attendais. Il fallait que cela finisse ainsi. Songez [Pg 290]donc: Aller plus loin, ce n'était pas possible; et cela ne pouvait plus durer. C'est pourquoi vous comprenez qu'il faut que cela soit fini. La prison m'a complètement changé. Je comptais sur elle pour cela—Bosy[6] est terrible; il ne peut pas comprendre cela; il ne peut pas comprendre que je ne reprenne pas la même existence; il accuse les autres de m'avoir changé... Mais il ne faut jamais reprendre la même existence... Ma vie est comme une œuvre d'art; un artiste ne recommence jamais deux fois la même chose ... ou bien c'est qu'il n'avait pas réussi. Ma vie d'avant la prison a été aussi réussie que possible. Maintenant c'est une chose achevée.»
Il allume une cigarette.
—«Le public est tellement terrible qu'il ne connaît jamais un homme que par la dernière chose qu'il a faite. Si je revenais à Paris maintenant, on ne voudrait voir en moi que le ... condamné. Je ne veux pas reparaître avant d'avoir écrit un drame. Il faut jusque-là qu'on me laisse tranquille.»—Et il ajoute brusquement:—«N'est-ce pas que j'ai bien fait de venir ici? Mes amis voulaient que j'aille dans le Midi pour [Pg 291]me reposer; parce que, au commencement, j'étais très fatigué. Mais je leur ai demandé de chercher pour moi, dans le Nord de la France, une très petite plage, où je ne voie personne, où il fasse bien froid, où il n'y ait presque jamais de soleil... Oh! n'est-ce pas que j'ai bien fait de venir habiter à Berneval? (Dehors il faisait un temps épouvantable.)
»Ici tout le monde est très bon pour moi. Le curé surtout. J'aime tellement la petite église! Croiriez-vous qu'elle s'appelle Notre-Dame de Liesse! Aoh! n'est-ce pas que c'est charmant?—Et maintenant je sais que je ne vais plus jamais pouvoir quitter Berneval, parce que le curé m'a offert ce matin une stalle perpétuelle dans le chœur!
»Et les douaniers! Ils s'ennuyaient tellement, ici! alors je leur ai demandé s'ils n'avaient rien à lire; et maintenant je leur apporte tous les romans de Dumas père... N'est-ce pas qu'il faut que je reste ici?
»Et les enfants! aoh! ils m'adorent! Le jour du jubilé de la reine, j'ai donné une grande fête, un grand dîner, où j'avais quarante enfants de l'école—tous! tous! avec le maître! pour fêter la reine! N'est-ce pas que c'est absolument charmant?... Vous savez que j'aime beaucoup la reine. J'ai toujours son portrait [Pg 292]avec moi.»—Et il me montre, épinglé au mur, le portrait caricatural de Nicholson.
Je me lève pour le regarder; une petite bibliothèque est auprès; je regarde un instant les livres. Je voudrais amener Wilde à me parler plus gravement. Je me rassieds, et avec un peu de crainte je lui demande s'il a lu les Souvenirs de la Maison des Morts. Il ne répond pas directement, mais commence:
—«Les écrivains de la Russie sont extraordinaires. Ce qui rend leurs livres si grands, c'est la pitié qu'ils y ont mise. N'est-ce pas, avant j'aimais beaucoup Madame Bovary; mais Flaubert n'a pas voulu de pitié dans son œuvre, et c'est pourquoi elle a l'air petite et fermée; la pitié, c'est le côté par où est ouverte une œuvre, par où elle paraît infinie... Savez-vous, dear, que c'est la pitié qui m'a empêché de me tuer? Oh! pendant les six premiers mois j'ai été terriblement malheureux; si malheureux que je voulais me tuer; mais ce qui m'a retenu de le faire, ç'a été de regarder les autres, de voir qu'ils étaient aussi malheureux que moi, et d'avoir pitié. O dear! c'est une chose admirable, que la pitié; et je ne la connaissais pas! (Il parlait à voix presque basse, sans exaltation aucune.)—Est-ce que vous avez bien compris combien [Pg 293]la pitié est une chose admirable? Pour moi je remercie Dieu chaque soir—oui, à genoux, je remercie Dieu de me l'avoir fait connaître. Car je suis entré dans la prison avec un cœur de pierre et ne songeant qu'à mon plaisir, mais maintenant mon cœur s'est complètement brisé; la pitié est entrée dans mon cœur; j'ai compris maintenant que la pitié est la plus grande, la plus belle chose qu'il y ait au monde... Et voilà pourquoi je ne peux pas en vouloir à ceux qui m'ont condamné, ni à personne, parce que, sans eux, je n'aurais pas connu tout cela.—Bosy m'écrit des lettres terribles; il me dit qu'il ne me comprend pas; qu'il ne comprend pas que je n'en veuille pas à tout le monde; que tout le monde a été odieux pour moi... Non, il ne me comprend pas; il ne peut plus me comprendre. Mais je le lui répète dans chaque lettre; nous ne pouvons pas suivre la même route; il a la sienne; elle est très belle; j'ai la mienne. La sienne, c'est celle d'Alcibiade; la mienne est maintenant celle de saint François d'Assise... Connaissez-vous saint François d'Assise? aoh! admirable! admirable! Voulez-vous me faire un grand plaisir? Envoyez-moi la meilleure vie de saint François que vous connaissiez...»
[Pg 294]Je le lui promets, il reprend:
—«Oui—ensuite nous avons eu un directeur de prison charmant, aoh! tout à fait charmant! mais les six premiers mois, j'ai été terriblement malheureux. Il y avait un gouverneur de prison très méchant, un juif, qui était très cruel, parce qu'il manquait complètement d'imagination.» Cette dernière phrase, dite très vite, était irrésistiblement comique; et comme j'éclate de rire, il rit aussi, la répète, puis continue:
—«Il ne savait quoi imaginer pour nous faire souffrir:—Vous allez voir comme il manquait d'imagination... Il faut que vous sachiez que, dans la prison, on ne vous laisse sortir qu'une heure par jour; alors on marche dans une cour, en rond, les uns derrière les autres, et il est absolument défendu de se parler. Des gardes vous surveillent et il y a de terribles punitions pour celui qu'on surprend—Ceux qui sont pour la première fois en prison se reconnaissent à ce qu'ils ne savent pas parler sans remuer les lèvres.., Il y avait déjà six semaines que j'étais enfermé, et que je n'avais dit un mot à personne—à personne. Un soir, nous marchions comme cela les uns derrière les autres pendant l'heure de la promenade, et tout d'un coup, [Pg 295]derrière moi, j'entends prononcer mon nom: c'était le prisonnier qui était derrière moi, qui disait: «Oscar Wilde, je vous plains, parce que vous devez souffrir plus que nous.» Alors j'ai fait un énorme effort pour ne pas être remarqué (je croyais que j'allais m'évanouir) et j'ai dit sans me retourner: «Non, mon ami; nous souffrons tous également.»—Et ce jour-là je n'ai plus du tout eu envie de me tuer.
»Nous avons parlé comme cela plusieurs jours. J'ai su son nom, et ce qu'il faisait. Il s'appelait P***; c'était un excellent garçon; aoh! excellent!... Mais je ne savais pas encore parler sans remuer les lèvres, et un soir: «C. 33! (C. 33 c'était moi)—C. 33 et C. 48, sortez des rangs!» Alors nous sortons des rangs et le gardien dit: «Vous allez comparaître devant Monsieur le Dirrrecteur!»—Et comme la pitié était déjà entrée dans mon cœur, je ne m'effrayais absolument que pour lui; j'étais, au contraire, heureux de souffrir à cause de lui.—Mais le directeur était tout à fait terrible. Il a fait passer P*** le premier; il voulait nous interroger séparément,—parce qu'il faut vous dire que la peine n'est pas la même pour celui qui a commencé à parler que pour celui qui a répondu; la peine de [Pg 296]celui qui a parlé le premier est le double de celle de l'autre; d'ordinaire le premier a quinze jours de cachot, le second seulement huit; alors le directeur voulait savoir qui de nous deux avait parlé le premier. Et, naturellement, P***, qui était un excellent garçon, a dit que c'était lui. Et quand, après, le directeur m'a fait venir pour m'interroger, naturellement, j'ai dit que c'était moi. Alors le directeur est devenu très rouge, parce qu'il ne comprenait plus.—«Mais P*** dit aussi que c'est lui qui a commencé! Je ne peux pas comprendre...»
«Pensez-vous, dear!! Il ne pouvait pas comprendre! Il était très embarrassé; il disait: «Mais je lui ai déjà donné quinze jours à lui...» et puis il a ajouté: «Enfin! si c'est comme ça, je m'en vais vous donner quinze jours à tous les deux.» N'est-ce pas que c'est extraordinaire! Cet homme-là n'avait aucune espèce d'imagination.»—Wilde s'amuse énormément de ce qu'il dit; il rit; il est heureux de raconter:
—«Et naturellement, après les quinze jours, nous avions beaucoup plus envie qu'auparavant, de nous parler. Vous ne savez pas combien cela pouvait paraître doux, de sentir que l'on souffrait l'un pour l'autre.—Peu à peu, comme on n'occupait pas tous les jours [Pg 297]le même rang, peu à peu j'ai pu parler à chacun des autres; à tous! à tous!... J'ai su le nom de chacun d'eux, l'histoire de chacun, et quand il devait sortir de prison.... Et à chacun d'eux je disais: En sortant de prison, la première chose que vous ferez ce sera d'aller à la poste; il y aura une lettre pour vous avec de l'argent.—De sorte que, comme cela, je continue à les connaître, parce que je les aime beaucoup. Et il y en a de tout à fait délicieux. Croiriez-vous qu'il y en a déjà trois qui sont venus me voir ici! N'est-ce pas que c'est tout à fait admirable?...
«Celui qui a remplacé le méchant directeur était un très charmant homme, aoh! remarquable! tout à fait aimable avec moi... Et vous ne pouvez pas imaginer quel bien m'a fait dans la prison la Salomé que l'on a jouée à Paris, précisément à cette époque. Ici, on avait complètement oublié que j'étais littérateur! Quand on a vu ici que ma pièce avait du succès à Paris, on s'est dit: Tiens! mais, c'est étrange! il a donc du talent. Et à partir de ce moment on m'a laissé lire tous les livres que je désirais.
«J'ai pensé d'abord que ce qui me plairait le plus ce serait la littérature grecque. J'ai demandé Sophocle; [Pg 298]mais je n'ai pu y prendre goût. Alors j'ai pensé aux Pères de l'Eglise; mais eux non plus ne m'intéressaient pas. Et tout d'un coup j'ai pensé à Dante... oh! Dante! J'ai lu le Dante tous les jours; en italien; je l'ai lu tout entier; mais ni le Purgatoire ni le Paradis ne me semblaient écrits pour moi. C'est son Inferno surtout que j'ai lu; comment ne l'aurais-je pas aimé? Comprenez-vous? L'Enfer, nous y étions. L'Enfer, c'était la prison...»
—Ce même soir il me raconte son projet de drame sur Pharaon et un ingénieux conte sur Judas.
Le lendemain il me mène dans une charmante petite maison, à deux cents mètres de l'hôtel, qu'il a louée et commence à faire meubler. C'est là qu'il veut écrire ses drames; son Pharaon d'abord, puis un Achab et Jésabel (il prononce: Isabelle) qu'il raconte merveilleusement.
La voiture qui m'emmène est attelée. Wilde y monte avec moi, pour m'accompagner un instant. Il me reparle de mon livre, le loue, mais avec je ne sais quelle réticence. Enfin la voiture s'arrête. Il me dit adieu, va descendre, mais, tout à coup:—«Ecoutez, dear, il faut maintenant que vous me fassiez une promesse. [Pg 299]Les Nourritures Terestres, c'est bien... c'est très bien... Mais dear, promettez-moi: maintenant n'écrivez plus jamais JE.»
Et comme je paraissais ne pas suffisamment comprendre, il reprenait:—«En art, voyez-vous, il n'y a pas de première personne.»
De retour à Paris, j'allai donner de ses nouvelles à Lord Alfred Douglas. Celui-ci me dit:
—«Mais tout cela est tout à fait ridicule. Wilde est tout à fait incapable de supporter l'ennui. Je le sais très bien: il m'écrit tous les jours; et moi aussi je suis d'avis qu'il faut d'abord qu'il termine sa pièce; mais, après, il me reviendra; il n'a jamais rien fait de bon dans la solitude; il a besoin d'être tout le temps distrait. C'est près de moi qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit de meilleur.—Voyez d'ailleurs sa dernière lettre...» Lord Alfred me la montre et me la lit.—Elle supplie Bosy de le laisser finir tranquillement son Pharaon, mais dit en effet que, sitôt cette pièce écrite, il reviendra, le retrouvera,—et termine par cette phrase glorieuse: «... et alors je serai de nouveau le Roi de la Vie (the King of Life).»
Et peu de temps après Wilde revint à Paris[7]. Sa pièce n'était pas écrite; elle ne le sera jamais. La société sait bien s'y prendre quand elle veut supprimer un homme, et connaît des moyens plus subtils que la mort... Wilde avait trop souffert depuis deux ans et d'une façon trop passive. Sa volonté avait été brisée. Les premiers mois, il put se faire illusion encore, mais bientôt il s'abandonna. Ce fut comme une abdication. Rien ne resta dans sa vie effondrée qu'un douloureux relent de ce qu'il avait été naguère; un besoin par instants de prouver qu'il pensait encore; de l'esprit, mais [Pg 302]cherché, contraint, fripé. Je ne le revis plus que deux fois:
Un soir, sur les boulevards où je me promenais avec G***, je m'entendis appeler par mon nom. Je me retournai: c'était Wilde. Ah! combien il était changé!... «Si je reparais avant d'avoir écrit mon drame, le monde ne voudra voir en moi que le forçat», m'avait-il dit. Il était reparu sans drame et, comme devant lui quelques portes s'étaient fermées, il ne cherchait plus de rentier nulle part; il rôdait. Des amis, à plusieurs reprises, avaient tenté de le sauver; on s'ingéniait; on l'emmenait en Italie... Wilde échappait bientôt; retombait. Parmi ceux demeurés le plus longtemps fidèles, quelques-uns m'avaient tant redit que «Wilde n'était plus visible...», je fus un peu gêné, je l'avoue, de le revoir et dans un lieu où pouvait passer tant de monde.—Wilde était attablé sur la terrasse d'un café. Il commanda pour G*** et pour moi deux cocktails... J'allais m'asseoir en face de lui, c'est-à-dire de manière à tourner le dos aux passants, mais Wilde, s'affectant de ce geste qu'il crut causé par une absurde honte (il ne se trompait, hélas! pas tout à fait):
—«Oh! mettez-vous donc là, près de moi, dit-il, [Pg 303]en m'indiquant, à côté de lui, une chaise; je suis tellement seul à présent!»
Wilde était encore bien mis; mais son chapeau n'était plus si brillant; son faux-col avait même forme, mais il n'était plus aussi propre; les manches de sa redingote étaient légèrement frangées»
—«Quand, jadis, je rencontrais Verlaine, je ne rougissais pas de lui, reprit-il, avec un essai de fierté. J'étais riche, joyeux, couvert de gloire, mais je sentais que d'être vu près de lui m'honorait, même quand Verlaine était ivre...» Puis craignant d'ennuyer G***, je pense, il changea brusquement de ton, essaya d'avoir de l'esprit, de plaisanter, devint lugubre. Mon souvenir ici reste abominablement douloureux. Enfin, G*** et moi nous nous levâmes. Wilde tint à payer les consommations. J'allais lui dire adieu quand il me prit à part et, confusément, à voix basse:
—«Ecoutez, me dit-il, il faut que vous sachiez...: je suis absolument sans ressources...»
Quelques jours après, pour la dernière fois, je le revis. Je ne veux citer de notre conversation qu'un mot. Il m'avait dit sa gêne, l'impossibilité de continuer, de commencer même un travail. Tristement je lui rappelais [Pg 304]la promesse qu'il s'était faite de ne reparaître à Paris qu'avec une pièce achevée:
—«Ah! pourquoi, commençais-je, avoir si tôt quitté Berneval, où vous vous étiez promis de rester si longtemps? Je ne puis pas dire que je vous en veuille, mais...»
Il m'interrompit, mit sa main sur la mienne, me regarda de son plus douloureux regard:
—«Il ne faut pas en vouloir, me dit-il, à quelqu'un qui a été frappé.»
Oscar Wilde mourut dans un misérable petit hôtel de la rue des Beaux-Arts. Sept personnes suivirent l'enterrement; encore n'accompagnèrent-elles pas toutes jusqu'au bout le funèbre convoi. Sur la bière, des fleurs, des couronnes; une seule m'a-t-on dit portait une inscription: c'était celle du propriétaire de l'hôtel; on y lisait ces mots: A MON LOCATAIRE.
[1] Ecrit en Décembre 1901.
[2] La rédaction qu'il fit plus tard de ce conte est, par extraordinaire, excellente—par conséquent aussi la traduction qu'en donna notre ami H. Davray, dans la Revue Blanche.
[3] Depuis que Villiers de l'Isle-Adam l'a trahi, tout le monde sait, hélas! le grand secret de l'Eglise: Il n'y a pas de purgatoire.
[4] Un de ces derniers soirs d'Alger, Wilde semblait s'être promis de ne rien dire de sérieux. Enfin je m'irritai quelque peu de ses trop spirituels paradoxes:
—«Vous avez mieux à dire que des plaisanteries, commençai-je; vous me parlez ce soir comme si j'étais le public. Vous devriez plutôt parler au public comme vous savez parler à vos amis. Pourquoi vos pièces ne sont-elles pas meilleures? Le meilleur de vous, vous le parlez; pourquoi ne l'écrivez-vous pas?
—Oh! mais, s'écria-t-il aussitôt,—mes pièces ne sont pas du tout bonnes! et je n'y tiens pas du tout... Mais si vous saviez comme elles amusent!... Elles sont presque toutes le résultat d'un pari. Dorian Grey aussi; je l'ai écrit en quelques jours, parce qu'un de mes amis prétendait que je ne pourrais jamais écrire de romans. Cela m'ennuie tellement d'écrire!»—Puis se penchant brusquement vers moi: «Voulez-vous savoir le grand drame de ma vie?—C'est que j'ai mis mon génie dans ma vie; je n'ai mis que mon talent dans mes œuvres.»
Il n'était que trop vrai. Le meilleur de son écriture n'est qu'un pâle reflet de sa brillante conversation. Ceux qui l'ont entendu parler trouvent décevant de le lire. Dorian Grey, tout d'abord, était une admirable histoire, combien supérieure à la Peau de Chagrin! combien plus significative! Hélas! écrit, quel chef-d'œuvre manqué!—Dans ses contes les plus charmants trop de littérature se mêle, si gracieux qu'ils soient on y sent trop l'apprêt; la préciosité, l'euphuisme y cachent la beauté de la première invention; on y sent, on ne peut cesser d'y sentir les trois moments de leur genèse; l'idée première en est fort belle, simple, profonde et de retentissement certain; une sorte de nécessité latente en relient fixement les parties; mais dès ici le don s'arrête; le développement des parties se fait de manière factice; elles ne s'organisent pas bien; et quand, après, Wilde travaille ses phrases, s'occupe de mettre en valeur, c'est par une prodigieuse surcharge de concettis, de menues inventions plaisantes et bizarres où l'émotion s'arrête de sorte que le chatoiement de la surface fait perdre de vue et d'esprit la profonde émotion centrale.
[5] Je n'ai rien inventé, rien arrangé, dans les derniers propos que je cite. Les paroles de Wilde sont présentes à mon esprit, et j'allais dire à mon oreille. Je ne prétends pas que Wilde vit nettement se dresser devant lui la prison; mais j'affirme que le grand coup de théâtre qui surprit et bouleversa Londres, transformant brusquement Oscar Wilde d'accusateur en accusé, ne lui causa pas à proprement parler de surprise. Les journaux, qui ne voulaient plus voir en lui qu'un pitre, ont dénaturé de leur mieux l'attitude de sa défense, jusqu'à lui enlever tout sens. Peut-être, quelque jour lointain, siéra-t-il de relever de la fange cet abominable procès...
[6] Lord Alfred Douglas.
[7] Les représentants de sa famille assuraient à Wilde une fort belle situation s'il consentait à prendre certains engagements, entre autres celui de ne jamais revoir Lord Alfred. Il ne put ou ne voulut pas les prendre.
ACHEVÉ D'IMPRIMER
Le vingt novembre mil neuf cent dix-neuf
PAR
BUSSIÈRE
A SAINT-AMAND (CHER)
pour le
MERCVRE
DE
FRANCE