
Title: Correspondance inédite de Hector Berlioz, 1819-1868
Author: Hector Berlioz
Editor: Daniel Bernard
Release date: September 18, 2009 [eBook #30021]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: French
Credits: Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team
DE
—1819-1868—
AVEC UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE
PAR
deuxième édition
REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

PARIS
CALMANN LÉVY, ÉDITEUR
ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES
rue auber, 3, et boulevard des italiens, 15
A LA LIBRAIRIE NOUVELLE
—
1879
Droits de reproduction et de traduction réservés
| Notice sur Berlioz | ||
| I. | — | A Ignace Pleyel |
| II. | — | A Rodolphe Kreutzer |
| III. | — | A M. Fétis |
| IV. | — | A M. Ferdinand Hiller |
| V. | — | Au même |
| VI. | — | Au même |
| VII. | — | Au même |
| VIII. | — | A MM. Gounet, Girard, Hiller, Desmarets, Richard, Sichel |
| IX. | — | A Ferdinand Hiller |
| X. | — | Au même |
| XI. | — | Au même |
| XII. | — | Au même |
| XIII. | — | Au même |
| XIV. | — | A madame Horace Vernet |
| XV. | — | A M. Ferdinand Hiller |
| XVI. | — | A M. l'intendant général de la liste civile |
| XVII. | — | A Joseph d'Ortigue |
| XVIII. | — | Au même |
| XIX. | — | A M. Ferdinand Hiller |
| XX. | — | A Joseph d'Ortigue |
| XXI. | — | Au même |
| XXII. | — | A M. Hoffmeister |
| XXIII. | — | A Robert Schumann |
| XXIV. | — | A Maurice Schlesinger |
| XXV. | — | A Liszt |
| XXVI. | — | A Buloz |
| XXVII. | — | A Joseph d'Ortigue |
| XXVIII. | — | A M. Griepenkerl |
| XXIX. | — | A Michel Glinka |
| XXX. | — | A Louis Berlioz |
| XXXI. | — | A Joseph d'Ortigue |
| XXXII. | — | Au même |
| XXXIII. | — | Au même |
| XXXIV. | — | A Joseph d'Ortigue |
| XXXV. | — | A Tajan-Rogé |
| XXXVI. | — | A M. Auguste Morel |
| XXXVII. | — | Au même |
| XXXVIII. | — | Au même |
| XXXIX. | — | A M. Alexis Lwoff |
| XL. | — | A M. Auguste Morel |
| XLI. | — | Au même |
| XLII. | — | A Joseph d'Ortigue |
| XLIII. | — | A M. Auguste Morel |
| XLIV. | — | Au même |
| XLV. | — | A Guillaume Lenz |
| XLVI. | — | A M. Alexis Lwoff |
| XLVII. | — | A M. Lecourt |
| XLVIII. | — | A M. Auguste Morel |
| XLIX. | — | A Joseph d'Ortigue |
| L. | — | A M. Alexis Lwoff |
| LI. | — | A M. Auguste Morel |
| LII. | — | A Joseph d'Ortigue |
| LIII. | — | Au même |
| LIV. | — | A Louis Berlioz |
| LV. | — | A M. Ferdinand Hiller |
| LVI. | — | A Joseph d'Ortigue |
| LVII. | — | Au même |
| LVIII. | — | Au même |
| LIX. | — | A M. Auguste Morel |
| LX. | — | A M. le directeur du Journal des Débats |
| LXI. | — | A Joseph d'Ortigue |
| LXII. | — | A M. Brandus |
| LXIII. | — | A M. B. Jullien |
| LXIV. | — | A Louis Berlioz |
| LXV. | — | Au même |
| LXVI. | — | Au même |
| LXVII. | — | A M. Hans de Bulow |
| LXVIII. | — | A M. Auguste Morel |
| LXIX. | — | A M. Hans de Bulow |
| LXX. | — | A Louis Berlioz |
| LXXI. | — | A Léon Kreutzer |
| LXXII. | — | A Tajan-Rogé |
| LXXIII. | — | A M. Auguste Morel |
| LXXIV. | — | A Richard Wagner |
| LXXV. | — | A Louis Berlioz |
| LXXVI. | — | A M. Auguste Morel |
| LXXVII. | — | Au même |
| LXXVIII. | — | Au même |
| LXXIX. | — | A Théodore Ritter |
| LXXX. | — | A M. Ernest Legouvé |
| LXXXI. | — | A M. Auguste Morel |
| LXXXII. | — | Au même |
| LXXXIII. | — | A M. l'abbé Girod |
| LXXXIV. | — | A M. Bennet |
| LXXXV. | — | A M. Auguste Morel |
| LXXXVI. | — | Au même |
| LXXXVII. | — | Au même |
| LXXXVIII. | — | Au même |
| LXXXIX. | — | Au même |
| XC. | — | Au même |
| XCI. | — | A M. Hans de Bulow |
| XCII. | — | A Louis Berlioz |
| XCIII. | — | Au même |
| XCIV. | — | Au même |
| XCV. | — | A M. Auguste Morel |
| XCVI. | — | Au même |
| XCVII. | — | Au même |
| XCVIII. | — | A Louis Berlioz |
| XCIX. | — | A M. Auguste Morel |
| C. | — | A Louis Berlioz |
| CI. | — | Au même |
| CII. | — | Au même |
| CIII. | — | A Louis Berlioz |
| CIV. | — | Au même |
| CV. | — | A madame Massart |
| CVI. | — | A Louis Berlioz |
| CVII. | — | Au même |
| CVIII. | — | Au même |
| CIX. | — | Au même |
| CX. | — | Au même |
| CXI. | — | Au même |
| CXII. | — | A M. Auguste Morel |
| CXIII. | — | A Louis Berlioz |
| CXIV. | — | Au même |
| CXV. | — | Au même |
| CXVI. | — | Au même |
| CXVII. | — | A Paul Smith |
| CXVIII. | — | A Louis Berlioz |
| CXIX. | — | A M. et madame Massart |
| CXX. | — | Aux mêmes |
| CXXI. | — | A madame Massart |
| CXXII. | — | A M. Johannès Weber |
| CXXIII. | — | A M. Alexis Lwoff |
| CXXIV. | — | A M. Bennet |
| CXXV. | — | Au même |
| CXXVI. | — | A M. et madame Massart |
| CXXVII. | — | A M. Auguste Morel |
| CXXVIII. | — | A M. et madame Damcke |
| CXXIX. | — | A madame Ernst |
| CXXX. | — | A madame Damcke |
| CXXXI. | — | A Louis Berlioz |
| CXXXII. | — | A madame Massart |
| CXXXIII. | — | A M. Damcke |
| CXXXIV. | — | A Louis Berlioz |
| CXXXV. | — | Au même |
| CXXXVI. | — | A M. et madame Damcke |
| CXXXVII. | — | A madame Massart |
| CXXXVIII. | — | A Louis Berlioz |
| CXXXIX. | — | Au même |
| CXL. | — | A M. Asger Hamerik |
| CXLI. | — | A madame Massart |
| CXLII. | — | A madame Massart |
| CXLIII. | — | A M. Ernest Reyer |
| CXLIV. | — | A M. Ferdinand Hiller |
| CXLV. | — | Au même |
| CXLVI. | — | A madame Damcke |
| CXLVII. | — | A M. et madame Massart |
| CXLVIII. | — | Aux mêmes |
| CXLIX. | — | A M. Édouard Alexandre |
| CL. | — | A M. et madame Massart |
| CLI. | — | A M. Damcke |
| CLII. | — | A M. et madame Massart |
| CLIII. | — | A M. Wladimir Stassoff |
| CLIV. | — | Au même |
| CLV. | — | A M. Auguste Morel |
| CLVI. | — | A M. Wladimir Stassoff |
| Appendice | ||
Monsieur
Je suis vivement touché de la noble abnégation qui
vous porte à refuser
notre admirable requiem pour
la cérémonie des Invalides, veuillez être
convaincu
de toute ma reconnaissance. Cependant, comme
la détermination
de Monsieur le Ministre de l'intérieur
est irrévocable, je viens vous
prier instamment de ne
plus penser à moi et de ne pas priver le
gouvernement
et vos admirateurs d'un chef d'œuvre qui donnerait
tant d'éclat à cette solennité.
Je suis avec un profond respect,
monsieur
votre dévoué serviteur
H. Berlioz
24 mars 1837.
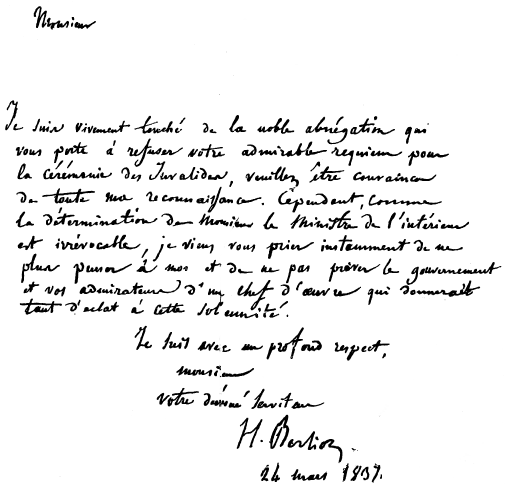
Quelqu'un a dit de Berlioz, il y a une vingtaine d'années:—Il n'a pas le succès, mais il a la gloire....—Aujourd'hui, le voilà en train de conquérir l'un et l'autre; c'est pourquoi les éléments de ce livre ont été rassemblés et pourquoi cette notice a été écrite.
La gloire et le succès tout à la fois!.... Pour réunir ces deux attributs, qui ordinairement marchent de compagnie et qui n'avaient été séparés (dans le cas présent) que par le plus grand des hasards, Berlioz n'a eu qu'une chose très-simple à faire,—une chose à laquelle nous sommes soumis, vous et moi, une chose de laquelle dépendent les oiseaux qui volent dans l'air, les poissons qui nagent dans l'eau, les fleurs qui présentent leurs corolles aux baisers du soleil, le mendiant sous ses haillons et le souverain sous sa pourpre, une chose que nous ne pouvons ni éviter quand nous ne la cherchons pas, ni rencontrer quand nous la cherchons: il n'a eu qu'à mourir.
C'est que la mort est une fée mystérieuse dont la baguette a déjà accompli bien des prodiges. Telle marâtre insupportable, tel prince tyrannique, tel parent qui nous embarrassait, tel ami qui nous avait pris une place, nous apparaissent, dès qu'ils sont couchés dans la tombe, comme des modèles de vertus. Nous jetons des roses sur ces fosses encore béantes, nous avons soin de planter un bel arbre sur la terre fraîchement remuée, comme pour sceller le cachot et pour être assurés que le cadavre ne ressuscitera pas; ces précautions prises, rien ne nous empêche de chanter les louanges de ceux qui ne sont plus. Non-seulement ils ne nous gênent guère, mais, par-dessus le marché, ils nous servent contre les vivants. Quoi de plus naturel que d'écraser Mozart sous la réputation de Haydn! quoi de plus juste que de jeter à la tête de Rossini le Barbier de Paisiello?
Berlioz, en vie, avait tous les inconvénients de son état de vivant; quoique, par ses maladies fréquentes, il donnât beaucoup d'espérances aux gens qui attendaient qu'il disparût, il n'en occupait pas moins un rang dans la presse, un fauteuil à l'Institut, une loge au théâtre, un espace quelconque d'air respirable; je ne parle pas de son prestige musical; certains critiques croyaient l'avoir détruit à tout jamais, ou s'imaginaient qu'ils le croyaient; car, au fond, ils n'en étaient pas bien sûrs.
Il existait donc d'excellentes raisons pour que Berlioz fût attaqué, discuté, calomnié par ses concurrents, qui, ayant du talent, ne lui pardonnaient pas d'avoir du génie, et par ceux, beaucoup plus nombreux, qui, ne possédant ni génie ni talent, se ruaient indifféremment à l'assaut de toute réputation sérieuse, sans espoir d'en tirer avantage pour eux-mêmes et uniquement pour le plaisir de briser. Couvert de lauriers à l'étranger, Berlioz s'irritait de trouver dans les feuilles de ses couronnes triomphales des moustiques parisiens qui le piquaient. Il était plus préoccupé des haines qu'il rencontrait dans son propre pays que des magnifiques ovations qui l'attendaient au delà des frontières; et, de Londres, de Saint-Pétersbourg, de Vienne, de Weimar, de Lowenberg, de partout, nous le voyons écrire au dévoué et savant Joseph d'Ortigue, le Thiriot de cet autre Voltaire:—«On m'a donné un banquet.... on m'a décoré de l'ordre de l'Aigle blanc.... On est venu m'offrir une tabatière de la part du Roi.... les journaux d'ici me portent aux nues.... fais en sorte que Paris le sache!—» Paris! Paris! il ne songeait qu'à cette ville ingrate.
Un jour, on lui propose, à lui qui n'avait rien, une place de maître de chapelle dans le palais de l'empereur d'Autriche: appointements élevés, résidence agréable, soins attentifs, nul souci de l'avenir, nuls risques de perdre ce poste, tout était réuni. Donizetti occupait déjà, dans la même résidence, une charge à peu près semblable, charge qui lui rapportait beaucoup et qui lui coûtait à peine une perte de temps. Berlioz refusa. Il voyageait en Allemagne à ce moment-là; sur le point de prendre une détermination il se tourne vers sa patrie, les yeux mouillés de larmes:—«Quoi! s'écrie-t-il, je ne te reverrai jamais (c'était dans les conditions du contrat); je n'aurai plus la liberté d'aller me faire traîner aux gémonies dans la fange de tes boulevards et sur les gradins de tes cirques! Mais je mourrais d'ennui, là-bas, au sein de mon opulence!»—Puis, s'adressant à ses amis, Desmarets, d'Ortigue, Dietsch, Schlesinger:—«O mes amis! je m'aperçois que je vous aime plus que tout au monde et que je ne peux pas me séparer de vous!»—Là-dessus, il repoussait les présents d'Artaxerce et reprenait avec joie le chemin de cette France adorée et maudite, qui, ayant parmi ses enfants le plus grand symphoniste du siècle après Beethoven, ne lui laissait à faire que des feuilletons.
Cependant il fallait, ou que la France se trompât au sujet de ce fils (si peu dénaturé pourtant!) ou que le reste de l'Europe se trompât de son côté; le doute n'est plus permis à présent, le procès est jugé; le bon sens de l'Europe avait raison contre la frivolité de la France... Que voulez-vous? le Gaulois est né léger comme d'autres naissent coiffés... Du temps des Romains, il montait à l'assaut du Capitole sans avoir pris soin d'éclairer sa route, en sorte que les oies criaient contre lui et avertissaient l'ennemi de se tenir en garde. Louis XV, à la veille d'une révolution qui devait emporter sa race, disait:—«Cela durera bien autant que moi.»—Légèreté des légèretés! tout n'est que légèreté. En ce qui concerne la musique, les Français ont eu des naïvetés et des fatuités formidables... Un émigré en Angleterre auquel on demandait s'il savait jouer du clavecin, répliquait d'un air digne:—«Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé.»
Nul n'est prophète en son village, ou plutôt ceux qui passent pour tels ne sont souvent que de faux prophètes. Berlioz, admiré au loin, bafoué par ses compatriotes, était une des organisations les plus riches et les mieux douées que l'on pût voir. Compositeur inégal, mais souvent sublime, écrivain de race et primesautier, il a laissé une double réputation, alors que ses ennemis se sont donné tant de mal pour en laisser seulement la moitié d'une. La Correspondance que nous publions aujourd'hui ne nuira pas, croyons-nous, à la renommée du musicien et augmentera de beaucoup celle du littérateur. On connaissait déjà par les Mémoires[1] ce style haché, décousu, violent, plein de fantaisie et de grâce, se perdant en élans désespérés ou s'affaiblissant en des tristesses mornes. Quel beau livre, malgré ses défauts! comme il vibre à chaque page, comme il sait mélanger le plaisant au sévère! La pensée de l'auteur est une balle qui rebondit selon la nature des objets qu'elle frappe, tantôt s'élevant jusqu'au pur lyrisme, tantôt échouant dans le marécage du calembour. Quelle opposition avec les paisibles récits de Grétry sur son enfance liégeoise! Les musiciens se suivent et ne se ressemblent pas; il y a entre l'auteur de Richard Cœur de lion et l'auteur du Dies iræ grotesque la différence qu'on remarquerait entre un ruisselet tranquille et un torrent débordé.
La Correspondance, venant après les Mémoires, a une utilité qui ne sera contestée par personne; d'abord, elle fermera la bouche aux détracteurs (s'il en reste encore), aux malveillants qui secouaient la tête quand on leur annonçait telle ou telle victoire remportée au dehors:—«A beau mentir qui vient de loin.»—Ils n'avaient pas d'autre réponse; ils seront obligés maintenant de chercher un biais. La plupart des lettres que nous avons retrouvées sont des bulletins écrits à l'issue de la bataille et encore noircis de la fumée du combat; impossible de nier ces documents triomphants,—et triomphants dans un double sens,—impossible de les rejeter, car ils acquièrent la valeur de pièces historiques. Ils nous donnent la vérité prise sur le fait; un artiste, ivre de la joie du succès, les oreilles remplies du bruit des applaudissements, les joues rougies par de fraternelles embrassades, se hâte de faire part de son bonheur aux amis qu'il a laissés à Paris; il leur mande que tels princes l'ont complimenté, que telles récompenses lui ont été décernées, que les populations organisent en son honneur des sérénades, des banquets, que la recette du concert a été superbe... Comment récuser ces témoignages? Si on les repousse, nous ne voyons plus aucune manière d'écrire l'histoire avec certitude et nous ne comprenons pas ce qu'on pourra répondre aux mauvais plaisants qui prétendent que Napoléon Ier n'a jamais existé.
Dans quelques passages, la Correspondance, faisant allusion à des événements oubliés ou ignorés de cette génération de lecteurs, nous avons cru devoir donner quelques éclaircissements. Nous avons pensé qu'une notice biographique aiderait peut-être à dissiper les ténèbres du texte. Notre prétention, on le suppose bien, n'a pas été, un seul instant, de rivaliser avec les Mémoires; cette folle témérité aurait été cruellement punie. Nous avons essayé seulement de recueillir ce que les Mémoires avaient omis et de les résumer en les complétant.
Berlioz (Louis-Hector) est né à la Côte-Saint-André, ville célèbre par ses fabriques de liqueurs, dans le département de l'Isère, à cinq heures du soir, le dimanche 19 frimaire an XII (c'est-à-dire, en langage ordinaire, le 11 décembre 1803)[2]. Son acte de naissance fut dressé devant les deux témoins suivants: le citoyen Auguste Buisson, âgé de trente-trois ans, propriétaire, et le citoyen Jean-François Recourdon, âgé de quarante-trois ans, receveur des contributions. Le père de l'enfant exerçait la profession de médecin; son grand-père, noble Louis-Joseph Berlioz, avait été conseiller du roy, auditeur de la Chambre des comptes du Dauphiné et habitait tantôt la Côte, tantôt Grenoble[3]. Louis Berlioz, le médecin, aimant la vie rurale, était venu se fixer à la campagne, sous le toit paternel; c'était un homme d'une nature mélancolique, d'un tempérament maladif, chercheur, un peu triste d'aspect, doux et bon; il se plaisait dans la solitude, pratiquait son art d'une façon désintéressée et charitable, et partageait sa vie entre l'étude et la surveillance de ses domaines. Il y est mort en août 1848, vénéré de tous, des petits surtout, qui n'avaient jamais vainement recours à ses conseils et à sa générosité.
S'il est souvent question, dans les Mémoires, du père d'Hector Berlioz, on ne fait qu'entrevoir sa mère; elle se nommait Marie-Antoinette-Joséphine Marmion et avait épousé Louis Berlioz vers le commencement du siècle. Femme d'une piété ardente et d'une rigide honnêteté, elle craignit longtemps pour son fils les souffles empestés de la gloire profane; elle chercha à le retenir au foyer des aïeux, impuissante à empêcher l'aiglon de briser sa coque et d'aller affronter la lumière à laquelle les ailes se brûlent parfois. Pauvre mère vigilante! ses efforts ne furent pas entièrement perdus; car si elle ne réussit pas à empêcher son fils de courir le monde, elle lui inculqua du moins l'amour de la patrie et du sol natal. L'enfant prodigue ne revint jamais aux lieux où ses premiers jours s'étaient écoulés sans pousser des cris d'admiration, provoqués par la beauté du pays, la douceur du climat, les réminiscences lointaines de la naissante aurore.
Vingt ans après, revenant d'Italie, il écrivait à madame Horace Vernet: «Les souvenirs du royaume de Naples sont restés impuissants contre l'aspect riant, varié, frais, riche, pittoresque, beau de masses, beau de détails, de notre admirable vallée de l'Isère[4]...» En descendant du Mont-Cenis, il s'était laissé aller à un véritable transport: «Voilà le vieux rocher de Saint-Eynard!... Voilà le gracieux réduit où brilla la Stella montis...; là-bas, dans cette vapeur bleue me sourit la maison de mon grand-père. Toutes ces villes, cette riche verdure,... c'est ravissant, c'est beau,... il n'y a rien de pareil en Italie[5].» Évidemment l'influence maternelle avait été pour quelque chose dans ce sentiment d'amour du clocher, amour si profondément tenace dans le cœur du poëte.
Les années d'enfance, passées à la Côte-Saint-André, ne présentèrent aucun fait saillant; le jeune Hector révélait cependant des dispositions intelligentes. Son penchant l'attirait vers l'étude de la géographie et ses rêves l'entraînaient vers une île déserte, paradis imaginaire de tous les enfants qui ont lu Robinson Crusoë. Sur la mappemonde, son petit doigt rose s'égarait de préférence sur la carte de l'Océanie, où tant d'archipels émergent de l'onde amère, comme ces insectes que le pied d'un passant réveille dans leurs trous de sable. Le grec et le latin, il ne les apprenait que par soubresauts et avec toutes sortes de caprices, sautant de l'Énéide aux fables de la Fontaine, et ne paraissant pas avoir goûté beaucoup les vrais classiques, Horace, Tite Live, Tacite, Salluste, Homère, Xénophon, Sophocle. En revanche, les livres qu'il aimait lui profitaient d'autant plus qu'il les lisait avec passion, tout en négligeant le reste. Ce fut son procédé, sa manière d'apprendre, à lui, jusqu'à la fin de sa vie. Jamais on ne put lui mettre dans la tête ce qui n'y voulait pas entrer; mais il sut tout ce qu'il voulut, et, plus d'une fois, devança l'enseignement de ses maîtres ou le corrigea par son expérience personnelle.
Son premier professeur de musique sérieux fut un nommé Imbert, que le malheur des temps avait jeté à la Côte-Saint-André et qui y était resté à titre d'épave. Il reçut aussi les leçons d'un M. Dorant (Alsacien de Colmar), que nous retrouvons dans un chapitre des Grotesques de la musique. La scène se passe à Lyon, où Berlioz, déjà célèbre, est venu donner un concert: «Messieurs, dit-il aux artistes de son orchestre, j'ai l'honneur de vous présenter M. Dorant, un très-habile professeur de Vienne; il a parmi vous un élève reconnaissant; cet élève, c'est moi, vous jugerez peut-être tout à l'heure que je ne lui fais pas grand honneur; cependant veuillez accueillir M. Dorant comme si vous pensiez le contraire et comme il le mérite[6].» En effet, MM. Imbert et Dorant n'avaient pas eu à se plaindre de leur disciple; dès l'âge de douze ans, celui-ci déchiffrait à première vue, chantait juste, avait composé un quintette, et jouait de trois instruments agréables en société, à savoir: la flûte, le flageolet et la guitare.
Nous voilà loin, n'est-ce pas? des biographes qui prétendaient que Monsieur Berlioz n'avait cédé qu'à une vocation tardive et que, jusqu'à l'adolescence, il s'était occupé de tout autre chose que de musique; d'abord la lettre Ire de notre recueil (à Ignace Pleyel) prouve le contraire. Et puis, la vérité ressort d'elle-même: Hector ne fut ni un petit prodige, ni un esprit en retard. Souvent la nature se dépense en premiers efforts et s'épuise après; tel qui promettait de passer pour un génie a beaucoup de peine à devenir un homme médiocre dès qu'il est arrivé à l'âge de raison; tel autre, qui n'excitait l'attention de personne, fleurit et éclate tout à coup, comme un bourgeon printanier. Casimir Delavigne, pour ne citer que lui, était toujours mis au pain sec quand il étudiait le De Viris; cependant sa réputation d'auteur dramatique fut très-précoce, puisque à vingt-six ans, il était illustre dans le quartier de l'Odéon.
M. Louis Berlioz destinait son fils à la médecine; c'était un parti sage, les pères ayant l'habitude de vouloir que leurs héritiers directs continuent les traditions de la famille, le fils d'un général étant militaire (le plus souvent) et le fils d'un avocat, avocat. Seulement, les pères proposent et les garçons disposent; nous voyons des romans remplis de ces exemples-là, sans compter que la réalité se charge quelquefois de copier les romans. Pour le savant et honorable médecin de la Côte-Saint-André, les pots-pourris que son fils écrivait sur des thèmes italiens n'étaient qu'un passe-temps agréable, les romances composées sur des paroles de Florian (toujours en mode mineur) servaient de soupapes de sûreté à une imagination trop échauffée; pour Hector Berlioz, au contraire, c'étaient les seuls travaux qui le séduisissent, les seuls auxquels il s'intéressât. Vainement, le père étalait-il dans son cabinet l'énorme traité d'ostéologie de Munro, contenant des gravures de grandeur naturelle «où les diverses parties de la charpente humaine étaient reproduites très-fidèlement»; l'adolescent, dédaignant ces superbes os, s'amusait à feuilleter le traité d'harmonie de Rameau ou celui de Catel, qu'il était parvenu à se procurer:—«Apprends ton cours d'ostéologie, dit un jour le père, je te ferai venir de Lyon une flûte garnie de nouvelles clefs...» Ce fut la première et la dernière fois, je suppose, que le sévère Munro fit progresser quelqu'un dans l'art de jouer de la flûte.
Il commençait à être temps de pousser plus à fond les insuffisantes études médicales commencées au logis; Paris, Montpellier, Strasbourg, délivraient des diplômes de docteur; M. Louis Berlioz se décida à envoyer son fils à Paris. Celui-ci s'y rendit en compagnie d'un sien cousin, excellent musicien lui-même, mais candidat moins frivole aux grades de la Faculté; par la suite, M. A. Robert devint, en effet, l'un des praticiens les plus distingués de la capitale. Les deux jeunes gens assistèrent ensemble aux leçons d'Amussat, de Thénard, de Gay-Lussac, d'Andrieux; comme Andrieux parlait littérature, Hector s'attacha surtout à ce professeur et conçut le projet de lui demander un livret d'opéra. L'auteur des Étourdis avait alors soixante-quatre ans: «Cher monsieur, répondit-il, je ne vais plus au spectacle; il me conviendrait mal, à mon âge, de vouloir faire des vers d'amour, et, en fait de musique, je ne dois plus guère songer qu'à la messe de Requiem.» Andrieux, sa lettre écrite, prit le parti de la porter au domicile de son correspondant inconnu. Il monte plusieurs étages, s'arrête devant une petite porte, à travers les fentes de laquelle s'échappe un parfum d'oignons brûlés; il frappe; un jeune homme vient lui ouvrir, maigre, anguleux, les cheveux roux et ébouriffés; c'était Berlioz, en train de préparer une gibelotte pour son repas d'étudiant, et tenant à la main une casserole:
—Ah! monsieur Andrieux, quel honneur pour moi!... Vous me surprenez dans une occupation.... Si j'avais su!
—Allons donc, ne vous excusez pas. Votre gibelotte doit être excellente et je l'aurais bien partagée avec vous; mais mon estomac ne va plus. Continuez, mon ami, ne laissez pas brûler votre dîner parce que vous recevez chez vous un académicien qui a fait des fables.
Andrieux s'assoit; on commence à causer de bien des choses, de musique surtout. A cette époque, Berlioz était déjà un glückiste féroce et intolérant:
—Hé! hé! dit le vieux professeur en hochant la tête, j'aime Gluck, savez-vous? je l'aime à la folie.
—Vous aimez Gluck, monsieur? s'écria Hector en s'élançant vers son visiteur comme pour l'embrasser. Dans ce mouvement, il brandissait sa casserole aux dépens de ce qu'elle contenait.
—Oui, j'aime Gluck, reprit Andrieux, qui ne s'était pas aperçu du geste de son interlocuteur et qui, appuyé sur sa canne, poursuivait à demi-voix une conversation intérieure... J'aime bien Piccini aussi.
—Ah! dit Berlioz froidement, en reposant sa casserole[7].
L'admiration de Gluck était venue au futur symphoniste de fragments d'Orphée qu'il avait découverts dans la bibliothèque de son père, à la Côte-Saint-André. Peu à peu, il avait consacré ses petites économies à acheter des billets pour l'Opéra, où l'on jouait des ouvrages de Spontini, de Salieri, de Méhul, tous de l'école de Gluck. En fait d'amphithéâtre, il ne fréquentait plus guère que celui de l'Académie de musique, et le cousin Robert, ayant voulu l'emmener à l'hospice de la Pitié pour y disséquer des sujets, Berlioz se sauva par la fenêtre. Jour et nuit, on l'entendait fredonner: Descends dans le sein d'Amphitrite, ou: Jouissez au destin propice, ou quelque autre mélodie de ses compositeurs favoris. Je ne crois pas trop au coup de foudre, terrassant le sensible Hector et lui révélant une vocation jusque-là confuse; cet événement extraordinaire se serait passé à une représentation des Danaïdes de Salieri[8]. Ce sont là des exagérations à l'adresse de la postérité et qu'on finit peut-être soi-même par croire exactes à force de les répéter aux gens. La froide raison ne tarde pas à abattre cet échafaudage de mélodrame; car il n'est pas admissible qu'un penchant aussi inné que celui dont nous avons montré les germes se soit jamais démenti ni oublié. Les Danaïdes ont frappé une âme très-disposée à être frappée; telle est la seule hypothèse vraisemblable et cette supposition n'a rien de commun avec les aventures de Saul sur le chemin de Damas. Quand on a, dès l'âge le plus tendre, tracé des notes sur du papier réglé, organisé des orchestres de famille, cherché des mélodies sur des paroles de Florian, trouvé le thème principal qui servira au largo de la Symphonie fantastique, on n'attend pas les Danaïdes pour savoir qu'on est musicien jusque dans les dernières fibres de son cœur. Notre héros s'est donc calomnié en prétendant qu'à un moment donné, «il allait devenir un étudiant comme tant d'autres, destiné à ajouter une obscure unité au nombre désastreux des mauvais médecins». Allons donc! est-ce qu'une organisation comme la sienne pouvait s'ignorer ainsi? est-ce que Catel, Rameau et Orphée n'avaient pas laissé de traces dans cette mémoire volage? Une vocation qui s'égare n'est point une vocation; l'homme marqué pour telle ou telle entreprise marche à son but sans détourner les yeux, sans s'arrêter aux bagatelles de la route, sans se préoccuper de l'avenir, sans s'inquiéter des obstacles. Connaissant l'intensité de tendresse avec laquelle Berlioz a aimé son art, je ne veux point admettre les défaillances; et, s'il n'y a pas eu défaillances, il n'y a eu ni conversion, ni coup de foudre, ni rien qui y ressemblât.
Décidé à se faire compositeur de musique à ses risques et périls, Hector manda à son père la résolution qu'il venait de prendre et entra au Conservatoire dans la classe de Lesueur. Personne ne connaît Lesueur aujourd'hui. C'était pourtant, sous la Restauration et sous le premier Empire, un homme considérable, membre de l'Institut, correspondant d'un grand nombre d'académies, et les divers gouvernements qui s'étaient succédé en France l'avaient tous accablé de leurs faveurs. Après la représentation des Bardes, Napoléon lui avait donné une tabatière d'or; Louis XVIII et Charles X l'avaient conservé comme surintendant de la chapelle royale, où, tous les dimanches, il faisait exécuter des oratorios de sa façon. Ses doctrines, sa théorie de la basse fondamentale, ses idées sur les modulations étaient autant de dogmes devant lesquels ses élèves s'inclinaient avec foi. Il avait su, à vrai dire, inspirer à ces jeunes gens une affection profonde, tant par le respect que son talent leur imposait que par l'ardeur qu'il mettait à les aider de son influence et de ses relations. Eux, se glorifiaient de son enseignement; parmi les lettres que nous publions dans ce volume, quelques-unes portent, après la signature, cette mention: Élève de Lesueur, et cela fait l'effet d'un titre de noblesse, énoncé avec orgueil.
Dans sa jeunesse, Lesueur avait été un révolutionnaire, introduisant des orchestres à Notre-Dame et publiant des brochures sur la musique d'église dramatique et descriptive. Aussi, les novateurs ne lui déplaisaient-ils pas, et, comme déjà Berlioz, dans la conversation, s'insurgeait volontiers contre certaines traditions reçues, contre certains préjugés incompréhensibles, le vieux maître avait pris en affection cet élève instruit, paradoxal, éloquent et fougueux. Les dimanches, avant la messe, il le faisait venir aux Tuileries, prenait la peine de lui expliquer le plan, les intentions, le sujet de l'œuvre qu'on allait exécuter. Après la messe, le professeur et son jeune ami allaient errer sur les bords de la Seine ou sous les ombrages du jardin des Tuileries, et Lesueur, avec sa physionomie fine, écoutait en souriant les véhéments discours de son compagnon de promenade, réfutait les opinions un peu hasardées de celui-ci et lui racontait le passé, quand le présent avait fourni trop longuement matière aux discussions sur la religion ou la philosophie.
On ne s'occupait pas seulement de musique dans la classe de Lesueur, on s'y piquait aussi de poésie. Un des élèves, nommé Gérono, qui taquinait les Muses à ses moments perdus, avait tiré du drame de Saurin, Beverley, une scène pour voix de basse, dont il avait confié les paroles à Berlioz; nous ignorons quel était le librettiste d'un autre ouvrage sur le Passage de la mer Rouge, qui date de la même époque. Hector résolut de révéler au public ces premiers essais et songea à les produire dans une représentation à bénéfice au Théâtre-Français. Il fallait l'assentiment de Talma, le bénéficiaire. «L'idée de parler au grand tragédien, de voir Néron face à face» fit reculer Berlioz, qui n'était pas timide d'ordinaire. Ne pouvant réussir dans le profane, il se retira dans le sacré, écrivit une Messe qu'on faillit exécuter à Saint-Roch, puis qu'on exécuta tout à fait, grâce à la libéralité d'un riche amateur, qui paya les violons. Très-peu de journaux parlèrent de ce début, assez médiocre; le style de l'ouvrage était une mauvaise imitation de la manière de Lesueur, et l'auteur, plus consciencieux ou plus difficile que la plupart de ses confrères, brûla son manuscrit. Un seul morceau, le Resurrexit, fut préservé des flammes: encore le compositeur l'a-t-il plus tard condamné sans rémission. Nul n'a eu la main plus prompte que lui dans ces sortes d'auto-da-fé; il y a quelques années, on a vendu à l'hôtel Drouot l'unique exemplaire de l'opus 2 de Berlioz: la Danse des Ombres, ronde nocturne pour chant et piano. L'exemplaire était accompagné de la note ci-jointe: «Curiosité et rareté. Toute l'édition de l'œuvre 2 de Berlioz a été détruite par ses ordres[9].»
Il prit part au concours pour le prix de Rome et ne fut pas même jugé digne d'entrer en loge. Cet échec alarma les parents du Dauphiné, qui n'étaient pas bien sûrs que leur enfant prodigue fût destiné à briller dans la carrière musicale. Le père ordonna à son fils de revenir en province; Hector obéit, mais, de retour à la Côte, il tomba dans un état de tristesse horrible, ne parlant à personne, passant les journées à errer dans les bois et les nuits à gémir dans l'ombre. M. Louis Berlioz finit par se laisser émouvoir: «Je consens, dit-il à son fils, à te laisser étudier la musique à Paris, mais pour quelque temps seulement; et si, après de nouvelles épreuves, elles ne te sont pas favorables, tu me rendras bien la justice de déclarer que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et tu te décideras à prendre une autre voie. Tu sais ce que je pense des poëtes médiocres: les artistes médiocres dans tous les genres ne valent pas mieux; et ce serait pour moi un chagrin mortel, une humiliation profonde de te voir confondu dans la foule de ces hommes inutiles[10].»
Ici, nous évitons à dessein de transcrire une scène intime que les Mémoires rapportent tout au long; elle nous a paru chargée en couleur et inutile à recueillir pour en orner cette biographie..... Nous voici de nouveau, avec Berlioz, dans la capitale, pendant l'hiver de 1826. Il commença par louer une très-petite chambre, au cinquième, dans la Cité, au coin de la rue de Harlay et du quai des Orfévres, s'imposa un régime alimentaire plus rigoureux peut-être que celui des solitaires de la Thébaïde; mais ces économies ne suffirent pas à lui permettre de s'acquitter envers l'ami généreux, qui lui avait prêté naguère douze cents francs pour l'exécution de la messe à Saint-Roch. Comme la moitié de la somme était encore due, l'ami, M. de Pons, crut bien faire en réclamant cet argent à M. Berlioz père. Celui-ci, pour le coup, signifia à son fils qu'il n'eût plus à compter sur un budget mensuel:—Qu'importe! pensa le déshérité, je suis accoutumé à vivre de peu; et puis n'ai-je pas trouvé des leçons de solfège à un franc le cachet?
Cette maigre ressource lui suffisait. Il eut la bonne fortune de rencontrer un Côtois de ses amis, étudiant en pharmacie, Antoine Charbonnel, et, comme la misère est plus facile à supporter à deux, les jeunes gens s'associèrent. Ils s'établirent, rue de la Harpe, au quartier Latin. Ils n'y menaient pas une existence de nababs; on nous a communiqué le registre sur lequel ils inscrivaient leurs dépenses quotidiennes; c'est on ne peut plus instructif.
En septembre, premier mois de l'association, ils commencent par acheter les ustensiles nécessaires à leur petit ménage: deux fourneaux, un pot à boulli (sic), une écumoire, une soupière, huit assiettes à quatre sols, et deux verres à quarante centimes. Le registre va du 6 septembre 1826 au 22 mai de l'année suivante. Les poireaux, le vinaigre, la moutarde, le fromage, l'axonge, y jouent les rôles principaux. Certaines journées paraissent avoir été terribles, surtout vers les fins de mois. Le 29 septembre, par exemple, les deux étudiants ont vécu de quelques grappes de raisin; le 30, leur dépense s'est élevée à:
| «Pain... | 0 | fr. | 43 | c. | |
| Sel.... | 0 | fr. | 25 | c. | |
| Total... | 0 | fr. | 68 | c. | ». |
Le 1er janvier, jour où tout le monde est en fête, Charbonnel, qui avait sans doute des connaissances en ville, est allé dîner au dehors: Hector, sans parents, sans amis, est resté seul, devant les tisons éteints de son triste foyer. Il a grignoté une croûte de pain desséchée (40 centimes) en attendant la gloire et en se récitant des vers de Thomas Moore, auteur qu'il venait de découvrir et qui lui causait une impression profonde. La belle jeunesse, les espérances en l'avenir, l'ont consolé des rigueurs du présent; sa pensée s'est envolée vers les triomphes futurs et son front a frissonné sous les lèvres imaginaires d'une bonne fée qui lui promettait le génie et le succès. O songes délicieux! les plus doux, les plus enchanteurs, ne se font-ils pas dans ces mansardes d'artistes, traversées par la bise de l'hiver ou chauffées par la violente canicule de juillet? avoir devant soi un horizon infini et songer qu'on remplira de bruit, de lumière et d'ambition assouvie, tout cet espace! fouler aux pieds les ennemis, ou, mieux encore, se sentir la force et le dédain de leur pardonner! Toucher au but et être récompensé de tant d'efforts par les caresses d'une femme aimée!... N'est-ce pas là ce qui se rêve à chaque instant sous les lambris peu dorés d'un sixième étage et ce qu'emporte vers les nuages la fumée de la grande ville, aux approches du soir?
En mai 1827, la gêne des deux camarades semble avoir cessé; l'un deux, je crois que c'est Charbonnel, annonce sur son cahier de dépenses, qu'il va partir: pour où? Nous l'ignorons. Toujours est-il que celui-là se livre à de nombreux achats assez excentriques: une paire d'éperons, un ruban avec clef et anneau doré, une paire de bamboches; on sent le jeune homme qui veut briller et faire bonne figure en province; il porte son chapeau chez le chapelier et fait repasser ses rasoirs[11]. Franchement, l'année avait été rude. Dans un moment de désespoir, Berlioz, à bout de ressources, avait sollicité et obtenu une place de choriste sur les planches du théâtre des Nouveautés; cette profession bizarre ne l'empêchait pas de suivre les cours de Lesueur et de Reicha, mais elle l'humiliait assez pour qu'il se dérobât le plus possible aux yeux indiscrets pendant l'exercice de ses fonctions dramatiques. Charbonnel, très-fier, eût été humilié de vivre sous le même toit qu'un baladin; Charbonnel se fâchait quand son ami portait ostensiblement dans la rue les provisions nécessaires au déjeuner ou au souper du ménage. Si l'étudiant en pharmacie avait su qu'il cohabitait avec un choriste, c'eût été une rupture complète.
Cependant l'Institut, en 1828, mit au concours une cantate: Orphée déchiré par les bacchantes, et, cette fois, Hector ne fut pas honteusement repoussé. Le jury se contenta de déclarer inexécutable le morceau présenté par le candidat. Berlioz, outré de dépit, jura que sa cantate inexécutable serait exécutée et demanda la salle du Conservatoire pour y donner un concert. M. de la Rochefoucauld, de qui dépendait l'autorisation, avait une réputation d'homme pudique parce qu'il avait prescrit aux danseuses de l'Opéra d'allonger leurs jupes; mais c'était un protecteur éclairé de l'art et des artistes. L'autorisation fut accordée; Cherubini, directeur du Conservatoire, eut beau protester, M. de la Rochefoucauld donna des ordres formels.
Ce fonctionnaire avait-il, manquant à toutes les traditions administratives, deviné le talent du jeune compositeur? Il est permis de le croire, puisque, tant que M. de la Rochefoucauld resta au pouvoir, Berlioz ne cessa d'avoir recours à ce gracieux Mécène. L'année suivante, un ballet sur Faust ayant été reçu à l'Opéra, Hector s'adressait de nouveau à son protecteur habituel, le surintendant des théâtres, et se recommandait à lui en ces termes:
«Le jury de l'Académie de musique a reçu, il y a deux mois, un ballet de Faust. M. Bohain, qui en est l'auteur, désirant me fournir l'occasion de me produire sur la scène de l'Opéra, m'a confié la composition de la musique de son ouvrage, à condition que M. le surintendant voudrait bien m'agréer. Si M. le surintendant veut connaître mes titres, les voici: j'ai mis en musique la plus grande partie des poésies de Gœthe; j'ai la tête pleine de Faust et si la nature m'a doué de quelque imagination, il m'est impossible de rencontrer un sujet sur lequel cette imagination puisse s'exercer avec plus d'avantages...[12].»
Pour parler ainsi à un grand de la terre, il fallait avoir reçu des preuves antérieures de sa bienveillance.
Le concert dans la salle du Conservatoire n'eut point lieu sans accidents. Alexis Dupont, l'un des solistes, fut pris d'un enrouement subit, la veille du concert, un trio avec chœurs fut chanté sans chœurs, par la faute des choristes qui manquèrent leur entrée; quant à la cantate d'Orphée, qui figurait sur le programme, on se vit obligé de la supprimer, à cause des défaillances de l'orchestre. Nos virtuoses parisiens ont fait, sous le rapport de la science et du mécanisme, d'immenses progrès; ils riraient bien aujourd'hui des difficultés qui ont arrêté l'archet de leurs ancêtres. Bien entendu, le concert ne rapporta rien à celui qui l'avait organisé; mais M. Fétis, qui faisait autorité, dit, un soir, dans un salon, le dos tourné vers la cheminée et en se chauffant les jambes:—Voilà un début qui promet!...—Et cette parole de M. Fétis fut très-répétée.
Dès lors, on commença, dans le monde musical, à compter sur Berlioz; on le considéra comme un élève qui prenait des licences fatales, qui s'affranchissait du joug et qu'il faudrait ramener à la vertu; mais son prix de Rome, obtenu en 1830, au bruit du canon des barricades, n'étonna personne. Le prix, cette année-là, fut partagé entre deux concurrents; le second lauréat de l'Institut était Alexandre Montfort, auquel on doit un ballet pour Fanny Essler, la Chatte métamorphosée en femme, et trois ou quatre opéras comiques dont le meilleur, Polichinelle, n'est guère bon.
Le séjour de Berlioz à Rome ne le réconcilia point avec la musique italienne, qu'il détestait; à la villa Médicis, au café Gréco, il forma avec Liszt, Mendelssohn, une bande à part, connue sous le nom de Société de l'indifférence en matière universelle[13]. Mendelssohn, aussi excellent pianiste que grand compositeur, régalait d'harmonie les pensionnaires du gouvernement; ceux-ci l'arrachaient souvent à ses travaux et l'on flânait, de compagnie. On causait de Beethoven, de Schiller, de Gœthe, de Haydn, de Mozart; en sa qualité d'Allemand, Mendelssohn s'imaginait de bonne foi que le génie universel était concentré entre les rives de la Sprée et les montagnes du Tyrol: en dehors de l'Allemagne, point de salut. Jaloux comme un tigre, peu bienveillant avec ses confrères, il ne soupçonnait guère que le garçon nerveux et anguleux, au profil d'aigle, qui cheminait à côté de lui dans la rue du Corso, lui disputerait un jour les palmes de la gloire musicale, qu'il échangerait des présents avec lui, et qu'il lui donnerait l'accolade coram populo, avec plus ou moins de sincérité:—«Berlioz, écrivait-il, en 1831, est une vraie caricature, sans ombre de talent, cherchant à tâtons dans les ténèbres et se croyant le créateur d'un monde nouveau; j'ai parfois des envies de le dévorer...[14].» Doux enfant de la Germanie! C'est le même Mendelssohn qui, après un concert où Berlioz avait fait entendre des symphonies gigantesques, jouées par des masses d'exécutants, le félicitait d'avoir composé de si jolies petites romances[15].
Hector n'avait pas quitté Paris sans regret; il y laissait une personne dont il crut avoir à se plaindre et dont il voulut se venger. Nous voici vraiment en plein roman ténébreux. Ombre de Pixérécourt, pardonne!... Un beau matin, Berlioz quitte Rome, emportant un poignard et des pistolets: son projet était de s'introduire sous un déguisement chez la belle infidèle, de la tuer et de se suicider après: «J'avais à punir, nous dit-il, deux coupables et un innocent...» A Florence, une modiste lui vend un costume de soubrette; à Gênes, une seconde modiste lui refuse un second costume, le premier ayant été perdu en route; vers Porto-Maurizio, Savone, le voyageur commençait à revenir à des sentiments moins féroces et l'instinct de la conservation l'aiguillonnait un peu. On se rappelle que tout élève qui franchissait sans permission la frontière italienne était regardé comme déserteur et rayé de la liste des pensionnaires de l'Académie; cette considération n'était pas à dédaigner. Réflexion faite, Berlioz jugea prudent de s'arrêter sur la pente du crime; il avait continué de courir en poste le long des falaises de la Corniche et il se trouvait, non à Vintimille, comme il le dit dans ses Mémoires, mais à Diano Marina, petite ville de l'ancien duché de Gênes, aux environs d'Oneille. De là, il écrivit à M. Horace Vernet, directeur de l'Académie de France à Rome, une lettre dont nous ne possédons que des fragments.
«Diano Marina, 18 avril 1831.
«...Un crime odieux, un abus de confiance dont j'ai été pris pour victime, m'a fait délirer de rage depuis Florence jusqu'ici. Je volais en France pour tirer la plus juste et la plus terrible vengeance; à Gênes, un instant de vertige, la plus inconcevable faiblesse a brisé ma volonté, je me suis abandonné au désespoir d'un enfant; mais enfin j'en ai été quitte pour boire l'eau salée, être harponné comme un saumon, demeurer un quart d'heure étendu mort au soleil et avoir des vomissements violents pendant une heure; je ne sais qui m'a retiré ou m'a vu tomber par accident des remparts de la ville. Mais enfin je vis, je dois vivre pour deux sœurs, dont j'aurais causé la mort par la mienne, et vivre pour mon art[16]...»
Il résulte de cette lettre que le pauvre amoureux, volontairement ou non, se serait laissé choir du haut des remparts de Gênes dans la Méditerranée; les Mémoires sont muets sur cet accident. Ils se bornent à constater le repentir du fugitif, sa soudaine résolution de rebrousser chemin et enfin sa rentrée au bercail.
Rome, qui attire à elle tant de cœurs chrétiens et artistes, n'exerça qu'une influence médiocre sur son nouveau commensal. C'est que la musique y était négligée ou jetée dans une voie déplorable; les Italiens abusaient déjà des orchestres bruyants; ils raffolaient «des clarinettes cafardes, des trombones rugissants, des grosses caisses furibondes, des trompettes saltimbanques», ensemble instrumental désigné sous le nom de musique militaire. On chantait platement de plates cavatines dans les salons; les théâtres, avec leurs habitudes méridionales, donnaient des opéras taillés sur le même patron, chantés par des gens prudents, incapables de ressentir la moindre émotion en scène; Palestrina, dans les églises, n'existait plus qu'à l'état de souvenir. Pour une âme éprise des grandes émotions musicales, Rome, ce merveilleux musée des chefs-d'œuvre plastiques, représentait la solitude et le néant.
Il n'y avait donc pour un musicien qu'un parti à prendre; emporter en bandoulière un fusil de chasse, tirer de la poudre aux moineaux des Abruzzes, pincer les cordes d'une guitare, noter les mélodies populaires, saisies au vol, réciter l'Énéide sur le sommet des montagnes et maudire les cavatines, les cabalettes, les trilles, les fioritures, les prime donne assolute, les ténors aux longs cheveux, les librettistes à l'imagination glacée. Oh! comme il était doux de se séparer de tout cela, de s'endormir, en liberté, à l'ombre d'un rocher sauvage, de s'asseoir au foyer d'une hôtellerie, dans quelque pays perdu! Les auberges de la campagne romaine abondent en détails pittoresques; quand les contadini, ayant attaché leurs chevaux dans la cour de l'osteria, entrent, à la tombée de la nuit, dans la salle commune où se vident les fiasques, leurs splendides haillons, leurs longs chapeaux pointus, leurs barbes touffues et mal peignées, forment l'assemblage le moins rassurant qui se puisse imaginer. C'est bien au milieu de ces paysans (ou de ces bandits) qu'une intelligence en éveil et à l'affût de la couleur devait trouver la Sérénade et l'Orgie des brigands de la symphonie d'Harold.
Les excursions de Berlioz à Subiaco, à Alatri, au mont Cassin, à Arcinasso, ne le consolaient que médiocrement de l'incurable ennui qu'il éprouvait dans la Ville éternelle.
...Enfin, enfin, il lui fut permis de quitter cette Italie qu'il ne revit jamais et où, contrairement à tant d'autres, moins difficiles, il n'avait pu s'acclimater. Son ardeur de rentrer dans la lutte et de se conquérir une place en vue était vraiment furieuse. On s'occupa de ses faits et gestes à Paris, dès qu'il y fut; et, à ce propos, qu'on nous permette d'ouvrir une parenthèse. Nous croyons que la vie des grands hommes doit être murée ni plus ni moins que celle des simples particuliers; mais quand un amour comme l'amour de Berlioz pour miss Smithson a occupé les badauds et les journaux d'une ville d'un million d'âmes, cet épisode ne rentre plus dans l'ordre des galanteries ordinaires; il appartient à l'histoire. Nous nous en emparons.
Miss Smithson était venue à Paris avec une troupe de comédiens anglais, chargés de populariser Shakespeare de ce côté-ci du détroit. La tâche était ardue; les Français ne s'enthousiasment pas facilement pour ce qu'ils ne comprennent point et très-peu d'entre eux connaissaient la langue de Byron et d'Hudson Lowe. A la vérité, ce démon de Shakespeare est doué d'un tel génie communicatif que ses œuvres, même jouées en pantomime, établiraient entre lui et les spectateurs un courant de sympathie électrique. Les étudiants de la rive gauche firent fête à Roméo, à Hamlet, qu'ils connaissaient par les adaptations du bon Ducis; miss Smithson fut engagée à l'Opéra-Comique pour y jouer un rôle muet dans l'Auberge d'Auray, de Carafa et d'Hérold. Elle s'était auparavant distinguée à Londres, à côté de Kean; le vieux Kemble l'avait encouragée à persévérer et elle avait déployé les qualités les plus touchantes, les plus pathétiques, dans les rôles d'Ophélie, de lady Macbeth, de Desdémone, de Virginie, de Cordélia. Sa timidité était extrême; aussi quand on lui annonça qu'un jeune musicien, déjà connu, s'était épris d'elle à une représentation de l'Odéon, quand on lui dit que ce romantique artiste ne rêvait plus qu'à elle, avait juré de ne plus composer que pour elle, miss Smithson refusa de croire à une aussi tenace passion. Un rédacteur du Galignani's Messenger, M. Schutter, persuada à la charmante actrice d'assister à un concert où l'auteur de la Symphonie fantastique faisait entendre ce bel ouvrage; en écoutant la phrase de l'adagio, cette phrase qui reparaît dans la Scène aux champs, dans la Marche au supplice, dans les fêtes orgiaques de la Nuit du Sabbat, Harriett Smithson comprit qu'elle était aimée. Elle consentit à recevoir son adorateur, elle lui permit d'espérer; mais une union projetée dans des conditions aussi étranges ne se noue pas sans des alternatives de beau temps et de tempêtes, d'espoir et de désespoir. Il faut sans doute rapporter à quelque péripétie orageuse le billet qu'on va lire:
A MADEMOISELLE HENRIETTE SMITHSON.
Rue de Rivoli, Hôtel du Congrès.
«Si vous ne voulez pas ma mort, au nom de la pitié (je n'ose dire de l'amour), faites-moi savoir quand je pourrai vous voir.
«Je vous demande grâce, pardon, à genoux, avec sanglots!!!
«Oh! malheureux que je suis, je n'ai pas cru mériter tout ce que je souffre, mais je bénis les coups qui viennent de votre main.
«J'attends votre réponse comme l'arrêt de mon juge[17].
«H. Berlioz.»
Agité par ces fiévreuses secousses, Berlioz s'échappait dans la campagne pour oublier les tourments qui le consumaient; Liszt et Chopin le suivirent, toute une nuit, à travers la plaine Saint-Ouen. Dans une de ces pérégrinations, un soir, avant son départ pour l'Italie, il s'était endormi sur l'herbe gelée, scintillante de perles, en face de l'île de la Grande Jatte et du parc de Neuilly. Une autre fois les garçons du café Cardinal n'osaient le réveiller, pendant qu'il sommeillait, épuisé, le front sur une table de marbre. Pendant une semaine entière, on crut à son suicide; il n'avait pas donné signe de vie, avait disparu de son domicile et on ignorait où il était allé. La mère et la sœur de miss Harriett faisaient, comme on pense bien, une opposition formidable aux projets des deux amants; la famille de la Côte-Saint-André ne voulait pas davantage de ce mariage. Pour comble d'infortune, la malheureuse Ophélie se ruina et se cassa la jambe en descendant d'un cabriolet. Quoique les ressources pécuniaires d'Hector fussent des plus minces à ce moment-là, il ne balança plus à accomplir son dessein. Si mademoiselle Smithson était restée riche et célèbre, il aurait peut-être renoncé à ses projets; pauvre et malade, il n'hésita plus: il l'épousa.
Ces premières années de mariage furent tout à la fois pénibles et charmantes. Le nouveau ménage, dont le budget, pour commencer, s'élevait à trois cents francs de capital[18], se fixa dans les quartiers les plus divers, tantôt rue Neuve-Saint-Marc, tantôt à Montmartre, dans une rue Saint-Denis dont il nous a été impossible de retrouver la trace. Liszt demeurait rue de Provence et rendait souvent visite aux jeunes époux; on passait ensemble des soirées, pendant lesquelles l'admirable pianiste exécutait des sonates de Beethoven dans l'obscurité, afin que l'impression produite fut plus forte. Aussi, comme Berlioz défendait son ami dans les journaux où il avait l'habitude d'écrire,—dans le Correspondant, la Revue européenne, le Courrier d'Europe, et enfin les Débats; comme il se fâchait quand les Parisiens volages essayaient d'opposer Thalberg à son rival; une lionne montrant les dents n'est pas plus redoutable! Gare à qui s'avisait de dire que Liszt n'était pas le premier pianiste des temps passés, présents et futurs! Et ce qu'il donnait comme un axiome musical indiscutable, le critique le pensait; car il n'aurait jamais pu trahir ses convictions et il affectait vis-à-vis des médiocrités un dédain voisin de l'impolitesse. Liszt, au surplus, lui rendait procédés pour procédés, transcrivant la Symphonie fantastique, jouant dans les nombreux concerts que le jeune maître donnait, l'hiver, avec un succès toujours croissant. Ici, rappelons quelques dates pour l'agrément des archéologues: la première audition de Sarah la Baigneuse et de la Belle Irlandaise eut lieu le 6 novembre 1834, au Conservatoire; Harold fut donné au second concert de cette série: «On s'aborde partout en s'entretenant de la Marche des Pèlerins», disaient les feuilles du temps; la mélodie du Cinq Mai et celle du Pâtre breton furent entendues pour la première fois le dimanche 22 novembre 1835. Berlioz et Girard, «l'excellent chef d'orchestre du Théâtre Nautique», plus tard, chef d'orchestre à l'Opéra, s'étaient associés; mais, Girard ayant été insuffisant dans l'exécution de certains morceaux, l'union se rompit et Berlioz s'en alla tout seul aux Menus-Plaisirs; car il changeait de salle de concerts aussi souvent que d'appartements privés, voyageant du Vaux-Hall à la rue Vivienne et du Garde-Meuble de la rue Bergère au Gymnase musical, situé sur le boulevard Bonne-Nouvelle[19]. Le bruit, commençait à se faire autour de son nom; si l'argent lui manquait parfois, les ennemis déjà ne lui manquaient pas. M. Fétis jeune l'attaquait dans je ne sais quelle feuille de chou; Arnal le parodiait au bal de l'Opéra, pendant que les masques dansaient des quadrilles, que les débardeurs faisaient vis-à-vis aux pierrettes, que la folie agitait ses grelots (style d'alors), et que Musard soufflait dans ses cornets à pistons: «Oui, messieurs, s'écriait Arnal, je vais faire exécuter devant vous une symphonie pittoresque et imitative, intitulée Épisode de la vie d'un joueur. Je n'ai besoin pour faire comprendre mes pensées dramatiques, ni de paroles, ni de chanteurs, ni d'acteurs, ni de costumes, ni de décorations. Tout cela, messieurs, est dans mon orchestre; vous y verrez agir mon personnage, vous l'entendrez parler, je vous le dépeindrai des pieds à la tête; à la seconde reprise du premier allegro, je veux vous apprendre même comment il met sa cravate. O merveille de la musique instrumentale! Mais je vous en ferai voir bien d'autres dans ma seconde Symphonie sur le code civil. Quelle différence, messieurs, d'une musique comme celle-là, qui se passe de mille accessoires inutiles au vrai génie et n'a besoin pour se faire comprendre que de... trois cents musiciens! Quelle différence, dis-je, avec les ponts neufs de Rossini! Oh! Rossini! ne me parlez pas de Rossini! un intrigant qui s'avise de faire exécuter sa musique dans les quatre parties du monde pour se faire une réputation!... Charlatan!... Un homme qui écrit des choses que comprendra le premier venu! Tenez, c'est abominable; et pour moi, la musique de Rossini est une chose ridicule; elle ne me fait aucun effet, mais aucune espèce d'effet, voilà l'effet qu'elle me fait[20].»
Dans la Caricature, un journaliste anonyme publiait un article intitulé: le Musicien incompris: «Le musicien incompris méprise profondément ce qu'on nomme vulgairement le public; mais en compensation il n'a qu'une médiocre estime pour les artistes contemporains. Si vous lui nommez Meyerbeer:—Hum! hum! il a quelque talent, je ne dis pas, mais il sacrifie à la mode.—Et M. Auber?—Compositeur de quadrilles et de chansons.—Bellini, Donizetti?—Italiens, Italiens, musiciens faciles, trop faciles.—Par exemple, s'il traite très-cavalièrement le présent, il a une grande vénération pour tout ce qui date d'un siècle; et quand vous lui parlez d'un opéra nouveau, d'un succès, il vous répond d'une voix attendrie: Ah! que diriez-vous, si vous connaissiez le fameux Jacques Lenglumé (un incompris de la jeunesse de Louis XIV); quelle musique! quel musicien!... Notre grand homme va chercher la solitude au huitième au-dessus de l'entresol; là, après s'être parfumé d'une grande quantité de cigares, après avoir tourné trois fois sur lui-même, il se livre tout entier au feu qui le dévore. Il saisit sa guitare (le piano généralement tapoté lui semblant fort mesquin) et tombe, le poil hérissé, sur un sofa où il compose, compose jusqu'à extinction de chaleur naturelle. Il court surtout après la haute philosophie musicale; pour lui la romance est un mythe qui doit exprimer une des faces les plus superficociquenqueuses de la vie humaine... Une fois lancé, rien ne l'arrête; il invente des accords inouïs, des rythmes inconnus, des mélodies inaccessibles. Grâce à cet agréable procédé et à cet exercice violent, le compositeur échevelé arrive à produire une partition qui peut lutter avec les charivaris les mieux organisés et il obtient toujours le succès... non, la chute demandée[21].»
L'allusion est on ne peut plus claire.
Tout en se défendant du bec et de l'ongle dans les journaux, l'auteur de la Symphonie fantastique prouvait son talent de la même façon que le philosophe grec prouvait le mouvement en se mettant à marcher; il travaillait jour et nuit, il couvrait de croches et de doubles croches des liasses énormes de papier réglé. Paganini, qui devait lui faire, quatre ans après, un cadeau royal, lui commandait un morceau sur les Derniers instants de Marie Stuart[22]; ce projet n'eut pas de suite ou fut transformé en un autre projet. Comme dans Harold en Italie, il y avait une partie d'alto principal que Paganini se chargeait de jouer et dont il voulait essayer l'effet sur le public anglais, un jour, à un concert de la rue Vivienne, Berlioz se trouva en face d'un géant aux ongles crochus, à la mine livide, à la chevelure tombant sur les épaules; ce géant l'embrassa en lui disant:—Tu Marcellus eris! Tu seras Beethoven!—C'était Paganini.
Comme nous le rappelions plus haut, les bienfaits du grand artiste ne s'arrêtèrent pas à cette démonstration théâtrale. Un dimanche, le 16 décembre 1838, Berlioz, riche de gloire, mais pauvre dans le vrai sens du mot (il avait dû payer les dettes de sa femme, qui s'élevaient à un chiffre assez respectable), donnait au Conservatoire une séance musicale dont nous transcrivons le programme exact: 1º Symphonie d'Harold. 2º Grand air de Marie Stuart, d'Alari, chanté par Madame Laty. 3º Le Pâtre breton, chanté par Madame Stoltz. 4º Cantando un di, de Bari, chanté par M. Boulanger et Mademoiselle Bodin. 5º Solo de violoncelle par M. Batta. 6º Scène de l'Alceste de Gluck, par M. Alizard et Madame Stoltz. 7º La Symphonie fantastique.
Paganini assistait au concert; deux jours après, il écrivit à son protégé le billet suivant[23]:
«Mon cher ami, Beethoven mort, il n'y avait que Berlioz qui put le faire revivre; et moi qui ai goûté vos divines compositions dignes d'un génie tel que vous, je crois de mon devoir de vous prier de vouloir bien accepter, comme un hommage de ma part, vingt mille francs qui vous seront remis sur la présentation de l'incluse. Croyez-moi toujours votre affectionné.»Nicolo Paganini.»
Voici la réponse de Berlioz:
«O digne et grand artiste,
»Comment vous exprimer ma reconnaissance!!! Je ne suis pas riche, mais, croyez-moi, le suffrage d'un homme de génie tel que vous me touche mille fois de plus que la générosité royale de votre présent.
»Les paroles me manquent, je courrai vous embrasser dès que je pourrai quitter mon lit, où je suis encore retenu aujourd'hui.»H. Berlioz.»
Jules Janin, un ami de la première et de la dernière heure, écrivit de son côté la lettre qu'on va lire[24]:
«Cher Berlioz,
»Il faut absolument que je vous dise tout mon bonheur en lisant ce matin cette belle et bonne lettre de change et de gloire que vous recevez de l'illustre Paganini. Je ne vous parle pas, je ne parle pas seulement de cette fortune qu'il vous donne, trois années de loisir, le temps de faire des chefs-d'œuvre, je parle de ce grand nom de Beethoven par lequel il vous salue. Et quel plus noble démenti à donner aux petits-maîtres et aux petites-maîtresses qui n'ont pas voulu reconnaître votre Cellini comme le frère de Fidelio! Donc, que Paganini soit loué comme le méritent ses belles actions, et qu'il soit désormais inviolable; il a été grand et généreux pour vous, plus généreux que pas un roi, pas un ministre, pas même un artiste de l'Europe, les véritables rois du monde. Il vous a appuyé de son approbation et de sa fortune; c'est maintenant plus que jamais qu'il faut louer ce grand musicien qui vous tend la main.
»Cher Berlioz, je vous embrasse bien tendrement, dans toute la joie de mon cœur.
»Jules Jamin.
»20 décembre, 1838.»
Paganini n'avait pas affaire à un ingrat.
D'abord, Berlioz lui dédia sa symphonie de Roméo et Juliette; puis, il traduisit l'ode italienne que le poëte Romani avait écrite en l'honneur du roi des violonistes, après un concert donné par ce dernier au théâtre Carignano, à Turin. L'ode de Romani est peu connue, la traduction en est oubliée tout à fait; ce poétique morceau méritait un meilleur sort. On en jugera par les strophes suivantes:
«Oh! qui me rendra un seul des sons fugitifs que verse ton archet comme un torrent de splendeurs éthérées? Peut-être, ô souffles des airs, de ces lieux où ils se perdraient épars, les reportez-vous au ciel conservateur de toute mélodie? Oh! dans quel astre d'amour les déposez-vous afin de rendre et plus douces et plus joyeuses les évolutions de sa sphère radieuse? Oh! laissez-moi me désaltérer dans cette source pure d'immortelle harmonie? que je m'y plonge et que j'y nage avec ivresse comme l'alcyon au sein des mers, comme le cygne au sein des lacs!
»Vains désirs! l'homme ne se délivre point du poids qui l'attache à la terre; l'aile rapide du son ne saurait être liée... Que le souvenir nous charme encore, puisqu'il est tout ce que nous pouvons conserver. Lui, du moins, sera impérissable, ô Paganini! et les symphonies divines échappées de tes cordes émues retentiront dans nos cœurs et dans notre mémoire comme un bien qui n'est plus, mais que l'on sent toujours!...
»Les nations qui sont par delà les Alpes et par delà les mers s'étonnaient, et la mère des chants, l'Italie elle-même, au bruit de ces mélodies inouïes, s'étonnait, comme firent les Thraces, quand, guidés par la lyre divine, faveur d'une déesse, ils serrèrent entre eux les premiers nœuds fraternels. Oui, tous étaient frappés d'étonnement, car des mains habiles et célestes avaient posé si loin les bornes de l'art, qu'il ne semblait plus possible de les reculer. Tous admiraient la puissance créatrice et souveraine donnée à un archet, et quand ils voulurent comparer, toutes les cordes qui, jusque-là, avaient vibré devant eux, leur parurent sourdes et inertes....
»Tout ce que la terre et le ciel et les flots ont de voix, tout ce que la douleur, la joie et la colère ont d'accents, tout est là dans le sein de ce bois creux; c'est la harpe qui frémit et mêle ses soupirs aux nocturnes soupirs de la lyre d'Éolie, aux plaintes du vent parmi les branches et les feuilles; c'est le pâtre entonnant sa chanson rustique en rassemblant son troupeau; c'est le ménestrel invitant à la danse; c'est la vierge se plaignant de ses peines à la lune silencieuse; c'est le cri d'angoisse d'un cœur séparé du cœur qu'il aime; c'est le badinage, c'est le charme, c'est la vie, c'est le baiser....
»Sur cette corde sont d'autres notes.... que peut seul connaître le génie audacieux qui la tend et la modère; mais l'Italie un jour avec transport les entendra...»
Nous avons emprunté ce morceau à un recueil, la Gazette musicale, qui fut, pour ainsi dire, le journal officiel de Berlioz, pendant vingt ans.
La Gazette musicale, fondée en 1834 par l'éditeur Schlesinger et continuée depuis par les frères Brandus, venait à un moment propice; cette année était une année féconde pour l'art. Victor Hugo publiait Claude Gueux dans la Revue de Paris, Alfred de Musset jetait au vent les pages légères de Fantasio, Halévy donnait à l'Opéra-Comique les Souvenirs de Lafleur et surveillait à l'Opéra les répétitions de la Juive, Ingres peignait les portraits de M. Bertin et du comte Molé, Jules Janin passionnait Paris avec ses feuilletons étincelants, un journal littéraire, le Protée, paraissait sous les auspices de Louis Desnoyers et de Léon Gozlan, que les compositeurs d'imprimerie ne connaissaient pas bien encore; car ils écrivaient ainsi son nom: Gorian ou Gozean. La Gazette musicale obtint tout de suite un vif succès, mêlé de scandale. Le gérant de la Gazette, M. Schlesinger, fut attaqué dans une salle de concert par un élève de M. Herz, nommé Billard, et un duel s'ensuivit; M. Billard fut atteint au bas ventre; heureusement que la balle, amortie, ne produisit qu'une violente contusion.
Les articles de Berlioz dans la Gazette musicale sont nombreux; nous signalerons spécialement le compte rendu de la première représentation de l'opéra des Huguenots, qui devait s'appeler primitivement la Saint-Barthélemy, et dont le rôle de basse, illustré par Levasseur, devait être confié à Serda. Pendant les répétitions, on ne croyait guère au succès de l'ouvrage; le chef d'orchestre s'arrêtait souvent pour dire à Meyerbeer:—Ce passage-là n'a pas le sens commun.—Eh bien! répliquait Meyerbeer de sa voix flûtée et avec un léger accent gascon, si ma musique n'a pas le sens commun, c'est qu'elle en a un autre[25].
En fait de critique, on a généreusement prêté à Berlioz les opinions les plus saugrenues; il aimait les Huguenots, il aimait Guillaume Tell; il n'a jamais écrit sur le Pré aux Clercs le fameux article qu'on lui a tant reproché. En veut-on la preuve? Qu'on se donne la peine d'ouvrir le Journal des Débats du 15 mars 1869, Jules Janin s'y avoue coupable du méfait dont un innocent, pendant un quart de siècle, a été victime:
«Certains critiques ont reproché à Berlioz d'avoir mal parlé d'Hérold et du Pré aux Clercs. Ce n'est pas Berlioz, c'est un autre, un jeune homme ignorant et qui ne doutait de rien en ce temps-là, qui, dans un feuilleton misérable, a maltraité le chef-d'œuvre d'Hérold. Il s'en repentira toute sa vie. Or cet ignorant s'appelait (j'en ai honte!) il faut bien en convenir... Monsieur, Jules Janin.»
Malgré cette déclaration formelle, on trouvera encore des obstinés qui parleront avec horreur du feuilleton sur le Pré aux Clercs.
Mais Berlioz n'aimait pas Mozart?
Il ne l'aimait pas?... Nous allons citer ses propres paroles au sujet d'Idoménée: «Mozart... Raphael!... Quel miracle de beauté qu'une telle musique! comme c'est pur! quel parfum d'antiquité! C'est grec, c'est incontestablement grec, comme l'Iphigénie de Gluck, et la ressemblance du style de ces deux maîtres est telle dans ces deux ouvrages qu'il est vraiment impossible de retrouver le trait individuel qui pourrait les faire distinguer[26]...» En fouillant dans la collection du Journal des Débats, nous rencontrerions bien d'autres témoignages de la fausseté des sentiments attribués au réformateur musical que M. Ingres et bien d'autres considéraient comme un monstre: immanissimum et foedissimum monstrum. Une fois pour toutes, établissons que Berlioz ne prétendait nullement au rôle que certains compositeurs ont tenu depuis. Il ne se vantait pas d'être le seul de son espèce et ne croyait point qu'avant lui, la musique fût une science ignorée, ténébreuse, inculte; loin de renier les anciens, il se prosternait avec vénération devant les dieux de la symphonie, il brûlait devant leurs autels l'encens le plus pur. Son unique prétention (et elle nous paraît justifiée) était de continuer la tradition musicale en l'agrandissant, en l'améliorant, grâce aux ressources modernes: «J'ai pris la musique où Beethoven l'a laissée», disait-il avec quelque orgueil à M. Fétis.—Il y avait du vrai dans cette assertion.
Dès 1835, les journaux annoncèrent que Berlioz s'occupait d'écrire un opéra sur un livret d'Alfred de Vigny; il s'agissait de Benvenuto sans doute, qui ne parut sur la scène que trois ans plus tard. En France, tout compositeur qui n'aborde pas le théâtre est condamné à l'obscurité; Berlioz se rendait bien compte de cet axiome et cherchait à se produire dans la musique dramatique. Un instant, il obtint le poste de directeur des Italiens[27]; mais la presse opposante cria au favoritisme et répandit le bruit que M. Bertin, des Débats, avait fait obtenir à son feuilletoniste le sceptre directorial, pour que mademoiselle Louise Bertin, qui composait, elle aussi, fît jouer, salle Ventadour, les ouvrages qu'on lui refusait ailleurs. Devant cette malveillance caractérisée, Berlioz se retira; il n'avait pas trop à se plaindre du Gouvernement qui lui commandait tantôt un Requiem, tantôt une Marche funèbre et triomphale, toutes les fois qu'il était question de célébrer les victimes de Juillet.
Le Requiem fut exécuté dans diverses villes de France, notamment à Lille, d'où Habeneck envoya à l'auteur une lettre de félicitation[28]. Mais ce n'étaient là que des succès relatifs. La grosse partie allait se jouer à l'Opéra, où les études de Benvenuto Cellini étaient poussées avec activité. Le soir de la première représentation, une horrible cabale fut organisée contre la pièce; le parterre siffla, grogna, hurla; les ennemis de la famille Bertin imitèrent les cris des animaux les plus divers pour faire payer à l'infortuné musicien l'honneur qu'il avait d'écrire dans une feuille ministérielle. Où la politique va-t-elle se nicher! Duprez, habituellement si applaudi, ne réussit pas à conjurer l'orage; madame Stoltz et madame Dorus-Gras eurent beau être charmantes, on leur tint rigueur; les musiciens de l'orchestre s'associèrent au ressentiment du public. Deux d'entre eux, pendant les répétitions, avaient été surpris jouant l'air J'ai du bon tabac, au lieu de jouer leur partie.
Vaincu dans cette bataille inégale, l'auteur de Benvenuto ne se découragea point; il avait la foi qui transporte les montagnes. Dès 1842, il commença par la Belgique la série de ces voyages à l'étranger qui furent pour lui la compensation et la revanche des insuccès parisiens. Si la France résistait au génie de Berlioz, l'Allemagne, la Russie, la Suisse, le Danemark pressentaient chez ce lutteur incompris une force bizarre et peut-être nouvelle: ainsi Cologne écoutait attentivement l'ouverture des Francs Juges, Mayence et Leipzig ne tardaient pas à acclamer le même morceau. Romberg, premier violon du Théâtre-Allemand à Saint-Pétersbourg, réussissait à faire entendre le Dies Iræ du Requiem et envoyait à l'éditeur Schlesinger un compte rendu enthousiaste; Hambourg, de son côté, se prononçait pour le maître; la contagion gagnait la ville de Copenhague, qui accourait au concert de M. et de madame Mortier Fontaine pour applaudir à l'ouverture de Waverley; Winterthur, dans le canton de Zurich, imitait Cologne, Copenhague et Hambourg. Cependant Winterthur est une ville si peu considérable, que nous avons eu quelque peine à la découvrir sur la carte.
Les siffleurs de Benvenuto, en apprenant ces nouvelles du dehors, commencèrent à réfléchir; si, par hasard, ils s'étaient trompés!... Il y eut une espèce de revirement dans le public et l'on vit, un jour, des conscrits entonner, dans la rue, le motif de la Marche funèbre et triomphale en se promenant du Palais-Royal aux Italiens et à l'Opéra. Le cortège se composait d'une centaine de jeunes gens précédés de vivandières, de sapeurs, de tambours-majors et de porte-drapeaux[29].
«A Bruxelles, nous dit le compositeur dans ses Mémoires, les opinions sur ma musique furent presque aussi divergentes qu'à Paris.» C'est là que nous nous trouvons pour la première fois en présence de mademoiselle Récio, que Berlioz devait épouser à la mort d'Henriette Smithson; mademoiselle Récio chanta dans les concerts de son futur mari; nous ignorons avec quel succès. Le voyage en Allemagne fut beaucoup plus décisif pour la gloire du musicien que l'excursion en Belgique; depuis longtemps, Berlioz était attendu de l'autre côté du Rhin. Nous osons à peine révéler la vérité, car elle est triste à dire; triste pour nous, Français, et pour notre goût artistique. Pendant que nous marchandions à notre compatriote de maigres applaudissements, la capitale de la Prusse le traitait en triomphateur; on lui accordait le théâtre royal et les premiers artistes de la ville, le roi accourait de Potsdam à franc étrier, se mêlait à l'enthousiasme de ses sujets (malgré l'étiquette), demandait pour ses bandes militaires la Fête chez Capulet[30]. Bien mieux: le maître de la chapelle ducale de Brunswick, M. Georges Muller, venait, après l'audition de Roméo et Juliette, déposer une couronne sur la partition[31]. Mendelssohn enfin, qui dédaignait tant son camarade de Rome, échangeait avec lui son bâton de chef d'orchestre, à propos du Sabbat de la Symphonie fantastique, exécuté presque en même temps que la Première Nuit du Sabbat, à Leipzig. Le compositeur parisien remercia par une lettre le compositeur allemand; nous avons eu la chance inespérée de retrouver le texte du billet:
Leipzig, 2 février 1843.
Au chef Mendelssohn.
«Grand chef, nous nous sommes promis d'échanger nos tomawacks! Voici le mien, il est grossier, le tien est simple!
»Les Squaws seules et les Visages-Pâles aiment les armes ornées. Sois mon frère, et, quand le Grand-Esprit nous aura envoyés chasser dans le pays des âmes, que nos guerriers suspendent nos tomawacks amis à la porte du conseil[32].»
Nous n'insisterons pas. Il nous est douloureux de constater que la justice et le sentiment du beau se sont rencontrés ailleurs que chez nous et, qui pis est, chez nos plus implacables adversaires. Au moment où l'Allemagne tressaillait aux accents des mâles symphonies du maître, nous raffolions, nous, d'opéra-comique; nous essayions d'implanter ce genre absurde dans les cinq parties du monde et une troupe de chanteurs se préparait à s'embarquer dans le port de Brest. La troupe était au complet; elle avait une prima donna, une dugazon, un ténor, des barytons, un régisseur. Quant à sa destination, on ne la devinerait jamais. Ces messieurs et ces dames allaient faire connaître les beautés du Domino noir, de Zampa, et de Fra Diavolo aux sauvages des îles Marquises[33]!!!!!
En juin 1843, Berlioz revint à Paris pour s'occuper d'un opéra, la Nonne sanglante, qu'il n'acheva jamais. Il trouva chez lui, en rentrant, un ordre de l'empereur de Russie, lui enjoignant d'arranger des plains-chants grecs à seize parties, en quadruple chœur. Vers la même époque, il fut nommé membre de l'Académie romaine de Sainte-Cécile, puis il reprit ses concerts. Concert à la salle Herz (3 février 1844) et première audition de l'ouverture du Carnaval romain; concert spirituel à l'Opéra-Comique, le samedi saint, 6 avril; concert aux Italiens, où il s'emporte contre deux dames qui causaient dans une loge tandis qu'on exécutait la Marche des Pèlerins[34]; enfin concerts au palais de l'Industrie et au Cirque des Champs-Élysées (janvier 1845). Là, fut joué un morceau dont nous avons complétement perdu la trace: l'ouverture de la Tour de Nice, écrite par l'auteur, pendant un séjour de quelques semaines dans un vieux donjon, sur le bord de la mer. Le morceau était, paraît-il, tout à fait bizarre, entrecoupé de sifflements, de hurlements, de cris de chouettes, de bruits de chaînes. Il ne plut guère à l'auditoire et l'auteur fut sans doute du même avis que ses juges, puisqu'il remplaça sur l'affiche l'ouverture de la Tour de Nice par le Désert de Félicien David, artiste charmant, frais éclos, et qui n'en était plus à faire jouer, sous la direction de Valentino, des nonetti pour instruments à piston[35].
Après l'Allemagne du Nord, Berlioz visita l'Autriche. «Nos dames, écrivait un Viennois, portent des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles à la Berlioz, c'est-à-dire avec son portrait[36].» Les peintres recherchaient l'honneur de reproduire ses traits et il n'accorda cette faveur qu'à un M. Kriuber qui exposa, au foyer de l'Opéra, l'image du musicien à la mode, entourée de lauriers. «C'était bien la peine, disait un vieux professeur, de travailler cinquante ans à notre édifice musical; en deux heures, ce diable de Français a tout renversé.» Drôles de mœurs! Pendant que Berlioz dirigeait ses concerts, un poëte hongrois lui jeta des vers pour l'engager à venir à Pesth. Il prit la route opposée; il s'en fut à Prague, où le directeur du Conservatoire, M. Kittl, lui amena tous ses élèves pour que ceux-ci assistassent aux répétitions. Au moment de son départ de l'Autriche, Berlioz entendit un critique de Breslau prononcer cette parole: «Eh bien, il nous laisse de sa chaleur, au moins pour un an!»
S'il laissait de sa chaleur aux autres, il allait se refroidir, lui, en passant à Paris par la plus douloureuse épreuve qu'il eût subie jusqu'alors: l'épouvantable fiasco de la Damnation de Faust à l'Opéra-Comique (6 décembre 1846). Les deux ou trois cents personnes qui assistèrent à l'exécution de cette légende dramatique furent ravies, transportées; malheureusement elles n'étaient que deux ou trois cents. Le Paris de la fin du règne de Louis-Philippe s'intéressait beaucoup plus à la politique qu'aux choses de l'intelligence, les badauds s'occupaient des mariages espagnols; deux fabricants de cachemires, M. Cuthbert et M. Biétry, s'adressaient dans le Constitutionnel des correspondances qui passionnaient l'Europe. Au lieu de répondre à l'appel du symphoniste, la noblesse du faubourg Saint-Germain resta chez elle, la haute finance se garda bien de manquer l'heure de la Bourse,—car le concert avait lieu en plein jour,—les artistes firent la sourde oreille, les boutiquiers continuèrent à préférer la Dame blanche; ce fut une déroute auprès de laquelle celle de la Bérésina aurait passé pour une retraite en bon ordre.
Par un assez étrange hasard, le sujet de Faust, si profondément tudesque et septentrional, doit à nos compositeurs nationaux une grande partie de sa popularité. Je me garderai bien de louer la Damnation au détriment de l'opéra, plus moderne, de M. Charles Gounod; les deux œuvres ont des tendances diverses et se complètent l'une par l'autre. La scène du jardin: voilà le tendre et incomparable éclat qui illumine le Faust de M. Gounod. Mais, à propos d'illumination, je me rappelle qu'un soir, à l'Opéra, mes yeux ne pouvaient se détacher du petit appareil de lumière électrique qui, placé dans les combles du théâtre, versait des feux artificiels sur le jardin de Marguerite. J'avais beau me dire: «Me voilà loin de Paris, dans une vieille cité aux enseignes grimaçantes, sous les arbres, près des fleurs; l'orchestre prend le soin de traduire en sons merveilleux les sentiments que ma pauvre petite éloquence serait incapable d'exprimer...»—Peine perdue! la machine électrique de là haut m'ôtait toute illusion; elle me rappelait à la prosaïque réalité, elle me chuchotait dans son langage de machine: «Ne sois pas dupe de ces gens qui s'agitent là sur les planches et qui s'abîment la voix pour gagner de quoi acheter plus tard une maison de campagne où ils iront abriter leur esquinancie. Méphistophélès meurt d'envie de s'aller coucher; Faust n'a qu'une pensée: ménager ses notes hautes, aussi précieuses pour lui que des obligations de chemins de fer. Quant à Marguerite, qui débute, et qui a refusé, le jour même, un engagement pour la province, elle réfléchit qu'elle a eu tort de ne pas accepter les offres qu'on lui faisait.»
Avec le Faust de Berlioz, de pareilles désillusions ne sont pas à craindre. Comme il n'y a ni décors, ni coulisses, ni rampes, ni maillots, ni pourpoints, ni ballerines, ni marcheuses, ni même de souffleur, la musique se charge de tous les frais et vous emporte toute seule sur l'aile des chimères. Un décor?.... A quoi bon? Le musicien vous conduit où vous voulez en vingt-cinq mesures. Voulez-vous boire avec les étudiants dans la taverne d'Auerbach?... A merveille! buvez. Le magicien donne un nouveau coup de sa baguette? Nous voici sur les bords de l'Elbe, près des sylphes qui frôlent les calices humides de rosée, sous les étoiles qui nous regardent en clignotant, comme des curieuses qu'elles sont de ce qui se passe chez nous... Attention! Nous avons eu à peine le temps de tourner la tête et le diable nous tient déjà compagnie devant la maison de Marguerite: Petite Louison, que fais-tu dès l'aurore... Oui, cet enchanteur de Berlioz dédaigne les machinistes; sans le secours de leur métier, il nous fait voyager, tout-simplement, dans le ciel et dans les enfers, sur la terre et sur l'onde, dans les nuages, dans l'Empyrée, dans le passé et dans l'avenir.
La Damnation de Faust rivalise avec les ouvrages des plus grands maîtres et n'est pas effacée par eux; elle lutte contre le poëme de Gœthe sans se laisser dominer par lui, elle rencontre Schubert et sa Marguerite au rouet; Schubert est vaincu. Mais savez-vous à quel sublime génie cette partition fait surtout songer?... Quand vous entendez la dernière partie de l'œuvre, quand vous suivez la «course à l'abîme», si vertigineuse qu'un frisson vous saisit comme si vous étiez sur le bord d'un précipice, quand les horribles cris des démons saluent la chute de Méphisto et de sa victime, quand l'orchestre se livre à des saturnales enragées auxquelles succèdent les ineffables joies du paradis, quand vous écoutez le langage de Swedenborg mêlé aux hymnes des élus, oh! alors, savez-vous à qui vous pensez? Vous songez involontairement à Michel-Ange; oui, vous revoyez en imagination les gigantesques peintures de la chapelle Sixtine, et aucune autre comparaison ne peut s'offrir à votre esprit: il est impossible que l'analogie ne vous frappe pas, pour peu que vous ayez l'habitude de faire des rapprochements entre les différentes parties de l'art.
Maintenant que la Damnation de Faust a reconquis la brillante place qu'elle doit occuper désormais dans les annales de la musique, il serait profitable et curieux de relire les critiques du temps. Parlant du magnifique chœur de la Pâque, un rédacteur d'un journal illustré insinuait que «cette résurrection ressemblait à un De Profundis»; la Danse des paysans, ajoutait-il, «ne me paraît pas des plus réservées (chaste critique, va!); le rhythme en est pesant et empêtré et ne donne pas une haute opinion de la grâce et de la légèreté des Hongroises.» Le compte rendu signé par M. Scudo serait à citer d'un bout à l'autre: «Cette étrange composition (la Damnation de Faust) échappe à l'analyse... La Marche hongroise est un déchaînement effroyable... un amoncellement monstrueux... La chanson du Rat et de la Puce manque de rondeur, d'entrain, de gaieté... L'idée mélodique de la Danse des sylphes est empruntée à un chœur de la Nina de Paisiello: Dormi, ô cara... Dans la troisième partie, il n'y a d'un peu supportable que quelques mesures d'un menuet, etc., etc.» M. Scudo était un Italien désagréable, qui avait échoué dans la carrière de la composition et qui avait réussi dans la spécialité du dénigrement de l'école française. On lui connaissait des torts nombreux; entre autres celui d'avoir écrit d'insipides romances longtemps chantées dans les pensionnats. Il se croyait une autorité et il n'était qu'un autoritaire, mal élevé d'ailleurs; ses propres haines l'ont tué. Il a éclaté de rage, comme la grenouille de la Fontaine; il est mort, délaissé et fou.
Après l'exécution de son chef-d'œuvre, Berlioz était ruiné; il devait une somme considérable qu'il n'avait pas. Grâce à la générosité de quelques amis, il put aller moissonner des roubles, en Russie, et s'acquitter enfin envers les personnes qui l'avaient aidé dans l'infortune. «Vous gagnerez là-bas cent cinquante mille francs!» lui avait dit Balzac.—On sait qu'en imagination l'auteur de la Comédie humaine remuait les millions à la pelle; Berlioz ne gagna pas la somme annoncée, mais il rapporta de quoi faire honneur à ses engagements. A ce moment-là, la direction de l'Opéra de Paris était sur le point de devenir vacante; le directeur, M. Léon Pillet, parlait de se retirer, et sa succession était briguée par MM. Duponchel et Roqueplan, qui, malgré leur zèle, malgré leurs démarches, n'avaient pas obtenu l'appui du ministère de l'intérieur. Ces messieurs recommandèrent leur candidature à Berlioz; ils furent nommés, par l'influence du Journal des Débats. Avant cette nomination, les solliciteurs, comme on pense, étaient tout feu, tout flammes; ils comptaient reprendre Benvenuto Cellini, jouer la Nonne sanglante, confier à l'homme auquel ils devaient leur titre de directeurs un poste important; une fois le décret ministériel signé, ces belles résolutions s'évanouirent comme par enchantement. Les relations devinrent de plus en plus froides entre MM. Duponchel, Roqueplan, et leur ancien ami; celui-ci, comprenant qu'ils étaient gênés avec lui, qu'on le prenait pour un malfaiteur auquel il ne fallait pas ouvrir les portes de l'Académie de musique, écrivit à ses obligés qu'il les dégageait de toute reconnaissance à son égard et qu'il était engagé par l'impresario Jullien pour conduire l'orchestre du théâtre de Drury-Lane, à Londres. Cette détermination terminait la crise; enchantés d'être débarrassés d'un importun qu'ils ne voulaient ni accueillir ni mécontenter, MM. Roqueplan et Duponchel feignirent l'étonnement en public, mais, en particulier, ils ne dissimulèrent pas leur joie.
«Votre lettre, répondirent-ils, nous a causé de la surprise et du regret. Les termes affectueux dans lesquels vous l'avez conçue ne nous permettent pas de vous supposer le moindre ressentiment des lenteurs involontaires qui ont retardé la conclusion de nos conventions. Nous aimons à penser que vous n'avez pas voulu étouffer votre génie musical dans les limites d'une place qui a quelque chose d'administratif, et que vous préférez, à votre âge, dans toute la force de votre talent, courir toujours les nobles aventures de l'art. Quant à notre regret, il est sincère; cela nous servait et nous honorait de mettre à la tête d'un de nos services les plus importants le nom d'un homme qui rattache à lui toutes les idées de progrès et de rénovation. Nous perdons un de nos plus glorieux drapeaux pour la campagne que nous entreprenons; il nous reste à compter sur les bonnes promesses qui terminent votre lettre et à espérer qu'elles ne seront pas vaines[37].»
De quelles promesses était-il question? Nous l'ignorons; elles furent emportées avec tant d'autres dans le tourbillon de la révolution de 1848. La saison musicale, à Drury-Lane, s'ouvrit par une représentation de Lucia de Lammermoor, jouée par madame Dorus Gras, le baryton Pischek, le ténor Reeves et la basse Withworth. En même temps, on donnait le Génie du Globe, ballet de la composition de M. Maretzek, maître du chant, audit théâtre[38]. La salle était peu garnie; Lucia, opéra fort démodé, même en Angleterre, n'attirait plus la foule, et Berlioz, qui avait fait une mauvaise affaire en liant sa destinée à celle de Jullien, devina que cette équipée se terminerait par une banqueroute. Ses prévisions ne tardèrent pas à se réaliser; pour comble de malheur, les événements politiques, en France, tournèrent à la tragédie des barricades et aux massacres de juin. Berlioz faillit perdre sa modeste place de bibliothécaire au Conservatoire; si cette catastrophe était arrivée en un pareil moment, il n'aurait plus eu qu'à se suicider. Mais il connaissait Victor Hugo, et le grand poëte, alors au pouvoir, réussit à congédier les affamés qui flairaient d'un peu trop près les rogatons d'appointements que le Conservatoire alloue à ses bibliothécaires.
Sous la seconde République, les artistes, presque tous enrôlés dans la garde nationale, n'eurent guère d'occasions de se distinguer. En ce qui concerne le musicien dont nous écrivons la vie, nos notes, si abondantes parfois, sont insignifiantes ici; nous trouvons à peine à signaler un concert au palais de Versailles (29 octobre 1848), un autre concert à Londres, après lequel, dans un souper, miss Dolby, miss Lyon et Reeves chantèrent, en l'honneur du maître, des glees ou anciens madrigaux anglais[39]. L'année suivante, le baron Taylor offrit à Berlioz la médaille d'or que certains admirateurs de la Damnation de Faust avaient fait frapper en souvenir de cette œuvre trop rarement entendue. Le goût de la symphonie commençait à se répandre à Paris. On essaya de fonder une société, avec deux cents exécutants et choristes, donnant ses séances dans la salle Sainte-Cécile, rue de la Chaussée-d'Antin: ce fut là que Berlioz fit exécuter la seconde partie de son Enfance du Christ, attribuée (sur le programme) à Pierre Ducré, musicien imaginaire, chimérique, ayant vécu, disait-on, au XVIe siècle; il fallait bien détourner les soupçons et désarmer la critique hostile. Le secret avait été bien gardé; tout le monde fut pris à cette plaisanterie. Léon Kreutzer, qui n'était pas dans la confidence, écrivait deux jours après: «Cette pastorale m'a paru assez jolie et modulée assez heureusement, pour un temps où l'on ne modulait jamais...» Une dame enthousiasmée disait à un journaliste: «Ce n'est pas votre Berlioz qui ferait cela!»
Le faux Pierre Ducré ressentit quelque amertume de ce succès calomnieux pour ses œuvres antérieures. L'Enfance du Christ, complétée et remaniée, fit recette à la salle Herz, pendant plusieurs soirées de suite[40]. Ce triomphe ne consola pas Berlioz du second échec que Benvenuto venait de subir à Londres, où les partisans de la musique italienne et de la vieille Société philharmonique dominaient encore. Le public de Weimar fut d'un avis contraire à celui du public anglais. Benvenuto, à Weimar, prit une revanche éclatante de ses autres déconvenues. Berlioz, étant venu à la représentation, on le célébra en langue allemande, en français, et même en latin. Nous avons découvert les paroles d'un toast, mis en musique par Raff, et chanté en chœur par l'élite des Weimarquois: c'est à pouffer de rire:
Nostrum desiderium
Tandem implevisti:
Venit nobis gaudium
Quia tu venisti.
Sicuti coloribus
Pingit nobis pictor;
Pictor es eximius,
Harmoniæ victor.
Vives, crescas, floreas,
Hospes Germanorum
Et amicus maneas
Neo-Wimarorum[41].
Vives, crescas, floreas, répétait le chœur des convives, en buvant du vin de Champagne: il n'y a que les Allemands pour s'amuser de la sorte. Berlioz, triste et préoccupé, ne retrouvait un peu de gaieté que hors de chez lui, au milieu de ces populations étrangères qui lui décernaient des honneurs dignes d'un proconsul mené au Capitole. Il venait de perdre sa femme, Henriette Smithson, et de se remarier avec mademoiselle Récio, l'ex-cantatrice de Bruxelles, dont le talent n'était pas toujours à la hauteur de l'ambition, si nous en jugeons par ce fragment de correspondance: «Plaignez-moi, mon cher Morel; Marie a voulu chanter à Mannheim et à Stuttgart et à Heckingen. Les deux premières fois, cela a paru supportable, mais la dernière!... et l'idée seule d'une autre cantatrice la révoltait[42]...»
Indépendamment de ses ennuis privés, Berlioz ne manquait pas non plus de tracas officiels; ainsi, à l'Exposition de 1855, on lui infligeait la charge de membre du jury, sous prétexte qu'à l'Exposition de Londres il avait rempli le même office; on souffrait que, la veille de l'ouverture, il organisât un immense Te Deum à Saint-Eustache; mais, pour la fermeture, on lui commandait une cantate, l'Impériale:
Du peuple entier les âmes triomphantes
Ont tressailli, comme au cri du destin,
Quand des canons les voix retentissantes
Ont amené le jour qui vient de luire enfin!...
Si l'Impériale passa comme une étoile filante, le Te Deum marqua davantage; quand on grava ce gigantesque morceau, les rois de Hanovre, de Saxe, de Prusse, l'empereur de Russie, le roi des Belges, la reine d'Angleterre, s'empressèrent de prendre part à la souscription: Beethoven avait été moins heureux, lorsque, pour faire éditer sa Messe, il ne rencontra que trois souscripteurs; deux riches habitants de Vienne et... Louis XVIII. Au début du règne de Napoléon III, on ne jouait nulle part de la musique de Berlioz, c'est vrai; seulement, il faut bien le reconnaître, le compositeur était comblé d'honneurs. Il avait reçu une avalanche de décorations; l'Aigle rouge à Berlin, l'ordre de la maison Ernestine à Weimar, la croix de la Légion d'honneur; il était correspondant de plusieurs sociétés, membre honoraire du Conservatoire de Prague, que dis-je? il faisait partie de l'Académie... de Rio-de-Janeiro[43]. L'Institut—le vrai, celui qui siège à l'extrémité du pont des Arts—ne pouvait manquer de s'attacher un homme si dédaigné par la vile multitude et si favorisé par les souverains. Un des intimes de Berlioz, l'intelligent facteur d'orgues M. Édouard Alexandre, s'employa à soutenir la candidature de son ami. Il s'agissait de conquérir la voix d'Adam; or, l'auteur du Chalet n'avait guère de points de contact avec l'auteur de la Symphonie fantastique et le rapprochement était difficile: «Voyons, voyons, dit M. Alexandre à Berlioz, qui ne voulait se résoudre à aucune démarche; réconciliez-vous avec Adam; que diable! c'est un musicien; vous ne pouvez nier cela?...—Aussi, je ne le nie point, dit l'autre; mais pourquoi Adam, qui est un grand musicien, s'obstine-t-il à s'encanailler dans le genre de l'opéra-comique; s'il voulait, parbleu! il ferait de la musique comme j'en fais!» M. Alexandre ne se découragea pas, et, se rendant chez Adolphe Adam: «Mon cher ami, vous donnerez votre voix à Berlioz, n'est-ce pas? Vous avez beau ne pas vous entendre avec lui, vous savez aussi bien que moi que c'est un musicien...—Un grand musicien certes (et le petit Adam rajusta ses lunettes sur son nez), un très grand, très grand... Seulement, il fait de la musique ennuyeuse; s'il voulait, il en ferait d'autre... il en ferait tout aussi bien que moi!...»
Ce fut une scène digne de Molière[44].
«Mais, parlant sérieusement, dit Adam, Berlioz est un homme d'une grande valeur. Je vous donne l'assurance, que, après Clapisson, auquel nous avons tous déjà promis, Berlioz aura le premier fauteuil vacant.»
L'institut nomma Clapisson.
Hélas! bizarrerie du sort: Adam mourut. Le pays fit une grande perte. Le premier fauteuil vacant fut le sien et ce fut Berlioz qui l'occupa. Il fut élu par dix-neuf voix contre six données à Niedermeyer, six à Charles Gounod et deux à Panseron. MM. Leborne, Vogel et Félicien David s'étaient présentés aussi. Ce dernier échec de Félicien David contre Berlioz rendit Azevedo, ce critique de mauvais aloi, furieux contre Berlioz[45].
De 1856, année où nous sommes arrivés, à 1863, année des Troyens, nous ne distinguons pas dans la vie du compositeur un grand nombre d'événements importants. Il organise, chaque année, un festival à Bade; il y fait représenter son ravissant opéra de Béatrice et Bénédict; la jeunesse de la ville de Gior (en allemand: Raab) lui envoie une adresse de félicitation; les artistes du Conservatoire de Paris lui font une ovation, peu de temps après le Tannhäuser; le Grand-Théâtre de Bordeaux s'avise de jouer Roméo et Juliette; voilà tout, ou à peu près tout. Ah! j'oubliais!... Il surveille les répétitions d'Alceste; quoique inspirant peu de confiance à l'administration de l'Opéra, on le juge capable de remplir cette besogne d'obscur manœuvre.
Pendant ce temps, un nouveau théâtre lyrique s'élevait sur les rives de la Seine, et les faiseurs de partitions, si délaissés d'ordinaire, commençaient à espérer qu'on allait enfin s'occuper d'eux. Le livret des Troyens, lu dans divers salons, y avait rencontré une approbation unanime; même l'empereur Napoléon III, ayant entendu parler de la chose, invita Berlioz à dîner; mais on causa de la pluie et du beau temps: «Je me suis splendidement ennuyé!» écrivit le lendemain le convive de Sa Majesté Impériale.—A un autre dîner mensuel où se réunissaient MM. Fiorentino, Nogent-Saint-Laurens, Édouard Alexandre, Paul de Saint-Victor, Carvalho, on s'inquiéta plus sérieusement de Didon et d'Énée; M. Carvalho, le directeur du Théâtre-Lyrique, n'avait pas besoin d'encouragement; il connaissait l'œuvre, il l'admirait et il comptait bien la révéler aux masses, comme il avait révélé Faust.
La première représentation des Troyens fut assez calme; les spectateurs qui se souvenaient de Benvenuto Cellini s'attendaient à des péripéties; le divertissement de la Chasse causa seul quelques rires, dus plutôt à l'interprétation de ce ballet qu'aux modulations hardies de l'orchestre. En revanche, l'air de Didon au premier acte, le fameux septuor et le duo: Nuit d'ivresse et d'extase... allèrent aux nues, alle stelle. Certains opéras modernes contiennent des morceaux plus soutenus, plus amples, que le septuor des Troyens, mais aucun de ces morceaux ne peut soutenir la comparaison avec lui au point de vue du sentiment pittoresque et de l'originalité poétique. C'est un diamant qui brille d'un éclat inouï; cela ne ressemble ni à la Bénédiction des poignards, ni à la Sérénade de Don Juan, ni au trio de Guillaume Tell, ni à la pastorale du Prophète; cela tient de la symphonie et du drame, de l'ode pindarique et de la méditation lamartinienne, cela bruit comme un souffle et frissonne comme une caresse; cela palpite, rêve, soupire, émeut... Les battements du cœur s'apaisent avec l'écroulement des vagues de la mer africaine, le parfum des orangers s'exhale de cette musique divine, et l'esprit s'endort bercé dans un palais des Mille et une Nuits.
Rien n'était fait pour déplaire davantage aux Parisiens de 1863; l'homme de génie qui avait écrit les Troyens eut contre lui à peu près toute la presse, sérieuse ou légère. Cham, dans le Charivari, fit une caricature: le Tannhäuser (en bébé) demandant à voir son petit frère. Au théâtre Déjazet, on joua une parodie où des acteurs, coiffés de casques ridicules, exécutaient un horrible vacarme, avec des casseroles, des gongs chinois, des scies ébréchées, des paires de pincettes; nous nous rappelons cette ignoble parade, plus digne de divertir les sauvages qui mangèrent le capitaine Cook que d'amuser les Athéniens de la décadence.
Il faut rendre justice à M. Carvalho; le chapitre que Berlioz lui a consacré dans les Mémoires est inexact; l'amertume de la défaite a envenimé la plume de l'auteur. Nous disons défaite, car les Troyens n'obtinrent qu'une trentaine de représentations, suivies, il est vrai, par l'élite du monde musical; Meyerbeer n'en manqua pas une, et je le vois encore au fauteuil de balcon qu'il occupait, très-attentif, donnant fréquemment des marques de vive satisfaction. M. Carvalho avait consacré une partie de ses bénéfices antérieurs à la mise en scène des Troyens; accordons, qu'il se soit trompé sur certains détails, c'est possible; qu'il ait essayé de ramener au goût mesquin du public une œuvre conçue selon les larges traditions de l'antiquité, c'est probable; il n'en a pas moins risqué sa fortune et son avenir.
M. Alexandre, le plus intime ami de Berlioz, aujourd'hui son exécuteur testamentaire, me disait l'autre jour: «Le monde musical doit beaucoup à Carvalho; il ne m'appartient pas d'énumérer tout ce que l'art lui doit de reconnaissance; je n'ai aucune autorité pour le faire; mais ce que j'ai le devoir de vous prier de consigner dans cette notice, pour laquelle vous me demandez des renseignements, c'est le cœur, le dévouement, le désintéressement de Carvalho pour monter les Troyens, autant que faire se pouvait, d'une façon digne du maître que personne, plus que lui, ne respectait ni n'admirait.
»Carvalho, oubliant tout pour une aussi grande question artistique, fit des sacrifices tels, qu'ils pesèrent sur sa vie entière. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier.»
Ce n'est pas à nous à le lui reprocher et personne n'oserait le faire.
Les Troyens avaient été la suprême espérance de Berlioz; leur chute causa sa longue agonie de six ans. A partir de ce moment, ses idées devinrent de plus en plus sombres; les souffrances physiques ne lui laissèrent plus aucun repos. Il avait tant compté sur son opéra! Au sortir de la répétition générale, il était allé chez madame d'Ortigue, la digne femme d'un de ses plus vieux amis. Il lui avait fait l'effet d'un spectre, tant il était pâle, maigre, décharné: «Qu'y a-t-il, s'écria-t-elle effrayée? Est-ce que la répétition aurait mal tourné, par hasard?...—Au contraire, dit l'autre en se laissant tomber sur une chaise. C'est beau, c'est sublime!...»—Et il se mit à pleurer[46].
Il était déjà affaibli et malade; dans sa jeunesse, il s'était quelquefois amusé à se laisser avoir faim pour connaître les maux par lesquels le génie pouvait passer; son estomac, plus tard, dut payer ces coûteuses fantaisies. Il vécut dans son appartement de la rue de Calais, retiré et dégoûté de tout, entouré de passereaux effrontés auxquels il donnait du pain qu'ils venaient picorer sur sa fenêtre, près de son immense piano à queue, de sa harpe et du portrait de sa première femme, Henriette Smithson. Sa belle-mère, madame Récio, le soigna avec une vigilance et un dévouement exceptionnels; ses amis prirent à tâche de lui faire oublier les injustices du sort et personne n'en a eu de plus attentifs, de plus fidèles que lui: Édouard Alexandre, Ernest Reyer, M. et madame Massart, M. et madame Damcke, la famille Ritter, et combien d'autres que je ne puis citer; la liste en serait trop longue. Il s'était mis à apprendre le français à un jeune compositeur danois, M. Asger Hammerik, aujourd'hui directeur du Conservatoire de Baltimore. «Je suis bien à plaindre, disait-il quelquefois; voilà ma belle-mère qui me parle en espagnol, ma bonne en allemand, et vous, avec votre danois, vous me déchirez les oreilles[47]!...»
La mort de son fils unique, Louis Berlioz, emporté par la fièvre, aux colonies, acheva de terrasser le glorieux vaincu. Louis Berlioz avait choisi la carrière de marin; son père l'adorait avec une passion dont on retrouvera la trace dans les Lettres. Il y avait eu entre eux des brouilles passagères; mais elles finissaient toujours par une réconciliation où le pauvre père cédait. Ce Berlioz, si hautain, si rogue, si absolu, avec la plupart des gens qu'il coudoyait dans la vie, il devenait tendre et humble avec son fils, il descendait aux supplications, il avait des raffinements d'amour paternel. Que de bons conseils il donnait à son enfant chéri: «Tu es jeune, tu es fort, ne te laisse pas aller à l'ennui, au découragement, et songe qu'avec les avantages que tu as et la santé, on peut surmonter bien des obstacles[48].»—«Cher Louis, écrivait-il encore à propos de certaines fredaines de jeune homme, tu ne trouveras jamais en moi un censeur tartufe de morale[49]...»»Figure-toi que je t'ai aimé même quand tu étais tout petit; et il m'est si difficile d'aimer les petits enfants! Il y avait quelque chose en toi qui m'attirait. Ensuite cela s'est affaibli à ton âge bête, quand tu n'avais pas le sens commun; et, depuis lors, cela est revenu, cela s'est accru, et je t'aime comme tu sais, cela ne fera qu'augmenter... Ah! mon pauvre Louis, si je ne t'avais pas[50]!...» L'année suivante, hélas! il le perdait, ce fils adoré, et il se replongeait, fou de douleur, dans l'anéantissement, dans le silence, dans la nuit.
Vainement essayait-on de lui proposer des distractions: «Mon cher Damcke, répondait-il à une invitation, je me donne le luxe de rester couché. Ainsi, excusez-moi auprès de S... si vous le voyez. J'ai pris mon parti; je ne veux plus subir aucun genre de servitude; je ne veux plus rien entendre de force; rien louer de force. Qu'on me laisse mourir tranquille. Je vous pardonne seulement de me forcer à vous aimer[51]...»
Une artiste dont il aimait le talent, mademoiselle Bockholtz-Falconi, parvint cependant à l'arracher à la torpeur où il se complaisait en le mettant en relations avec M. Herbeck, maître de chapelle de la cour à Vienne, qui le demandait pour diriger la Damnation de Faust. Berlioz accéda aux désirs de M. Herbeck et n'eut pas à s'en repentir. D'autres propositions magnifiques l'attirèrent chez la grande-duchesse Hélène de Russie, qui le logea dans son propre palais, à Saint-Pétersbourg, et ne lui permit de partir que comblé de distinctions, de gloire et d'argent.
En revenant des bords de la Néva, Berlioz éprouvait une grande fatigue; sa maladie nerveuse empirait. Il était allé trouver le célèbre docteur Nélaton, qui, après l'avoir ausculté, palpé, interrogé, lui avait dit: «Êtes-vous philosophe?—Oui, avait répondu le patient.—Eh bien, puisez du courage dans la philosophie, car vous ne guérirez jamais[52].» Assuré de mourir dans un assez bref délai et en proie à des tortures épouvantables, le vieux maître se décida à changer de lit de souffrances.—«Je vais m'étendre sur les gradins de marbre de Monaco... Le soleil me réchauffera peut-être... Oh! la belle Méditerranée et les orangers aux doux parfums!...» Telles étaient ses pensées—nous allions dire ses rêves—en prenant le chemin de fer. On l'accueille à l'hôtel des Étrangers de Nice comme une ancienne connaissance, on l'accable de témoignages de respect et de sympathie. Des bouffées de jeunesse lui remontent au cerveau; il se rappelle sans doute cette tour crevassée, pleine de rats et de chats-huants, ouverte à tous les vents du ciel, dénudée, romantique, dont il avait fait autrefois son domicile légal. Il veut se promener encore dans ces jardins embaumés, sur ces falaises qui contrastent par leur immobile blancheur avec l'azur des vagues. Le voilà à Monaco, près des buissons de cactus, s'enivrant des senteurs d'une végétation presque orientale. Mais son regard se trouble, son pied chancelle; il tombe, on le relève, la face ensanglantée. Le lendemain, même accident. Deux Anglais qui passaient sur la terrasse de Nice le ramènent à son appartement, où il reste huit jours soigné par les gens de l'hôtel. Dès qu'il peut prendre le train, il retourne à Paris où l'attendaient sa belle-mère, madame Récio, et sa fidèle servante, qui poussent des cris d'horreur en le revoyant défiguré.
Le séjour à Nice ne fut pas le dernier voyage de Berlioz. Quelque temps après sa chute dans les rochers, il fut invité à se rendre à un festival orphéonique qui se donnait dans sa province natale, à Grenoble. Ce dernier épisode rappelle vraiment le dénoûment des pièces de Shakespeare et l'homme qui avait le mieux compris le génie du poëte anglais devait avoir une fin assez semblable à celle du roi Lear, de Macbeth ou d'Othello. Pour bien peindre cette scène suprême, il faudrait que l'histoire empruntât les couleurs du drame. Qu'on se figure une salle resplendissante de lumières, ornée de tentures officielles, une table chargée de mets délicats, une réunion de joyeux convives attendant un des leurs qui tarde à venir. Tout à coup, une draperie s'entr'ouvre et un fantôme apparaît: le spectre de Banquo? non; mais Berlioz à l'état de squelette, le visage pâle et amaigri, les yeux vagues, le chef branlant, la lèvre contractée par un amer sourire. On s'empresse autour de lui, on l'acclame, on lui serre les mains,—ces mains tremblantes qui ont conduit à la victoire des armées de musiciens. Un assistant dépose une couronne sur les cheveux blancs du vieillard. Celui-ci contemple d'un œil étonné les amis, les compatriotes qui l'accablent d'hommages tardifs mais sincères. On le félicite, il ne paraît s'apercevoir de rien. Machinalement, il se lève pour répondre à des paroles qu'il n'a pas comprises; à ce moment, un vent furieux, venu des Alpes, s'engouffre dans la salle, soulève les rideaux, éteint les bougies; des rafales soufflent au dehors et des éclairs déchirent la nue, illuminant d'un fauve reflet les assistants muets et terrifiés. Au milieu de la tempête, Berlioz est resté debout; il ressemble, environné de lueurs, au génie de la symphonie, auquel la puissante nature ferait une apothéose, dans un décor de montagnes et avec l'aide du tonnerre, musicien gigantesque.
Dès lors, tout fut fini.
Le lundi, 8 mars 1869, dans la matinée, Hector Berlioz, de retour à Paris, rendait le dernier soupir. Ses obsèques eurent lieu à l'église de la Trinité, le jeudi suivant; l'Institut avait envoyé une nombreuse députation, les cordons du poêle étaient tenus par MM. Camille Doucet, Guillaume, Ambroise Thomas, Gounod, Nogent Saint Laurens, Perrin, le baron Taylor; la musique de la garde nationale précédait le cortège jouant des fragments de la Symphonie en l'honneur des victimes de Juillet. Sur le cercueil étaient (souvenir touchant) les couronnes données par la Société Sainte-Cécile, par la jeunesse hongroise, par la noblesse russe, et enfin les derniers lauriers de la ville de Grenoble.
Il était mort!... la réparation commençait...
Il dort maintenant sur cette haute colline qui vit couler le sang des martyrs; là-bas, au-dessus de nous, écoutant peut-être les bruits tumultueux de l'immense ville. Aux anniversaires, de pieuses mains viennent déposer sur son tombeau des bouquets de fleurs promptement fanées par l'intempérie des saisons; j'y ai vu des roses blanches, aussi blanches que le lys, et des violettes répandues en pluie odoriférante, sur la pierre, sur le fer, et jusque dans la boue qu'avait produite le piétinement des passants. Il se repose là des tracas de sa vie agitée, attendant l'heure de la justice, lente à venir. Aucune rue ne porte son nom, aucun théâtre ne possède sa sombre effigie, aucun ministère (et il y en a eu pourtant beaucoup!) n'a songé à lui rendre des honneurs quelconques; de toutes les gloires musicales de la France, la France n'en oublie qu'une, celle dont elle peut le mieux se glorifier devant le monde entier. D'autres musiciens passeront; que dis-je? ils ne sont déjà plus... Berlioz est resté et son souvenir grandit, comme ces ombres qui, à mesure que décroît le soleil et que le temps s'écoule, deviennent plus accusées, plus nettes, et s'allongent sur le sable d'or.
Daniel Bernard.
(1819-1868)
A IGNACE PLEYEL.
La Côte-Saint-André (Isère), 6 avril 1819.
Monsieur,
Ayant le projet de faire graver plusieurs œuvres de musique de ma composition, je me suis adressé à vous, espérant que vous pourriez remplir mon but. Je désirerais que vous prissiez à votre compte l'édition d'un pot-pourri[53] concertant composé de morceaux choisis, et concertant pour flûte, cor, deux violons, alto et basse.
Voyez si vous pouvez le faire et combien d'exemplaires vous me donnerez. Répondez-moi au plus tôt, je vous prie, si cela peut vous convenir, combien de temps il vous faudra pour le graver et s'il est nécessaire d'affranchir le paquet.
J'ai l'honneur d'être, avec la plus parfaite considération, votre obéissant serviteur.
A RODOLPHE KREUTZER[54].
(1826....?)
O génie!
Je succombe! je meurs! les larmes m'étouffent! la Mort d'Abel! dieux!...
Quel infâme public! il ne sent rien! que faut-il donc pour l'émouvoir?...
O génie! et que ferai-je, moi, si un jour ma musique peint les passions; on ne me comprendra pas, puisqu'ils ne couronnent pas, qu'ils ne portent pas en triomphe, qu'ils ne se prosternent pas devant l'auteur de tout ce qui est beau!
Sublime, déchirant, pathétique!
Ah! je n'en puis plus; il faut que j'écrive! A qui écrirai-je? au génie?... Non, je n'ose.
C'est à l'homme, c'est à Kreutzer... il se moquera de moi...., ça m'est égal...; je mourrais... si je me taisais. Ah! que ne puis-je le voir, lui parler, il m'entendroit, il verroit (sic) ce qui se passe dans mon âme déchirée; peut-être il me rendroit le courage que j'ai perdu, en voyant l'insensibilité de ces gredins de ladres, qui sont à peine dignes d'entendre les pantalonnades de ce pantin de Rossini.
Si la plume ne me tombait des mains, je ne finirais pas.
AH! GÉNIE!!!
A M. FÉTIS, DIRECTEUR DE LA REVUE MUSICALE[55].
(16) mai 1828.
Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à votre bienveillance et de réclamer l'assistance de votre journal pour me justifier aux yeux du public de plusieurs inculpations assez graves.
Le bruit s'est répandu dans le monde musical que j'allais donner un concert composé tout entier de ma musique et déjà une rumeur de blâme s'élève contre moi; on m'accuse de témérité, on me prête les intentions les plus ridicules.
A tout cela je répondrai que je veux tout simplement me faire connaître, afin d'inspirer, si je le puis, quelque confiance aux auteurs et aux directeurs de nos théâtres lyriques. Ce désir est-il blâmable dans un jeune homme? Je ne le crois pas. Or, si un pareil dessein n'a rien de répréhensible, en quoi les moyens que j'emploie pour l'accomplir peuvent-ils l'être?
Parce qu'on a donné des concerts composés tout entiers des œuvres de Mozart et de Beethoven, s'ensuit-il de là qu'en faisant de même j'aie les prétentions absurdes qu'on me suppose? Je le répète, en agissant ainsi, je ne fais qu'employer le moyen le plus facile de faire connaître mes essais dans le genre dramatique.
Quant à la témérité qui me porte à m'exposer devant le public dans un concert, elle est toute naturelle, et voici mon excuse. Depuis quatre ans, je frappe à toutes les portes; aucune ne s'est encore ouverte. Je ne puis obtenir aucun poëme d'opéra, ni faire représenter celui qui m'a été confié[56]. J'ai essayé inutilement tous les moyens de me faire entendre; il ne m'en reste plus qu'un, je l'emploie, et je crois que je ne ferai pas mal de prendre pour devise ce vers de Virgile:
Ulla salus victis nullam sperare salutem.
Agréez, etc.
A M. FERDINAND HILLER.
Paris, 1829.
Mon cher Ferdinand,
Il faut que je vous écrive encore ce soir; cette lettre ne sera peut-être pas plus heureuse que les autres... mais n'importe. Pourriez-vous me dire ce que c'est que cette puissance d'émotion, cette faculté de souffrir qui me tue? Demandez à votre ange... à ce séraphin qui vous a ouvert la porte des cieux!... Ne gémissons pas!... mon feu s'éteint, attendez un instant... O mon ami, savez-vous?... J'ai brûlé, pour l'allumer, le manuscrit de mon élégie en prose!... des larmes toujours, des larmes sympathiques; je vois Ophelia en verser, j'entends sa voix tragique, les rayons de ses yeux sublimes me consument. O mon ami, je suis bien malheureux; c'est inexprimable!
J'ai demeuré bien du temps à sécher l'eau qui tombe de mes yeux...—En attendant, je crois voir Beethoven qui me regarde sévèrement, Spontini guéri de mes maux, qui me considère d'un air de pitié plein d'indulgence, et Weber qui semble me parler à l'oreille comme un esprit familier habitant une région bienheureuse où il m'attend pour me consoler.
Tout ceci est fou... complétement fou, pour un joueur de dominos du café de la Régence ou un membre de l'Institut... Non, je veux vivre... encore...; la musique est un art céleste, rien n'est au-dessus, que le véritable amour; l'un me rendra peut-être aussi malheureux que l'autre, mais au moins, j'aurai vécu..... de souffrances, il est vrai, de rage, de cris et de pleurs, mais j'aurai... rien... Mon cher Ferdinand!... j'ai trouvé en vous tous les symptômes de la véritable amitié, celle que j'ai pour vous est aussi très vraie; mais je crains bien qu'elle ne vous donne jamais ce bonheur calme qu'on trouve loin des volcans... hors de moi, tout à fait incapable de dire quelque chose de... raisonnable... il y a aujourd'hui un an que je la vis pour la dernière fois... Oh! malheureuse! que je t'aimais! J'écris en frémissant que je t'aime!...
S'il y a un nouveau monde, nous retrouverons-nous?.. Verrai-je jamais Shakespeare?
Pourra-t-elle me connaître?...
Comprendra-t-elle la poésie de mon amour?................ Oh! Juliette, Ophelia, Belvidera, Jeanne Shore, noms que l'enfer répète sans cesse............................
Au fait!
Je suis un homme très malheureux, un être presque isolé dans le monde, un animal accablé d'une imagination qu'il ne peut porter, dévoré d'un amour sans bornes qui n'est payé que par l'indifférence et le mépris; oui! mais j'ai connu certains génies musicaux, j'ai ri à la lueur de leurs éclairs et je grince des dents seulement de souvenir!
Oh! sublimes! sublimes! exterminez-moi! appelez-moi sur vos nuages dorés, que je sois délivré!...............
La Raison.
«Sois tranquille, imbécile, dans peu d'années, il ne sera pas plus question de tes souffrances que de ce que tu appelles le génie de Beethoven, la sensibilité passionnée de Spontini, l'imagination rêveuse de Weber, la puissance colossale de Shakspeare!...
Va, va, Henriette Smithson
et Hector Berlioz
seront réunis dans l'oubli de la tombe, ce qui n'empêchera pas d'autres malheureux de souffrir et de mourir!......»
AU MÊME
La Côte-Saint-André, 9 janvier 1831.
Mon cher ami,
Je suis depuis huit jours chez mon père, environné de soins affectueux et tendres par mes parents et mes amis, accablé de félicitations, de compliments de toute espèce; mais mon cœur a tant de peine à battre, je suis si oppressé, que je ne dis pas dix paroles en une heure. Mes parents conçoivent ma tristesse et me la pardonnent. Je partirai pour Grenoble dans six jours; si vous me répondez, adressez néanmoins votre lettre à la Côte-Saint-André (Isère), et mettez mon nom Hector pour que la lettre ne parvienne pas à mon père.
Je vous écris dans le salon de Rocher, qui me charge de le rappeler à votre souvenir.
Que faites-vous?... Il n'y a toujours point de musique, n'est-ce pas, dans ce bruyant Paris?... Avez-vous fini vos trios?... Feydeau est-il enfin fermé?... l'opéra de Meyerbeer est-il en répétition[57]?... Saluez-le, je vous prie, de ma part, quand vous le verrez (Meyerbeer! ma phrase est si mal tournée, que vous pourriez croire que c'est son opéra que je veux dire).
Nous allons avoir la guerre!... On va tout saccager; des hommes qui se croient libres vont se ruer contre d'autres hommes qui sont certainement esclaves; peut-être les hommes libres seront-ils exterminés, les esclaves seront-ils maîtres; puisse toute l'Europe s'épuiser en cris de rage, tous ses enfants s'entr'égorger, le fer et le feu triompher, la peste régner, la famine ronger; puisse Paris brûler, pourvu que j'y sois et que, la tenant dans mes bras, nous nous tordions ensemble dans les flammes!
Voilà mes vœux sincères et le bien que je souhaite à l'espèce humaine. Quand je serai heureux, ce sera tout différent; je laisserai l'espèce humaine tranquille, et elle ne s'en tourmentera pas moins.
Assez grincé des dents. Voulez-vous, je vous prie, aller chez Desmarest, rue Monsigny, nº 1, près de l'Opéra-Comique, lui dire mille amitiés de ma part, le charger de cinq cents autres pour Girard, et lui demander s'il n'a point eu de lettre à mon adresse; il s'était engagé à les prendre chez mon portier.
Blasphémez un peu à mon intention, je vous prie, j'en éprouverai du soulagement, et je vous rendrai la pareille quand vous voudrez.
Adieu! les cœurs de lave ne sont durs que quand ils sont froids, le mien est rouge fondant. Je suis toujours votre ami dévoué.
Mettez, je vous prie, cette petite lettre à la poste.
AU MÊME.
La Côte-Saint-André, 23 janvier 1831.
Je viens de faire à Grenoble un insipide voyage, passant la moitié de mon temps malade au lit, l'autre moitié à faire des visites plus assommantes les unes que les autres; j'arrive hier après avoir passé une dévorante journée sans dire un mot. Mon père, qui venait d'apprendre mon état par ma mère, m'embrasse en souriant et me dit qu'il y avait une lettre de Paris pour moi; j'ai compris à son air que c'était de madame...; effectivement, c'était une lettre double; je suis redevenu calme; j'étais aussi ravi que je puisse l'être dans un si exécrable exil. Ne faut-il pas que votre lettre arrive aujourd'hui pour troubler ma tranquillité? que le diable vous emporte! Qu'aviez-vous besoin de venir me dire que je me plais dans un désespoir dont PERSONNE ne me sait gré, «personne moins que les gens pour qui je me désespère».
D'abord, je ne me désespère pas pour des gens; ensuite, je vous dirai que, si vous avez vos raisons pour juger sévèrement la personne pour laquelle je me désespère, j'ai les miennes aussi pour vous assurer que je connais aujourd'hui son caractère mieux que personne. Je sais très bien qu'elle ne se désespère pas, elle; la preuve de cela, c'est que je suis ici et que, si elle avait persisté à me supplier de ne pas partir, comme elle l'a fait plusieurs fois, je serais resté. De quoi se désespèrerait-elle? elle sait très bien à quoi s'en tenir sur mon compte, elle connaît aujourd'hui tout ce que mon cœur enferme de dévouement pour elle (pas tout cependant: il y a encore un sacrifice, le plus grand de tous, qu'elle ne connaît pas, et que je lui ferai). Vous ne savez pas ce qui me tourmente, personne au monde qu'elle ne le sait; encore n'y a-t-il pas longtemps qu'elle l'ignorait.
Ne me donnez pas de vos conseils épicuriens, ils ne me vont pas le moins du monde. C'est le moyen d'arriver au petit bonheur, et je n'en veux point. Le grand bonheur ou la mort, la vie poétique ou l'anéantissement. Ainsi, ne venez pas me parler de femme superbe, de taille gigantesque, et de la part que prennent ou ne prennent pas à mes chagrins les êtres qui me sont chers; car vous n'en savez rien, qui vous l'a dit?... Vous ne savez pas ce qu'elle sent, ce qu'elle pense. Ce n'est pas parce que vous l'aurez vue dans un concert, gaie et contente, que vous pourrez en tirer une induction fatale pour moi. Si cela était, que devriez-vous donc induire de ma conduite à Grenoble, si vous m'aviez vu un jour dans un grand dîner de famille, ayant à droite et à gauche mes deux charmantes cousines de dix-sept à dix-huit ans, avec lesquelles je folâtrais et riais de la façon la plus inaccoutumée?...
Ma lettre est brusque, mon ami, mais vous m'avez froissé horriblement. Je resterai encore ici neuf jours au moins; Ferrand viendra demain. Si vous vouliez m'écrire courrier par courrier une seconde lettre, vous me feriez bien plaisir et elle arriverait à temps.
Adieu, mille choses à Sina et à Girard; si vous avez entendu parler de mon mariage dans le monde, dites-le-moi, et ce qu'on en dit.
Voulez-vous, je vous prie, passer chez Gounet, rue Saint-Anne, 34 ou 36, et lui dire mille choses de ma part? Je lui écrirai dès que Ferrand sera arrivé.
AU MÊME.
La Côte Saint-André, 31 janvier 1831.
Quoique mon agitation dévorante n'ait pas cessé un instant depuis mon arrivée ici, je puis cependant aujourd'hui vous écrire avec plus de calme. Puisque vous avez déjà à votre âge rencontré un filon d'or dans cette pauvre mine où nous fouillons tous, tâchez de le suivre jusqu'au bout, mais songez bien que vous êtes sous une voûte que vous creusez en avançant, et qui peut s'écrouler derrière vous. La bévue que vous avez faite, en demandant à Cherubini la salle du Conservatoire avant que la Société de concerts ait fini, est impardonnable. Vous deviez bien savoir que jamais ces messieurs n'y consentiraient, et il est fort désagréable de se voir contre-carré par une volonté contre laquelle la sienne propre est impuissante. Je dois vous dire que vous faites quelquefois les choses trop précipitamment. Il faut, je crois, réfléchir beaucoup à ce qu'on projette, et quand les mesures sont prises, frapper un tel coup que tous les obstacles soient brisés. La prudence et la force, il n'y a au monde que ces deux moyens de parvenir. Je crains qu'on ne me laisse pas partir avant samedi ou même lundi prochain. Je suis toujours malade, je ne me lève pas tous les jours, et il fait un froid terrible. Et tout ce temps se perd..... et j'ai tant de mois encore à dévorer!....
Oui, mon cher ami, je dois vous faire un mystère d'un chagrin affreux que j'éprouverai peut-être longtemps encore; il tient à des circonstances de ma vie qui sont complétement ignorées de tout le monde (C..... excepté); j'ai au moins la consolation de le lui avoir appris sans que..... (assez).
Quoique je sois forcé d'être mystérieux avec vous sur ce point, je ne crois pas que vous ayez de raison de l'être avec moi sur d'autres. Je vous supplie donc de me dire ce que vous entendez par cette phrase de votre dernière lettre: «Vous voulez faire un sacrifice; il y a longtemps que j'en crains un que, malheureusement, j'ai bien des raisons à croire que vous ferez un jour.» Quel est celui dont vous voulez parler? Je vous en conjure, dans vos lettres, ne parlez jamais à mots couverts, surtout quand il s'agit d'elle. Cela me torture. N'oubliez pas de me donner franchement cette explication.
Écrivez-moi poste restante, à Rome, en ayant soin d'affranchir jusqu'à la frontière, sans quoi la lettre ne me parviendrait pas.
A MM. GOUNET, GIRARD, HILLER, DESMAREST, RICHARD, SICHEL.
Nizza, le 6 mai 1831.
Allons Gounet[58], lisez-nous cela.
D'abord je vous embrasse tous; je me réjouis de vous revoir encore, de me retrouver auprès d'amis dont l'affection m'est si chère, de parler ensemble musique, enthousiasme, génie, poésie enfin. Je suis sauvé, je commence à m'apercevoir que je renais meilleur que je n'étais, je n'ai même plus de rage dans l'âme... Comme je ne vous ai pas écrit depuis mon départ de la France, il faut que je vous conte mon voyage.
Je me suis embarqué à Marseille sur un brick sarde, faisant voile pour Livourne. Ce trajet se fait ordinairement en cinq jours avec un temps passable, et nous en avons mis onze. Pendant la première semaine, nous étions accablés de calmes plats qui duraient tous les jours jusqu'au coucher du soleil; ce n'était que pendant la nuit que nous avancions un peu. Ne sachant comment nous désennuyer, nous avions imaginé de tirer au pistolet sur le pont. La cible était un biscuit fiché au bout d'un bâton qu'on avait attaché à la poupe, et que l'oscillation du navire rendait très difficile à atteindre. Tel était notre passe temps. Mes compagnons de voyage étaient des militaires italiens, accourant à Modène prendre part à la révolution qui venait d'y éclater. Arrivés dans la rivière de Gênes, un vent furieux des Alpes nous a assaillis tout à coup; les vagues entraient par les écoutilles et couvraient le pont à tout instant. Bon! disais-je, cela manquait, il serait bien dommage que je n'eusse pas aussi mon petit bout de tempête; ce sera charmant!... Mais le charme est devenu un peu fort, comme vous allez voir.
Le capitaine, voulant regagner le temps perdu, avait laissé toutes les voiles étendues, et le vaisseau, pris en flanc par le vent, penchait horriblement sur le côté. Le soir, comme j'étais dans la chambre, à essayer de dormir, j'entends la voix d'un de nos passagers qui criait aux matelots: Coraggio, corpo di Dio! sara niente. «Diable, dis-je, il paraît au contraire que c'est beaucoup.» Je m'enveloppe alors dans mon manteau, et je monte sur le pont, suivi de quatre officiers épouvantés de ce que nous venions d'entendre.
J'avoue qu'il est difficile de s'imaginer un pareil spectacle et que, malgré le peu de cas que je faisais alors de la vie, le cœur commença à me battre d'une terrible manière. Figurez-vous le vent rugissant avec une furie dont on ne peut avoir d'idée à terre, les vagues enlevées de la mer, lancées en l'air, d'où elles retombaient en poussière, le vaisseau tellement penché que son bord droit était en entier dans l'eau, et, avec cela, quatorze voiles immenses étendues, où le vent s'engouffrait de plein vol. Le passager que nous avions entendu crier tout à l'heure était un capitaine-corsaire vénitien, et même, ce qui est curieux, il avait été le capitaine de la corvette que lord Byron fit armer à ses frais pour parcourir l'Archipel; c'est ce qu'on appelle un crâne. Au bout de quelques minutes, le vent augmentant encore de rage, je l'entends qui dit en français: «Ce b....-là va nous faire sombrer avec toutes les voiles.» Alors je vis qu'il fallait prendre son parti, et le cœur cessa de me battre plus vite qu'à l'ordinaire. Je regardai tout à coup avec la plus grande indifférence ces vallées blanches ouvertes devant moi, où j'allais sans doute être bercé pour mon dernier sommeil; le pont était tellement incliné, qu'il était impossible de s'y tenir debout; j'étais cramponné à un morceau de fer de tribord et entortillé dans mon manteau, de manière à ne pouvoir remuer les membres; j'avais pensé m'épargner une longue agonie en m'empêchant de nager, et j'espérais couler bas comme une pièce de canon.
Enfin, le danger devenant de plus en plus imminent, notre corsaire vénitien prend sur lui de commander la manœuvre: Tutti, tutti, al perrochetto, s'écria-t-il, prestissimo al perrochetto; ecco la borresca. Les matelots lui obéissent; mais, pendant qu'ils se précipitent sur le grand mât pour carguer les voiles, un dernier effort du vent nous couche presque entièrement sur le côté. Alors la scène est devenue sublime d'horreur; tous les meubles qui garnissaient l'intérieur du navire, les armoires, les tables, les chaises, les ustensiles de cuisine s'écroulent avec un fracas épouvantable; sur le pont, les tonneaux roulent les uns sur les autres, l'eau entre par torrents, le vaisseau craque comme une vieille coquille de noix, le pilote tombe et lâche le gouvernail; enfin nous sombrons. Mais nos matelots intrépides n'en continuaient pas moins au haut de la vergue à plier précipitamment les voiles, et il s'est trouvé que la plus grande était carguée justement dans l'instant où le vaisseau revenait un peu sur lui-même, ce qui a rendu la seconde oscillation moins basse; le gouvernail lâché par le pilote a permis au vaisseau de tourner et de se présenter au vent dans sa longueur; ce court instant a suffi pour nous tirer d'affaire.
Alors il a fallu courir à la pompe, c'étaient des cris à devenir fou; ensuite, pour compléter la détresse, la lanterne de la chambre s'était cassée et, en tombant sur des ballots de laine, y avait mis le feu. En voyant la fumée sortir par l'escalier, on s'en est aperçu; l'enfer n'est pas pire qu'un pareil moment. Heureusement pour moi, je n'ai pas le mal de mer, mais il fallait voir ces pauvres passagers se vomissant les uns sur les autres, tombant dans l'escalier, sur le pont, saisis de vertiges affreux; cela faisait mal. Le navire une fois remis, nous avons cheminé avec une seule voile et sans la moindre inquiétude, malgré la force de l'orage et l'inclinaison du vaisseau. C'était alors un autre concert, le vent sifflant dans les cordages nus, dans les poulies et les haubans, ricanait, grinçait comme un orchestre de petites flûtes; mais le matelot qui était à côté de moi disait: Oh! adesso, mi futto del vento! et, en effet, nous sommes arrivés le matin même à Livourne, sans accident. Oh! quelle nuit! et la lune qui nous regardait en courant à travers les nuages, avec une physionomie toute décomposée! elle semblait pressée d'arriver quelque part et ennuyée de nous trouver sur son passage.
Arrivé à Rome, j'ai trouvé que les bruits qu'on avait répandus à Florence sur les dangers que courait l'Académie étaient un peu exagérés, mais fondés. Les Transteverini, supposant les Français partisans de la révolution et hostiles au pape, voulaient tout simplement mettre le feu à l'Académie et nous égorger tous. Ils étaient déjà venus plusieurs fois examiner les avenues du jardin, et madame Horace en avait rencontré un dans une allée, qui l'avait menacée d'un long couteau qu'il montrait sous son manteau. Aussi notre directeur avait-il armé tout le monde de fusils à deux coups, pistolets, etc... Pourtant il n'est rien résulté de tout cela qu'une tarentelle que les Transteverini ont composée sur la mort prochaine des Français, et qu'ils venaient chanter sous nos fenêtres. Tous les camarades qui m'attendaient m'ont reçu avec la cordialité la plus franche; il m'a fallu quatre ou cinq jours pour retenir les noms de chacun, et, comme on se tutoie, j'étais obligé de dire à tout instant à quelqu'un: «Comment t'appelles-tu donc, toi?»
De M. Horace et de sa famille j'ai reçu un très-bon accueil; mais, quand le vieux Carle Vernet a su que j'admirais Gluck, il n'a plus voulu me quitter: «C'est que, voyez-vous, me disait-il, M. Despréaux prétendait que tout cela était rococo, et que Gluck était perruque.»
J'ai trouvé Mendelssohn; Monfort le connaissait déjà, nous avons été bien vite ensemble. C'est un garçon admirable, son talent d'exécution est aussi grand que son génie musical, et vraiment c'est beaucoup dire. Tout ce que j'ai entendu de lui m'a ravi; je crois fermement que c'est une des capacités musicales les plus hautes de l'époque. C'est lui qui a été mon cicerone; tous les matins, j'allais le trouver il me jouait une sonate de Beethoven, nous chantions Armide de Gluck, puis il me conduisait voir toutes les fameuses ruines qui me frappaient, je l'avoue, très-peu. Mendelssohn est une de ces âmes candides comme on en voit si rarement; il croit fermement à sa religion luthérienne, et je le scandalisais quelquefois beaucoup en riant de la Bible. Il m'a procuré les seuls instants supportables dont j'aie joui pendant mon séjour à Rome. L'inquiétude me dévorait, je ne recevais point de lettre de ma fidèle fiancée, et sans M. Horace, je serais parti au bout de trois jours, tant j'étais désespéré de n'avoir point trouvé de ses nouvelles à mon arrivée. A la fin du mois, n'en recevant pas davantage, je suis parti le vendredi saint, abandonnant ma pension pour aller savoir à Paris ce qui s'y passait. Mendelssohn ne voulait pas croire que je partisse réellement, il paria avec moi un dîner pour trois que je ne partirais pas, et nous le mangeâmes avec Monfort le mercredi saint, quand il vit que M. Horace m'avait payé mon voyage et que j'avais retenu ma voiture.
A Florence, le mal de gorge m'a pris; je me suis arrêté; il m'a fallu attendre de pouvoir me remettre en route; alors j'ai écrit à Pixis pour qu'il me dise au plus vite ce qu'il y avait au faubourg Montmartre; il ne m'a pas répondu; je lui mandais que j'attendais sa lettre à Florence, et effectivement je l'ai attendue jusqu'au jour où j'ai reçu l'admirable lettre de madame X... Il m'est impossible de dépeindre ce que j'éprouvais dans mon isolement, de fureur, de rage, de haine et d'amour combinés. J'étais tout à fait rétabli; je passais des journées sur le bord de l'Arno, dans un bois délicieux à une lieue de Florence, à lire Shakspeare. C'est là que j'ai lu pour la première fois le Roi Lear et que j'ai poussé des cris d'admiration devant cette œuvre de génie; j'ai cru crever d'enthousiasme, je me roulais (dans l'herbe à la vérité), mais je me roulais convulsivement pour satisfaire mes transports. L'ennui est revenu au bout de quelques jours; je me rongeais le cœur, et mes pensées qui ne se sont trouvées que trop justes, me poursuivaient impitoyablement. Un soir, la cathédrale étant ouverte, j'y suis entré; comme je rêvais assis dans un coin de la nef, je vis sortir de la sacristie une longue file de pénitents blancs, de prêtres, d'enfants de chœur portant des flambeaux avec la croix. Je demandai à un homme ce que c'était; il me répondit: Una sposina morta el mezzo giorno. Je suivis le convoi, mon sang commençait à circuler, je pressentais des sensations. La jeune femme était morte dans une superbe maison voisine, appartenant à son mari, riche Florentin qui l'adorait. Une foule immense était assemblée devant la porte pour voir enlever le catafalque. On avait distribué un grand nombre de cierges qui répandaient dans les rues obscures la plus étrange clarté. Arrivés à l'église, les prêtres font leur office, et nous abandonnent ensuite le cadavre. Il faisait tout à fait nuit; les porteurs du catafalque l'ont découvert, et j'ai vu un enfant nouveau-né qu'ils tiraient d'une petite bière, et qu'ils mettaient dans la plus grande où était sa mère. J'ai reconnu alors que la sposina était morte en couches et qu'on allait l'enterrer avec son enfant. J'ai voulu voir ce que cela deviendrait et la fantaisie m'a pris de suivre les porteurs au cimetière. Après un long trajet, durant lequel la foule des curieux s'était complétement éloignée, je suis arrivé près d'une porte éloignée de Florence; mais, au lieu d'aller au cimetière, le convoi s'est arrêté à une espèce de morgue où on dépose les morts jusqu'à deux heures du matin, où un tombereau vient les chercher pour aller en terre. Un des chantres, s'approchant de moi, me dit en français: «Voulez-vous entrer?...—Oui.» Et, en effet, me plaçant à côté de lui, pour un paolo (12 sous), il parle à l'oreille du gardien de la morgue et on me laisse entrer. Ils ont tiré de la bière la pauvre sposina et l'ont déposée sur une des tables de bois qui garnissaient cette espèce de caveau. «Voyez, monsieur, me disait mon chantre avec une espèce de joie, toutes ces tables, eh bien, il y a des jours où c'est tout plein, tout plein! et puis, à deux heures de nuit, la voiture vient et emporte tout!—Mais faites-moi donc voir cette dame!» Il l'a découverte aussitôt. Oh! Dieu! elle était charmante! Vingt-deux ans, elle avait une belle robe de percale nouée au-dessous de ses pieds, ses cheveux n'étaient pas encore trop dérangés. Sans doute elle était morte d'un dépôt dans le cerveau, une eau jaunâtre lui coulait des narines et de la bouche; je lui ai fait essuyer la figure; puis ce brutal lui a laissé retomber la tête tout d'un coup, avec un bruit sourd qui a ému toutes les tables. Je lui ai pris la main, elle avait une main ravissante, blanche; je ne pouvais la quitter. Son enfant était laid, il me faisait mal au cœur. Pour un paolo j'ai touché la main de cette belle, pendant que son mari se désespérait; si j'avais été seul, je l'aurais embrassée; je pensais à Ophelia. Pour un paolo!... et, bien sûr, à deux heures, quand le voiturier vient chercher sa proie, le Caron florentin fait payer aux morts leur passage: il ne lui aura pas laissé sa belle robe; il l'aura dépouillée; je pensais cela pendant que je lui tenais la main pour un paolo!
Mais c'était une bénédiction vraiment, car le lendemain j'ai assisté au service funèbre du jeune Napoléon Bonaparte, fils de la reine Hortense et neveu de l'autre Napoléon. Il venait de mourir à point nommé. Une condamnation capitale pesait sur lui comme révolutionnaire, elle allait l'atteindre, la mort a été plus prompte. Pendant ce temps, son frère et sa mère fuyaient en Amérique!... Pauvre Hortense! quelles vicissitudes! Il y a quarante ans, elle venait de Saint-Domingue avec sa mère Joséphine, qui n'était alors que madame Beauharnais; joyeuse créole, elle dansait la danse des nègres sur le vaisseau, et chantait aux matelots des chansons caraïbes; aujourd'hui, elle repasse l'Océan pour soustraire un de ses fils à la hache des réactions; elle laisse son mari à Florence, et voilà la fille adoptive du plus grand homme des temps modernes, fugitive de l'Europe, exilée de la France, dont elle s'était fait chérir, reine sans États ni couronne, mère désolée, orpheline, à peu près veuve, oubliée, abandonnée...
Toutes ces idées me saisissaient au cœur en entrant dans l'église. C'était bien, il me semble, un sujet d'inspiration pour l'organiste; mais cet homme n'est pas un homme! Il avait tiré le registre des petites flûtes et jouait de petits airs gais qui ressemblaient assez au gazouillement des roitelets dans les beaux jours d'hiver.
O Italiens, misérables que vous êtes, singes, orangs-outangs, pantins toujours ricanants, qui faites des opéras comme ceux de Bellini, de Pacini, de Rossini, de Vaccaï, de Mercadante, qui jouez des airs gais aux funérailles du neveu du grand homme, et qui, pour un paolo...!
C'est deux jours après et dans une telle disposition d'esprit que j'ai reçu la lettre de madame X..., la lettre où elle m'annonçait que sa fille se mariait!... Cette lettre est un modèle incroyable d'impudence! Il faut la voir pour le croire. Hiller sait mieux que personne comment toute cette affaire avait commencé; et moi je sais que je suis parti de Paris, portant au doigt son anneau de fiancée donné en échange du mien; on m'appelait: «Mon gendre», etc.,... et, dans cette lettre étonnante, madame X... me dit qu'elle n'a jamais consenti à la demande que je lui avais faite de la main de sa fille; elle m'engage beaucoup à ne pas me tuer, la bonne âme!
Oh! si je m'étais trouvé seulement de cent cinquante lieues plus près! Mais, brisons là; ce que j'ai fait et ce que j'ai voulu faire n'est pas de nature à pouvoir être confié au papier. Seulement, je vous dirai que je me trouve ici, à Nice, par suite de cette abominable, lâche, perfide et dégoûtante ignoblerie. J'y suis depuis onze jours, et j'y reste à cause de la proximité de la France et du besoin impérieux que j'éprouve de correspondre rapidement avec ma famille. Mes sœurs m'écrivent tous les deux jours; leur indignation et celle de mes parents est au comble.
Me voilà rétabli, je mange comme à l'ordinaire; j'ai demeuré longtemps sans pouvoir avaler autre chose que des oranges. Enfin, je suis sauvé, ils sont sauvés; je reviens à la vie avec délices, je me jette dans les bras de la musique et sens plus vivement que jamais le bonheur d'avoir des amis. Je vous prie tous, Richard, Gounet, Girard, Desmarest, Hiller, écrivez-moi chacun isolément une lettre. Je ne passe pas la frontière; Vernet m'a rappelé hier qu'il était encore temps et que ma pension n'était pas perdue. Je lui ai écrit que je m'engageais sur l'honneur à ne pas sortir d'Italie; j'ai profité d'un bon moment pour me lier ainsi. J'avais de bonnes raisons pour le faire.
Gounet, mademoiselle Vernet a chanté vos mélodies, et a trouvé que la poésie en était pleine de grâce et de fraîcheur.
Le théâtre allemand est-il ouvert? et Paganini?... et Euryanthe?... Ce misérable Castil-Blaze a encore mutilé cette partition en lui ajoutant des membres étrangers. Et la Symphonie avec chœurs de Beethoven, parlez-moi donc de tout cela.
Girard, allez-vous monter Iphigénie en Aulide?... Oh! à propos, je vous prie de me pardonner, j'ai perdu votre lettre pour une dame romaine; j'espère qu'elle n'était pas importante. Desmarest, que fait-on à l'Opéra?... Hiller, votre concert ne s'est donc pas donné?... Et toi, Richard, comment se fait-il que j'aie vu dans les journaux Loëve-Weimar cité comme traducteur de la Symphonie de Beethoven?... Cela me confond. Dites-moi, Gounet, Auguste le nouveau marié est-il heureux en ménage?... Mon cher Sichel, les malades donnent-ils?...
J'ai un appartement délicieux dont les fenêtres donnent sur la mer. Je suis tout accoutumé au continuel râlement des vagues; le matin, quand j'ouvre ma fenêtre, c'est superbe de voir ces crêtes accourir comme la crinière ondoyante d'une troupe de chevaux blancs. Je m'endors au bruit de l'artillerie des ondes, battant en brèche le rocher sur lequel est bâtie ma maison.
Nice, par sa position, est une petite ville vraiment charmante; fraîches et rosées sont la mer et les montagnes. Je fais quelquefois, au risque de me rompre les membres, des excursions dans les rochers; j'ai découvert l'autre jour les ruines d'une tour bâtie sur le bord du précipice; il y a une petite place devant, je m'y étends au soleil et je vois arriver au large de lointains vaisseaux, je compte les barques de pêcheurs et j'admire ces petits sentiers rayonnants et dorés, qui (à ce que dit M. Moore) doivent conduire à quelque île «heureuse et paisible». C'est, parbleu! en nature le sujet de la lithographie de nos mélodies; Gounet, c'est tout à fait cela. A propos de lithographie, ils ont fait mon portrait à Rome; il ne vaut rien; mais un sculpteur a fait ma médaille, et fort ressemblante, en plâtre de demi-grandeur.
Allons, en voilà assez, je pense. J'attends vos lettres au plus tôt. Je demeure: H. B., chez madame veuve Pical, maison Cherici, consul de Naples, aux Ponchettes, Nice-Maritime.
Adieu tous! adieu mille fois!
Votre affectionné et sincère ami.
P.-S.—Mille choses à Pixis, à Sina, à Schlesinger, à Séghers, à M. Habeneck, à Turbri, à Urhan.
J'ai presque terminé l'ouverture du Roi Lear; je n'ai plus que l'instrumentation à achever. Je vais beaucoup travailler.
A FERDINAND HILLER.
Rome, 17 septembre 1831
Mon cher ami,
J'ai reçu votre lettre dans les montagnes de Subiaco, longtemps après qu'elle était arrivée à Rome; encore l'aurais-je attendue bien davantage, si un sculpteur de l'Académie ne l'eût apportée. Je ne pouvais concevoir votre silence, je ne vous croyais pas paresseux. Bon, bon, assez! Êtes-vous toujours dans votre ermitage du bois de Boulogne? Je vais retourner dans le mien à Subiaco; rien ne me plaît tant que cette vie vagabonde dans les bois et les rochers, avec ces paysans pleins de bonhomie, dormant le jour au bord du torrent, et le soir dansant la saltarelle avec les hommes et les femmes habitués de notre cabaret. Je fais leur bonheur par ma guitare; ils ne dansaient avant moi qu'au son du tambour de basque, ils sont ravis de ce mélodieux instrument. J'y retourne pour échapper à l'ennui qui me tue ici. Pendant quelques jours, je suis venu à bout de le surmonter en allant à la chasse; je partais de Rome à minuit pour me trouver sur les lieux au point du jour; je m'éreintais, je mourais de soif et de faim, mais je ne m'ennuyais plus. La dernière fois, j'ai tué seize cailles, sept oiseaux aquatiques, un grand serpent et un porc-épic.
La campagne des environs de Rome est si sévère et si majestueuse, le soir surtout! Toutes les ruines de palais, de temples éclairés par le soleil couchant, sur un sol nu comme la main, sans arbres, creusé de profonds ravins, forment le tableau le plus pittoresque et le plus sombre. Le matin, j'ai déjeuné sur une vieille citerne ou tombeau étrusque; j'ai dormi à midi dans le temple de Bacchus, mais je n'avais que de l'eau pour lui faire des libations; j'espère que le vainqueur du Gange me pardonnera cette offrande indigne de lui!
Eh bien, vous avez donc eu la complaisance de vous nantir de ma médaille et de quelques brimborions d'or! Ainsi, comme tout cela vaut près de deux cents francs, si je meurs du choléra avant de retourner en France, ma petite dette d'argent sera payée. En a-t-on bien peur à Paris de ce fameux choléra?...
Mendelssohn est-il arrivé?... C'est un talent énorme, extraordinaire, superbe, prodigieux. Je ne suis pas suspect de camaraderie en en parlant ainsi, car il m'a dit franchement qu'il ne comprenait rien à ma musique. Dites-lui mille choses de ma part; il a un caractère tout virginal, il a encore des croyances; il est un peu froid dans ses relations, mais, quoiqu'il ne s'en doute pas, je l'aime beaucoup.
AU MÊME.
Rome, 8 décembre 1831.
Mon cher Hiller,
Quoique vous soyez un paresseux, un drôle, un vilain, comment n'avez-vous pas honte de me laisser sans signe de vie de votre part, sans réponse à ma dernière lettre? (Ma foi, j'ai oublié la conclusion de mon quoique!)
Enfin, n'importe, j'arrive de Naples il y a un mois; j'ai fait le voyage à pied à travers les montagnes, les bois, les rochers, sans guide, excepté le dernier jour pour arriver à Subiaco, mon village chéri. Il serait trop long de vous parler des torrents de sensations magiques que m'ont fait éprouver Naples, le Vésuve, Pompéi, la mer, les îles, nous parlerons de tout cela. Ce qui vaut beaucoup mieux, c'est que je serai à Paris peut-être plus tôt que vous ne pensez, mais certainement plus tôt que notre directeur ne pense.
Allons donc, voilà un succès! Robert le Diable a fait merveilles. Allez, je vous prie, de ma part, chez M. Meyerbeer lui faire mon sincère compliment, ou du moins l'assurer de la joie vive que m'a fait éprouver la réussite brillante de son grand ouvrage. J'en ai passé une nuit blanche après la lecture des journaux. Le sang me bout dans les veines. Cinq cent mille malédictions! faut-il que je sois ici claquemuré, dans ce pays morne et antimusical, pendant qu'à Paris on joue la Symphonie avec chœurs, Euryanthe et Robert, et pendant que les ouvriers de Lyon s'amusent comme des diables! Je me serais peut-être trouvé à Lyon aussi, et j'en aurais pris ma part. Cependant il paraît que les Anglais de Bristol se sont encore mieux amusés; du moins leur ouvrage a fait bien plus d'impression: cela avait plus de caractère.
Seriez-vous capable de marcher contre ces pauvres diables, dont le tour de jouir de la vie vient seulement d'arriver? Ce serait bien mal à vous, de toutes manières. Parlons d'affaires. Veuillez aller trouver M. Réty au Conservatoire et lui demander de prendre dans ma musique la Cantate de la Mort d'Orphée. Je la lui avais demandée, mais Prévost, qui devait l'apporter, paraît ne pas devoir venir. Vous la prendrez donc et vous me ferez copier sur papier à lettre la dernière page de la partition, l'adagio con tremulandi, qui succède à la Bacchanale; puis vous le mettrez sous enveloppe à la poste. J'en ai besoin absolument.
Adieu! si vous me faites attendre une réponse, je vous voue à la Providence.
AU MÊME.
Rome, 1er janvier 1832.
Ah! vous ne m'aviez pas écrit parce que vous vous êtes mis dans vos meubles! voilà une exquise raison! Il valait mieux me dire: «parce que je suis à Paris, et qu'à Paris on oublie le reste du monde».—Enfin, n'en parlons plus; je pense que vous aurez reçu la petite lettre que j'ai envoyée pour vous à Schlesinger, ne sachant pas votre adresse, et que vous ne me ferez pas attendre le petit morceau que je vous prie de me faire parvenir. J'avais vu un compte rendu dans le Globe, qui vous a fait un assez bon article, mezzo philanthropico-mystique, et qui prétend que vous sortez du Conservatoire de Paris. Je n'ai rien vu dans les autres journaux; M... était sans doute trop occupé à décrire quelque nouvelle roulade ou trille de madame Malibran, ou à expliquer l'accord d'un second et d'un troisième cor dans Robert le Diable, pour s'amuser à une vétille comme votre concert.
Nous aurions été bien flattés de voir le jugement que ce gigot fondant aurait laissé tomber du haut de sa succulence sur vos nouvelles productions. Il comprend si bien la poésie de l'art, ce Falstaff!... Patience, je lui ai taillé des croupières (comme on dit en Dauphiné) dans un certain ouvrage dont je vous prie de ne pas parler et dans lequel j'ai lâché l'écluse à quelques-uns des torrents d'amertume que mon cœur contenait à grande peine. Cela fera, au jour de l'exécution, l'effet d'un pétard dans un salon diplomatique. Je ne vous en avais rien dit, parce que vous savez que je n'aime pas à vous parler de ce que je fais, jusqu'au moment de la mise au monde de l'ouvrage. Ce n'est pas, comme vous me faites l'amitié de le supposer, parce que j'ai peur que vous ne me fassiez un vol intellectuel (gros scélérat!!), mais bien parce que je veux suivre tout droit le chemin de mon caprice, de ma fantaisie, dût-il me conduire dans quelque bourbier obscur, et que l'impression bonne ou mauvaise, produite sur vous par des épreuves anticipées de l'ouvrage, se reflétant sur moi, me distrairait en mal de ma première direction, ou ralentirait l'élan de ma course. Voilà!
Vous voulez savoir ce que j'ai fait depuis mon arrivée en Italie; 1º ouverture du Roi Lear (à Nice); 2º ouverture de Rob-Roy, Mac Gregor (esquissée à Nice, et que j'ai eu la bêtise de montrer à Mendelssohn, à mon corps défendant, avant qu'il y en eût la dixième partie de fixée). Je l'ai finie et instrumentée aux montagnes de Subiaco; 3º Mélologue en six parties, paroles et musique; composé par monts et par vaux en revenant de Nice, et achevé à Rome. Puis, quelques morceaux vocaux, détachés, avec et sans accompagnement: 1º un chœur d'anges pour les fêtes de Noël; 2º un chœur de toutes les voix, improvisé (comme on improvise) au milieu des brouillards, en allant à Naples, sur quatre vers que je fis pour prier le soleil de se montrer; 3º un autre chœur sur quelques mots de Moore avec accompagnement de sept instruments à vent; composé à Rome, un jour que je mourais du spleen, et intitulé: «Psalmodie pour ceux qui ont beaucoup souffert et dont l'âme est triste jusqu'à la mort.»
Voilà tout.
A présent, je ne fais que copier des parties et écrire un grand article sur l'état actuel de la musique en Italie, qui m'a été demandé de Paris pour la Revue européenne; si vous le lisez, vous le verrez sans doute d'ici à deux mois; le journal n'étant que mensuel, cela ne paraîtra pas plus tôt... Eh bien, oui, je suis allé à Naples, c'est superbe; j'en suis revenu à pied, ce que vous savez déjà, en traversant jusqu'à Subiaco les montagnes des frontières, couchant dans des repaires ou capitales de bandits, dévoré de puces, et mangeant des raisins volés ou achetés le long de la route pendant le jour, et, le soir, des œufs, du pain et des raisins; après deux jours de repos à Subiaco, où j'ai trouvé un de mes camarades de l'Académie qui m'a prêté une chemise dont j'avais grand besoin, je suis parti, toujours à pied, pour Tivoli, et de là à Rome.
Voilà encore.
Mille choses à Mendelssohn, dont nous parlons bien souvent chez M. Horace. Madame Fould m'a fait entendre dernièrement, chez elle, la symphonie qu'il fit exécuter à Londres, et qu'il a dérangée pour violon, basse et piano à quatre mains. Le premier morceau est superbe, l'adagio ne m'est pas resté bien net dans la tête, l'intermezzo est frais et piquant; le final, entremêlé de fugue, je l'abomine. Je ne puis pas comprendre qu'un pareil talent puisse se faire tisserand de notes dans certains cas comme il l'a fait, mais lui le comprend. C'est toujours la même histoire; il n'y a pas de beau absolu, et je trouve que vous avez bien de la bonté d'établir des discussions à mon sujet avec Mendelssohn.
Voulez-vous prouver à quelqu'un qu'il a tort d'être impressionné de telle manière plutôt que de telle autre?... Il n'y a pas plus de tort réel qu'il n'y a de crime, de vice ou de vertu: tout n'est que relation ou convention. Je suis sot de vous dire cela, je pense bien que vous n'en êtes plus à avoir encore les idées contraires: ce sont de vieux lambeaux de langes que vous devez avoir secoués à présent pour jamais.
Vous avez (toujours suivant moi) bien fait de conserver votre adagio et de le mettre en ut; ce morceau-là est plein de délicatesse. Il paraît que vous n'avez pas écrit de menuet, j'en suis charmé; il n'en faut plus, on a usé cela.
Je relis votre lettre: Comment! si j'irai en Allemagne?—Êtes-vous fou? Certainement; je passerai à Wesserling voir Th. Schlösser, puis à Francfort si vous y êtes, puis enfin à Berlin. Mais auparavant je passerai à Paris lâcher deux ou trois bordées musicales à la fin de l'année. Je partirai de Rome dans trois mois et m'arrangerai de manière à passer en France le reste de mon temps d'Italie, ce qui m'économisera un peu d'argent. Mais je ne dis pas cela à M. Horace, auquel je serai obligé de faire un conte, un mensonge bien serré pour pouvoir m'évader.
Dieu vous soit en aide!
Mes amitiés à Gounet, mais sans impiétés, parce que cela l'oppresse, ce qui est contre ma volonté bien nette. Je lui souhaite, pour son nouvel an, une augmentation d'appointements, de grade, d'argent, d'honneurs, et une indifférence radicale pour la politique.—Pour tous les autres, comme ils ne m'ont pas donné signe de vie, je leur souhaite une plume bien taillée et un peu moins de paresse à s'en servir.
AU MÊME.
Rome, 16 mars 1832.
Eh! oui, damnation, il y a de quoi être en colère!
Qui diable vous empêche de mettre la main à la plume? Vous voilà bien avancé! Par un retard inouï de la poste, je reçois à l'instant votre lettre datée du 17 février; elle a mis un mois pour m'arriver. Je suis malade, toujours du gracieux mal de gorge qui me tuera si je lui en laisse le temps; je me précipite hors de mon lit, après avoir lu votre lettre, pour y répondre. Je ne sais si ma réponse sera assez tôt à Paris; dans tous les cas, je vous adresse un mot chez votre père, à Francfort.
En fait d'argent, je puis, je le crois, vous payer cet été, à moins que M. Horace ne s'oppose à ce que je touche ma pension en bloc en quittant Rome; mais voilà qui vaut mieux: vous avez le paquet qu'on vous a adressé, ouvrez-le, je vous y autorise. Seul et discret, prenez ma médaille qui doit y être et vendez-la chez le changeur du passage des Panoramas; elle vaut deux cents francs, peut-être plus. Dépêchez-vous et écrivez-moi tout de suite à Florence, poste restante; je pars le 1er mai de Rome.
Vous quittez donc Paris! Mendelssohn aussi! Quand j'arriverai, je n'y trouverai personne; je m'étais accoutumé à l'idée de cette réunion; j'y retomberai dans une solitude musicale que mes autres amis ne pourront combler! Quand je dis mes autres, je devrais dire mon autre; car, excepté le bon Gounet, il n'y a rien. Cela me fait mal dans le cœur; notre fleur s'effeuille, je suis disposé plus que jamais aux affections tristes, et j'ai la bêtise d'en pleurer. Où voulez-vous que je vous retrouve!... je n'entrerai en Allemagne qu'en 1833. Je ne peux pas me mettre à votre poursuite, car ce serait une raison pour ne pas vous atteindre. Et puisque votre plume est si lourde pour vous, je ne dois guère compter sur des nouvelles de vos voyages. Eh bien, allez, ce n'est qu'une continuation de la même charge; voyons comment nous la supporterons!
Je remercie Mendelssohn de son souvenir et de ses quelques lignes; les sentiments que je voudrais lui exprimer sont trop tumultueusement confus en moi aujourd'hui pour que je l'essaie. Je reviens encore des montagnes où j'ai passé dix jours de vagabondage dans la neige et la glace, mon fusil à la main. Sans ma damnée gorge, j'y serais déjà retourné. J'en ai rapporté entre autres choses une petite orientale de Hugo[59], pour une voix et piano. Ce petit morceau a un succès incroyable; on en prend des copies partout, chez M. Horace, chez madame Fould, chez l'ambassadeur, chez des Français de leur connaissance, etc.; tous les pensionnaires de l'Académie me cornent ce malheureux morceau, à table, dans les corridors, au jardin; ils commencent à me le faire suer; il n'y a pas jusqu'à M. Horace qui ne le chante. Ah! pour le paquet en question, j'oubliais, remettez-le à Gounet.
En quittant Rome, j'irai visiter l'île d'Elbe et la Corse, pour me gorger de souvenirs napoléoniens; j'espère ne pas trouver de belle occasion pour l'autre île, car je serais capable de succomber à la tentation.
Qu'il est grand là surtout! quand, puissance brisée,
Des porte-clefs anglais misérable risée,
Au sacre du malheur il retrempe ses droits,
Tient au bruit de ses pas deux mondes en haleine
Et, mourant de l'exil, gêné dans Sainte-Hélène,
Manque d'air dans la cage où l'exposent les rois!
Oh!!!!!!!!
Enfin! après tout, je serai à Paris au mois de novembre et de décembre, nous pourrons encore nous y voir; mais Mendelssohn n'y sera pas. Alors je le reverrai à Berlin, ou je ne le reverrai pas. Comme toujours, j'ai su par une lettre plus jeune que la vôtre, qu'on avait donné au Conservatoire la ravissante ouverture du Songe d'une nuit d'été. On en parle avec admiration, il n'y a pas de fugue là dedans.
Adieu... adieu... adieu...
Souviens-toi de moi!
(Shakspeare, Hamlet.)
Je vais me recoucher, je meurs de froid.
AU MÊME.
Florence, 13 mai 1832.
Je suis arrivé hier. Je viens de la poste, où je n'ai trouvé que votre lettre seule, au lieu de trois ou quatre que je comptais y avoir. Aussi votre exactitude ressort-elle cette fois avec avantage. Mais, étourneau que vous êtes! pourquoi oublier tant de choses?... Vous ne me dites pas même si le prix de l'illustre médaille a suffi pour faire les deux cents francs que je vous devais; vous oubliez aussi de me dire un mot de ce bon Gounet, et si c'est à lui que vous avez remis le paquet de l'hippopotame.
J'ai laissé Rome sans regret; la vie casernée de l'Académie m'était de plus en plus insupportable. Je passais toutes mes soirées chez M. Horace, dont la famille me plaît beaucoup, et qui, à mon départ, m'a donné tout entières des marques d'attachement et d'affection, auxquelles j'ai été d'autant plus sensible que je m'y attendais moins. Mademoiselle Vernet est toujours plus jolie que jamais, et son père toujours plus jeune homme. J'ai revu Florence avec émotion. C'est une ville que j'aime d'amour. Tout m'en plaît, son nom, son ciel, son fleuve, ses environs, tout, je l'aime, je l'aime... J'y ai renouvelé connaissance avec un ancien élève de Choron, Duprez, qui est ici le chanteur à la mode, qui gagne quinze mille francs au théâtre de la Pergola, et qui, par-dessus le marché, a un grand et un vrai talent, une voix délicieuse et juste, et sait la musique. Il n'est pas acteur comme Nourrit, mais chante mieux, et sa voix a quelque chose de plus naïf et de plus original dans le timbre. Il fera fureur à Paris dans quelques années, j'en suis sûr. Il avait chanté à mon premier concert, avant que vous fussiez à Paris. Hier soir, dans un entr'acte, nous nous sommes remémoré cette époque de notre connaissance avec un certain plaisir. Nous avons depuis lors avancé tous les deux; avancé de quelques pas, moi de six ou sept, et lui de trente ou quarante.
Je ne vais pas à l'île d'Elbe ni en Corse; il y a actuellement des règlements sanitaires, des quarantaines qui me vexeraient. Dans trois jours, je pars pour Milan; j'y resterai au plus une semaine; de là, j'irai droit chez ma sœur à Grenoble, puis à la Côte Saint-André (Isère), où vous m'adresserez vos lettres. Je retrouverai à Milan un de vos compatriotes, homme de talent, M. de Sauër, que j'ai connu à Rome. Il m'a dit vous avoir vu enfant à Vienne. Il connaît beaucoup Mendelssohn et Bellini. Il veut absolument me lier avec Bellini, ce que je refuse de toutes mes forces; la Sonnambula, que j'ai vue hier, redouble mon aversion pour une pareille connaissance. Quelle partition!! Quelle pitié!!! Les Florentins mêmes l'ont chutée et sifflée. C'est cependant bien bon pour eux. Oh! mon cher, il vous faut voir l'Italie pour vous douter de ce qu'ils osent nommer musique dans ce pays-là!...
J'irai à Paris au mois de novembre ou de décembre; jusque-là, je ne sortirai guère du midi de la France. Je vous remercie de votre invitation pour Francfort, je ne sais quand j'en profiterai, mais ce sera tôt ou tard.
Adieu, mon bon et très-cher ami. Je vous embrasse tendrement.
P.-S.—Si je savais l'adresse de Richard, je lui écrirais; il est trop paresseux pour que je compte sur la lettre de lui que vous m'annoncez.
P.-S.—Voilà une sotte et froide lettre, je suis tout triste. Chaque fois que j'ai revu Florence, j'ai ressenti un trouble intérieur, un bouillonnement confus que je puis à peine m'expliquer. Je n'y connais personne... Il ne m'y est jamais arrivé d'aventure... J'y suis seul comme j'étais à Nice... C'est peut-être pour cela qu'elle m'affecte d'une façon si étrange. C'est tout à fait bizarre. Il me semble que, quand je suis à Florence, ce n'est plus moi, mais quelque individu étranger, quelque Russe ou quelque Anglais qui se promène sur ce beau quai de l'Arno. Il me semble que Berlioz est autre part et que je suis une de ses connaissances. Je fais le dandy, je dépense de l'argent, je me pose sur la hanche comme un fat. Je n'y comprends rien
What is it?...
A MADAME HORACE VERNET, A ROME.
La Côte Saint-André, 25 juillet 1832.
C'est une situation aussi neuve qu'agréable, madame, que celle où vous avez bien voulu me placer. Une femme d'esprit m'autorise à lui adresser mes divagations et veut bien perdre son temps à les lire, sans trop en voir le côté ridicule. Il est peu généreux à moi d'en profiter, je le sens, mais qui n'a pas son grain d'égoïsme?... je n'en suis pas exempt; aussi, toutes les fois qu'une tentation de ce genre viendra m'assaillir, je m'empresserai d'y succomber.—Je l'eusse fait plus tôt, impatient comme je le suis de recevoir de vos nouvelles, si, en descendant les Alpes, je n'avais été pris au bond et renvoyé comme un ballon de villa en villa dans tous les environs de Grenoble. Les parents, les amis à revoir, les curiosités à satisfaire, les récits de Rome, de Naples, du Vésuve, à varier tant bien que mal, m'ont occupé continuellement, tantôt d'une façon bien douce, tantôt de la manière la plus cruellement fastidieuse.
Je craignais, en arrivant en France, d'avoir à retourner le vers de Voltaire en m'avouant que «plus je vis l'étranger moins j'aimai ma patrie»; mais il n'en a rien été, et les souvenirs du royaume de Naples sont demeurés impuissants contre l'aspect riant, varié, frais, riche, pittoresque, beau de masses, beau de détails, de notre admirable vallée de l'Isère. Je l'ai revue dans son meilleur moment; la coquette semblait s'être mise en frais d'atours extraordinaires pour me prouver, à mon retour, qu'elle n'avait rien à envier aux beautés étrangères.
Il n'en a pas été de même dans la comparaison que je n'ai pu m'empêcher d'établir entre la société que je voyais le plus habituellement à Rome et celle que je retrouvais après ma longue absence. Cette fois, l'avantage est resté tout entier aux beautés éloignées, sinon étrangères, et le proverbe «les absents ont tort», m'a paru complétement faux.
Malgré tous mes efforts pour détourner la conversation de pareils sujets, on s'obstine à me parler art, musique, haute poésie; et Dieu sait comme on en parle en province!... des idées si étranges, des jugements faits pour déconcerter un artiste et lui figer le sang dans les veines, et par-dessus tout le plus horrible sang-froid. On dirait, à les entendre causer de Byron, de Gœthe, de Beethoven, qu'il s'agit de quelque tailleur ou bottier, dont le talent s'écarte un peu de la ligne ordinaire; rien n'est assez bon pour eux; jamais de respect ni d'enthousiasme; ces gens-là feraient volontiers de feuilles de rose la litière de leurs chevaux. De sorte que, vivant au milieu du monde, je demeure dans le plus profond et le plus cruel isolement. Puis j'étouffe par défaut de musique; je n'ai plus à espérer le soir le piano de mademoiselle Louise, ni les sublimes adagios qu'elle avait la bonté de me jouer, sans que mon obstination à les lui faire répéter pût altérer sa patience ou nuire à l'expression de son jeu. Je vous vois rire, madame; vous dites, sans doute, que je ne sais ni ce que je veux ni où je voudrais être, que je suis à demi fou. A cela je vous répondrai que je sais parfaitement bien ce que je veux, mais que, pour ma mezza pazzia, comme on s'accorde assez généralement à m'en gratifier et que dans beaucoup de circonstances il y a un grand avantage à passer pour fou, j'en prends facilement mon parti. Mon père avait imaginé ces jours-ci un singulier moyen de me rendre sage. Il voulait me marier. Présumant, à tort ou à raison, sur des données à lui connues, que ma recherche serait bien accueillie d'une personne fort riche, il m'engageait très-fortement à me présenter, par la raison péremptoire qu'un jeune homme qui n'aura jamais qu'un patrimoine d'une centaine de mille francs ne doit pas négliger l'occasion d'en épouser trois cent mille comptant, et autant en expectative. J'en ai ri pendant quelque temps, comme d'une plaisanterie; mais, les instances de mon père devenant plus vives, j'ai été obligé de déclarer fort catégoriquement que je me sentais incapable d'aimer jamais la personne dont il s'agissait et que je n'étais à vendre à aucun prix. La discussion s'est terminée là; mais j'en ai été désagréablement affecté, je me croyais mieux connu de mon père. Au fond, madame, ne me donnez-vous pas raison?...
Après une maladie de Marie-Louise, l'empereur dit à M. Dubois, qui l'avait soignée: «Que vous faut-il, Dubois? de l'argent ou des honneurs.—Sire, de l'argent et des honneurs.» Si pareille question m'était adressée: «Voulez-vous de l'argent, de l'amour ou de la liberté...?», je dirais bien aussi: «De la liberté, de l'amour et de l'argent.» Mais, comme ce ne sera jamais à un Napoléon que je ferai semblable réponse, je renoncerai toujours à l'argent pour garder ou obtenir l'un des deux autres, quelque Vanloo que cela soit. J'aurais bien voulu envoyer à mademoiselle Louise quelque petite composition dans le genre de celles qu'elle aime; mais ce que j'avais écrit ne me paraissant pas digne d'exciter le sourire d'approbation du gracieux Ariel, j'ai suivi le conseil de mon amour-propre et je l'ai brûlé. Je crains de ne pas être plus heureux de longtemps, car, au lieu de composer, je suis forcé de copier moi-même les parties d'un nouvel ouvrage que je donnerai à Paris au mois de décembre, si l'émeute et le choléra veulent bien le permettre. Vous avez eu la bonté, madame, de me faire espérer pour cette occasion des lettres d'introduction auprès de mademoiselle Allard et de madame Duchambge, et ce que vous m'avez dit de ces deux dames me fait attacher beaucoup de prix à faire leur connaissance. Mon passage à Paris n'aura lieu qu'à la fin de l'année, ainsi que je m'y suis engagé envers M. Horace, et, immédiatement après avoir lâché ma bordée vocale et instrumentale, je partirai pour Berlin à pleines voiles. Mais je m'aperçois que j'ai étrangement abusé de la liberté de vous ennuyer, et, tout honteux, je m'empresse de finir en vous priant de me pardonner ma loquacité.
A M. FERDINAND HILLER.
La Côte, ce 7 août 1832.
Qu'il a un drôle d'esprit, piquant, agaçant, coquet, cet Hiller! Si nous étions tous les deux femmes, avec la manière de sentir que nous avons, je la détesterais; si lui seulement était femme, je la haïrais avec crispation, tant j'abhorre les coquettes. La Providence a donc tout fait pour le mieux, comme disent les jobards, en nous jetant tous les deux sur le globe, armés du sexe masculin.
Non, mon cher mauvais plaisant, vous n'avez pas pu faire autrement que de me faire attendre deux mois votre réponse; mais je ne puis pas non plus faire autrement que de vous en vouloir, et d'avoir perdu radicalement la confiance dans vos promesses de ce genre. Comme je ne m'en fâche pas beaucoup ou, du moins, comme je n'y mets pas beaucoup d'amour-propre, je vous avais écrit une seconde lettre de Grenoble; mais, six heures après, réfléchissant à ce qu'elle contenait, je l'ai brûlée. «Il y a des choses, disait Napoléon, qu'il ne faut jamais dire; à plus forte raison, faut-il se garder de les écrire.» Oh! Napoléon! Napoléon!... Allons, voilà la poche de l'enthousiasme qui va crever... Pour empêcher ce malheur, je vais, au lieu de vous parler de lui, de ses ouvrages en Lombardie, de ses traces sublimes que j'ai suivies jusqu'aux Alpes en revenant en France, je vais vous parler de trois grosses fautes de français que contient votre lettre!! Oh!!!... Puisque vous apprenez le latin, je vais me faire pédagogue. 1º Il ne faut point d'accent sur negre; 2º vous dites que je trouve ici «des grands amusements»: il faut de grands amusements; 3º «Il est possible que Mendelssohn l'aura»:—que Mendelssohn l'ait.
Profitez de cette leçon.
Ouf!
Je suis, en effet, avec ma famille, mais je n'ai que ma sœur cadette qui m'adore, et je me laisse adorer d'une manière fort édifiante... Oh! quand je retournerai en Italie!!!—Voyez-vous, mon cher, il me faut de la liberté, de l'amour et de l'argent. Nous trouverons cela plus tard, en y ajoutant même un petit objet de luxe, de ces superflus qui sont nécessaires à certaines organisations, la Vengeance, générale et privée. On ne vit et ne meurt qu'une fois.
Pendant que je suis en province, isolé de mes agitations ordinaires, seul avec ma pensée, qui se retourne dans tous les sens comme un porc-épic en me blessant de ses dards aigus, mes idées se fixent, se consolident par l'étude des profonds ouvrages de Locke, Cabanis, Gall et autres; ce n'est pas qu'ils m'apprennent autre chose que des détails techniques, car je m'aperçois bien souvent que je suis plus avancé qu'eux, et qu'ils n'osent pas suivre leur marche dans les conséquences de leurs principes, par crainte de l'opinion. L'opinion, cette reine du monde!... mais il n'y a plus de rois ni de reines, il y a eu un tremblement de trônes (dit Lamartine) qui les a tous renversés.
Je copie toute la journée les parties de mon Mélologue; depuis deux mois, je ne fais pas autre chose, et j'en ai encore pour soixante-deux jours; vous voyez que j'ai de la patience. Il en faut pour tout, non pas pour supporter chiennement les maux, mais pour agir. Le besoin de musique me rend souvent malade; il me donne des tremblements nerveux; puis nous avons aussi l'influence cholérique qui m'a retenu quelques jours au lit; j'en suis libre aujourd'hui, prêt à recommencer. Je vais aller voir F....; nous ne nous sommes pas vus depuis cinq ans. Les extrêmes se touchent, comme vous voyez. Il est plus religieux que jamais, il a épousé une femme qui l'adorait, et il adore ferme aussi, lui. Quelle drôle de chose que cette adoration, et elle est vive et sincère:
A M. L'INTENDANT GÉNÉRAL DE LA LISTE CIVILE
Paris, vendredi 9 novembre 1832.
Monsieur l'intendant général,
Élève de l'École des beaux-arts française de Rome (section de musique), je ne pouvais mieux répondre au but de l'institution qu'en cherchant à multiplier les productions de mon art. Mais, moins heureux en cela que les peintres qui ont la ressource des expositions, nos partitions sont mortes s'il n'y a pas exécution. Je m'adresse, monsieur l'intendant général, à votre justice éclairée en vous priant de mettre à ma disposition la salle du Conservatoire de musique pour un concert que je me propose de donner le dimanche 2 décembre. L'accueil encourageant que quelques-uns de mes ouvrages ont reçu du public dans cette même enceinte m'enhardit à croire que ceux que je rapporte d'Italie m'attireront de nouveaux suffrages. J'ai surtout à cœur de me montrer digne de l'École à laquelle j'appartiens et de son illustre patronage.
J'ai l'honneur d'être, etc.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
Samedi, 19 janvier 1833.
Cher ami,
Field vous a réservé un billet pour son concert de dimanche (demain); il est chez Schlesinger; venez le prendre. Apportez-moi en même temps mes partitions; je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne faut pas songer à arranger le bas à quatre mains pour mademoiselle Perdreau; trouvez un prétexte; mais, l'ouvrage n'étant pas gravé, cela pourrait avoir des conséquences fort désagréables pour moi.
Je vous parle de chants, tandis que Rome brûle[60]; n'importe! Venez me voir demain dimanche dans la journée. Si je n'y suis pas, donnez-moi un rendez-vous.
Jamais plus intense douleur n'a rongé un cœur d'homme! Je suis au septième cercle de l'enfer. J'avais bien raison; il n'y a pas de justice au ciel.
A propos, je vais faire un opéra italien fort gai, sur la comédie de Shakspeare (Beaucoup de bruit pour rien)[61].
A cette occasion, je vous prierai de me prêter le volume qui contient cette pièce.
Oui, oui, ronge, ronge, je m'en moque; je te défie de me faire sourciller; quand tu auras tout rongé, quand il n'y aura plus de cœur, il faudra bien que tu t'arrêtes.
Votre article sur les Armides sera fait demain tant bien que mal. Oh! oh! damnation, je broierais un fer rouge entre mes dents.
Charmant!
Adieu.
AU MÊME.
5 février 1833.
Cher et bon ami,
Je n'ai rien que du bonheur à vous annoncer. Le soleil luit en ce moment-ci du plus vif éclat. Je vous raconterai en détail tout cela. Henriette et moi avions été mutuellement calomniés vis-à-vis de l'autre d'une manière infâme. Tout est éclairci. Son amour se montre fort. Il y a une opposition formidable. J'ai écrit à mon père. Le dénoûment approche. Venez me voir, je vous en prie, et apprenez-moi ce que vous avez de nouveau. J'ai quelque chose à donner à Pichot qui peut suffire pour un premier article. Je vous le montrerai.
God bless you!
A M. FERDINAND HILLER.
Paris, 18 juillet 1833.
Mon cher ami,
Vous devinez sans doute, au long et absurde silence que j'ai gardé avec vous, que l'état de liberté dans lequel vous m'avez laissé à votre départ n'a pas été long. Deux jours après que vous aviez quitté Paris, Henriette me fit prier instamment de venir la voir. Je fus froid et calme comme un marbre. Elle m'écrivit deux heures après; j'y retournai, et après mille protestations et explications qui, sans la justifier complétement, la disculpaient au moins sur le point principal, j'ai fini par lui pardonner, et depuis lors je ne l'ai pas quittée un seul jour. Quand votre lettre m'est parvenue, le jeune homme qui me l'a remise ne m'ayant pas laissé son adresse, je n'ai pu vous envoyer la musique que vous me demandiez. J'aurais pu toutefois vous écrire plus tôt, sans l'immense préoccupation où je vis depuis longtemps. Vous veniez de faire une perte, d'ailleurs, pour laquelle je n'aurais su vous offrir que de bien pâles et faibles consolations. Vous aviez en votre père un ami qui ne s'est jamais démenti un seul instant depuis votre enfance, un guide et non un maître, un protecteur et non un gouverneur; oh! c'est précieux et rare. Vous avez dû ressentir une douleur étrange, inconnue, à cette séparation.
Ce que je vous dis là est peut-être mal, je rappellerai peut-être encore quelques larmes dans vos yeux, mais j'espère qu'elles seront du moins sans amertume.
Je vais partir dans deux jours pour Grenoble; il faut que je voie si décidément j'ai aussi perdu mon père, et si je suis pour toute ma famille un paria.
Ma pauvre Henriette commence à marcher; nous sommes allés déjà plusieurs fois ensemble nous promener aux Tuileries. Je suis les progrès de sa guérison avec l'anxiété d'une mère qui voit les premiers pas de son enfant. Mais quelle affreuse position est la nôtre! Mon père ne veut rien me donner, espérant par là empêcher mon mariage. Elle n'a rien, je ne puis rien ou fort peu pour elle; hier soir, nous avons passé deux heures noyés de larmes tous les deux. Sous quelque prétexte que ce soit, je ne puis lui faire accepter l'argent dont je puis disposer. Heureusement, j'ai obtenu de la Caisse d'encouragement des beaux-arts une gratification de mille francs pour elle, que je lui remettrai ces jours-ci. C'est l'attente de cette somme, que je veux lui remettre moi-même, qui retarde mon voyage. Aussitôt après, je pars pour obtenir, soit de mon père, soit de mon beau-frère, ou de mes amis, ou même des usuriers qui connaissent la fortune de mon père, quelques mille francs qui puissent me mettre dans le cas de la tirer, ainsi que moi, de l'atroce situation où nous nous trouvons.
Comme je ne sais pas trop comment tout cela finira, je vous prie de conserver cette lettre, afin que, si quelque malheur définitif m'arrive, vous puissiez réclamer toute ma musique manuscrite que je vous lègue et confie. Vous ne serez ici que dans deux mois; ainsi, écrivez-moi une fois au moins avant. Je suis toujours à la même adresse, rue Neuve-Saint-Marc, nº 1, et je ne demeurerai absent qu'une douzaine de jours.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
Paris, 15 octobre 1833.
Non, sans doute, je n'ignore pas que tout ce qui me touche te touche; mais, cher bon ami, tu dois m'excuser de ne t'avoir pas écrit, d'autant plus facilement que je suis encore dans l'impossibilité de me rappeler ton ancienne adresse à Vaugirard; puis j'ai été, tous ces derniers temps, si préoccupé de mon bonheur, de mes inquiétudes, de mes projets pour elle, si accablé par la révolution immense que tout cela fait dans ma vie, qu'en vérité je ne songeais pas au monde, et tu me pardonneras de t'avoir un instant oublié, ainsi que tous mes autres amis.
Je monte une représentation avec concert pour le 12 du mois prochain à l'Odéon. Ma pauvre Ophélie y reparaîtra dans le quatrième acte d'Hamlet; madame Dorval jouera Antony; tu nous annonceras ça[62].
Nous serons à Paris chez moi, rue Neuve-Saint-Marc, nº 1, dès demain. Ainsi, si tu veux venir prendre du thé avec nous le soir dans quelques jours, quand nous serons un peu casés, tu nous feras grand plaisir. Je t'écrirai un mot.
Adieu. Ton sincère et inaltérable ami.
A M. LE COMTE D'ORTIGUE, RÉDACTEUR
DE LA QUOTIDIENNE, FORT CONNU DANS
L'UNIVERS
ET BEAUCOUP D'AUTRES LIEUX.
31 mai 1834.
Mon pauvre ami, je suis bien désolé de te savoir malade. Je devais aller te voir avant-hier, mais j'ai été forcé de faire à Paris plusieurs courses imprévues qui m'ont dévoré mon temps. A la maison, je ne quitte pas la plume, soit pour ces gredins de journaux, soit pour finir ma symphonie, qui sera née et baptisée avant peu.
Je te croyais parti pour le pays des troundedious; d'autant plus parti que la domestique de Liszt m'avait dit que tu avais fait une visite, rue de Provence, annonçant ton départ pour le lendemain. Pourquoi ne voudrais-tu pas un jour dîner avec nous à la fortune du pot? (Je ne m'appelle pas De Chambre comme le fameux calembourgeois; ainsi sois tranquille.) Je tâcherai en tout cas de trouver un jour pour aller à Issy. Cependant Henriette me charge expressément de te dire qu'elle est encore au monde et que je ne pourrai ni dîner ni coucher chez toi.
Dieu t'ait en sa sainte et digne garde et te guérisse du mal d'yeux, sans être obligé de t'y faire une application de salive. Fais-tu quelque chose?
A M. HOFFMEISTER, ÉDITEUR DE MUSIQUE, A LEIPSIG.
Paris, 8 mai 1836.
Monsieur,
Vous avez publié dernièrement une ouverture réduite, pour le piano à quatre mains, sous le titre d'Ouverture des Francs Juges, dont vous m'attribuez non-seulement la composition, mais aussi l'arrangement. Il est pénible pour moi, monsieur, d'être obligé de protester que je suis parfaitement étranger à cette publication, faite sans mon aveu et sans que j'en aie été seulement prévenu. L'arrangement de piano que vous venez de livrer à l'impression N'EST PAS DE MOI et je ne saurais davantage reconnaître mon ouvrage dans ce qui reste de l'ouverture. Votre arrangeur a coupé ma partition, l'a rognée, taillée et recousue de telle façon que je n'y vois plus en maint endroit qu'un monstre ridicule, dont je le prie de garder tout l'honneur pour lui seul. Si une semblable liberté avait été prise à mon égard par un Beethoven ou un Weber, je me serais soumis sans murmures à ce qui m'eût certes paru néanmoins une humiliation cruelle; mais ni Weber ni Beethoven ne me l'auraient jamais fait subir: si l'ouvrage est mauvais, ils ne se fussent pas donné la peine de le retoucher; s'il leur eût paru bon, ils en auraient respecté la forme, la pensée, les détails et jusqu'aux défauts. Et puis, les hommes de cette trempe n'étant pas plus communs en Allemagne qu'ailleurs, j'ai tout lieu de croire que mon ouverture n'est pas tombée entre les mains d'un musicien bien extraordinaire. La simple inspection de son travail en fournit une preuve évidente. Je ne parle pas du style de piano qu'il a substitué au style d'orchestre, et qu'on croirait souvent emprunté à des sonates faites pour des enfants de huit ans; je ne dirai rien non plus de l'inintelligence complète dont il fait preuve d'un bout à l'autre de l'ouvrage, soit en reproduisant de la façon la plus plate et la plus mesquine ce qui eût nécessité toutes les puissances du piano pour donner une idée approximative de l'effet d'orchestre, soit en prenant souvent l'idée accessoire pour l'idée principale, et vice versa; dans tout cela, il n'y a pas de la faute de l'arrangeur; je suis persuadé qu'il n'y a point mis de malice. Mais ce qui me paraît vraiment déplorable, c'est que vous ayez chargé un pareil chirurgien de me faire d'aussi graves amputations. On ne coupe pas un membre d'ordinaire sans en connaître l'importance générale, les fonctions spéciales, les rapports intimes et l'anatomie interne et externe. Il n'y a que le bourreau qui puisse couper le poing à un malheureux, sans tenir compte des articulations, des attaches musculaires, des filets nerveux et des vaisseaux sanguins; aussi le fait-il brutalement d'un coup de hache, et la tête du patient saute bientôt après. C'est le supplice des parricides. C'est celui, monsieur, que votre arrangeur m'a infligé. Il a fait disparaître non-seulement des passages entiers, mais des fragments de phrases dont la suppression rend l'ensemble incompréhensible ou absurde. Ainsi, dans la prière en ut mineur des flûtes et clarinettes, au milieu de l'allégro, l'arrangeur n'a pas vu que cette mélodie est un adagio écrit avec les signes de l'allégro dans lequel il est jeté; qu'une ronde y représente toujours une noire, trois rondes liées et soutenues une blanche pointée, et que par conséquent il faut quatre mesures du mouvement allégro pour former une seule mesure réelle du chant adagio. Trouvant donc cette prière trop longue, et sans tenir compte de l'action contrastante qui se passe en même temps dans le reste de l'orchestre, votre arrangeur l'a tronquée de telle sorte qu'il est impossible à présent d'y trouver aucune espèce de sens; il a enlevé des mesures isolées qui ne représentaient en réalité qu'un temps de la grande mesure du mouvement lent dans lequel la phrase se développe, et le rhythme, tombant à faux, amène nécessairement une conclusion aussi imprévue que stupide. C'est ce dont il ne s'est pas aperçu. Pour la coupure qui fait disparaître tout le grand crescendo de la péroraison, il est évident qu'elle détruit entièrement l'éclat de la rentrée du thème en fa majeur, qui ne reparaissait ni d'une façon aussi brusquement triviale, ni sans avoir passé par des transformations qui donnaient plus de force et de puissance au retour de l'idée primitive reproduite intégralement. Mais j'aurais trop à faire de suivre les traces des ciseaux ébréchés de mon censeur; je me bornerai à protester de nouveau que la seule ouverture des Francs Juges, arrangée à quatre mains, que je reconnaisse, est celle que viennent de publier M. Richault à Paris, et M. Schlesinger à Berlin; encore celle de M. Schlesinger, bien que gravée sur un manuscrit que je lui ai adressé moi-même, diffère-t-elle un peu de l'édition de Paris en quelques endroits, pour la manière dont les parties sont disposées dans les extrémités du clavier. Ces légères modifications m'ont été indiquées par plusieurs pianistes habiles, tels que MM. Chopin, Osborne, Schunke, Swinski, Benedict, Eberwein, qui ont bien voulu revoir les épreuves et me donner leurs conseils. Pour toute autre publication de la même nature sur cet ouvrage, qu'elle me soit attribuée ou non, je la désavoue formellement, et sur ce, je prie Dieu de pardonner aux arrangeurs comme je leur pardonne.
A ROBERT SCHUMANN.
Paris, 19 février 1837.
Je vous dois beaucoup, monsieur, pour l'intérêt que vous avez bien voulu prendre jusqu'ici à quelques-unes de mes compositions. J'apprends que l'ouverture des Francs Juges vient d'être par vos soins entendue à Leipzig, et que la supériorité de l'exécution n'a pas peu contribué au bienveillant accueil qu'elle a reçu du public. Veuillez être l'interprète de ma reconnaissance auprès de MM. les artistes. Leur patience à étudier ce morceau difficile a d'autant plus de prix à mes yeux, que je n'ai pas eu beaucoup à me louer jusqu'à présent de celle de plusieurs sociétés musicales qui ont voulu faire la même tentative. A part celles de Douai et de Dijon, les autres se sont découragées après une première répétition, et l'ouvrage, après avoir été lacéré de mille façons, a dû rentrer dans l'ombre des bibliothèques, comme digne de figurer tout au plus dans la collection des monstruosités. Il paraît même qu'une épreuve de ce genre a beaucoup diverti la Société philharmonique de Londres; quelques artistes parisiens que les virtuoses anglais n'avaient pas dédaigné de s'adjoindre à cette occasion, et qui connaissaient parfaitement mon ouvrage pour l'avoir exécuté à Paris, m'ont dit avoir franchement partagé l'hilarité britannique; seulement le sujet en était tout différent. Figurez-vous en effet les mouvements pressés du double dans l'adagio, et ralentis d'autant dans l'allégro, de manière à produire cet aplatissant mezzo termine insupportable à tout ce qui possède le moindre sentiment musical; imaginez des violons déchiffrant à première vue des traits encore assez difficiles, malgré le tempo confortabile qu'on avait donné à l'allégro, les trombones partant dix ou douze mesures trop tôt, le timbalier perdant la tête, dans le rhythme à trois temps, et vous aurez une idée de l'aimable charivari qui devait en résulter. Je ne conteste point l'habileté de MM. les philharmoniques d'Argyle-Room, Dieu m'en garde! je signale seulement l'étrange système d'après lequel on les dirige dans les répétitions. Certes, il nous est arrivé souvent ici de faire aussi de bien mauvaise musique au premier essai d'un nouveau morceau; mais, comme, à notre avis, personne n'a la science infuse, pas même les artistes anglais, et qu'il n'y a point de honte à étudier avec attention et courage ce qu'on n'est pas tenu de comprendre du premier coup, nous recommencions trois fois, quatre fois, dix fois s'il le fallait, et plusieurs jours de suite. De la sorte, nous arrivions à une exécution presque toujours correcte et quelquefois foudroyante. Ainsi avez-vous fait sans doute à Leipzig, et, je le répète, en l'absence de l'auteur intéressé à soutenir son ouvrage, une telle persévérance honore autant les exécutants qu'elle flatte le compositeur en le pénétrant de reconnaissance. Elle est si rare, cependant, que je me suis mille fois repenti d'avoir si étourdiment laissé publier l'ouverture dont il est ici question. Et, à ce sujet, je dois vous faire ma profession de foi en vous priant de la transmettre à l'éditeur, M. Hoffmeister; ce sera ma réponse aux offres qu'il a la bonté de me faire relativement à la publication de mes symphonies. L'an dernier, on m'écrivit à peu près en même temps de Vienne et de Milan, pour avoir un exemplaire manuscrit de ces deux ouvrages; non point dans le but de les graver, mais seulement de les faire entendre. Il y a quelques mois, une lettre semblable me fut adressée de la Nouvelle-Orléans. Les offres très-avantageuses qui accompagnaient ces demandes ne me séduisirent point; j'ai toujours refusé et toujours pour la même raison, la crainte d'être traduit à contre-sens par une exécution infidèle ou incomplète. Si le bonheur a voulu que l'ouverture des Francs Juges ait trouvé à Leipzig des interprètes aussi consciencieux qu'habiles et un patron tel que vous pour réchauffer leur zèle, vous venez de voir que, loin d'éprouver partout le même sort, celui qu'elle a subi en Angleterre a été assez brutal; et je dois ajouter que, cette ouverture étant le premier morceau de musique instrumentale que j'aie écrit de ma vie, les compositions qui lui ont succédé ont tout naturellement tendu à revêtir des formes plus larges, à s'assimiler plus de substance musicale, à s'étayer d'un plus grand nombre de points d'appui. Or, ce sont autant de chances de plus contre la facilité de l'exécution. Il faut un génie bien rare pour créer de ces choses que les artistes et le public saisissent de prime abord, et dont la simplicité est en raison directe de la masse, comme les pyramides de Djizeh. Malheureusement, je ne suis point de ceux-là; j'ai besoin de beaucoup de moyens pour produire quelque effet, et je craindrais de perdre à tout jamais l'estime des amis de l'art musical, si, par une publication prématurée, j'exposais mes symphonies, trop jeunes pour voyager sans moi, à être mutilées plus cruellement encore que ma vieille ouverture. Ce qui, à part deux ou trois villes hospitalières et artistes comme la vôtre, leur arriverait partout, n'en doutez pas.
Et puis, vous le dirai-je, je les aime, ces pauvres enfants, d'un amour paternel qui n'a rien de spartiate, et je préfère mille fois les savoir obscures, mais intactes, à les envoyer au loin chercher la gloire ou d'affreuses blessures et la mort.
Je n'ai jamais compris, je l'avoue, au risque de paraître ridicule, comment les peintres riches pouvaient, sans un déchirement d'entrailles, se séparer de leurs plus beaux ouvrages pour quelques écus, et les disséminer aux quatre coins du monde, ainsi que cela se pratique journellement. Cela m'a paru toujours ressembler beaucoup à la cupidité du célèbre anatomiste Ruisch, qui, à la mort de sa fille, jeune personne de seize ans, ayant trouvé le moyen, grâce aux ingénieux procédés d'injection dont il est l'inventeur, de rendre pour toujours à ce cadavre chéri l'aspect de la vie et de la santé, ne sut pas résister aux séductions de l'or d'un souverain, et lui abandonna, avec ce chef-d'œuvre d'un art alors nouveau, le corps de sa propre fille.
Les écrivains, poëtes et prosateurs, sont seuls dans le cas de pouvoir vendre leurs ouvrages sans courir trop de risques de les voir défigurer, comme les musiciens, ou sans les perdre à jamais de vue, comme les peintres ou statuaires. Encore les poëtes dramatiques sont-ils exposés, en imprimant leurs pièces, à les voir, malgré eux, représentées plus ou moins mal, devant un public plus ou moins incapable de les comprendre, coupées, rognées et sifflées. Byron, avec son Marino Faliero, en a fait la triste expérience. Non, il y a une joie intense pour le compositeur, à couver, pour ainsi dire, son œuvre, à la garantir le plus longtemps possible des orages que les mauvais orchestres, les mauvais chanteurs, les mauvais directeurs et les marchands de contredanses, font gronder autour d'elle; il y a pour lui un indicible bonheur à ne la montrer au grand jour qu'à de longs intervalles, lorsque des soins assidus ont donné à sa beauté tout son éclat, que l'air est pur, le temps doux et serein, et la société choisie.
Le nombre des compositions qu'on peut, sans les condamner à une obscurité absolue, arracher ainsi pendant longtemps aux dents de la presse, ce lion quaerens quem devoret, est malheureusement bien peu considérable; ne le restreignons pas encore.
Croyez-vous que Weber, quelque amoureux de la célébrité qu'on le suppose, sachant de quelle manière son Freyschütz allait être écartelé à Paris, n'eût pas rejeté avec indignation la gloire même qu'il lui était réservé d'acquérir parmi nous à ce prix? C'est faire injure à sa mémoire que d'en douter.
Mais il était hors de son pouvoir de s'y opposer: sans laisser graver sa partition, il en avait vendu des copies, et c'était assez pour que la tutelle lui en échappât pour jamais.—Je mets un terme à toutes mes comparaisons, que vous allez sans doute, monsieur, trouver bien ambitieuses, et j'ajoute simplement que le suffrage de l'Allemagne, cette patrie de la musique, est d'un trop haut prix à mes yeux et me sera, je le crains, trop difficile à obtenir si toutefois je l'obtiens, pour ne pas attendre le moment où je pourrai, moi-même, aller en pèlerin déposer à ses pieds ma modeste offrande. Alors, encore, aurai-je grand besoin du secours de votre amitié, comme aussi de votre talent si noble et si élevé, pour le faire accueillir.
Jusque-là, j'ose espérer qu'on ne verra dans ma réserve qu'une méfiance très-naturelle et déjà trop bien justifiée. Je me contenterai donc pour le présent, en prudent navigateur, de louvoyer sur nos côtes, sans courir au naufrage dans un voyage au long cours.
Tels sont mes motifs, et vous les apprécierez, je l'espère.
Je ne veux pas finir ma lettre sans vous dire quelles heures délicieuses j'ai passées dernièrement à lire vos admirables œuvres de piano; il m'a semblé qu'on n'avait rien exagéré en m'assurant qu'elles étaient la continuation logique de celles de Weber, Beethoven et Schubert. Liszt, qui me les avait ainsi désignées, m'en donnera incessamment une idée plus complète, me les fera connaître plus intimement, par son exécution incomparable. Il a le projet de faire entendre votre sonate intitulée Clara à l'une des magnifiques soirées où il rassemble autour de lui l'élite de notre public musical. Je pourrai alors vous parler avec plus d'assurance de l'ensemble et des détails de ces compositions essentiellement neuves et progressives.
A MAURICE SCHLESINGER.
Paris, 7 janvier 1838.
Mon cher Maurice,
Il me faut absolument du repos et un abri contre les albums. Voici bientôt quinze jours que je cherche inutilement trois heures pour rêver à loisir à l'ouverture de mon opéra[63]; ne pouvoir les obtenir est un supplice dont vous n'avez pas d'idée et qui m'est absolument insupportable. Je vous préviens donc que, dussé-je vivre de pain et d'eau, jusqu'au moment où ma partition sera finie, je ne veux plus entendre parler de critique d'aucune espèce. Meyerbeer, Liszt, Chopin et Kalkbrenner n'ont pas besoin de mes éloges. Vos albums, je le sais, contiennent d'ailleurs plusieurs morceaux charmants dont vous ne parlez pas, et dont vous ne me citez pas même les auteurs. Mais je suis poussé à bout; je veux pendant quelque temps, assez de loisir et de liberté pour finir mon ouvrage; je veux être artiste enfin; je redeviendrai galérien après. Jusque-là qu'on ne me parle plus de critique d'aucune espèce; je suis obsédé, abîmé, exterminé. Gardez-vous donc de venir me relancer dans ma tanière, ce serait d'une révoltante inhumanité. Je n'ai jamais compté parmi les apologistes du suicide; mais j'ai là une paire de pistolets chargés, et, dans l'état d'exaspération où vous pourriez me mettre, je serais capable de vous brûler la cervelle.
Votre tout dévoué ami.
A LISZT.
Paris, le 6 août 1839.
Je voudrais bien, mon cher ami, pouvoir te dire absolument tout ce qui se passe dans notre monde musical, ou du moins tout ce que je sais, des transactions qui s'y opèrent, des marchés qu'on y fait, des souterrains, des mines qu'on y creuse, des platitudes qui s'y commettent; mais je doute fort que mon récit eût quelques chances de t'intéresser; il ne t'offrirait rien de nouveau; l'étude des mœurs italiennes t'a blasé sur toutes ces gentillesses, et ce qu'on fait à Paris ressemble horriblement à ce que tu as vu pratiquer à Milan.
Tu n'aurais pas d'ailleurs le cœur d'en rire; tu n'es pas de ces gens qui trouvent des sujets de plaisanterie dans les outrages dont la Muse que nous servons a tant à souffrir, toi qui voudrais à tout prix, au contraire, cacher les souillures de sa robe virginale et les tristes lésions de son voile divin.
Ne parlons donc pas des énormités qui t'irriteraient autant que moi et contre lesquelles nous ne pouvons pas même protester librement... Je vais tâcher seulement de te donner une idée superficielle de ce qui se passe dans nos concerts, dans nos théâtres lyriques, parmi nos virtuoses, nos chanteurs, nos compositeurs; et cela, sans passion, sans blâme ni éloge, en un mot, avec le calme plat d'un adepte de cette fameuse école philosophique que nous avons fondée à Rome en l'an de grâce 1830, et qui avait pour titre: École de l'indifférence absolue en matière universelle.
Cette forme a l'avantage de me dispenser des théories, des développements, et me permet de laisser tomber le fait lourdement, brutalement, sans m'inquiéter des suites. Je commence, sans ordre chronologique, par ce qu'il y a de plus récent.
Avant-hier, pendant que je fumais, selon mon habitude, un cigare sur le boulevard des Italiens, quelqu'un me prit vivement le bras: c'était Batta arrivant de Londres.
—Que fait-on à Londres? lui dis-je.
—Absolument rien; on y méprise la musique et la poésie, et le drame, et tout; excepté le Théâtre-Italien, où la présence de la reine attire la foule, tous les autres clubs harmoniques sont abandonnés. Je m'estime heureux de n'en être pas pour mes frais de séjour et de voyage, et d'avoir été applaudi dans deux ou trois concerts; c'est tout ce que j'ai obtenu de l'hospitalité britannique. Mais je suis arrivé trop tard; il en est de même d'Artot, qui, malgré son succès à la Société Philharmonique, malgré l'incontestable beauté de son talent, s'est beaucoup ennuyé.
—Et Doehler?
—Doehler s'ennuie aussi.
—Et Thalberg?
—Thalberg cultive les provinces.
—Et Bénédict?
—Encouragé par la vogue de sa première partition, il écrit un nouvel opéra anglais.
—Et madame Gras-Dorus?
—Madame Gras est devenue fashionable en quelques jours; elle a balancé la vogue des Italiens, elle chantait et partout son nom ne figurait plus sur l'affiche qu'accompagné de l'épithète de cantatrice sans égale, imprimée en très gros caractères. On dit qu'elle a été chutée ici (à Paris) à sa rentrée dans Guillaume Tell?
—C'est vrai.
—Comment donc? Pourquoi?
—Voulez-vous boire un grog?
—Non, je pars; venez ce soir chez Hallé, nous boirons et nous ferons de la musique.
—Bon!
M. Hallé est un jeune pianiste allemand, qui a de longs cheveux, qui est grand et maigre, qui joue magnifiquement du piano, qui devine la musique plutôt qu'il ne la lit, c'est-à-dire qu'il tend à te ressembler. J'ai trouvé chez lui son compatriote M. Heller. Un talent sérieux, une intelligence musicale des plus vastes, une conception rapide, une grande habileté d'exécution, telles sont les qualités de compositeur et de pianiste que lui assurent tous ceux qui le connaissent bien, et je suis de ceux-là.
Hallé et Batta nous ont fait entendre une sonate en si bémol de Félix Mendelssohn. On a généralement admiré la facture savante et le style ferme de ce morceau: «C'est d'un grand maître», disait Heller. Nous avons fait chorus en buvant de la bière; puis est venue la sonate en la majeur de Beethoven, dont le premier morceau a arraché à l'auditoire des exclamations, des jurements, des cris d'enthousiasme; le menuet et le finale n'ont fait que redoubler notre exaltation toute musicale, bien que les bouteilles de vin de Champagne fussent déjà en circulation.
Et quelqu'un a fait observer à ce sujet que la bonne bière était bonne, mais que le vin de Champagne valait mieux.
O vagabond infatigable! quand reviendras-tu donc pour nous rendre ces nuits musicales que tu présidais si dignement? Entre nous, il y avait trop de monde à tes réunions; on parlait trop, on n'écoutait pas assez, on philosophait. Tu faisais une dépense affreuse d'inspiration qui eût donné le vertige à quelques-uns sans tous les autres.
Te rappelles-tu notre soirée chez Legouvé, et la sonate en ut dièse mineur, et la lampe éteinte, et les cinq auditeurs couchés sur le tapis dans cette obscurité, et notre magnétisation, et les larmes de Legouvé et les miennes, et le respectueux silence de Schœlcher, et l'étonnement de M. Goubeaux? Mon Dieu! mon Dieu! que tu fus sublime ce soir-là! Allons, j'oublie que j'appartiens à l'école des indifférents.
J'y reviens.
L'Exposition des produits de l'industrie nous a valu cette année des volumes de critique musicale; on s'est beaucoup disputé, on a crié pour et contre les pianos, pour et contre les orgues; j'ai vu les moments où l'on intenterait un procès pour un jeu de flûtes; on a failli se battre pour une vis de pression.
Je ne concevais pas trop tout ce remue-ménage; car, enfin, il nous arrive tous les jours, à nous autres artistes, d'essuyer des critiques pour le moins aussi injustes et aussi ridicules qu'aucune de celles que les fabricants d'instruments peuvent avoir à subir, et nous laissons aboyer sans mot dire. Nous ne manquons pourtant pas d'amour-propre, notre sensibilité n'est pas éteinte, tant s'en faut, et nous pourrions nous en défendre et nous ne le faisons pas.
D'autre part, quand, par extraordinaire, un critique se montre bienveillant, nous le remercions bien dans l'occasion; mais nous ne courons pas chez lui pour cela, et trop souvent même nous poussons l'impolitesse jusqu'à oublier de lui envoyer une carte. Loin de là, les exposants loués ont été d'une reconnaissance exemplaire; visites, lettres et présents, ils n'ont rien négligé pour l'exprimer. Ceux, au contraire, dont on a peu ou mal parlé ne concevaient pas qu'il leur fût défendu de courir sus au critique et de le tuer au coin d'une borne comme un chien enragé. Chacun peut dire ce qu'il pense et même ce qu'il ne pense pas sur les plus grands artistes, sur les œuvres les plus magnifiques comme sur les médiocrités les mieux reconnues sans qu'on y fasse attention; mais ne pas sentir le prix d'une nouvelle cheville de contre-basse, ou louer le chevalet d'un alto, ce sont là des événements dont le retentissement est immense et prodigieusement prolongé....
...On vient de trouver le moyen de gagner de l'argent en ne bâtissant pas de salle pour les Italiens. La troupe chantante de notre grand Opéra va se trouver en lutte directe avec les chanteurs ultramontains; on veut réunir les deux troupes dans la salle de la rue Le Peletier. La mêlée sera rude: Lablache contre Levasseur, Rubini contre Duprez, Tamburini contre Dérivis, la Grisi contre mademoiselle Nathan, et tous contre la grosse caisse. Nous serons là pour faire le relevé des morts et des mourants. Le directeur aura aussi l'administration du théâtre de Londres, et il fera peut-être beaucoup d'argent, et ce sera une fameuse affaire, et ça m'est égal; je suis de la secte des indifférents.
C'est aux marchands à calculer combien la denrée musicale, exploitée de la sorte, peut leur rapporter bon an mal an. Ce sont eux qui doivent s'inquiéter de la durée de leurs instruments chantants; quant à moi, si je n'étais pas indifférent, je dirais absolument comme toi: «J'aime mieux la musique que tout ça.»
Duponchel conservera la haute direction des costumes; ainsi ne t'inquiète pas, l'art et les artistes seront dans de beaux draps...
...Beaucoup de gens disent que l'orchestre (de l'Opéra) se fatigue, ou se néglige, ou se dégoûte de sa tâche. L'autre jour, j'entendais des habitués se plaindre de ce que les instruments n'étaient pas d'accord; ils prétendaient que le côté droit de la masse instrumentale tendait à s'élever sans cesse d'un quart de ton au-dessus du côté gauche; prétention exorbitante à en croire ces messieurs. «Vous souffrez en silence, me dit l'un deux.—Moi, je n'ai pas dit que je souffrais; d'abord parce que je n'ai rien dit du tout, et ensuite...»
On joue quelquefois Don Juan quand on ne sait plus où donner de la tête. Si Mozart revenait au monde, il dirait peut-être, comme ce président dont parle Molière, qu'il ne veut pas qu'on le joue. Spontini, au contraire, a voulu être joué, et il l'a été. On ne veut pas entendre parler, à l'Opéra, de reprendre ses anciens chefs-d'œuvre. Ambroise Thomas, Morel et moi, nous disions l'autre jour que nous donnerions bien cinq cents francs pour une bonne représentation de la Vestale. Comme nous savons cette partition par cœur, nous l'avons chantée jusqu'à minuit; tu manquais pour l'accompagner.
La cause de Spontini a été défendue dans une brochure par un de nos amis, Émile D...; quelques journaux se sont joints à lui. Cette cause allait être gagnée, quand Spontini a cru devoir publier une lettre, déjà imprimée, il y a deux ou trois ans à Berlin, sur la musique et les musiciens modernes[64]. Les adversaires de Spontini eussent payé mille écus pour la publication de cette lettre, il la leur a donnée pour rien. Ça n'empêche pas la Vestale d'être un chef-d'œuvre, mais cela fait que nous ne le reverrons jamais...
Tu as vu que la place de professeur de composition laissée vacante par la mort de Paër allait être donnée à M. Carafa. On assure que mon système sur l'indifférence commence à être apprécié au ministère. Les orangers du Jardin Musard portent déjà des fruits; Théophile de Ferrière a été assassiné par un inconnu la semaine dernière, en sortant de l'Opéra-Comique; il va beaucoup mieux. Heine s'écrit toujours par un e; il demeure rue des Martyrs. On m'a volé son charmant livre sur l'Italie. As-tu lu ses Bains de Lucques? On nous promet des nuits vénitiennes au Casino; il y a là un orchestre de cent quarante musiciens, toutes les fois que soixante d'entre eux ne sont pas employés à la même heure aux concerts des Champs-Élysées. Il y a un microscope au gaz; j'y ai vu des cirons qui paraissaient gros comme des melons. Je te donne toutes mes nouvelles comme elles me viennent.
F. Hiller m'a envoyé de Milan quelques morceaux de sa Romilda. On prétend que Rossini vend des poissons comme on n'en voit guère[65]; je parie qu'il s'ennuie dans sa villa autant que ses gros poissons dans leur vivier. Il dit toujours: «Qu'est-ce que ça me fait?» S'il n'aimait pas tant les énormes poissons, il aurait peut-être des dispositions pour l'indifférence absolue; mais j'en doute.
Un de nos ennemis a voulu dernièrement se précipiter de la colonne Vendôme; il a donné quarante francs au gardien pour le laisser monter, puis il a renoncé à son projet... Il faut espérer que, dans la nouvelle salle qu'on promet à l'Opéra-Comique, il y aura un foyer pour les musiciens; car actuellement, au théâtre de la Bourse, les malheureux sont obligés avant le lever de la toile de s'accorder coram populo d'où il suit que, pendant que les hautbois et les violons donnent le la, les trombones grognent leur si bémol; et véritablement, en pareil cas, il n'y a pas d'indifférence qui tienne, c'est terrible...
M. Wilhem a donné, le mois passé, deux séances publiques; ses cinq cents élèves chanteurs ont été fort applaudis; je n'ai pas trouvé leur exécution en voie de progrès. Tous ces jeunes hommes et ces enfants ont un sentiment rhythmique d'un vulgarisme désespérant. Ils martellent chaque temps de la mesure; ils convertissent tout, plus ou moins, en mouvement de marche. Certainement ce résultat est très-beau, si l'on compare l'ancienne ignorance des classes populaires à ce qu'elles savent aujourd'hui; mais savoir n'est pas tout en musique, il faut sentir aussi, et je crois que le peuple parisien aime trop le vaudeville et les tambours.
On répète depuis deux mois et demi l'opéra de Ruolz[66]; en conséquence les acteurs n'en savent pas une note; mais les costumes sont prêts et Duponchel veut le jouer vendredi prochain. Chopin ne revient pas; on le disait fort malade, il n'en est rien. Dumas a fait une pièce ravissante[67]; mais ceci n'est pas de mon domaine. J'ai fini, je ne sais plus rien.
Adieu; mon indifférence ne va pas jusqu'à prendre mon parti de ta longue absence. Reviens donc; il en est temps pour nous, et pour toi, je l'espère.
A M. BULOZ.
Paris, 22 novembre 1840.
Monsieur,
Dans le compte rendu par la Revue des Deux Mondes du festival que j'ai donné à l'Opéra, on a commis des erreurs de faits dont je crois pouvoir vous demander la rectification.
L'auteur de cet article veut me rendre coupable du crime de lèse-majesté à l'égard de Gluck et de Palestrina: «Pauvre Gluck! dit-il, vous ne vous doutiez pas, lorsqu'au son des trombones, vous évoquiez jadis les esprits de haine et de rage, qu'un jour viendrait où M. Berlioz vous ferait l'aumône de quelques ophicléides; et Palestrina qu'on a arraché à la chapelle Sixtine, où quelques soprani suffisaient à des mélodies fuguées, pour l'écraser lui, le maestro paisible, à l'inspiration suave et religieuse, sous la pompe des voix et des instruments.»
Or, l'acte d'Iphigénie a été exécuté absolument tel que l'auteur l'écrivit; on n'y a donc point entendu d'ophicléides. Quant à Palestrina, quelques soprani lui suffisaient si peu, que son madrigal Alla riva del Tebro, morceau profane du reste, et qui n'a jamais pu être entendu à la chapelle Sixtine, est à quatre parties (SOPRANI, CONTRALTI, TÉNORS et BASSES); il a fallu en outre une étrange préoccupation pour trouver écrasé sous la pompe instrumentale le chœur chanté d'après le texte du compositeur SANS ACCOMPAGNEMENT.
Voilà les erreurs qui devaient me blesser dans mon rôle d'interprète de maîtres que j'admire et les seules qu'il m'importe de relever.
Recevez, etc.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
Leipzig, 28 février 1843.
Il y a longtemps que j'aurais dû t'écrire, mais un métier de galérien comme celui que je fais me paraît une excuse suffisante à ce retard. J'ai été malade et je le suis encore des fatigues incroyables que m'ont données les répétitions de Dresde et de Leipzig. Figure-toi que j'ai fait à Dresde, en douze jours, huit répétitions de trois heures et demie chacune, et deux concerts, et qu'il m'a fallu une fois aller de Leipzig à Dresde et revenir dans le même jour, c'est-à-dire faire soixante lieues en chemin de fer, préparer mes deux concerts et revenir assister à celui que Mendelssohn dirigeait ici. Mendelssohn a été charmant, excellent, attentif, en un mot, bon camarade tout à fait; nous avons échangé nos bâtons de chef d'orchestre en signe d'amitié.
C'est un grandissime maître: je le dis malgré ses compliments enthousiastes pour mes romances; car des symphonies, ni des ouvertures, ni du Requiem, il ne m'a jamais dit un mot[68]. Il a fait exécuter ici pour la première fois sa Nuit du sabbat sur un poëme de Gœthe et je t'assure que c'est une des plus admirables compositions orchestrales et chorales qu'on puisse entendre. Schumann, le taciturne Schumann, est tout électrisé par l'Offertoire de mon Requiem; il a ouvert la bouche, l'autre jour, au grand étonnement de ceux qui le connaissent, pour me dire, en me prenant la main: Cet offertorium surpasse tout!
Rien, en effet, n'a produit sur le public allemand une pareille impression. Les journaux de Leipzig ne cessent depuis quelques jours d'en parler et de demander une exécution du Requiem en entier; chose impossible, puisque je pars pour Berlin et puisque les moyens d'exécution manquent ici pour les grands morceaux de la prose.
A Dresde, nous avons dit deux fois l'Offertoire et le Sanctus, une fois la Fantastique, une fois Harold, les ouvertures du Roi Lear, de Benvenuto, le Cinq Mai (qui a prodigieusement émotionné le parterre saxon), la cavatine de Benvenuto, une des nouvelles mélodies instrumentées récemment, la romance pour le violon, deux morceaux de Roméo, l'apothéose (deux fois) avec les deux orchestres et les chœurs, comme nous avons fait à l'Opéra de Paris avant mon départ. Reissiger conduisait l'orchestre inférieur.
Ici, j'ai donné, à mon concert, le Roi Lear, la Fantastique, qui les a plus étonnés que touchés, etc.; le finale (le Sabbat) a été exécuté avec une précision et une fureur diabolique sans exemple. Puis on m'a demandé quelques morceaux pour un concert au bénéfice des pauvres et je leur ai donné de nouveau le Roi Lear, une mélodie avec orchestre, et l'éternel Offertoire. Ces trois morceaux ont décidément enlevé les Leipziquois. Oh! si j'avais à Paris une salle et un chœur dont je puisse disposer sans des frais ridicules, combien je ferais entendre de choses qui vous sont à peu près inconnues!
Quant aux autres villes où j'ai donné des concerts, ce sont les ouvertures du Roi Lear, des Francs Juges et la scène aux champs de la Symphonie fantastique, qui ont produit le plus constamment de l'effet; l'Adagio (scène aux champs) a frappé le public incomparablement plus que tout le reste. A Mannheim, ce sont les deux morceaux d'Harold, la marche des Pèlerins et la Sérénade qui ont eu les honneurs; quant au final, nous n'avons pas essayé de le donner, l'orchestre n'était pas de force; mais il a été enlevé à Dresde, sans toutefois que cette exécution approche de celle de Paris; il n'y avait pas assez de violons et les trombones sont de trop honnêtes gens pour cette orgie de brigands.
Je vais tâcher de faire quelque grande exécution à Berlin. Après quoi, je m'en retournerai en concertant encore sur la route à Weimar et à Francfort, si faire se peut.
Dis-moi donc un peu où en est la gravure de mon traité d'instrumentation; si tu n'en sais rien, fais-moi le plaisir de l'aller demander chez Schonenberger, boulevard Poissonnière; c'est te demander en même temps de m'écrire. Tu adresseras ta lettre poste restante à Berlin. Fais-moi l'amitié aussi d'aller à l'Opéra, un de ces soirs, dire à Desmarets[69] mille et une choses de ma part et lui montrer cette lettre. Tu peux bien dire à Dieppo aussi que je n'ai pas encore trouvé son pareil, et que les trombones qui essaient l'Oraison funèbre me font bien mal à la poitrine, sans compter les oreilles. Et notre jeune armée de violoncelles, et notre brillante bande de violons, tout cela je le cherche encore en Allemagne; mais, par exemple, en fait de trompettes, il y en a partout, et de fameuses, qui montent sans peur et sans reproches, et qui ont un son d'enfer; les trompettes à cylindre sont très-répandues et excellentes.
Je reçois à l'instant une lettre de Meyerbeer m'annonçant qu'une fête ordonnée par le roi retarde de quelques jours mes répétitions; il m'engage à aller en conséquence à Brunswick, où je suis attendu et où le Roi Lear m'a déjà conquis de chauds partisans. Les frères Muller écrivent aussi qu'ils se mettent en quarante-quatre pour m'aider.
Je vais donc y aller.
Adieu; voilà toutes mes nouvelles. Mille choses à tous ceux de mes amis que tu vois quelquefois, entre autres à Perrot; embrasse tes gamins pour moi et salue de ma part madame d'Ortigue. Elle est fidèle, comme à l'ordinaire, aux concerts du Conservatoire?
A M. GRIEPENKERL[70].
Paris, janvier, 1845.
Mon cher Griepenkerl,
Il y a bien longtemps que je n'ai de vos nouvelles; j'ignore même si vous avez reçu la partition du Carnaval romain et les deux volumes que je vous ai envoyés par l'entremise du libraire Brockhaus; que fait-on dans votre chère ville de Brunswick? Avez-vous toujours des querelles avec les savants de Leipzig? Combien je suis sensible à tous les procédés de généreuse sympathie que vous me donnez! Ne me laissez pas ainsi un an sans m'écrire. Depuis que j'ai reçu votre dernière lettre, j'ai entrepris une grande affaire musicale; une salle de concerts avec cinq cents exécutants dans le cirque équestre des Champs-Élysées. C'est la plus grande et la plus belle salle de Paris; mais elle est située à peu près hors de la ville, et s'il y a de la boue, la recette peut s'en ressentir cruellement. De sorte qu'à chaque concert, ce sont des inquiétudes nouvelles; car les frais sont immenses (6,000 francs). Je donne le quatrième dans quelques jours. J'aurais bien du plaisir ou plutôt du bonheur à vous voir ici, pendant ces affreuses répétitions surtout, qui me font suer sang et eau. J'ai beaucoup plus de peine en effet avec ces concerts qu'avec tous ceux qui les ont précédés; voici pourquoi: les meilleurs artistes de mon orchestre ordinaire font partie de celui du Conservatoire; or, cette Société célèbre les empêche, pendant toute la saison des concerts, de prendre part (à mes concerts, à moi)...
A MICHEL GLINKA[71].
Ce n'est pas tout, monsieur, d'exécuter votre musique et de dire à beaucoup de personnes qu'elle est fraîche, vive, charmante de verve et d'originalité; il faut que je me donne le plaisir d'écrire quelques colonnes à son sujet; d'autant plus que c'est mon devoir.
N'ai-je pas à entretenir le public de ce qui se passe à Paris de plus remarquable en ce genre? Veuillez donc me donner quelques notes sur vous, sur vos premières études, sur les institutions musicales de la Russie, sur vos ouvrages, et, en étudiant avec vous votre partition pour la connaître moins imparfaitement, je pourrai faire quelque chose de supportable et donner aux lecteurs des Débats une idée approximative de votre haute supériorité.
Je suis horriblement tourmenté avec ces damnés concerts, avec les prétentions des artistes, etc.; mais je trouverai bien le temps de faire un article sur un sujet de cette nature: je n'en ai pas souvent d'aussi intéressant.
A LOUIS BERLIOZ[72].
Samedi 25..... (vers 1846).
Mon cher Louis,
Ta mère va un peu mieux, mais elle est toujours obligée de garder le lit et de ne pas parler. La moindre émotion, en outre, lui serait fatale. Ainsi ne lui écris pas de lettre comme la dernière que tu m'as adressée. Rien n'est plus désolant que de te voir condamné toi-même à l'inaction et à la tristesse. Tu arriveras à dix-huit ans sans pouvoir entrer dans une carrière quelconque. Je n'ai point de fortune; tu n'auras point d'état: de quoi vivrons-nous?
Tu me parles toujours d'être marin; tu as donc bien envie de me quitter?... car, une fois sur mer, Dieu sait quand je te reverrais!... Si j'étais libre, entièrement indépendant, je partirais avec toi et nous irions tenter la fortune aux Indes, ou ailleurs; mais, pour voyager, il faut une certaine aisance, et le peu que j'ai m'oblige à rester en France. D'ailleurs, ma carrière de compositeur me fixe en Europe et il faudrait y renoncer entièrement si je quittais l'ancien monde pour le nouveau. Je te parle là comme à un grand garçon. Tu réfléchiras et tu comprendras.
En somme, quoi qu'il arrive, je serai toujours ton meilleur ami et le seul entièrement dévoué et plein d'une affection inaltérable pour toi. Je sais que tu m'aimes et cela me console de tout. Cependant, ce sera bien triste si tu restes à vingt ans un garçon inutile à toi-même et à la société.
Je t'envoie des enveloppes pour écrire à tes tantes. Ma sœur Nancy me parle de toi; je t'envoie sa lettre; il n'y a pas besoin de cire noire. Comment veux-tu que je te l'envoie? on ne met pas des bâtons de cire à la poste.
Parle-moi encore de tes dents. Les a-t-on soigneusement nettoyées?...
Adieu, cher enfant; je t'embrasse de toute mon âme.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
Prague, 27 janvier 1846.
Il y a longtemps que j'aurais dû t'écrire, mais tu es sans doute au courant de la plupart des incidents qui ont rendu mon voyage de Vienne si heureux pour moi et mes amis. Je te raconterai tout cela avec les plus grands détails à mon retour; car il faudrait pour te les écrire vingt colonnes du Journal des Débats tout au moins.
Je veux te parler seulement de mon excursion à Prague. J'y arrivais avec l'idée de tomber au milieu d'une population de pédants antiquaires ne voulant rien admettre que Mozart, et prêts à conspuer tout compositeur moderne. Au lieu de cela, j'ai trouvé des artistes dévoués, attentifs, d'une intelligence rare, faisant sans se plaindre des répétitions de quatre heures, et, au bout de la seconde répétition, se passionnant pour ma musique plus que je n'eusse jamais osé l'espérer. Quant au public, il s'est enflammé comme un baril de poudre; on me traite maintenant ici en fétiche, en lama, en manitou....
A Vienne, il y a discussion dans un petit coin hostile; ci rien de pareil; il y a adoration (ce mot est risible mais vrai). Et elle se manifeste de la façon la plus originale et dans des termes que je ne voudrais pour rien au monde voir mis sous les yeux de nos blagueurs parisiens. Si tu vois Pixis, dis-lui que je suis plus que content de ses compatriotes. J'ai entendu avant-hier son neveu; c'est un jeune violoniste de quatorze ans d'un grand talent déjà et qui fera honneur à son nom. Je vais maintenant en quittant mes chers Viennois aller visiter les compatriotes de Heller. (Je te prie d'aller le voir de ma part et de lui montrer ma lettre; ce sera comme si je lui écrivais; je devrais bien, pour toute l'amitié qu'il m'a témoignée tant de fois, lui écrire longuement; ce que je ferai un de ces jours avant de quitter sa ville de Pesth).... Vois s'il y a moyen d'infliger quelques mots à quelque grand journal sur ce succès de Prague. Tu peux écrire une réclame où tu parleras aussi de Vienne; mais, s'il te faut marcher plus de cent pas pour cela, n'y songe plus. L'affaire du bâton a dû faire un certain tapage à Paris; ce fut une surprise complète pour moi, tant le secret des préparatifs de la fête avait été bien gardé.
Mille amitiés. Embrasse ton gros garçon pour moi.
P.-S.—Pardon de te cauchemarder ainsi. On vient de m'avertir que nous aurions un monde fou au théâtre ce soir.
Tout se loue.
AU MÊME.
Breslau, 13 mars 1846.
Je te remercie cent fois, mon cher ami, de ta lettre. Elle m'est parvenue ce matin, et j'y ai trouvé enfin des nouvelles de Paris dont je suis privé depuis très-longtemps. Desmarets ne m'a envoyé que quelques lignes...
Il a été effectivement question à Vienne de m'engager, non pas à la place de Donizetti qui n'est pas vacante, puisqu'il vit encore, mais à celle de Weigl (directeur de la Chapelle impériale) qui vient de mourir. Quelqu'un dont l'influence est considérable dans la capitale de l'Autriche, m'ayant demandé si j'acceptais cette position, je répondis que j'avais besoin de réfléchir vingt-quatre heures. Il s'agissait de s'engager à rester indéfiniment à Vienne sans pouvoir obtenir le moindre congé pour revenir annuellement en France. A ce sujet, j'ai fait une curieuse découverte; c'est que Paris me tient tellement au cœur (Paris, c'est-à-dire vous autres, mes amis, les hommes intelligents qui s'y trouvent, le tourbillon d'idées dans lequel on se meut), qu'à la seule pensée d'en être exclu, j'ai senti littéralement le cœur me manquer et j'ai compris le supplice de la déportation. Ma réponse a été péremptoirement négative et j'ai prié qu'on ne me mît point sur les rangs pour la succession de Weigl. La place de Donizetti n'est pas si rude, puisqu'elle me donnerait six mois de congé; mais il n'en est pas question.
Remercie Dietsch de l'intérêt qu'il prend à ce qui me regarde et dis-lui que je lui prépare de la besogne avec mon grand opéra de Faust, auquel je travaille avec fureur et qui sera bientôt achevé. Il y a là des chœurs qu'il faudra étudier et limer avec soin. J'espère beaucoup de cette composition qui me préoccupe au point d'oublier presque le concert que je prépare (ou plutôt que l'on prépare ici). J'ai été peu engagé par le spécimen que les artistes de Breslau m'ont donné de leur savoir-faire; cependant ils sont fort empressés et me fêtent de leur mieux. Il y a même ce matin une affiche portant ces mots: «Grand concert donné par M. le maître de chapelle Schöne en l'honneur du M. le chevalier Berlioz de Paris.» Je serai donc obligé d'aller demain soir me montrer en loge ornée et fleurie; on viendra me chercher en voiture; vu la circonstance de la guerre de Pologne, on ne tirera pas le canon, mais il est défendu de fumer dans la salle.
Adieu.
AU MÊME.
Prague, 16 avril 1846.
Je n'ai pas répondu à ta dernière lettre, faute d'avoir quelque chose d'important à te dire. J'ai donné un excellent concert à Breslau et je me suis hâté de revenir ici, où j'étais attendu et où j'ai retrouvé les chœurs de Roméo et Juliette parfaitement sus par l'Académie de chant. J'ai respiré en m'entendant pour la première fois exécuté par des choristes amateurs si différents des braillards des théâtres. Nous avons fait hier la dernière répétition générale, où beaucoup de monde s'était introduit et que Liszt m'a aidé à faire marcher, en me servant d'interprète.
J'ai eu le plaisir de le voir souvent étonné et touché par cette composition, qui lui était demeurée jusqu'à présent absolument inconnue. Je crois que tu serais content des changements que j'y ai faits. Il n'y a plus qu'un prologue (le premier), et beaucoup modifié et raccourci; il y a des corrections très-importantes dans le scherzo, dans le grand finale et dans le récitatif mesuré du Père Laurence. Enfin, cela marche maintenant tout à fait bien, et je supprime entièrement la scène du Tombeau, qui ne te plaisait guère et qui fera toujours la même impression qu'à toi à beaucoup de gens. Mais l'adagio, de l'avis de tous, ici comme à Vienne, reste le meilleur morceau que j'aie encore écrit. Hier, à la répétition, celui-là et la Fête chez Capulet ont été furieusement applaudis, contre l'usage du pays, où l'on ne dit jamais le mot aux répétitions.
J'ai un très-bon Père Laurence (Stackaty), un Bohême, dont la voix est belle et le sentiment musical très-juste. Après la répétition, tous ces musiciens m'ont fait une surprise en m'invitant à un grand souper où l'on m'a offert une coupe de vermeil de la part des principaux artistes de Prague, avec force vivats, couronnes, applaudissements, discours (Liszt en a fait un vraiment superbe de chaleur et d'enthousiasme, dont les termes sont trop beaux pour que je te les répète ici). Puis, sont venus le prince de Rohan, notre compatriote, Dreyschok, le directeur du Conservatoire, les deux maîtres de chapelle du théâtre et de la cathédrale, les premiers critiques musicaux de la ville, etc. J'ai (parmi mes toasts) porté la santé de ces derniers que je n'avais pas encore vus, n'ayant pas fait une seule visite à la presse, en les remerciant de leur bienveillance que je méritais peu, puisqu'ils devaient me trouver au moins impoli à leur égard, mais je pensais leur faire honneur par ma grossièreté. Cette phrase les a fait tous prodigieusement rire et les a flattés quand ils l'ont eu comprise. Ceux de Vienne aiment mieux autre chose. Ils ont cependant dû s'en passer aussi; mais il y a, parmi eux, deux Charles Maurice qui m'en garderont toujours rancune.
Ils m'ont fait hier promettre de revenir monter ici la Damnation de Faust, dès que cette partition aura été donnée à Paris; j'ai encore quatre grands morceaux à faire pour la terminer.
On m'écrit lettres sur lettres de Brunswick pour me faire arriver; le concert y est affiché, et j'y serai le 21. Adieu; mille amitiés à tous les nôtres. Les détails sur la malheureuse affaire de David[73] m'ont fait frissonner. L'article de Duchesne, dans les Débats, était terrible dans sa froide impartialité. Mais aussi, quelle idée de vouloir monter sur le Sinaï quand on est de courte haleine et de vouloir porter les tables de la Loi quand on n'a pas le bras fort!... Ce sujet ne lui allait pas du tout. Je te fais à son sujet la même recommandation que tu m'adressais dans ta dernière lettre: ne dis pas que je t'aie rien écrit là-dessus.
Adieu encore; je suis un peu fatigué de tous ces cris, de toutes ces embrassades, de toutes ces rasades d'hier. Mais je me promets de l'exécution de Roméo un plaisir immense et que j'avoue sans pudeur, comme feraient certains académiciens.—Ils chantent maintenant ici les thèmes de la Fantastique (l'Idée fixe et le Bal) jusque dans les rues. Ils ont fait des phrases de cette symphonie une sorte d'argot musical. Quand on rencontre une femme,
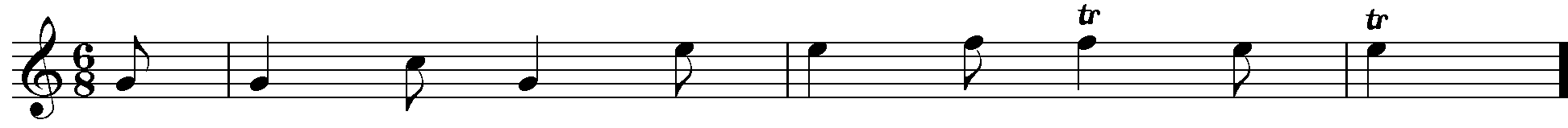
signifie qu'elle a l'air commun et hardi.
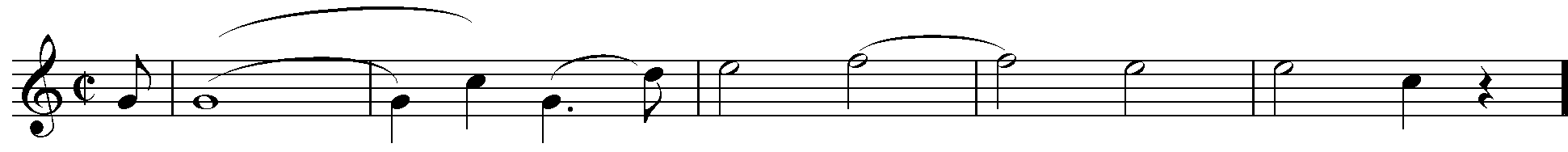
veut dire qu'elle est charmante.
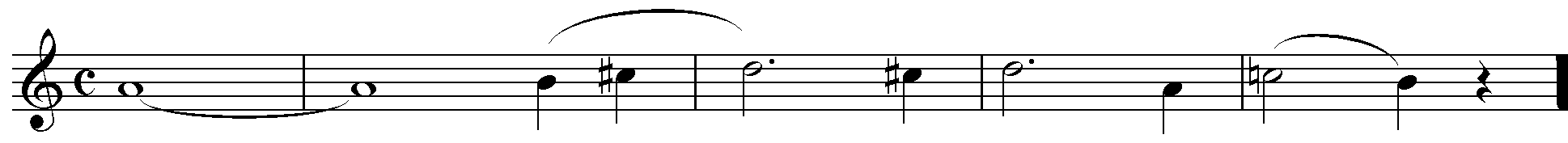
veut dire qu'on est triste et inquiet.
Mon troisième et dernier concert à Prague aura lieu demain; cela fait le sixième en tout que j'y aurai donné cet hiver en deux visites.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
Paris, 26 août 1847.
Ta lettre m'a été renvoyée ici par ma sœur; je n'ai pas encore quitté Paris, grâce aux oscillations, aux tripotages de l'Opéra.
Maintenant, je suis libre de partir pour la Côte. J'ai signé dernièrement un engagement pour Londres incomparablement plus avantageux que celui qu'on m'offrait à regret ici[74]. J'ai donc rendu leur dernière parole à MM. les directeurs de l'Opéra et j'ai accepté la proposition que m'a faite Jullien (le directeur du théâtre de Drury Lane) de conduire l'orchestre. Il me donne pour cela dix mille francs, plus dix autres mille francs pour monter quatre concerts avec ma musique; en outre, il m'engage pour écrire un opéra en trois actes destiné à la seconde année. Je ne serai occupé à Londres que quatre mois de l'année. Tu vois qu'il n'y avait pas à hésiter et que j'ai dû définitivement renoncer à la belle France pour la perfide Albion.
Je vais écrire encore une lettre pour les Débats et je partirai pour la Côte. La première sur Vienne a paru avant-hier. Je t'adresserai celles sur la Russie: c'est convenu.
Je m'attends à être passablement assommé par les conversations côtoises, viennoises et grenobloises; mais je suis bronzé à ce sujet depuis longtemps et je pense que je me tirerai à mon honneur de cette nouvelle épreuve.
D'après ce que tu me narres, je vois d'ailleurs que nous sommes beaucoup moins melons en Dauphiné qu'en Provence. On s'y occupe même énormément de littérature moderne,—pour la dénigrer, bien entendu. On en est à Voltaire; mais enfin on lit, et, comme aux bords de la Garonne...
On lit, on jase, on déraisonne,
On absurde un petit moment...
Il faut faire le verbe absurder.
Si je pars assez tôt pour la Côte, comme tu ne reviens qu'en octobre, je suis fort capable d'aller te dire bonjour à Avignon.
A M. TAJAN-ROGÉ[75].
Londres, 10 novembre 1847.
Mon cher Rogé,
Je serais bien coupable de n'avoir pas encore répondu à votre aimable lettre, si les deux cent mille tracas de toute espèce qui m'ont assailli à mon retour à Paris ne me servaient d'excuse. Vous n'avez pas une idée exacte de mon existence dans cette infernale ville, qui prétend être le centre des arts. Je viens d'y échapper enfin. Me voilà en Angleterre avec une position indépendante (financièrement parlant) et telle que je n'avais pas osé l'ambitionner. Je suis chargé de la direction de l'orchestre du grand opéra anglais qui va s'ouvrir à Drury-Lane dans un mois; de plus, je suis engagé pour quatre concerts composés exclusivement de mes ouvrages, et en troisième lieu pour écrire un opéra en trois actes destiné à la saison de 1848. L'opéra anglais ne durera que trois mois cette année et ne pourra avoir qu'une troupe de chanteurs fort incomplète à cause de la précipitation avec laquelle il vient d'être organisé et d'une circonstance fatale qui nous privera cette année du concours de Pischek (un artiste allemand merveilleux sur lequel nous comptions). Le directeur est prêt à tous les sacrifices et ne compte que sur la seconde année. Les chœurs et l'orchestre en revanche sont splendides. Pour mes concerts, nous ne commencerons qu'en janvier; je crois qu'ils marcheront bien. Jullien (le directeur) est un homme d'audace et d'intelligence qui connaît Londres et les Anglais mieux que qui que ce soit. Il a déjà fait sa fortune et il s'est mis en tête de construire la mienne. Je le laisse faire, puisqu'il ne veut, pour y parvenir, employer que des moyens avoués par l'art et le goût. Mais la foi me manque... J'ai eu le plaisir de voir une fois madame Rogé à Paris; elle est sans doute allée vous rejoindre maintenant. J'ai présenté votre ami à Alfred de Vigny, qui l'a engagé à venir le voir de temps en temps et à recourir à son intervention dans toutes les affaires littéraires pour lesquelles il pourrait le servir.
Vous me demandez des notes pour votre brochure; mais je ne sais vraiment rien de plus que ce que je vous ai dit. Nos artistes deviennent de plus en plus malheureux, parce que la direction des arts devient pire. Voilà pourtant une anecdote qui pourra figurer dans votre travail. Pendant les derniers temps de la direction Pillet, les répétitions générales devenaient de plus en plus nombreuses pour les ouvrages nouveaux, sans que les besoins de l'exécution en fissent sentir la nécessité. Comme les musiciens s'en plaignaient, un jour, Habeneck et Tulou, qui connaissaient la cause de ce surcroît de travail, finirent par leur répondre: «Eh! applaudissez donc madame X.....! Vous ne voyez pas qu'elle enrage de votre silence, et tant qu'elle n'aura pas eu un succès de répétition, un succès d'orchestre, elle vous fera piocher comme des galériens!» En effet, l'orchestre, qui voulait en finir, se décida le lendemain à lui faire un bruyant accueil, et la diva, satisfaite, trouva que l'ouvrage marchait bien et qu'on pouvait afficher la première représentation. Que dites-vous de ce système d'extraction de l'enthousiasme[76]?... Voilà l'Opéra débarrassé de madame X....., mais Dieu sait s'il marchera moins mal pour cela. Tout le monde pense que ce sera exactement de même que sous Pillet. Duponchel et Roqueplan n'ont pas plus de savoir que lui et détestent bien davantage toute tendance musicale. Les conséquences sont faciles à prévoir. J'ai failli entrer dans cette détestable officine comme directeur de l'exécution chorale; mais le bonheur a voulu que je pusse faire volte-face à temps, en conservant tous les avantages. J'ai voulu garder à l'égard des directeurs une position d'ami de la maison, que je suis heureux de laisser maintenant sur le dos de mon successeur au Journal des Débats. Je ne reprendrai mes feuilletons qu'en rentrant en France, au mois de mars, ou même plus tard. J'aurai cinq ou six mois de bon temps, chaque année. Je suis engagé ici pour six ans. Je publierai seulement pendant mon séjour à Londres, cet hiver, la suite de mes lettres sur mes excursions musicales. Vous avez peut-être vu les trois premières sur Vienne et Pesth. Je vais maintenant écrire celles de Prague et de la Russie. J'ai conservé de Pétersbourg un souvenir bien vif, et je vous avoue, malgré votre désir extrême d'en sortir, que j'y reviendrais avec grande joie. Rappelez-moi à la mémoire de tous ces artistes, vos confrères, qui m'ont si chaleureusement secondé, de la famille Mohrer, de madame Merss, de cet excellent Cavos et de Romberg (à qui je dois écrire sous peu), et surtout de Guillou, ce véritable artiste, cordial, intelligent, dévoué, dont je suis si heureux d'avoir fait la connaissance. Dites-lui bien qu'il ne regrette pas trop Paris et qu'il y mourrait d'une colère contenue, s'il était obligé de l'habiter maintenant.
Desmarest a été bien sensible à votre souvenir. Je vous le dis, parce que, sans aucun doute, il ne vous l'aura pas dit lui-même, il est trop Parisien pour vous avoir répondu. Sa place à l'Opéra est devenue meilleure, sans être bien merveilleuse; pourtant, si je pouvais parvenir à le caser convenablement ici, il m'a avoué qu'il m'y suivrait de grand cœur. J'en serais heureux sous tous les rapports; mais il n'y a pas beaucoup de chance en notre faveur. Tout est pris, et bien pris.
Je suis venu seul à Londres; vous pouvez en deviner les raisons. D'ailleurs, j'avais un prodigieux besoin de cette liberté qui m'a toujours et partout manqué jusqu'ici. Il a fallu non pas un coup d'État, mais bien une succession de coups d'État pour parvenir à la reprendre. Cependant, tant que nous n'aurons pas commencé nos grandes répétitions, l'isolement où je vis une grande partie de mon temps me paraîtra étrange.
Puisque j'en suis à vous faire des confidences, croiriez-vous que je me suis laissé prendre à Pétersbourg par un amour véritable autant que grotesque?... (Ici je vous laisse rire à grand orchestre et dans le mode majeur!... Allez! allez! ne vous gênez pas...) Je continue.—Par un amour poétique, atroce et parfaitement innocent (avec ou sans calembour), pour une jeune (pas trop jeune) fille qui me disait: «Je vous écriverai» et qui, en parlant des obsessions de sa mère pour la marier, ajoutait: «C'est une scie!» Combien de promenades nous avons faites ensemble dans les quartiers excentriques de Pétersbourg et jusque dans les champs, de neuf à onze heures du soir!... Que de larmes amères j'ai versées quand elle me disait comme la Marguerite de Faust: «Mon Dieu, je ne comprends pas ce que vous pouvez trouver en moi... je ne suis qu'une pauvre fille bien au-dessous de vous... il n'est pas possible que vous m'aimiez ainsi, etc., etc.» C'est pourtant si possible que c'est vrai, et que j'ai pensé mourir de désespoir quand j'ai passé devant le Grand-Théâtre en quittant en poste Pétersbourg. De plus, j'ai été réellement malade à Berlin de ne pas y trouver une lettre d'elle. Elle m'avait tant promis qu'elle m'écriverait!... Elle est sans doute mariée maintenant. Son fiancé, qui partit le soir de mon premier concert, est certainement revenu depuis longtemps.
O Dieu! je nous vois encore sur le bord de la Newa, un soir, au soleil couchant.... Quelle trombe de passion! Je lui broyais le bras contre ma poitrine; je lui chantais la phrase de l'adagio de Roméo et Juliette:
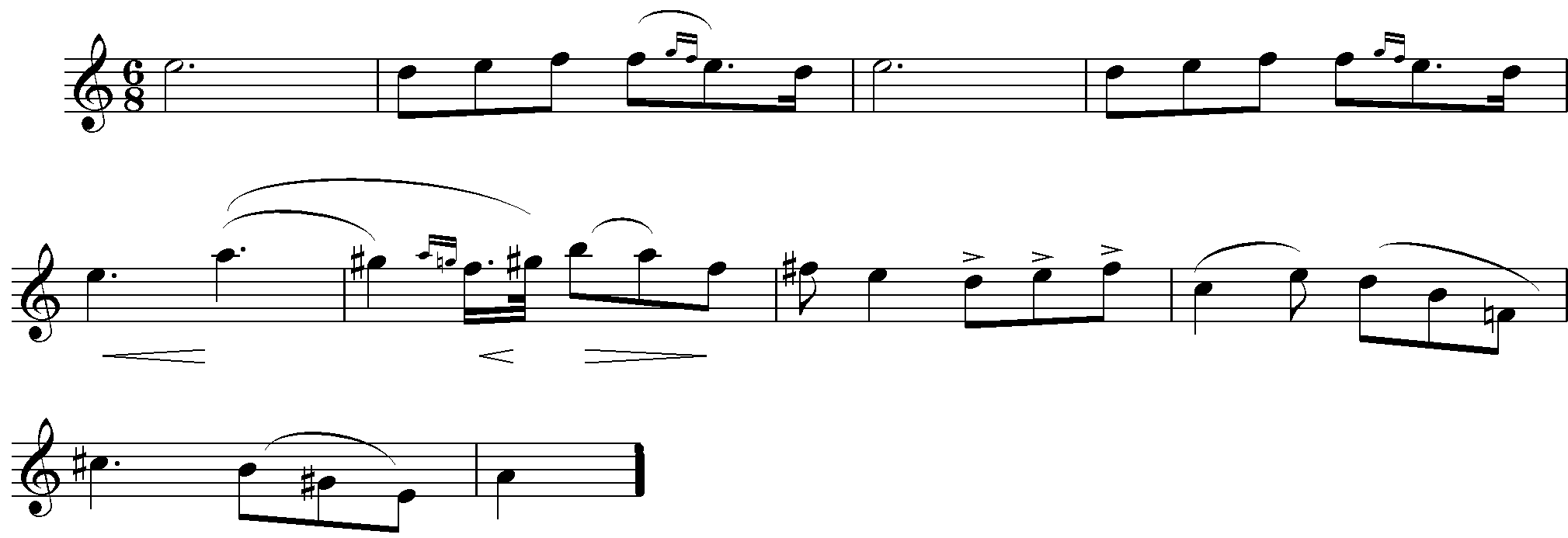
je lui promettais, je lui offrais, tout ce que je pouvais promettre et offrir.... et je n'ai pas obtenu seulement deux lignes depuis mon départ. Je ne suis pas même sûr que ce soit elle qui m'a fait un signe d'adieu de loin au moment de monter en voiture à la poste!.... Adieu, adieu. Vous m'écriverez, au moins, vous.
A M. AUGUSTE MOREL.
Londres, 31 novembre [1847]. Harley street, 76.
Mon cher Morel,
Jullien me charge de vous écrire confidentiellement pour savoir de vous la vérité sur le succès de l'opéra de Verdi[77]. Peu importe le mérite de l'œuvre, c'est une question de directeur que je vous transmets.
Nous n'ouvrirons pas avant huit jours; la Fiancée de Lammermoor par madame Gras et Reeves ne peut à mon sens manquer de bien marcher. Reeves a une jolie voix naturelle et il chante aussi bien que cette effroyable langue anglaise puisse permettre de chanter.
Le baryton Withworth est moins bien; nous attendons tous les jours Staudigl. On monte, en attendant, l'opéra de Balfe. L'orchestre est superbe, et, à part quelques imperfections de justesse dans les instruments à vent, on n'en trouverait guère de meilleur. Nous avons 120 choristes qui vont bien aussi. Tout ce monde m'a fait un accueil très chaleureux, le jour où Jullien a fait jouer dans un de ses concerts l'Invitation à la valse. L'orchestre m'a fait une ovation et le public a redemandé le morceau de.... Weber! et puis nous avons bien des artistes français et allemands et italiens qui me connaissaient déjà et me sont tout dévoués. Tels sont Tolbecque, Rousselot, Sainton, Piatti, Eisenbaum, Beauman, etc., etc. Je ne commencerai mes concerts qu'au mois de janvier.
Maintenant seriez-vous assez bon pour aller chez Th. Gautier, villa Beaujon, avenue Byron, nº 14 (pardon de la course), lui demander une réponse à la lettre que je lui écrivis il y a plus de quinze jours; il s'agissait d'un ballet que Jullien lui demande immédiatement pour mademoiselle Fuoco et qui doit être mis en scène par Coralli père. Jullien a besoin de savoir tout de suite si Gautier consent à le faire, à quelles conditions, et s'il peut livrer le manuscrit avant le 15 décembre.
Je vous en prie, acceptez cette corvée; mille amitiés à Desmarest. Je m'ennuie terriblement dans le joli appartement que Jullien m'a donné. J'ai reçu pourtant force invitations depuis que je suis ici, et votre ami M. Grimblot a la bonté de me venir voir souvent. Il m'a fait recevoir de son club; mais Dieu sait le divertissement qu'on peut trouver dans un club anglais! Macready a donné en mon honneur un magnifique dîner, il y a huit jours; c'est un homme charmant et point du tout prétentieux dans son intérieur. Il est terrible aux répétitions, et il a raison de se montrer tel. Je l'ai vu, l'autre jour, dans une nouvelle tragédie, Philippe d'Artevelde; il y est superbe, et il a mis en scène la pièce d'une manière vraiment extraordinaire: personne ici n'entend comme lui l'art de grouper les masses populaires et de les faire agir. C'est admirable.
AU MÊME.
Londres, 8 décembre [1847]
Mon cher Morel,
Toujours des commissions!... Soyez assez bon pour aller au reçu de cette lettre chez mon graveur Parent, 43, rue Rochechouart, et lui dire qu'il m'envoie tout de suite par la diligence les parties d'instruments à vent, harpe et timbales, etc., d'Harold, en double, comme je lui ai indiqué dans une note qu'il a entre les mains; plus, la feuille volante des altos où se trouvait une faute qu'il doit avoir corrigée; plus les exemplaires fautifs que je lui ai renvoyés de Londres. J'en ai besoin pour vérifier les corrections. En outre, s'il ne peut m'envoyer une épreuve telle quelle de la partition, il m'en renverra le manuscrit. Je vous recommande de vous assurer de la voie par laquelle tout ceci me parviendra, car vous comprenez que je ne voudrais pas perdre votre partition.
Maintenant, je dois vous dire que l'ouverture de notre grand opéra a eu
un succès immense; toute la presse anglaise s'accorde à nous louer.
Madame Gras et Reeves, le ténor (dans Lucie), ont été rappelés quatre
ou cinq fois avec frénésie. Et vraiment l'un et l'autre le méritaient.
Reeves est une découverte sans prix pour Jullien; il a une voix
charmante, d'un timbre essentiellement distingué et sympathique, il est
très bon musicien, sa figure est très expressive et il joue avec son feu
national d'Irlandais. A mon entrée à l'orchestre, la salle m'a fait une
superbe réception. Nous avons joué pour commencer la belle ouverture
d'Éléonore de Beethoven, nº 1, superbement. On a redemandé dans
Lucie le grand sextuor en ré ![]() , qui commence le final du second
acte, et ce soir, à la seconde représentation, on a en outre redemandé
le chœur en mi
, qui commence le final du second
acte, et ce soir, à la seconde représentation, on a en outre redemandé
le chœur en mi ![]() du toisième acte.
du toisième acte.
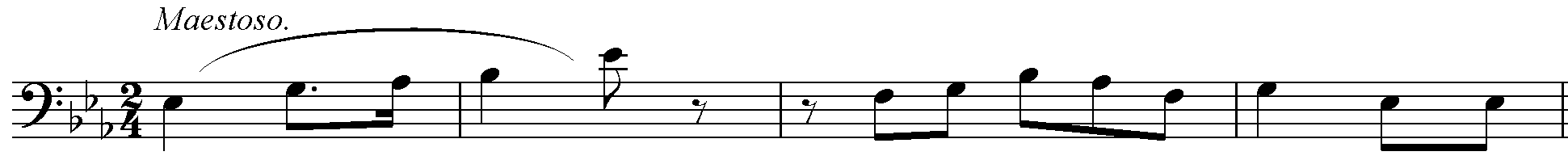
Les Anglais sont dans la stupéfaction d'entendre dans un théâtre anglais cette masse de cent vingt choristes et ce bel orchestre, et d'avoir un pareil ténor et une telle prima donna. Il n'y a que le ballet qui est misérable, mais nous aurons mieux dans quelque temps.
Je vais commencer à répéter mes symphonies un mois et demi d'avance, dès que les parties d'orchestre et la partition d'Harold me seront parvenues.
Mille pardons de vous faire ainsi courir pour cette affaire, mais je n'ose me fier qu'à vous.
AU MÊME.
Londres, 14 janvier 1848.
Mon cher Morel,
Votre lettre m'a fait bien plaisir; je vous en remercie. Si je ne me trompe, elle s'est croisée avec la dernière que je vous ai écrite; car vous ne me dites rien dans la vôtre des journaux que je vous demandais, ni des informations que je vous priais de prendre au sujet d'une commission donnée à Brandus, dont je n'avais point de nouvelles. Je fais ici un métier de cheval de moulin, répétant tous les jours de midi à quatre heures et conduisant tous les soirs l'opéra de sept heures à dix heures. Depuis avant-hier seulement, nous n'avons pas de répétitions et je commence à me remettre d'une grippe qui m'inquiétait, ainsi traitée par la fatigue et les vents froids du théâtre. Vous avez eu sans doute déjà connaissance de l'horrible position où Jullien s'est mis et nous a entraînés tous avec lui. Cependant, comme il faut ruiner son crédit à Paris le moins possible, ne parlez à personne de ce que je vais vous dire. Ce n'est pas l'entreprise de Drury-Lane qui a renversé sa fortune; elle était déjà détruite avant l'ouverture, et il avait sans douta compté sur de fortes recettes pour la relever. Jullien est toujours le même fou que vous avez connu; il n'a pas la moindre idée des nécessités d'un théâtre lyrique, ni des nécessités même les plus évidentes pour une bonne exécution musicale. Il a ouvert son théâtre sans avoir une seule partition à lui, et à l'exception de l'opéra de Balfe qu'il a bien fallu faire copier, nous ne vivons jusqu'à présent que sur le bon vouloir des agents de Lumley, qui nous prêtent les parties d'orchestre des opéras italiens que nous montons. Jullien est en ce moment à faire sa tournée de province, gagnant beaucoup d'argent avec ses concerts-promenades; le théâtre fait ici chaque soir des recettes fort respectables, et, en résumé, après nous avoir fait consentir à la réduction d'un tiers de nos appointements, nous ne sommes pas payés du tout. On paye seulement chaque semaine les choristes, l'orchestre et les ouvriers, afin que le théâtre puisse marcher. Cependant Jullien a vendu il y a quinze jours son magasin de musique de Regent's street près de deux cent mille francs... et je ne puis me faire payer, et les acteurs principaux, le peintre décorateur, les maîtres de chant et de ballet et de mise en scène, tout ce monde est dans le même cas que moi... Concevez-vous rien à cela?
Cependant, il proteste que nous ne perdrons rien, et nous allons toujours, et le public ne demande qu'à venir. Mais le crédit de Jullien à Londres est perdu entièrement... Mon concert est toujours annoncé pour le 7 février. Je n'ai pas voulu ces jours-ci faire de nouvelles répétitions. Je vais les reprendre toutefois jeudi prochain. Nous avons maintenant l'espérance que le théâtre ne fermera pas, grâce à un emprunt qu'un éditeur de musique a procuré à M. Gye, le délégué de Jullien en son absence.
Si Jullien à son retour ne me paye pas, je tâcherai de m'arranger avec Lumley et de donner des concerts au théâtre de la Reine. Car il y a maintenant ici une belle place à prendre pour moi, place laissée vacante par la mort de ce pauvre Mendelssohn. Tout le monde me le répète du matin au soir, la presse et les artistes sont très bien disposés pour moi. Déjà les deux répétitions que j'ai faites d'Harold et du Carnaval romain, et de deux parties de Faust, leur ont fait ouvrir de grands yeux et d'immenses oreilles: j'ai lieu de croire que c'est ici que je dois me faire une belle position. Quant à la France, je n'y pense plus, et Dieu me préserve de céder à des tentations comme celle que vous me donniez dans votre dernière lettre, de venir donner un concert à Paris au mois d'avril. Si jamais j'ai assez d'argent pour DONNER des concerts à mes amis de Paris, je le ferai; mais ne me croyez plus assez simple pour compter sur le public pour en faire les frais. Je ne ferai pas de nouveaux appels à son attention pour ne recueillir que l'indifférence, et perdre l'argent que je gagne avec tant de peines dans mes voyages. Ce sera un grand chagrin pour moi, car les sympathies de mes amis de France me sont toujours les plus chères. Mais l'évidence est là: comparaison faite des impressions que ma musique a produites sur tous les publics de l'Europe qui l'ont entendue, je suis forcé de conclure que c'est le public de Paris qui la comprend le moins. Ai-je jamais vu à Paris, dans mes concerts, des gens du monde, hommes et femmes, émus comme j'en ai vu en Allemagne et en Russie? Ai-je vu des princes du sang s'intéresser à mes compositions au point de se lever à huit heures du matin, pour venir, dans une salle froide et obscure, les entendre répéter, comme faisait à Berlin la princesse de Prusse? Ai-je jamais été invité à prendre la moindre part aux concerts de la cour? La société du Conservatoire, ou du moins ceux qui la dirigent, ne me sont-ils pas hostiles? N'est-il pas grotesque qu'on joue dans ces concerts les œuvres de tout ce qui a un nom quelconque en musique, excepté les miennes?... N'est-il pas blessant pour moi de voir l'Opéra avoir toujours recours à des ravaudeurs musicaux, et ses directeurs toujours armés contre moi de préventions que je rougirais d'avoir à combattre, si la main leur était forcée? La presse ne devient-elle pas ignoble de jour en jour? y voyons-nous autre chose maintenant (à de rares exceptions près) que de l'intrigue, de basses transactions et du crétinisme?
Les gens mêmes que j'ai tant de fois obligés et soutenus par mes feuilletons en ont-ils montré jamais la moindre reconnaissance réelle? Et croyez-vous que je sois la dupe d'une foule de gens au sourire empressé, et qui ne cachent leurs ongles et leurs dents que parce qu'ils savent que j'ai des griffes et des défenses?..... Ne voir partout qu'imbécillité, indifférence, ingratitude ou terreur... voilà mon lot à Paris. Encore si mes amis y étaient heureux! Mais, loin de là, vous êtes presque tous esclaves, dans des positions gênantes et gênées; je ne puis rien pour vous et vos efforts pour moi sont impuissants.
La France donc est effacée de ma carte musicale, et j'ai pris mon parti d'en détourner le plus possible mes yeux et ma pensée. Je ne suis pas aujourd'hui dans la moindre disposition mélancolique, je n'ai pas de spleen; je vous parle avec le plus grand sang-froid, la plus entière lucidité d'esprit. Je vois ce qui est.
Un vif regret pour moi, dans mes absences de plus en plus fréquentes de Paris, c'est de ne pas vous voir; et vous n'en doutez pas, j'espère. Vous savez combien j'apprécie la rectitude de jugement, la bonté d'âme et l'amour de l'art dont vous m'avez donné tant de preuves. Pardonnez-moi donc de vous faire aussi franchement ma profession de foi nationale.
A M. ALEXIS LWOFF[78].
Londres, 29 janvier 1848.
Mon cher général,
C'est un malade qui vous écrit; en conséquence, ne le grondez pas trop d'avoir tant tardé à vous répondre. Je suis fâché que vous ayez pu me croire contrarié de la publication de ma lettre sur Ondine. Elle ne contenait rien que je tinsse fort à garder secret: mes sentiments d'amitié pour vous d'abord, ma haute estime pour vos rares talents ensuite, et enfin mes observations sur l'insalubrité des ténors auxquels nous sommes généralement exposés, nous tous qui avons le malheur de chercher des intelligences servies par une voix. Mes plaisanteries sur eux m'auront valu quelques douzaines d'ennemis intimes de plus; mais je m'en moque comme d'un opéra comique sur lequel je n'ai pas de feuilleton à faire. Mieux que cela, j'en suis fort aise: j'aime à être détesté des crétins, ils m'autorisent ainsi à leur rendre la pareille.
A propos de crétins, si vous saviez dans quelle crétinière je suis tombé ici!... Mais Dieu sait qui dirige le directeur de ce malheureux théâtre!..... Figurez-vous que cela s'appelle Académie royale de musique, Grand-Opéra anglais, et que, depuis que l'ouverture s'en est faite, c'est-à-dire depuis deux mois, je n'ai à conduire que du Donizetti et du Balfe, Lucia, Linda di Chamounix, the Maid of honour. Nous avions un orchestre superbe; le directeur en a emmené la fleur avec lui dans sa tournée de province où il donne des concerts populaires; et nous devons nous contenter de ce qu'il n'a pas voulu, et marcher quand même.
J'entends des raisonnements sur la musique, sur le public, sur les artistes, qui feraient les quatre cordes de votre violon se rompre de colère, si elles pouvaient les entendre; je subis des chanteuses anglaises qui feraient se briser et se tordre les crins de votre archet...
On m'a engagé aussi pour quatre concerts; je donnerai le premier dans huit jours, le 7 février. Nous n'avons pas encore pu avoir une seule fois l'orchestre complet pour les études. Ces messieurs viennent quand il leur plaît et s'en vont à leurs affaires, les uns au milieu, les autres au quart des répétitions. Le premier jour, je n'ai point eu de cors du tout; le second, j'en ai eu trois; le troisième, j'en ai eu deux qui sont partis après le quatrième morceau. Voilà comment on entend la subordination dans ce pays-ci. Les choristes seuls me sont dévoués presque autant que ceux de Saint-Pétersbourg... Oh! la Russie! et sa cordiale hospitalité, et ses mœurs littéraires et artistiques, et l'organisation de ses théâtres et de sa chapelle, organisation précise, nette, inflexible, sans laquelle, en musique comme en beaucoup d'autres choses, on ne fait rien de bon ni de beau, qui me les rendra? Pourquoi êtes-vous si loin?...
Tenez, général, je suis depuis cinq jours malade, au lit, d'une bronchite violente; c'est la colère, le dégoût et le chagrin qui me l'ont donnée. Pourtant il y a beaucoup à faire ici, à cause du public, qui est attentif, intelligent et vraiment amateur d'œuvres sérieuses.
J'ai entendu le dernier oratorio de ce pauvre Mendelssohn (Elie). C'est magnifiquement grand et d'une somptuosité harmonique indescriptible. J'espère que les inquiétudes dont vous me parlez et qui vous agitent sont dissipées maintenant et que madame Lwoff est rétablie. Veuillez lui présenter mes respectueux hommages. Vous me demandez où je compte passer l'été; je n'en sais rien. Pourtant il est à croire que j'irai visiter encore Nice, comme je fais toujours quand j'ai passé un rude hiver. En tout cas, on vous dira à Paris où je serai; je vous en prie, ne manquez pas de me trouver et de faire que je vous trouve: je serai si heureux de vous voir!...
Vous êtes mille fois bon d'avoir parlé de moi à Sa Majesté et de me laisser encore l'espoir de me fixer près de vous quelque jour. Je ne me berce pas beaucoup de cette idée: tout dépend de l'empereur. S'il voulait, nous ferions de Pétersbourg en six ans le centre du monde musical.
Je n'ai pas eu la moindre nouvelle des comtes Wielhorski; j'ai écrit au comte Michel, il ne m'a pas répondu. La crainte qu'il ne voie dans mes lettres un but intéressé m'empêche de lui écrire de nouveau: j'ai tellement peur d'avoir l'air d'un solliciteur!... Et, pourtant, Dieu sait combien j'ai conservé de vive reconnaissance pour toute les bontés qu'ils ont eues l'un et l'autre pour moi, l'an dernier!
On joue, ce soir, à Drury-Lane, Linda di Chamounix; j'ai le bonheur d'être malade, je ne conduis pas. Je vais tâcher de dormir comme on dort dans une chambre bien close quand on entend pleuvoir à verse au dehors.
A M. AUGUSTE MOREL.
Londres, samedi, 12 février 1848.
Mon cher Morel,
Ce n'est qu'aujourd'hui seulement que j'ai le temps de vous écrire. Mon concert a eu lieu lundi dernier avec un éclatant succès; l'exécution a été magnifique de verve, de puissance et de précision. Nous avions fait cinq répétitions d'orchestre et dix-huit pour le chœur. Ma musique a pris sur le public anglais comme le feu sur une traînée de poudre; j'ai été rappelé après le concert. On a encore redemandé (comme ailleurs) la marche Hongroise et la scène des Sylphes. Tout ce qui a quelque importance musicale dans Londres était à Drury-Lane ce soir-là, et la plupart des artistes de quelque valeur sont venus après le concert me féliciter. Ils ne s'attendaient à rien de pareil; ils croyaient à une musique diabolique, incompréhensible, dure, sans charme...—Il faut voir comment ils arrangent maintenant nos critiques de Paris. Davison lui-même a fait un article dans le Times dont on lui a, faute de place, ôté la moitié; ce qui en est resté a produit son effet néanmoins. Mais je ne sais ce qu'il pense au fond: avec des opinions comme les siennes, il faut s'attendre à tout. Le vieux Hogarth du Daily News était dans une agitation des plus comiques: «J'ai tout mon sang en feu, m'a-t-il dit; jamais de ma vie je n'ai été excité de la sorte par la musique.» Maintenant je cherche comment je pourrai donner mon second concert. Jullien ne payant plus ses musiciens ni ses choristes, je n'ose m'exposer au danger de les voir me manquer au dernier moment. Hier soir, après Figaro, la défection a commencé. Les cors m'ont averti qu'ils ne viendraient plus. Et mes appointements courent les champs... Dieu sait si je les attraperai jamais.
AU MÊME.
Londres, 6 mars [1848].
Mon cher Morel,
Que devenez-vous? Pourquoi ne m'écrivez-vous pas un mot? Où en sont vraiment les affaires musicales? Je l'ai demandé à Desmarest il y a huit jours et, comme de raison, il ne m'a pas répondu. Il faut convenir que Paris est un aimable séjour, et que c'est là, surtout, qu'on peut s'écrier comme je ne sais quel ancien: «O mes amis! il n'y a plus d'amis!» Que le feu du ciel et celui de l'enfer se réunissent pour brûler cette damnée ville... Quand serai-je donc arrivé à ne plus songer à ce qu'on y fricotte!... J'espère que nous allons au moins être débarrassés du droit des hospices sur les concerts; j'espère qu'il n'y aura plus de subventions pour nos stupides théâtres lyriques; j'espère que les directeurs de ces lieux s'en iront comme ils sont venus, et au plus vite; j'espère qu'il n'y aura plus de censure pour les morceaux de chant; j'espère enfin que nous serons libres d'être libres, sinon nous avons une nouvelle mystification à subir.
Que devient M. Bertin? On dit ici qu'il se cache... Que deviennent tous nos précieux ennemis (precious villains), comme dit Shakspeare?
A JOSEPH D'ORTIGUE.
76, Harley street, London, 15 mars 1848.
Mon cher d'Ortigue,
Il y a longtemps que je veux t'écrire et, c'est aujourd'hui seulement que j'en trouve le temps. La vie de Londres est encore plus absorbante que celle de Paris; tout est en proportion de l'immensité de la ville.
Je me lève à midi; à une heure, viennent les visiteurs, les amis, les nouvelles connaissances, les artistes qui se font présenter. Bon gré, mal gré, je perds ainsi trois bonnes heures. De quatre à six, je travaille; si je n'ai pas d'invitation, je sors alors pour aller dîner assez loin de chez moi; je lis les journaux; après quoi vient l'heure des théâtres et des concerts: je reste à écouter de la musique telle quelle jusqu'à onze heures et demie. Nous allons enfin trois ou quatre artistes ensemble souper dans quelque taverne et fumer jusqu'à deux heures du matin. Voilà ma vie extérieure... Tu sais, plus ou moins bien, le succès brusque et violent de mon concert de Drury-Lane. Il a déconcerté en quelques heures toutes les prévisions favorables ou hostiles et renversé l'édifice de théories que chacun s'était faites ici sur ma musique d'après les critiques tricornues du continent. Dieu merci! la presse anglaise tout entière s'est prononcée avec une chaleur extraordinaire, et, à part Davison et Gruneisen, je ne connaissais pas un des rédacteurs.
C'est différent maintenant; les principaux d'entre eux sont venus me voir, m'ont écrit et nous avons ensemble de fréquentes et cordiales relations. Il y avait bien longtemps que je n'avais éprouvé une satisfaction aussi vive qu'en lisant l'article de l'Atlas que j'ai envoyé à Brandus et qu'il n'a pas fait traduire. Il est de M. Holmes, l'auteur d'une Vie de Mozart extrêmement admirée ici.
M. Holmes était venu dans la persuasion qu'il allait entendre des duretés, des folies, des non-sens, etc.
Je t'assure que tu eusses été bien heureux de cette grande victoire. Il faut maintenant poursuivre l'ennemi et ne pas s'endormir à Capoue. Jullien ne m'a pas payé, tu le sais. Son théâtre est maintenant un cirque équestre. Les deux théâtres italiens se disputent à qui exécutera le mieux les chefs-d'œuvre italiens. On a joué hier soir l'Attila de Verdi au théâtre de la Reine... Après l'Attila, holà! Les directeurs de Covent-Garden désirent monter un concert shakspearien, composé de Roméo, le Roi Lear, la Ballade sur la mort d'Ophélie et la Tempête. Nous avons eu ensemble une conférence avant-hier, à ce sujet, et je leur ai déclaré qu'à aucun prix, je ne consentirais à organiser cette exécution, s'ils ne m'assuraient quinze jours d'étude pour les voix et quatre répétitions pour l'orchestre. Ils se concertent maintenant à ce sujet.
La Société philharmonique a commencé ses séances avant-hier. On y a exécuté une symphonie de Hesse (l'organiste de Breslau) bien faite, bien froide, bien inutile; une autre en la de Mendelssohn, admirable, magnifique, bien supérieure, selon moi, à celle également en la qu'on joue à Paris. L'orchestre est très bon; à l'exception de quelques instruments à vent, il n'y a rien à lui reprocher, et Costa le dirige à merveille. Personne ne voulait croire, ce soir-là, que la Société ne m'eût encore rien demandé pour ses concerts; c'est pourtant vrai. On dit qu'ils y seront forcés par les journaux et par leur comité. Mais je ne me livrerai qu'avec de grandes précautions aux pattes de velours de tous les vieillards entêtés qui dirigent l'institution. C'est la répétition des manières du Conservatoire de Paris.
J'aurais trop à te dire sur ces petites vanités fiévreuses et goutteuses; et tu les devines sans peine. En résumé, je resterai ici tant que je pourrai, car il faut du temps pour s'y faire place et s'y créer une position. Heureusement, les circonstances sont favorables. Tôt ou tard, cette position arrivera et sera, me dit-on, solide. Je n'ai plus à songer, pour ma carrière musicale, qu'à l'Angleterre ou à la Russie. J'avais, depuis longtemps, fait mon deuil de la France; la dernière révolution rend ma détermination plus ferme et plus indispensable. J'avais à lutter, sous l'ancien gouvernement, contre des haines semées par un feuilleton, contre l'ineptie de ceux qui gouvernent nos théâtres et l'indifférence du public; j'aurais, de plus, la foule des grands compositeurs que la République vient de faire éclore, la musique populaire, philanthropique, nationale et économique. Les arts, en France, sont morts maintenant, et la musique, en particulier, commence déjà à se putréfier; qu'on l'enterre vite! Je sens, d'ici, les miasmes qu'elle exhale...
Je sens, il est vrai, toujours un certain mouvement machinal qui me fait me tourner vers la France quand quelque heureux événement survient dans ma carrière; mais c'est une vieille habitude dont je me déferai avec le temps, un véritable préjugé.
La France, au point de vue musical, n'est qu'un pays de crétins et de gredins: il faudrait être diablement chauvin pour ne pas le reconnaître. Est-il vrai que Perrot ait perdu sa place? Je ne sais si on a daigné me conserver celle de la bibliothèque du Conservatoire qui me rapportait 118 francs par mois. J'ai écrit à ce sujet au ministre de l'intérieur qui, bien entendu, ne m'a pas répondu.
A M. AUGUSTE MOREL.
Londres, lundi 24 avril 1848.
Mille remerciements, mon cher Morel, pour la peine que vous prenez à mon sujet et pour votre lettre si amicale. C'est une bonne fortune en ce temps-ci d'obtenir de Paris une réponse de ses amis... Il est vrai, comme dit le proverbe, qu'il y a fagots et fagots.
Ne m'écrivez pas avant d'avoir reçu une seconde lettre de moi; je ne sais pas encore où je vais loger. J'ai dû quitter la maison de Jullien il y a quatre jours, une nouvelle saisie y ayant été opérée, au nom de la reine, pour la queen's-tax qu'il n'avait pas payée.
Avant-hier, les journaux de Londres ont annoncé la banqueroute de Jullien, qui, dit-on, est, à cette heure, en prison. Je n'ai donc plus rien à espérer de lui.
Les journaux d'ici s'occupent toujours beaucoup de moi; mais la résistance du comité de la Société philharmonique est quelque chose de curieux: ce sont tous des compositeurs anglais, et Costa est à leur tête. Or, ils engagent M. Molique, ils jouent des symphonies nouvelles de M. Hesse et autres; mais je leur inspire, à ce qu'il paraît, une terreur incroyable. Beale, Davison, Rosemberg et quelques autres se sont mis en tête de les forcer à m'engager. Je laisse faire, nous verrons bien. C'est un vieux mur qu'il me faut renverser, et derrière lequel je trouve, tout à moi, le public et la presse.
Paris semble un peu se rasséréner. Dieu veuille que cela dure et que l'Assemblée soit une véritable représentation de la nation. Alors, en effet, on pourrait espérer quelque grande chose. Mais vous ne sauriez croire combien votre sort, à vous, Morel, et celui de quelques autres de nos amis, me préoccupe et m'inquiète. Comment pouvez-vous vous tirer d'affaire au milieu de cette triomphante débâcle?
AU MÊME.
Londres, 16 mai 1848.
Mon cher Morel,
Je ne puis vous dire combien je suis touché de votre sollicitude à mon sujet et de l'insistance que vous mettez à me faire retourner à Paris. Malheureusement, toute aigreur à part, je suis forcé de vous démontrer que la raison qui me fait rester est une raison d'argent. J'ai encore à recevoir de Beale[79] le prix de deux morceaux qui ne sont pas terminés, et un concert s'organise à peu de frais pour le 29 juin. Si j'y gagne quelques sous, ce sera un grand bonheur, tandis qu'à Paris je suis sûr de n'avoir rien à gagner du tout et, en y allant en ce moment, de perdre le peu que je recevrai ici. Je fais très peu de dépenses à Londres, d'ailleurs; aussitôt que je serai sûr de n'y avoir plus rien à faire, je retournerai à Paris, en souhaitant, sans l'espérer, que vous ne vous abusiez pas sur les chances qui me restent d'y trouver un emploi musical. Peut-être à cette époque MM. Marie, Schœlcher, Pyat, ne seront plus rien; le terrain est mouvant comme du sable. D'ailleurs que peuvent-ils? Il s'agit d'argent, personne n'en a pour les nécessités de la vie; la République a bien à faire d'en dépenser pour le luxe des arts.... Cela saute aux yeux. Et une fois que je serai au bout de ce qui me reste, il n'y aura plus pour moi qu'à aller m'asseoir au coin d'une borne et à y mourir de faim comme un chien perdu, ou à me faire sauter la cervelle. On n'a pas encore fait un acte ni dit un mot qui puisse fournir un argument contre mes prévisions. Mais enfin, comme il en serait de même ici, après l'époque où je n'aurai plus rien à y faire, autant vaut-il crever à Paris qu'ailleurs.
Adieu; quoi qu'il en soit de mon horrible position et de la certitude que j'ai d'être de trop dans le monde, croyez à toute ma reconnaissante amitié et à la confiance que j'ai dans la vôtre.
A M. GUILLAUME LENZ, A SAINT-PÉTERSBOURG.
Paris, 22 décembre 1848.
Comment! si je m'en souviens... Il faudrait que j'eusse à la fois bien peu de cœur et bien peu de mémoire pour ne pas m'en souvenir!... Et nos parties de billard, chez M. le comte Michel[80], parties que nous faisions avec tant de calembours et force carambolages de mots! et tant de cigares fumés, tant de bière bue, tant d'opinions musicales débattues. Non, mon cher monsieur, je n'ai rien oublié, et je vous prie de n'avoir point à mon sujet de ces idées calomniatrices.
Je vous écrirais mille folies, si le ton de votre lettre n'eût été un peu triste: vous m'y parlez, à la façon d'un moribond, des éventualités cholériques... Cela m'a douloureusement ému. Sous l'empire d'une préoccupation semblable, peu de jours avant la réception de votre aimable lettre, j'avais écrit à M. le comte Michel Wielhorski pour lui demander de ses nouvelles. J'espère que tout va bien chez lui.
Notre choléra républicain nous laisse un peu de répit en ce moment; on ne clube plus beaucoup; les rouges rongent leur frein; le suffrage universel nous a donné une majorité foudroyante pour Louis-Napoléon; les paysans comptent ne plus payer d'impôts de longtemps, et fondent de grandes espérances sur les bons conseils que l'empereur donnera à son neveu. Car on sait à quoi s'en tenir sur cette bourde de la mort de l'empereur... Ah bien, oui, il s'est seulement retiré des affaires... On va aussi s'occuper bientôt de la répartition des milliards que Napoléon (le Grand) a rapportés de sa campagne d'Égypte, trésor inépuisable déterré sous la grande Pyramide. Nous allons filer des jours d'or et tout ira de soie.
Pardon de cet indigne calembour! Comme vous devez rire là-bas et vous moquer de nous; de nous, qui nous intitulons les peuples avancés! Savez-vous comment on appelle les bécasses trop faites, les bécasses pourries? Ce sont aussi des bécasses avancées. Enfin, que la volonté de Dieu soit faite! J'ai bien de la bonté, n'est-ce pas? Il est très sûr qu'elle se fera toujours.
Et vous pensez encore à la musique! Barbares que vous êtes! Quelle pitié! au lieu de travailler au grand œuvre, à l'abolition radicale de la famille, de la propriété, de l'intelligence, de la civilisation, de la vie, de l'humanité, vous vous occupez des œuvres de Beethoven!!... Vous rêvez de sonates! vous écrivez un livre d'art[81]!
Ironie à part, je vous en remercie. Nous sommes donc encore quelques vivants adorateurs du beau. Rari... Mais comment faire connaître votre travail dans notre gurgite?
Nous n'avons plus qu'un seul journal musical, la Gazette musicale. J'ai fait part de ce que vous m'avez écrit à M. Brandus, directeur de ce journal, et il paraît fort disposé à insérer des fragments de votre ouvrage, mais il voudrait le connaître.
De mon côté, j'en parlerais avec bien du plaisir dans l'un de mes feuilletons des Débats, quand une partie au moins du livre aurait paru d'une façon ou d'une autre. Je ne sais quel moyen vous indiquer pour me faire parvenir votre manuscrit. Cela me paraît fort délicat. La perte d'un imprimé n'est rien; mais un manuscrit qui s'égare, c'est irréparable. Je crois que le plus sûr serait de le confier à quelqu'un qui aurait le malheur de venir en France, en lui recommandant de me le remettre sans intermédiaire. Cherchez cette occasion, et ne doutez pas de mon empressement à entrer dans vos vues.
Mille amitiés respectueuses à nos excellents amis de la place Michel. Je vous serre la main. Dieu vous garde de la république, et surtout des républicains!
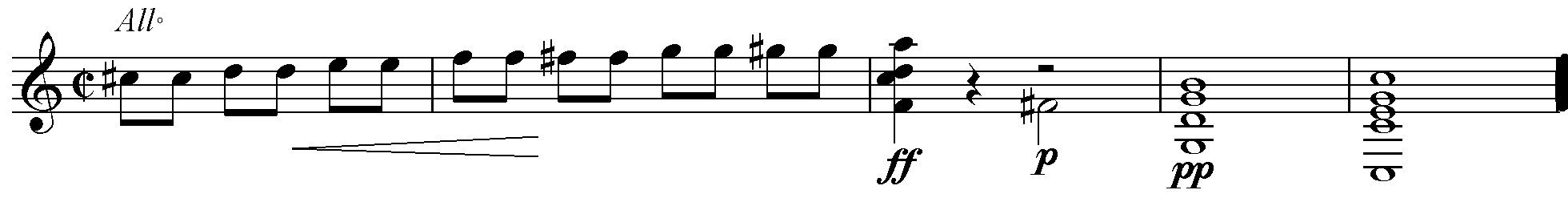
A M. ALEXIS LWOFF.
Paris, 23 février 1849.
Mon cher monsieur Lwoff,
J'ai été très sensible au reproche bienveillant que vous m'adressez au commencement de votre lettre; j'ai vu par là que vous ne saviez pas toute la reconnaissante amitié que j'ai pour vous, amitié bien vive, bien sincère et que le temps et l'absence n'altéreront pas. J'ignorais quelles étaient vos relations avec M. Lenz, et c'est la cause du silence que vous me reprochez. L'indifférence ni l'oubli n'y sont pour rien, soyez-en tout à fait persuadé.
Je me suis occupé des deux choses dont vous m'avez fait le plaisir de me parler. Meyerbeer s'était déjà, de son côté, acquitté de la commission relative à un poème nouveau.
Sans nous être donné le mot, nous sommes allés tous les deux frapper à la même porte, celle de Saint-Georges. Dès les premiers mots, Saint-Georges m'a appris que Meyerbeer vous avait répondu et envoyé en même temps le consentement du librettiste à vous livrer un opéra nouveau qu'il vient de finir. Vous devez donc être instruit de tout ce qui a trait à votre question.
Quant à l'autre travail dont Saint-Georges se chargera également, il le trouve beaucoup plus difficile et plus long que d'écrire un opéra nouveau, à cause de la nécessité de conserver la musique.
Pour refaire Ondine en trois actes, Saint-Georges demande... que vous lui procuriez une partition des voix, sans laquelle il ne peut appliquer ses nouvelles paroles à la musique. Je ne sais ce que vous penserez de la proposition; la partition me paraît indispensable et toutes les imitations ou traductions de paroles, si fidèles qu'elles soient, ne sauraient la remplacer[82].
Saint-Georges demeure rue de Trévise, numéro 6. C'est un homme habile pour ces sortes de choses, et l'énorme succès du Val d'Andorre donne en ce moment plus d'autorité encore à son nom.
Si vous lisez la Gazette musicale et les Débats, vous devez être au courant de tout ce qui se fait chez nous en musique, cet hiver. Je ne vous en parlerai donc pas. Dimanche dernier, soit dit seulement en passant, Spontini, avec son second acte de la Vestale, a tellement enthousiasmé et bouleversé le public du Conservatoire que nous ressemblions à une assemblée de fous. J'en pleure encore en vous en parlant. Je viens de faire deux feuilletons là-dessus; peut-être vous tomberont-ils sous les yeux: ils paraîtront ces jours-ci dans la Gazette musicale et les Débats.
Je travaille en ce moment à un grand Te Deum à deux chœurs avec orchestre et orgue obligés. Cela prend une certaine tournure. J'en ai encore pour deux mois à travailler; il y aura sept grands morceaux.
Adieu, mon cher général; ne m'oubliez pas plus que je ne vous oublie: je ne vous en demande pas davantage.
A M. LECOURT, AVOCAT, A MARSEILLE.
Paris, jeudi 3 avril 1851.
Mon cher Lecourt,
Allez trouver M. Morel et dites-lui de ma part que nous venons de répéter pour la première fois son ouverture et que tous nous la trouvons admirable. Elle sera exécutée à notre concert[83] du 29 de ce mois. Nous l'avons dite trois fois ce matin; l'orchestre était à peu près complet, et déjà elle marche assez bien. Nous aurons encore quatre répétitions.
Je jure que c'est un meurtre de voir éloigné du centre musical un artiste de la valeur de Morel. Son ouverture le prouverait seule. Il y a là une habileté harmonique, une science d'instrumentation et de modulations, un sentiment du rhythme et une distinction mélodique qui, selon moi, sont du premier ordre. Et je puis vous dire, à vous Lecourt, que mon amitié pour l'auteur ne m'influence pas le moins du monde en sa faveur. Ce serait de Carafa ou d'Adam que je dirais la même chose. Seulement je serais mille fois plus surpris. Je ne retrouve pas la dernière lettre de Morel, et j'ai encore oublié son adresse, voilà pourquoi je ne lui écris pas directement.
Adieu; je vais changer de tout (il s'agit de vêtements, et non de sentiments); cette sacrée ouverture m'a fait suer à torrents et je suis tout trempé.
P.-S.—Dites-lui que Louis est arrivé bien fort, bien portant, bien épris de sa carrière; qu'il repart pour les Antilles dans quinze jours, et qu'il serre la main de son ami Morel.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, vendredi 9 mai 1851.
Mon cher Morel,
J'ai été si occupé tous ces derniers jours, que je n'ai pas eu l'esprit de trouver dix minutes pour vous écrire. Après le concert où votre ouverture a si brillamment figuré, nous en avons eu deux autres coup sur coup, au Jardin d'hiver, pour lesquels l'orchestre était payé, et qu'il n'y avait, en conséquence, pas moyen de refuser.
Maintenant je pars pour Londres, le ministre du commerce ayant eu l'idée (singulière pour un Français) de me prendre pour juge du mérite des divers fabricants d'instruments de musique, exposant leurs travaux dans le Cristal-Palace. Je ne reviens pas de mon étonnement... Nous avons eu, hier et avant-hier, des réunions de jurés, et je prends ce soir le chemin de fer. J'aurai beaucoup à faire, étant le seul musicien de la commission. Votre ouverture a été fort bien exécutée et médiocrement applaudie, mais admirée de tous les artistes et des vrais amateurs. Vos billets ont été remis d'après vos indications. Je me réserve de vous la faire entendre quelque jour avec un orchestre immense, car c'est une œuvre de grandes masses; Bourges en a bien parlé dans la Gazette musicale. J'y viendrai, à mon tour, je ne sais quand, dans le Journal des Débats.
Il est question d'une gigantesque entreprise musicale dont on me confierait la direction à Londres, et où figurerait le Te Deum. Si les fonds se font, je vous écrirai pour que vous veniez m'aider, soit aux études de Paris, soit à celles de Londres, car il faudra bien du monde et bien de l'intelligence pour mener à bien ce projet.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
Londres, 21 juin 1851. 27, Queen Anne street, Cavendish square.
Mon cher d'Ortigue,
J'ai déjà fait un rapport en faveur de M. Ducroquet; ainsi il a tout lieu d'être content de moi. Je n'en puis dire autant du jeune homme qui touche son orgue, car je maudis ce malheureux. Il nous régale chaque jour de deux ou trois douzaines de polkas, sans compter les cavatines d'opéras bouffons; il prend sans doute les Anglais pour des imbéciles!...
Je réponds à tes paragraphes:
1º Je ne me rappelle pas la date de l'article où il est question de la chapelle de Saint-Pétersbourg; il a paru il y a quatre mois au moins. Va de ma part au bureau du journal; on te le trouvera.
2º Ce n'est, je crois, que dans mon voyage d'Italie, à l'article du concours de l'Institut, que j'ai parlé de la marche de Cherubini. J'ignorais que tu eusses un livre sur le chantier. En tout cas, je serai à Paris bien avant le 31 juillet, et nous en causerons.
Tâche de lire mon second article dans les Débats; s'il n'a pas paru à Paris aujourd'hui, il faut le guetter chaque jour. J'y raconte l'impression sans égale que j'ai reçue dernièrement dans la cathédrale de Saint-Paul, en entendant le chœur des six mille cinq cents enfants des écoles de charité, qui s'y réunissent une fois l'an. C'est, sans comparaison, la cérémonie la plus imposante, la plus babylonienne à laquelle il m'ait, jusqu'à présent, été donné d'assister. Je me sens encore ému en t'en parlant. Voilà la réalisation d'une partie de mes rêves et la preuve que la puissance des masses musicales est encore absolument inconnue. Sur le continent, du moins, on ne s'en doute pas plus que les Chinois ne se doutent de notre musique.
A ce propos, vois aussi mon article du 31 mai; tu y trouveras une relation de ma visite à la chanteuse chinoise et à son maître de musique. Tu verras ce qu'il faut penser de ces folles inventions de quelques théoriciens savants sur une prétendue musique par quarts de ton. Il n'y a rien de bête comme un savant.
Dis à M. Arnaud que je serai bien heureux de mettre en musique une série de ses poèmes sur Jeanne d'Arc, si, pour moi aussi, une voix d'en haut se fait entendre. Qu'il tâche de faire de petites strophes; les longs couplets et les grands vers sont mortels à la mélodie. Il faudrait pouvoir faire de cela une légende populaire, toute simple mais digne, en une foule de parties ou chansons.
Adieu; je suis obsédé d'instruments de musique et plus encore de facteurs.
C'est la France qui l'emporte, sans comparaison possible, sur toute l'Europe. Érard, Sax et Vuillaume. Tout le reste tient plus ou moins du genre chaudron, mirliton et pochette.
A M. ALEXIS LWOFF.
Paris, 21 janvier 1852.
C'est à moi de m'excuser, au contraire, d'avoir écrit aussi tard un article aussi insuffisant; mais vous ne pouvez savoir comment ces affaires de feuilletons s'arrangent et de combien de niaiseries nous sommes forcés de parler avant de pouvoir étudier les choses importantes.
Enfin, bon ou mauvais, l'article a paru, et, s'il vous satisfait à peu près, je suis plus que content.
Il faut que je vous remercie maintenant de la proposition que vous me faites au sujet de votre Stabat. Malheureusement, vous êtes à mille lieues de vous douter de l'état musical au milieu duquel nous avons la honte de vivre à Paris. Notre Société philharmonique n'a pas encore essayé de reprendre ses séances et je ne sais si elle les recommencera. Les recettes étaient si faibles, que les artistes n'y gagnaient presque rien. De là leur inexactitude désespérante aux répétitions, de là l'impossibilité de leur faire apprendre un important ouvrage nouveau.
J'ai fini l'an dernier trois partitions nouvelles, et, à l'heure qu'il est, je n'ai pas pu trouver l'occasion d'en entendre une note, et pas un éditeur n'a osé les publier. Je crois en outre que l'exécution et la vente d'un Stabat sont encore plus difficiles que celles de tout autre ouvrage, à cause de l'impossibilité d'obtenir des Parisiens l'attention nécessaire à une composition grave et triste.
Voilà l'exacte vérité.
Rien n'est plus possible à Paris, et je crois que, le mois prochain, je vais retourner en Angleterre où le désir d'aimer la musique est au moins réel et persistant. Ici toute place est prise; les médiocrités se mangent entre elles et l'on assiste au combat et aux repas de ces chiens avec presque autant de colère que de dégoût.
Les jugements de la presse et du public sont d'une sottise et d'une frivolité dont rien ne peut offrir d'exemple chez les autres nations. Chez nous, le beau, ce n'est pas le laid, c'est le plat; on n'aime pas plus le mauvais que le bon, on préfère le médiocre; le sentiment du vrai dans l'art est aussi éteint que celui du juste en morale, et, sans l'énergie du président de la République, nous en serions à cette heure à nous voir assassiner dans nos maisons. Grâce à lui et à l'armée, nous vivons tranquilles en ce moment; mais nous, artistes, nous vivons morts (pardonnez-moi l'antithèse).
Si vous trouvez que je puisse vous être utile de quelque façon par mon feuilleton, ne manquez pas, je vous prie, de m'en informer, ce sera toujours un bonheur pour moi d'entretenir le petit nombre de lecteurs sérieux que nous avons en France des choses grandes et sérieuses qui se font en Russie. D'ailleurs, c'est une dette que je voudrais pouvoir acquitter. Je n'oublierai jamais, croyez-le bien, l'accueil que j'ai reçu de la société russe en général, de vous en particulier, et la bienveillance que m'ont témoignée et l'impératrice et toute la famille de votre grand empereur. Quel malheur qu'il n'aime pas la musique!
Adieu, cher maître; rappelez-moi au souvenir de votre merveilleuse Chapelle, et dites aux artistes qui la composent que j'aurais bien besoin de les entendre, pour me faire verser toutes les larmes que je sens brûler en moi et qui me retombent sur le cœur.
A M. AUGUSTE MOREL
Paris, 10 février 1852.
Mon cher Morel,
Je ne vous ai pas écrit depuis trop longtemps, c'est mal, très mal de ma part, et je vous prie de me pardonner cette négligence apparente. Vous savez par les journaux toutes les nouvelles musicales de Paris. Je ne vous en dirai donc rien. J'allais partir demain pour Weimar, la première représentation de Benvenuto devant avoir lieu le 16 de ce mois, jour de la fête de la grande-duchesse. Et voilà que Liszt m'écrit pour m'annoncer la maladie de deux des principaux chanteurs, le ténor (Cellini) et l'Ascanio (mezzo soprano). Cela retardera donc la chose de quinze ou vingt jours. Or, comme je dois être rendu à Londres le 1er mars, je ne ferai pas le voyage d'Allemagne très probablement.
Notre philarmonique de Paris étant à vau-l'eau, j'ai fait porter votre Ouverture (très belle) dans ma chambre de la bibliothèque du Conservatoire, où se trouve exclusivement la musique qui m'appartient; si vous en aviez besoin, Rocquemont (qui demeure rue Saint-Marc, 27) irait la prendre avec un mot de moi et vous la ferait parvenir.
Je suis au fond assez vexé de ne pas aller entendre Benvenuto. Liszt dit que cela va à merveille; voilà quatre mois qu'on y travaille. J'avais bien nettoyé, reficelé, restauré la partition avant de l'envoyer. Je ne l'avais pas regardée depuis treize ans; c'est diablement vivace, je ne trouverai jamais une telle averse de jeunes idées. Quels ravages ces gens de l'Opéra m'avaient fait faire là dedans!... J'ai tout remis en ordre. Et votre nouveau quatuor, quand le grave-t-on? quand l'entendrons-nous? Ah! scélérat! si vous vous mettez à faire aussi modestement des chefs-d'œuvre!... Il était temps; personne ne pouvait plus faire de quatuors.
P.-S.—Tout l'Opéra est en émoi à cause de mon dernier feuilleton, que Bertin a fait passer malgré la censure (par mégarde!!!). Je reçois des lettres de félicitations, des visites, des congratulations, et les autres m'ont en abomination.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
[Londres], 23 mars [1852].
Mon cher d'Ortigue,
Je t'écris trois lignes pour que tu saches que j'ai obtenu hier soir un succès pyramidal. Redemandé, je ne sais combien de fois, acclamé et tout (sic) comme compositeur et comme chef d'orchestre. Ce matin, je lis dans le Times, le Morning Post, le Morning Herald, l'Advertiser et autres, des dithyrambes comme on n'en écrivit jamais sur moi. Je viens d'écrire à M. Bertin pour que notre ami Raymond, du Journal des Débats, fasse un pot-pourri de tous ces articles et qu'on sache au moins la chose.
La consternation est dans le camp de la vieille société philharmonique. Costa et Anderson boivent leur bile à pleins verres.
Je n'ai pu faire entrer à Exeter Hall qu'une de tes dames; mais l'autre a trouvé le moyen d'entrer aussi (en payant, je le crains). Enfin, sois content. Tout va bien. J'ai un fameux orchestre et un admirable entrepreneur (Beale) qui ne lésine pas. Depuis hier, il est à moitié fou de joie. C'est un grand événement pour l'art musical ici et pour moi que ce succès. Les conséquences n'en sont guère douteuses, à ce que chacun dit.
Adieu, mille amitiés. Va voir Brandus, si tu en as le temps, et prie-le de tirer la moelle des journaux anglais pour sa Gazette. C'est curieux, je t'assure.
AU MÊME.
Londres, 30 avril 1852.
Je n'ai pas vu ton article dans les Débats. Écris-moi un mot pour m'instruire de tes relations avec M. Bertin. A-t-il imprimé ton travail sur M. Lehman (c'est, je crois, le nom de l'organiste). As-tu narré les malheurs du Juif errant[84]? Quel est le succès? Quelle est la valeur de l'ouvrage? J'ignore tout cela. Quelques mots échappés à la plume d'un des artistes chantant dans l'œuvre nouvelle me donnent à entendre qu'elle a fait, à son apparition, un mezzo fiasco; ce qui, selon moi, ne prouverait rien contre elle. Mais, consacre-moi un quart d'heure pour me mettre au courant.
Avant-hier soir a eu lieu notre troisième concert et la seconde exécution des quatre premières parties de Roméo et Juliette. Tout a été rendu avec une verve, une finesse, une intelligence inconnues dans ce pays-ci. L'orchestre, à certains moments, dépassait en puissance tout ce que j'ai encore entendu. Le morceau de la Fête, qui m'avait moins satisfait le premier jour, a été rendu comme il ne le fut jamais ailleurs... et croirais-tu que dans l'Introduction le solo du trombone a été interrompu, après sa troisième période, par des salves d'applaudissements!
Quant à ceux qui ont accueilli tout le reste, j'aurais voulu te voir là pour les entendre. Les journaux continuent à me chauffer (excepté le Daily News), qui est rédigé par M. Hogarth, un excellent vieillard qui fut, jusqu'à présent, fort de mes amis, mais qui, depuis quelques années, remplit les fonctions de secrétaire de la Société philharmonique. Indè iræ. Il y a aussi X..., qui fait un peu le Scudo, parce qu'il n'a pas pu tirer de Beale les scudi qu'il demandait pour les traductions anglaises des œuvres nouvelles que nous exécutons... (confidentiel). Mais cela ne gâte rien; le succès est général et je suis au cœur de la place. Je monte, en ce moment, la symphonie avec chœurs de Beethoven qui, jusqu'à présent, n'a été qu'abîmée ici.
Croirais-tu que presque tous les critiques sont hostiles à la Vestale, dont nous avons, avant-hier, exécuté largement les plus beaux fragments?...
J'ai eu la faiblesse d'éprouver de ce lapsus judicii un crève-cœur inexprimable... comme si j'eusse ignoré qu'il n'y a rien de beau, ni de laid, ni de faux, ni de vrai pour tout le monde... comme si l'intelligence de certaines œuvres de génie n'était pas nécessairement refusée à des peuples entiers...
Je suis presque honteux de réussir à ce point... Tout cela entre nous.
A LOUIS BERLIOZ.
Londres, lundi 3 mai [1852].
Tu me dis que tu deviens fou! Tu l'es.
Il faut être fou ou imbécile pour m'écrire de pareilles lettres: il ne me manquait que cela au milieu des fatigues de jour et de nuit que j'ai à endurer ici. Dans ta dernière lettre de la Havane, tu m'annonces que tu arriveras avec cent francs et maintenant tu en dois quarante!!! qui est-ce qui t'a dit de payer 15 francs pour l'entrée d'un paquet de cigares? ne pouvais-tu les jeter à la mer?
Voici la moitié d'un billet de banque de cent francs; tu recevras l'autre moitié quand tu m'auras accusé réception de celle-ci. Tu les recolleras ensemble et chez un changeur on te donnera ton argent.
C'est une précaution usitée quand on met de l'argent à la poste. Maintenant j'écris à M. Cor et à M. Fouret pour savoir à quoi m'en tenir sur ton prochain départ. Tu penses bien que je ne fais pas le moindre cas des folies et des bêtises que tu me dis. Tu as commencé une carrière choisie par toi; elle est très pénible, je le sais, mais le plus pénible est fait. Tu n'as plus qu'un voyage de cinq mois à achever, après quoi tu feras pendant six ton cours d'hydrographie dans un port français et tu pourras ensuite gagner ta vie.
Je travaille pour mettre de côté l'argent nécessaire pour ta dépense pendant ces six mois.
Je n'ai pas d'autre moyen de te tirer d'affaire.
Qu'est-ce que tu me dis de tes habits déchirés? Pour un mois et demi passé à la Havane, tu as donc abîmé tes effets?... Tes chemises sont pourries... il faudra donc des douzaines de chemises tous les cinq mois? Est-ce que tu te moques de moi?
Je te recommande de mesurer tes termes quand tu m'écris; ce style-là ne me convient pas. Si tu croyais que la vie est semée de roses, tu dois commencer à voir le contraire. En tout cas et en trois mots, je ne pense pas te donner un autre état que celui que tu as choisi. Il est trop tard. A ton âge, on doit savoir assez le monde pour mener une conduite différente de celle que tu paraîs tenir.
Quand tu auras répondu une lettre raisonnable en m'accusant réception du demi-billet, tu recevras le reste et mes instructions. Jusque-là, reste au Havre.
Adieu.
A M. FERDINAND HILLER.
Paris, 1852.
Mon cher Hiller,
Vous allez me croire coupable, mais je ne le suis pas. Je rentre de la répétition, je déjeune, il faut que je ressorte aussitôt pour aller au concert où joue madame Kalergi, chez le prince Poniatowski; chez Armand Bertin, au bureau de censure; à l'imprimerie donner des instructions à mon copiste, pour insérer des réclames dans six journaux. Vous voyez qu'il m'est impossible de rester à la maison. Sans compter mon damné feuilleton que je ne puis faire la nuit car il faut absolument que je dorme. Le sommeil est le premier et le plus impérieux de mes besoins. J'aurais à être guillotiné à neuf heures du matin, que je voudrais encore dormir jusqu'à onze!
Adieu; tâchez de venir un instant ce soir à neuf heures voir si j'y suis.
A JOSEPH D'ORTIGUE.
Londres, 5 mai [1852].
Mon cher ami,
Je n'ai pas eu ces jours-ci une heure pour t'écrire; et je te réponds aujourd'hui au sortir d'une répétition de la symphonie avec chœurs de Beethoven, et au moment d'en aller commencer une autre pour la partie vocale du même ouvrage.
J'ai couru vainement tous les cabinets de lecture sans pouvoir trouver ton article. Je le lirai à Paris. Les comptes du caissier du Journal des Débats ne se règlent que de mois en mois et du 15 au 18. Ainsi ne dis rien; je ne puis supposer qu'on ait eu l'idée de ne te pas payer. Pour l'envoi du journal, c'est différent; je sais qu'on ne l'envoie qu'aux rédacteurs sempiternels. Je n'ai pas écrit à M. Bertin. Maintenant fais l'article sur Coussemaker, et, de plus, je te prie instamment d'aller de ma part chez Stephen de la Madeleine, nº 19, rue Tronchet, lui dire que, ne pouvant trouver ici le temps d'écrire quelque chose sur son excellente Théorie du chant, je te charge de me remplacer. Il te donnera son livre et tu feras entrer cette analyse dans le même numéro avec celle de l'ouvrage de Coussemaker. Si tu peux trouver le moyen de dire en une colonne et demie quelque chose d'important sur mes collections de chants, fais-le; sinon, laisse-les pour une autre occasion.
Je veux seulement qu'on sache qu'ils existent, que ce n'est point de la musique de pacotille, que je n'ai point en vue la vente et qu'il faut être musicien, et chanteur, et pianiste consommé, pour rendre fidèlement ces petites compositions; qu'elles n'ont rien de la forme ni du style de celles de Schubert.
Mademoiselle Moulin était au second concert. Je lui avais donné deux places; mais sa mère est, je crois, absente de Londres. L'effet, je te le répète, a été de beaucoup supérieur à celui du premier concert, et l'exécution beaucoup meilleure. J'ai conservé le tambour de basque[85], parce que j'avais un habile artiste pour le jouer et qu'il a fait ces petits solos très délicatement et avec un excellent résultat de lointain, qui ne ressemblait pas à ce que nous entendions à Paris; en outre, le pianissimo des timbales dans cette salle n'étant presque pas entendu, le contraste des rythmes eût été perdu en laissant la timbale seule. Non, c'est bien cela que j'ai voulu; mais, pour le tambourin comme pour le violon, il faut en savoir jouer quand on s'en sert.
Veux-tu me rendre encore un service?
Va chez Amyot, libraire, rue de la Paix, et chez Charpentier, rue de Lille, demander s'il leur conviendrait à l'un ou à l'autre de publier un fort volume in 8º de 450 à 500 pages, de moi, très drôle, très mordant, très varié, intitulé les Contes de l'orchestre. Ce sont des nouvelles, historiettes, contes, romans, coups de fouet, critiques et discussions, où la musique ne prend part qu'épisodiquement et non théoriquement, des biographies, des dialogues soutenus, lus, racontés, par les musiciens d'un orchestre anonyme, pendant la représentation des mauvais opéras. Ils ne s'occupent sérieusement de leur partie que lorsqu'on joue un chef-d'œuvre. L'ouvrage est ainsi divisé en soirées; la plupart de ces soirées sont littéraires et commencent par ces mots: On joue un opéra français ou italien ou allemand très plat; les tambours et la grosse caisse s'occupent de leur affaire, le reste de l'orchestre écoute tel ou tel lecteur ou orateur, etc.
Lorsqu'une soirée commence par ces mots: On joue Don Juan, ou Iphigénie en Tauride, ou le Barbier, ou la Vestale, ou Fidelio, l'orchestre plein de zèle fait son devoir et personne ne lit ni ne parle. La soirée ne contient rien que quelques mots sur l'exécution du chef-d'œuvre.
Tu conçois que ces soirées sont rares et que les autres donnent lieu à mille sanglantes ironies, facéties; sans compter les nouvelles d'un intérêt purement romanesque. Je termine ce livre; vois si tu peux lui trouver un éditeur. Adieu, mille amitiés.
AU MÊME.
Londres, 22 mai 1852
Mon cher d'Ortigue,
Je te prie d'excuser mon retard à te répondre. J'ai été tout à fait absorbé ces jours-ci par la terminaison de mon livre. Il est fini et je le lime, frotte et regratte en ce moment.
Je n'ai rien écrit à M. Bertin; tu ne m'as pas demandé de lettre pour lui; au contraire, ta recommandation expresse était de ne lui point parler de l'affaire d'argent. Je ne doutais pas qu'elle ne se terminât comme nous l'espérions tous les deux.
Tu me parles des frais de nos concerts ici; ils sont énormes, en effet, et les entrepreneurs perdent comme tous ceux de toutes les institutions musicales de Londres, cette année. Mais ils savaient d'avance qu'il en serait ainsi, et ils en font si peu un mystère, que, dans le programme du dernier concert, Beale a fait part au public (cependant n'en dis rien aux Français) de la dépense occasionnée par les répétitions de la symphonie avec chœurs de Beethoven, dépense qui a absorbé plus d'un tiers de la souscription (abonnement).
Néanmoins, il considère ces frais comme des frais de premier établissement et son intention est toujours de continuer l'an prochain, en se débarrassant toutefois d'un individu intéressé dans l'entreprise et qui nous gêne. Je te dirai cela en détail à mon retour.
La symphonie avec chœurs qui n'avait jamais pu bien marcher ici, a produit un effet miraculeux, et j'ai eu un succès de conducteur très grand. On m'a rappelé après la première partie du concert. C'était un tel événement que bien des gens doutaient que nous vinssions à bout à notre honneur de cette œuvre terrible et merveilleuse. Dans la même soirée, mademoiselle Clauss a joué le concerto en sol mineur de Mendelssohn avec une pureté de style, une expression et un fini admirables. Cette enfant est maintenant considérée à Londres comme la première pianiste musicienne de l'époque, en dépit des intrigues de... Ne manque pas de parler de mademoiselle Clauss et de la symphonie de Beethoven dans ton prochain feuilleton.
Je te remercie mille fois de tes démarches auprès des libraires. Si tu en as le temps, essaye encore auprès de quelque autre. Et, en passant, revois Amyot pour lui dire que je lui répondrai à mon retour et lui demander s'il consentirait à faire des illustrations pour mon livre. Il y a une foule de sujets de dessins, vignettes, etc., qui donneraient à l'œuvre beaucoup de piquant. Sache aussi de lui combien d'exemplaires il me donnerait et à combien il tirerait la première édition si je me voyais obligé de la lui céder pour rien.
Je n'ai pas compris ta phrase: «Gounod, par déférence pour son futur beau-père, a cru devoir parer les coups portés à l'école romantique». En quoi cette école concerne-t-elle Zimmermann? et comment Gounod a-t-il besoin de considérations étrangères pour la défendre?...
Écris-moi dès que tu le pourras. Je vais commencer les répétitions de notre cinquième concert où je n'aurai qu'une ouverture. Au sixième, on jouera les deux premiers actes de Faust.
Mille amitiés.
AU MÊME.
Londres, samedi 12 juin [1852].
Mon cher ami, je ne t'écris que trois lignes pour te dire que notre dernier concert a eu lieu mercredi dernier avec un succès extravagant, une foule immense et une grosse recette. J'ai été rappelé quatre ou cinq fois. Deux morceaux de Faust ont été bissés avec des cris et des trépignements; les journaux anglais déclarent qu'on n'a pas d'exemple à Londres d'un succès musical de cette violence. Enfin, c'est mirobolant. Après le chœur des Sylphes, on m'a jeté une couronne; il y a donc à ce succès lauriers, comme disent les guerriers, chênes et toutes les herbes de la Saint-Jean. Je voulais partir hier et ensuite demain. Et je reste encore quelques jours pourtant, à moins que je ne me débarrasse plus tôt que je ne l'espère des dernières affaires, visites, dîners, lettres de remerciements, etc., etc.
Pourtant ce séjour prolongé m'inquiète sous le rapport financier. J'ai tant de loyers à payer à Paris, les dépenses de mon fils qui s'y trouve maintenant, etc., que le luxe d'habiter Londres quand je n'y ai plus rien à faire m'écraserait. A vrai dire, ce n'est pas tout à fait du luxe; car il m'est, au fond, désavantageux de quitter l'Angleterre au moment où j'aurais tant de choses à y voir venir.
Un amateur naïf de Birmingham qui regrettait dernièrement de n'avoir pas pu m'engager cette année pour diriger le festival de sa province, disait:
—C'est bien malheureux pour nous, car il paraît que M. Berlioz est encore supérieur à M. Costa.
Je vais bien regretter mon magnifique orchestre, et le chœur. Quelles belles voix de femmes! J'aurais voulu que tu entendisses la symphonie avec chœurs de Beethoven que nous avons donnée pour la seconde fois mercredi dernier!... Vraiment, l'ensemble de tout cela dans cette salle immense d'Exeter Hall était grandiose et imposant.
Je vais maintenant bientôt oublier à Paris toutes ces joies musicales pour reprendre ma stupide tâche de critique, la seule qui me soit laissée à remplir dans notre cher pays.
Je vais, je crois, terminer ici demain un arrangement pour la publication en anglais de mon livre. C'est Mitchell qui s'en chargera...
Madame Moulin m'annonce une commission pour toi; je m'en chargerai. C'est d'un paletot qu'il s'agit et je l'endosserai pour que la douane n'ait rien à y voir.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, 19 décembre 1852.
Mon cher Morel,
Vous auriez le droit de m'adresser de vifs reproches sur la longue interruption de notre correspondance et pourtant vous me les épargnez!... Je reconnais bien là votre bonté ordinaire. Si quelque chose peut atténuer mes torts, c'est la certitude que j'ai, moi, de l'intention où j'étais de vous écrire après-demain. Eh bien je vous écris ce soir en rentrant d'un concert de la nouvelle Société symphonique organisée par Aristide Farrenc, concert dans lequel on a eu l'heureuse et audacieuse idée de nous faire entendre une symphonie de Haydn.
Vous voyez maintenant combien le besoin de cette société devait être vif et impérieux chez les amateurs parisiens!... Oui, j'ai grande envie de dormir et pourtant je vous écris tout de suite, pour vous assurer que j'ai ressenti une grande joie en apprenant votre tardive nomination.
Je m'étais depuis un an fait le flatteur de Balton pour l'exciter à sévir contre vos obstacles; car il avait vu et il n'avait pas encore vaincu. Heureusement, il était presque aussi indigné que moi, et je n'ai pas eu besoin de descendre à des flatteries excessives. Enfin, vous voilà à peu près tranquille sinon bien portant!... Je vous cherche bien souvent au café Cardinal, et je ne conçois pas pourquoi on y déjeune sans vous. Mais vous me faites espérer votre visite et un deuxième quatuor. J'aurais de longues pages à barbouiller pour vous donner tous les détails des affaires de Weimar et de Londres et de Paris.
Je vous dirai seulement que cette petite excursion en Allemagne a été la plus charmante que j'aie jamais faite dans ce pays-là. Ils m'ont comblé, gâté, embrassé, grisé (dans le sens moral). Tout cet orchestre, tous ces chanteurs, acteurs, comédiens, tragédiens, directeurs, intendants réunis au dîner de l'hôtel de ville la nuit de mon départ, représentaient un ordre d'idées et de sentiments qu'on ne soupçonne pas en France. J'ai fini par pleurer comme deux douzaines de veaux, en songeant à ce que ce même Benvenuto m'a valu de chagrins à Paris. Cet excellent Liszt a été adorable de bonté, d'abnégation, de zèle, de dévouement. La famille ducale m'a comblé de toutes façons. Les jeunes princesses de Prusse ont été d'une grâce ravissante, elles ont eu des mots... surtout sur Roméo et Juliette, que nous avons exécuté en entier avec un chœur superbe de cent vingt voix. Puis le bouillant Griepenkerl, qui était venu de Brunswick et qui a oublié le peu de français qu'il savait, m'a dit, après la première représentation de Benvenuto, en m'embrassant avec fureur: E pur si muove, mon cher! e pur si muove! J'ai retouché quelques petites choses dans la partition, et arrangé le livret de manière à ce qu'il marche bien maintenant. On s'occupe de le traduire en italien.
Mais tout cela ne doit pas me faire oublier nos grandes solennités de Londres!... Il fallait voir cet immense public d'Exeter Hall, lancé après les morceaux de Roméo et de Faust!... et ces hourras de notre grand orchestre!... ah! je vous ai bien souvent cherché, le soir, en rentrant, quand nous soupions avec ces Anglais, enthousiastes réels, au rhum, au vin de champagne glacés. Quel singulier, mais quel grand peuple! il comprend tout! ou du moins on y trouve des gens pour tout comprendre.
Eh bien, Beale, après m'avoir prévenu, il y a un mois, que j'allais recevoir mon engagement pour la saison prochaine, m'écrit il y a huit jours, qu'il vient de donner sa démission du Comité, parce que l'un de mes chefs d'orchestre a trouvé le moyen d'obtenir qu'on ne m'engageât pas. Il a été tellement berné l'an dernier par les artistes, par le public et par la presse, qu'il veut l'an prochain, dit-il, prendre sa revanche en se choisissant un partenaire moins incommode. Il veut faire engager le vieux Spohr. Je ne pouvais pourtant pas, pour être agréable à ce monsieur, conduire en dépit du bon sens, c'est-à-dire comme il conduisait lui-même. Il ne veut qu'un borgne ou un aveugle pour associé et je ne portais pas même de lunettes.
Ceci est fatal;... mais ni moi ni nos amis de Londres, nous n'y pouvons rien. On me parle maintenant d'autres projets, toujours pour l'Angleterre; ce sera bientôt décidé. Ici rien, toujours rien. Le Te Deum est en l'air, on en parle; mais l'empereur ne veut pas dire un mot. Il renvoie sa décision à trois ou quatre mois. Il est même question pour moi de sa chapelle. Je laisse faire et dire, et je ne crois à rien. Je connais trop mon pays et mon monde. Mon livre des Soirées de l'orchestre réussit; on en parle beaucoup. Je vais vous l'envoyer.
Mille amitiés à Lecourt. Oh! comme il aurait ri, bu et blagué à Weimar, s'il y fût venu!... Nous avions du monde de tous les environs, de Leipzig, de Iéna, de Brunswick, de Hanovre, d'Erfurth, d'Eisenach, de Dresde même, et jusqu'à Chorley qui était venu de Londres. Celui-là aime Benvenuto et ne comprend rien à Roméo! qu'y faire? Certes non, le pauvre M*** n'a pas pu vous remplacer au Requiem!...
Adieu, mon cher Morel; il est une heure du matin et ma bougie est finie.
A M. LE DIRECTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS.
Paris, 25 décembre 1853.
Monsieur,
Le procès intenté à l'administration de l'Opéra par M. le comte Tyczkiewickz, à propos de la représentation de Freischütz sur ce théâtre, a fait du bruit en Allemagne, et j'en ai été informé comme tout le monde. Mais j'ignorais, avant mon retour à Paris, de quelle façon je me trouve mêlé à ce procès. En lisant dans le Journal des Débats la plaidoirie de Me Celliez, et en me voyant accusé d'être l'auteur des mutilations du chef-d'œuvre de Weber, j'ai éprouvé un instant d'indécision entre la colère et l'hilarité. Mais comment ne pas finir par rire d'une telle accusation lancée contre moi, dont la profession de foi en pareilles matières a été faite de tant de façons et en tant de circonstances!
Il faut que Me Celliez ait eu une grande confiance dans l'historien qu'il a consulté, pour accueillir de pareils documents en faveur de sa cause et leur donner place dans sa plaidoirie. Me croyant néanmoins à l'abri du soupçon à cet égard, en tenant compte de la profonde indifférence du public pour de telles questions, je n'eusse point réclamé contre l'imputation de ce méfait musical.
Mais j'apprends que les journaux de musique du Bas-Rhin y ajoutent foi (il faut avoir bien envie de me croire coupable!) et me maltraitent avec une violence qui les honore. L'un d'eux m'appelle brigand tout simplement. Or voici la vérité.
Les coupures, les suppressions, les mutilations dont s'est plaint à si juste titre M. Tyczkiewickz furent faites dans la partition de Weber à une époque où je n'étais même pas en France; je ne les connus que longtemps après, par une représentation du chef-d'œuvre ainsi lacéré, et ma surprise alors égala au moins celle que j'éprouve aujourd'hui de me les voir attribuer.
Une seule fois, plus tard, lors de la mise en scène du nouveau ballet, le Freischütz, qui devait lui servir de lever de rideau, paraissant trop long encore, je fus invité à me rendre à l'Opéra. Il s'agissait de raccourcir mes récitatifs. En présence des ravages déjà faits dans la partition de Weber, la prétention de conserver intacts mes récitatifs eût paru ridicule, pour ne rien dire de plus. Je laissai donc faire en disant que je serais honteux d'être mieux traité que le maître. Mais c'était déjà un point résolu; on m'avait appelé seulement pour indiquer les soudures à faire entre les divers tronçons du dialogue, procédé de pure politesse, car il y a, à l'Opéra, des soudeurs d'une rare habileté, grâce à l'extrême habitude qu'ils ont de ces sortes d'opérations.
Je suis donc étranger aux attentats commis sur la partition de Weber autant que peuvent l'être MM. les rédacteurs des gazettes musicales du Bas-Rhin, et M. Celliez, et M. Tyczkiewickz lui-même.
Quelle que soit l'invraisemblance de l'opinion contraire, il m'importe qu'elle ne puisse s'accréditer auprès des vrais amis de l'art en général et de ceux d'Allemagne en particulier, et je vous prie, Monsieur, de vouloir bien accueillir ma juste réclamation.
A JOSEPH D'ORTIGUE
Paris, 17 janvier 1854.
Oui, mon bon cher d'Ortigue, tu as raison; c'est mon indomptable passion pour tout ce que je connais de l'art, qui me donne si facilement des sujets de chagrin, de douleur même. Pardonne-moi de t'avoir laissé lire si aisément dans ma pensée; je sentais que cela devait te faire de la peine et il m'était impossible de retenir les paroles qui me brûlaient les lèvres. Il est tout naturel que tes convictions religieuses aient amené des opinions analogues dans tes théories sur l'art. J'aurais dû y songer et me taire. Quand il s'agit des jugements portés sur ce qui me regarde directement, sur mes ouvrages, par exemple, l'extrême habitude de la contradiction me fait les supporter, comme je le dois, c'est-à-dire silencieusement et même avec résignation. Mais, dès que la contradiction frappe sur mes idoles (car je suis un fanatique évidemment), tout mon sang se bouleverse, mon cœur bondit et bat si rudement, que sa souffrance ressemble à de la colère et doit paraître offensante à mes interlocuteurs.
J'ai l'amour du beau et du vrai, tu as raison d'en convenir; mais j'ai un autre amour bien autrement furieux et immense: j'ai l'amour de l'amour. Or, quand quelque idée tend à priver les objets de mes affections des qualités qui me les font aimer, et qu'on veut ainsi m'empêcher de les aimer, ou m'engager à les aimer moins, alors quelque chose en moi se déchire et je crie comme un enfant dont on a brisé le jouet. La comparaison est juste: c'est certainement puéril, je le sens et je ferai tous mes efforts pour me corriger. Enfin, tu m'as puni chrétiennement, en rendant le bien pour le mal; car ta lettre m'a rendu heureux. Laisse-moi te serrer la main et te remercier.
Tes notes sont excellentes. Je crois que je m'en tirerai. Mais jamais je ne fus moins disposé à écrire. Ce feuilleton est du grand nombre de ceux que je ne sais pas commencer. Et je suis si triste en dedans... La vie s'écoule... Je voudrais tant travailler et je suis obligé de labourer pour vivre... Mais qu'importe tout!...
Adieu, adieu
A M. BRANDUS.
Paris, 22 janvier 1854.
Mon cher Brandus,
Plusieurs journaux de Paris annoncent mon prochain départ pour une ville d'Allemagne, où je serais, à les en croire, nommé depuis peu maître de chapelle. Je conçois tout ce que mon départ définitif de France doit avoir de cruel pour beaucoup de gens, et avec quelle peine ils en sont venus à donner foi à cette grave nouvelle et à la mettre en circulation.
Il me serait donc agréable de pouvoir la démentir tout simplement en disant comme le héros d'un drame célèbre: «Je te reste, France chérie, rassure-toi!» Mon respect pour la vérité m'oblige à ne faire qu'une rectification. Le fait est que je dois quitter la France, un jour, dans quelques années, mais que la chapelle musicale dont la direction m'a été confiée n'est point en Allemagne. Et puisque tout se sait tôt ou tard dans ce diable de Paris, j'aime autant vous dire maintenant le lieu de ma future résidence: je suis directeur général des concerts particuliers de la reine des Ovas à Madagascar. L'orchestre de Sa Majesté Ova est composé d'artistes malais fort distingués et de quelques Malgaches de première force. Ils n'aiment pas les blancs, il est vrai, et j'aurais en conséquence beaucoup à souffrir sur la terre étrangère dans les premiers temps, si tant de gens en Europe n'avaient pris à tâche de me noircir. J'espère donc arriver au milieu d'eux bronzé contre leur malveillance. En attendant, veuillez faire savoir à vos lecteurs que je continuerai à habiter Paris le plus possible, à aller dans les théâtres le moins possible, mais à y aller cependant et à remplir mes fonctions de critique comme auparavant, plus qu'auparavant. Je veux pour la fin m'en donner à cœur joie, puisque aussi bien il n'y a pas de journaux à Madagascar.
Recevez, etc.
A M. B. JULLIEN.
Paris, 23 janvier 1854.
Recevez, monsieur, mes sincères remerciements pour le beau livre[86] que vous avez bien voulu m'envoyer. Je l'ai déjà lu deux fois, je l'étudie et je l'admire. C'est radieux de raison et de bon sens. Vous êtes, ce me semble, le premier qui ayez traité avec intelligence, et sans se laisser décevoir par le mirage des folies antiques et modernes, ces diverses questions.
Vos études sur la prosodie latine m'ont expliqué bien des choses demeurées pour moi complétement obscures jusqu'à ce jour. Aussitôt que je le pourrai, je tenterai de donner aux lecteurs du Journal des Débats une idée des rares mérites de votre ouvrage, et je vous prie d'avance de recevoir mes excuses pour l'insuffisance de ma critique, qui n'aura d'autre mérite que la bonne foi.
A LOUIS BERLIOZ, ASPIRANT VOLONTAIRE A BORD DE L'AVISO LE CORSE, A CALAIS.
Lundi, 6 mars 1854.
Pauvre cher Louis, tu as reçu ma lettre d'hier; maintenant tu sais tout. Je suis là tout seul à t'écrire dans le grand salon de Montmartre, à côté de sa chambre déserte[87]. Je viens encore du cimetière; j'ai porté sur sa tombe deux couronnes, une pour toi, une pour moi. Je n'ai pas la tête à moi; je ne sais pourquoi je suis rentré ici... Les domestiques y sont encore pour quelques jours. Elles mettent tout en ordre et je tâcherai que ce qu'il y a puisse produire le plus possible pour toi. J'ai gardé ses cheveux; ne perds pas cette petite épingle que je lui avais donnée. Tu ne sauras jamais ce que nous avons souffert l'un par l'autre, ta mère et moi, et ce sont ces souffrances mêmes qui nous avaient tant attachés l'un à l'autre. Il m'était aussi impossible de vivre avec elle que de la quitter. Enfin, elle t'a vu avant de mourir. Moi, j'étais venu la veille, le lendemain de ton départ et je suis rentré dix minutes après qu'elle venait de rendre sans secousses ni douleurs le dernier soupir. La voilà délivrée. Je t'aime, mon cher fils. Nous avons longuement parlé de toi hier, dans ce triste jardin, avec Alexis Bertschtold. Combien il me tarde de te voir devenir un homme raisonnable! que je serais heureux de te savoir sûr de toi-même! Je pourrai maintenant t'aider plus que par le passé, mais toujours en prenant des précautions pour que tu ne puisses gaspiller l'argent. Alexis lui-même est de cet avis. Je suis sans ressources dans ce moment.
Ma gêne durera encore six mois au moins, car il faut que je paye le médecin et la vente des meubles ne rapportera presque rien. J'ai reçu hier une lettre de l'intendant du roi de Saxe; on m'attend à Dresde pour le mois prochain. Il faut que j'emprunte de l'argent pour faire ce voyage. Hier soir, Alexis m'a envoyé sous enveloppe la lettre que tu lui avais laissée pour moi et que son portier avait gardée.
Je n'ai pas de réponse de M. de Maucroix; demande-lui, je t'en prie, s'il a reçu ma lettre. J'espérais de lui quelques détails sur la destination du Corse, etc.
Adieu, je t'embrasse de tout mon cœur. Aime-moi comme je t'aime.
AU MÊME.
Paris, jeudi 23 mars 1854.
Cher ami,
Ta lettre m'a causé une joie bien inattendue; te voilà donc avec 70 francs par mois, et, si tu sais t'arranger et renoncer à ta manière d'employer l'argent, tu peux sans aucun doute en économiser une partie. Écris-moi, si tu crois pouvoir tôt ou tard dégager ta montre que tu as, je le crains, mise en gage au Havre au temps de ta folie. Elle t'avait été donnée par mon père... Si tu ne peux pas la retrouver, je t'en achèterai une autre sur l'argent que j'ai à toi. Je viens de te faire faire un cordon de montre avec les cheveux de ta pauvre mère et je voudrais bien que tu le conservasses religieusement. J'ai fait faire aussi un bracelet que je donnerai à ma sœur et je garde le reste des cheveux... Je ne pourrai t'envoyer ton linge que samedi prochain 25, à cause d'une formalité qu'il y a à remplir à ce sujet, et que le feuilleton que je fais aujourd'hui et demain m'oblige de remettre à la fin de la semaine. Je pense que tu as vu les choses charmantes que J. Janin a dites sur ta pauvre mère dans son feuilleton de lundi dernier, et avec quelle délicatesse il a fait allusion à mon ouvrage sur Roméo et Juliette en citant les paroles de la marche funèbre: «Jetez des fleurs». Le Siècle d'hier contenait aussi quelques mots; beaucoup d'autres journaux que tu ne connais pas ont parlé de notre cruelle perte... Je pars dimanche prochain à huit heures du soir pour Hanovre, où je serai jusqu'au 3 ou 4 avril. Après cette date, je ne sais où je devrai aller; mais, en tout cas, je serai certainement à Dresde (Saxe) du 15 avril au 1er mai. Écris-moi le plus souvent possible pour m'informer de tes affaires. J'attends une lettre de toi avant dimanche et je compte en recevoir une autre à Hanovre, où tu m'informeras si tu as reçu le paquet que je vais t'envoyer. Le reste des objets que je n'ai pas vendus à Montmartre, tes livres, les portraits de ta mère et le mien, resteront à Paris, rue de Boursault, dans une malle fermée et portant ton adresse et la déclaration que cela t'appartient. J'ai donné deux de mes portraits à Joséphine et à Madeleine, qui me les ont demandés. En outre, j'ai donné plusieurs objets d'habillement de ta mère à Joséphine. Dieu veuille que mon voyage d'Allemagne me rapporte quelque chose! L'appartement de Montmartre n'est pas loué et il faudra peut-être que je le paye pendant un an encore.
Adieu, très cher enfant; mon affection pour toi semble avoir doublé depuis la perte que nous avons faite.
Je t'embrasse de tout mon cœur.
AU MÊME.
Dresde, 14 avril 1854.
Mon bien cher Louis,
Je reçois ta lettre et j'y réponds à l'instant. Tu m'annonces à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. Te voilà donc obligé d'aller dans la Baltique; mais quoi faire donc? puisque tu me dis que vous ne vous trouverez pas dans la bagarre. Je ne le devine pas. Enfin, j'espère que, hors du théâtre de la guerre, tu pourras continuer à te rendre utile et à mériter l'estime de ton nouveau commandant. Je t'autorise à faire toucher chez M. Réty, au Conservatoire, les cent francs qu'il devait te remettre dans le cas où tu serais allé chez ta tante. Tu lui enverras le billet ci-joint et tu m'écriras ensuite pour m'accuser réception de la somme quand Alexis te l'aura fait parvenir. Mais prends garde, il me semble que tu recommences à gaspiller ton argent. Je t'en ai envoyé deux fois le mois dernier. Achète une montre de peu de prix, mais excellente.
Je n'ai pas touché un sou depuis que je suis en Allemagne. On devait m'envoyer ici une somme de quatre cents francs de Hanovre, avec la croix que le roi m'avait fait annoncer; je n'ai reçu ni croix ni argent. J'ai écrit à ce sujet à trois personnes; aucune ne m'a répondu. Cela me fait partir la tête d'impatience. Je trouve tout le monde ici parfaitement disposé; on espère faire un grand riche concert. C'est une ville splendide, immense et animée comme Paris. Tous mes anciens amis s'y trouvent encore.
Adieu, cher enfant; écris-moi toujours le plus souvent possible, surtout quand tu auras quitté la France. Ne manque aucune occasion de me donner de tes nouvelles en m'indiquant bien où je devrai adresser mes lettres.
Je t'embrasse de tout mon cœur.
A M. HANS DE BULOW.
28 juillet 1854.
C'est une charmante surprise que vous m'avez faite, et votre manuscrit est arrivé d'autant plus à propos que l'éditeur Brandus, qui grave en ce moment Cellini, avait déjà choisi un assez obscur tapoteur de piano pour arranger l'ouverture.
Votre travail est admirable; c'est d'une clarté et d'une fidélité rares et aussi peu difficile qu'il était possible de le faire sans altérer ma partition. Je vous remercie donc de tout mon cœur. Je vais voir Brandus ce soir, et lui porter votre précieux manuscrit. J'ai beaucoup travaillé depuis mon retour de Dresde; j'ai fait la première partie de ma trilogie sacrée: le Songe d'Hérode. Cette partition précède l'embryon que vous connaissez sous le nom de Fuite en Égypte, et formera avec l'Arrivée à Saïs un ensemble de seize morceaux, durant en tout une heure et demie avec les entr'actes. C'est peu assommant, comme vous voyez, en comparaison des saints assommoirs qui assomment pendant quatre heures.
J'ai essayé quelques tournures nouvelles: l'air de l'Insomnie d'Hérode est écrit en sol mineur sur cette gamme, déterminée sous je ne sais quel nom grec dans le plain-chant:
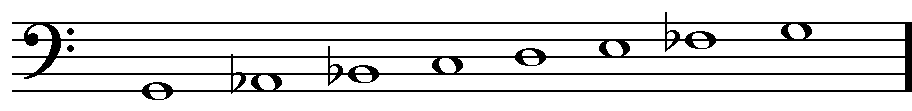
Cela amène des harmonies très sombres, et des cadences d'un caractère particulier, qui m'ont paru convenables à la situation. Vous avez été bien taciturne en m'envoyant le paquet de musique; j'eusse été si heureux de recevoir quelques lignes de votre main!
Mademoiselle votre sœur a passé dernièrement à Paris, mais si vite, que, quand on nous a remis la carte qu'elle a laissée à la maison un matin de bonne heure, elle était déjà partie pour Londres.
Veuillez, je vous prie, saluer de ma part madame votre mère. Ne viendrez-vous pas à Paris? Je pars dans quelques jours pour Munich, où je resterai trois semaines. Plus tard, vers novembre, je retournerai encore en Allemagne et peut-être vous reverrai-je à Dresde.
Rappelez-moi au souvenir de M. et madame Pohl et serrez la main à cet excellentissisme Lipinski.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, 28 août 1854.
J'espère que vous êtes bien portant et que vous et notre ami Lecourt avez échappé à la terrible maladie dont Marseille a tant eu à souffrir. Donnez-moi vite de vos nouvelles. Vous avez dû recevoir, il y a trois semaines, l'épreuve déjà corrigée de votre quatuor. L'avez-vous renvoyée? avez-vous écrit à Brandus?
J'ai manqué mon voyage à Munich, à cause de la vacance survenue à l'Institut. On m'a poussé à me mettre sur les rangs, à faire les visites et démarches d'usage en pareille circonstance. J'ai fait tout cela, j'ai vu tous les académiciens l'un après l'autre; et, après mille belles paroles extrêmement flatteuses, un accueil chaleureux, etc., ils ont nommé hier Clapisson. A la prochaine vacance maintenant. Je suis résolu à persister avec une patience égale à celle d'Eugène Delacroix et de M. Abel de Pujol, qui s'est présenté dix fois.
Reber m'a donné toutes les marques possibles de sincère sympathie et les trois autres musiciens de sincère antipathie. Z... a travaillé pour moi d'une main, j'ignore ce qu'il a fait de l'autre. On songe déjà sérieusement à faire admettre Leborne tôt ou tard. Vous voyez que tout va bien et qu'on progresse dans la voie de l'absurde. Je viens de passer huit jours aux bords de la mer, à Saint-Valéry, pour me décolériser. Ce grand air des falaises, ce vaste horizon, cette solitude et ce silence m'ont tout à fait remis. J'y serais demeuré plus longtemps sans les anxiétés que j'éprouvais au sujet de Louis. Et je suis revenu dans l'espoir d'obtenir plus vite à Paris des nouvelles du siège de Bomarsund, où il se trouvait. Heureusement il s'en est tiré sain et sauf, je viens de recevoir une lettre de lui. Dieu vous préserve, mon cher Morel, de connaître jamais de semblables émotions....
Madame Stoltz rentre mercredi prochain.
La *** ne tardera pas à revenir; ces deux tigresses vont s'entre-dévorer; ce sera cet hiver un spectacle curieux. Perrin vient de donner sa démission de directeur du Théâtre-Lyrique, il borne son ambition au trône de l'Opéra-Comique. Les criailleries des barbouilleurs de papier réglé l'ont effrayé.
A M. HANS DE BULOW.
1er septembre 1854.
J'ai été bien enchanté de votre aimable lettre et je me hâte de vous en remercier. Je ne suis pas allé à Munich. Au moment de partir, une place est devenue vacante à l'Académie des beaux-arts de notre Institut, et je suis resté à Paris pour faire les démarches imposées aux candidats. Je me suis résigné très franchement à ces terribles visites, à ces lettres, à tout ce que l'Académie inflige à ceux qui veulent intrare in suo docto corpore (latin de Molière); et on a nommé M. Clapisson.
A une autre fois maintenant. Car j'y suis résolu; je me présenterai jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Je viens de passer une semaine au bord de l'Océan, dans un village peu connu de la Normandie; dans quelques jours, je partirai pour le Sud, où je suis attendu par ma sœur et mes oncles pour une réunion de famille.
Je ne compte retourner en Allemagne que dans l'hiver. Sans doute, Liszt a raison en vous approuvant d'avoir accepté la position qui vous était offerte en Pologne; en tout cas, il ne faut pas perdre de vue votre voyage à Paris, si vous pouvez le faire avec une complète indépendance d'esprit, eu égard au résultat financier des concerts. Je me fais une fête de vous mettre en rapports avec tous nos hommes d'art dont les qualités d'esprit et de cœur pourront vous rendre ces rapports agréables.
Vous savez si bien le français, que vous pourrez comprendre le parisien; et vous trouverez peut-être amusant de voir comment tout ce monde d'écrivains danse sur la phrase, comment ceux qui osent encore accepter le titre de philosophes dansent sur l'idée.
Je serai tout à vous à mon retour, et fort désireux de connaître les compositions d'orchestre dont vous me parlez. Ma partition de Cellini ne saurait trouver un critique plus intelligent ni plus bienveillant que vous; laissez-moi vous remercier d'avoir songé à faire, dans le livre de M. Pohl, le travail qui s'y rapporte. Au reste, cette œuvre a décidément du malheur; le roi de Saxe se fait tuer au moment où on allait s'occuper d'elle à Dresde... C'est de la fatalité antique, et l'on pourrait dire à son sujet ce que Virgile dit sur Didon:
Ter sese attollens cubitoque adnixa levavit:
Ter revoluta toro est.
Quel grand compositeur que Virgile! quel mélodiste et quel harmoniste! C'était à lui qu'il appartenait de dire en mourant: Qualis artifex pereo! et non à ce farceur de Néron qui n'a eu qu'une seule inspiration dans sa vie, le soir où il a fait mettre le feu aux quatre coins de Rome,... preuve brillante qu'un homme médiocre peut quelquefois avoir une grande idée.
Hier, on a rouvert l'Opéra. Madame Stoltz a fait sa réapparition dans le rôle de la Favorite. En la voyant entrer en scène, je l'ai prise en effet pour une apparition. Sa voix aussi a subi du temps l'irréparable outrage. La nouvelle administration de l'Opéra avait fait un coup d'État et retiré leurs entrées à tous les journalistes; cette pauvre Stoltz va avoir fait une rentrée inutile. Il y a eu conseil, au foyer, de toutes les plumes (d'oie) puissantes, et nous avons décidé, à l'unanimité, qu'il fallait déclarer à l'Opéra la guerre du silence. En conséquence, on ne dira pas un mot de sa réouverture ni du début de madame Stoltz, jusqu'à ce que la direction revienne à de meilleurs sentiments.
Je travaille à un long feuilleton de silence qui paraîtra la semaine prochaine et qui m'ennuie fort. Adieu, je me suis un peu délassé à vous écrire.
A LOUIS BERLIOZ.
Paris, 26 octobre 1854.
J'étais tout triste ce matin, mon cher Louis. J'ai rêvé cette nuit que nous étions ensemble à la Côte et que nous nous promenions tous les deux dans le petit jardin. Ne sachant où tu es, ce songe m'avait péniblement affecté. Ta petite lettre que le portier m'a donnée comme je sortais, m'a remis le cœur à l'aise. Je t'écris au milieu de mes courses dans ma chambre du Conservatoire, avec l'espoir que cette lettre sera plus heureuse que les trois dernières, qui, à ce qu'il paraît, par ton avant-dernière datée de Kiel, ne te sont pas parvenues. Je t'ai écrit à Kiel au reçu de ta lettre. Enfin, j'espère que nous allons nous voir, ne fût-ce que quelques jours. J'ai à t'annoncer une nouvelle qui ne t'étonnera probablement pas et dont j'avais fait part d'avance à ma sœur et à mon oncle à mon dernier voyage à la Côte. Je suis remarié. Cette liaison, par sa durée, était devenue, tu le comprends bien, indissoluble; je ne pouvais ni vivre seul, ni abandonner la personne qui vivait avec moi depuis quatorze ans. Mon oncle, à sa dernière visite à Paris, fut lui-même de cet avis et m'en parla le premier. Tous mes amis pensaient de même. Tes intérêts, tu peux le penser, ont été sauvegardés. Je n'ai assuré à ma femme après moi, si je meurs le premier, que le quart de ma petite fortune; encore, ce quart, je sais que son intention est de te le faire revenir par un testament. Elle m'a apporté en dot son mobilier, dont la valeur est plus considérable que nous ne pensions, mais qui devra lui être rendu si je meurs avant elle. Tout cela a été réglé d'après les indications que m'avait données mon beau-frère. Ma position, plus régulière, est plus convenable ainsi. Je ne doute pas, si tu as conservé quelques souvenirs pénibles et quelques dispositions peu bienveillantes pour mademoiselle Récio, que tu ne les caches au plus profond de ton âme par amour pour moi. Ce mariage s'est fait en petit comité, sans bruit comme sans mystère. Si tu m'écris à ce sujet, ne m'écris rien que je ne puisse montrer à ma femme, car je voudrais pour beaucoup qu'il n'y eût pas d'ombres dans mon intérieur; enfin, je laisse à ton cœur à te dicter ce que tu as à faire. J'ai vu l'amiral Cécile qui a reçu ta lettre. Il m'a appris qu'avant l'expiration de tes trois ans de navigation sur un vaisseau de l'État, tu ne pouvais entrer dans la marine militaire; mais que c'était de droit, si tu le voulais, après cette époque; qu'alors tu serais admis comme sergent d'armes ou comme second chef de timonerie. Je suis dans tous les embarras et ennuis des préparatifs d'un concert pour faire entendre une première fois mon nouvel ouvrage l'Enfance du Christ. Il surgit, comme je m'y attendais, des difficultés qui peut-être seront insurmontables; car je ne veux point risquer d'argent. A propos d'argent, j'en ai mis de côté, que j'ai à te remettre en partie pour tes dépenses. J'ai aussi une malle contenant divers objets dont tu ne peux faire usage dans ta position; elle est fermée et porte ton nom comme t'appartenant. Je t'en prie, si tu reçois cette lettre, écris-moi aussitôt.
Je t'embrasse de toute mon âme; mon affection pour toi semble redoubler. Ton admission comme suppléant du lieutenant à bord du La Place a produit le meilleur effet, et, de plus, diverses personnes (entre autres un rédacteur correspondant du Moniteur) qui t'ont vu, ont parlé de toi à l'amiral et à mon ami Raymond avec de grands éloges. Je te remercie.
Adieu, cher fils ami, cher Louis! aime-moi comme je t'aime.
A LÉON KREUTZER.
Weimar, 16 février 1855.
Merci, mon cher Kreutzer, mille fois merci et dix mille compliments! Liszt vient de me donner votre article de dimanche dernier[88] qui m'a rendu bien heureux. C'est merveilleusement écrit et senti. Je ne saurais vous dire ma joie en lisant votre analyse du microcosme sentimental contenu dans la Ballade du Roi de Thulé!... Rien ne vous a échappé! Seriez-vous par hazard (sic) le véritable auteur de ce morceau?... Et ne suis-je que votre plagiaire?... Quels yeux doivent ouvrir en vous lisant les braves confectionneurs de musique parisienne!... Mais qu'ils ouvrent les yeux en vous lisant ou qu'ils les ferment en m'écoutant, au fond, qu'importe! Ni vous, ni moi, je crois, n'avons jamais eu la prétention de travailler pour eux.
Permettez-moi de vous dire encore que ce parallélisme de sentiments et d'idées qui me semble évidemment exister chez nous deux, a développé et renforcé l'amitié que je ressentais pour vous, sans que, je puis le jurer, la satisfaction égoïste de l'amour-propre y soit pour rien. Non, il est naturel d'aimer les cœurs qui battent dans le rythme du nôtre, les esprits qui volent vers le point du ciel où nous voudrions pouvoir voler, autant qu'il l'est, c'est triste à dire, d'éprouver de l'antipathie pour les êtres divergents, rampants, négatifs et très positifs. Pardon de ce jeu de mots qui a l'air de rendre mon idée.
J'ai été singulièrement attristé hier à la répétition du trio avec chœurs de Cellini en voyant avec quel aplomb l'orchestre, le chœur et les chanteurs l'ont exécuté, et en songeant aux tristes vicissitudes de cette partition égorgée deux fois en deux infâmes guet-apens!... Certainement il y a là une verve et une fraîcheur d'idées que je ne retrouverai peut-être plus. C'est empanaché, fanfaron, italo-gascon, c'est vrai! Tenez, moquez-vous de moi; mais j'en ai rêvé cette nuit et je me sens le cœur serré d'avoir entendu cette scène! et j'ai hâte pourtant de la réentendre demain.
Adieu; priez le bon Dieu pour vos gens qui vont se battre; ce sera une rude journée. Je vous serre la main.
A M. TAJAN-ROGÉ.
Paris, 2 mars 1855.
J'arrive ce matin de l'Allemagne du Nord, je trouve votre lettre, et tout ratatiné par une horrible nuit passée en wagon, avec un froid digne du Canada, je vous réponds sans prendre haleine. N'est-ce pas exemplaire? D'abord, je vous remercie d'avoir tenu votre parole et de m'avoir envoyé un vrai feuilleton de six colonnes... et vous faites cela pour rien? gâte-métier!
Je me doutais bien des belles mœurs musicales au milieu desquelles vous avez le bonheur de vivre, et rien de ce que vous m'apprenez ne m'étonne, si ce n'est le nombre des répétitions qu'on vous fait faire pour monter un grand opéra[89]. Oui, franchement, je pensais que, dans le nouveau monde, pays de la Liberté, qui connaît le prix du temps, on avait entièrement aboli cette vieille coutume des répétitions, et qu'on ne répétait jamais. Mais je vois qu'on ne m'avait pas trompé: la Nouvelle-Orléans est antiabolitioniste! et c'est vous autres qui êtes les nègres. Vous comptez même à ce qu'il paraît des nègres marrons, puisque votre première contrebasse s'est sauvée et qu'elle vit libre dans les bois, à l'heure qu'il est.
Vous ne me dites rien de vos projets commerciaux; vous aviez emporté un tas de petites bouteilles, qui m'avaient fait espérer que vous opéreriez là-bas la transmutation des vils métaux en or. Mais je pense que vos bouteilles ne vous auront pas donné de l'eau à boire.
Je viens de Weimar et de Gotha, où l'on m'a comblé, archi-comblé de tout ce qui en Europe constitue le succès.
Au dernier concert de Weimar, j'avais un programme monstre (L'Enfance du Christ,—la Symphonie fantastique,—le Retour à la vie). Ce dernier ouvrage que vous ne connaissez pas et dont j'ai fait aussi les paroles et la musique, est un monodrame lyrique. L'acteur unique qui joue le rôle de l'artiste, le joue sur l'avant-scène agrandie.—La toile est baissée et derrière la toile s'élève un amphithéâtre d'où l'orchestre, les chefs et les chanteurs se font entendre invisibles. Les morceaux de musique sont des mélodies et des harmonies imaginaires, que l'artiste entend en pensée seulement, et que l'auditoire entend en réalité, mais un peu affaiblies par la toile qui sert ainsi de sourdine. J'ai été rappelé quatre fois après cet ouvrage, que j'écrivis, il y a vingt-deux ans, en vagabondant dans les bois en Italie, et que je ne ferai sans doute jamais exécuter ici que par fragments. Il y a là un chœur d'Ombres qui m'a fait frissonner, je vous l'avoue, tant c'est étrangement terrible dans son lent et solennel crescendo. En voici les paroles:
Froid de la mort, froid de la tombe,
Bruit éternel des pas du temps,
Noir chaos où l'espoir succombe,
Quand donc finirez-vous? Vivants!
Toujours, toujours la mort vorace
Fait de vous un nouveau festin,
Sans que sur la terre on se lasse
De donner pâture à sa faim.
Pour L'Enfance du Christ, l'effet a été le même qu'ici, où il faut avouer que le public a été réellement très aimable. On a pleuré à mouiller des mouchoirs. Je regrette bien de ne pouvoir pas vous faire connaître cela; mais, dès que la partition aura paru, je vous l'enverrai. Le fils de Guiraud m'a été bien utile pour les deux dernières exécutions. Il a accompagné les chœurs aux répétitions, il a dû même les diriger pendant le finale de la première partie, où les choristes sont placés de manière à ne pas voir le chef d'orchestre. C'est un charmant garçon qui deviendra un homme.
Faites sur lui des compliments à son père en lui transmettant mes plus cordiales amitiés. Je serre la main à Prévost en lui souhaitant du courage pour le rude labeur qu'il accomplit.
Maintenant adieu, mon cher Rogé; il me faut employer activement les huit jours que je suis venu passer à Paris, étant engagé à donner trois concerts à Bruxelles du 15 au 25 de ce mois. Puis je dois en donner un autre ici à l'Opéra-Comique le 6 avril, avec les deux théâtres de M. Perrin réunis, organiser l'exécution (première) de mon Te Deum à Saint-Eustache pour le 1er mars et partir pour Londres, où je suis engagé par la New Philharmonic Society.
Du reste, rien de nouveau dans le monde musical parisien, mademoiselle Cruvelli n'a toujours que cent mille francs pour huit mois....
Ma femme vous remercie de votre bon souvenir. Nous voyons quelquefois madame et mademoiselle Rogé, qui sans doute se portent bien. Je suis ici depuis six heures et n'ai pu avoir encore de leurs nouvelles.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, le 14 avril 1855.
Mon cher Morel,
Je ne vous écris que six lignes pour vous prier de m'excuser si je n'ai pas encore répondu à votre dernière lettre. Elle m'arriva au moment où je partais pour Bruxelles et j'ai été depuis lors si éreinté, si absorbé par mille tracas, qu'il m'a été impossible de trouver cinq minutes de liberté. Les musiciens belges m'ont fait souffrir une torture de Huron. Ces braves artistes, si bons, si patients, si accueillants, ne peuvent se décider à prendre la peine de décomposer une mesure et tout ce qui ne frappe pas le premier temps fort leur fait perdre l'équilibre. Le troisième concert seul a bien marché.
Celui de l'Opéra-Comique, samedi dernier, a beaucoup laissé à désirer sous le rapport de l'exécution. L'orchestre seul est resté irréprochable.
Maintenant me voilà plongé dans le Te Deum, et c'est en ce moment que votre absence me semble étrange... J'espère pourtant que tout marchera bien. Voulez-vous être assez bon pour faire reproduire dans les journaux de Marseille la réclame ci-jointe? Il faut que l'immense église soit pleine, ou nous sommes flambés. Cela coûte sept mille francs.
J'apprends que vous écrivez un nouveau quintette?... tant mieux! que ce genre difficile fleurisse donc en France! Votre ami Baudillon se marie, il épouse une jeune pianiste qui a l'air fort gracieux et tout à fait agréable. Et vous? ne vous mariez-vous point? vous auriez pourtant besoin d'un intérieur; vous manquez de dorloteries, je le crains, sensible et mélancolique comme vous l'êtes.
Je serre la main à Lecour. Théodore Bennet (Ritter) lui a dédié sa réduction pour le piano de notre adagio de Roméo. Cet enfant est très remarquable et je l'aime sincèrement.
A RICHARD WAGNER.
Paris, 10 septembre 1855.
Mon cher Wagner,
Votre lettre m'a fait un bien grand plaisir. Vous n'avez pas tort de déplorer mon ignorance de la langue allemande, et ce que vous me dites de l'impossibilité où je suis d'apprécier vos ouvrages, je me le suis dit bien des fois. La fleur de l'expression se fane presque toujours sous le poids de la traduction, si délicatement que cette traduction soit faite. Il y a des accents, dans la musique vraie, qui veulent leur mot spécial, il y a des mots qui veulent leur accent. Séparer les uns des autres, ou leur donner des approximatifs, c'est faire allaiter un petit chien par une chèvre et réciproquement. Mais que voulez-vous! j'ai une difficulté diabolique à apprendre les langues; c'est à peine si je sais quelques mots d'anglais et d'italien....
Vous êtes donc en train de faire fondre les glacières en composant vos Niebelungen!... Cela doit être superbe, d'écrire ainsi en présence de la grande nature!... Voilà encore une jouissance qui m'est refusée! Les beaux paysages, les hautes cimes, les grands aspects de la mer, m'absorbent complétement au lieu de provoquer chez moi la manifestation de la pensée. Je sens alors et ne saurais exprimer. Je ne puis dessiner la lune qu'en regardant son image au fond d'un puits.
Je voudrais bien pouvoir vous envoyer les partitions que vous me faites le plaisir de me demander; malheureusement mes éditeurs ne m'en donnent plus depuis longtemps. Mais il y en a deux et même trois: le Te Deum, l'Enfance du Christ et Lelio (monodrame lyrique), qui vont paraître dans peu de semaines, et celles-là au moins, je pourrai vous les envoyer.
J'ai votre Lohengrin; si vous pouviez me faire parvenir le Tannhäuser, vous me feriez bien plaisir. La réunion que vous me proposez serait une fête; mais je dois bien me garder d'y penser. Il faut que je fasse des voyages de désagrément, pour gagner ma vie, Paris ne produisant pour moi que des fruits pleins de cendre.
C'est égal, si nous vivions encore une centaine d'années, je crois que nous aurions raison de bien des choses et de bien des hommes. Le vieux Demiourgos doit bien rire là-haut, dans sa vieille barbe, du succès constant de la vieille farce qu'il nous fait... Mais je ne dirai pas de mal de lui, c'est un de vos amis, et je sais que vous le protégez. Je suis un impie plein de respect pour les Pies. Pardon de cet affreux calembour avec lequel je finis en vous serrant la main.
P.-S.—Voilà qu'il m'arrive une troupe ailée d'idées de toutes couleurs, et l'envie de vous les envoyer... Je n'ai pas le temps. Tenez-moi pour une bête, jusqu'à nouvel ordre.
A LOUIS BERLIOZ.
Paris, 27 avril 1855.
Cher Louis,
Je t'écris trois lignes à la course. Je ferai ce que tu veux à partir de la semaine prochaine. L'amiral est venu chez moi avant-hier, je n'y étais pas; je vais courir après lui.
J'ai été bien malade avant-hier; j'ai cru que je n'aurais pas la force d'aller jusqu'au bout de mes répétitions. Aujourd'hui je suis un peu mieux; nous avons fait hier à Saint-Eustache la première répétition d'orchestre[90] avec les six cents enfants. Aujourd'hui je fais répéter l'ensemble de mes deux cents choristes artistes. Cela va marcher. C'est colossal! Le diable m'emporte, il y a un final qui est plus grand que le Tuba mirum de mon Requiem.
Quel malheur que tu n'entendes pas cela!
Adieu; sois bien raisonnable, ne gaspille pas ton peu d'argent.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, 2 juin 1855.
Excusez-moi de ne vous avoir pas encore répondu. Vous connaissez la vie de Paris et pourtant je doute que vous vous fassiez une idée de celle que j'ai menée depuis un mois. Enfin, me voilà un peu plus libre, je n'ai que des épreuves à corriger du matin au soir, des courses à faire chez les graveurs et imprimeurs, etc., etc.; on grave à la fois l'Enfance du Christ, grande et petite partition; le Te Deum, grande partition, le monodrame du Retour à la vie, grande et petite partition. Quant au Te Deum, c'est moi qui le publie en société avec Jemmy Brandus; et, si le Conservatoire de Marseille peut m'en prendre un exemplaire, je me recommande à lui. Le prix de la souscription est de quarante francs. Parlez donc de cela à Lecourt. Bennet[91] prétend que je pourrai trouver cinq ou six souscripteurs à Marseille. Laval m'a dit vous avoir envoyé les dernières épreuves de votre quatuor; avez-vous fini? ai-je quelque chose à dire chez Brandus à ce sujet? Je vous remercie mille fois de votre affectueuse sollicitude pour Louis. Il a en effet dû laisser partir le Fleurus et il est en ce moment en convalescence à l'hôpital de Saint-Mandrier à Toulon. Vous me demandez de vous parler du Te Deum; c'est très difficile à moi. Je vous dirai seulement que l'effet produit sur moi par cet ouvrage a été énorme et qu'il en a été de même pour mes exécutants. En général, la grandeur démesurée du plan et du style les a prodigieusement frappés, et vous pouvez croire que le Tibi omnes et le Judex, dans deux genres différents, sont des morceaux babyloniens, ninivites, qu'on trouvera bien plus puissants encore, quand on les entendra dans une salle moins grande et moins sonore que l'église Saint-Eustache. Je pars vendredi pour l'Angleterre. Wagner, qui dirige à Londres l'ancienne Société philharmonique (direction que j'avais été obligé de refuser étant déjà engagé par l'autre), succombe sous les attaques de toute la presse anglaise. Mais il reste calme, dit-on, assuré qu'il est d'être le maître du monde musical dans cinquante ans.
Verdi est aussi aux prises avec tous les gens de l'Opéra. Il leur a fait hier une scène terrible à la répétition générale.
Le pauvre homme me fait mal; je me mets à sa place. Verdi est un digne et honorable artiste. Rossini est arrivé; il blaguotte tous les soirs sur le boulevard. Il a l'air d'un vieux satyre en retraite.
AU MÊME.
Paris, 21 juillet 1855.
Mille remerciements pour votre bonne et affectueuse lettre; je ne pourrai pas vous en écrire une pareille, je suis malade de l'ennui de Paris, de la chaleur, de mille assommantes affaires. J'ai fait tout de suite votre commission. Laval ne vous avait pas expédié le quatuor parce que les corrections n'étaient pas faites; le graveur l'avait trompé en lui disant qu'elles l'étaient. Cela doit être terminé maintenant, et je pense que vous recevrez bientôt le paquet si vous ne l'avez pas déjà reçu.
J'ai fait une brillante excursion à Londres, où je me case de mieux en mieux. J'y retournerai cet hiver, après une tournée que je projette en Bohême et en Autriche, si nous ne sommes pas en guerre contre les Autrichiens.
Je ne fais en ce moment que corriger des épreuves du matin au soir.
Je vous remercie de m'avoir trouvé pour le Te Deum quelques souscripteurs; il sera publié très prochainement. On m'a commandé à Londres un petit travail: L'art du chef d'orchestre, qui doit être ajouté à l'édition anglaise de mon traité d'instrumentation revu et augmenté. Cela va m'occuper exclusivement tout le mois prochain.
Louis est ici; il se remet tout doucement, il se loue avec effusion de vos bontés pour lui et des amis que vous lui avez procurés à Toulon. Depuis mon retour à Londres, je n'ai rien vu, rien entendu; je ne puis donc rien vous raconter. Je ne connais pas encore les Vêpres de Verdi. Meyerbeer doit être content de son Étoile à Covent-Garden; on lui a jeté des bouquets comme à une prima donna. Et Gouin n'y était pas! Bennet et son fils (Ritter) m'avaient suivi à Londres. Après avoir entendu l'adagio de Roméo et Juliette par notre grand orchestre d'Exeter Hall, Bennet, le père, commence à croire que le piano ne peut pas approcher de cette puissance expressive, chose qu'il ne croyait pas auparavant...
Son fils est un admirable et charmant enfant, qui sera bientôt, je le crois, un grand artiste. Il vous a remplacé dans la Fée Mab, en jouant les petites cymbales.
AU MÊME.
Paris, 9 janvier 1856.
Merci de toutes les choses amicales que vous me dites et des détails que vous me donnez sur le mouvement musical du centre où vous vivez. Il n'y a rien ici de nouveau; l'Opéra ne varie pas plus son répertoire qu'il ne le variait autrefois.
Mais je le crois (l'Opéra) dans de graves embarras. Crosnier ne veut ni ne peut rien; le directeur musical c'est Girard, qui fait tout ce qu'il veut et ne laisse rien faire que ce qu'il veut; il a pour remplir cette dictature 18,000 francs d'appointements.
On vient de décorer Dietsch. Que vous dirai-je? On donne un opéra nouveau tous les huit jours. Le Théâtre-Lyrique a été sur le point de fermer avant-hier; il ne payait pas du tout. Il repaye un peu maintenant et compte, pour se sauver, sur un opéra de Clapisson. L'Opéra-Italien est en perte de 200,000 francs. L'Opéra-Comique seul, sans faire de brillantes affaires, se soutient passablement.
Tout cela n'est pas gai; on ne voit que tripotages, platitudes, niaiseries, gredineries, gredins, niais, plats et tripoteurs.
Je me tiens toujours de plus en plus à l'écart de ce monde empoisonné d'empoisonneurs.
Je commence à me remettre des fatigues terribles des concerts de l'Exposition.
Je reçois de temps en temps des lettres de l'extérieur qui me donnent des recrudescences momentanées d'ardeur musicale. Il m'en est arrivé une de Bruxelles il y a quinze jours, sur Faust, qui dépasse tout ce qu'on m'a jamais écrit en ce genre, même les lettres du baron de D*** sur Roméo et Juliette. Quant aux Parisiens, c'est toujours la même chose inerte et glacée en général; le petit public de la salle Herz est si peu puissant, que son influence est presque nulle. Le prince Napoléon me fait un très gracieux accueil; il s'étonne de la mesquine position que j'occupe à Paris, et ne parvient pas à m'en faire changer. L'empereur est inaccessible et exècre la musique comme dix Turcs...
Merci de vos bonnes intentions et de celles de Lecourt pour mon fils; je n'entre pas dans votre manière de voir au sujet de la marine marchande; tant mieux si je me trompe. Mais il n'y a point de carrière assurée pour Louis dans ce moment en quittant la marine de l'État, et je suis dans la plus complète impossibilité de lui venir en aide. C'est l'opinion de ma sœur et de mon oncle qu'il devrait rester où il est; il va les mécontenter tous, surtout mon oncle, qu'il a tant d'intérêt à ménager. Je ne sais plus que dire; il m'a fait écrire à l'empereur pour qu'il l'aide à arriver à un grade qu'il ambitionne; j'ai mis sans succès en mouvement l'amiral Cécile et tous mes amis des Débats.
Maintenant je ne puis plus rien; Louis s'est posé l'arbitre de sa destinée en n'agissant qu'à son gré. Il faut me taire et attendre avec anxiété le résultat de sa conduite irréfléchie. En tout cas, je n'ai pas besoin de vous dire combien je suis touché de l'intérêt que vous lui témoignez et de vous assurer de ma vive reconnaissance pour ce que vous ferez pour lui. Je ne puis rien tenter en musique à Paris d'un peu important; obstacles en tout et partout. Pas de salle! pas d'exécutants (de ceux que je voudrais). Il n'y a pas même un dimanche dont je puisse disposer pour donner mon petit concert. Les uns sont pris par la Société des concerts, les autres par la Société Pasdeloup, qui a retenu la salle Herz pour toute la saison. Je suis forcé de me contenter d'un vendredi.
Adieu; en voilà assez, en voilà trop, à quoi bon récriminer? le choléra existe, on le sait, pourquoi la musique parisienne n'existerait-elle pas?
A THÉODORE RITTER.
12 janvier 1856.
Mon cher et très cher Théodore,
Souvenez-vous du 12 janvier 1856!
C'est le jour où, pour la première fois, vous avez abordé l'étude des merveilles de la grande musique dramatique, où vous avez entrevu les sublimités de Gluck!
Quant à moi, je n'oublierai jamais que votre instinct d'artiste a, sans hésiter, reconnu et adoré avec transport ce génie nouveau pour vous. Oui, oui, soyez-en certain, quoi qu'en disent les gens à demi-passion, à demi-science, qui n'ont que la moitié d'un cœur et un seul lobe au cerveau, il y a deux grands dieux supérieurs dans notre art: Beethoven et Gluck. L'un règne sur l'infini de la pensée, l'autre sur l'infini de la passion; et, quoique le premier soit fort au-dessus du second comme musicien, il y a tant de l'un dans l'autre néanmoins, que ces deux Jupiters ne font qu'un seul dieu en qui doivent s'abymer (sic) notre admiration et nos respects.
A M. ERNEST LEGOUVÉ[92].
Paris, 9 avril 1856.
Mille joies triomphantes, mon cher Legouvé! c'est superbe! C'est le plus beau succès, le plus pur, le plus légitime, le plus providentiel auquel j'aie assisté de ma vie. J'ai le cœur gonflé, à en éclater.... C'est si beau, un chef-d'œuvre complet! un chef-d'œuvre interprété par une femme de génie, par une muse, et un chef-d'œuvre échappé, qui plus est, aux dangers de la traduction. Vous avez tous les bonheurs à la fois, un traducteur incomparable, une actrice sublime, un public intelligent et sensible, et une offense vengée....
Je vous chante en mon âme un hymne de gloire dont les fanfares retentiraient jusqu'en Grèce si on l'exécutait.
Nous avons pleuré et frémi, ma femme et moi. Je vous embrasse; il y avait longtemps que je n'avais ressenti une telle joie!
A M. AUGUSTE MOREL
Paris, 23 mai 1856.
Louis m'écrit de Toulon. Il va quitter le service de l'État, et il cherche un embarquement pour un voyage d'un an à quinze mois. Soyez assez bon pour l'aider à trouver un navire où il soit convenablement et qui parte bientôt. Priez instamment Lecourt de ma part de vous seconder dans cette recherche. Vous m'obligerez beaucoup. Je viens de lui écrire (à Louis) à Toulon, pour le prévenir qu'un paquet de vêtements dont il a besoin lui sera expédié mardi prochain 27, par mon tailleur,—Bureau restant des Messageries impériales de Marseille. Si ma lettre arrivait à Toulon pendant que Louis sera à Marseille, veuillez l'en prévenir, afin qu'il aille réclamer le paquet au bureau des Messageries vers le 29 ou le 30.
J'ai vu votre ami, dont je ne me rappelle pas le nom (M. Rostand) et qui cause très bien de toutes choses et même de musique. Il aurait voulu entendre quelque ouvrage de moi pendant son séjour à Paris, mais il n'y avait pas de possibilité de le satisfaire. Je suis immensément occupé et, pour vous dire la vérité, très malade, sans que je puisse découvrir ce que j'ai. Un malaise incroyable; je dors dans les rues, etc.; enfin, c'est peut-être le printemps. J'ai entrepris un opéra en cinq actes dont je fais tout, paroles et musique. J'en suis au troisième acte du poème; j'ai fini hier le deuxième. Ceci est entre nous; je le cisèlerai à loisir après l'avoir modelé de mon mieux; je ne demande rien à personne en France. On le jouera où je pourrai le faire jouer: à Berlin, à Dresde, à Vienne, etc., ou même à Londres; mais on ne le jouera à Paris (si on en veut) que dans des conditions tout autres que celles où je me trouverais placé aujourd'hui. Je ne veux pas remettre ma tête dans la gueule des loups ni dans celle des chiens.
Nous avons eu à Weimar des scènes incroyables au sujet du Lohengrin de Wagner.... Ce serait trop long à vous raconter. Il en est résulté des histoires qui font encore long feu en ce moment dans la presse allemande.
Adieu, mon cher Morel; je sais que votre affaire avec Brandus est enfin terminée. Il était temps. Bennet est à Nancy avec son fils. Je ne vois jamais le fils de Lecourt, j'aurais pourtant bien du plaisir à causer quelquefois avec lui. On dit que c'est un charmant garçon.
C'est comme le petit Daniel Liszt. Son père m'annonce ses visites et je ne l'ai jamais vu. J'attends un mot de vous très prochainement.
AU MÊME.
Paris, 9 septembre 1856.
Mon cher Morel,
Le navire sur lequel doit partir Louis est-il arrivé? je ne reçois point de nouvelles à cet égard.
Comment allez-vous? Voilà bientôt votre Conservatoire qui va vous retomber sur les bras. Votre opéra est-il avancé? Je travaille exclusivement au mien, sans en parler seulement à Alphonse Royer, qui est, comme furent tous les autres directeurs de l'Opéra, un Hottentot en musique. Il me regarde comme un grand symphoniste qui ne peut et ne doit faire que des symphonies et qui ne sait pas écrire pour les voix. Il n'a entendu ni Faust ni l'Enfance du Christ; il ne connaît rien à toutes ces questions, et c'est néanmoins une opinion arrêtée chez lui. Il l'a dit dernièrement à un de mes amis. J'en étais d'ailleurs parfaitement sûr d'avance; je connaissais ses idées sur la musique. Mais je n'en continue pas moins ma partition avec un vague espoir d'arriver plus tard par le haut de l'édifice, c'est-à-dire par la volonté de l'empereur.
En attendant, je vous avouerai que le poème, que j'ai lu à diverses personnes, a un grandissime succès. Je crois que vous aussi vous trouveriez cela beau.
A M. L'ABBÉ GIROD[93].
Paris, 16 décembre 1856
Monsieur,
J'ai reçu le livre que vous avez bien voulu m'envoyer et je l'ai lu avec le plus vif intérêt. Si la question pouvait être rendue plus claire qu'elle ne l'est, elle l'eût été par vous. Il n'est pas possible de la concevoir mieux exposée, ni mieux débattue; mais c'est, je l'avoue, une espèce de chagrin pour moi, de voir des hommes de cœur et d'intelligence tels que vous, monsieur, employer leur temps et leurs forces à combattre de semblables moulins à vent. Les seuls points sur lesquels j'ai le regret de me trouver en dissidence avec vous, sont ceux qui ont trait à la fugue classique sur Amen! et au jeu de mutation des orgues.
Sans doute, on pourrait écrire une belle fugue d'un caractère religieux pour exprimer le souhait pieux: Amen! Mais elle devrait être lente, pleine de componction et fort courte; car, si bien qu'on exprime le sens d'un mot, ce mot ne saurait être, sans ridicule, répété un grand nombre de fois. Au lieu de cette réserve et de cette tendance expressive, les fugues sur le mot amen sont toutes rapides, violentes, turbulentes, et ressemblent d'autant plus à des chœurs de buveurs entremêlés d'éclats de rire, que chaque partie vocalise sur la première syllabe du mot a......a-a-a-a-men, ce qui produit l'effet le plus grotesque et le plus indécent. Ces fugues traditionnelles ne sont que d'insensés blasphèmes.
Quant aux jeux de mutation de l'orgue, c'est le charivari organisé et je ne puis les entendre sans horreur.
L'habitude, l'usage, la routine sont les soutiens de ces barbaries que nous légua l'ignorance du moyen âge; si j'étais encore un artiste guerroyant comme autrefois, je vous dirais: Delenda est Carthago! Mais je suis las et obligé de reconnaître que les absurdités sont nécessaires à l'esprit humain et naissent de lui comme les insectes naissent des marécages. Laissons les uns et les autres bourdonner!
A M. BENNET.
Paris, 26 ou 27 janvier (1857).
Oui, Théodore a raison: votre papier pelure qui boit l'encre m'a fortement agacé les nerfs, qui sont déjà si malades. Changez donc de parchemin pour m'écrire à l'avenir.
Je vous remercie néanmoins, et très cordialement, de votre bonne et réconfortante lettre. Mais je n'ai pas besoin, autant que vous le croyez, d'être encouragé à continuer mon travail. Tout malade que je suis, je vais toujours; ma partition[94] se fait, comme les stalactites se forment dans les grottes humides, et presque sans que j'en aie conscience. J'achève en ce moment d'instrumenter le finale monstre du premier acte, qui m'avait jusqu'à hier donné de graves inquiétudes à cause de ses dimensions. Mais j'ai envoyé Rocquemont me chercher au Conservatoire la partition d'Olympie de Spontini, où se trouve une marche triomphale dans le même mouvement que la mienne et dont les mesures ont la même durée que celles de mon finale. J'ai compté les mesures; il y en a 347, et je n'en ai, moi, que 244. D'ailleurs, il n'y a point d'action durant cet immense développement processionnel de la marche d'Olympie, tandis que j'ai une Cassandre qui occupe la scène pendant le déroulement du cortège du cheval de bois dans le lointain. Enfin cela peut aller[95].
J'ai entièrement fini aussi le duo et le finale du quatrième acte. Voyez avec quelle facilité vous m'entraînez à vous parler de mon ouvrage!... Ah! je n'ai pas d'illusions, non, et vous me faites rire avec ces vieux mots de mission à remplir! quel missionnaire!... Mais il y a en moi une mécanique inexplicable qui fonctionne malgré tous les raisonnements, et je la laisse faire, parce que je ne puis l'empêcher de fonctionner.
Ce qui me dégoûte le plus, c'est la certitude où je suis de la non-existence du beau pour l'incalculable majorité des singes humains!...
Madame X..., qui est venue me voir avant-hier, m'avouait naïvement et tristement qu'elle n'avait jamais ni vu ni lu la Vestale de Spontini.
Une artiste pareille qui a passé sa vie dans le monde musical et théâtral, s'être trouvée, par hasard, partout où cette lumière du génie ne brillait pas!... N'y a-t-il pas là de quoi révolter contre le sort des chefs-d'œuvre! Il est vrai qu'elle a été élevée au milieu de la boutique des épiciers italiens!... Mais cette éducation coloniale ne l'a pas empêchée de faire connaissance plus tard avec Mozart, Haydn, Beethoven, Gluck, et de s'éprendre même pour la lourde face emperruquée de ce tonneau de porc et de bière qu'on nomme Haendel!...
Ainsi me voilà à la tête d'un acte et demi de partition terminée. Avec du temps, le reste de la stalactite se formera peut-être bien, si la voûte de la grotte ne s'écroule pas....
Nous serons bien heureux de vous voir revenir à Paris, ne fût-ce que pour quelques semaines.... Réalisez votre plan de concert, je serai probablement assez fort dans un mois pour pouvoir le diriger, et cela me réchauffera un peu.
Il est heureux que ma lettre touche à sa fin;... le pâle rayon de soleil qui éclairait ma fenêtre quand j'ai commencé à vous écrire, s'éteint, et je ne me sens plus que du froid au cœur, et je vois tout en gris, et je vais m'étendre sur mon canapé et y fermer les yeux de l'esprit et du corps pour ne rien voir et demeurer stupide comme un arbre sans feuilles et ruisselant de pluie.
P.-S.—Rue de Calais (encore une fois, et non de Douai), nº 4.
A M. AUGUSTE MOREL
Paris, samedi soir 25 ou 26 avril 1857.
Mon cher Morel,
Je vous remercie de votre empressement à me faire savoir que vous aviez reçu des nouvelles de Louis; mais j'avais déjà, moi aussi, une lettre de Bombay, dans laquelle il m'apprenait à peu près les mêmes choses qu'il vous a dites. Je vous enverrai plus tard une lettre que je vous prierai de lui remettre à son arrivée à Marseille, qu'il m'annonce seulement pour la fin d'août. Je suis bien heureux qu'il puisse avoir un mois à peu près à sa disposition pour venir me faire une visite. Je me recommanderai encore à vous à cette occasion, pour veiller à ce qu'il ne vienne à Paris qu'avec une entière certitude de ne pas compromettre par ce voyage sa position à bord de la Belle-Assise, et la promesse bien formelle d'y être de retour au temps que lui indiquera son capitaine. Au reste, je le suppose plus raisonnable maintenant.
Je travaille comme vous à une énorme partition; malgré toutes les interruptions forcées et les distractions qu'apporte la vie de Paris, j'ai fait deux actes et demi, entièrement instrumentés, polis et limés. Il me tarde cependant de ne plus traîner ce monstrueux boulet. On fait en ce moment, dans notre petit monde, un succès boursouflé à mon poème. J'en ai fait deux lectures devant deux aréopages assez compétents, l'une chez M. Édouard Bertin, l'autre chez moi. On trouve cela beau. Dernièrement, à l'une des soirées des Tuileries, l'impératrice m'en a parlé longuement. J'irai plus tard le lire à Leurs Majestés, si l'empereur a une heure de liberté. Je voudrais, quand je subirai cette épreuve, être plus avancé dans le travail de la partition, et avoir au moins trois actes achevés. Pourtant quand l'empereur ordonnerait la mise à l'étude immédiate de cet immense ouvrage, je ne pourrais y consentir. Je n'ai pas les deux femmes capables de jouer, de chanter et de représenter Cassandre et Didon.
Allez souhaiter le bonjour à Lecourt de ma part et lui serrer la main. Comment traîne-t-il la vie? Je ne vois jamais son fils.
Obéron continue à remplir la caisse du Théâtre-Lyrique.
Dimanche matin.
Je reçois à l'instant une lettre de Lecourt. Il m'apprend que vous vous donnez un mal d'enfer pour faire aller la Fête de Roméo et Juliette. Pourquoi avez-vous tenté cela? sans harpes?... et sans un orchestre assez fort?... Dites-moi comment a marché le concert.
AU MÊME.
Paris, 7 septembre 1857.
Mon cher Morel,
Vous avez encore comblé Louis de bontés et de témoignages d'affection, laissez-moi vous en remercier et vous prier aussi de présenter l'expression de ma vive reconnaissance à madame votre mère, dont Louis ne parle qu'avec attendrissement. Il commence à se montrer moins enfant et plus préoccupé de son avenir; je ne doute pas que vos bons avis ne soient pour beaucoup dans ce progrès. Nous avons fait, lui et moi, plusieurs démarches inutiles ces jours-ci, pour avoir des nouvelles de son capitaine et de son navire. Le silence de M. Aubin commence à nous inquiéter. J'ai appris chez M. de Rothschild que l'ancien capitaine de la Belle-Assise était parti pour Marseille, afin de prendre connaissance de l'état du navire et de celui de sa cargaison. Il aura sans doute retenu M. Aubin à Marseille, pour l'aider dans cet examen. Soyez assez bon, mon cher Morel, pour vous informer au port de l'époque du retour à Paris de ces messieurs et de celle du départ de la Belle-Assise, si elle est connue. Je crois que Louis vous a déjà écrit à ce sujet. Il est en ce moment à Dieppe, où il est allé visiter une amie de sa mère, madame Lawsson, qui lui veut beaucoup de bien. Il reviendra ce soir. Je me suis remis à ma partition, et, si je n'étais pas constamment interrompu, de trois jours l'un, j'avancerais assez vite. En somme, dans six ou sept mois, l'ouvrage sera fini; et je me mettrai, pour mieux en étudier les défauts, à arranger la partition pour le piano. Il n'y a pas de travail plus utile, en pareil cas, que celui-là; et d'ailleurs, la partition de piano et chant a bien sa valeur intrinsèque, surtout pour les études.
Je suis tout triste du mauvais effet que vient de produire la représentation d'Euryanthe. Le poème, malgré les modifications qu'on a fort sagement fait d'y apporter, n'est pas supportable. Vous lirez ces jours-ci l'analyse que je viens de faire du drame allemand dans le Journal des Débats, je ne crois pas qu'on ait jamais mis en scène de semblables stupidités; on n'est pas bête à ce point. Nous nous accordons tous pour louer la musique, qui contient en effet de bien belles parties, mais ne saurait, selon moi, soutenir la comparaison avec Obéron ni avec le Freyschütz. Quand va-t-on s'occuper au théâtre de Marseille de votre opéra? tenez-moi au courant de tout ce qui s'y rapporte. Si j'avais un peu d'argent de côté, je ne manquerais pas d'aller assister à sa première représentation.
Mille amitiés à Lecourt. Théodore Ritter vient d'achever la partition de piano complète de Roméo et Juliette. C'est très clair et très jouable. Il a exécuté la semaine dernière l'ouvrage entier devant une quinzaine de personnes chez Pleyel; Duprez et moi, nous chantions les chœurs, etc. Il a très bien joué. Cela se grave à Leipzig.
P.-S.—Le capitaine Aubin, et non Bodin, vient de venir. Il retourne à Marseille. Il avertira Louis du jour où il devra être rendu à bord. Ainsi ne vous inquiétez pas de cela.
AU MÊME.
Paris, dimanche 11 octobre 1857.
Mon cher Morel,
Je vous remercie, nous vous remercions. Faites l'impossible pour obtenir une promesse positive du capitaine de la Reine des Clippers, ou plutôt de M. Acquarone. C'est précisément un semblable embarquement qui conviendrait le mieux à Louis, et je serais dans de graves embarras, s'il me fallait envoyer mon fils dans les ports de l'Océan chercher lui-même un navire. Tenez-moi au courant de l'état de vos négociations.
Je compte aussi sur l'aide de notre excellent Lecourt. J'ai peine à vous écrire ces quelques lignes. Je ne puis me remettre de ma maladie nerveuse, qui se transforme chaque jour et amène les plus étranges accidents.
Mille amitiés dévouées. J'aurais bien des choses à vous dire, mais je n'ai pas la force d'écrire.
AU MÊME.
Paris, mercredi 27 ou 28 octobre 1857.
Grâce à vos relations et à l'intervention de Lecourt, Louis est enfin reçu comme lieutenant à bord de la Reine des Clippers; c'est un important avantage pour lui. On ne réclame pas encore sa présence à Marseille; mon avis est néanmoins qu'il doit s'y rendre d'avance pour ne s'exposer à aucun mécompte, se faire présenter à M. Acquarone, à ses chefs du bord, et tâcher de se faire employer même avant le départ. Il va d'ailleurs profiter du répit qu'on lui laisse pour passer quelques jours à Vienne chez ma sœur et faire une visite à mon oncle à Tournon. Je pense qu'à son arrivée à Marseille, il vous trouvera de retour de votre excursion à Aix. Dans le cas où son séjour se prolongerait chez vous, il est convenu que vous me permettrez de payer sa pension et que vous ne vous fâcherez pas. J'ai vu ces jours-ci M. de Rémusat qui m'a le premier appris la bonne nouvelle de la réception de Louis. Je crois qu'il assistait hier à l'inauguration de la petite salle de concerts (la salle Beethoven), que Bennet vient d'ouvrir au public. Géraldy donne un concert dans ce local demain, et je vois sur le programme un morceau de vous. Je suis plongé jusque par-dessus les yeux dans l'instrumentation de mon avant-dernier acte, et cela me grise... Lecourt, dans une de ses lettres, semble craindre que je n'aie choisi un mauvais sujet. Aurait-il conservé ce vieux préjugé contre les sujets antiques?... Les sujets antiques sont redevenus neufs, à la condition pour les auteurs de ne pas les traiter à la façon lamentable de MM. de Marmontel, du Rollet et Guillard. Je crois que ce n'est pas le cas dans mon ouvrage. Je vous assure qu'il y a un mouvement, une variété de contrastes et une mise en scène extraordinaires. Et cela doit faire pardonner au sujet d'être beau par les sentiments et les passions, et la pensée poétique. J'ai mis au pillage Virgile et Shakspeare, et j'ai trouvé en outre une scène d'un effet terrible, qui n'est pas dans les allures des tragédies lyriques du siècle dernier. J'écris cette partition avec une passion qui semble s'accroître de jour en jour. Dites à Lecourt que très probablement il s'est fait de mon poème une fausse idée, puisqu'il ne le connaît pas, mais qu'il résultera de tout cela (paroles et musique) quelque énormité dont il sera content, je lui en donne ma parole d'honneur. J'aurai fini dans six mois, ballets et le reste.
Je vais ce soir dîner à Versailles chez Émile Deschamps avec les directeurs de l'Odéon. On veut me séduire. Il s'agit de la mise en scène de Roméo et Juliette, traduit par Deschamps et qu'on voudrait illustrer!!!.. (expression favorite des pianistes) par l'exécution, dans les entr'actes, de trois fragments de ma symphonie. Cela coûterait fort cher, mais ils paraissent résolus à ne pas reculer devant la dépense.
Adieu, cher ami; je vous recommande mon cher grand garçon, qui est bien excellent et bien désireux de faire sa carrière, et qui commence à devenir raisonnable, et que j'aime de toute mon âme. Aimez-le bien aussi.
AU MÊME.
Paris, 15 novembre 1857.
Mon cher Morel,
Je vous remercie de m'avoir envoyé des nouvelles de Louis. Dieu veuille que son voyage continue comme il a commencé. Quant à moi, je suis toujours malade; j'ai, dit mon médecin, une névrose intestinale. Cela me tourmente à un point que je ne saurais exprimer. Je travaille pourtant tout de même.
On vient de donner enfin l'opéra en deux actes de M. Billetta, célèbre professeur de piano à Londres. Je voudrais que vous entendissiez cela. Ne croyez pas un mot des quelques éloges que contient sur cette musique mon feuilleton de ce matin, et croyez, au contraire, que je me suis tenu à quatre pour en faire aussi tranquillement la critique. On a travaillé treize mois à l'Opéra pour accoucher de ce chef-d'œuvre. La troisième représentation n'a pas suivi la seconde; on l'annonce pourtant pour lundi. La Rose de Florence sera bientôt fanée et effeuillée. Fiorentino, qui a une grande peur de ses compatriotes, et qui a été forcé de louer celui-là, n'a jamais pu se décider à écrire lui-même son nom; il l'a laissé en blanc dans son manuscrit.
Je viens de me procurer un de mes portraits, vous le recevrez prochainement. Comment se porte Lecourt? que fait-on, sinon de bon, au moins de mauvais, en musique à Marseille?
AU MÊME.
Paris, 21 décembre 1857.
Je ne puis plus vous parler, vous me l'avez défendu, de toutes vos bontés pour Louis et de l'intérêt constant que vous prenez à tout ce qui le regarde. J'y suis de plus en plus sensible cependant. Mon oncle et ma sœur sont également bien touchés de vos soins et de votre affection pour lui. Grâce à vous et à cet excellent Lecourt, le voilà monté sur un magnifique navire et investi de fonctions qui doivent le forcer à devenir laborieux et raisonnable de plus en plus.
J'espère beaucoup du mode de traitement auquel votre médecin vient de vous soumettre[96]. En tout cas, s'il a raison ou non dans ses conjectures, vous ne tarderez pas à le savoir. Vous devez être tourmenté par la suspension du travail de votre partition. Je serais au supplice, en ce moment surtout, s'il m'arrivait d'être obligé d'abandonner la mienne. Et pourtant qu'y a-t-il de plus triste, de plus misérable que notre monde musical de Paris! quelle direction imprimée à tous nos théâtres lyriques!...
L'Opéra a toujours du monde; on ne peut pas empêcher le public d'y aller. Dès lors, une suffisance et une nonchalance dans l'administration qui dépassent tout ce que vous pouvez vous figurer. Pourvu qu'on puisse régulièrement, quatre ou cinq fois par mois, donner la Favorite, paroles de M. le directeur, et Lucie, paroles de M. le directeur, tout va bien. En ce moment, tout va mieux encore; on monte la Magicienne (paroles de M. le directeur attribuées à M. de Saint-Georges). Roqueplan fait parler de lui par ses excentricités de langage à l'Opéra-Comique. Il dit à Stockhausen qu'il ne sait pas chanter, il envoie tout le monde se faire f..... Il dit à ce brave M***, qui s'était cru obligé, de lui faire une visite: «Qu'est-ce que vous f..... ici? f.....-moi le camp! l'Opéra-Comique n'est pas un lieu public.» Nous avons un haut fonctionnaire qui ne va pas mal non plus de son côté; il répond à un homme de lettres qui était allé le remercier de la part de nos associations pour une faveur que ce grand homme leur avait accordée: «Je me f... de la reconnaissance des artistes! je n'ai pas fait cela pour eux. Les arts m'embêtent.» Vous voyez que les idées poétiques ont à se manifester dans un joli petit monde... L'empereur et l'impératrice sont allés voir le Cheval de bronze, il y a trois jours. Ils sont sortis très mécontents, dit-on. Je voudrais que vous entendissiez la musique qu'on fait à la cour de temps en temps... D'un autre côté, voilà ce pauvre roi de Prusse qui perd la tête; je ne sais si son frère aura autant que lui le sentiment des arts. Les petites cours allemandes, où l'on aime la musique, ne sont pas riches, et la Russie (comme l'Angleterre) est tout acquise aux Italiens.
Reste la reine Pomaré; mais Taïti est bien loin. Encore assure-t-on que la gracieuse Aimata-Pomaré préfère à tout les jeux de cartes, les cigares et l'eau-de-vie. Le Brésil est à Verdi. Si nous allions en Chine!...
A M. HANS DE BULOW.
Paris, 20 janvier 1858.
Je vous remercie de votre charmante lettre, charmante par son style, par la cordialité qui l'a dictée, par les bonnes nouvelles qu'elle m'apporte, charmante de tout point. Je l'ai lue avec bonheur, comme un chat boit du lait.
Aussi ne tarderai-je pas à vous répondre. Je m'étais levé avec l'intention de travailler exclusivement à ma partition aujourd'hui; mon feu était allumé, ma porte fermée; pas d'importuns, pas de crétins possibles, et voilà votre lettre qui vient renverser tous mes beaux projets de travail, et je cède au plaisir de causer avec vous et je dis comme le Romain (sic): «A demain les affaires sérieuses[97]!» Non pas que je croie vous intéresser en vous répondant, mais je vous réponds avec un plaisir extrême; c'est de l'égoïsme pur, concentré, sans alliage, un égoïsme élément (pour parler comme les chimistes).
Votre foi, votre ardeur, vos haines même, me ravissent. J'ai, comme vous, encore des haines terribles et des ardeurs volcaniques; mais, quant à la foi, je crois fermement qu'il n'y a rien de vrai, rien de faux, rien de beau, rien de laid... N'en croyez pas un mot, je me calomnie... Non, non, j'adore plus que jamais ce que je trouve beau, et la mort n'a pas, à mon sens, de plus cruel inconvénient que celui-ci: ne plus aimer, ne plus admirer. Il est vrai qu'on ne s'aperçoit pas qu'on n'aime plus. Pas de philosophie, autrement dit, pas de bêtises.
Vous avez donc osé entreprendre une série de concerts, et à Berlin encore! une ville, non pas glaciale (un bloc de glace est beau, cela rayonne, cela a du caractère), mais une ville qui dégèle, froide, humide. Et puis des luthériens!... des gens qui ne rient jamais, des blonds sans être doux... Voyez comme je divague, j'ai été blond et je ne suis pas doux... Riez, je vous le permets, tout m'est égal.
Votre programme était fort beau: vous m'avez fait l'injure de supposer
que rien autre que le sort de mes deux morceaux ne pouvait m'intéresser
dans le récit que vous m'avez fait des suites de ce concert. Vous ne
m'avez parlé ni de votre Ouverture ni des morceaux de Liszt; vous m'avez
calomnié. Mais je vous pardonne. Encore une fois, tout m'est égal,
excepté que l'on m'attribue la musique des chefs de l'école parisienne.
Ce n'est pas la première fois (comme vous le pensez) que les Berlinois
ont subi mon ouverture de Cellini; je la leur fis avaler deux fois, il
y a quinze ou seize ans, à mes concerts du théâtre. Je me rappelle même
que notre ami Schlesinger, après la seconde audition, vint tout étonné
me demander si cela était beau... Comme je ne voulais pas le tromper,
je lui répondis que oui. Mais il ne me crut pas. Les critiques
luthériens n'ont pas trop éreinté, dites-vous, le Pâtre breton. Ce
sont des gens honnêtes, après tout, et en entendant l'accord de mi
![]() :
:

ils sont franchement convenus que cet accord, bien qu'écrit par moi,
n'était pas devenu faux. Notre maniaque de la Revue des Deux Mondes
n'est pas de cette probité-là[98], et quand on lui fait entendre un
accord de mi ![]() sorti de ma plume, il déclare l'accord intolérable.
sorti de ma plume, il déclare l'accord intolérable.
Baisez la main, de ma part, je vous prie, à mademoiselle Milde quand
vous la verrez, et remerciez-la de son courage à chanter l'accord de
mi ![]() quand même.
quand même.
Les parties d'orchestre et de chœur de l'Impériale sont à vos ordres, et je vous les enverrai quand vous le désirerez; seulement je n'ai pas la traduction allemande du texte de cette cantate, et je ne suppose pas qu'on puisse faire chanter du français par des choristes allemands. Comment tournerez-vous cette difficulté? Répondez-moi à ce sujet; après quoi, je ferai ce que vous voudrez et je vous donnerai quelques indications pour l'exécution du morceau.
Je fais des vœux pour la prospérité de votre pieuse entreprise; mais, entre nous, je tremble qu'elle ne vous coûte de l'argent; à moins que votre orchestre ne soit d'un bon marché extrême. Ici, une pareille crainte serait déraisonnable: il n'y a rien à craindre, on est sûr de ne pas faire les frais.
Il faut que je vous dise que Brandus vient de faire une espèce de nouvelle édition de Roméo et Juliette, grande partition et parties séparées, contenant une foule de corrections et quelques petits changements de détail assez importants. C'est d'après ces corrections qu'a été rédigée la partition de piano et chant, avec double texte allemand et français, qu'on va publier prochainement à Leipzig. Si jamais vous aviez envie d'exécuter quelque fragment de Roméo et Juliette à vos concerts, ne le faites pas sans me prévenir; je vous indiquerai les morceaux où il y a des changements.
Vous me demandez ce que je fais. J'achève les Troyens. Depuis quinze jours, il m'a été impossible d'y travailler. J'en suis à la catastrophe finale; Énée est parti, Didon l'ignore encore, elle va l'apprendre, elle pressent le départ...
Quis fallere possit amantem?
Ces angoisses de cœur à exprimer, ces cris de douleur à noter, m'épouvantent... comment vais-je m'en tirer? Je suis surtout inquiet sur l'accentuation de ce passage dit par Anna et Narbal au milieu de la cérémonie religieuse de prêtres de Pluton:
S'il faut enfin qu'Énée aborde en Italie,
Qu'il y trouve un obscur trépas!
Que le peuple latin à l'Ombrien s'allie,
Pour arrêter ses pas!
Percé d'un trait vulgaire en la mêlée ardente,
Qu'il reste abandonné sur l'arène sanglante
Pour servir de pâture aux dévorants oiseaux!>
Entendez-vous, Hécate, Érèbe, et toi, Chaos?
Est-ce une imprécation violente? est-ce de la fureur concentrée, sourde?... Si cette pauvre Rachel n'était pas morte, je serais allé le lui demander. Vous pensez, sans doute, que j'ai bien de la bonté de me préoccuper ainsi de la vérité d'expression, et que ce sera toujours assez vrai pour le public. Oui, mais pour nous?... Enfin, je trouverai peut-être.
Vous ne sauriez, mon cher Bulow, vous faire une idée juste du flux et du reflux de sentiments contraires dont j'ai le cœur agité depuis que je travaille à cet ouvrage. Tantôt c'est une passion, une joie, une tendresse dignes d'un artiste de vingt ans. Puis c'est un dégoût, une froideur, une répulsion pour mon travail, qui m'épouvantent. Je ne doute jamais: je crois et je ne crois plus, puis je recrois... et, en dernière analyse, je continue à rouler mon rocher... Encore un grand effort, et nous arriverons au sommet de la montagne, l'un portant l'autre.
Ce qu'il y aurait de fatal en ce moment pour le Sysiphe, ce serait un accès de découragement venu du dehors; mais personne ne peut me décourager, personne n'entend rien de ma partition, aucun refroidissement ne me viendra par suite des impressions d'autrui. Vous même, vous seriez ici, que je ne vous montrerais rien. J'ai trop peur d'avoir peur.
J'ai ajouté une fin au drame, fin bien plus grandiose et plus concluante que celle dont je m'étais contenté jusqu'à présent. Le spectateur verra ainsi la tâche d'Énée accomplie, et Clio s'écrie à la dernière scène, pendant que le Capitole romain rayonne à l'horizon:
Fuit Troja!... Stat Roma!
Il y a là, en outre, une grande pompe musicale, dont il serait trop long de vous expliquer le sujet.
Voyez avec quelle naïveté je me laisse aller à vous parler de tout cela. Voilà ce que c'est que de m'écrire des lettres comme celle que je viens de recevoir de vous. Il ne faut pas porter une vive lumière aux yeux d'un homme enrhumé, si l'on ne veut pas le faire éternuer pendant une demi-heure.
Mais voilà mes éternuements finis. Adieu; écrivez-moi souvent, je m'engage à vous répondre en style de notaire et fort laconiquement. Je ne suis pas féroce...
P.-S.—Gounod vient de faire un joli petit opéra-bouffe, le Médecin malgré lui. Voyez mon feuilleton qui paraîtra vendredi ou samedi prochain.
A LOUIS BERLIOZ.
Paris, 24 janvier [1858].
Cher ami,
La poste des Indes part le 10 et le 26 de chaque mois; je t'écris donc un peu plus tôt ma seconde lettre pour qu'elle puisse te parvenir en même temps que ma première. Il s'est passé de terribles choses depuis le 10 de ce mois. Tu le sais peut-être déjà, une troupe d'effroyables bandits est venue entourer la voiture de l'empereur au moment où il se rendait avec l'impératrice à la représentation au bénéfice de Massol à l'Opéra. Ces monstres ont jeté des bombes fulminantes dont l'explosion a tué un grand nombre de personnes et de chevaux, criblé la voiture de l'empereur, etc., etc. Par le plus grand des bonheurs, l'empereur n'a pas été atteint; la charmante impératrice n'a pas même perdu un instant son sang-froid. Ils ont été admirables de courage et de présence d'esprit tous les deux, au milieu de cette scène de carnage à la porte de l'Opéra. Toute l'Europe, tu le penses, est en émoi d'un pareil événement.
J'ai vu madame Lawsson en lui portant une loge pour l'Opéra-Comique. Morel m'a écrit que M. Lecourt était à Paris; mais ce dernier n'est pas venu me voir, et j'en suis à me demander pourquoi. Cet excellent Morel n'a voulu accepter que la moitié de ce que je lui avais envoyé pour tes frais de séjour chez lui et m'a renvoyé le reste.
J'ai été encore bien malade et au lit ce mois-ci; me voilà de nouveau sur pied et je reprends le travail interrompu de ma partition. Avant-hier, j'ai fait une lecture de mon poème des Troyens chez notre confrère de l'Institut M. Hittorf. Il y avait une grande réunion de peintres, statuaires, architectes de l'Institut; M. Blanche, secrétaire du ministre d'État; M. de Mercey, directeur des beaux-arts, etc., etc. J'ai eu un véritable succès; on a trouvé cela grand et beau, on m'a interrompu plusieurs fois par des applaudissements. Enfin, cela m'a rendu un peu de courage pour achever mon immense partition.
Voilà à peu près toutes mes nouvelles, cher Louis; ma sœur m'écrit de temps en temps de charmantes lettres; mon oncle est à Cannes dans le Midi, où il se chauffe au soleil pendant que nous grelottons à Paris. J'ai reçu, il y a quelques jours, une longue lettre de M. de Bulow, l'un des gendres de Liszt, celui qui a épousé mademoiselle Cosima. Il m'apprend qu'il a donné sous sa direction un concert à Berlin et qu'il y a fait exécuter avec grand succès mon ouverture de Cellini et le petit morceau de chant: le Jeune Pâtre breton. Ce jeune homme est l'un des plus fervents disciples de cette école insensée qu'on appelle en Allemagne l'école de l'avenir. Ils n'en démordent pas et veulent absolument que je sois leur chef et leur porte-drapeau. Je ne dis rien, je n'écris rien, je ne puis que les laisser faire; les gens de bon sens sauront voir ce qu'il y a de vrai.
AU MÊME.
Paris, 9 février 1858.
Cher Louis,
Le courrier des Indes part demain et j'ai tout juste aujourd'hui quelques instants pour causer un peu avec toi. Je suis bien impatient de recevoir de tes nouvelles! Comment auras-tu fait cette longue traversée? comment te portes-tu? comment te trouves-tu à bord? n'oublie aucun de ces détails. Ici, on ne va pas bien. Je suis, moi, assez passablement remis en ce moment; mais ma femme est presque toujours au lit et fort souffrante, et se tourmentant beaucoup.
J'ai aussi une triste nouvelle à t'annoncer; le pauvre M. Lawsson est mort ces jours-ci. Il s'est éteint sans agonie, sans souffrance, comme une lampe qui n'a plus d'huile. Mon oncle est toujours à Cannes en Provence.
Je travaille tant que je peux pour finir ma partition et j'avance peu à peu. J'en suis à cette heure au dernier monologue de Didon: «Je vais mourir dans ma douleur immense submergée.»
Je suis plus content de ce que je viens d'écrire que de tout ce que j'ai fait auparavant. Je crois que ces terribles scènes du cinquième acte seront en musique d'une vérité déchirante.
Mais j'ai encore modifié cet acte. J'y ai fait une large coupure et j'y ai ajouté un morceau de caractère, destiné à contraster avec le style épique et passionné du reste. C'est une chanson de matelot; je pensais à toi, cher Louis, en l'écrivant et je t'en envoie les paroles. Il fait nuit, on voit les vaisseaux troyens dans le port: Hylas, jeune matelot phrygien, chante, en se balançant au haut du mât d'un navire.
Vallon sonore
Où, dès l'aurore,
Je m'en allais chantant, hélas!
Sous tes grands bois chantera-t-il encore
Le pauvre Hylas?
Berce mollement sur ton sein sublime,
O puissante mer, l'enfant de Dindyme!
Fraîche ramée
Retraite aimée,
Contre les feux du jour, hélas!
Quand rendras-tu ton ombre parfumée
Au pauvre Hylas?
Berce mollement sur ton sein sublime,
O puissante mer, l'enfant de Dindyme!
Humble chaumière,
Où de ma mère,
Je reçus les adieux, hélas!
Reverra-t-il ton heureuse misère
Le pauvre Hylas?
Berce mollement sur ton sein sublime,
O puissante mer, l'enfant... (Il s'endort).
Voilà à peu près toutes mes nouvelles, cher ami. Je suis allé au bal des Tuileries mercredi dernier; mais il y avait une telle foule, qu'il n'y avait pas moyen même d'apercevoir l'empereur ni l'impératrice, et je suis revenu à onze heures, trop heureux de n'avoir pas été étouffé et d'avoir retrouvé mon paletot. Je ne puis te donner des nouvelles d'Alexis[99], je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Adieu, cher enfant; j'ai un long et filandreux article à faire, il faut que je me résigne à y travailler.
Jules B*** est revenu avant-hier d'une tournée dans les provinces. Il est maintenant fixé à Paris avec une pauvre petite position, qui le fait terriblement travailler et lui donne à peine de quoi vivre. Un garçon d'une pareille intelligence et de tant d'esprit!... voilà la vie.
Adieu. Je t'embrasse de tout mon cœur, cher Indien, reviens-moi vite bien portant, bien savant, bien en argent, et tout ira merveilleusement.
AU MÊME.
Paris, 5 mai 1858.
Cher Louis,
Enfin, voilà une lettre de toi! je commençais à être inquiet. Voilà de bien bonnes nouvelles; tu es bien portant, content de toi et de ton entourage... Mais tu me fais craindre une plus longue absence... Si vous allez en Chine, ma lettre te parviendra-t-elle? je t'écris à tout hasard. J'ai été et je suis encore malade; j'ai eu la grippe et d'autres maux encore. Dimanche dernier, j'avais à diriger au Conservatoire le concert de Litolff, un de mes amis d'Allemagne. Nous avions un orchestre modèle, le premier peut-être qu'on puisse entendre en Europe. Litolff m'avait demandé deux morceaux de ma composition: la Captive et la Fête de Roméo et Juliette. J'ai eu un succès prodigieux, fracassant; que n'étais-tu là! C'était un véritable tremblement de salle.
Le lendemain, lundi, je suis allé à la réception des Tuileries. L'empereur m'a vu, m'a abordé et m'a demandé des nouvelles de mon opéra; je n'ai pas manqué de le prier de prendre connaissance du poème, et il m'a répondu que cela l'intéresserait beaucoup, que je devrais lui demander une audience pour cela. Elle sera pour la semaine prochaine. J'ai bien des choses à dire à l'empereur; Dieu veuille que je n'oublie pas les plus essentielles!
Les chances paraissent peu favorables pour faire monter mes Troyens à l'Opéra. Il est question d'y donner l'an prochain un grand ouvrage d'un amateur, le prince Poniatowski!!!!!
Nous avons eu ici dernièrement des craintes très vives sur une guerre entre la France et l'Angleterre. Heureusement ces craintes sont tout à fait dissipées.
J'avais envoyé un billet à Alexis pour le concert de dimanche dernier; je sais qu'il y était, mais je n'ai pas pu le voir.
Adieu, cher enfant, cher Louis, cher lieutenant! continue à marcher sérieusement à ton but et tu l'atteindras. Je t'embrasse avec une affection qui semble s'accroître de jour en jour. Je te réembrasse.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, 13 février 1859.
Mon cher Morel,
Ou en êtes-vous de vos répétitions? donnez-moi donc de vos nouvelles. J'ai vu deux fois dernièrement M. de Rémusat, qui ne m'a rien appris de précis au sujet de votre opéra. Ici, rien de nouveau; à l'heure qu'il est, on refait encore certaines scènes de l'Herculanum de David. On nous annonce pour la fin du mois le Faust de Gounod, dont je crois qu'il faut bien augurer. On en dit beaucoup de bien.
Louis va arriver dans un mois, j'espère; soyez assez bon pour lui remettre la lettre ci-jointe. Je compte le retrouver tout à fait sérieux, et décidé à travailler vaillamment pour son examen. J'ai été bien malade il y a six semaines; je commence à me remettre, grâce aux soins du fameux docteur Noir, le sauveur de notre ami Sax. Vous savez que Sax avait un cancer mélanique à la lèvre supérieure; il était condamné par toute la faculté de Paris. Et le voilà radicalement guéri; son affreux bubon de la lèvre est tombé, il n'y paraît plus. Jeudi prochain, les amis de Sax, en très grand nombre, donneront au docteur Vriès (c'est son nom) un dîner à l'hôtel du Louvre, qui promet d'être fort gai et même musical.
Les Troyens sont toujours là, attendant que le théâtre de l'Opéra devienne praticable. Après David, nous aurons le prince Poniatowski; après le prince, nous aurons le duc de Gotha, et, en attendant le duc, on traduira la Sémiramide de Rossini.
AU MÊME.
Paris, 18 mars 1859.
Je n'ose vous engager à faire le voyage de Paris pour faire soigner vos yeux; les cures du docteur Vriès dans cette spécialité ne me sont pas connues; il est en outre en ce moment et il sera de plus en plus inabordable; il faut faire queue chez lui pendant quatre ou cinq heures sans être sûr de pouvoir lui parler, et il vous demandera plusieurs mois pour suivre son traitement. Quant à moi, je suis depuis plus de dix jours repris de mes infernales coliques qui ne me quittent pas une heure sur vingt-quatre. Rien n'y fait.
Je me force pourtant à vaincre ma faiblesse, pour organiser un concert spirituel à l'Opéra-Comique le samedi saint. Il faut gagner de l'argent, et, ce jour-là, je suis à peu près sûr de remplir la salle. Ce pauvre Louis, qui n'a jamais rien entendu de moi, sera cette fois au moins à Paris. Je commence à m'étonner du retard de l'arrivée de son navire. Mille amitiés à Lecourt. J'ai un nouveau patron pour mon opéra, un prôneur très chaud; c'est M. Véron, qui a voulu entendre dernièrement une lecture du poème et qui en dit partout de magnifiques choses. Il déclare le cinquième acte un chef-d'œuvre, en ajoutant que, s'il était directeur, il dépenserait cent cinquante mille francs pour monter cela.
Il est vrai que les paroles ne l'engagent à rien; mais elles font sensation parmi les gens de l'Opéra. Peu à peu, seront-ils forcés de venir vers la montagne?... en tout cas la montagne s'obstine à ne pas aller à eux. Je n'ai jamais parlé de mon ouvrage à Royer et je ne lui en parlerai jamais.
Pauvre ami, je vous plains d'être ainsi harcelé par vos chanteurs. Adieu.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
Embrassez Louis pour moi trente ou quarante fois.
AU MÊME.
Mardi matin, 19 juillet 1859.
Merci, mon cher Morel, de votre bonne nouvelle[100]. J'étais horriblement inquiet et n'osais vous communiquer mes inquiétudes, persuadé d'ailleurs que vous m'écririez aussitôt que la moindre nouvelle vous serait parvenue. Veuillez donner à Louis la lettre ci-jointe. Je pense qu'il y aura moyen pour lui de se faire payer de la maison Acquarone avant de quitter Marseille. Lecourt, dans une de ses lettres, m'assurait que les appointements de l'équipage d'un navire étaient payés avant tout. J'ai été bien malade encore ces jours derniers; mais je crois que l'anxiété y était pour beaucoup. Je ne vous dirai pas combien j'aime Louis; car vous le savez et vous l'aimez vous-même, et cette affection que vous lui portez a redoublé la mienne pour vous. Enfin, le voilà! j'attends un mot de lui; mais j'attends tranquillement à cette heure. La saison de Bade n'est pas raccommodée par la paix. Bénazet ne sait pas encore si le festival pourra avoir lieu.
Adieu, adieu; je vous serre la main, je suis bien joyeux.
A LOUIS BERLIOZ.
Vendredi soir, 23 septembre 1859.
Il est onze heures et quart du soir, on m'apporte ta lettre et j'y réponds tout de suite. Oui, cher ami, j'aurais dû t'écrire tout ces jours-ci, mais pardonne-moi, j'ai tant souffert... Je suis allé passer deux jours à Courtavenel, chez madame Viardot, où je me suis trouvé horriblement malade; on ne voulait pas me laisser repartir. Mais l'ennui de voir toute cette charmante famille s'occuper de moi, de chagriner de tels amis a été plus fort. En arrivant à Paris, je n'ai fait que monter à la maison: je suis reparti immédiatement pour Saint-Germain, où Marie[101] m'attendait chez M. de la Roche. Le lendemain, je suis revenu seul, toujours torturé et préoccupé de quatre ou cinq corrections que j'avais en tête de faire dans le deuxième acte de ma partition des Troyens. J'ai travaillé à cela tout le reste du jour, jusqu'à onze heures. Le lendemain, Rocquemont est venu m'apporter le travail que je lui avais donné à faire pour la partition d'Orphée; comme on attend le premier acte de cet ouvrage au Théâtre-Lyrique, j'ai dû me mettre à l'ouvrage encore sans désemparer, pour en corriger les fautes de copie. Puis sont revenues mes crises de larmes, mes convulsions de cœur... Et je ne pouvais t'écrire que des non-sens ou des choses qui t'eussent horriblement attristé. Ce soir, je suis un peu mieux. J'ai fini de mettre en ordre le premier acte d'Orphée; Carvalho viendra le chercher demain matin. Il (Carvalho) est enthousiasmé de mon poème des Troyens, que je lui ai prêté. Il voudrait les monter à son théâtre; mais comment faire? il n'y a point de ténor pour Énée... Madame Viardot me propose de jouer à elle seule les deux rôles successivement; la Cassandre des deux premiers actes deviendrait ainsi la Didon des trois derniers. Le public, je le crois, supporterait cette excentricité, qui n'est pas d'ailleurs sans précédent. Et mes deux rôles seraient joués d'une façon héroïque par cette grande artiste.
Ce serait pour l'année prochaine et dans un nouveau théâtre qu'on va construire sur la place du Châtelet, sur le bord de la Seine. Attendons. Cependant on parle beaucoup de divers côtés aux gens de l'Opéra. Mon article leur a démoli leur Roméo et Juliette[102], cela ne fait pas d'argent, on en a déjà interrompu les représentations.
Il faut voir venir et prendre patience. Madame Viardot, qui est aussi une grande pianiste, a étudié mes deux premiers actes pendant que j'étais chez elle. «Quel bonheur, me disait-elle, que cela soit si beau! Oh! si je pouvais tout de suite jouer Cassandre au lieu d'Orphée!» Patience pour toi, mon très-cher Louis; prends aussi patience pour moi. J'ai des amis, j'ai des cœurs dévoués... Mais je te vois dans des dispositions d'exaltation fâcheuse, tu as besoin de calme et de tranquillité d'esprit pour travailler avec fruit. Je t'en prie, songe à ta carrière avant tout et ne t'inquiète pas de moi. Nous avons parlé de toi longtemps, l'autre jour, à Courtavenel, où l'on sait combien nous nous aimons.
Je n'ai pas vu les petits articles dont tu me parles; mais cela m'importe peu. Je n'ai pas eu signe de vie d'Alexis. Au nom de Dieu, ne t'inquiète pas quand mes lettres sont en retard; tu sais à peine dans quel tourbillon de douleurs et d'anxiétés je passe ma vie.
Adieu, cher ami; je t'embrasse de tout mon cœur. Je t'aime comme tu m'aimes; que veux-tu de plus?
A M. AUGUSTE MOREL.
17 juin 1860.
Mon cher Morel,
Je viens de recevoir votre charmante lettre et le billet qu'elle contenait. Merci de toutes les choses amicales que vous me dites. Je suis bien heureux d'apprendre que votre intérieur se soit animé par la présence de votre neveu, et je serais charmé que l'occasion se présentât pour Louis de faire la connaissance de cet aimable garçon. Louis est en ce moment au Havre sur le point de subir son second examen; le premier a été passé avec succès. S'il en est de même du second, Louis sera capitaine au long cours en quête d'un navire. Je ne sais vers quel port il compte diriger alors ses recherches.
J'ai dîné dernièrement avec d'Ortigue chez cet excellent Rémusat, et nous y avons bu à votre santé et à celle de Lecourt. On y a exécuté après dîner un trio et un autre morceau de Rémusat, qui sont parbleu très bien. Je ne savais pas même que Rémusat jouât du violon. Ah ça! l'air de Marseille est donc essentiellement musical?
A LOUIS BERLIOZ.
Paris, 21 novembre 1860.
Cher ami,
Je t'envoie ci-inclus un billet de cent francs dont tu m'acseras réception. Je suis bien heureux de savoir que tu vas mieux; tes maux d'estomac m'inquiétaient. Il me semble aussi que ma maladie s'use, et, depuis que je ne fais plus de remèdes, je me sens beaucoup plus fort. J'ai tant travaillé, tous ces jours-ci, que cette distraction même a contribué à me remettre sur pied. Je ne puis suffire à écrire les morceaux de musique de mon petit opéra, tant ils se présentent avec empressement; chacun veut passer le premier. Quelquefois j'en commence un avant que l'autre soit fini. A l'heure qu'il est, j'en ai écrit quatre, et il m'en reste cinq à faire. Tu me demandes comment j'ai pu réduire les cinq actes de Shakspeare en un seul acte d'Opéra-Comique. Je n'ai pris qu'une donnée de la pièce; tout le reste est de mon invention. Il s'agit tout bonnement de persuader à Béatrice et à Bénédict (qui s'entre-détestent), qu'ils sont chacun amoureux l'un de l'autre et de leur inspirer par là l'un pour l'autre un véritable amour. C'est d'un excellent comique, tu verras. Il y a en outre des farces de mon invention et des charges musicales qu'il serait trop long de t'expliquer.
Si tu veux rire, lis samedi prochain (c'est-à-dire dimanche) mon grand article que je viens d'envoyer au Journal des Débats. Il y a là des calembredaines à défrayer trois feuilletons.
Adieu, cher ami; quand tu voudras que je parle à M. Béhic, tu me le diras et en outre tu m'indiqueras ce qu'il faut lui demander.
AU MÊME.
Paris, 2 janvier 1861.
Cher ami,
Tu m'as laissé bien longtemps sans me donner de tes nouvelles... qu'importe que ce fût à mon tour de t'écrire! Dois-tu regarder à cela? J'ai été tourmenté de cent manières. J'ai eu une sorte d'érésipèle à la joue gauche qui m'a fait beaucoup souffrir et dont il me reste une inflammation de la paupière. J'ai eu des montagnes d'épreuves à corriger pour les Troyens, et je n'ai pas pu trouver un instant pour continuer ma partition de Béatrice. Quand ta lettre est arrivée, j'allais écrire à Morel pour savoir depuis quand et pour quel pays tu étais parti. Hier, je suis allé aux Tuileries pour me montrer à l'empereur, qui se soucie aussi peu de moi que de mes ouvrages. Je ne sais pas comment sera pour la musique le nouveau ministre d'État[103]; nous allons voir. Il se passe en ce moment des choses si étranges dans notre monde de l'art! On ne peut pas sortir à l'Opéra des études du Tannhäuser de Wagner; on vient de donner à l'Opéra-Comique un ouvrage en trois actes d'Offenbach (encore un Allemand) que protège M. de Morny. Lis mon feuilleton qui paraîtra demain sur cette horreur.
Tu as ri de l'histoire des cantatrices chinoises, dans le dernier; mais tu ne sais pas que je pensais en t'écrivant à une de tes connaissances, mademoiselle X***, qui, dans un concert, a égorgé des cavatines de la façon la plus révoltante. Jamais cuisinière ne chanta ainsi! J'étais furieux. Et, comme elle tournait autour de moi, après son exécution, pour me soutirer un compliment, j'étais bien décidé, si elle m'eût fait une question, à lui répondre: «Mademoiselle, c'est horrible! et vous devriez vous cacher!» Elle va être furieuse de n'être pas nommée dans mon compte rendu. Tu ne me dis pas quel est ton titre maintenant, quels sont en somme tes appointements. Je ne sais à cet égard rien de positif. Et quand reprends-tu la mer?
Le Théâtre-Lyrique va toujours fort mal. Il commence à ne plus payer ses artistes.
Bénazet est ici; il m'a engagé pour Bade. Je lui ai promis mon opéra en un acte pour son nouveau théâtre qu'on bâtit à Bade.
Voilà toutes mes nouvelles. Adieu, cher ami; je t'embrasse, nous t'embrassons de tout notre cœur.
AU MÊME.
Paris, 14 février 1861.
Cher ami,
Je te remercie de ta lettre que j'espérais chaque jour. Je te vois pourtant encore dans un état d'esprit qui me tourmente; je ne sais pas quels rêves tu as caressés qui te rendent pénible ta position actuelle; tout ce que je puis te dire, c'est qu'à ton âge j'étais fort loin d'être aussi bien traité du sort que tu l'es.
Bien plus; je n'avais pas espéré quand tu as été reçu capitaine que tu aurais un emploi même modeste si promptement. Ton impatience de parvenir est toute naturelle, mais exagérée. Il faut te le dire et te le redire. Un an quelquefois amène plus de changements imprévus dans la vie d'un homme que dix ans d'efforts fiévreux.
Que puis-je te dire pour te faire prendre patience? tu te tourmentes pour des niaiseries, et tu as une matrimoniomanie qui me ferait rire, si ce n'était pas triste de te voir aspirer avec tant d'âpreté à la chaîne la plus lourde qui se puisse porter, et aux embarras et aux dégoûts du ménage, qui sont bien ce que je connais de plus désespérant et aussi de plus exaspérant. Tu as, à vingt-six ans, 1,800 francs d'appointements et la perspective d'un avancement peut-être rapide. Moi, quand j'ai épousé ta mère, j'avais trente ans, je ne possédais que 300 francs, que mon ami Gounet m'avait prêtés, et le reste de ma pension du prix de Rome qui ne devait durer que dix-huit mois. Après cela, rien, qu'une dette de ta mère, à peu près 14,000 francs (que j'ai payés peu à peu); et je devais envoyer de temps en temps de l'argent à sa mère, qui habitait l'Angleterre; et j'étais brouillé avec ma famille, qui ne voulait plus entendre parler de moi; et j'avais, au milieu de tous ces embarras, à faire ma première trouée dans le monde musical. Compare un peu ce que j'ai dû souffrir alors avec ce qui te mécontente si fort aujourd'hui.
Encore à présent, crois-tu que ce soit gai, d'être forcé, contraint, de rester à cette infernale chaîne du feuilleton qui se rattache à tous les intérêts de mon existence? Je suis si malade que la plume à tout instant me tombe de la main, et il faut pourtant m'obstiner à écrire pour gagner mes misérables cent francs, et garder ma position armée contre tant de drôles qui m'anéantiraient s'ils n'avaient tant de peur. Et j'ai la tête pleine de projets, de travaux, que je ne puis exécuter à cause de cet esclavage! Tu te portes bien, et moi, je me tords du matin au soir dans des souffrances sans répit et auxquelles il n'y a pas de remède.
Depuis un mois je n'ai pu trouver un seul jour pour travailler à ma partition de Béatrice. Heureusement, j'ai du temps pour l'achever. Je suis allé lire la pièce à M. Bénazet, qui s'en est montré enchanté. Cet opéra sera donc joué à Bade sur le nouveau théâtre; et le sort des Troyens est toujours incertain. J'ai eu une longue conférence, il y a huit jours, avec le ministre d'État à ce sujet; je lui ai raconté toutes les vilenies dont j'avais été victime. Il m'a demandé à connaître mon poème; je le lui ai porté le lendemain, et depuis lors je n'ai pas de nouvelles. L'opinion publique s'indigne de plus en plus de me voir laissé en dehors de l'Opéra quand la protection de l'ambassadrice d'Autriche y a fait entrer si aisément Wagner.
En attendant, la gravure de ma partition se poursuit tout doucement; elle ne sera probablement pas terminée avant trois mois. Je ne sais si je t'ai dit que je venais de faire un double chœur pour deux peuples, chacun chantant dans sa langue. C'est pour les orphéonistes français qui vont au mois de juin faire une seconde visite aux orphéonistes de Londres; les Anglais chanteront en anglais et les Français en français. On étudie déjà ici le chœur français et tous ces jeunes gens sont dans un entrain d'enthousiasme que je ne demande qu'à voir se continuer jusqu'au bout. Ce sera curieux, un duo chanté au Palais de cristal par huit ou dix mille hommes, mais je n'irai pas l'entendre. Je n'ai pas d'argent à dépenser en parties de plaisir.
La Société des concerts du Conservatoire va me demander un fragment de la Damnation de Faust pour une de ses prochaines séances, on m'en a prévenu. Comme cela ne lui coûtera rien, cela se fera.
Voilà où j'en suis. Marie te remercie de ton bon souvenir; elle est aussi toujours malade.
Je ne reçois pas plus que toi de nouvelles de là-bas. Chacun pour soi et Dieu pour personne! voilà le vrai proverbe. Tu as au moins, toi, un père, ami, camarade, frère dévoué qui t'aime plus que tu ne parais le croire, mais qui voudrait bien voir ton caractère se raffermir et devenir plus clairvoyant.
AU MÊME.
Paris, 21 février [1861].
Cher ami,
Tu me dis qu'il est inutile de t'écrire à Marseille avant la fin de mars; puis tu me pries à la fin de ta lettre de t'écrire encore... Si tu ne bats pas un peu la campagne, tu as du moins l'air de la maltraiter.
Eh bien, voilà, je t'écris; je viens de me lever, il est trois heures de l'après-midi. Je ne puis travailler, que puis-je faire de mieux que de causer avec toi? Je ne sais ce que tu veux dire avec ton cauchemar de l'abordage; nous ne sommes pas en temps de guerre. Je n'ai pas entendu parler de l'aventure du père Archange.
Scribe est mort hier dans sa voiture. On a arrêté Mirès pour quelques menus millions. M. Richemont, un receveur compromis là dedans, s'est pendu hier. Murger est mort, Eugène Guinot est mort, Chélard est mort à Weimar. Cela va bien.
Les professeurs de chiffres (musique en chiffres) m'ont provoqué dernièrement; tu as vu dans mon article du 19, à quoi leur instance a abouti et quel coup de poing ils m'ont obligé de leur donner sur la tête. Fais lire cela à Morel, qui fut insulté par eux il y a quelques années.
Que tu es donc provincial et enfant de t'étonner que les journaux ne parlent pas de moi! Hé! que veux-tu qu'ils en disent? Crois-tu que le monde se préoccupe de ce que je fais?
Le duo pour les deux peuples est fait; on l'étudie à Paris et à Londres. Wagner fait tourner en chèvres les chanteuses, les chanteurs et l'orchestre et le chœur de l'Opéra. On ne peut pas sortir de cette musique du Tannhäuser. La dernière répétition générale a été, dit-on, atroce et n'a fini qu'à une heure du matin. Il faut pourtant qu'on en vienne à bout. Liszt va arriver pour soutenir l'école du charivari. Je ne ferai pas l'article sur le Tannhäuser, j'ai prié d'Ortigue de s'en charger. Cela vaut mieux sous tous les rapports et cela les désappointera davantage. Jamais je n'eus tant de moulins à vent à combattre que cette année; je suis entouré de fous de toute espèce. Il y a des instants où la colère me suffoque.
Adieu; il faut que j'essaye de sortir, de marcher; si je ne puis pas, je reviendrai me coucher.
AU MÊME.
Paris, mardi matin 5 mars [1861].
Cher ami,
J'ai vu hier le général Mellinet: il va écrire pour toi à l'amiral de La Roncière, je lui remettrai demain une note qu'il m'a demandée à ce sujet.
On est très ému dans notre monde musical du scandale que va produire la représentation du Tannhäuser; je ne vois que des gens furieux; le ministre est sorti l'autre jour de la répétition dans un état de colère!... L'empereur n'est pas content; et pourtant il y a quelques enthousiastes de bonne foi, même parmi les Français. Wagner est évidemment fou. Il mourra comme Jullien est mort l'an dernier, d'un transport au cerveau. Liszt n'est pas venu, il ne sera pas à la première représentation; il semble pressentir une catastrophe. Il y a, pour cet opéra en trois actes, 160,000 francs de dépensés à l'heure qu'il est. Enfin, c'est vendredi que nous verrons cela.
Comme je te l'ai dit, je ne ferai pas l'article là-dessus, je le laisse faire par d'Ortigue. Je veux protester par mon silence, quitte à me prononcer plus tard si l'on m'y pousse. On parle vaguement des Troyens, dans le monde officiel; on va, dit-on, s'en occuper... Je ne sais rien de positif, nous allons voir.
A MADAME MASSART.
14 mars 1861[104].
Eh! oui, parbleu! à ce soir donc!
Ah! Dieu du ciel, quelle représentation! quels éclats de rire! Le Parisien s'est montré hier sous un jour tout nouveau; il a ri du mauvais style musical, il a ri des polissonneries d'une orchestration bouffonne, il a ri des naïvetés d'un hautbois; enfin il comprend donc qu'il y a un style en musique.
Quant aux horreurs, on les a sifflées splendidement.
Tâchez donc de ne jamais mieux jouer que la dernière fois; si vous continuez à faire des progrès, vous tomberez dans le puits de l'Avenir.
La perfection suffit.
A LOUIS BERLIOZ.
Mardi, 21 mars [1861].
Cher Louis,
Je ne sais si ce billet te parviendra. Je te l'écris cependant pour te souhaiter un bon voyage et t'embrasser avant ton départ. Je profite d'un instant où je suis seul dans la chambre du jury. C'est pour moi une corvée abominable que cette session du jury. Ce matin, j'ai dû faire un tel effort pour me lever que les vomissements m'ont pris. En ce moment je vais mieux. La deuxième représentation du Tannhäuser a été pire que la première. On ne riait plus autant; on était furieux, on sifflait à tout rompre, malgré la présence de l'empereur et de l'impératrice qui étaient dans leur loge. L'empereur s'amuse. En sortant, sur l'escalier, on traitait tout haut ce malheureux Wagner de gredin, d'insolent, d'idiot. Si l'on continue, un de ces jours la représentation ne s'achèvera pas et tout sera dit. La presse est unanime pour l'exterminer. Pour moi, je suis cruellement vengé.
AU MÊME.
Paris, 18 avril 1861.
Cher Louis,
Donne-moi de tes nouvelles, si tu peux m'écrire une lettre sans les coups de couteau que contenait ta dernière. Je suis plus malade aujourd'hui qu'à l'ordinaire; j'ai un feuilleton à faire que je n'ai pas la force de commencer. On m'a fait au Conservatoire une ovation rare après l'exécution des scènes de Faust. M. de Rémusat, qui y était, a dû écrire cela à Morel ou à Lecourt. On continue tout doucement les répétitions du Freyschütz à l'Opéra. J'ai dîné chez l'empereur il y a huit ou dix jours; j'ai pu à peine échanger trois mots avec lui et je me suis ennuyé splendidement.
AU MÊME.
Vendredi, 4 mai [1861].
Cher ami,
Depuis ta dernière lettre, j'ai eu de tes nouvelles par Lecourt, que j'ai chargé aussi de te donner des miennes. Hier soir, il y a eu une audition de quelques scènes des Troyens chez M. E. Bertin; grandissime succès, étonnement de tout le monde de l'opposition que je trouve à l'Opéra.
Enthousiasme du secrétaire intime du ministre, lequel ministre d'État m'a invité à dîner pour lundi prochain; et ce sera comme au dîner de l'empereur, on me parlera de la pluie et du beau temps. Et il faut souffrir cette outrageante indifférence! et je suis sûr que j'ai fait une grande œuvre, plus grande et d'un plus noble aspect que ce qu'on a fait jusqu'à présent!... Et il faut mourir à petit bruit, écrasé sous les pieds de ces lourds animaux!
Ah! tu te décourages! et que ferai-je donc aussi?...
Je ne puis que pâtir et me taire.
Mais la vie est bien dure et bien lourde aussi. Je ne puis encore me remettre à l'œuvre pour Béatrice et Bénédict; il faut pourtant finir cette partition. Celle-là au moins sera jouée; mais je suis malade et tiraillé par tant d'occupations diverses, tant d'ennuis de toute espèce!
Adieu; je t'embrasse de tout mon cœur.
AU MÊME.
Paris, 2 juin 1861.
Je te vois très tourmenté; je ne puis rien te dire de rassurant. Alexis cherche à te trouver une place à Paris, et c'est précisément parce qu'il la cherche, qu'il ne la trouvera pas. Je suis aussi incapable que lui de changer ta position. C'est à toi à te faire ton sort et à ne pas te mettre dans des embarras dont personne au monde ne pourra t'aider à sortir. Je suis allé chez madame Lawsson; elle va mieux, elle était sortie. Les répétitions du Freyschütz sont abandonnées. On m'a fait perdre un mois pour rien.
Comme compensation on m'a demandé de monter l'Alceste, ainsi que j'avais monté Orphée au Théâtre-Lyrique, en m'offrant les droits d'auteur complets; pour des raisons musicales qu'il serait trop long de t'expliquer, j'ai refusé. On croit dans ce monde-là que l'on pourrait faire faire pour de l'argent les choses les plus contraires à la conscience de l'artiste; je viens de leur prouver que cette opinion était fausse.
Les Troyens sont décidément admis à l'Opéra. Mais il y a Gounod et Gevaert à passer avant moi; en voilà pour deux ans. Gounod a passé sur le corps de Gevaert, qui devait être joué le premier. Et ils ne sont prêts ni l'un ni l'autre; et moi, je pourrais être mis en répétition demain. Et Gounod ne pourra être joué au plus tôt qu'en mars 1862.
Mon obstination à refuser de monter Alceste fait du bruit et contrarie beaucoup de gens.
On ferait mieux de ne pas s'amuser à perdre du temps et de l'argent pour insulter un chef-d'œuvre de Gluck, et de monter les Troyens tout de suite.
Mais, comme le bon sens indique cela, c'est cela qu'on ne fera pas. Liszt vient de faire la conquête de l'empereur: il a joué à la cour la semaine dernière, et hier il a été nommé commandeur de la Légion d'honneur. Ah! quand on joue du piano!...
Je n'ai pas encore fini ma partition de Béatrice; je puis si rarement y travailler. Pourtant cela avance peu à peu.
AU MÊME.
[23 octobre 1861.]
J'ai reçu tes deux lettres avec les détails que contenait la première sur ta prochaine position. Je la trouve plus avantageuse que je n'avais espéré. Avec 200 francs par mois, étant logé et nourri (car ton navire est ta maison quand tu voyages), tu seras assez à l'aise. Mais tu ne me dis pas quelle assurance tu as d'être deuxième lieutenant. Je serai embarqué, me dis-tu, j'aurai tout. Qui donc a pu te dire quelque chose de positif à cet égard? tu me le laisses ignorer complétement. Tâche d'observer la diète quand tes maux d'estomac te tourmentent; il paraît que c'est le grand moyen de les conjurer. J'ai travaillé hier pendant sept heures à un petit ouvrage en un acte que j'ai entrepris; je ne sais si je t'en ai parlé. C'est très joli, mais très difficile à bien traiter. J'aurai encore longtemps à travailler au poème; il m'arrive si rarement de pouvoir y songer avec suite. Puis la musique aura son tour. Rien de nouveau pour les Troyens, sinon que le Théâtre-Lyrique approche de plus en plus de sa ruine, pendant que sa nouvelle salle s'élève. Je voudrais que la catastrophe fût déjà accomplie; on aurait une nouvelle administration moins malheureuse et moins maladroite que celle qui existe. Tu as donc entendu le finale de la Vestale? Tu me dis le duo, tu te trompes. La phrase citée dans ta lettre appartient au finale, à moins qu'on n'ait fait à Marseille un pot-pourri des deux.
AU MÊME.
Paris, lundi 28 octobre 1861.
Cher Louis,
Si je ne savais pas quelle détestable influence le chagrin peut avoir sur les meilleurs caractères, je serais capable de te répondre de tristes vérités; tu m'as blessé au cœur et atrocement, et avec un sang-froid que dénote le choix de tes expressions. Mais je t'excuse et je t'embrasse; tu n'es pas, malgré tout, un mauvais fils. Quelqu'un qui lirait ta lettre sans rien savoir de notre position à tous les deux, croirait que je suis sans affection réelle pour toi, que le monde dit que tu n'es pas mon fils; que j'aurais pu et que je pourrais, si je voulais, te trouver une meilleure position, que j'ai tort de ne pas t'engager à venir à Paris solliciter UNE PLACE, et à quitter celle que tu as; que je t'ai humilié en te comparant à je ne sais quel héros de Béranger auquel tu fais allusion. Tiens, franchement et sans vouloir récriminer, tu as été trop loin... et j'éprouve une douleur qui ne m'était pas connue... De bonne foi, est-ce ma faute si je ne suis pas riche, si je n'ai pas de quoi te faire vivre tranquille, en oisif, à Paris avec ta femme, ton enfant ou tes enfants, si tu en as d'autres?... Y a-t-il l'ombre de justice à me reprocher cela? Tu m'as écrit au milieu d'août à Bade; depuis lors, pas un mot; tu m'as laissé deux mois et demi sans savoir ce que tu étais devenu; Alexis n'en savait pas davantage. A présent tu m'écris avec des expressions d'ironie... Ah! pauvre cher Louis, ce n'est pas bien.
Ne t'inquiète pas de ce que tu dois à ton tailleur; le billet sera payé quand on me le présentera. Si tu veux que je te débarrasse plus tôt de cette dette, envoie-moi l'adresse du tailleur et j'irai l'acquitter. Il est vrai que je te croyais plus jeune; ne vas-tu pas me faire un crime aussi de ne pas avoir la mémoire des dates? Est-ce que je sais quel âge avaient mon père, ma mère, mes sœurs, mon frère, quand ils sont morts; faut-il en conclure que je ne les aimais pas?... Ah! vraiment... mais j'ai l'air de me justifier. Oui, je le répète, le chagrin te fait délirer, et voilà pourquoi je ne puis que t'aimer et te plaindre davantage. Tu me parles de solliciter pour toi, mais qui? et pour obtenir quoi? Tu sais bien qu'il n'y a personne de plus maladroit que moi en sollicitations. Dis-moi clairement ce que je puis faire et je le ferai. Je n'ai pas reçu de lettre de Morel.
Que pourrait-il me dire?
Adieu, cher ami, cher fils, cher malheureux par ta faute et non par la mienne.
Je t'embrasse de tout mon cœur et j'attends de tes nouvelles par le prochain courrier.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, dimanche soir, 2 mars 1862.
Mon cher Morel,
Soyez assez bon pour me donner des nouvelles de Louis. Est-il parti pour les Indes? Ce que j'avais prévu est arrivé: il ne m'a pas écrit une ligne. Je ne puis vous dire à ce sujet rien que vous n'ayez dès longtemps deviné; mais j'avoue que ce chagrin est un des plus poignants que j'aie jamais éprouvés. Je vous écris au travers d'un de ces abominables feuilletons dont on ne sait comment se tirer. Je cherche à soutenir un peu ce malheureux X... qui vient de faire un fiasco, comme on n'en vit jamais. Il n'y a rien dans sa partition, absolument rien. Comment soutenir ce qui n'a ni os ni muscles? Et pourtant il faut que je trouve quelque chose à louer. Le poème est au-dessous de tout. Cela n'a pas l'ombre d'intérêt ni du bon sens. Et c'est son troisième fiasco. Eh bien, il en fera un quatrième! On ne fait plus des douzaines d'opéras... beaux. Paesiello en a écrit cent soixante-dix; mais quels opéras! et qu'en reste-t il?
En fait de symphonies, Mozart en écrivit dix-sept dont trois sont belles, et encore!... Le bon Haydn seul a fait une grande quantité de jolies choses en ce genre. Beethoven a fait sept chefs-d'œuvre. Mais Beethoven n'est pas un homme. Et quand on n'est qu'un homme, il ne faut pas trancher du dieu.
A LOUIS BERLIOZ.
Dimanche soir, 15 mars [1862].
Cher ami,
Comment peux-tu, quand tu es en France (l'Algérie c'est la France), me laisser si longtemps sans nouvelles de toi? Enfin tout va bien. Excepté moi qui viens encore de passer trente heures à me tordre dans mon lit. Je t'écris avant de me recoucher, seul au coin de mon feu. Je n'ai de lettres de personne; ni mon oncle, ni mes nièces ne m'ont écrit depuis un temps fort long. Les événements de notre monde musical ne sont pas réjouissants. La chute de la Reine de Sabba a effarouché le ministre, qui ne sait plus quel parti prendre; pour mettre à couvert sa responsabilité, il voudrait un opéra nouveau, d'un maître consacré par de nombreux succès à l'Opéra. Mais Meyerbeer ne veut pas, Halévy est mourant ou mort à cette heure (à Nice), Auber n'a rien fait. Le ministre n'ose pas encore se décider en ma faveur. En conséquence, on ne fait rien et on ne décide rien. Madame Charton-Demeur vient d'avoir un grand succès au Théâtre-Italien; il faut espérer qu'on aura le bon sens de l'engager à l'Opéra. Si on lui fait des propositions, elle demandera à débuter dans les Troyens. En attendant, nous répétons chez moi tous les mardis Béatrice, qui paraîtra au théâtre de Bade le 6 août... J'ai fini tout ce que j'avais à faire, et je me garderai bien de recommencer un autre ouvrage. Notre maison était sur le point de s'écrouler tant elle était mal bâtie. Les architectes de la ville sont intervenus et ont obligé le propriétaire à d'immenses réparations. Dans quelques semaines, nous serons forcés de déménager et de faire tout transporter au deuxième étage, que l'on répare maintenant; puis il faudra remonter. Quel tracas! sans indemnité ni compensation d'aucune sorte. Notre grand cousin de Toulouse vient de mourir.
Tout le monde ici t'envoie mille amitiés.
AU MÊME.
Paris, 17 juin 1862.
Cher Louis,
Tu as dû recevoir une dépêche télégraphique et, ce matin, une lettre de moi[105]. Je t'écris encore ce matin pour te dire que je vais passablement par moments et qu'il n'est pas nécessaire que tu viennes. Mes nièces m'ont offert aussi de venir. Mais je sens qu'il vaut mieux pour le moment que je reste livré à moi-même. Ce que je voudrais, c'est que tu puisses venir à Bade me retrouver le 6 ou le 7 août; je sais que cela te ferait aussi un grand plaisir d'assister aux dernières répétitions et à la première représentation de mon opéra. Au moins, dans l'intervalle de mes occupations forcées, tu serais mon compagnon; je te présenterais à mes amis, enfin je serais avec toi. Il s'agit de savoir si tu pourras sans danger t'absenter, au moment où ton navire sera sur le point de partir. Tu retournerais à Marseille le 11 août, la première représentation ayant lieu le 9.
Je ne sais pas non plus de quel argent je pourrai disposer pour te l'envoyer; les dépenses de la triste cérémonie de la translation de Saint-Germain sont considérables et je ne les connais pas encore. Et puis j'ai peur de te faire venir dans cette ville de jeu et de joueurs. Pourtant, si tu me donnes ta parole d'honneur de ne pas risquer seulement un florin, j'aurai confiance en toi, et je me résignerai à la douleur de notre séparation quand tu me quitteras pour partir; douleur qui sera bien plus vive dans ces nouvelles circonstances. Dis-moi ce que tu penses à ce sujet.
Adieu, cher Louis. Hier, ma belle-mère est revenue de Saint-Germain, où elle était allée; ne me voyant pas paraître à dîner mardi, elle se doutait de quelque malheur. Elle y est arrivée comme M. et madame Laroche et moi venions d'en partir et n'a plus trouvé que le cadavre de sa fille... Depuis ce jour, elle y était restée à moitié folle et gardée par une de ses amies qui était venue à son secours, et je ne l'avais pas revue. Tu penses, en nous retrouvant, quel déchirement!
Écris-moi, cher, cher Louis.
AU MÊME.
Paris, 12 juillet [1862].
Je t'écris aussi dans un moment de fatigue; j'éprouve un soulagement si grand à causer un peu avec toi. Oui, j'étais heureux, la nuit, de te savoir là près de moi... Mais je ne veux pas t'attrister, j'aime mieux envisager la nouvelle position où tu te trouves et l'amélioration prochaine de ton sort.
Tu ne feras pas de ces interminables voyages qui t'eussent éloigné de moi si longtemps. Dans quelques années, tu auras de beaux appointements et des bénéfices dans les entreprises navales. Et nous nous verrons plus souvent. Je ne veux voir que cela. J'ai reçu ce matin une lettre du régisseur de Bade, qui m'annonce que mes chœurs sont sus et qu'ils produisent beaucoup d'effet. Il compte sur un grand succès (comme s'il connaissait le reste de la partition!). Tout n'est que prévention dans ce monde-là. Hier, nous avons répété à l'Opéra-Comique; tout le monde y était par extraordinaire, et nous avons commencé à régler la mise en scène.
Je vais à l'Institut aujourd'hui pour la première fois depuis un mois.
J'ai rendu à Alexis le linge qu'il t'avait prêté. J'espère que ton genou est guéri, tu ne m'en parles pas.
Adieu, cher ami; je t'embrasse de tout mon cœur. Ma belle-mère te remercie de ton souvenir.
AU MÊME.
Bade, dimanche 10 août [1862].
Cher Louis,
Grand succès! Béatrice a été applaudie d'un bout à l'autre, on m'a rappelé je ne sais combien de fois. Tous mes amis sont dans la joie. Moi, j'ai assisté à cela dans une insensibilité complète; c'était un de mes jours de souffrance et tout m'était indifférent.
Aujourd'hui, je suis mieux, et les amis qui viennent me féliciter me font grand plaisir. Madame Charton-Demeur a été admirablement charmante, et Montaubry nous a présenté un Bénédict élégant et distingué. Le duo, que tu connais, chanté par mademoiselle Montrose et madame Geoffroy dans une jolie décoration et sous un clair de lune très habilement fait par le machiniste, a produit un effet monstre, on ne finissait pas d'applaudir. Allons, je t'embrasse, tu dois être content. Mais tu es demeuré bien longtemps sans m'écrire. Pourquoi donc te fait-on ainsi courir de navire en navire? Je tâcherai de retourner à Paris ces jours-ci; alors ne m'écris plus à Bade.
Je n'ai que le temps de t'embrasser; on me tiraille de tous côtés. Il faut que j'aille remercier mes acteurs qui sont, eux aussi, tout joyeux.
A PAUL SMITH[106].
Paris, 28 septembre 1862.
Vous êtes un terrible homme. Votre article sur mon petit livre A travers chants contient, au début, un des plus atroces mots à double détente que des gens de notre profession aient jamais trouvé. J'en suis la victime, mais je l'admire et je vous l'envie. L'art avant tout!
Eh bien, voyez quelle est ma bonté d'âme et mon amour pour la famille des gens d'esprit: si je rencontrais jamais un mot de cette subtile férocité qui vous fût applicable, je ne vous l'appliquerais pas, non, croyez-moi; je le mettrais à l'adresse de quelqu'un de mes ennemis, qui, on le sait, ne sont pas de votre famille.
Quel est donc ce mot à la congrève, diront quelques gens qui ne voient pas aussi loin que leur nez? Je ne suis pas assez... ennemi de moi-même pour le dire. Qu'ils cherchent! En tout cas, je vous le pardonne, parce qu'il est beau, et que vous ne l'avez pas fait exprès. Mais ce que je ne vous pardonnerai jamais, c'est de n'avoir pas corrigé vos épreuves. Comment! vous me faites dire en citant ma prose: L'école du petit chien est celle des chanteuses dont la voix extraordinairement étendue dans le CHANT, pour étendue dans le HAUT. Ailleurs vous poussez l'indifférence pour le bon sens (d'autrui) jusqu'à me faire dire dans ma paraphrase du to be or not to be: Ou s'armer contre ce torrent de maures, pour ce torrent de MAUX! C'est trop fort!
J'aimerais mieux que vous eussiez trouvé deux autres mots à double détente, comme le premier, et recevoir une vraie bordée de votre revolver, que de subir des coquilles de cette dimension, coquilles qui me feront prendre pour une huître. Je sais bien que vous l'avez fait exprès, à l'inverse du mot susmentionné; mais c'est justement pour cela que j'en conserverai une rancune avec laquelle j'ai le chagrin d'être, mon cher ami, votre tout meurtri (c'est trop faible en français), your murdered.
A LOUIS BERLIOZ.
Vers 1863.
Cher ami,
Je viens de recevoir ta triple lettre et j'en ai été vivement touché. Tu me dis des choses que je pense souvent, mais que je n'écris jamais; tu vois le monde intérieur que le vulgaire ne voit pas; merci, cher ami.
Je voudrais bien, comme tu le dis, passer quelque temps à ton bord, sous le grand œil du ciel et loin de notre petit monde; et je te l'eusse déjà proposé, si je n'étais retenu par les liens de Gulliver, la santé, l'argent, le mal de mer, mes petites places.
Je me suis levé aujourd'hui. On a trouvé le moyen de me replonger dans la musique, et le remède a opéré. Madame Demeur est venue me prier de lui apprendre son rôle d'Armide qu'on a mis à l'étude au Théâtre-Lyrique, et Carvalho est venu de son côté me demander de diriger ses répétitions. Je ne suis pas sûr qu'on parvienne à se tirer d'une si énorme tâche. Personne n'en connaît une mesure, ni un mot, ni une intention. Il faut, tout leur apprendre; chacun marche à tâtons et patauge dans ce sublime. Alors, tous les jours madame Charton vient chez moi avec Saint-Saëns, le grand pianiste que tu connais et qui sait fort bien son Gluck, et nous travaillons à remonter cette pauvre femme, qui se décourage et qui ne comprenait RIEN d'abord à son rôle.
Tu sauras que le ministre des beaux-arts vient d'augmenter les appointements des professeurs du Conservatoire et que les miens ont été doublés. Ainsi, au mois de mars prochain, au lieu de 118 francs par mois, je toucherai 236 francs. Cela m'aidera beaucoup.
J'ai à recevoir pour toi, ce mois-ci, trente francs pour un semestre de deux obligations ottomanes que j'ai achetées sur ton argent. Dans six mois, encore autant.
Te voilà rentier. Adieu, cette lettre m'a diablement fatigué. Quand espères-tu venir me voir?
A M. ET MADAME MASSART.
Weimar, 9 avril 1863.
Que c'est gentil à vous, chers amis, de m'avoir écrit tous les trois! Vous allez vous moquer de moi; eh bien, vous aurez tort; cette idée m'a ravi.
Je vous écris en me levant à une heure. On m'a fait passer une partie de la nuit à un banquet qui m'a été offert, après la première représentation[107], par les artistes de Weimar, réunis à ceux qui étaient venus des villes voisines et même de Dresde et de Leipzig. Le succès de Béatrice a été flambant, l'exécution excellente dans son ensemble. Les grands-ducs et la grande-duchesse et la reine de Prusse m'ont accablé de compliments. La reine surtout m'a dit des choses, oh! mais des choses que je n'ose vous répéter. Le morceau qu'elle aime le plus, c'est le trio des trois femmes, tout en avouant que le duo est une invention ravissante, et que l'air de Béatrice et la fugue comique lui plaisent infiniment.
On m'annonce pour demain une bordée d'applaudissements à démolir la salle.
L'orchestre va à merveille et tout l'ensemble vocal se comporte musicalement. La Béatrice est délicieusement jolie et une artiste véritable; seulement elle reste trop allemande et rend cette lionne sicilienne presque sentimentale.
Adieu, chers amis; je ne reviendrai pas à Paris aussitôt que je l'avais cru; le prince de Hohenzollern, qui habite Lowenberg, en Silésie, à cent vingt lieues d'ici, m'envoie chercher pour lui diriger un concert composé de:
Ouverture du Roi Lear.
Adagio de Roméo et Juliette.
La fête chez Capulet (du même).
Ouverture du Carnaval Romain.
La symphonie d'Harold.
Son orchestre sait tout cela presque par cœur; je lui ferai faire (à l'orchestre) trois répétitions et tout devra marcher pas trop mal.
Voyez-vous ces princes qui se donnent le luxe d'avoir des orchestres de soixante musiciens et de donner de pareils concerts à leurs amis!
Je serre les trois savantes mains et je remercie les trois bons cœurs de leur souvenir.
AUX MÊMES.
Lowenberg, 19 avril 1863.
Voici encore un bulletin de la grande armée.
La seconde représentation de Béatrice à Weimar a été ce qu'on m'avait annoncé qu'elle serait; j'ai été rappelé après le premier acte et après la deuxième. Je vous fais grâce de toutes les charmantes flatteries des artistes et du grand-duc. Me voilà maintenant à Lowenberg chez le prince de Hohenzollern, que je n'avais pas revu depuis 1843. Hélas! que de choses se sont passées pendant ces vingt ans! Il est devenu, lui, impotent, goutteux; mais sa gaieté lui est restée et son amour pour la musique semble avoir augmenté. Il m'adore littéralement. Son orchestre sait à fond toutes mes symphonies et ouvertures. Et c'est un charmant orchestre de cinquante musiciens musiciens. Le prince a fait construire, dans son château de Lowenberg, une délicieuse salle de concerts d'une sonorité parfaite, avec foyer derrière l'orchestre, bibliothèque musicale, tout ce qu'il faut. Il m'a donné un appartement à côté de ce bijou de salle, et tous les jours, à quatre heures, on entre dans mon salon m'annoncer que l'orchestre est réuni. J'ouvre deux portes et je trouve les cinquante artistes immobiles à leur poste, silencieux et bien d'accord. Ils se lèvent courtoisement quand je monte à mon pupitre; je prends mon bâton, je marque le premier temps, et tout part. Et comme ils vont ces gaillards! Figurez-vous qu'à la première répétition ils ont exécuté le FINALE d'Harold sans fautes, et l'adagio de Roméo et Juliette sans manquer un accent!... Le maître de chapelle Seifriz me disait après cet adagio: «Ah! monsieur, quand nous... écoutons cette morceau, nous... toujours... en larmes».
Savez-vous, chers amis, ce qui me touche le plus dans les témoignages d'affection que je reçois? C'est de voir que je suis mort. Il s'est passé en vingt ans tant de choses que j'ai l'impertinence d'appeler progressives! on m'exécute à peu près partout.
Un maître de Breslau vient d'arriver ici; il me dit que la Société musicale placée sous sa direction a exécuté, le mois dernier, le scherzo de la Fée Mab avec les honneurs du bis; celui de Dresde est venu à Weimar la semaine dernière et m'a appris plusieurs faits de la même nature. Or a joué des fragments du Requiem à Leipzig, il y a un mois; mon ouverture du Corsaire se joue partout, et je ne l'ai, moi, entendue qu'une fois. Les autres ouvertures, celle du Roi Lear surtout, et celle de Benvenuto Cellini, se jouent souvent, et ce sont précisément les moins connues à Paris. Avant-hier (riez, ou souriez, chère madame), je me suis surpris, en conduisant l'ouverture du Roi Lear, à ne pouvoir retenir quelque humidité qui voulait tomber de mes yeux. Je me disais que peut-être le father Shakespeare ne me maudirait pas d'avoir osé faire parler ainsi son vieux roi breton et sa douce Cordélia. J'avais oublié cette ouverture que j'écrivis à Nice en 1831.
Il n'y avait point de harpe à Lowenberg, le prince a fait venir la harpiste de Weimar (cent vingt lieues)...
J'ai été interrompu cinq fois pendant que je vous écrivais. Le prince est dans son lit, retenu par la goutte, et furieux de ne pouvoir assister à nos répétitions. A tout instant il m'envoie chercher; pendant les dîners, auxquels il a la bonté d'inviter les artistes étrangers arrivés ici pour le concert de demain, il m'écrit des billets au crayon qu'un grand laquais galonné m'apporte sur un plat d'argent et auxquels je réponds entre la poire et le baba (car il n'y a pas de frommage ici) (y a-t-il deux m à frommage? je ne crois pas). Puis je vais passer une demi-heure à côté de son lit, et il me dit des choses!... Il connaît tout ce que j'ai écrit en prose et en musique. Ce matin, il m'a dit: «Venez, que je vous embrasse; je viens de lire votre analyse de la Symphonie pastorale...» Il n'ose pas se lever pour la répétition d'aujourd'hui dans la crainte d'éprouver une rechute qui l'empêcherait d'assister demain au concert. Il aime ce que j'aime en musique et il déteste ce que je hais.
Croiriez-vous que les quatre répétitions et les deux représentations de Béatrice que j'ai conduites à Weimar, ne m'ont pas fatigué, à beaucoup près, autant que les répétitions du concert de Lowenberg. Je suis brisé, moulu. C'est que l'orchestre de théâtre est un esclave; il agit en esclave placé dans une cave; l'orchestre de concert est un roi placé sur un trône. Et puis ces grandes passions des symphonies me retournent le cœur un peu plus brutalement que les sentiments d'un opéra de demi-caractère comme Béatrice.
Pourquoi n'êtes-vous pas là? quel charme ce serait, pour les auditeurs intelligents qui m'entourent, de vous entendre!... Il y a pourtant, mon cher Jacquard, un jeune homme de dix-sept ans qui serait digne d'être votre élève; mais il n'a pas une basse comme votre bien-aimée.—J'y vais!—On vient me chercher; l'orchestre est à son poste et d'accord; je vais me chanter la scène de Roméo et Juliette; je penserai à vous. Ah! comme ils disent bien la phrase:
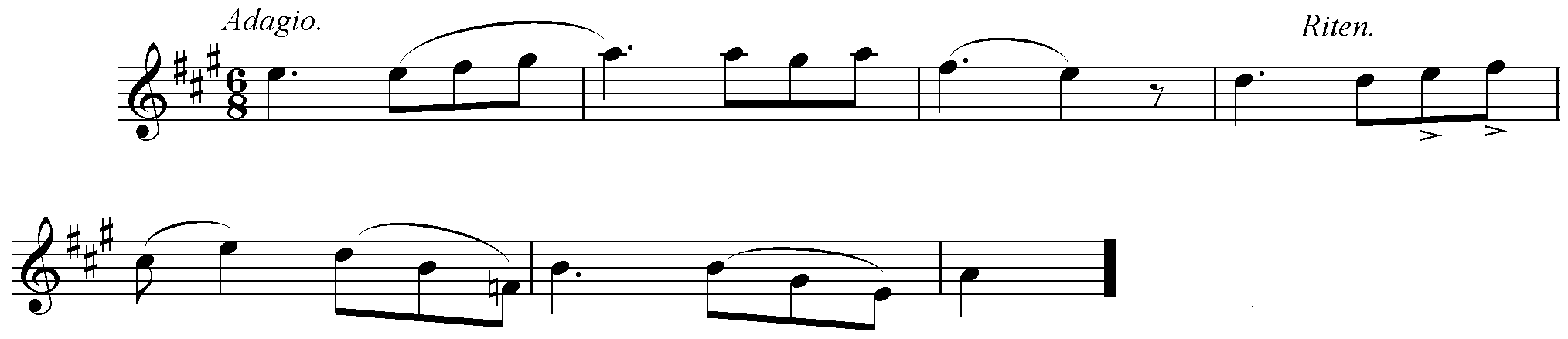
A MADAME MASSART.
Paris, 23 septembre au soir, au coin de mon feu (1863).
Chère madame Massart, vous croyez peut-être que, n'ayant plus à recevoir chez vous ni tasses de chocolat, ni sonates de Beethoven, ni quatuors, je ne pense plus à vous?... Vous en êtes capable; vous avez sucé le venin des Maximes de la Rochefoucauld; vous croyez qu'il y a un motif intéressé à toutes nos actions!—Hélas! cela pourrait bien être.
Pourtant, qu'est-ce qui m'oblige à vous écrire, ce soir? Qu'est-ce qui me force à envoyer une poignée de main à votre mari? Qu'est-ce qui me porte à m'apitoyer sur votre sort? car, j'en suis sûr, vous traînez une vie misérable dans votre petite boîte de sapin, pompeusement nommée «maison de campagne», où il n'y a de place que pour un piano, sans queue, où vous sentez la mer à toute heure, où il vente à décorner des bœufs, où, quand vous jouez la sonate en fa mineur, vous vous ennuyez vous-même,
Ayant pour auditeurs des crabes seulement...
Il faut qu'on dise: «Madame Massart est à la campagne, dans sa villa; elle prend des bains de mer, elle folâtre sur les grèves, elle aspire les senteurs marines et les effluves de l'infini...» O blagues colossales et puériles! Je vous plains; mais il faut bien faire son métier de banquiste...
C'est égal, je vous replains.
Quand revenez-vous? Bon, il semble que je m'attende à recevoir de vos nouvelles, et certes, ni Massart ni vous n'oserez m'écrire trois lignes. Je vous sais trop modestes, vous ne vous ferez pas cet honneur. J'ai chargé l'autre jour votre parrain (oh! un parrain! la Dame blanche! est-ce bouffon!) de vous présenter mes hommages; il a dû vous voir. Bertsch aussi a dû vous voir.
Je suis tout absorbé par nos répétitions du Théâtre-Lyrique. Ça va, ça va. Heureusement, vous ne serez pas encore revenus de vos terres au mois de novembre et vous ne me ferez pas le chagrin de vouloir assister à la première représentation; car je n'aurai pas de billets à vous donner. Massart, qui est un si fameux enleveur de salles, me fera bien faute. Cela diminuera beaucoup mes chances de succès et peut me faire perdre quatre ou cinq cents représentations; je me résigne.
Vous croyez peut-être que je vais vous dire: «Ah! le cinquième acte!... Ah! les adieux de Didon! Ah! le chœur des prêtres de Pluton! Ah! ceci! ah! cela!...» Eh bien, oui, vous avez raison, je n'ai pas la vanité de me croire modeste, moi; j'ai, au contraire, la modestie de me croire bouffi de vanité. Eh oui, il y a tout plein de «Ah!» Si votre crabe entendait cela, il en frémirait sous sa carapace.
Bonjour, bonjour! Massart fait, dit-on, des chasses merveilleuses; le bruit court qu'il a tué un chardonneret (a goldfinch). Vous qui vous piquez d'anglais, vous ne saviez certes pas le nom britannique de ce charmant oiseau.
Adieu, adieu! La présente n'a pour objet que de vous faire savoir que je me porte fort mal; je souhaite qu'elle vous trouve de même. Cela me consolera.
A M. JOHANNES WEBER.
Dimanche, 32 novembre 1863.
Monsieur et cher confrère,
Je suis malade depuis quinze jours et n'ai eu qu'aujourd'hui connaissance de votre grand et beau travail de mardi dernier sur mon nouvel ouvrage[108].
Recevez mes sincères remerciements; je ne pouvais être que très heureux et très fier d'être si sérieusement étudié par un de ces hommes trop rares, hélas! dans notre temps et dans notre monde, qui unissent à une organisation musicale et à un vrai savoir, la droiture du cœur et de l'esprit.
Permettez-moi de vous serrer la main.
A M. ALEXIS LWOFF.
Paris, 13 décembre 1863.
Votre lettre m'a causé une joie bien vive. Merci de toutes les expressions cordiales qu'elle contient. C'est une attention charmante de votre part de m'envoyer vos félicitations au sujet des Troyens. J'ai, en effet, été obligé de garder le lit pendant vingt-deux jours, par suite des tourments endurés pendant les répétitions.
Qu'est-ce que cela en comparaison de ceux que votre malheur vous inflige[109]? Il est singulier que tant de grands musiciens aient été frappés d'une calamité semblable: Beethoven, Onslow, Lwoff et Paganini, qui, lui, ne pouvait se faire entendre.
Je vous remercie de l'offre que vous voulez bien me faire d'un sujet d'opéra, mais je ne puis l'accepter, mon intention étant bien arrêtée de ne plus écrire. J'ai encore trois partitions d'opéras que les Parisiens ne connaissent pas, et je ne trouverai jamais les circonstances favorables pour les leur faire bien connaître. Il y a quatre ans que les Troyens sont terminés et l'on vient d'en représenter la seconde partie seulement: les Troyens à Carthage. Reste à représenter la Prise de Troie. Je n'écrirai jamais rien que pour un théâtre où l'on m'obéirait aveuglément, sans observations, où je serais le maître absolu. Et cela n'arrivera probablement pas.
Les théâtres (ainsi que je l'ai écrit quelque part), sont les mauvais lieux de la musique, et la chaste muse qu'on y traîne ne peut y entrer qu'en frémissant. Ou encore: les théâtres lyriques sont à la musique sicut amori lupanar.
Et les imbéciles et les idiots qui y pullulent, et les pompiers et les lampistes, et les sous-moucheurs de chandelles, et les habilleuses qui donnent des conseils aux auteurs et qui influencent le directeur!...
Adieu, cher maître; Dieu vous préserve du contact de cette race! Ce que je vous écris au sujet des théâtres en général est tout à fait confidentiel; d'autant plus que je n'ai trouvé au Théâtre-Lyrique, depuis le directeur jusqu'au dernier musicien de l'orchestre, que dévouement et bon vouloir.
Et cependant...
Et néanmoins...
J'en suis encore malade.
A M. BENNET[110].
Paris, 22 février 1864.
Voici la lettre demandée. Je suis bien aise de vous savoir à Vienne; Théodore pourra y profiter beaucoup en étudiant avec soin les nouveaux chefs-d'œuvre d'Offenbach qu'on y joue en ce moment avec tant de succès. Vous êtes tous bien portants? tant mieux. Quant à moi, depuis huit jours seulement, je mène une vie passable... J'ai demandé un congé illimité au Journal des Débats; plus de feuilletons; les Troyens m'ont enrichi assez pour que je me donne ce luxe. Je n'ai pas mis le pied dans un théâtre dit Lyrique depuis deux mois; je n'ai vu ni Moïse, ni la Fiancée du roide Garbe, ni les merveilles du Théâtre-Italien, ni le nouveau ballet, ni rien. Je suis en train de me débattre avec la Société des concerts du Conservatoire, qui veut exécuter des fragments de Roméo et Juliette; et moi, je ne veux pas. Qui l'emportera? Me joueront-ils malgré moi?... ou me convertiront-ils à leur manière de voir?
Rappelez-moi au souvenir de votre aimable et affectueux petit monde. Je serre la main à Théodore, en lui souhaitant sérieusement d'oublier les manières parisiennes, et la conversation parisienne, et toute espèce de style parisien. Rien n'est plus bête que cette éternelle et plate blague qu'on applique à tout à Paris; qu'il l'oublie à jamais. Il est trop grand artiste pour en tenir compte. Qu'il n'écrive pas trop, ni trop vite, ni pour trop de monde, et qu'il laisse les gens venir à lui sans leur faire trop d'avances. Adieu.
AU MÊME.
Paris, 15 mars 1864
Que diable voulez-vous que je vous dise? Il n'y a point de nouvelles musicales qui vaillent la peine de vous être envoyées. On a joué dernièrement un opéra de Boulanger, le Docteur Magnus. On va donner un opéra, Lara..., tatouille de M... (je ne me rappelle plus son nom....), à l'Opéra-Comique; bientôt Mireille de Gounod au Théâtre-Lyrique. Je suis allé prier George Hainl de remettre l'exécution des fragments de Roméo et Juliette à l'année prochaine; je voyais qu'on n'aurait pas le temps de répéter cela avec assez de soin en ce moment et je ne tiens pas à être exécuté à demi. Pasdeloup a donné une scène des Troyens au dernier concert de l'Hôtel de ville et ne m'a pas même averti de la répétition. Carvalho m'a appris hier à dîner qu'il m'avait mis sur le programme de deux concerts spirituels qu'il va donner dans la semaine sainte, et qu'il voulait qu'à l'instar de David et de Gounod je vinsse diriger en personne le septuor des Troyens: «Non, ai-je répondu, je n'ai pas de robe rouge et je ne puis figurer dans cette cérémonie du Malade imaginaire. Cela ferait quatre chefs d'orchestre.»
J'ai donné ma démission au Journal des Débats. Rien de plus comique que le désappointement et la colère des gens qui, depuis trois mois, me faisaient la cour; ils ont perdu leurs avances, ils sont volés...
Si vous rencontriez, par hasard, à Vienne, M. Peter Cornelius, dites-lui mille choses de ma part et que je serais bien heureux d'avoir une lettre de lui.
A M. ET MADAME MASSART.
Lundi, 15 août 1864[111].
Eh bien, oui, voilà! le maréchal Vaillant m'a écrit, il y a trois jours, une lettre charmante que la Gazette musicale a eu la bonté de me gâter, laquelle lettre m'annonçait que l'empereur nous avait nommés officiers de la Légion d'honneur... oui, madame, vous et moi... Ainsi faites vos arrangements pour changer de ruban, de croix, etc.
Vous n'avez pas voulu venir dîner chez le ministre; nous étions soixante, y compris le chien de Son Excellence, qui a bu son café dans la tasse de son maître. Il y avait un grand écrivain, M. Mérimée, qui m'a dit ceci: «Il y a longtemps que l'on aurait dû vous nommer officier; et cela prouve bien que je n'ai pas encore été ministre.» Samson chancelait sous le poids de sa joie.
Vous voyez que je ne vais pas trop mal aujourd'hui et que je suis beaucoup plus bête qu'à l'ordinaire; je souhaite que la présente vous trouve de même. Paris est en fête; vous n'y êtes pas... La plage de Villerville doit être bien triste... comment pouvez-vous y rester? Massart va à la chasse; il tue des mouettes, quelque cachalot par-ci par-là; et Dieu sait comment vous parvenez à tuer le temps! Vous délaissez votre piano et je parie que, lorsque vous reviendrez, vous aurez de la peine à faire la gamme en si naturel majeur, la plus facile des gammes. Voulez-vous que j'aille vous faire une petite visite?... Vous ne risquez rien de dire: oui; car je n'irai pas. Ah! pardon! je redeviens sérieux; les douleurs me reprennent. Je vais me rejeter sur mon lit. Je vous serre la main à tous les deux.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, dimanche, 21 août 1864.
Mon cher Morel,
Je vous remercie de votre cordiale lettre; cette croix d'officier, et surtout l'avis non officiel que m'a donné de cette faveur le maréchal Vaillant, m'ont fait plaisir à cause de mes amis et aussi un peu à cause du déplaisir que cela fait aux autres. Mais comment pouvez-vous conserver encore des illusions sur les réalités musicales de notre pays? tout y est mort, excepté l'autorité des imbéciles; il faut bien se résigner à le reconnaître, puisque cela est. Je suis à peu près seul ici; Louis est reparti avant-hier pour Saint-Nazaire; tous mes amis et voisins sont en Suisse, en Italie, en Angleterre, à Bade. Je vois seulement quelquefois Heller; nous allons dîner à Asnières, nous sommes gais comme des chouettes; je lis, je relis; le soir, je passe devant les théâtres lyriques pour me donner le plaisir de n'y pas entrer. Avant-hier, j'ai passé deux heures dans le cimetière Montmartre; j'y avais trouvé un siège très commode sur une tombe somptueuse et je m'y suis endormi. De temps en temps, je vais à Passy chez madame Érard, où je trouve une colonie d'excellents cœurs qui me font le meilleur accueil; je savoure le plaisir de ne pas faire de feuilletons, de ne rien faire du tout. Si je n'étais pas attaché à Paris par plusieurs petits intérêts, je voyagerais malgré mes maux physiques, mais il faut y rester. D'ailleurs, Paris devient de jour en jour plus beau; c'est un plaisir de le voir fleurir si rapidement. Il y a après-demain grand festival à Carlsruhe; Liszt y est venu de Rome; ils vont y faire de la musique à arracher les oreilles; c'est le conciliabule de la jeune Allemagne présidée par Hans de Bulow. Vous savez que ce bon Scudo est reconnu fou et enfermé.
Quel malheur!
A M. ET MADAME DAMCKE, A BRUNNEN,
SUR LE LAC DES QUATRE CANTONS (SUISSE).
Paris, 24 août 1864.
Voilà qui est aimable, gracieux, et bien à vous de m'écrire tous les deux. J'allais demander votre adresse à Heller quand votre lettre m'est arrivée.
Mon fils est reparti, ma belle-mère n'est pas revenue, je m'ennuie à grand orchestre. La ville que j'habite m'offre pourtant plus de beaux souvenirs que ne vous en présente la Suisse.
Il y a une maison, rue de la Victoire, où vécut Napoléon, jeune général en chef de l'armée d'Italie; c'est de là qu'il partit un jour pour aller à Saint-Cloud jeter par la fenêtre les représentants du peuple. Il y a sur une place, qu'on appelle la place Vendôme, une haute colonne qu'il a fait élever avec le bronze des canons pris sur l'ennemi. On voit à gauche de cette place un immense palais, nommé le palais des Tuileries, où il s'est passé diablement de choses... Quant aux maisons de certaines rues, vous n'avez pas idée de toutes les idées qu'elles font naître en moi... Il y a des pays comme cela qui exercent un puissant empire sur l'imagination. Eh bien, je m'ennuie tout de même.
Le maréchal Vaillant a donné un grandissime dîner dernièrement; il m'a fait placer à côté de lui et m'a comblé de gracieusetés; mais le dîner a duré deux heures. Avant-hier, les boulevards étaient couverts de badauds qui ont attendu trois heures pour voir passer la voiture où devait se trouver le roi d'Espagne, qui était attendu à l'Opéra. C'est si étonnant un roi d'Espagne!
Vous avez beau dire, chère madame Damcke, quand vous avez bien regardé le lac et que vous êtes bien sûre que c'est beau, vous voudriez voir autre chose. Je lis tous les jours un peu de votre splendide Don Quichotte, je vais par-ci par-là à Passy, chez madame Érard; vous n'avez rien en Suisse de comparable au parc de la Muette, et, dans ce parc, au moins, il n'y a ni vaches ni vachères.
C'est après-demain qu'a lieu le festival de Carlsruhe. Liszt y est déjà. Le programme du premier jour est publié. Comment pouvez-vous n'y pas aller? Moi, j'ai une bonne excuse: je suis malade.
Que vous seriez heureuse si vous aviez en Suisse, pour déjeuner, des fromages comme ceux que l'on a ici! Et puis soupçonnez-vous les melons? Avez-vous du vin potable?
Non, non; vous vivez comme des anachorètes; mais être en Suisse en ce moment, c'est bon genre. Un de ces jours, Heller et moi, nous irons dîner à Montmorency ou à Enghien où il y a aussi un LAC!!!!!
Adieu à tous les deux.
Je vous plains presque autant que je vous aime.
A MADAME ERNST[112].
Paris, 14 décembre 1864.
C'est bien charmant à vous, chère madame Ernst, de m'avoir écrit. Je devrais vous répondre d'une façon gracieuse en faisant la bouche en cœur, d'un style bien épinglé, bien cravaté, bien aimable. Impossible! Je suis malade, triste, dégoûté, ennuyé, sot, ennuyeux, irrité, assommant, assommé, stupide. Je suis dans un de ces jours où je voudrais que la terre fût une bombe remplie de poudre à laquelle je mettrais le feu pour m'amuser. Le tableau que vous me faites de vos plaisirs de Nice ne me séduit pas du tout. Je voudrais voir votre pauvre cher malade et vous, mais je n'accepterais pas votre chambre. J'aimerais mieux habiter la grotte qui se trouve sous le rocher des Ponchettes que la plus jolie chambre d'ami. On y est libre de grogner comme Caliban (qui y loge, je l'y ai trouvé un soir), et il est rare que la mer la remplisse. Au lieu que chez un ami, chez le meilleur ami, on est exposé à des attentions, à une foule d'attentions insupportables. On vous demande comment vous avez passé la nuit, et jamais comment vous passez l'ennui. On vous offre du café, on vous fait admirer une foule de choses; on rit quand vous dites une bêtise, on vous questionne du regard quand vous êtes triste ou gai; on vous parle quand vous causez avec vous-même; et puis le mari dit à sa femme: «Mais laisse-le donc, tu vois bien qu'il ne veut pas dire un mot, tu le tourmentes.» Et alors on prend son chapeau et on sort, et, en sortant, on ferme la porte trop fort. Et l'on se dit: «Allons bon, voilà que je suis un grossier maintenant... Je m'impatiente des attentions qu'on a pour moi; je vais être la cause d'une querelle conjugale, etc., etc.»—Dans la grotte de Caliban, au contraire, on ne risque pas de fermer la porte trop fort et par là on évite les conséquences de la brutalité.
Enfin, n'importe! Vous vous promenez donc beaucoup sur la terrasse, sous les allées d'arbres?... Et après? Vous admirez les couchers de soleil?... Et après? Vous respirez la brise de mer?... Et après? Vous regardez pêcher toutes sortes de thons?... Et après? Vous enviez de jeunes Anglaises qui ont des milliers de livres sterling de revenu?... Et après? Vous enviez davantage des imbéciles sans idées, sans le moindre sentiment, qui ne comprennent rien, qui n'aiment rien... Et après?
Eh! mon Dieu, je vous en offre autant. Il y a aussi des terrasses et des arbres à Paris; on y voit aussi des couchers de soleil, des Anglaises, des imbéciles, plus même qu'à Nice, la population étant beaucoup plus grande; on y pêche des goujons à la ligne. On s'y ennuie, presque autant qu'à Nice. C'est partout de même.
J'ai reçu hier une belle lettre d'un monsieur inconnu sur ma partition des Troyens. Il me dit que les Parisiens étaient accoutumés à une musique plus indulgente que la mienne. Cette expression m'a ravi. Les Viennois m'ont aussi envoyé dimanche dernier une dépêche télégraphique pour m'annoncer qu'ils venaient de fêter mon jour de naissance en exécutant un grand morceau de ma légende la Damnation de Faust, et que ce double chœur avait eu un succès immense. Je ne savais pas même avoir un jour de naissance.
J'adore les cordiaux et les gens bons.
Pardonnez-moi ces deux calembours, avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre dévoué.
A MADAME DAMCKE.
[Paris, 24 décembre 1864?]
Chère madame,
Pardonnez-moi si je ne vais pas dîner chez vous demain. C'est le jour du Seigneur, et, puisque tout travail est interdit, je vais me reposer comme l'ouvrier de la dernière heure.
J'eusse été très heureux de me trouver chez vous avec mesdames d'Ortigue qui sont la grâce et la bonté même et que j'aime beaucoup; mais je me sens si affaibli et j'ai une telle horreur d'entendre parler de Noël! Vous n'auriez qu'à laisser échapper ce nom pour me donner une indigestion et une attaque de choléra.
Et puis il y a encore une autre raison que je ne veux pas vous dire.
Abusez-vous bien, ce soir, à l'Opéra-Comique; mais, je vous en prie, à votre retour, ne me racontez pas la pièce et je vous en saurai un gré infini.
A M. BERSCHTOLD, POUR M. LOUIS BERLIOZ,
CHEZ M. DE ROTHSCHILD, RUE LAFITTE, 17
Sans date, vers 1864 ou 1865.
Quand tu te sentiras plus calme, et j'espère que ce sera demain, reviens donc, cher Louis, dîner au moins à la maison, comme à l'ordinaire, pendant que tu es ici, si le déjeuner te dérange trop pour tes affaires. Mais cela me paraît incroyable; tu as bien assez de cinq à six heures par jour et tu peux bien m'en donner deux. Voyons, réfléchis donc un instant: tu as des chagrins violents qui te troublent le cœur et la tête; personne ne peut rien pour les calmer. Est-ce une raison pour être furieux contre tout le monde?
Tu souffres; viens donc auprès de ceux qui t'aiment; sans parler de la cause de tes souffrances, tu éprouveras un peu de calme à te trouver avec eux. Ta position, d'après ce que tu m'as dit hier, est meilleure que je ne l'espérais; te voilà avec un état, tu es indépendant, tu es libre, autant qu'homme du monde puisse être libre, puisque tu ne devras rien à personne et que ton aisance ne fera que rapidement augmenter, puisqu'on est content de toi dans l'administration qui t'emploie. C'est immense cela; tes chagrins passeront, et ces avantages resteront et en amèneront d'autres plus importants. Moi aussi, j'ai de grands ennuis et de vifs chagrins; pourtant je reconnais que tu n'y es pour rien.
Allons, viens demain, nous t'attendrons à midi et à six heures.
Je t'embrasse de tout mon cœur, pauvre cher Louis. Tu viendras?
A MADAME MASSART.
Ce soir, 1865[113].
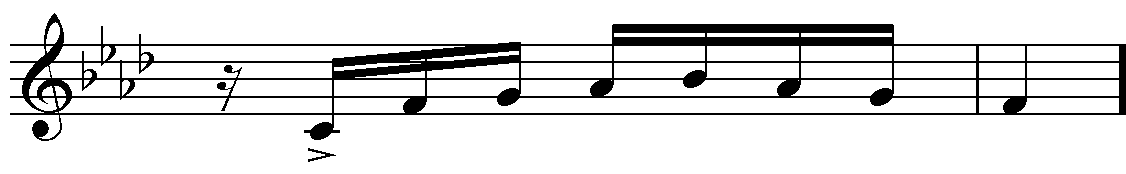
Chère madame,
Autant il est tombé de flocons de neige aujourd'hui, autant de genres de douleurs me torturent ce soir; et le moindre de mes maux n'est pas le regret que j'éprouve de ne pas vous aller entendre.
Je reste couché; je me figure la sonate et le ton de fa mineur, et votre inspiration,.. Ah! pour cela, non! Je n'ai pas assez d'imaginative pour me le figurer; mais, enfin, je me figure que vous êtes une virtuose comme il y en a 87 à Paris, 187 en France et 2,187 en Europe, sans compter ceux et celles d'Amérique, d'Australie et de Tasmanie. Alors, je m'estime trop heureux de dormir. Fi! fi!
Vous ne me croyez pas; vous dites: c'est un farceur; il pourrait très bien se lever; je ne crois pas à sa maladie.
Attendez un peu et je vous inviterai à mon enterrement; et, si vous n'y venez pas, je vous en voudrai à la mort.
A vous quand même!
Accentuez bien le
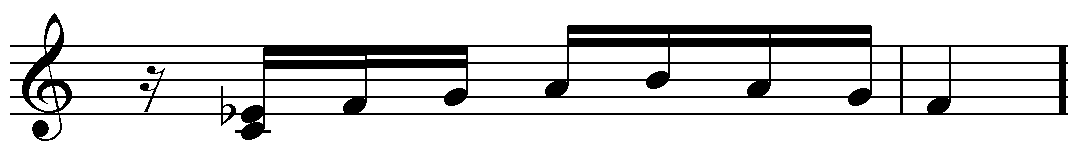
Adieu, chère madame; je suis tout à fait gai. Oh! si je pouvais mourir cette nuit, seulement pour vous prouver que vous me calomniez!
A M. DAMCKE.
26 avril [1865?].
Mon cher ami, ne m'attendez pas pour aller au concert hongrois. Je suis trop bien portant aujourd'hui et je veux rester tranquille. On ne vit qu'une fois... et encore!
A LOUIS BERLIOZ.
Paris, 28 juin 1865.
Cher ami,
Je ne sais pas pourquoi je t'écris, car je n'ai rien à te dire. Ta lettre de ce matin m'a troublé au dernier point. Elle est peu intelligible, tout en étant fort claire dans l'expression de tes sentiments. Tu crains maintenant d'être capitaine, tu te méfies de toi... Et tu désires pourtant être nommé. Tu veux un intérieur au lieu de ta modeste chambre; tu veux te marier, mais pas avec une femme ordinaire. Tout cela est fort simple et facile à comprendre; seulement il ne faut pas reculer devant des fonctions qui peuvent seules te donner l'aisance dont tu as besoin. Tu as trente-deux ans, et, à cet âge, on doit connaître les réalités de la vie, ou on ne les connaîtra jamais. Il te faut de l'argent et ce n'est pas moi qui puis t'en donner. J'ai de quoi joindre les deux bouts de ma dépense annuelle et voilà tout. J'étais comme toi quand j'ai épousé ta mère, mais bien plus à plaindre encore; car je n'avais pas les appointements que tu as et j'étais brouillé avec mes parents, qui d'ailleurs ne pouvaient rien me donner. Je te laisserai ce que mon père m'a laissé et quelque chose de plus; mais je ne puis te dire quand je mourrai. Cela ne tardera guère pourtant. Ainsi ne me parle donc pas de tes convoitises, car je ne puis rien pour les satisfaire. Moi aussi, je voudrais avoir une fortune que je n'ai pas; une fortune qui me permît de la partager avec toi d'abord, et ensuite de voyager, de faire exécuter mes ouvrages, etc., etc. Il faut bien me résigner à m'en passer. Songe que, si, en ce moment, tu étais marié et si tu avais des enfants, tu serais cent fois plus malheureux que tu n'es. Profite autant que tu le pourras de mon exemple. C'est une série de miracles (le présent de Paganini, mon voyage en Russie, etc.) qui m'ont tiré de la plus horrible misère. Or, les miracles sont rares; sans quoi ils ne seraient plus des miracles. Pour vivre seul il faut de l'argent; pour vivre avec une femme, il faut trois fois plus d'argent; pour vivre avec une femme et des enfants, il faut huit fois plus d'argent. Cela est certain comme il l'est que deux et deux font quatre. Je ne parle pas des tourments moraux de certaines positions (même avec de l'argent), car cela dépasse mon talent de description.
En somme, ta lettre est sans conclusion; il semble que tout d'un coup tu découvres le monde, la société, le plaisir, la douleur, etc.
AU MÊME.
Paris, le 11 juillet 1865.
Oui, mon cher bon Louis, causons, quand nous pourrons, aussi souvent que nous pourrons. Ta lettre de ce matin est la bienvenue. Mais j'ai passé hier une abominable journée. Je suis sorti, j'ai erré pendant deux heures sur les boulevards des Italiens et des Capucines. A huit heures et demie, je commençais à sentir la faim; je suis entré au café Cardinal pour y manger quelque chose, et je me suis aussitôt entendu appeler et j'ai vu un gai visage me sourire; c'était Balfe, le compositeur irlandais qui arrivait de Londres, et qui m'a engagé à dîner avec lui. Puis nous sommes allés au Grand Hôtel, où il loge, fumer un cigare excellentissime, qui me fait cependant mal ce matin. Et nous avons tant et tant parlé de Shakspeare, qu'il comprend bien, dit-il, depuis dix ou douze ans seulement.
Je ne lis aucun journal, et tu me ferais bien plaisir de me dire où diable tu as vu toutes les belles choses sur moi que tu me cites. Je n'en sais pas le premier mot. Le programme de Bade est bien tel que je t'ai dit. C'est Jourdan qui chantera Énée, et madame Charton, Didon. Mais il y a du Wagner, du Liszt, du Schumann, et Reyer ne sait pas ce qui l'attend aux répétitions.
Je suis allé hier chez l'agent de change; il n'y avait pas assez de tes cinq cents francs pour acheter deux obligations ottomanes qui rapportent neuf pour cent; ainsi, de l'avis de l'agent, j'attendrai que tu m'envoies ce que tu m'as dit qu'on te devait pour t'acquérir une petite rente. J'ai donc gardé ton argent, parce qu'un retard même de trois mois ne te ferait pas perdre un sou pour le payement du semestre de janvier. Tu sais que Liszt est abbé? Quand j'aurai un volume broché de mes Mémoires, je te l'enverrai, sous ta promesse formelle qu'il ne sortira jamais de tes mains et même que tu me le renverras quand tu l'auras lu et relu.
A M. ET MADAME DAMCKE.
Genève, hôtel de la Métropole, 22 août 1865.
Chers amis,
Je vous écris seulement trois lignes pour que vous ne m'accusiez pas de vous oublier. Vous le savez, je n'oublie pas aisément, et, si je le pouvais, je me garderais bien d'oublier des amis tels que vous.
Je suis ici dans un état de trouble que je ne chercherai pas à vous décrire; il y a des instants d'un calme sublime, mais beaucoup d'autres pleins d'anxiété et même de douleur. On m'a reçu avec un empressement, une cordialité extrêmes[114]; on veut que je sois de la maison, on me gronde quand je ne viens pas. Je fais des visites de quatre heures, nous faisons de longues promenades à pied sur le bord du lac; hier, nous sommes allés en voiture à un village éloigné que l'on nomme Yvonne, avec sa bru et son plus jeune fils qui vient d'arriver; mais je n'ai pas pu me trouver un instant seul avec elle; je n'ai pu parler que d'autres choses; cela m'a donné un gonflement de cœur qui me tue.
Que faire? Je n'ai pas l'ombre de raison, je suis injuste, stupide. Tout le monde dans la famille a lu et relu le volume des Mémoires. Elle m'a doucement reproché d'avoir imprimé trois de ses lettres; mais sa belle-fille m'a donné raison et, au fond, je crois qu'elle n'en est plus fâchée...
Je tremble déjà en pensant au moment où il me faudra partir. Le pays est charmant, le lac est bien pur, bien beau et bien profond; mais je connais quelque chose de plus profond encore, et de plus pur, et de plus beau. Adieu, chers amis.
A MADAME MASSART.
Paris, 15 septembre 1865.
Bonjour, madame! Comment vous portez-vous? comment va Massart? Je suis tout désorienté de ne pas vous retrouver à Paris. J'arrive de Genève, de Grenoble, de Vienne et lieux circonvoisins, tout aussi malade que quand je suis parti. Les deux premiers jours de mon arrivée à Genève m'ont fait croire à une délivrance complète, je ne souffrais plus du tout; mais les douleurs sont revenues plus âpres qu'auparavant.
Êtes-vous heureuse de ne connaître rien de pareil! Je profite d'un moment de répit que me laissent mes douleurs pour vous écrire. Vous allez dire en riant, ou rire en disant: «Pourquoi m'écrire?» Sans doute, vous trouveriez bien plus naturel que je n'eusse pas cette idée saugrenue; mais, que voulez-vous! je l'ai, et, si vous trouvez mon idée trop intempestive, vous en serez quitte pour ne pas me répondre et me traiter d'original.
Pourtant, le but secret de cette lettre est, et ne peut être, que d'en avoir une de vous. Si vous saviez avec quelle violence on s'ennuie à Paris! Je suis seul, bien plus que seul. Je n'entends pas un son musical; je n'entends que charabias à droite, charabias à gauche... Grétry disait qu'il donnerait un louis pour entendre une chanterelle dans l'opéra d'Uthal de Méhul, où il n'y a que des altos; je donnerais bien le double pour entendre de temps en temps parler français autour de moi... Quand revenez-vous à Paris? quand me jouerez-vous une sonate? J'ai parlé de vous à Genève, où l'on m'a bien reçu, bien fêté et un peu grondé. Nous avons passé en revue ma vie parisienne, pendant de longues promenades sur le bord du lac... Ah! bon! me voilà parti! je sens déjà, pour ces quatre mots, le serrement de gorge qui me prend. Parlons d'autre chose. Vous devez en faire aussi, de longues promenades, sur le bord de la mer. Vous avez là de bons gros crabes de votre connaissance, qui doivent venir à vos pieds, vous remercier de votre musique qu'ils écoutent si attentivement. Et cela vous flatte; on est toujours flattée des hommages, même de ceux des crabes, quand on est jolie femme et grande virtuose. Dieu sait si vous en avez, à Paris, des crabes dans votre salon! Voilà donc mademoiselle X... mariée! Permettra-t-elle à son mari de porter une robe de chambre, elle qui ne veut pas tolérer ce vêtement pour Brutus?
Quand vous serez revenue, un soir, il nous faudra recomposer notre petit auditoire d'hommes, et nous lirons Coriolan. Rien ne me fait plus vivre que de voir l'enthousiasme des gens non blasés, compréhensifs, doués de sensibilité et d'imagination. Je m'amusais, dernièrement, à Vienne, à faire pleurer mes nièces de toutes les larmes de leurs yeux... Ce sont de charmantes enfants que j'aime comme si elles étaient mes filles et qui reçoivent les impressions de la poésie comme une planche photographique reçoit celle du soleil. C'est fort extraordinaire pour deux jeunes personnes élevées dans cette province des provinces qu'on nomme Vienne, et dans le milieu le plus antilittéraire que l'on puisse imaginer.
J'ai aussi le gros volume de mes Mémoires qui vous attend. Je vous le prêterai seulement, pour le temps que Massart et vous mettrez à le lire. C'est bien triste; mais c'est bien vrai. Je suis honteux de n'avoir pas eu l'esprit de signaler dans ce long récit les douces heures que je vous dois et l'amitié sincère que je vous porte à tous les deux; mais je viens de m'apercevoir que vous n'y êtes pas nommés. C'est inexplicable; vous me battrez, vous me bouderez; mais, à mon grand regret, c'est ainsi. Et je parle de tant de crabes! Il est vrai que ce n'est pas pour les louer.
Ah! voilà une crise qui me reprend!
Laissez-moi, madame, laissez-moi, je vous en prie; laissez-moi donc, je ne puis plus écrire.
Adieu, mon cher Massart; je vous serre la main.
A LOUIS BERLIOZ.
6 novembre 1865.
Cher ami,
Je ne t'ai pas écrit hier, j'étais très souffrant et d'une humeur de dogue.
Figure-toi que l'acquéreur de mon domaine du Jacquet qui devait me payer ces jours-ci vingt mille francs, qui s'y est engagé par écrit dans le contrat, me fait dire tout simplement qu'il n'est pas en mesure et qu'il me payera une forte somme à Pâques, c'est-à-dire dans six mois et demi. C'est là que tu te mettrais en fureur... Tu vois que les écrits ne font pas plus que les paroles. Mon beau-frère me dit qu'il n'y a pas d'inquiétudes à avoir, parce que ce monsieur est riche. Mais j'aimerais mieux un pauvre qui paye qu'un riche qui ne paye pas. J'ai toujours cinq cents francs à toi, si tu m'en envoies cinq cents autres, j'achèterai des obligations ottomanes qui te rapporteront quatre-vingt-dix francs par an (pour mille francs). D'après mon calcul, l'inexactitude de mon acquéreur me fera perdre au moins neuf cents francs, puisqu'il ne me donne en revenu que 5 pour 100 et que j'eusse reçu 9 en plaçant la somme dans les obligations ottomanes.
D'ailleurs, c'est d'un sans-gêne incroyable, et ce serait curieux si la Banque de France, qui, elle aussi, est riche, s'avisait, quand on lui présente un billet, de dire qu'elle n'est pas en mesure. Allons, il faut en prendre son parti, je n'y puis rien.
Je vois que tu deviens un virtuose, et le grand navire est un instrument dont tu joues tout à fait bien. Je te fais mon compliment. Mais il t'en faut un à toi (un navire). En conséquence, travaille toujours pour l'avoir; mais, quand on te l'aura promis, n'y compte pas plus que si l'on ne t'avait rien dit. Il faut toujours dire comme Paul-Louis Courier: «Je crois que deux et deux font quatre et encore... n'en suis-je pas bien sûr.» Un avare disait aussi: «Si saint Pierre venait m'emprunter de l'argent en me donnant le Père éternel pour caution, je ne lui en prêterais pas.»
On annonce plusieurs morceaux de ma musique dans des concerts qui auront lieu cet hiver à Bruxelles. D'Ortigue a fait un grand article sur Rossini dans le Correspondant[115]. Cet écrit est fort sensé, fort juste, mais a blessé horriblement le prétendu philosophe compositeur. Un rossiniste a répondu à d'Ortigue, et Rossini a écrit à ce monsieur pour le remercier, en lui disant: «Je vous dois beaucoup pour avoir si bien lavé la tonsure de mon ami M. le curé d'Ortigue.»
AU MÊME.
Paris, 13 novembre 1865.
Cher ami,
Il est une heure. Je viens de recevoir ta lettre et j'y réponds avant de me recoucher. C'est que tu seras fort occupé le 15 et que c'est aujourd'hui le 13. J'espère que tu te débrouilleras au milieu de ce peuple de soldats et de passagers. J'approuve beaucoup ton idée d'avoir un home, un chez toi, et d'acheter des meubles; mais tu ne crains donc pas que ton vaisseau ne vienne à être enradé dans un autre endroit que Saint-Nazaire? au reste, tu ne dois pas ignorer cela. Je ne sais pas ce que tu peux avoir écrit à madame X***, mais je devine bien ce qu'elle a pu te répondre. Il faut de l'argent! n'en fût-il plus au monde. Il faut rester à terre, à Grenoble, à Claix, être juge de paix, bon citoyen, savoir vendre son blé, ses moutons, son vin, etc. Alors on est un homme calé, on joue aux boules le dimanche, on a un tas de sales enfants que les grands-parents trouvent fort mal élevés; on s'ennuie à devenir huître; on a une femme qui grossit, qui devient obèse, et qu'on finit par ne plus pouvoir souffrir; et l'on se dit: «Ah! si c'était à recommencer!»
Et alors on se sent furieux jusque dans la moelle des os; car on vieillit, on voit sa vie s'écouler bêtement; on a beaucoup d'argent qui est venu tard et dont on ne sait que faire; et puis l'on meurt gros Jean comme devant.
Oh! que je souffre! si je pouvais, comme je me sauverais à Palerme, ou au moins à Nice! Où la chèvre broute, il faut qu'elle soit attachée. Il fait un temps infâme; à trois heures et demie, il faut allumer la lampe! Ce soir est notre dîner du lundi, je me relèverai pour y aller. Je vais tâcher de dormir deux ou trois heures. Je n'ai pas reçu ces jours-ci de lettres de Genève; il est vrai que je n'en attendais pas. Quand une lettre m'arrive, cela me remonte le cœur et l'esprit.
Ah! mon pauvre Louis, si je ne t'avais pas... Figure-toi que je t'ai aimé, même quand tu étais tout petit. Et il m'est si difficile d'aimer les petits enfants! Il y avait quelque chose en toi qui m'attirait. Ensuite, cela s'est affaibli à ton âge bête, quand tu n'avais pas le sens commun; et, depuis lors, cela est revenu, cela s'est accru, et je t'aime comme tu sais, et cela ne fera qu'augmenter.
A M. ASGER HAMERIK, A COPENHAGUE.
Paris, 1er décembre 1865.
Votre lettre m'a fait bien plaisir, vous ne m'avez pas oublié! vous avez eu raison, car j'ai pour vous une affection véritable.
D'ailleurs, votre passion musicale me touche beaucoup, et bien que je ne m'intéresse plus à rien dans l'art, tant il est insulté et avili par notre horrible monde, je ne puis cependant voir sans de chaleureux élans de cœur un jeune artiste aux nobles illusions tel que vous.
Vous me rappelez ce que j'étais il y a quarante ans; vous me le rappelez surtout par votre ardent amour de la musique, par votre croyance au beau, par votre énergique volonté, par votre persévérance indomptable.
Vivez, croyez, aimez et travaillez! Méprisez le vulgaire, mais faites d'abord comme si vous ne le méprisiez pas; laissez-lui croire que vous êtes de ses amis, de ses flatteurs même; il est si bête qu'il ne s'en doutera pas!
Puis, quand vous serez devenu fort, puissant, maître, et qu'il se verra dompté, il s'écriera en vous applaudissant:
«JE L'AVAIS TOUJOURS DIT!»
Je suis constamment torturé par ma névralgie; je vis néanmoins au milieu de mes douleurs physiques et écrasé d'ennui. La mort est bien lente! cette vieille capricieuse!...
On exécutera quelques fragments de ma symphonie de Roméo et Juliette dans les prochains concerts du Conservatoire. Comment cet insolent public idiot va-t-il prendre cela?
N'importe! j'aurai au moins la joie d'entendre ce que j'ai fait de mieux, exécuté par ce merveilleux orchestre! Mais je ne conduirai pas; voilà l'absynthe, comme dit Hamlet.
Mille compliments empressés à M. Gade, dont je voudrais tant faire la connaissance. On joue dimanche prochain une de ses symphonies au concert du Cirque. Si je ne suis pas confiné dans mon lit, je ne manquerai pas d'y aller. Veuillez saluer de ma part monsieur votre père.
Savez-vous que vous avez fait de grands progrès dans la langue française? Votre lettre m'a étonné; elle contient très peu de fautes. Allons, revenez vite à Paris, et, au bout de quelques années, vous finirez par parler français presque aussi mal qu'un Parisien.
A MADAME MASSART.
30 janvier 1866.
Chère madame,
Je suis toujours enchanté quand je vois arriver une enveloppe portant les deux lettres A M (Aglaé Masson ou Massart), parce que j'éprouve toujours un plaisir extrême à lire vos billets si bien tournés, si gentils, si amicaux. (Les puristes prétendent qu'il ne faut pas employer cet adjectif au pluriel masculin; en conséquence, je l'emploie.) Cette fois, pourtant, vous m'avez fait me récrier dès votre première ligne. Vous m'appelez «cher maestro!» Pardieu! je ne suis pas maestro, ni quoi que ce soit d'italien. Si vous étiez là, je vous planterais mon grattoir dans le bras droit, si beau qu'il soit, pour vous apprendre à m'écrire des injures pareilles. Est-ce le bras qui est beau ou le grattoir? N'importe. Je n'ai pas de rancune, et, dans quelques semaines, je ne penserai plus à votre vilenie.
Je suis à vos ordres le 20 février, tous les jours, à toute heure, et quand même je ne vous l'eusse pas promis. J'irai demain, jeudi soir, vous prier de me jouer la chose, pour que je me la fourre bien dans la tête.
J'ai été très malade hier; j'ai crié comme un aigle, brait comme un âne, geint comme un petit chien, beuglé comme un veau; on m'a apporté votre lettre, je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir. Ce n'est que ce matin que je me suis donné ce plaisir. Jugez un peu....
Heureusement, je sais me résigner; mes sentiments religieux me soutiennent. Si je n'en avais pas, je serais bien à plaindre....
Vous n'êtes pas venue aux quatuors Armingaud-Jacquart, l'autre jour. Pourquoi cela?
Je vous porterai demain le volume des Mémoires; vous y verrez pourquoi je suis d'humeur si gaie.
Tout à vous et à Massart; mais ne l'appelez plus devant moi le père Massart, car cela me révolte et je me fâcherais tout bleu.
A LA MÊME.
3 septembre 1866.
Ah! mon Dieu, quel malheur! Ce matin, chère madame Massart, oui, pas plus tard que ce matin, je me suis mis à vous penser une lettre charmante, pleine d'esprit, de gracieux compliments, et d'une flatterie si fine, si ingénieuse, si adroite, que vous eussiez cru tout ce que je vous disais; je vous parlais de votre exquise bonté, de votre grâce, de votre talent, de l'affection que vous inspirez à tous ceux qui vous connaissent, des jalousies que vous excitez, de mille choses, enfin, et de vingt autres encore. Et voilà que j'ai eu le malheur de m'endormir, et qu'au réveil, je n'ai plus retrouvé le moindre souvenir de ma lettre et que me voilà obligé de vous écrire des banalités. Il y a des gens, je le sais, à qui ces choses-là sont justement les plus agréables; mais je ne crois pas que vous apparteniez à cette espèce de melons. Ainsi, résignez-vous. Je ne parlerai pourtant pas de l'immense ennui qui vous dévore dans votre petit étui de carton, d'où l'on voit la mer, dit-on. Je craindrais de vous pousser au suicide; et ce genre de désennui est extrêmement inconvenant pour une jolie femme. Mais que pouvez-vous faire pourtant? Vous avez fait le tour de Beethoven depuis si longtemps; cette année, vous avez lu Homère; vous connaissez trois ou quatre grands chefs-d'œuvre de Shakspeare; vous voyez la mer tous les jours; vous avez des amis qui viennent vous voir, un mari qui vous adore.... Que devenir, bon Dieu! que devenir? Je contribue, pour ma part, autant qu'il est en moi, à vous rendre ce séjour maritime supportable, en m'abstenant, de toutes mes forces, de vous y visiter. Je ne puis rien de plus.
On m'a, pour ainsi dire, traîné dernièrement à X..., pour y présider un concours d'orphéonistes qui ont crié à tue-tête pendant sept heures d'horloge; et vous savez que ces heures-là sont bien plus longues que celles des montres.
L'adjoint du maire a voulu m'avoir chez lui; il est venu me chercher à la gare, en voiture attelée de deux superbes chevaux; il a une maison toute neuve, bâtie hors de la ville, sur une petite éminence entourée de bois et de jardins. C'est un grand amateur de musique et un millionnaire, ce qui ne fait ni chanter ni juger faux. Il a sept enfants!
En apprenant cela, je m'étais fait un singulier portrait de leur mère. Je me figurais une femme laide, déhanchée, couperosée, tout ce qu'il y a d'affreux! Eh bien, pas du tout: elle est charmante, d'une taille droite et fine comme une aiguille anglaise; des yeux délicieux, pleins de feu; naturelle, calme mais non froide; pas trop dévote; en relations convenables mais non compromettantes avec le bon Dieu; ne gâtant point ses enfants; se mettant bien, sans idées provinciales. Et dire qu'un homme a trouvé tout cela, femme, enfants, maison, millions, en vendant du vin de Champagne!
J'allais partir pour Genève quand il m'est arrivé une lettre d'un mien cousin (François Berlioz), directeur de la manufacture de glaces de Montluçon, qui vient se marier à Paris dans huit jours et qui me demande d'être son témoin. Je lui ai répondu: «Arrive, et tu verras comme je témoigne bien.» Pouvais-je faire autrement?
Il faut, pourtant, autant qu'on le peut, assister les siens dans les circonstances difficiles!
On m'a prié aussi de diriger les études d'Alceste à l'Opéra; mais Perrin traîne tellement, pour laisser revenir le monde à Paris (comme s'il y avait un monde parisien pour Alceste!), que je vais le planter là pour quelques jours et courir à Genève; je n'y tiens plus.
Ah! chère madame, que c'est beau! que c'est beau! L'autre jour, à la première répétition d'ensemble en scène, nous pleurions tous comme des cerfs aux abois! «C'était un homme que Gluck!» disait Perrin.—Pas du tout; c'est nous qui sommes des hommes. Ne confondons pas.—Taylor disait hier à l'Institut que Gluck avait plus de cœur qu'Homère. Oui, il avait plus de fibre humaine. Et l'on va faire entendre ces sublimités à tant de plats polissons! Cela me renfonce dans mon système de l'Indifférence absolue en matière universelle, le seul raisonnable, décidément!
J'ai été fort surpris de mademoiselle Battu, qui joue et chante Alceste d'une manière sinon inspirée, du moins fort satisfaisante, et qui se perfectionne chaque jour. Villaret est un très bon Admète, et David représente on ne peut mieux le grand prêtre. Enfin, j'espère que cela ira. Vous pourriez être à Paris au mois d'octobre, à la première représentation. Tâchez.
Massart chasse-t-il, pêche-t-il, peint-il, bâtit-il?—Ce dernier verbe-là fait pitoyablement.—Songe-t-il?
Car que faire en ce gîte, à moins que l'on ne songe?
Il est couvert de gloire, cette année. Ses élèves ont eu tous les prix; il se vautre sur les lauriers. La couche, toutefois, pourrait être plus douce.
Tiens! ceci est un vers! pardon! Quels sont vos visiteurs? Bersch en est-il? dites-lui mille amitiés de ma part; Jacquart en est-il? dites-lui en mille autres.
Adieu, chère madame; excusez-moi d'avoir si longtemps divagué la plume à la main; mon sans gêne vous prouve tout au moins le plaisir que j'éprouve à causer avec vous et à vous dire tout ce qui me passe par la tête.
«Quoi qu'il arrive ou qu'il advienne», comme dit le grand poète Scribe.
Je finis ici mon scribouillage en serrant votre savante main.
A M. ERNEST REYER.
Vienne, 17 décembre [1866].
Mon cher Reyer,
Je me lève aujourd'hui lundi à quatre heures. J'ai dû rester au lit depuis hier; je n'en pouvais plus.
La Damnation de Faust a été exécutée hier dans la vaste salle de la Redoute devant un auditoire immense avec un succès foudroyant. Vous dire tous les rappels, les bis, les pleurs, les fleurs, les applaudissements de cette matinée, serait chose ridicule de ma part.
J'avais 300 choristes et 150 instrumentistes; une charmante Marguerite, mademoiselle Bettleim, dont la voix de mezzo soprano est splendide, un ténor-Faust (Walter) dont nous n'avons certainement pas l'égal à Paris, et un énergique Méphistophélès (basse) Meyerhoffer: tous les trois du grand Opéra de Vienne. Le duo d'amour entre Faust et Marguerite, supérieurement chanté, a été interrompu trois fois par les applaudissements. La scène de Marguerite abandonnée a ému encore plus. Les Sylphes, les Follets, le chant de la Fête de Pâques et l'Enfer et le Ciel ont littéralement révolutionné mes bienveillants auditeurs. Helmesberger (le directeur du Conservatoire) a joué d'une façon toute poétique le petit solo d'alto dans la ballade du Roi de Thulé si bien chantée par mademoiselle Bettleim.
Ma chambre ne désemplit pas depuis hier de visiteurs, de complimenteurs. Ce soir, on me donne une grande fête à laquelle assisteront deux ou trois cents personnes, artistes et amateurs; entre autres mes cent quarante dames (amateurs) qui ont si bien chanté mes chœurs. Quelles voix fraîches et justes! et comme tout cela avait été bien instruit par le directeur de la Société des amis de la musique, Herbeck, un chef d'orchestre de premier ordre, qui s'est mis en quatre, en seize, en trente-deux pour moi, et qui a eu le premier l'idée de monter en entier mon ouvrage.
Demain, je suis invité par le Conservatoire, qui veut me faire entendre, sous la direction d'Helmesberger, ma symphonie d'Harold.
Que vous dirai-je? c'est la plus grande joie musicale de ma vie; il faut me pardonner si je vous en parle si longuement. Il était venu des auditeurs de Munich et de Leipzig.
Walter (Faust) sort d'ici, il est venu m'embrasser encore. Oh! comme il a dit l'air dans la chambre de Marguerite et surtout la phrase: «Que j'aime ce silence!»
Enfin, voilà une de mes partitions sauvée. Ils la joueront maintenant à Vienne sous la direction d'Herbeck, qui la sait par cœur. Le Conservatoire de Paris peut continuer à me laisser dehors! Qu'il se renferme dans son ancien répertoire!
Vous m'avez vous-même demandé de vous écrire et vous vous êtes attiré cette algarade.
Adieu; on m'a demandé de Breslau pour aller y diriger Roméo et Juliette; mais il faut que je me retrouve à Paris avant la fin du mois.
A M. FERDINAND HILLER.
Paris, 12 janvier 1867.
Mon cher Hiller,
Vous serait-il possible, pour que je ne me présente pas au public de Cologne seulement avec de la musique instrumentale, de placer dans le programme du 26 février, un duo nocturne pour deux femmes (un soprano et un contralto). Ce petit morceau de Béatrice et Bénédict a fait partout un grand effet; il n'est pas difficile; il faudrait que les cantatrices fussent des oies, pour ne pas chanter cela convenablement. Il est vrai que nous rencontrons souvent de pareils volatiles. Mais voyez s'il y aurait moyen de trouver dans votre cercle musical les deux chanteuses capables de cet effort. Je vous enverrais alors les exemplaires du duo, avec paroles allemandes, et je porterais ensuite moi-même les parties d'orchestre. Si vous trouvez la chose imprudente ou seulement difficile, qu'il n'en soit pas question. J'attends votre réponse.
Dites-moi aussi à quelle époque précise je devrai me trouver à Cologne, et combien vous me donnerez de répétitions pour la Symphonie. Le duo pourra aller avec une seule, si les chanteuses savent bien leur affaire.
J'irai loger à l'hôtel Royal, où je suis déjà descendu plusieurs fois. Je serai ainsi bien plus libre de rester couché tant qu'il me plaira; car je suis un des hommes les plus couchés qui existent. Il est vrai que j'existe bien peu. Malgré les joies musicales du séjour, ce voyage à Vienne et les nombreuses répétitions que j'ai dû y faire m'ont exténué et à moitié tué. Les médecins homœopathes ou allopathes, pas plus que ceux qui soignent leurs patients par l'une ou l'autre méthode (à la volonté des personnes), les docteurs à double détente n'y peuvent rien. Je tâchera pourtant d'être un peu mieux portant pour aller vous voir; sinon, je serai bien insupportable.
AU MÊME.
Paris, 8 février 1867.
Mon cher Hiller,
Vous êtes le plus excellent camarade que l'on puisse trouver. Je ferai ce que vous me dites: je vais tâcher d'acquérir quelques forces, et, le 23 de ce mois, je partirai pour Cologne, où je serai à l'hôtel Royal le soir. Mais ne me retenez pas DES chambres, comme vous dites, UNE petite chambre me suffira. Si j'étais incapable de me mettre en route, je vous enverrais les parties d'orchestre du duo, et vous en seriez quitte pour conduire le tout. Vous me parlez comme les médecins: «C'est une névralgie». Ainsi, madame Sand ayant fait remarquer à son jardinier qu'un mur de son jardin s'était écroulé: «Oh! ce n'est rien, madame, lui répondit-il, c'est la gelée qui en est cause.—Oui, mais il faut le faire rebâtir.—Oh! ce n'est rien, c'est la gelée.—Je ne dis pas non, mais il est à terre.—Ne vous tourmentez pas, madame, c'est la gelée.»
Tâchez que votre jeune soprano ne
me fasse pas le stupide changement sur
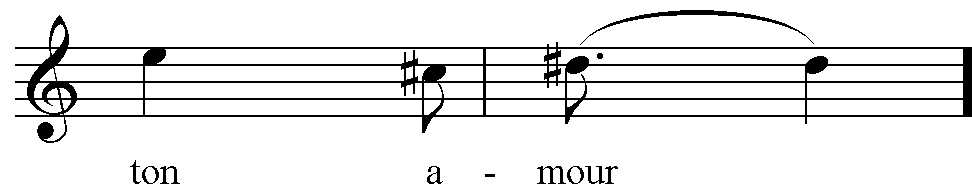 .
Il n'y a que les cantatrices
pour avoir de pareilles idées.
.
Il n'y a que les cantatrices
pour avoir de pareilles idées.
A bientôt; je ne puis plus écrire, je vais me recoucher.
A MADAME DAMCKE, A MONTREUX (SUISSE).
Paris. Je ne sais pas le quantième. [24 septembre 1867].
Chère madame Damcke,
Je vous eusse bien écrit depuis mon retour, mais je ne savais pas où adresser ma lettre. Je vous remercie donc doublement de la vôtre.
Voici ma réponse laconique: je suis toujours malade.
Arrivé à Néris, j'ai pris cinq bains; au cinquième, le médecin en m'entendant parler et me tâtant le pouls: «Sortez vite, s'est-il écrié, les eaux vous sont contraires; vous allez avoir une laryngite; il faut vous en aller en un lieu où vous soignerez bien votre gorge; diable! ce n'est pas une chose légère!»
Je suis parti, le soir même. J'ai failli étouffer en chemin de fer dans une quinte de toux. Puis je suis arrivé à Vienne où mes nièces m'ont comblé de soins. J'étais presque toujours couché. Enfin, la voix naturelle m'est à peu près revenue, le mal de gorge a fui; mais ma névralgie aussi est revenue, plus féroce que jamais.
On m'a fait rester à Vienne un mois, parce que l'aînée de mes nièces se mariait et qu'elle me voulait pour témoin.
Elle a épousé un chef de bataillon, charmant sous tous les rapports; sans quoi je n'eusse pas témoigné. Après le dîner de noces, ils sont partis pour un long voyage dans le sud de la France; sans quoi encore je n'eusse pas témoigné.
Nous étions trente-deux gens de la noce, venus de tous les coins de la famille, de Grenoble, de Tournon, de Saint-Geoire, etc., etc.; nous nous sommes tous retrouvés là, moins un, hélas!...
C'est le plus vieux que j'ai eu le plus de plaisir à revoir; mon oncle le colonel, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Nous avons bien pleuré en nous revoyant; il semblait honteux de vivre...; je le suis bien davantage.
Me voilà à Paris maintenant, presque toujours couché comme à Vienne. Et dernièrement, la grande-duchesse Hélène de Russie m'a fait entortiller pour aller à Saint-Pétersbourg; elle a voulu me voir, et enfin j'ai consenti. Je partirai le 15 novembre pour aller diriger six concerts du Conservatoire, dont un de ma musique.
La princesse paye mon voyage, aller et retour, met une de ses voitures à ma disposition, me loge chez elle au palais Michel et me donne quinze mille francs. Au moins, si j'en meurs, je saurai que cela en valait la peine.
J'ai écrit à votre mari, l'autre jour, une lettre que je n'ai pas envoyée, faute d'adresse, pour lui demander si je ne lui ai pas prêté ma belle partition d'Orphée de Leipzig. Je ne puis plus la trouver; je suis allé chez Heller, je lui ai laissé ma carte; je n'ai point de ses nouvelles.
Adieu, madame; je vous serre la main en vous envoyant à tous les deux mille amitiés.
A M. ET MADAME MASSART.
Paris, 4 octobre 1867.
Eh bien, oui, je vais en Russie. La grande-duchesse Hélène était ici il y a quelques jours et m'a fait faire des propositions que, après un peu d'hésitation et de l'avis de tous mes amis, j'ai acceptées. Il s'agit d'aller, à la fin de novembre, diriger, à Saint-Pétersbourg, six concerts du Conservatoire, dont cinq formés des chefs-d'œuvre des grands maîtres et un composé exclusivement de mes partitions.
Elle me loge chez elle, au palais Michel, me fournit une de ses voitures, paye mon voyage, aller et retour, et me donne quinze mille francs. Je serai exténué de fatigue, malade comme je suis; mais, si je meurs, nous le verrons bien. Venez donc aussi; je vous ferai jouer votre jovial concerto de clavecin en ré mineur de S. Bach et nous rirons d'une belle manière.
Adieu; mille amitiés pour tous les deux; j'irais bien chez vous dans les beaux jours que vous passez à Villerville, mais je vous avoue que cela me paraît d'une indiscrétion révoltante.
Ma belle-mère vous remercie de votre souvenir. A vous.
P.-S.—Vous êtes, décidément, une néréide ou une tritonne.
Vous saurez encore qu'un Américain dont j'avais refusé les offres, il y a un mois et demi, apprenant que j'acceptais celles des Russes, est revenu, il y a trois jours, m'offrir cent mille francs, si je voulais aller à New-York l'année prochaine. Que dites-vous de cela? En attendant, il fait faire ici mon buste en bronze pour une superbe salle qu'il a fait bâtir là-bas; et je vais poser tous les jours. Si je n'étais pas si vieux, tout cela me ferait plaisir.
Avez-vous lu les comptes rendus du festival de Meiningen, en Allemagne? Cela aussi m'aurait fait plaisir, si je ne souffrais pas tant et si je n'étais pas si vieux. Oui, vous en avez lu quelqu'un; votre lettre me l'annonce. J'ai vu des gens qui y étaient. N'avez-vous pas honte d'aller encore massacrer des faisans? La belle chose que de tuer de la volaille dans une basse-cour!!!
Adieu; cela ne fait rien, j'ai toujours pour vous, quand même, une véritable et chaleureuse amitié; vous êtes, tous les deux, des cœurs excellents, que j'apprécie chaque jour davantage.
AUX MÊMES.
Paris, 2 novembre 1867.
Comment vous portez-vous, châtelain et châtelaine?
Comment se porte votre château?
Savez-vous encore le français?
Savez-vous encore la musique?
Savez-vous encore vivre?
Savez-vous que vous ne savez rien?
Savez-vous qu'on vous a oubliés?
Savez-vous qu'on se passe de vous?
Savez-vous que vous êtes passés
De mode?
Bonsoir!
2 novembre, jour des morts.
Et quand on est mort, c'est pour longtemps.
A M. ÉDOUARD ALEXANDRE.
Saint-Pétersbourg, 15 décembre 1867.
Chers amis,
Vous êtes bien bons de me donner ainsi de vos nouvelles, et j'ai l'air bien oublieux de ne pas vous avoir encore donné des miennes. On me comble d'attentions, d'applaudissements, depuis la grande-duchesse jusqu'au moindre musicien de l'orchestre.
On a su, je ne sais comment, que le 11 décembre était le jour de ma naissance, et j'ai reçu des cadeaux charmants; et, le soir, j'ai dû assister à un dîner de 150 couverts, où, comme vous le pensez bien, les toasts n'ont pas manqué. Le public et la presse sont d'une ardeur extrême. Au second concert, j'ai été rappelé six fois après la Symphonie fantastique qui avait été exécutée d'une manière foudroyante et dont la quatrième partie avait été bissée.
Quel orchestre! quelle précision! quel ensemble! Je ne sais pas si Beethoven s'est jamais entendu exécuter de la sorte. Aussi faut-il vous dire que, malgré mes souffrances, quand j'arrive au pupitre et que je me vois entouré de tout ce monde sympathique, je me sens ranimé et je conduis comme jamais, peut-être, il ne m'arriva de conduire.
Hier, nous avions à exécuter le second acte d'Orphée, la symphonie en ut mineur et mon ouverture du Carnaval romain. Tout cela a été sublimement rendu. La jeune personne qui chantait Orphée (en russe) a une voix incomparable et s'est très bien acquittée de son rôle. Il y avait 130 choristes. Tous ces morceaux ont obtenu un merveilleux succès. Et ces Russes, qui ne connaissent Gluck que par d'horribles mutilations faites par-ci par-là, par des gens incapables!!! Ah! c'est pour moi une joie immense de leur révéler les chefs-d'œuvre de ce grand homme. Hier, on ne finissait pas d'applaudir. Nous donnerons dans quinze jours le premier acte d'Alceste. La grande-duchesse a ordonné que l'on m'obéît en tout; je n'abuse pas de son ordre, mais j'en use.
Elle m'a demandé de venir, un de ces soirs, lui lire Hamlet. J'ai parlé l'autre jour, devant elle, à ses dames d'honneur, du livre de Saint-Victor, et voilà maintenant Son Altesse et tout ce monde qui va acheter Hommes et Dieux et l'admirer.
Ici, on aime ce qui est beau; ici on vit de la vie musicale et littéraire; ici, on a dans la poitrine un foyer qui fait oublier la neige et les frimas. Pourquoi suis-je si vieux, si exténué?
Adieu, tous; je vous serre la main; je vous embrasse.
A M. ET MADAME MASSART.
Saint-Pétersbourg, 22/10 décembre 1867.
Chère madame Massart,
Je suis malade comme dix-huit chevaux; je tousse comme six ânes morveux et, avant de me recoucher, je veux pourtant vous écrire.
Nos concerts marchent à merveille. Cet orchestre est superbe et fait ce que je veux; si vous entendiez les symphonies de Beethoven exécutées par lui, vous diriez, je crois, bien des choses que vous ne pensez pas au Conservatoire de Paris. Ils m'ont joué, avec la même perfection, l'autre jour, la Fantastique qu'on avait demandée, et qu'il a fallu introduire dans le programme du second concert. C'était foudroyant. Nous avions fait trois répétitions. On a redemandé à grands cris la Marche au supplice; et l'adagio (la Scène aux champs) a fait pleurer bien des gens, sans vergogne. Samedi prochain, nous dirons l'Héroïque et le second acte d'Alceste, avec l'Offertoire de mon Requiem (le chœur sur deux notes). A l'autre (5me concert), je donnerai les trois premières parties instrumentales de la Symphonie avec chœurs de Beethoven. Je n'ose pas risquer la partie vocale, les chanteurs dont je dispose ne m'inspirant pas assez de confiance... On est venu me chercher de Moscou, où j'irai après le 5me concert d'ici, madame la grande-duchesse m'en ayant donné la permission. Ces messieurs de la capitale mezzo-asiatique ont des arguments irrésistibles, quoi qu'en dise Wieniawski, qui trouve que je n'aurais pas dû accepter simplement leur proposition. Mais je ne sais pas liarder, et j'aurais honte de le faire. Voilà qu'on m'interrompt dans mon salon où je suis seul à vous écrire, parce que madame la grande-duchesse donne ce soir une soirée musicale où elle veut entendre mon duo de Béatrice et Bénédict, que l'accompagnateur et les deux cantatrices savent à merveille (en français). Je viens donc d'envoyer, chez Son Altesse, la partition, en recommandant aux trois virtuoses de n'avoir pas peur, parce qu'ils savent tout à fait leur affaire. Moi, je vais me recoucher.
Madame la grande-duchesse veut que je lui lise Hamlet un de ces soirs, mais je n'en aurais pas trop la force maintenant. On m'a donné un dîner de cent cinquante couverts le jour de ma fête (11 décembre), où toutes les têtes musicales de Pétersbourg étaient réunies. Vous pensez, avec effroi, aux toasts auxquels il m'a fallu répondre. Il y a encore bien des choses que je vous raconterais volontiers, si je n'étais pas si exténué; mais il est neuf heures et je n'ai pas l'habitude d'être hors de mon lit à des heures aussi indues.
D'ailleurs, je vous narrerai cela quand vous viendrez dîner avec moi au café Anglais.
Bien des choses à Massart, à Jacquard et à tous les arts qui, chez vous, se donnent la main.
Adieu, adieu, adieu. Remember me.
Vous savez toujours l'anglais?...
Je vais prendre trois gouttes de laudanum pour tâcher de m'endormir.
Vous savez que vous êtes charmante; mais pourquoi diable êtes-vous si charmante?
Je ne le découvre pas.
Farewell. I am your.
A M. DAMCKE.
Moscou, 31 décembre 1867.
Mon cher Damcke,
J'étais si fatigué ces jours-ci, que je n'avais pas le courage de vous écrire; et pourtant il m'est arrivé un grand événement musical. Les directeurs du Conservatoire de Moscou sont venus me chercher à Saint-Pétersbourg et ont obtenu de la grande-duchesse un congé de douze jours pour moi. J'ai accepté l'engagement de diriger deux concerts.
Ne trouvant pas une salle assez grande pour le premier, ils ont eu l'idée de le donner dans la salle du Manège, un local grand comme la salle du milieu de notre Palais de l'Industrie, aux Champs-Élysées. Cette idée qui me paraissait folle a obtenu le plus incroyable succès.
Nous étions cinq cents exécutants et il y avait, au compte de la police, douze mille cinq cents auditeurs.
Je n'essayerai pas de vous décrire les applaudissements pour la Fête de Roméo et Juliette et pour l'Offertoire du Requiem. Seulement, j'ai éprouvé une mortelle angoisse quand ce dernier morceau, qu'on avait voulu absolument, à cause de l'effet qu'il avait produit à Pétersbourg, a commencé. En entendant ce chœur de trois cents voix répéter toujours ses deux notes, je me suis figuré tout de suite l'ennui croissant de cette foule, et j'ai eu peur qu'on ne me laissât pas achever. Mais la foule avait compris ma pensée, son attention redoublait et l'expression de cette humilité résignée l'avait saisie.
A la dernière mesure, une immense acclamation a éclaté de toutes parts; j'ai été rappelé quatre fois; l'orchestre et les chœurs s'en sont ensuite mêlés; je ne savais plus où me mettre. C'est la plus grande impression que j'aie produite dans ma vie. On a aussitôt envoyé une dépêche à la grande-duchesse pour l'informer de cette émotion populaire...
Après-demain, on me donne une fête dans la salle de l'assemblée des Nobles, où sera toute la ville artiste de Moscou. Après quoi, je repartirai pour Saint-Pétersbourg... Je suis bien exténué, mais heureux aussi de ce beau résultat. Adieu, mon cher ami; je vous embrasse de tout mon cœur.
Je remercie bien Heller d'avoir été assez bon pour m'envoyer le volume des Mémoires. Malgré nos précautions, le livre a mis douze jours pour arriver entre mes mains. Je n'ai pu le remettre à la princesse que le jour de mon départ pour Moscou.
Si vous avez un instant pour voir Reyer, faites-le. Adieu à madame Damcke, dont je n'ai pas encore vu la sœur.
A M. ET MADAME MASSART.
Saint-Pétersbourg, 18 janvier 1868.
Chère madame Massart,
J'arrive de Moscou et, en rentrant dans mon salon, je trouve un petit monceau de lettres, au nombre desquelles la vôtre ne me cause pas la plus vive joie, parce qu'il y en a une autre, vous devinez de qui, que je n'espérais pas. La vôtre, cependant, m'a fait bien plaisir. Elle aurait dû me laisser indifférent; mais, quoi! on n'est pas parfait. J'ai lu, tout de même, vos lignes si cordiales et j'y réponds aujourd'hui. La place Michel est silencieuse sous son manteau de neige; les corbeaux, les pigeons et les moineaux ne remuent pas; les traîneaux ne courent pas; il y a un grand enterrement, celui du prince Dolgorouki, où va l'empereur avec toute la cour et auquel, en conséquence, tout le monde assiste.
Mon programme du concert de samedi prochain est fixé. Je n'y suis pour rien, heureusement; car, au suivant et dernier, je serai pour tout. Oh! quelle joie quand j'aurai battu la dernière mesure du final d'Harold! quand je pourrai me dire: «Je pars pour Paris dans trois jours, c'est-à-dire au commencement de février.» Je ne puis résister à ce climat. J'ai moins souffert à Moscou. Et quels enthousiasmes! Le premier concert avait lieu dans la salle du Manège; il y avait dix mille six cents auditeurs. Et quand j'ai vu tout ce monde acclamer l'Offertoire de mon Requiem avec son chœur sur deux notes, et me redemander sans fin, j'avoue que ce sentiment religieux si rare, manifesté par une foule immense, m'a remué jusqu'au cœur. Au second concert qui avait lieu avec les seules ressources du Conservatoire, dans la salle des Nobles, l'Offertoire avait été redemandé et il a produit le même effet.
Que me parlez-vous de vous donner un concert à Paris? Si je donnais un concert à mes amis, en dépensant purement trois mille francs, je n'en serais que plus injurié par la presse.
Après vous avoir vus à Paris, j'irai à Saint-Symphorien et de là à Monaco me baigner dans les violettes et dormir au soleil. Je souffre tant, chère madame, mes maux sont si constants, que je ne sais que devenir. Je voudrais ne pas mourir maintenant, j'ai de quoi vivre.
Dites mille choses à Massart et remerciez de son bon souvenir madame Nicolet, si charmante.
Adieu, adieu; je vous serre la main.
A M. WLADIMIR STASSOFF[116].
Paris, dimanche 1er mars 1868.
Je ne vous ai pas écrit depuis mon retour, je souffrais horriblement. Aujourd'hui, je vais un peu mieux et je viens vous dire bonjour en vous annonçant mon départ pour Monaco. Je partirai ce soir à sept heures. Je ne sais pas pourquoi je ne meurs pas. Puisqu'il en est ainsi, je vais revoir ma chère côte de Nice et les rochers de Villefranche et le soleil de Monaco. Hier, je me suis traîné à l'Académie, où j'ai vu mon statuaire et confrère Perraud[117]. Il m'a appris que l'Américain Steinway l'avait enfin payé pour mon buste et qu'on était en ce moment occupé à en couler trois exemplaires plus grands que nature pour New-York et Paris. Je crois bien que c'est vous qui m'avez témoigné le désir d'en avoir un pour le Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Si ce n'est pas vous, c'est Kologrivoff[118], ou Cui[119], ou Balakireff[120]. En tout cas, sachez et faites-leur savoir que M. Perraud m'a appris qu'on pourrait couler encore d'autres exemplaires de ce buste... Écrivez-moi rue de Calais, nº 4, à Paris. On m'enverra votre lettre à Nice ou à Monaco. Mais il serait mieux encore d'écrire à M. Perraud, statuaire, membre de l'Académie des Beaux-Arts, à l'Institut, Paris. Vous lui direz ce que vous voulez et quand vous le voudrez. Et ce sera plus prompt. Oh! quand je pense que je vais m'étendre sur les gradins de marbre de Monaco, au soleil, au bord de la mer!!!...
Ne soyez pas trop juste, écrivez-moi malgré mon laconisme; songez que je suis malade, que votre lettre me fera du bien et ne me parlez pas de composer, ne me dites pas de bêtises... Assurez-moi que vous m'avez rappelé au souvenir de votre charmante belle-sœur, de votre gracieuse fille et de votre frère. Je les vois tous les trois comme s'ils étaient là.
La musique... Ah! j'allais vous dire quelque chose sur la musique, mais j'y renonce.
Adieu, écrivez-moi vite, votre lettre me fera renaître et aussi le SOLEIL... Pauvre malheureux! vous habitez la neige!...
AU MÊME.
Paris, avril 1868.
Mon cher Stassoff,
Vous m'avez appelé monsieur Berlioz dans votre dernière lettre et Cui aussi; je vous pardonne à tous les deux.
Figurez-vous que vos deux lettres sont à refaire. Vous ne savez pas que j'ai failli mourir. Je suis allé à Monaco pour chercher le soleil, et, trois jours après mon arrivée j'ai voulu parcourir des rochers qui descendent à la mer et ma témérité a été cruellement punie; je suis tombé dans ces rochers la tête la première, sur la figure, et j'ai versé beaucoup de sang, tellement que je suis resté seul à terre et n'ai pu revenir à l'hôtel que longtemps après et tout sanglant. J'avais retenu ma place à l'omnibus de Nice; j'ai voulu néanmoins revenir le lendemain. Je suis revenu, et, à peine arrivé, j'ai voulu revoir la terrasse qui est sur le bord de la mer et dont j'avais conservé un très vif souvenir. J'y vais, je ne vois pas bien la mer, je veux changer de banc pour mieux voir, je me lève et, au bout de trois pas, je tombe de nouveau sur la figure et je verse mon sang comme un malheureux. Deux jeunes gens qui passaient me relèvent à grand-peine et me reconduisent à l'hôtel des Étrangers, tout près de là, où je demeurais. On me déshabille, on me couche et je reste sans voir ni médecin ni personne que les domestiques pendant huit jours. Ah! ma foi, je ne puis plus écrire. A demain... je n'ai plus la force. Bonsoir.
...Après huit jours de cette claustration, je me sens un peu mieux, et, la figure toute décomposée, je prends le chemin de fer et reviens à Paris. Ma belle-mère et ma domestique poussent des cris en me voyant. Cette fois, je fais venir un médecin et il m'a soigné si bien, que, après un mois et quelques jours, je puis à peu près marcher en me tenant aux meubles. Voilà où j'en suis. Mon nez est presque guéri à l'extérieur.
Voulez-vous être assez bon pour me dire pourquoi on ne m'a pas renvoyé ma partition des Troyens? Je suppose qu'elle est copiée et qu'on n'en a plus besoin.
Je ne puis plus écrire;... si j'attends que je me trouve bien, ce sera peut-être long... Écrivez-moi vous-même. Ce sera une charité.
A M. AUGUSTE MOREL.
Paris, 26 mai 1868.
Mon cher Morel,
Je viens d'apprendre par Lecourt que vous m'aviez écrit à Monaco et qu'on vous avait renvoyé votre lettre. Merci de cette attention. J'ai été bien éprouvé et j'ai encore, en ce moment, bien de la peine à écrire. Ne soyez pas étonné si je ne vous ai rien dit; mes deux chutes, l'une à Monaco, l'autre à Nice, m'avaient ôté toutes mes forces. A présent, les suites directes de ces deux chutes sont à peu près effacées; mais ma maladie est revenue et je souffre plus que jamais. Je n'ai que des choses cruelles à vous écrire. Je suis allé en Russie pour me distraire un peu et j'ai assez bien supporté le double voyage à Moscou et à Saint-Pétersbourg; ils m'ont fêté de toutes les manières. La grande-duchesse m'a comblé de soins et d'attentions. J'ai dirigé six concerts du Conservatoire de Pétersbourg et deux de Moscou. Maintenant je ne pense à rien; je vous vois désenchanté comme moi, Lecourt tout comme vous; j'aurais eu un grand plaisir à vous voir tous les deux, quand j'étais dans les environs de Marseille, et j'y serais allé en revenant de Nice, si je n'avais pas été en si mauvais état. Mais le moyen? et puis je serais bien plus brisé par votre société que par toute autre. Peu de mes amis ont aimé Louis comme vous l'aimiez. Et je ne puis oublier. Pardonnez-moi tous les deux.
A M. WLADIMIR STASSOFF.
Paris, 21 août 1868.
Mon cher Stassoff,
Vous le voyez, je supprime le «Monsieur»; j'arrive de Grenoble où l'on m'a fait aller à peu près de force pour présider une espèce de festival orphéonique et assister à l'inauguration d'une statue de l'empereur Napoléon Ier.
On a bu, on a mangé, on a fait les cent coups et j'étais toujours malade...! On est venu me chercher en voiture, on m'a porté des toasts auxquels je ne savais que répondre. Le maire de Grenoble m'a comblé de gracieusetés, il m'a donné une couronne en vermeil, mais il m'a fallu rester une heure entière à ce commencement de banquet.
Le lendemain, je suis parti; je suis arrivé exténué chez moi, à onze heures du soir...
Je n'en puis plus, et je reçois des lettres... où l'on me demande des choses impossibles. On veut que je dise beaucoup de bien d'un artiste allemand, bien que je pense en effet, mais à condition que je dirai du mal d'un artiste russe qu'on veut remplacer par l'Allemand et qui a droit au contraire, à beaucoup d'éloges, chose que je ne ferai pas. Quel diable de monde est-ce là?
Je sens que je vais mourir; je ne crois plus à rien, je voudrais vous voir; vous me remonteriez peut-être; Cui et vous me donneriez peut-être du bon sang.
Que faire?
Je m'ennuie d'une manière exorbitante. Il n'y a personne à Paris; tous mes amis sont absents, à la campagne, à leur campagne, à la chasse; il y en a qui m'invitent à aller chez eux. Je n'en ai pas la force.
Que devenez-vous? Et votre frère? Et vos charmantes dames?
Oh! je vous en prie, écrivez-moi aussi laconiquement que vous voudrez. J'ai pourtant encore des suites de ma chute dans les rochers de Monaco; Nice me donne aussi des souvenirs.
Ma lettre va vous trouver peut-être absent; je m'attends à tout.
Si vous êtes à Pétersbourg, écrivez-moi six lignes; je vous en saurai un gré infini.
Mille choses à Balakireff.
Adieu, j'ai beaucoup de peine à écrire.
Vous êtes bon, montrez-le-moi encore.
Je vous serre la main.
A SA SŒUR[121].
Paris, 20 février 1822.
...Nous fîmes un dîner charmant avec le cousin Raimond et mon oncle. Après, nous allâmes à Feydeau entendre Martin. On jouait ce soir-là Azémia et les Voitures versées. Ah! comme je me dédommage des violons et du flageolet du bal de M. T...! J'absorbais la musique! Je pensais à toi, ma sœur! Quel plaisir tu aurais à entendre cela! l'opéra te ferait peut-être moins plaisir; c'est trop savant pour toi, au lieu que cette musique touchante, enchanteresse de Dalayrac, la gaîté de celle de Boïeldieu, les inconcevables tours de force des actrices, la perfection de Martin et de Ponchard... oh! tiens! je me serais jeté au cou de Dalayrac si je m'étais trouvé à côté de sa statue, quand j'ai entendu cet air auquel on ne peut point donner d'épithète: «Ton amour, ô fille chérie!»
C'est à peu près la même situation que celle que j'ai éprouvée en entendant à l'Opéra, dans Stratonice, celui de: «Versez tous vos chagrins dans le sein paternel.» Mais je n'entreprends pas de te décrire encore cette musique... (la fin manque).
A M. LESUEUR, MEMBRE DE L'INSTITUT, SURINTENDANT
DE LA CHAPELLE DU ROI.
(Sans date—vers 1825—de la Côte-Saint-André.)
Monsieur,
Depuis longtemps, j'étais tourmenté du désir de vous écrire, et je n'osais le faire, retenu par une foule de considérations qui me paraissent, à présent, plus ridicules les unes que les autres. Je craignais de vous importuner par mes lettres, et que mon désir de vous en adresser ne vous parût avoir sa source dans l'amour-propre qu'un jeune homme doit naturellement ressentir en correspondant avec un de ces hommes rares qui honorent leur pays. Mais je me suis dit: cet homme rare auquel je brûle d'écrire trouvera peut-être mes lettres moins importunes si l'art sur lequel il répand tant d'éclat en est la matière; ce grand musicien a bien voulu me permettre de suivre ses leçons, et, si jamais les bontés d'un maître, la reconnaissance et l'amour filial de ses élèves lui ont acquis sur eux le titre de père, je suis du nombre de vos enfants.
J'ai été reçu dans ma famille comme je m'y attendais, avec beaucoup d'affection. Je n'ai point eu à essuyer de la part de ma mère de ces malheureuses et inutiles remontrances, qui ne faisaient que nous chagriner l'un et l'autre; cependant papa m'a recommandé, par précaution, de ne jamais parler musique devant elle. J'en cause, au contraire, très-souvent avec lui. Je lui ai fait part de vos curieuses découvertes, que vous avez bien voulu me montrer, sur la musique antique. Je ne pouvais pas venir à bout de lui persuader que les anciens connussent l'harmonie; il était tout plein des idées de Rousseau et des autres écrivains qui ont accrédité l'opinion contraire. Quand je lui ai cité le passage latin de Pline l'ancien, dans lequel il y a des détails sur la manière d'accompagner les voix et sur la facilité que l'orchestre peut avoir à peindre les passions par le moyen de rhythmes différents de celui de la vocale, il est tombé des nues et m'a avoué qu'il n'y avait rien à répliquer à une pareille explication. Cependant, m'a-t-il dit, je voudrais avoir l'ouvrage entre les mains pour être bien convaincu.
Je n'ai encore rien fait depuis que je suis ici. D'abord, je n'ai pas été maître de mon temps pendant les premières semaines. Les visites à recevoir et à rendre, dans une petite ville où tout le monde se connaît, me l'absorbaient presque en entier. Puis, quand j'ai voulu me mettre à cette messe dont je vous avais parlé, je suis demeuré si froid, si glacé en lisant le Credo et le Kyrie, que, bien convaincu que je ne pourrais jamais rien faire de supportable dans une pareille disposition d'esprit, j'y ai renoncé. Je me suis mis à retoucher cet oratorio du Passage de la mer Rouge que je vous ai montré et que je trouve à présent terriblement barbouillé dans certains endroits. J'espère pouvoir le faire exécuter à Saint-Roch, à mon retour, qui aura lieu, je crois, avant les premiers jours d'août.
En attendant que j'aie le plaisir de vous revoir, monsieur, mon père me charge d'être l'interprète de ses sentiments auprès de vous, et de vous témoigner toute sa reconnaissance pour les soins que vous m'avez prodigués; vous ne doutez pas, monsieur, que je n'en sois pénétré moi-même. Veuillez en recevoir l'assurance avec mes salutations respectueuses.
A M. BERLIOZ, A LA COTE-SAINT-ANDRÉ.
Paris ce 10 mai [1828].
Mon excellent père,
Que je vous remercie de votre lettre! Quel bien elle m'a fait! Vous commencez donc à prendre un peu de confiance en moi! Puissé-je la justifier! C'est la première fois que vous m'écrivez sur ce ton, et mille fois je vous en remercie; c'est un si grand bonheur de pouvoir faire honneur et plaisir à ceux qui nous sont chers. Oh! certes, oui, je serais enchanté de pouvoir me faire entendre de vous; mais pour un voyage de vous à Paris, il faut quelque chose de plus positif et de plus assuré qu'un concert qui peut être empêché par le plus léger caprice des hommes du pouvoir. J'attends depuis huit jours, dans une mortelle impatience, la permission de M. Mangin, le préfet de police, pour faire afficher le concert; je dois retourner seulement demain pour savoir si on m'accorde l'autorisation. Il faut passer par les mains des chefs et sous-chefs de division, qui ont l'air de faire une affaire d'État de ce qui n'est qu'une formalité. Dans mes deux précédents concerts, je m'en étais dispensé; mais, comme cette fois, c'est le soir et dans un théâtre, les directeurs des Nouveautés ne veulent point prendre d'engagement décisif avec moi, avant d'avoir la pièce officielle de la police. D'un autre côté, M. de La Rochefoucauld pourrait, s'il voulait, empêcher ma soirée d'avoir lieu, car, dans ce pays de liberté, les musiciens sont au nombre des esclaves. D'un autre côté, le succès de ma symphonie n'est pas sûr; le public sera moins musical dans cette saison que dans l'hiver; toute la haute société qui a une espèce d'éducation musicale est à la campagne, et je doute que l'originalité de mon drame musical inspire assez d'intérêt pour faire revenir à Paris des gens de sang aussi froid. Puis, j'ai un autre sujet d'inquiétude, c'est celui de l'exécution: mon orchestre va être obligé de se frayer une route à travers une forêt vierge. Outre qu'il y a beaucoup de choses nouvelles pour eux, la plus grande difficulté est celle de l'expression. La première partie, surtout, est d'une telle fougue dans le mouvement et d'une si grande intensité de sentiment, qu'avant de pouvoir leur inculquer toutes mes intentions et qu'ils puissent les rendre, il faudra une patience angélique de la part du chef d'orchestre et un nombre très-considérable de répétitions. Heureusement, ce n'est pas plus difficile que l'ouverture des Francs-Juges (que je redonne encore), et elle a été sublimement exécutée.
Je suis déjà vos instructions quant au régime; je mange ordinairement peu et ne bois presque plus de thé.
Je ne fais depuis quelques jours, que corriger des parties d'orchestre, surveiller mes copistes, copier moi-même. Le soir, je vais au théâtre allemand, où le directeur a eu la politesse de me donner mes entrées, sans que je les aie, en aucune manière, demandées. Je compte sur l'incroyable chanteur Haitzinger pour chanter à mon concert et compléter le programme. Je l'ai vu ces jours-ci; il m'a demandé si j'avais un rôle important pour sa voix dans l'opéra des Francs-Juges (que je ne pourrai jamais monter à Paris); et, sur l'assurance que je lui en ai donnée, il m'a engagé beaucoup à venir en Allemagne, où il me serait beaucoup plus aisé de le faire exécuter, mais je ne puis pas encore m'occuper de le faire traduire en allemand. Voilà mon plan: si ces messieurs de l'Institut me croient digne d'obtenir un des deux grands prix, si je puis me faire assez petit pour passer par la porte du royaume des cieux, je resterai aussi peu de temps que possible en Italie, et de là, je courrai à Carlsruhe, où est ordinairement Haitzinger, ou bien à Dresde, où le célèbre compositeur Spohr est maître de chapelle et professe des principes autrement généreux que le font les compositeurs de Paris. Alors, il me sera aisé de voir ce que j'ai à faire pour monter mon opéra. Vous me parlez d'hommes de lettres en réputation; mais rien n'est plus inutile. Il n'y en a qu'un, c'est Scribe, qui puisse faire passer une partition. Les directeurs ne font pas plus de cas des autres que s'ils étaient inconnus. J'ai un grand opéra, Atala, qui a été reçu, il y a deux mois, à l'unanimité, sans corrections, ni conditions, par le jury de l'Opéra. Dernièrement, Onslow, qui venait de lire la partition des Francs-Juges que je lui avais prêtée, courut, dans son enthousiasme de jeune homme (quoiqu'il ait 49 ans), chez M. Lubbert, directeur de l'Opéra, lui parler de moi. Il savait qu'Atala était reçu et m'était destiné; il pressa beaucoup Lubbert de me faire jouer, l'assurant que rien n'était ridicule comme les obstacles qu'on me faisait éprouver et qu'il était de son intérêt de les lever. A tout cela, Lubbert se contenta de répondre que beaucoup de gens lui avaient parlé de moi, les uns avec admiration, les autres lui assurant que j'étais fou; d'autres, qu'il n'y avait aucun fond à faire sur moi (entre autres Cherubini, qui n'a jamais entendu de sa vie une note de moi, si on excepte les balivernes de l'Institut défigurées sur un piano); mais que, dans tous les cas, il avait l'intention de m'écrire pour m'engager à ne pas faire la musique d'Atala, parce que, malgré sa réception, il ne voulait pas monter ce poëme, dont il ne voulait pas introduire le genre à l'Opéra. «D'ailleurs, ajouta-t-il, je répète encore ce que j'ai dit déjà tant de fois: il me faut de l'argent; rien ne fait plus d'argent que la musique d'Auber, parce que le peuple l'aime. Ainsi, j'ai assez d'Auber et de Rossini. Beethoven et Weber reviendraient au monde et m'apporteraient des opéras, que je n'en voudrais pas.»
A Feydeau, c'est le dernier degré de la dégradation musicale; ils ne pourraient m'exécuter. Le directeur va faire banqueroute incessamment. Il faut absolument laisser un théâtre nouveau jouer de la musique nouvelle; il faut que cet odieux privilège tombe, et il tombera si, à la Chambre des députés, la demande en est faite. Benjamin Constant et deux autres devaient se charger de la présenter, si la prorogation ne fût survenue. Conçoit-on que les Allemands, les Italiens, tous les étrangers puissent élever des théâtres à Paris pendant une partie de l'année et que les Français, seuls, soient obligés de se faire écorcher à Feydeau, ou de garder leurs partitions, tandis que le théâtre des Nouveautés a un orchestre superbe et des chœurs passables, qu'on emploie à chanter des vaudevilles ou des morceaux tirés des partitions étrangères. Mais il ne faut pas porter ombrage à ce Conservatoire du pont-neuf et de la routine; il faut tout sacrifier pour faire prospérer la ronde, la romance, le duetto; et, malgré la puissance de ces grands moyens musicaux, donner des subventions payées par les provinciaux qui ne vont pas à l'Opéra-Comique, et voir, tous les deux ans, un directeur manquer.
Eh! mon Dieu! laissez-les donc libres tous de jouer ce qu'ils voudront: opéra, grand ou petit; ne donnez point de subventions et laissez-les se ruiner! Cela coûtera moins cher aux contribuables, et les moyens ne manqueront pas, à quelques-uns du moins, de s'enrichir.
Je vous écrirai dans quelques jours pour vous donner des nouvelles de mon affaire, si les répétitions sont commencées.—Adieu, mon cher papa, je vous embrasse tendrement.
A SON PÈRE
Paris, ce 3 novembre 1828.
Mon cher papa,
D'abord, pour vous tirer d'inquiétude, vous saurez que j'ai obtenu un succès d'enthousiasme des artistes et du public, que j'ai couvert les frais du concert et que j'ai gagné.... 150 francs! J'ai mieux aimé ne pas vous parler de ce concert avant de l'avoir donné. Je vous aurais encore trop inquiété. Quoiqu'il m'ait donné beaucoup moins de peine que le premier, néanmoins, après la dernière répétition, je ne pouvais plus me tenir. La fatigue m'accablait. Je ne m'en ressens presque plus. Cherubini s'est contenté cette fois, de ne pas trop me contrarier. Il m'a refusé d'abord, et accordé l'instant d'après, tout ce que je lui ai demandé.
Enfin, le concert a eu lieu. Mon orchestre de cent musiciens a été dirigé par Habeneck. A part quelques fautes qui venaient du défaut de répétitions, mes grands morceaux ont été exécutés d'une manière foudroyante. Il n'y a eu que mon septuor de Faust que je n'ai pas eu le temps d'apprendre aux exécutants et au public.
J'ai été mis à une épreuve effrayante à laquelle je n'avais pas réfléchi. Hiller, ce jeune Allemand dont je vous ai parlé, jouait dans mon concert un concerto de piano de Beethoven, qui est une composition vraiment merveilleuse. Immédiatement après, venait mon ouverture des Francs-Juges. En voyant l'effet du sublime concerto, tous mes amis m'ont cru perdu, écrasé, anéanti, et j'avoue que j'ai éprouvé un moment de crainte mortelle. Mais aussitôt que l'ouverture a été commencée, je me suis aperçu de l'impression qu'éprouvait le parterre et j'ai été complétement rassuré. L'effet a été terrible, volcanique; les applaudissements ont duré près de cinq minutes. Après que le calme a été un peu rétabli, j'ai voulu me glisser entre les pupitres pour prendre une liasse de musique qui était sur une banquette du théâtre (car l'orchestre est sur la scène). Le public m'a aperçu. Alors, les cris, les bravos ont recommencé; les artistes s'y sont mis, la grêle d'archets est tombée sur les violons, les basses, les pupitres. J'ai failli me trouver mal; cette bourrasque inattendue m'a bouleversé. Je tremblais comme vous pouvez le penser; mais vous me manquiez. J'étais seul de la famille dans un tel moment; tout le monde m'embrassait, tout le monde... excepté mon père, ma mère, mes sœurs!
La séance a été terminée par mon chœur du Jugement dernier, qui a produit presque autant d'effet que l'ouverture des Francs-Juges. Je n'avais pas assez de voix; l'orchestre les écrasait.
Quand tout a été fini, que j'ai cru les issues libres, je suis sorti; mais les artistes m'attendaient dans la cour du Conservatoire, et en me voyant passer les cris ont recommencé. Hier soir, à l'Opéra, tous les musiciens sont venus me complimenter, me féliciter. Enfin, j'ai obtenu un grand succès qui m'a complétement satisfait. Le Figaro d'aujourd'hui a rendu compte de mon concert; je vous l'enverrai avec les autres journaux.
Eh bien! depuis hier, je suis d'une tristesse mortelle; j'ai envie de pleurer; je voudrais mourir. Je sens que le spleen va me reprendre plus fort qu'auparavant. Il faut, je crois, que je dorme beaucoup. Je ne puis lier mes idées.
Adieu, mon cher papa, j'embrasse maman, et vous, et mes sœurs, et mon frère.
A M. BERLIOZ, A LA COTE-SAINT-ANDRÉ.
Paris, ce 2 août 1829.
Mon cher papa, j'ai attendu que tout fût terminé pour répondre à la dernière lettre de maman que j'ai reçue à l'Institut, avec la dernière lettre qu'elle contenait. Le jugement a été porté hier: il n'y a point de premier prix ni pour moi, ni pour d'autres.
L'Institut ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à en donner un, l'a réservé pour l'année prochaine, où il pourra en donner deux si bon lui semble. M. Lesueur étant malade n'a pu se mêler de tout cela, et c'est ce qui m'a nui terriblement. Cependant, Cherubini et Auber m'ont soutenu; MM. Pradier, Ingres, grands admirateurs de l'École allemande, ont fait, à la fin de la séance, un long discours où ils ont exhalé toute leur indignation en disant qu'il était inconcevable qu'une telle assemblée prononçât aussi légèrement sur moi dont on connaissait les antécédents et dont on ne pouvait connaître l'ouvrage après une pareille exécution.
En effet, madame Dabadie, qui devait chanter pour moi, a été obligée de me manquer de parole à cause de la répétition générale de Guillaume Tell, qui était à la même heure que le concours de l'Institut. Elle m'a envoyé sa sœur, élève du Conservatoire, qui est d'une inexpérience totale, et qui n'avait eu que quelques heures pour se préparer.
Mais la principale cause de tout ceci est que, d'après la voix publique, le prix m'était destiné. Je me suis cru assez solidement soutenu pour me permettre d'écrire comme je sens, au lieu de me contraindre comme l'année dernière. Le sujet était la Mort de Cléopâtre, qui me paraissait grand et neuf, et que je n'ai pas résisté à écrire... et c'est là mon tort!..
Tous ces messieurs étaient bien disposés pour moi: mais ils ne m'ont pas compris, et pour les musiciens, mon ouvrage a été une sorte de satire de leur manière.
Je viens de rencontrer Boïeldieu sur le boulevard. Il est tout de suite bonnement venu à moi et m'a tenu conversation pendant une heure.
—Oh! mon ami! qu'avez vous fait? nous comptions tous vous donner le prix. Nous pensions que vous seriez plus sage que l'année dernière, et voilà qu'au contraire vous avez été cent fois plus loin en sens inverse. Je ne puis juger que ce que je comprends: aussi, suis-je bien loin de dire que votre ouvrage n'est pas bon; j'ai déjà tant entendu de choses que je n'ai comprises et admirées qu'à force de les entendre! Mais, que voulez-vous? je n'ai pas encore pu comprendre la moitié des œuvres de Beethoven. Vous avez une organisation volcanique au niveau de laquelle nous ne pouvons pas nous mettre.
D'ailleurs, je ne pouvais m'empêcher de dire à ces messieurs hier:—Ce jeune homme, avec de telles idées, une semblable manière d'écrire, doit nous mépriser du plus profond de son cœur. Il ne veut absolument pas écrire une note comme personne. Il faut qu'il ait jusqu'à des rhythmes nouveaux; il voudrait inventer des modulations si c'était possible. Tout ce que nous faisons doit lui paraître commun et usé!...
Voilà la clef de l'énigme pour Catel et Boïeldieu. Auber et Cherubini ont été néanmoins pour moi, par des considérations personnelles; mais ils éprouvaient la même influence de mon ouvrage; Cherubini, toutefois, beaucoup moins que les autres.
Pour les membres non musiciens, ils n'y ont rien compris: c'est comme si on faisait lire Faust à P... L'autre second prix qui concourait avec moi pour le premier, n'a rien eu pour la raison contraire; il était trop plat; il a excité l'hilarité.
Je n'ai pas pu faire la commission de l'alcarazas; quand je suis sorti de la loge, votre caisse de livres était déjà partie.
Je ne puis pas encore aller vous voir. Je veux terminer quelques arrangements avec Feydeau qui me donneront la latitude de demeurer plus longtemps auprès de vous.
Je vous écrirai encore dans peu. Il faut, ce soir, que j'aille passer la soirée chez Boïeldieu. Il me l'a fait promettre pour reprendre notre conversation. Il veut, dit-il, m'étudier.
A M. THÉOPHILE GAUTIER.
Vers 1845 (Sans date).
Mon cher Thé,
Les autres disent Théo, je supprime l'o et ne garde que le Thé; première bêtise!
Je donne un concert; deuxième bêtise!
Faites maintenant la troisième de l'annoncer pour engager le public à faire la quatrième, la plus grosse de toutes, celle d'y venir!
Vous pouvez dans votre feuilleton blaguer à mort sur mon voyage d'Allemagne, puis dire que dimanche 19, au Conservatoire, il y aura Duprez, Massol, madame Dorus-Gras, chantant un grand trio de ma façon; Duprez chantera l'Absence de M. Théophile Gautier, un poète de grande espérance, avec orchestre. J'ai instrumenté ce morceau à Dresde; on ne l'a pas encore entendu à Paris.
Il [y] aura un solo de violon exécuté par Allard, puis l'ouverture du Roi Lear, la symphonie de Harold, le scherzo de la Reine Mab, le finale de la Symphonie funèbre et l'Apothéose, avec les deux orchestres.
Il faut que je prie le jeune poëte de grande espérance de venir à la répétition de samedi, s'il en a le temps, tellement je suis impatient de lui faire entendre le chant de l'Absence, ainsi rendu par l'orchestre de Duprez.
Adieu. Mille amitiés.
A M. LE GÉNÉRAL LVOFF.
Riga, 16/28 mai 1847.
Mille remercîments, général, pour les excellentes recommandations que vous m'envoyez. J'en ai déjà fait usage et la famille du gouverneur m'a accueilli comme un de vos amis. Nous nous occupons du concert, qui ira comme il plaira à Dieu. En attendant ma répétition, qui va commencer dans une heure, il faut que je vous dise encore combien j'ai été frappé des belles choses que contient, en grand nombre, votre dernière partition. Ce sujet d'«Ondine» vous a on ne peut mieux inspiré; et le style harmonique et méthodique de cette grande œuvre brille autant par la vérité de l'expression que par une distinction constante et une fraîcheur juvénile bien rares partout aujourd'hui. L'ouverture est une des plus heureusement trouvées que je connaisse; il y a là des effets de rhythme syncopé qui m'ont fait bondir de joie. Le premier chœur, l'air d'Ondine d'un charmant coloris, le premier final si franc et si chaud, la prière avec accompagnement de violons, le morceau splendide de la fête, le deuxième final, la marche et tant d'autres passages que je pourrais citer, prouvent une invention, un goût et un savoir de premier ordre et vous placent à un rang bien haut parmi les compositeurs actuels. Mais, pour vous tout dire, j'étais sûr de cela avant de vous avoir entendu. Quand on aime et respecte la musique comme vous l'aimez et la respectez; quand on en parle comme vous en parlez et qu'on a la pratique de l'art que vous avez, on doit écrire de la sorte. Tout cela s'enchaîne: tout cela désole aussi, si l'on pense aux moyens d'exécution qui deviennent de plus en plus introuvables. Et je ne sais si cet Anglais qui demandait dans un de nos grands restaurants de Paris un ténor ou un melon pour son dessert avait raison de laisser le choix au garçon. Moi, je demanderai toujours le melon; il y a beaucoup plus de chances avec lui d'éviter les coliques; le végétal est bien plus inoffensif que l'animal.
A M. ERNST[122].
Paris, 8 mai 1849.
Mon cher Ernst,
Je vous remercie de votre lettre, j'étais impatient d'avoir de vos nouvelles. Vous n'êtes pas mort, bon! moi je suis malade d'ennui, de dégoût de Paris et de tout ce qui s'y tripotte; je suis d'une humeur de chien, je voudrais m'en aller et je ne puis pas bouger, et j'ai des feuilletons à faire... ah! les Plaies d'Égypte ne sont rien en comparaison de celle-là. J'avais écrit à Maurice Barnett à votre sujet; le connaissez-vous? Il rédige le Morning Post; c'est un excellent homme. Comment va Halle? et Dawson? et Vivier?... Quel temps! il a plu hier à emporter les maisons! maintenant, il fait presque froid. J'ai mal à la tête, damné feuilleton! je ne le commencerai pas, voici huit jours que je recule, je n'ai pas la moindre idée sur le sujet qui m'est imposé.... Quel métier!... Où trouver du soleil et du loisir? être libre de ne penser à rien, de dormir, de ne pas entendre pianoter, de ne pas entendre parler du Prophète, ni des Élections, ni de Rome, ni de M. Proudhon, de regarder à travers la fumée d'un cigare le monde s'écrouler..., d'être bête comme dix-huit représentants...
Ah! mon Dieu! mon Dieu! quel sacré monde vous nous avez fait là! Vous fûtes bien mal inspiré de vous reposer le septième jour et vous auriez diablement mieux fait de travailler encore, car il restait beaucoup à faire.
Mon cher Ernst, je voudrais vous écrire une lettre bien.... (bien quoi? voyons!) bien... (animal, on n'annonce pas une épithète quand on n'est pas capable de la trouver!) enfin une lettre qui vous fit plaisir, et je vois qu'il faut renoncer à la moindre chance d'y parvenir. (Quelle phrase!) Je ne trouve rien..., mais rien, rien de rien. C'est comme pour mon feuilleton. Ce feuilleton me fera tourner en Cabet! c'est sûr.
Je sors, je vais m'ennuyer dehors, je m'ennuie trop chez moi.
Venez donc un peu à Paris.
Adieu.
P.-S.—J'ai mal à l'estomac; autre chose que j'ai oublié de vous dire. Ah! mon pauvre Ernst, plaignez-moi; les feuilletons me feront mourir.
A M. ÉRARD[123]
Old Cavendish street, Cavendish square, London, 20 avril 1852.
Mon cher Érard,
Je sors de la première répétition du fragment de la Vestale que nous exécutons à notre troisième concert d'Exeter Hall, mercredi prochain 28, à 8 heures.
Les musiciens sont dans un étonnement et une admiration qui ne peuvent se décrire. Et ils étaient venus avec les préjugés hostiles qu'une espèce de faction anti-spontinienne se plaisait à répandre à Londres depuis vingt-cinq ans. Je crois que je vais leur donnera tous une rude leçon. L'effet sera immense; nous avons cent vingt choristes, un orchestre colossal. Staudigl chante le Grand Prêtre, madame Novello, Julia; pour Licinius, j'ai un jeune ténor allemand, Reichart, à qui j'apprends le rôle et qui ira.
Tâchez donc de venir avec madame Spontini assister à ce triomphe vingt fois plus important que ceux obtenus sur le continent. Voir écraser une cabale qui dure depuis un quart de siècle! C'est une joie qui ne se trouve pas souvent.
Venez! venez!
A M. ZACHARIE ASTRUC.
23 mai 1858 (?)
Monsieur,
Permettez-moi de vous remercier pour le bel article que vous venez d'écrire sur mon concert. Je n'ai jamais lu sur mes tentatives musicales rien qui m'ait aussi vivement touché.—Le spectre grimaçant de l'ironie est bien là, comme toujours, pour me siffler à l'oreille: «Ce n'est pas vrai; M. Astruc se trompe et te trompe. Vous êtes des niais tous les deux.» Mais il y a aussi un autre juge qu'il est permis de consulter et qui siège à côté du sens intime. Et quand je demande à celui-là: «Mon critique est-il un niais, suis-je un niais, nous trompons-nous à ce point? L'amour du vrai et du beau est-il une chimère, la passion un leurre, l'enthousiasme une hallucination?...» Le juge me répond: «Non, non, non, non.... et non.»
Vous aimez ce que j'aime, vous honorez et adorez tous mes dieux; voilà pourquoi à la joie d'être loué par vous, se joint un sentiment plus vif, plus profond, plus intense, le fanatisme clairvoyant d'un coreligionnaire.
Voilà pourquoi j'emprunte quelques mots à Shakespeare pour vous dire:
Most noble brother, give me your hand...
A M. STEPHEN HELLER.
Vienne (en Dauphiné). mardi 4 ou 5 septembre
c'est-à-dire mercredi 6 (1865).
Mon cher Heller,
Voilà bien longtemps que je n'ai de vos nouvelles. Pourquoi n'avez-vous pas répondu un mot à ma lettre collective adressée à madame Damcke? Je vous écrivais à tous les trois. Je suis toujours malade et j'ai bien peur de n'apporter qu'une addition d'ennui à celui que vous subissez probablement avec tant de peine.—Mes nièces sont plus charmantes que jamais. Nous lisons beaucoup, elles comprennent tout admirablement et rapidement. Malgré leurs instances pour me garder, je retournerai pourtant à Paris à la fin de la semaine; voulez-vous être assez bon pour prévenir mon concierge que j'arriverai dimanche matin à 6 h. ½ de plus, venez dîner avec moi ce même dimanche; nous serons seuls, car je crois que ma belle-mère ne sera pas encore revenue. Dans tous les cas, si vous venez, faites-le savoir à Caroline, pour qu'elle nous fasse à dîner.
Il fait une chaleur atroce; j'ai un violent mal de tête et j'ai peine à vous écrire.
J'ai reçu, il y a quatre jours, de Genève une lettre qui m'a fait un bien infini et m'a rendu à peu près raisonnable. Il serait bien temps que cela fût et que je pusse vivre de la vie qui m'est propre, sans pourtant souffrir si cruellement de ma lutte insensée contre l'impossible. Cela viendra votre amitié aidant.
Avez-vous composé quelque chose? Vous me direz cela et de quelle manière vous avez tué ce brigand de temps qui nous tue si lâchement.
Adieu, adieu, à dimanche.
A M. SZARWADY.
Paris, 25 février 1866.
Mon cher Szarwady,
Je vous remercie de la peine que vous prenez pour l'édition allemande de mes Mémoires. Je vous autorise à traiter avec M. Heinze et à lui céder la propriété complète de cet ouvrage au prix de 4,000 fr., pas à moins; aux conditions dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de ne le mettre en vente qu'après moi et quand il sera publié à Paris. MM. Heller et Damcke ont rejeté bien loin la tâche de traducteur pour la somme de 500 fr.; en conséquence si vous pouviez vous en charger ce serait au mieux. Mais je tiens à ce que cela soit fait à Paris sous vos yeux. Tenez-moi au courant de ce que vous aurez stipulé avec M. Heinze à Leipzig, mais écrivez un peu plus lisiblement car, malgré tous mes efforts, il y a bien des lignes de votre lettre qu'il m'a été impossible de déchiffrer.
Le concerto de Kreutzer marche bien, nous avons déjà fait quatre répétitions partielles. Madame Massart a invité Mademoiselle Szarwady, qui nous fait espérer qu'elle viendra.
P.-S.—Je ne puis pas vous signaler toutes les parties du livre qui ont paru dans les journaux, le nombre en est trop considérable.
En tout cas, ce qui regarde mon histoire intime n'a jamais paru et le reste a été considérablement augmenté.
A M. HOLMÈS[124].
Saint-Pétersbourg, 1er février 1868.
Mon cher Holmès,
On vous a dit la vérité au sujet des concerts particuliers qui ne pourront commencer qu'en mars. Je donne le dernier qui m'est confié au Conservatoire dans quelques jours. Après quoi, je partirai pour Paris sans en donner un pour moi, malgré les offres des divers artistes qui joueraient gratuitement de bon cœur. Mais je ne puis accepter ces générosités et je suis trop malade; je n'ai plus de force; j'aspire à mon lit, à mon feu, à mon repos absolu; les répétitions me tuent. Vous dépenserez trois fois plus d'argent ici qu'à Berlin et il y a un jeune violoniste, Vuillelmi, qui a joué une fois dans un concert, qui est engagé par la Grande-Duchesse, et qui a un succès fou. On ne parle que de lui. Malgré toutes les offres qu'on me fait pour me garder, je veux repartir; le froid, la neige me chassent; je suis incapable, avec ma santé, de soutenir une telle température. J'ai une répétition ce soir et j'en tremble d'avance. Je n'ose rien vous dire pour votre symphonie. En quelle langue la chanterez-vous? Et qui la chantera?
Pardon de vous écrire avec si peu d'ordre. Je n'ai pas la force de rassembler mes idées. Le voyage de Moscou m'a achevé. Les gens du Conservatoire de Moscou sont venus me chercher, la Grande-Duchesse m'a accordé un congé de douze jours et c'était de l'argent à gagner. J'ai dirigé le premier concert dans la salle immense du manége avec cinq cents musiciens et un auditoire de dix mille six cents personnes. En ce moment, il s'agit de faire marcher, ici, un programme terrible approuvé par la Grande-Duchesse pour ma fin. Le concert qu'on m'eût fait donner pour moi au mois de Mars m'eût retenu ici plus d'un mois; j'aime mieux sacrifier huit mille francs et m'en retourner tout de suite.
Les gracieusetés de tout le monde, des artistes, du public; les dîners, les cadeaux, n'y font rien. Je veux le soleil; je veux aller à Nice, à Monaco.
Adieu, mon cher Holmès, présentez mes hommages à Madame, qui aura bien besoin de courage pour soutenir le vôtre.
Il y a six jours, il faisait 32 degrés de froid. Les oiseaux tombaient; les cochers tombaient de leurs siéges. Quel pays! et je chante l'Italie dans mes symphonies et les sylphes et les bosquets de roses des bords de l'Elbe!!!
FIN
IMPRIMERIE CENTRALE DES CHEMINS DE FER.—A. CHAIX ET Cie. RUE BERGÈRE, 20, A PARIS.—2832 9.
[1] Mémoires de Berlioz, publiés chez M. Calmann Lévy.
[2] Extrait des registres de la mairie de la Côte-Saint-André.
[3] Renseignements communiqués par la famille.
[4] Lettre du 25 juillet 1832. Vente des autographes du chevalier R.....y. 30 novembre 1862.
[5] Mémoires, p. 182.
[6] Grotesques de la musique, p. 279. Édition Michel Lévy. Voyage en France: lettres à Édouard Monnais.
[7] Cette anecdote est insérée dans les Mémoires, mais fort en abrégé. Je la donne telle que je la tiens d'un ami intime, à qui Berlioz l'avait racontée souvent.
[8] Mémoires, p. 21.
[9] Renseignements communiqués par M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul.
[10] Mémoires, p. 37.
[11] Cahier des dépenses de Berlioz; manuscrit autographe communiqué par madame Damcke.
[12] Lettre autographe, vendue par M. Laverdet: 30 mars, 1863.
[13] Voir la lettre XXV adressée à Liszt.
[14] Correspondance de Mendelssohn, traduite par M. A.-A. Rolland, p. 127.
[15]. Voir la lettre XXVII de notre recueil.
[16] Collection de M. le baron de Trimont.
[17] Lettre communiquée par M. Alexis Berchtold.
[18] Mémoires, p. 190, et lettres à son fils.
[19] Voir la Gazette musicale, passim: aux nouvelles de la semaine.
[20] Gazette musicale, année 1835, p. 23.
[21] Le journal la Caricature. Numéro du 16 mai 1841.
[22] Gazette musicale, 26 janvier 1834.
[23] Mio caro amico, Beethoven estinto, non c'era che Berlioz
che potesse farlo revivere; ed io che ho gustalo le vostre divine
composizioni, degne di un genio qual siete, credo mio dovere di pregarvi
a voller accettare in segno del mio omaggio venti mila franchi i quali
vi saranno rimessi dal signor baron de Rothschild, dopo che gli avrete
presentato l'acclusa. Credete mi sempre, il vostro affetionatissimo
amico.
Nicolo Paganini.
Parigi, le 18 décembre 1838.
[24] Gazette musicale, année 1838.
[25] Gazette musicale, année 1836, p. 73.
[26] Gazette musicale, p. 39, année 1836.
[27] Gazette musicale, année 1838, p. 242.
[28] Ibid., p. 275.
[29] Gazette musicale, année 1842, p. 86.
[30] Ibid., année 1843, p. 169.
[31] Ibid., p. 115.
[32] Collection de madame Vieweg de Brunswick. Ce billet a été reproduit dans la nouvelle édition de l'ouvrage du docteur Nohl: Musiker Briefe, p. 74, Leipzig, Dander et Humblot, 1873.
[33] Gazette musicale, année 1843, p. 348.
[34] Gazette musicale, année 1844, p. 167.
[35] Ibid., année 1840, p. 179.
[36] Ibid., année 1845, p. 411.
[37] Gazette musicale, année 1847, p. 294
[38] Ibid., p. 403.
[39] Gazette musicale, année 1848, p. 58.
[40] Voici la distribution des personnages: la sainte Vierge, madame Meillet.—Saint Joseph, M. Meillet.—Hérode, Depassio.—Père de famille, Battaille.—Un récitant, Jourdan.—Un centenier, Chapron.—Polydorus, M. Noir.—Le trio des flûtes était joué par MM. Brunot, Magnier et Prumier.
[41] Gazette musicale, année 1855, p. 171.
[42] Lettre à M. Auguste Morel, datée de Francfort.
[43] Gazette musicale, année 1857, p. 286.
[44] Renseignements communiqués par M. Édouard Alexandre.
[45] Gazette musicale, année 1856, p. 202.
[46] Renseignements fournis par madame d'Ortigue.
[47] Lettre de M. Asger Hammerik à l'auteur de la Notice.
[48] Lettre à son fils, du 7 septembre, sans autre mention.
[49] Lettre inédite à son fils, datée de Bade, 23 août.
[50] Lettre du 13 novembre 1865.
[51] Lettre inédite.
[52] Anecdote racontée par Berlioz lui-même à l'auteur de cette biographie.
[53] Il s'agit sans doute d'un pot-pourri sur des opéras italiens; Berlioz avoue en avoir composé plusieurs de ce genre (Voir les premiers chapitres des Mémoires). Cette lettre a été publiée dans le Musiciana de M. Wekerlin.
[54]La date de cette lettre est assez difficile à préciser. La Mort d'Abel, dont il est question, fut jouée en 1810 et n'eut jamais les honneurs d'une reprise. Sans doute, Berlioz avait entendu seulement quelques fragments de cet opéra. Comme il signe sa lettre: H. Berlioz, élève de Lesueur, et qu'il entra dans la classe de ce maître en 1826 pour y rester jusqu'en 1828, on ne peut guère assigner au curieux document que nous reproduisons qu'une date approximative.
[55] La Revue musicale, dirigée par M. Fétis, n'avait pas encore opéré sa fusion avec la Gazette musicale de Schlesinger, fondée, comme nous l'avons dit dans la notice, en 1834.
[56] Le ballet de Faust sur un livret de M. Bohain: voir la Notice
[57] Robert le Diable, dont la première représentation eut lieu le 21 novembre de la même année.
[58] M. Gounet est le poëte qui a traduit en vers français les paroles de Thomas Moore sur lesquelles Berlioz a écrit de la musique.
[59] La romance de la Captive.
[60] Tout ce qui suit est relatif au mariage de Berlioz avec mademoiselle Henriette Smithson, qu'il épousa dans le courant de l'année 1833.
[61] Ce projet n'a été exécuté que vingt-neuf ans plus tard Béatrice et Bénédict, opéra joué à Bade en 1862, est écrit sur la comédie de Shakspeare Much ado about nothing.
[62] Cette représentation fut désastreuse: madame Dorval eut tout le succès, et l'infortunée Harriett Smithson put se convaincre que le public parisien ne s'intéressait plus à elle.
[63] L'opéra de Benvenuto Cellini.
[64] Cette brochure, adressée par Spontini aux membres de la Chambre des députés, fut discutée en séance publique. M. Monnier de la Sizeranne en soutint les conclusions, qui furent rejetées après un discours de M. Taschereau.
[65] Rossini habitait alors Bologne.
[66] La Vendetta, opéra en trois actes, qui n'eut qu'un petit nombre de représentations.
[67] Mademoiselle de Belle-Isle.
[68] On remarquera que, malgré l'hostilité avouée de Mendelssohn, Berlioz a toujours rendu justice à cet admirable musicien et qu'aucun mauvais procédé n'a pu le faire changer d'avis à cet égard.
[69] Violoncelliste à l'Opéra.
[70] Collection de madame Vieweg, de Brunswick.
[71] Célèbre compositeur russe, auteur de l'opéra: la Vie pour le czar, de Rousslane et Lioudmila, de nombreuses romances, etc.
[72] Publiée dans le livre de M. Wekerlin. Musiciana. Paris, 1877.
[73] La première audition de Moïse au Sinaï, oratorio de Félicien David, exécuté à l'Opéra, le 21 mars 1846.
[74] Cette affaire est racontée en entier chapitre LVII des Mémoires; nous y renvoyons le lecteur, ainsi qu'à la lettre de MM. Duponchel et Roqueplan, publiée dans notre Notice.
[75] M. Tajan-Rogé faisait partie de l'orchestre du théâtre impérial de Saint-Pétersbourg.
[76] Nous ne garantissons pas l'authenticité de l'anecdote, qui ressemble fort à un cancan musical. Ajoutons qu'il nous est impossible de prendre la responsabilité des opinions de Berlioz, qui sont, presque toujours, violentes, et quelquefois même injustes. (Note de l'éditeur.)
[77] Jérusalem, opéra représenté en novembre 1847 à l'Académie royale de musique de Paris.
[78] Auteur de l'hymne national russe, directeur pendant vingt-cinq ans de la chapelle impériale des chantres de la cour à Saint-Pétersbourg, violoniste distingué, auteur de l'opéra d'Ondine dont il est parlé dans la lettre. Cet opéra fut représenté pour la première fois à Vienne en 1846 en langue allemande et en langue russe à Saint Pétersbourg en 1848. Nous devons la lettre à M. Lwoff et en général toutes les lettres adressées à des personnages russes à l'obligeante bonté de M. Wladimir Stassoff, qui occupe une haute position à la Bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg.
[79] Éditeur de musique à Londres.
[80] Le comte Michel Wielhorski, grand échanson à la cour de Russie, amateur de musique et connaisseur distingué.
[81] Beethoven et ses trois styles, par M. Guillaume Lenz. Ce beau livre n'a été publié qu'en 1852.
[82] Le libretto de M. de Saint-Georges se trouve dans la bibliothèque du château de Romany, près Kowno, en Lithuanie; ce libretto n'a jamais été mis en musique par M. Lwoff, mort en 1870. (Renseignements communiqués par M. Wladimir Stassoff.)
[83] De la Société philharmonique de Paris, rue de la Chaussée-d'Antin. (V. la Notice.)
[84] Le Juif errant d'Halévy.
[85] Dans la scène intitulée: Tristesse de Roméo.
[86] L'excellent ouvrage dont il est question ici a pour titre: De quelques points des sciences dans l'antiquité: physique, métrique, musique. A plusieurs reprises, H. Berlioz est revenu à la charge; la métrique, la poésie et la musique des anciens l'intéressaient vivement; il songeait à ses Troyens! Quelques années après cette première lettre, il écrirait à M. B. Jullien, père de M. Ad. Jullien, le jeune et savant critique auquel on doit déjà tant de travaux, tels que la Cour et l'Opéra sous Louis XVI, Airs variés, etc.: «Malgré vos efforts, j'ai bien peur que la France ne reste barbare et que le sens harmonique des langues anciennes ne lui reste interdit...» Et, le 20 avril 1867: «Permettez-moi de vous demander si vous êtes d'avis, comme tout porte à le croire, que les anciens ne prononçaient pas, dans les vers, les syllabes élidées. J'espérais trouver dans votre livre excellent un chapitre spécial sur ce sujet et je n'y trouve que l'exemple de l'élision d'une fin de vers lacertosque, avec le début d'un autre: Exuit...; vous ne dites pas qu'on prononçât membror artus, magn'orsa; et sans cela pourtant il n'y a point d'élision et le vers a deux syllabes de trop.»
[87] Berlioz venait de perdre sa première femme: Henriette Smithson, mère de Louis Berlioz.
[88] Analyse de la Damnation de Faust dans la Gazette musicale.
[89] M. Tajan-Rogé habitait alors la Nouvelle-Orléans.
[90] Du Te Deum.
[91] Le père de l'excellent pianiste, Théodore Ritter et de mademoiselle Cécile Ritter; la famille Bennet est d'origine marseillaise.
[92] Après la représentation de Médée, avec madame Ristori.
[93] Auteur des ouvrages: De la musique religieuse et de la connaissance pratique des grandes orgues (au collège de la Paix, à Namur).
[94] La partition des Troyens.
[95] Berlioz n'en était encore qu'à la première partie de son opéra: la Prise de Troie, c'est-à-dire celle qui n'a jamais été jouée et que nous ne connaissons pas.
[96] M. Auguste Morel souffrait d'une maladie d'yeux.
[97] Chacun sait que ce n'est pas un Romain, mais Archias, tyran de Thèbes, qui prononça cette fameuse phrase, au milieu d'un repas. Nous avons cru, par excès de scrupule peut-être, devoir respecter le lapsus calami de Berlioz.
[98] P. Scudo, dont il est question dans la Notice.
[99] M. Alexis Bertschtold, dont il a déjà été question plusieurs fois.
[100] Berlioz, comme on l'a vu par les lettres précédentes, était préoccupé au sujet de son fils, et M. Morel l'avait rassuré en lui apprenant l'arrivée à Marseille du navire sur lequel était Louis Berlioz.
[101] Sa seconde femme.
[102] Roméo et Juliette de Bellini, traduit en français par M. Nuitter pour les débuts de madame Vestvali et joué à l'Opéra le 7 septembre 1859.
[103] M. Walewski.
[104] Écrite le lendemain de la première représentation du Tannhäuser.
[105] Berlioz venait de perdre sa seconde femme décédée à Saint-Germain en Laye.
[106] C'était M. Édouard Monnais qui écrivait sous ce pseudonyme dans la Gazette musicale. Il avait fait un article très bienveillant sur le livre intitulé A travers chants. L'apostrophe de Berlioz l'émut beaucoup; il chercha vainement le mot à double détente qui avait excité les susceptibilités de son ami; il ne le trouva pas. Nous l'avons cherché, nous aussi, ce mot terrible; nous ne l'avons pas découvert non plus.
[107] Il s'agit de la première représentation de l'opéra de Béatrice et Bénédict.
[108] Les Troyens.
[109] M. A. Lwoff était devenu sourd.
[110] Communiquée par M. Bouscatel, d'Auxerre.
[111] Il avait été nommé officier de la Légion d'honneur le 12 août; il était chevalier depuis 1839.
[112] Lettre publiée par M. Xavier Feyrnet, dans le Temps du 15 mars 1865.
[113] Cette lettre, si peu datée, est du 22 mars.
[114] Pour l'intelligence de cette lettre énigmatique, nous sommes obligé de renvoyer le lecteur au dernier chapitre des Mémoires où toutes les explications nécessaires lui seront données.
[115] Intitulé les Royautés musicales.
[116] C'est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à l'extrême complaisance de M. Stassoff que nous devons toutes les lettres de ce recueil, adressées à des correspondants Russes.
[117] Perrot, dans l'original; nous ne connaissons point de sculpteur de ce nom-là, à l'Institut.
[118] Inspecteur de la musique dans les théâtres impériaux.
[119] Excellent critique et compositeur russe.
[120] Chef d'orchestre et compositeur de talent.
[121] Communiquée ainsi que ces trois suivantes par M. de Colongeon.
[122] Communiquée par M. Émile Laurent.
[123] Communiquée par madame Érard.
[124] Communiquée par M. B. de Fourcaud.
CALMANN LÉVY, ÉDITEUR
——
DE
——
format grand in-18.
——
| a travers chants | 1 | vol |
| les grotesques de la musique | 1 | — |
| mémoires, comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre 1803-1865. | 2 | — |
| les soirées de l'orchestre | 1 | — |
————
imprimerie centrale des chemins de fer.—a. chaix et cie
rue bergère, 20, a paris.—578-8.